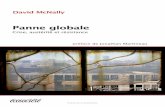restitution du plan du théâtre gallo-romain du sanctuaire Éduens de la Genetoye à Autun
L'autorité du présent. Essai de reconstruction du concept de charisme de fonction
Transcript of L'autorité du présent. Essai de reconstruction du concept de charisme de fonction
L'AUTORITÉ DU PRÉSENT. ESSAI DE RECONSTRUCTION DUCONCEPT DE CHARISME DE FONCTION Jean-Philippe Heurtin P.U.F. | L'Année sociologique 2014/1 - Vol. 64pages 123 à 169
ISSN 0066-2399
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-l-annee-sociologique-2014-1-page-123.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Heurtin Jean-Philippe, « L'autorité du présent. Essai de reconstruction du concept de charisme de fonction »,
L'Année sociologique, 2014/1 Vol. 64, p. 123-169. DOI : 10.3917/anso.141.0121
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour P.U.F..
© P.U.F.. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 122 / 256
- © PUF - 20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 123 / 256
- © PUF -
L’Année sociologique, 2014, 64, n° 1, pp. 123-169
L’AUtOrItÉ dU prÉSENt. ESSAI dE rECONStrUCtION dU CONCEpt dE ChArISmE
dE fONCtION
Jean-philippe heurtin
résumé. – le propos de cet article est de revenir sur le concept de « charisme de fonction », tel que max Weber l’a introduit dans sa Sociologie des religions. la conceptualisation qu’en propose Weber semble toutefois inachevée, et utilisée seule-ment pour caractériser une forme de dégénérescence du charisme personnel, et, plus précisément, comme la forme que prend le charisme quand il se quotidiennise. la discussion de cette hypothèse suppose de revenir aux sources utilisées par Weber, à savoir l’ouvrage de rudoph sohm, Kirchenrecht, paru en 1892. c’est chez sohm que Weber a puisé la paire opposée du charisme personnel et du charisme de fonction. le contexte de la parution de Kirchenrecht est un contexte luthérien, et il semble que Weber, dans l’interprétation et la sécularisation qu’il opère de la notion de charisme, est resté prisonnier des ces attendus luthériens ; ils l’ont, en particulier, empêché de penser véritablement, et de façon autonome, le « charisme de fonction ». mais, le livre de sohm n’a cessé d’alimenter aussi la réflexion des catholiques sur la question du charisme ; elle les a amenés, en particulier, à redécouvrir la dimension pneuma-tique dans leur théologie de l’église et des ministères. la question qui s’ouvre, dès lors, est celle de savoir si la théologie catholique, et plus précisément son ecclésio-logie, ne peuvent pas permettr4e de penser autrement le charisme, en particulier dans son rapport à l’institution – de sorte que cette ecclésiologie serait porteuse d’un possible latéral pour la sociologie du charisme. il s’agit donc, dès lors, de découvrir comment on peut, à la lumière de la réflexion catholique, reconstruire un concept alternatif de charisme de fonction.
mots-clés. – Bureaucratie ; charisme ; légitimité légale-rationnelle ; théologie ; Weber.
abstract. – the purpose of this article is to reconsider the concept of “charisma of function”, such as max Weber introduced it in his Sociology of religion. the conceptualization that Weber proposed of it seems however unfinished, and used only to characterized a kind of degeneration of personal charisma, and more
L’autorité du présentJean-Philippe Heurtin
123-169
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
Jean-Philippe Heurtin124
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 124 / 256
- © PUF - 20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 125 / 256
- © PUF -
precisely, as the shape that takes charisma when routinized. the discussion of this assumption supposes to return to the sources used by Weber, namely the book of rudoph sohm, Kirchenrecht, published in 1892. it is in sohm that Weber drew the opposite pair of personal charisma and charisma of function. But, the context of the publication of Kirchenrecht is a lutheran one, and it seems that Weber, in its interpre-tation and the secularization which he operates of the concept of charisma, remained prisoner of these lutheran reasoning; it, in particular, prevented him from properly and autonomously conceptualising the “charisma of function”. But, sohm’s work did not cease also feeding the reflection of the catholics on charisma; it led them, in particular, to rediscover the pneumatic dimension in their theology of the church and ministries. the question which now, consequently, remains open is that to know if catholic theology, and more precisely catholic ecclesiology, cannot make it possible to think the charisma differently, in particular in his relation to the institution – so that this ecclesiology would be carrying a lateral possibility for the sociology of charisma. the question is thus to discover whereas one can reconstruct, in the light of the catholic reflection, an alternative concept of the charisma of function.
Keywords. – Bureaucracy; charisma; legal-rational legitimac; theology; Weber.
le propos de cet article est de revenir sur le concept de « charisme de fonction » (ou de « charisme de l’office »1), tel que max Weber l’a introduit, pour l’essentiel, au début du chapitre xi de la iiie partie d’Économie et société, intitulé « l’état et la hiérocra-tie » (Weber, 1996c)2. À dire vrai, ce concept apparaît largement énigmatique, tant Weber l’a laissé, en quelque sorte, à l’état d’ébau-che, quand, par contraste, le charisme personnel faisait l’objet, on le sait, d’amples développements. le charisme de fonction a été, semble-t-il, principalement utilisé pour signifier un développement du charisme personnel, et, plus précisément, la forme que prend ce dernier type de charisme quand il se quotidiennise. ce type de charisme de fonction, second donc, ne saurait ainsi être compris que par référence au type « pur » du charisme personnel, comme son double dégradé ; et la caractérisation de ces deux types de charisme cherche à cerner la nature de l’autorité ayant cours au sein d’une autre paire conceptuelle opposée, celle de la secte et de l’église. nous souhaiterions discuter cette description théorique. la manière que nous avons choisie pour ce faire est de revenir à la racine de la conceptualisation wébérienne du charisme. ce que l’on voudrait
1. voir également Weber, 1972, pp. 775-776. nous préfèrerons la traduction de « charisme de fonction » à celle de « charisme de l’office », dans la mesure où nous traitons, pour l’essentiel, du christianisme ancien. or, il faut attendre sans doute le ive siècle et le De officiis ministrorum d’ambroise, pour voir introduit dans l’ecclésiologie chrétienne le vocabulaire de l’office.
2. Weber fait également référence de manière plus ponctuelle à ce charisme de fonction dans Le Judaïsme antique (Weber, 1970).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 124 / 256
- © PUF -
125L’autorité du présent
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 125 / 256
- © PUF -
faire apparaître, en effet, c’est que cette conceptualisation est dépen-dante d’une source particulière, en l’occurrence, de deux ouvra-ges de rudoph sohm, Kirchengeschichte im Grundriss de 1887, et Kirchenrecht, écrit en 1892, et de la controverse qu’a fait naître leur publication. c’est dans ces deux ouvrages que ce juriste et théolo-gien allemand a élaboré une théorie de l’essence du christianisme primitif qui met essentiellement l’accent sur une dimension spiri-tuelle opposée à toute institutionnalisation : l’ecclésia chrétienne originaire aurait d’abord été animée par le charisme personnel d’un certain nombre d’enseignants, dont l’origine se trouverait dans la grâce divine qui leur a été accordée. mais, – et c’est le cœur de l’his-toire critique de la catholicisation de l’église retracée par sohm –, cette église spirituelle originaire se serait progressivement constituée et juridicisée, aurait autonomisé et spécialisé des fonctions ecclé-siales, et institutionnalisé le charisme – ce qui constituait une véri - table contradictio in terminis dans la perspective de l’auteur dont l’œuvre de canoniste tout entière voulait précisément montrer l’inadéquation essentielle entre grâce et institution.
c’est donc chez sohm que, de manière tout-à-fait explicite, Weber a puisé la paire opposée du charisme personnel et du charisme de fonction. Weber le cite, en effet, deux fois dans Économie et société, comme étant la source du concept de charisme :
« le concept de “charisme” (“grâce”) est tiré de la terminologie du christianisme ancien. rudolph sohm, dans son Kirchenrecht, a, le premier, éclairci le concept de hiérocratie chrétienne, selon le fait si ce n’est selon la terminologie3. » (Weber, 1971, p. 222).
fort curieusement, rares ont été les chercheurs et les commen-tateurs de Weber qui ont cherché à éclairer cette référence, et à en analyser les enjeux4. or, ce que nous voulons analyser dans cet article, c’est précisément les conséquences de cette origine pour la formation du concept, la délimitation de son contenu, mais égale-ment les limites qu’elle lui impose.
il n’est pas possible de restituer entièrement ici la complexe controverse qui, pendant plusieurs décennies, a opposé historiens et théologiens allemands, à propos des livres de sohm. il s’agit, on voudrait y insister, d’un débat interne au protestantisme luthérien allemand, et l’hypothèse que nous allons développer, est que Weber,
3. voir également Weber, 1972, chapitre xiv, p. 655.4. on peut, toutefois, citer turner et factor (1994), mais également riesebrodt
(1999) ; hatscher (2000) ; Kroll (2001).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
Jean-Philippe Heurtin126
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 126 / 256
- © PUF - 20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 127 / 256
- © PUF -
dans l’interprétation et la sécularisation qu’il opère de la notion de charisme, est resté prisonnier des attendus luthériens de la contro-verse ; ils l’ont, en particulier, empêché de penser véritablement ce que dans sa Sociologie des religions, il appelle – à la suite de sohm, au demeurant – le « charisme de fonction ». or, la réflexion de sohm n’a cessé d’alimenter aussi la réflexion des catholiques sur la question du charisme ; elle les a amenés, en particulier, à redécou-vrir la dimension pneumatique dans leur théologie de l’église et des ministères. la question qui s’ouvre, dès lors, est celle de savoir si la théologie catholique, et plus précisément son ecclésiologie, ne peuvent pas permettre de penser autrement le charisme, en parti-culier dans son rapport à l’institution – de sorte que cette ecclé-siologie serait porteuse d’un possible latéral pour la sociologie du charisme. cet article vise ainsi en premier lieu à découvrir quelle conséquence pour la sociologie wébérienne du charisme aurait eu une véritable prise en compte de la réflexion catholique sur l’articu-lation de l’esprit et de l’institution, et comment, en deuxième lieu, on peut, à sa lumière, reconstruire un autre concept de charisme de fonction ; en troisième lieu, nous proposer l’hypothèse que le concept de charisme de fonction ainsi reconstruit permettrait de lever un certain nombre des embarras théoriques de la fondation de la légitimité légale-rationnelle.
L’Église comme réalité essentiellement pneumatique
La conception anti-institutionnelle de l’Église chez Sohm
si l’on prend au sérieux l’idée d’une origine du concept wébérien de charisme chez sohm, il convient tout d’abord de revenir à son œuvre de canoniste5. le centre de sa démonstration, plus qu’une analyse proprement historique, emporte une option théologique sur l’essence de l’église : pour lui, l’église est une réalité essentiellement spirituelle ; elle ne peut s’inscrire adéquatement dans des institutions mondaines. c’est bien ce que sohm affirme dès la première page de son Kirchenrecht :
« l’essence de l’église est spirituelle […]. l’église sera conduite, dirigée par la puissance de l’esprit divin. » (sohm, 1892, p. 1).
5. l’œuvre importante de sohm ne se limite pas au droit canon. celui-ci reste d’abord un romaniste et un historien des droits germaniques.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 126 / 256
- © PUF -
127L’autorité du présent
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 127 / 256
- © PUF -
c’est en ce sens que l’on peut dire que l’église est invisible, et qu’elle n’appartient pas au monde. l’église comme réalité pratique naît quand des personnes croient, et qu’elles s’assemblent : « là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » (mat 18 : 20). et,
« là où est le christ, là est l’église. […] l’église, le peuple de dieu, signifie un peuple spirituel ; le royaume qui est établi dans l’église est un royaume spirituel ; la chrétienté ne forme pas un état, pas plus qu’une association politique, mais un pouvoir spirituel. » (sohm, 1887, p. 27).
dans le sillage de paul, en particulier dans son épître au corinthiens, ce qui, pour sohm, fait église, c’est l’esprit ; un esprit qui se manifeste dans des dons :
« dieu, c’est-à-dire le christ, conduit et lie ensemble tous les membres de la chrétienté par les seuls dons de la grâce (charismata) qu’il donne. » (sohm, 1887, p. 26).
et ce qui, à proprement parler, lie ces individus, c’est la reconnais sance de l’intervention de dieu dans le charisme des autres. l’élection, dans ce cadre, se laisse lire comme ayant valeur de désignation par dieu, et reconnaissance de cette désignation :
« le charisme n’exclut pas l’élection, et réciproquement ; l’élection ne signifie pas appel sans charisme. au contraire, l’élection est attestation, reconnaissance du charisme. » (sohm, 1892, p. 51).
la communauté se soumet au charisme dans l’amour, mais l’obéissance est en quelque sorte impersonnelle : on obéit à la parole de dieu, reconnue dans celui qui la porte.
« le peuple de dieu, l’ecclésia doit être conduite, non par le verbe de l’homme, mais par le verbe de dieu proclamé par ceux qui ont reçu divinement le don d’enseigner ; et l’ecclésia obéit au verbe de celui qui enseigne si et seulement si il y reconnaît le verbe de dieu. » (sohm, 1892, p. 26).
ce fait montre que ces porteurs de charisme n’ont pas de pouvoir juridique pour parler avec autorité. on a affaire à une obéissance sans contrainte : une obéissance libre, dit sohm, sans autorité légale (sohm, 1892, p. 27) – ce point est évidemment essentiel, nous y reviendrons. seul peut accomplir un ministère de direction celui que est directement appelé par dieu, celui qui est armé de l’esprit, donc charismatique. il prend ses décisions par l’esprit, et n’est pas astreint
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
Jean-Philippe Heurtin128
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 128 / 256
- © PUF - 20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 129 / 256
- © PUF -
à l’observation de prescriptions juridiques. il ne peut y avoir donc de « fonction » dans l’église :
« le gouvernement de l’ecclésia vient d’en haut au travers de la personnalité individuelle élue par dieu. » (sohm, 1892, p. 54).
il y a bien toutefois place pour une autorité dans le charisme, et l’organisation de l’église est à la fois de type monarchique et autoritaire :
« là ne règne aucune égalité abstraite entre tous les membres de la communauté chrétienne. […] là c’est la supériorité et la subordination qui sont de mise, et, certes, une supériorité et une subordination voulue par dieu, en fonction des dons que dieu a distribué à chacun pour le service de la chrétienté. le charisme exige la reconnaissance et exige l’obéissance à ceux que l’on désigne comme chef, comme dirigeant, ou comme administrateur. aussi le gouvernement dans la chrétienté est-il un gouvernement en vertu du charisme, en vertu d’une mission confiée par dieu en vue du règne. » (sohm, 1892, p. 26).
tout l’enjeu du travail de sohm apparaît ainsi précisément dans la compréhension du paradoxe d’une autorité spirituelle dont la reconnaissance et le fait de s’y soumettre relève d’une liberté.
cette option sur l’essence de l’église, implique donc qu’
« au lieu de loi, on trouve l’enseignement de la parole du seigneur, qui doit également régler l’organisation et la vie du christianisme. […] mais cet enseignement est l’affaire de celui qui a reçu le don d’enseigner, et qui en vertu de son charisme proclame autoritairement la parole du seigneur et les conséquences que l’on doit en tirer. » (sohm, 1892, p. 25 ; p. 29. nous soulignons).
la conséquence principale, et qui constitue ce que l’on retient habituellement de la démarche de sohm, est qu’« une fois pour toute, une église légalement constituée ne peut pas être » (sohm, 1892, p. 28). l’église et le droit, l’église et le ministère canonique-ment réglé sont aux antipodes l’un de l’autre :
« il ne peut y avoir aucune constitution légale et aucun pouvoir juridique de législation dans l’ecclésia. tirée du verbe divin, l’enseignement apostolique, en vérité, de la constitution de l’ecclésia affirme que l’organisation de la chrétienté n’est pas juridique, mais qu’elle est une organisation charismatique. » (sohm, 1892, p. 26).
si la nature de l’église est déterminée par la conduite de l’esprit, seul un ordre directement imposé par l’esprit y est possible
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 128 / 256
- © PUF -
129L’autorité du présent
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 129 / 256
- © PUF -
(« on ne reconnaît pas la parole de dieu à une forme quelconque, mais à sa puissance intérieure. [...] l’opération de l’esprit divin est libre de toute forme. le charisme conféré par dieu envahit seulement celui qui est saisi de l’intérieur. » (sohm, 1892, p. 23 ; p. 56)).
or, « le droit est mondain » (sohm, 1892, p. 1), de sorte que – et c’est la phrase, répétée deux fois, et la plus célèbre, dans Kirchenrecht – :
« le droit de l’église est en contradiction avec l’essence de l’église. » (sohm, 1892, p. 1 et p. 700).
« le christianisme est venu dans ce monde, supraterrestre, supramondain […], monde du spirituel qui plane au-dessus du monde terrestre et l’illumine. […] mais ce monde du spirituel ne peut pas être conçu juridiquement. Bien davantage, son essence est contraire à l’essence du droit. l’essence spirituelle de l’église exclut tout ordre juridique ecclésial. c’est en contradiction avec l’essence de l’église qu’on en est venu à constituer un droit de l’église. » (sohm, 1892, p. x).
Une controverse interne au protestantisme sur l’institutionnalisation de l’Église
la publication du Kirchenrecht s’inscrit dans un contexte histo-rique particulier, marqué par la fondation officielle de l’église évangélique allemande, en 1817 – le roi frédéric-Guillaume iii de prusse souhaitant ainsi réunir les églises réformées et luthériennes au moment où elles tentaient de rompre les liens avec l’état en affir-mant leur droit à la dissidence –, et par le Kulturkampf des années 1875, où les tensions entre catholiques et protestants se sont trouvées exacerbées. de ce point de vue, les positions de sohm peuvent se laisser interpréter, à partir de présupposés dogmatiques luthériens, contre l’institutionnalisation des églises menée par le pouvoir poli - tique et, symétriquement, comme un plaidoyer pour une ecclésio-logie construite sur la base de la personne individuelle du croyant. la foi est affaire individuelle, la base du rassemblement des croyants est profondément individualiste : comme l’a souligné sohm, « le présupposé fondamental de la conception de l’église [ancienne] », c’est « l’individualisme religieux absolu » (sohm, 1892, p. 36). la conception « spiritualiste » de l’église que sohm pensait retrouver historiquement dans le christianisme primitif, s’enracine, en même temps, dans l’invisibilité comme caractéristique fondamentale de la compréhension luthérienne de l’Église : l’église est d’abord et essen-tiellement, comme on a vu sohm l’affirmer, « corps mystique du
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
Jean-Philippe Heurtin130
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 130 / 256
- © PUF - 20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 131 / 256
- © PUF -
christ ». enfin, l’accent mis sur le prophétisme propre à l’église ancienne, renvoie aussi à la composante eschatologique, soulignée par Weber, propre au luthéranisme (Weber, 1996a, p. 270) – une eschatologie purement individuelle. il y a clairement, chez sohm, l’idée obsidionale d’une parenté spirituelle entre l’époque primitive et la réforme : le refus systématique de toute institution et de toute organisation, laisse la place, sur le modèle de l’apostolat de paul, à une mission prophétique de rassemblement eschatologique propre au protestantisme6.
toutefois, et l’on retrouve ici l’origine de l’idée de « quotidien-nisation du charisme », l’église existe bel et bien comme commu-nauté et comme institution, et de manière hautement visible. sohm entreprend d’expliquer ce phénomène, et propose ainsi une forme d’histoire naturelle de la transformation de l’ecclésia en église catholique :
« le christianisme primitif voulait faire de la loi de la vie religieuse la loi même de la vie sociale. que cela dusse prévaloir sur le long terme, a entrainé une exigence de juridicisation de la vie ordinaire et de formalisation de la vie religieuse, c’est-à-dire une catholicisation, et donc une déformation du christianisme. » (sohm, 1892, p. 57).
son explication est d’ordre anthropologique : l’homme naturel désire rester sous l’empire de la loi. il renâcle face à la liberté de l’appel de dieu. et il appelle, dans le domaine spirituel, des lois et des statuts. l’église comme rassemblement au nom de dieu est non naturelle : « l’homme naturel est un catholique-né. » dans le premier chapitre de Kirchenrecht, sohm décrit l’institutionnalisation de l’église, c’est-à-dire, sa catholicisation : autour des années 60, il y aurait eu deux organisations concurrentes au sein de l’ecclésia ; une organisation de l’enseignement appuyée sur des charismes ; une organisation de la direction de la communauté, qui présente une figure juridique et des organes de gouvernement. l’organisation juridique n’aurait concerné que les communautés locales, et sohm peut donc affirmer que
« dans les temps anciens, c’est seulement la communauté particulière qui se présente comme organisée, et non l’église » (sohm, 1892, p. 12).
6. depuis le chiliasme piétiste au xviiie siècle, le protestantisme avait renoué avec le prophétisme en même temps qu’avec la question eschatologique fondamentale de la rédemption. sur ce point voir Barth, 1969, p. 70.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 130 / 256
- © PUF -
131L’autorité du présent
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 131 / 256
- © PUF -
progressivement les deux organisations se seraient fondues, et l’épiscopat serait devenu, à partir du milieu du iie siècle, un ministère de l’église, et non plus seulement de la communauté, un Kirchamt. la constitution légale de l’église se serait développée, selon lui, « au début du iie siècle », quand « la croyance dans l’exercice libre de la grâce a déclinée » (sohm, 1887, p. 28) :
« l’église avait changée, non pas simplement sa constitution, mais sa foi. la communion personnelle avec le christ est le secret et le pouvoir de sa vie chrétienne. cette communion avec le christ et avec dieu est désormais dépendante de formes et de conditions extérieures. c’est cela l’essence du catholicisme. la dépendance envers un organisme extérieur, représenté par l’évêque et les presbytres, est la nouvelle loi qui a lié chaque chrétien. l’ecclésia, l’église, le peuple de dieu ne se trouvera plus que là où les officiels, les évêques et les presbytres apparaissent. l’église n’est plus fondée sur la communion des croyants, en tant que tels, mais sur l’office qui est désormais indispensable aux relations de l’église avec le christ. la chrétienté, le corps du christ, l’ecclésia, a désormais une constitution définie, légale […]. et quiconque veut appartenir au christ, doit appartenir à cette église légale et visible, qui est le fondement de tout le catholicisme. » (sohm, 1892, p. 30).
la « catholicisation » de l’ecclésia – que sohm décrit comme une véritable catastrophe spirituelle – a d’abord consisté en sa consti-tution juridique :
« au lieu de l’obéissance de la foi qui est fondée sur la conviction intérieure de la vérité divine, à tous les niveaux d’organisation de l’église a surgi, pour des raisons extérieures, l’exigence d’une obéissance à la loi. entre les mains du catholicisme, ce qui était communauté spirituelle est devenu une communauté juridique, ce qui était corps du christ est devenu un corps constitué et régi par un pouvoir terrestre. » (sohm, 1892, p. 456).
et cela a entraîné une transformation ou, plutôt, une dégénéres-cence du charisme :
« Jadis, l’office [...] reposait sur le charisme. désormais, à l’inverse, le charisme repose sur l’office. Jadis, on avait seulement un charisme reconnu comme réel par la communauté, désormais on a une force déléguée par la règle de droit, c’est-à-dire un charisme fictif, qui soumet la communauté. la règle de droit (fondée sur un présumé jus divinum) issu du charisme de l’office de l’evêque signifiait la fiction, qui à la fois voilait la rupture avec l’originel et l’exprimait. » (sohm, 1892, p. 216).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
Jean-Philippe Heurtin132
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 132 / 256
- © PUF - 20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 133 / 256
- © PUF -
La reprise wébérienne de la thèse de Sohm
Weber, on l’a souligné, a dit sa dette à sohm concernant le concept de charisme. il a retenu un certain nombre des traits du charisme avancés dans Kirchenrecht, non sans en modifier et infléchir certains de manière parfois radicale.
Une sécularisation du charisme
Weber semble, en premier lieu, tomber d’accord au plan histo-rique avec sohm, concernant la nature pneumatique des premiè-res assemblées chrétiennes. il y a immédiatement, toutefois, chez Weber, une sécularisation du charisme, une séparation de la notion de son origine religieuse. et ce qui était grâce donnée par l’esprit devient « état psychique sacré » – en sorte que ce qui était interven-tion externe de l’esprit devient disposition interne. et la communau-tisation est une emotionale Vergemeinschaftung (« communautisation émotionnelle »), à laquelle les individus appartiennent en vertu d’un lien purement affectif. ce faisant, Weber ne fait pas du charisme quelque chose de spécifiquement chrétien. ainsi, dans Le Judaïsme antique, s’attache-t-il à montrer les ressemblances et différences des pneuma juifs et chrétiens ; mais les guerriers peuvent être aussi charismatiques, comme achille.
Weber reprend ou partage, en deuxième lieu, l’idée de sohm d’une autorité reposant sur une fondation purement charismatique dans le christianisme primitif. nous avons souligné que chez sohm, le charisme était un phénomène individuel et autoritaire. c’est, dans la formulation wébérienne du charisme, un élément également central : la qualification charismatique est personnelle, et la reven-dication de pouvoir charismatique repose sur « la dévotion person-nelle aux leaders naturels, et leur autorité personnelle ». l’essentiel du mouvement de sécularisation du concept de charisme effectué par Weber, cependant, est qu’il transforme radicalement l’écono-mie de la « reconnaissance » du charisme. on a vu que, chez sohm, les membres de l’église reconnaissent dans l’individu charismati-que la parole de dieu, et que cela n’est possible que parce que, eux-mêmes, sont membres du corps du christ, par l’opération de l’esprit saint. sans élément extra mondain, comment expliquer que des sectateurs puissent reconnaître le charisme, et faire allégeance à son porteur ? la reconnaissance ne pouvant s’originer dans une force extérieure, divine, va faire fond, dans des contextes historiques
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 132 / 256
- © PUF -
133L’autorité du présent
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 133 / 256
- © PUF -
particuliers7, sur une rupture initiale avec le quotidien : les individus s’arrachent au monde qu’ils connaissent dans la perspective de le changer, ou de contribuer à son changement. l’individu charisma - tique est d’abord un homme porteur d’une qualité « extraordinaire »,
« un personnage, qui est, pour ainsi dire, doué de forces ou de caractères surnaturels, ou surhumains ou tout au moins en dehors de la vie quotidienne » (Weber, 1972, p. 661).
le charisme se reconnaît – se prouve – dans les effets révolu-tionnaires qu’il a sur le monde, qu’il s’agisse d’une guérison, d’une victoire militaire, d’une conversion de masse, etc., ou d’une « trans-formation de l’intérieur », une metanoïa ; effets déjà échus, mais qu’il pourra et même devra confirmer dans le futur. la reconnaissance (Anerkennung) du charisme, précise Weber, est une « reconnaissance libre » (Weber, 1971, p. 249) – comme l’obéissance est libre chez sohm –, et elle ne vaut ainsi qu’autant que le charisme trouve une confirmation (Bewährung) :
« la domination charismatique bouleverse (dans son domaine propre) le passé, et elle est, en ce sens, spécifiquement révolutionnaire. […] mais elle n’est légitime que dans la mesure où (et aussi longtemps que) “vaut” le charisme personnel en vertu de sa confirmation. » (Weber, 1971, p. 251).
si chez sohm, le charisme était une véritable force agissant dans l’histoire, pour Weber, il prend le tour de la reconnaissance de ce que le chef a déjà pu révolutionner le monde, et qu’il est doté des capacités de continuer à le faire :
« si la confirmation tarde à venir, si celui qui possède la grâce charismatique paraît abandonné de son dieu, de sa puissance magique ou de sa puissance héroïque, si le succès lui reste durablement refusé, si, surtout, son gouvernement n’apporte aucune prospérité à ceux qu’il domine, alors son autorité charismatique risque de disparaître. c’est le sens charismatique authentique de la “grâce divine” » (Weber, 1971, p. 250).
en sorte qu’il n’y a plus rien, pour Weber, de substantiel dans le charisme, hormis sa reconnaissance comme tel par un groupe social.
7. « la création d’une domination charismatique dans le sens “pur”, tel que nous l’avons décrit, est toujours l’enfant des situations externes exceptionnelles, spécialement de situations politiques ou économiques, ou des situations psychiques internes, notam-ment religieuses, ou des deux ensemble. » (Weber, 1972, p. 661).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
Jean-Philippe Heurtin134
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 134 / 256
- © PUF - 20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 135 / 256
- © PUF -
en troisième lieu, Weber reprend de sohm l’idée d’une « autorité » qui n’est accompagnée d’aucune prescription juri dique. comme force antiquotidienne, le charisme est aussi, en effet, fonciè-rement antijuridique. en cela, Weber retrouve encore le thème central de l’œuvre de sohm de rupture du charisme avec la loi. comme le souligne Weber, « les disciples et les suiveurs tendent à vivre sans système de règles formelles, de principes légaux abstraits et donc sans processus juridique de décision les concernant ».
« il n’y a pas d’“autorités constituées” établies, mais seulement dans les limites du service du seigneur et du charisme propre des émissaires mandatés charismatiquement. il n’y a aucun règlement, aucun statut juridique abstrait, et partant aucune invention de la justice rationnelle qui y renvoie, aucune directive ni aucune décision de droit orientée vers des précédents traditionnels. au contraire, les créations juridiques actuelles se font formellement de cas à cas […]. la domination charismatique est spécifiquement irrationnelle en ce sens qu’elle est affranchie des règles » (Weber, 1971, pp. 250-251).
on aura alors affaire à de « nouveaux commandements » (neue Gebote, comme le dit Weber) issus de l’autorité qui a décidé d’un état d’exception par rapport à la loi :
« le prophète authentique, aussi bien que le chef de guerre authentique, que tout chef authentique, d’une façon générale, prend, proclame, expédie de nouveaux ordres ; dans le sens primitif du charisme, cela a lieu en vertu de la révélation, de l’oracle, de l’inspiration, ou d’une volonté de transformation concrète, reconnue pour son origine par la communauté de croyance, de défense, de parti ou autre » (Weber, 1971, pp. 250-251).
en quatrième et dernier lieu, ce que Weber reprend enfin à sohm, au-delà de l’antijuridisme, c’est bien la lecture que ce dernier effectue de l’institutionnalisation de l’église chrétienne. comme on l’a déjà souligné, c’est bien ce que Weber lit comme « quoti-diennisation ». on saisit, dès lors, que ce que Weber retient de sohm reste bien l’opposition polaire entre institution et charisme. si, pour le second, l’institutionnalisation de l’église a signifié la fin du charisme, pour le premier, la séparation du charisme de la personne – et « son rattachement à l’institution, et particuliè-rement à la fonction » (Weber, 1996a, p. 252), en même temps qu’elle signe le passage de la « secte » à l’« église », entraîne une profonde transformation de l’économie du charisme, qui le trans-forme en « charisme de fonction ».
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 134 / 256
- © PUF -
135L’autorité du présent
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 135 / 256
- © PUF -
De l’autorité à la domination charismatique
ce qu’il importe toutefois de remarquer, c’est que le mouve-ment de sécularisation effectué par Weber emporte une réduction de la signification de l’autorité charismatique en la ramenant à la question du pouvoir – de la « domination ». encore doit-on ajouter que Weber n’effectue pas cette réduction sans ambiguïté, ni sans hésitation. on constate d’abord que dans les premiers linéaments de sa sociolo-gie de la domination, on ne rencontre pas encore, paradoxalement, de définition de la domination charismatique, et que l’on a bien plutôt affaire à une appréhension du charisme, sous la seule focale de l’individu extraordinaire, et l’« autorité charismatique » n’en apparaît que comme une conséquence (Wang, 1997, pp. 23-24). ainsi, dans l’introduction de L’Éthique économique des religions mondiales, dont la rédaction date vraisemblablement de 1913, Weber peut-il écrire :
« l’expression de “charisme” doit être comprise […] comme une qualité extraquotidienne attachée à un homme (peu importe que cette qualification soit réelle, supposée ou prétendue). “autorité charismatique” signifie donc : une domination (qu’elle soit plutôt externe ou plutôt interne) exercée sur des hommes, à laquelle les dominés se plient en vertu de la croyance en cette qualité attachée à cette personne en particulier. » (Weber, 1996b, p. 370).
il faut attendre les écrits plus tardifs, rassemblés au chapitre iii d’Économie et société, et datant des années 1919-1920, pour voir for - mulée une définition de la « domination charismatique », comme
« soumission extraordinaire au caractère sacré, à la vertu héroïque ou à la valeur exemplaire d’une personne, ou encore [émanant] d’ordres révélés ou émis par celle-ci » (Weber, 1971, p. 222).
on peut remarquer ensuite des différences significatives dans le traitement du charisme par rapport à celui des autres types de domination. on peut, en effet, constater tout d’abord que la définition de la « domination » renvoie, chez Weber, à la notion « d’ordre » (dans le sens d’injonction ou de directive) qui traduit le terme allemand de Befehl8. et de fait, dans les sections consa-crées aux dominations légale et traditionnelle, c’est bien le terme de Befehl qui revient. mais, il n’en va pas de même dans les para - graphes consacrés à la « domination charismatique », où s’y substi-
8. « Domination [Herrschaft] signifie la chance de trouver des personnes détermi-nables prêtes à obéir à un ordre [Befehl] » (Weber, 1971, p. 56).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
Jean-Philippe Heurtin136
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 136 / 256
- © PUF - 20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 137 / 256
- © PUF -
tue le terme de Gebot. ce terme, malheureusement traduit égale-ment dans la version française par « ordre », renvoie beaucoup plus qu’à l’idée de directive, à celle de « commandement » (religieux ou moral) – comme dans les dix commandements (die Zehn Gebote) et fait écho au terme de « devoir » (Pflicht), également très présent dans ces paragraphes. ensuite, et surtout, il n’est pas certain que, du point de vue de Weber lui-même, la relation sociale fondée sur le charisme puisse être qualifiée, à proprement parler, de forme de domination dans la mesure même où il n’évoque ni contrainte, ni discipline au principe de l’obéissance au chef charismatique9. c’est précisément le fait que l’ordre charismatique n’est pas un « droit », dans la mesure où sa validité n’est pas
« garantie extérieurement par la chance d’une contrainte (physique ou psychique), grâce à l’activité d’une instance humaine, spécialement instituée à cet effet, qui force au respect de l’ordre et châtie la violation » (Weber, 1971, p. 33).
de fait, dans les seules pages consacrées au charisme où il évoque une quelconque sanction envers les non-participants (die Nicht-Teilnahme), celle-ci ne consiste qu’en de simples « quolibets » (der Spott).
ces hésitations sont susceptibles de nous mettre sur la voie d’une différence entre « autorité » et « domination ». À l’évidence, y compris dans la partie la plus tardivement composée d’Économie et société, Weber confond ces deux notions – ainsi, dès les premières lignes du paragraphe 1 du chapitre iii d’Économie et société, consacré aux « types de domination », il les synonymise :
« la domination (l’« autorité ») peut reposer, dans un cas particulier, sur les motifs les plus divers de docilité… » (Weber, 1971, p. 219).
il est possible malgré tout que, dans un premier temps, Weber ait voulu rendre par « autorité » le caractère personnel de la soumis-sion, et celle-ci renvoie tant au charisme qu’au traditionalisme10. pour autant, les caractéristiques du charisme que nous avons évoqués
9. dans le cas de la domination légale, au contraire, la possibilité de la coercition est clairement envisagée, même si les moyens de cette coercition et les hypothèses de leur application sont précisément délimités (Weber, 1971, p. 223). dans le cas de la domi-nation traditionnelle, l’obéissance est fondée d’abord sur une fidélité ou une docilité traditionnelle.
10. dans « l’éthique économique des religions mondiales », Weber (1996b) réserve, en effet, le terme de « domination » à la seule bureaucratie rationnelle et, donc, impersonnelle.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 136 / 256
- © PUF -
137L’autorité du présent
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 137 / 256
- © PUF -
– absence de sanction, caractère moral de l’obligation, libre reconnais-sance – particularisent ce phénomène par rapport aux formes tradi-tionnelle et bureaucratique de « domination ». l’hypothèse que l’on peut former, c’est que ce sont ces caractéristiques, cette possibilité de soumission libre qui a posé problème à Weber, et qui l’a incité à introduire la composante de la légitimité dans sa sociologie de la domination. cette hypothèse est corroborée par edith hanke, qui, à partir d’une analyse fine des différentes strates de composi-tion de la théorie de la domination, a montré que Weber ne s’est d’abord intéressé qu’au mode de fonctionnement de la domination (hanke, 2001, p. 33). elle montre ainsi que, si l’on se réfère aux chapitres de la sociologie de la domination de la troisième partie de Wirtschaft und Gesellschaft, le terme de « légitimité » n’apparaît pas une seule fois dans le chapitre consacré à la bureaucratie, et n’est évoqué qu’en passant quand il s’agit d’évoquer les différentes formes de domination traditionnelle. en revanche, la question de la légitimité a une place considérable dans les chapitres consacrés à la domination charismatique. de sorte qu’elle peut conclure que « le charisme est le lieu de naissance de la typologie de la domination proprement dite » (hanke, 2001, p. 32), autrement dit de la typolo-gie de la domination légitime, telle qu’elle apparaît dans sa version plus tardive du chapitre 3.
dans le cas du charisme,
« la légitimité procède de l’autorité personnelle. et celle-ci, à son tour, peut […] trouver à se fonder dans l’abandon à l’extraordinaire, c’est-à-dire dans la croyance au charisme d’une personne qui bénéficierait par elle-même d’une révélation ou d’une grâce : sauveur ou messie, prophète, héros de toutes espèces. […] la structure “charismatique” de pouvoir repose sur une autorité conférée à des personnalités concrètes, qui n’est ni rationnelle ni fondée sur la tradition. » (Weber, 1972, pp. 548-550).
pour autant, l’obéissance libre, comme l’est la reconnaissance du charisme, ne peut se comprendre que si l’on saisit qu’entre la reven-dication d’autorité et l’obéissance s’intercale une mission. il est à cet égard tout-à-fait révélateur que dans le texte d’Économie et société, c’est précisément le terme de « Sendung » (mission) que Weber utilise (et uniquement dans les passages concernant le charisme) : c’est un devoir de changement dans lequel les sectateurs sont d’abord pris. en sorte que l’on saisit un premier ressort de l’obéissance, qui est un intérêt partagé par le chef charismatique ou le prophète et ses suppôts, et qui consiste précisément dans la réalisation de ce devoir.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
Jean-Philippe Heurtin138
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 138 / 256
- © PUF - 20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 139 / 256
- © PUF -
le porteur de charisme est celui qui a été envoyé pour accomplir une tâche, et son autorité se rapporte toujours à cette tâche pour laquelle il a été missionné. en sorte que cette « mission » qu’il incarne, et qui le légitime, le dépasse également, et le limite :
« le charisme peut être, et est évidemment de règle générale, qualitativement spécifique : il en résulte une limitation qualitative de la mission et du pouvoir de celui qui la porte ; limitation qui vient de l’intérieur, et ne résulte pas de l’ordre extérieur. la mission peut dépendre, et il en va ainsi normalement, dans son sens et son contenu, d’un groupement délimité de personnes, que ce soit sur une base locale, ethnique, sociale, politique ou professionnelle, ou autre : c’est ainsi qu’elle trouve ses limites dans ce cercle circonscrit. » (Weber, 1972, chap. ix, p. 655).
c’est en ce sens que la reconnaissance « libre » est aussi un « devoir » (Weber, 1971, p. 251) :
« le porteur de charisme embrasse la tâche pour laquelle il est destiné, et exige obéissance et loyauté en vertu de sa mission (Sendung). le succès se mesure dans la réponse à cette exigence. que ceux auprès desquels il se sent envoyé ne reconnaissent pas sa mission, et c’en est fini de sa revendication. qu’ils la reconnaissent, alors il est leur maître, aussi longtemps qu’il saura par “confirmation” entretenir la reconnaissance. » (Weber, 1972, p. 655).
mais, on voit aussi, combien il faut relativiser le caractère person-nel de l’obéissance, entièrement soumise à la « confirmation » (tout ensemble par l’épreuve et la preuve) :
« cette légitimité repose donc sur la croyance en la magie, en une révélation ou en un héros, croyance qui a sa source dans la “confirmation” de la qualité charismatique par des miracles, des victoires et d’autres succès, autrement dit par des bienfaits apportés aux dominés ; c’est pourquoi cette croyance s’évanouit ou risque de s’évanouir en même temps que l’autorité revendiquée, dès que la confirmation fait défaut et que la personne dotée de la qualité charismatique paraît abandonnée par sa force magique ou par son dieu. » (Weber, 1996b, pp. 370-371).
il y a donc dans le charisme une articulation de la mission, de la croyance, et de l’obéissance : dans le cadre d’une visée partagée de transformation d’une situation (politique, religieuse ou autre), on croit dans les capacités d’un individu à accomplir cette tâche, et on lui obéit dans la mesure même où on y croit. c’est la mission qui donne sens à la foi dans la personnalité charismatique – foi, à nouveau,
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 138 / 256
- © PUF -
139L’autorité du présent
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 139 / 256
- © PUF -
assise sur les preuves qu’il a au moins commencé d’accomplir cette mission – et qui engendre l’obéissance. en plaçant la mission au cœur de la « domination » charismatique, Weber sécularise le thème de l’attente eschatologique qui était au cœur du christianisme primitif. mais, ce faisant, il spécifie aussi l’autorité du porteur de charisme comme une autorité liée au futur, comme une « autorité de l’avenir » – pour reprendre l’expression d’alexandre Kojève. celui-ci insiste bien, en effet, quand il cherche à définir spécifiquement l’« autorité du chef », sur le fait que celle-ci est liée à un « projet », et qu’elle subsiste « tant que dure l’exécution de son projet ». elle trouve son fondement dans une capacité de « clairvoyance », de « prescience », c’est-à-dire une capacité d’être « en avant », de « voir plus loin », de voir l’avenir, meilleure que ceux qui « ne voient que les données immédiates, les besoins du jour » (Kojève, 2004, pp. 73-75 ; p. 126 passim).
L’ecclésiologie catholique et l’articulation de la loi et de la grâce
la publication du livre de sohm a provoqué, on l’a dit, une longue et intense dispute, dont le sommet se situe dans les années 1880-1910. l’une des particularités de cette controverse est qu’elle a d’abord concerné des historiens, théologiens ou sociologues protestants, sans que la critique de sohm ne trouve immédiatement de réponses catholiques11. sans doute, l’ecclésiologie catholique contemporaine a-t-elle été pour partie dépendante dans son développement de la thèse, pour elle provocatrice, de sohm12. les théologiens catholiques (et anglicans), en substance, nient que dans l’église primitive, il y ait eu un quelconque gouvernement par l’esprit (et que la place de l’esprit ne s’est affirmée qu’après la pentecôte) – en sorte que l’église aurait été originairement une christocratie hiérarchique. À partir des douze apôtres se sont distinguées, des « fonctions ». ce qui apparaît quand on examine l’histoire paléochrétienne, c’est tout d’abord la multiplicité des titres13, qui dérivent des pratiques des groupes culturels très divers – juifs palestiniens et hellénistes –, et des services dans les commu-nautés : enseignement, mission, gouvernement, service des tables, etc. il y a, à l’évidence, toutefois des titres fondateurs liés à la mission
11. voir haley 1980.12. voir à ce sujet rouco-varela (1969). voir également congar (1973).13. voir la mise au point d’ensemble d’alexandre faivre (2007).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
Jean-Philippe Heurtin140
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 140 / 256
- © PUF - 20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 141 / 256
- © PUF -
apostolique : les douze, les sept, les apôtres, les diakonoi ; et puis des titres locaux, renvoyant à des responsabilités sédentaires : les pasteurs, les presbyteroi (anciens ou presbytres), les episcopoi kai diakonoi, etc.14
pour autant, ces arguments historiques et exégétiques ne nous semblent pas atteindre le cœur de l’argument sohmien – du reste l’exégèse catholique reste également controversée. sohm, en effet, se centre sur l’idée d’une essence de l’église. en sorte que les réponses de nature historique, ou liées à une interprétation textuelle, apparais-sent peu adéquates. c’est en revanche, chez erik peterson, que nous allons trouver une position qui, respectueuse des données histo riques disponibles, engageait un débat général sur l’essence catholique de l’église, et qui a fourni, sans le nommer, une réponse vigoureuse à la position de sohm (peterson, 1928).
La proposition petersonienne sur l’Église
le point central, quoique relégué dans deux incises15 dans le texte de peterson, est sans doute celui du « marcionisme » des positions, qui telle celle de sohm, tendent à détacher la loi et l’esprit – marcionisme que marque la formule, reprise d’ailleurs dans le texte de Weber : « il est écrit, mais je vous dis ». la doctrine de marcion, d’allure gnostique, proposait, en forme de solution à la théodicée, l’idée de deux dieux : le dieu créateur, et le dieu de la nouvelle alliance. ce faisant, marcion, qui se disait disciple de paul, et s’appuyant sur la phrase de l’épître aux romains « la fin de la loi, c’est le christ » (rom., 10, 4), avance l’idée du caractère inconci-liable de l’ancien et du nouveau testament, et avec lui l’opposition de la loi et de la grâce. la venue du christ a seulement annoncé la rédemption universelle contre l’élection du seul peuple juif, et, ce faisant, a aboli la loi et les prophètes. il s’agissait donc de manifester la contradiction entre l’évangile et la loi, et, dès lors, de refuser l’héritage de l’ancien testament et de sa réalité juive. on trouve ainsi l’idée d’un « christianisme pur16 » que portait r. sohm – avec tout un courant du luthéranisme allemand – en rupture avec l’ancien testament, et avec la loi.
14. ce n’est, sans doute, toutefois qu’au iiie siècle, notamment avec la Tradition apos-tolique, que sera fixé un véritable statut clérical (faivre, 2007, pp. 31-32).
15. deux incises, et une note qui renvoie au livre d’adolf von harnack, Marcion. L’Évangile du Dieu étranger. Une monographie sur l’histoire de la fondation de l’Église catholique (2003 [1ère édition, 1921]).
16. pour reprendre l’expression de B. lauret, « l’idée d’un christianisme pur », (in harnack 2003, pp. 259-376).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 140 / 256
- © PUF -
141L’autorité du présent
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 141 / 256
- © PUF -
or, pour peterson, la réalité de l’origine de l’église, tant d’un point de vue historique que théologique est autrement complexe. sans doute, l’église n’existe-t-elle que parce que « les juifs, peuple élu de dieu n’ont pas cru au seigneur ». l’église, de ce fait, est bien une église de païens, et pour les païens. et, le moment du passage à l’église, qui rompt avec l’eschatologie chrétienne juive du royaume, est constituée par la pentecôte, où est conféré aux apôtres, par une communication de l’esprit, le don des langues qui « préfigure le chemin qui mènera les apôtres [aux païens], et donc à ce que nous appelons l’église » (peterson, 1928, p. 177). on en vient avec cet événement de la pentecôte à l’idée que « l’église n’existe que tant qu’est admis le fait que les douze apôtres sont appelés à l’esprit saint et prennent en s’inspirant de lui la décision d’aller vers les païens » (peterson, 1928, p. 177). or, de cette thèse apparemment anodine, peterson tire une conséquence extrêmement importante et radicale, qui est que « Jésus n’a pas mis en place l’église, ni les différentes charges ecclésiastiques. Jésus a prêché aux juifs le royaume, mais non l’église aux païens » (peterson, 1928, p. 177). mais cela veut dire que si Jésus n’a pas nommé des évêques, ni ordonné les prêtres, c’est à l’esprit saint qu’il faut rapporter cette hiérarchie, agissant en la personne des douze apôtres.
l’ecclésiologie catholique de peterson repose donc sur l’inter-prétation du rôle des douze. ces douze sont des « chrétiens juifs », désigné par le christ et appelés à « juger les tribus d’israël » (c’est-à-dire à régner sur elles). ils ont reçu, d’une part, de Jésus leur pouvoir par une délégation de droit. ils sont ancrés à l’intérieur d’israël, et leur mission est liée au rassemblement eschatologique qui concerne le seul peuple juif. mais, d’autre part, il y a le récit de la pentecôte, c’est-à-dire, encore une fois, une communication particulière de l’esprit qui leur donne la langue de tous les peuples. À partir de là, les douze sont destinés à aller vers les païens, et deviennent les « douze apôtres ». ils vont quitter Jérusalem. avec ces deux événements, on a, selon peterson, les deux éléments constitutifs de la notion d’église : « la légitimité dans la succession de droit des “douze” qui découle directement du seigneur » (les dirigeants des assemblées cultuelles sont légitimés par l’imposition des mains des apôtres, et il n’y a pas de succession épiscopale qui se fonde sur paul), et une foi qui, comme pour les douze apôtres, est « dans l’obligation de prendre des décisions indépendantes, en raison de l’esprit saint ». comme le souligne peterson, « il y a donc un droit apostolique, et une liberté pneumatique en matière dogmatique », que manifeste la formule : « il
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
Jean-Philippe Heurtin142
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 142 / 256
- © PUF - 20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 143 / 256
- © PUF -
a plu à l’esprit saint et à nous-mêmes (edoxe to pneumati to agio kai emin). » ou, pour le dire autrement, les « douze » appartiennent à l’ordre juridique, et les douze apôtres à l’ordre charismatique.
Le rôle de l’Esprit dans le « déjà-là » et le « pas-encore »
le rôle fondamental de l’esprit dans la constitution de l’église qu’avec peterson nous avons évoqué n’épuise cependant pas ses « fonctions » ecclésiologiques. on ne peut toutefois saisir ces der nières qu’en les replaçant dans la crise que représente le retard de la parousie. dans les premiers temps, les chrétiens vivaient avec l’idée qu’elle était imminente. dès lors, le retard devient une impasse, et désespère les premières communautés chrétiennes. comme l’a souli-gné Jacob taubes,
« l’histoire la plus intérieure du christianisme résulte d’un événement qui n’est pas arrivé, celui de la parousie, et comprend la tentative de saisir néanmoins ce non-événement dans une interprétation chrétienne. » (taubes, 2009, p. 81).
on sait que saint paul a expliqué que le nouvel éon a déjà commencé malgré le retard de la parousie. ce monde-ci ancien n’a pas encore disparu, mais ce monde-là est déjà-là, et les élus doivent vivre cette période intermédiaire, ce kairos, où les deux mondes coexistent17.
l’église se constitue comme telle entre l’événement de l’incarna-tion et la parousie, et comme les reliant, dans une double dimension, à la fois historique et eschatologique. la succession apostolique – dont on a vu, avec peterson, qu’elle était au principe de l’institution de l’église –, peut en effet se comprendre d’abord comme un processus historique. elle situe les ministères – au terme d’un choix exégétique et dogmatique – dans le cadre d’une séquence christ-ministères issus des apôtres-église18. cette compréhension de la succession aposto-lique se définit comme une « continuité rétrospective avec le passé » (Zizioulas, 1981, p. 143), et comme une orientation. elle renvoie à la mission des apôtres : ils sont envoyés et dispersés à travers le monde pour annoncer la venue du royaume de dieu, « pas encore » accompli. l’église se révèle donc comme l’institution qui va du passé vers le futur ; elle permet l’inscription actuelle, dans le présent,
17. voir Goguel, 1947. 18. voir congar, 1966, p. 61.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 142 / 256
- © PUF -
143L’autorité du présent
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 143 / 256
- © PUF -
de l’événement passé de l’incarnation ; et le rôle des ministères est ici essentiellement anamnétique : il s’agit de rappeler au présent et fidèlement la doctrine transmise par les apôtres – les ministères, on l’a souligné, ont partie liée à l’enseignement. dans ce cadre, la succes-sion apostolique permet à l’église d’être conforme à son origine, et de la rendre contemporaine de tous les moments de l’histoire19. mais l’apostolat a aussi une dimension eschatologique. cette dimension, qui a été sans doute mieux représentée dans le christianisme oriental que dans l’église latine, renvoie au « déjà-là » du royaume. cette compréhension de l’eschatologie décrit alors un « état d’existence » qui révèle une présence du royaume, ici et maintenant. cette présence est en particulier assurée par l’eucharistie. la succession aposto - lique renvoie ainsi au sacrement de l’eucharistie qui leur a été confié par le christ et qu’eux et leurs successeurs ont à leur tour transmis. elle permet aux évêques et aux prêtres d’actualiser ce qui n’est « pas encore », le banquet des noces de l’agneau, promis par l’apocalypse de Jean, où les apôtres entourent le christ dans son royaume, et de convoquer, en un même lieu, le peuple dispersé afin qu’il consti-tue un même corps – celui du christ. l’église se laisse dans cette perspective définir comme « communauté eucharistique » qui réalise le rassemblement et l’unité des chrétiens. si, donc, la fonction histo - rique des apôtres et de leurs successeurs renvoyait à leur dispersion pour annoncer la Bonne nouvelle, leur fonction eschatologique est celle du rassemblement du peuple de dieu dispersé20 en assurant ensemble, ici et maintenant, la présence sacramentelle du royaume.
la pneumatologie joue un rôle primordial et double dans cette période intermédiaire entre la résurrection et la parousie. ainsi, en particulier dans l’évangile de Jean, peut-on lire ses deux fonctions, d’une part de fidèle représentation du christ historique (« le paraclet, l’esprit saint, que le père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit » – Jean, 14, 26), et, d’autre part, de fidèle représentation du christ futur, eschatologique, et de son royaume (« J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant… quand il viendra, lui, l’esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière ; car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu’il entendra, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir » – Jean, 16, 12-14) ». la
19. Je reprends ici les termes d’ Y. congar (1966, p. 77). 20. cette dimension eschatologique est bien mise en évidence par J. Zizioulas
(1981, p. 137 sq.), justement à propos de la continuité apostolique.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
Jean-Philippe Heurtin144
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 144 / 256
- © PUF - 20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 145 / 256
- © PUF -
constitution de l’église ne peut ainsi s’effectuer que dans la relation à l’esprit. c’est l’esprit qui, on l’a vu avec la pentecôte, est à l’œuvre, d’une part, dans la dispersion des apôtres ; c’est d’autre part, l’esprit qui, conduisant « à la vérité tout entière », et, annonçant « les choses à venir », travaille au rassemblement du peuple de dieu. son action est à la fois une actualisation de l’événement de l’incarnation, et une introduction des eschata – « ce qui vient en dernier, les derniers temps » – dans l’histoire21. dans cette perspective, la prière qui appelle l’intervention de l’esprit saint – l’épiclèse – s’articule à la succession des apôtres au deux sens que nous avons évoqués, histo-rique et eschatologique : elle noue l’incarnation divine et le futur de la seconde venue du christ dans le présent ecclésial.
nous disposons donc avec la reconstruction opérée du rôle de l’esprit dans la tradition et la théologie catholique, d’un autre modèle du charisme. nous voudrions en faire deux types d’usage. un premier qui sera critique : le déploiement de l’« essence » de l’église catholique, et de la signification catholique du charisme de fonction peut nous permettre de revenir sur un certain nombre de proposi-tions effectuées par Weber, et qui peuvent sembler trop dépendantes désormais de sources proches de la tradition luthérienne. un second usage pourra alors être fait qui, en suivant le geste de sécularisa-tion effectué par Weber sur la notion de charisme personnel, pourra permettre de cerner les contours d’un concept de « charisme de fonction », de le constituer en propre, et de dégager, de manière autonome, le type d’autorité qu’il revendique.
Une approche critique du modèle wébérien du charisme de fonction
Une transformation du charisme dans le « développement de la secte à l’Église » ?
le concept de charisme s’intègre tout d’abord, pour Weber, dans le jeu typologique en miroir de la secte et de l’église. ce jeu concerne, en premier lieu, des différences des doctrines du salut. la secte est une « association de salut », un regroupement volontaire de « personnes qualifiées de façon purement personnelle et charisma-tique » (Breuer, 1996, p. 1293), qui a pour fondement le principe de
21. pour reprendre l’expression de J. Zizioulas (1981, p. 99 et p. 144).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 144 / 256
- © PUF -
145L’autorité du présent
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 145 / 256
- © PUF -
la libre appartenance ; elle apparaît, en même temps que se construit l’église, dès les débuts du christianisme, avec les montanistes et les donatistes par exemple. au contraire de l’église, les sectes entrent naturellement en opposition avec le reste de la société. demandant à leurs membres une conduite irréprochable – les critères d’admission y sont également très stricts – elles représentent la prétention d’éta-blir, sur terre, un ordre qui ressemble le plus possible au royaume céleste. mais, la rédemption définitive n’appartient qu’au futur. la secte rejette l’idée que l’adhésion à une institution et que la médiation sacramentelle puissent donner l’accès aux biens du salut ; la garantie du salut réside dans une vie centrée sur l’enseignement originel du fondateur, et dans une vie modelée sur la sienne. la secte est donc, comme le souligne stefan Breuer, « une formation aristocratique, une communauté des saints » (Breuer, 1996, p. 1293), qui prépare et attend l’accomplissement final du salut annoncé.
l’église, en revanche, est une « institution de salut » qui a reçu du divin le pouvoir temporel de dispenser le salut et la grâce : dans l’église, il y a transfert de la sacralité charismatique sur l’institution comme telle. dans cette perspective, elle hérite, en totalité ou en partie, du pouvoir donné au fondateur par la divinité, et cela afin de continuer l’œuvre de rédemption et d’assurer la diffusion du message de salut – pour une société donnée ou pour l’humanité tout entière. l’église prétend ainsi être le canal à travers lequel le divin inter-vient mystérieusement et miraculeusement dans le monde. l’église demande ainsi la soumission des croyants en échange du don des biens du salut (doctrine, sacrements, morale). comme le fait valoir annette disselkamp,
« ses membres jouissent de la grâce intrinsèque à la fondation, du fait de leur participation aux sacrements, dont l’action salvatrice est immédiate, que celui qui les reçoit et celui qui les dispense soient ou non personnellement vertueux » (disselkamp, 2006, p. 460).
c’est la raison pour laquelle l’institution ecclésiastique n’exige pas de qualification religieuse spécifique. corrélativement, l’appar-tenance est considérée comme étant obligatoire, nul n’étant censé s’exclure de la perspective du salut.
ce qu’il est essentiel de remarquer c’est le lien interne qui unit dans chacun des cas la définition du type de mouvement religieux et un forme de charisme. la secte ne se laisse ainsi définir que par référence à une qualification religieuse, dont le critère est le « charisme de l’état de grâce », « conférée directement par dieu
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
Jean-Philippe Heurtin146
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 146 / 256
- © PUF - 20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 147 / 256
- © PUF -
sans aucune transmission par l’institution hiérocratique » (Breuer, 1996, p. 1293). or, on a vu que ce charisme personnel et immédiat était le substrat même de la définition sohmienne du christianisme avant sa catholicisation. de même, l’église, pour Weber, se définit, pour l’essentiel, sous le rapport du charisme, comme « porteuse et gestionnaire d’un charisme de fonction (Amtscharisma) » (Breuer, 1996, p. 1293). réciproquement, ce charisme n’est jamais, on l’a dit, véritablement défini que de manière tautologique dans le reprise même de la définition du type église : le charisme de fonction est ainsi défini comme « la croyance dans la grâce spécifique d’une insti-tution sociale, en tant que telle » (Weber, 1972, p. 675).
alors que
« le prêtre reste légitimé par sa charge de membre d’une entreprise sociétisée de salut, le prophète, de même que le magicien charismatique, agit purement et simplement en vertu d’un don personnel. » (Weber, 1971, p. 464).
ainsi, est-ce
« la fonction assumée par le prêtre et non point sa qualification charismatique personnelle qui est décisive pour la grâce qu’il administre. » (Weber, 1971, p. 570).
le caractère antinomique de la possession du charisme de fonction et du charisme personnel s’origine ainsi dans la source – et donc dans la légitimité – du charisme. dans le cas du charisme personnel, le charisme est conféré directement à l’individu par le pneuma divin ; dans le cas du charisme de fonction, l’objectivation du charisme permet de le transmettre sans considération de la personne du titulaire de l’office, et l’efficacité des sacrements n’est pas non plus liée à sa personne, mais au seul accomplissement du rite (ex opere operato). la querelle des donatistes qu’évoque Weber en témoigne (Weber, 1996a, p. 254). la conception rigoriste que les donatistes défendaient faisait que la validité et l’efficacité des sacrements étaient liées à la pureté des ministres (ex opere operantis). or, pour les catholiques, le baptême est toujours valide s’il a été fait dans les formes instituées par le christ. de la même manière, le sacrement de l’ordre marque le prêtre d’un caractère indélébile22 ; il ne peut être conféré qu’une fois, et ne peut être « annulé », du fait de ses fautes ou ses manquements personnels.
22. Weber fait référence à quatre reprises au « character indelebilis » dans Économie et société (1971, p. 255 ; 1972, p. 144, p. 339, p. 675, p. 694 (cette dernière référence n’est pas reprise dans la traduction de « état et hiérocratie », cf. Weber, 1996c, p. 254)).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 146 / 256
- © PUF -
147L’autorité du présent
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 147 / 256
- © PUF -
l’opposition entre ces deux formes de charisme, fait que, comme le souligne Weber :
« l’activité (Betrieb) sacerdotale, qui est organisée rationnellement et qui gère les biens de salut comme une “institution” (Anstalt), et le transfert de sacralité charismatique sur cette institution comme telle – ce qui est le propre et l’essentiel de toute formation d’“église” – signifient que le charisme de fonction, quand il va jusqu’au bout de sa logique, devient irrémédiablement l’ennemi juré de tout charisme authentiquement personnel, lequel attaché à la personne en tant que telle, encourage et enseigne une voie autonome vers dieu ; il devient l’ennemi de tout charisme prophétique, mystique, extatique, tous ces charismes étant susceptibles de détruire la dignité de l’“activité” (Betrieb) sacerdotale » (Weber, 1996a, pp. 253-254).
cette logique est liée au fait que l’esprit peut « passer » où il veut, et notamment par des agents hors institutions, ou en position hiérarchiquement inférieure, mais également à la dimension critique du prophétisme à l’endroit du caractère « magique » des formes de transmissions institutionnelles du charisme23.
le couple idéal-typique polaire de l’église et de la secte reste, toutefois, pour Weber, lié par une ligne de développement. en effet, les formes religieuses descriptibles sous l’idéal-type de l’église apparais-sent en grande partie comme des développements de formes, ratta-chées au type secte :
« quand une communauté (Gemeinschaft) religieuse est née dans le sillage d’une prophétie ou de la propagande d’un sauveur, le soin de réglementer la vie incomba d’abord à ceux, parmi les successeurs, élèves, disciples du prophète ou du sauveur, que leur charisme qualifiait pour cette tâche. ultérieurement, et dans des conditions déterminées qui se sont reproduites très régulièrement […], ce soin incomba à une hiérocratie sacerdotale, héréditaire ou de fonction (amtlich), tandis que le prophète ou le sauveur s’opposait en règle générale aux puissances hiérocratiques traditionnelles (magiciens ou prêtres), en opposant précisément son charisme personnel à leur dignité consacrée par la tradition, afin de briser leur puissance ou la contraindre à se mettre à son service. » (Weber, 1996a, pp. 416-417).
ce qui, pour Weber, était toutefois également décisif dans l’oppo-sition idéal-typique entre la secte et l’église, et, plus encore, dans l’idée d’une ligne de développement les reliant, c’est précisément la
23. « par son sens même, toute prophétie dévalorise, à des degrés divers, les élé-ments magiques de l’entreprise des prêtres » (Weber, 1971, p. 479).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
Jean-Philippe Heurtin148
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 148 / 256
- © PUF - 20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 149 / 256
- © PUF -
transformation du charisme, attaché à la personne dans la secte, et à la fonction dans l’église :
« une hiérocratie se développe en “église” quand [1] s’est constitué un corps de prêtres professionnels, dont le statut est réglé par un salaire, une carrière, des devoirs professionnels et un style de vie spécifique (en dehors de l’exercice de la profession) ; [2] quand la hiérocratie prétend à une domination “universaliste”, c’est-à-dire pour le moins quand elle a dépassé les liens qui l’assujettissent à la maison, à la parentèle, à la tribu, et pleinement quand les barrières ethno-nationales sont elles aussi tombées, donc dans une situation de complet nivellement religieux ; [3] quand le dogme et le culte sont rationalisés, consignés dans des écrits sacrés, commentés, et font l’objet d’un enseignement systématique, tout en n’étant pas considérés seulement comme une technique à maîtriser ; [4] quand tout ceci s’accomplit à l’intérieur d’une communauté institutionnalisée. car le point qui est décisif par-dessus tout, […] c’est la séparation du charisme d’avec la personne et son rattachement à l’institution, et particulièrement avec la fonction (Amt). » (Weber, 1996a, pp. 251-252).
mais, comme le suggère peterson, s’il y a eu des ministères dès l’ori-gine, et si le christ a effectivement délégué aux douze leur première mission apostolique, si, en d’autres termes, le christianisme a connu, dès l’origine, des formes institutionnelles – devenues dans un second temps, après la pentecôte, pneumatiques –, cela signifie que les communau-tés religieuses rattachables au type église, ne sont pas le résultat d’un développement de celles rattachables au type secte. il semble qu’à cet égard, Weber ait été trop influencé par la description de la catholici-sation de l’église ancienne, effectuée par sohm. mais, cette idée d’un développement de la secte à l’église emportait également avec elle, celle d’une ligne de développement du charisme personnel au charisme de fonction – là encore comme sohm avait voulu le démontrer de manière critique. si, historiquement, on a pu observer des formes de quotidien-nisation du charisme personnel, en particulier, comme on va le voir, par un détachement progressif du charisme de la personne, il paraît difficile de faire du charisme de fonction le résultat d’un simple développement du charisme personnel. on aurait, en fait, affaire donc à deux modèles opposés, mais autonomes l’un par rapport à l’autre.
« La grâce spécifique d’une institution sociale, en tant que telle »
il y a, on l’a vu, un lien interne, concernant les apôtres, entre charisme et droit. reste à comprendre comment ce lien a pu s’institutionnaliser, et, ce faisant, constituer l’église. la question
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 148 / 256
- © PUF -
149L’autorité du présent
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 149 / 256
- © PUF -
centrale devient ainsi de comprendre comment une institution peut être considérée comme pneumatique. pour Weber, le charisme de fonction est construit dans une première antinomie avec le charisme personnel, comme étant objectivé (Weber parle de « Versachlichung des Charisma ») – ce qui caractérise l’église, c’est justement la sépara-tion de la personne et de la fonction. cette séparation supposait l’appropriation du charisme des apôtres par l’institution et la possi-bilité de le transmettre au titulaire d’une fonction particulière. les notions d’ordre (ordo) et de tradition apostolique permettent préci-sément de réaliser cette appropriation. l’ordre désigne un degré dans la hiérarchie, ou même simplement une fonction ecclésias-tique24, et emporte une qualification juridique de l’individu pour cette fonction ou ce ministère. mais, l’ordre est aussi un dispositif pneumatique. c’est en l’occurrence d’abord l’opération paulinienne qui permet de le comprendre. en effet, contrairement à la lecture univoque effectuée par sohm de l’église primitive, il n’y a pas seule-ment une valorisation du charisme dans les épîtres de paul, mais aussi une rationalisation de ces charismes, et surtout leur délimita-tion à des fonctions ministérielles. si paul ne nie pas l’importance des charismes, il perçoit la « ferveur de l’esprit » comme un éventuel facteur de division de l’église : certains « dons spirituels » entraînant des hiérarchisations internes à la communauté, et suscitant autant de conflits. or, ce qui est remarquable, c’est que paul, affirme effective-ment l’existence d’une hiérarchie, mais place à la tête de l’église, des fonctions instituées, présentées donc également comme des pneuma-tikà, avant l’ensemble hétérogène des autres charismes :
« et dieu a établi dans l’église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » (1 co 12, 28).
mais, d’autre part, le rapport entre charisme et fonction apparaît très spécifique. ce ne sont pas en effet des individus doués de charisme qui sont faits ministres, mais c’est tout l’inverse : c’est le ministère, historiquement premier, qui fait le charisme. cette seconde opéra-tion est révélée dans les Épîtres pastorales, et en particulier dans les deux épîtres à timothée. dans la première, on peut en effet lire : « ne néglige pas la grâce qui est en toi, qui t’a été donnée par la prophétie et l’imposition des mains du collège des presbytres. » (1tm 4, 14) ;
24. voir Gaudemet, 1994.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
Jean-Philippe Heurtin150
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 150 / 256
- © PUF - 20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 151 / 256
- © PUF -
et dans la seconde : « … je te rappelle d’aviver la grâce de dieu qui est en toi par l’imposition de mes mains. » (2tm 1, 6). les deux passages sont traditionnellement interprétés comme autant de rappel de l’ordination – en particulier du fait de la référence à l’imposition des mains. c’est donc l’ordination qui confère le charisme, désor-mais ministériel. et ce charisme – ou ces charismes – est transmis de personne à personne, en suivant une chaîne seulement ministérielle depuis les apôtres aux disciples et des disciples aux ministres locaux. ce qui devient donc essentiel dans le charisme de fonction, c’est bien une légitimité tirée de « tradition », c’est-à-dire de la succession ministérielle, et in fine apostolique25.
Le mode de reconnaissance propre au charisme de fonction
mais, ce qui est décisif dans la manière dont le pneuma opère, c’est qu’il articule les ministères et la communauté. on n’en prendra que deux exemples, centraux pour notre propos : celui de l’ordination, et celui de la prononciation du dogme. concernant l’ordination, et la désignation des évêques, elles supposaient d’abord l’imposition des mains. mais, cette opération n’est pas, en elle-même, charisma-tique. or, pour que l’on puisse parler pertinemment de charisme de la fonction, il faut bien la présence de l’esprit. le sacrement de l’ordre, pour être interprété charismatiquement, requiert une « reconnaissance », et la présence de l’esprit ne se lit que dans l’inter-vention de l’église « unanime », par acclamation ou par élection. le sens effectivement que l’élection prend dans cette procédure n’est pas encore, de toute évidence, celui, moderne, de nos démocra-ties, mais se comprend comme la marque de l’action de l’esprit : ce type d’« élection » ne peut s’analyser « comme une manifestation de la volonté d’un groupe », « elle est un “signe” qui “désigne”, à côté d’autres signes de caractère prophétique ou miraculeux » (Gaudemet, 1979, p. 9). le mixte des deux éléments de manumis-sion et d’élection, parfois confondus sous le terme de « chirotonie », renvoie en fait aux deux significations de la succession apostolique que nous venons d’évoquer : l’imposition des mains est ce processus formel qui signale la succession au sens historique, qui fait de chaque
25. clément de rome est sans doute le premier à articuler une formulation « dog-matique » de la succession apostolique : 1 clém. 42, 4 insiste ainsi sur le fait que ce sont les apôtres eux-mêmes qui ont institué les ministères épiscopaux et diaconaux : « prêchant à travers villes et campagnes, [les apôtres] installaient leurs prémices, après les avoir éprouvés par l’esprit, comme épiscopes et diacres des futurs croyants. ».
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 150 / 256
- © PUF -
151L’autorité du présent
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 151 / 256
- © PUF -
évêque un maillon de la chaîne qui a commencé avec les apôtres, et qui, de ce fait, permet la validité sacramentelle. mais, la marque du caractère charismatique de la fonction d’évêque se révèle aussi par l’importance de l’épiclèse dans l’ordination. À l’épiclèse corres-pond le contexte eschatologique même de cet acte liturgique, qui est celui du peuple rassemblé. et ce rassemblement se manifeste dans l’élection (unanime), et dans l’eucharistie qui l’accompagne. dans ce mode de désignation « mixte » des évêques, l’on voit à la fois se rejouer la continuité entre l’ordre charismatique et l’ordre juridique, et le mode de formation même du charisme de fonction.
le dogme comme révélation du christ se situe également dans le « déjà-là » et le « pas-encore » ; il est représentation fidèle tant du christ historique que de l’avenir eschatologique du christ et de son royaume dans le présent de l’église. un premier critère, comme le souligne maurice sachot, est à l’articulation de la tradition et de la succession, comme
« voie d’accès pour l’homme à la vérité, celle-là même que dieu a empruntée pour la lui communiquer, à savoir celle de la révélation depuis l’origine du monde, celle qui, dans un premier temps, passant par moïse et les prophètes, atteint son achèvement et sa réalisation avec Jésus le christ, et, dans un second temps, se maintient et se propage, dans une succession ininterrompue, depuis les apôtres jusqu’au presbytres et épiscopes actuels en passant par leurs successeurs » (sachot, 2011, pp. 209-210).
la tradition et la succession instituent ainsi l’église, et ouvre un champ d’autorité qui appelle à l’obéissance ceux qui ont reçu déléga-tion juridique à se prononcer sur dieu. mais, le respect des critères formels de validité ne suffit pas. le dogme est, en effet, l’œuvre du synode apostolique et de l’esprit saint, comme le signale la citation des actes des apôtres que nous avons rencontrée sous la plume de peterson : « il a plu à l’esprit saint et à nous-mêmes » (actes 15, 28). la présence de l’esprit se manifeste dans le fait d’une collégialité unanime. mais, elle suppose aussi une reconnaissance de l’église tout entière. cette reconnaissance peut passer sous la forme du « amen », sans lequel les ministres ne peuvent effectuer aucun acte authenti-quement liturgique ; elle renvoie aussi à la tradition – au moins dans l’église latine – de la receptio.
comme le relève en termes prudents Yves congar :
« la “foi de nicée” était attribuée, non à un “pouvoir” de l’assemblée hiérarchique, mais à la conformité de son enseignement
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
Jean-Philippe Heurtin152
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 152 / 256
- © PUF - 20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 153 / 256
- © PUF -
avec la foi des apôtres. […] les ministres “hiérarchiques” n’exercent qu’un service, une fonction, une mission […], étant entendu qu’une mission comporte le moyen nécessaire pour son accomplissement : ici la grâce ou le charisme. mais ce charisme ne peut être, comme tel, interprété en termes de “pouvoir” juridique. un tel “pouvoir” existe bien : c’est l’autorité juridictionnelle qui, dans l’église et à l’égard de ses membres, ajoute à la proposition authentique de vérité, une obligation qui fait le “dogma” proprement dit […]. mais l’adhésion de foi, lorsqu’il s’agit de doctrine, s’adresse au contenu de vérité. […] si l’on attribue au ministre une autorité relative au contenu de vérité comme tel, on se situe au plan juridique et l’on ne peut trouver qu’un rapport d’obéissance. si l’on considère le contenu de vérité et de bien, on peut reconnaître aux fidèles, mieux à l’ecclésia, une certaine activité de discernement et de “réception”. » (congar, 1972, p. 65).
la réception ne confère pas de validité à une décision ou à une proposition, mais reconnaît et atteste qu’elle correspond effective-ment au bien de l’église. mais c’est aussi un processus pneumatique, où, là encore, l’esprit marque sa présence par l’unanimité.
l’articulation de la communauté et des ministères vient spéci-fier la nature de la relation de groupement que noue le charisme de fonction. dans l’église primitive tout du moins, on voit que la « reconnaissance » que manifeste l’expression unanime de la communauté est nécessaire à l’attestation du charisme de fonction et à l’autorité qu’il emporte. mais, c’est dire aussi qu’elle est une condition essentielle du déploiement de l’obéissance. cette obéis-sance qui ne dépend, alors, d’aucune sanction est ainsi tout aussi principiellement libre que celle que sohm décrivait dans sa propre version de l’église ancienne.
Une autorité du présent
l’insistance que nous avons mise sur la dimension temporelle du pneumatisme – la façon dont l’esprit noue passé de l’incarnation et futur eschatologique dans le présent ecclésial – nous permet de saisir quel est le type d’autorité associé aux ministères. cette autorité, il faut la lire précisément au travers des deux significations de la continuité apostolique. avec la première signification, nous voyons que se dessine une référence au passé. cet élément est certainement central dans la théologie catholique, et il emporte une différence fondamentale, dans la parole déployée par l’église et la synagogue – mais aussi, à l’intérieur du christianisme, entre catholicisme et protestantisme. comme l’a magistralement remarqué peterson,
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 152 / 256
- © PUF -
153L’autorité du présent
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 153 / 256
- © PUF -
la révélation a modifié fondamentalement le régime de parole. si avant la révélation les prophètes, inspirés, disaient la parole de dieu qui ne s’est pas encore révélé, l’incarnation a signifié que dieu a parlé de dieu, et cette parole a eu lieu26. la conséquence de cela est lapidairement ramassée par peterson : « les prophètes de l’ancienne alliance prophétisaient le futur, les prophètes de la nouvelle alliance prophétisent le passé » (peterson, 1925, p. 140). la tâche des minis-tères, dès lors, est celle d’un enseignement et d’une exégèse du logos divin qui s’est déjà incarné – comme sohm l’avait souligné, quand il montrait que le gouvernement de l’église était fondé sur le charisme de l’enseignement. mais cet aspect a un retentissement immédiat sur le rapport au temps du charisme : le charisme des prophètes de l’ancien testament – et c’est ce sens du charisme, comme on l’a vu, que garde sohm et, à sa suite, Weber – vise le futur et vise à changer le monde ou les esprits pour le futur. en revanche le charisme des catholiques, dans cette première acception de la continuité apostolique, est tourné vers cet événement passé de l’incarnation qu’il a charge de rappeler au présent.
on pourrait en conclure que l’autorité tirée du charisme de fonction se résoudrait en une « autorité du père », pour reprendre la typologie de Kojève, autorité du seul passé, de la tradition, et qui trouverait sa justification métaphysique dans la « “présence” du passé dans le présent » (Kojève, 2004, p. 81 sq.)27. pour autant, avec la seconde compréhension de la succession apostolique qui met en avant une dimension proprement eschatologique, le futur s’affirme aussi. cette compréhension, on l’a vu, suppose une orientation vers le futur de la parousie. on a compris aussi que l’apostolicité, dans cette perspec-tive, ne consiste plus seulement dans le mouvement du passé vers le futur, mais se révèle plutôt comme anticipation de la fin, comme prolepse du royaume, et donc comme manifestation du futur dans le présent. ce qui est crucial, c’est que cette orientation ne fonde pas non plus une autorité du futur, prophétique, car, à l’inverse de la conception luthérienne, le mouvement ne va pas du présent vers le futur, mais inversement du futur vers le présent – le rôle de l’esprit est bien d’annoncer « les choses à venir », d’actualiser le futur. on saisit
26. voir peterson (1925). voir également le commentaire très éclairant de Karsenti (2011).
27. À cet égard, et pour appuyer cette interprétation, on remarquerait que la consé-quence de cette importance du passé, est la dévalorisation de la fonction prophétique dans le catholicisme – le prophétisme est achevé puisque l’incarnation a accompli le temps messianique. voir vauchez, 2012, en particulier pp. 61-126.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
Jean-Philippe Heurtin154
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 154 / 256
- © PUF - 20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 155 / 256
- © PUF -
dès lors que le présent se constitue comme la rencontre de ce passé et de ce futur, là où « les extrémités des éons se rencontrent » (1cor, 10-11) ; il est le kairós défini par paul. la dimension pneumatique de la vie ecclésiale, entendue comme le foyer vers lequel tendent les deux types de compréhension de l’apostolicité, est liée à la manière, pour reprendre la formule de Kojève, « d’assurer une « “présence réelle” du Passé et de l’Avenir » (Kojève, 2004, p. 127). ce présent est ainsi le temps de l’église même, et c’est ce présent qui est la source d’une autorité. or, selon Kojève :
« un tel présent (humain ou “historique”) n’est rien d’autre que l’action au sens fort du terme, l’action qui réalise dans le présent tant le souvenir du passé que le projet d’avenir. […] le présent ne se “manifeste” sous une forme “autoritaire” que dans la mesure où il se réalise en tant qu’action proprement dite » (Kojève, 2004, pp. 127-128).
et l’action de l’église est précisément celle de l’actualisation de la révélation comme rassemblement et comme communion (Zizioulas, 1981, p. 99) – communion qui se réalise, par excellence, dans l’office, c’est-à-dire dans l’eucharistie.
Le développement de l’Église catholique en hiérocratie et la secondarisation de la pneumatologie
L’Église catholique, une institution non pneumatique ?
il reste que le charisme de fonction catholique a connu un important développement, entre le iie et le xiie siècle, qui l’a profon-dément modifié, et l’a en partie vidé de son sens. plusieurs facteurs partiellement liés ont contribué à ce développement. il faut d’abord souligner – premier facteur – le déclin et la transformation de la dimension eschatologique dans l’église latine. comme l’a montré taubes, entre le iie et le ive siècle, les espérances eschatologiques déclinent, et la théologie en porte la marque avec le remplacement progressif du christ qui vient par le christ qui est là présent, et la raréfaction corrélative des apocalypses – le chiliasme n’étant sans doute plus porté que par les couches les plus populaires28. comme le relève taubes, ce mouvement qui trouve son couronnement avec
28. le chiliasme est une variante du millénarisme (du grec ancien khiliasmos : « mille ») soutenant l’idée d’un règne terrestre de mille ans du messie, après sa parousie et qu’il aura chassé l’antéchrist et préalablement au Jugement dernier.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 154 / 256
- © PUF -
155L’autorité du présent
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 155 / 256
- © PUF -
augustin, désinvestit le futur pour verser l’attente eschatologique dans le présent de l’église :
« augustin inverse précisément ce caractère à venir de l’empire millénaire : à son avis, le chiliasme de l’avenir passe à côté du sens de l’apocalypse de Jean. car “maintenant déjà, l’église est le royaume du christ et le royaume céleste”. » (taubes, 2009, p. 99).
dans le même temps, l’eschatologie individuelle prend la place de l’eschatologie universelle : « le destin de l’âme est désormais au centre, et la fin des temps est remplacée par le dernier jour de la vie humaine. » (taubes, 2009, p. 100). mais, – et c’est un deuxième facteur d’évolution –, l’individualisation et l’intériorisation de l’eschatologie a eu une répercussion importante sur la pneumato-logie chrétienne latine. la disparition dans les sommes théologiques de conception de l’histoire dotée d’une direction et orientée vers un but concentre d’abord le regard sur le passé de l’incarnation, et délimite dès lors l’autorité des ministres comme une autorité du passé, autorité des pères, dans la perspective tout historique de la succession apostolique : « rien ne doit être innové qui ne soit transmis par la tradition29. » mais elle affaiblit, par suite aussi, le rôle eschatologique de l’esprit dans sa représentation actuelle des fins dernières. de plus en plus, l’esprit voit sa nouvelle mission de paraclet passer au second plan, au profit de la tâche d’actualisation du passé de l’incarnation, et est largement refoulé.
on peut mettre en relation cette secondarisation du pneuma dans l’église catholique avec un troisième facteur, qui est celui du recul, entre la fin du xiie et le début du xiiie siècle, de l’élection dans les procédures de désignation des évêques – en particulier, avec l’exclusion des laïcs du corps électoral, la réduction de celui-ci aux chanoines de l’église cathédrale, et les interventions directes de plus en plus fréquentes du pape30. les révélations de l’esprit, liées à la nouvelle mission du paraclet, entrent toutefois en tension avec la tradition et l’institution. cette tension a, de fait, été résolue histori-quement par un développement – au sens wébérien du terme – de l’institution ecclésiale vers une forme de christomonisme, c’est-à-dire une théologie qui consiste dans une tendance à vouloir enserrer
29. saint vincent de lérins, Commonitorium, 6, cité par sachot, 2011, p. 214. 30. voir Gaudemet, 1979. dès le décret de Gratien, dans sa Distinction lxiii, on
peut lire : « que les laïcs n’interviennent pas dans l’élection des pontifes. qu’aucun laïc, qu’aucun puissant n’intervienne dans l’élection ou la promotion d’un patriarche, d’un métropolitain ou d’un évêque… »
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
Jean-Philippe Heurtin156
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 156 / 256
- © PUF - 20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 157 / 256
- © PUF -
toute la divinité en la personne de Jésus-christ, et pour laquelle la figure de l’esprit est reléguée à une position subalterne, en tout cas, secondaire, comme simple « vicaire » (vicarius christi). mais, cette relégation de la pneumatologie a eu aussi comme conséquence de concentrer l’attention sur l’institution, en tant que porteuse de la délégation « juridique » du christ. de manière concomitante, à partir du début du xiie siècle, un quatrième facteur d’évolution, a renforcé ce mouvement avec la constitution de manière autonome du droit canonique et son détachement de la théologie31. en parti-culier, et cela dès le xie siècle, les canonistes vont raffiner et rationa-liser une série de questions qui entrent dans le champ de la validité sacramentelle des actes ministériels. dans l’ensemble, il semble que la contribution des canonistes a été d’amplifier la séparation de la personne et de la fonction, et de renforcer la dimension formelle des actes ecclésiaux, en affaiblissant de manière corrélative la conception pneumatique des sacrements (Gaudemet, 1989, p. 10). l’ensemble de ces éléments a eu pour conséquence de mettre l’accent sur l’impor-tance des ministères, du fait de l’autorité fonctionnelle du prêtre en matière de sacrement32, et sur la forme institutionnelle, au détriment de la dimension épiclétique des actes ecclésiaux.
De l’autorité du charisme de fonction à la domination hiérocratique
il y a eu initialement, comme on l’a vu, dans l’ecclésiolo-gie catholique, une articulation de l’institution et de la grâce : le charisme est ainsi apparu encadré par l’institution, l’esprit ne s’expri-mant qu’au travers de formes juridiquement instituées. reste toute-fois à comprendre de quel droit il s’agit. peterson, dans une note de son texte sur l’église, indique tout d’abord que « “droit” est évidem-ment pris ici au sens de jus divinum » (peterson, 1928, p. 179, n. 15), et la centralité de l’eucharistie permet de mieux comprendre le « droit » de l’église : le caractère liturgique de ces actes indique que ce droit est essentiellement un droit des sacrements33. le droit sacré
31. voir Gaudemet, 1989.32. sur ce point, voir la mise au point nuancée d’Y. congar (1970).33. « ce que l’église reconnaît comme opéré en elle par dieu constitue un droit qui
est sacramentel et divin, jus divinum. » (congar, 1973, p. 266). ceci rejoint, par certains aspects la position de r. sohm. si celui-ci est en effet critique du droit canon, en tant que droit d’organisation, il ne l’est en aucun cas du « droit sacramentaire ». il répète ainsi, à de multiples reprises que « l’ordre même de l’église (sa constitution fondamentale) a pris naissance à partir de l’ordre même de la célébration eucharistique » (sohm, 1892, p. 1 et p. 700).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 156 / 256
- © PUF -
157L’autorité du présent
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 157 / 256
- © PUF -
est donc fondamentalement « habilitant », et renvoie donc concrè-tement à « des actes donateurs de statut ». ce sont ainsi le Baptême et l’eucharistie, qui font entrer les individus dans la communion des chrétiens. À ce droit a correspondu un sacrement, celui de l’ordre. l’ordination, – dont on a vu qu’il s’agissait aussi d’une opération charismatique –, donne une autorité et délimite une compétence pour administrer avec validité certains sacrements. il s’agit, en ce sens, d’une délégation juridique : « s’il y a un jus divinum dans l’église, c’est parce que c’est le fils de dieu qui a délégué légalement les “douze” » (peterson, 1928, p. 179, n. 15). en vertu de la tradi-tion, l’église ordonne, baptise, exclut des membres – essentiellement donc des sacrements.
toutefois, cette compétence – ou cette autorité – a été, avec la relégation progressive de la pneumatologie, lue comme pouvoir. s’il ne peut être question ici de restituer l’histoire de ce dévelop-pement, remarquons qu’elle a été certainement marquée par la distinction progressive, mais acquise entre la fin du xie siècle et le xiie siècle entre deux types d’actes et de compétences : l’ordinatio et la juridictio34. la juridiction renvoie au processus même de décision, et désigne la capacité de dire le droit et de juger, un pouvoir d’inté-grer et d’exclure, de lier et de délier. en sorte que, comme le souli-gne laurent villemin (2003), il « recouvre une réalité beaucoup plus vaste qu’il serait plus exact d’appeler pouvoir de gouvernement ». si ce pouvoir était initialement confié à ceux qui étaient ordonnés, la juridictio s’est progressivement détachée de l’ordinatio :
« une telle autorité découlant de la juridiction pouvait être exercée par quiconque en avait reçu délégation. le pape, par exemple, pouvait déléguer un diacre pour siéger comme juge d’une dispute entre deux évêques » (Berman, 2002, p. 221) 35.
À partir du xiie siècle, les décrétistes ont systématisé la distinc-tion entre pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction, contribuant ainsi à séparer le pouvoir sur les sacrements et le gouvernement de l’église, mais aussi, du coup, à détacher le principe de la domination hiérocratique de toute forme d’office charismatique36.
ainsi, si l’on a souligné que la définition de la domination charismatique chez Weber n’est caractérisée par aucune « sanction »,
34. sur les notions d’ordre et de juridiction, voir villemin, 2003.35. de même, des « princes-évêques », issus de la noblesse pouvaient être insti-
tués en vue du gouvernement d’un diocèse, et cela sans être ordonnés, et ne bénéficiant d’aucun pouvoir sacramentel.
36. voir Gaudemet, 1985 ; villemin, 2003.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
Jean-Philippe Heurtin158
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 158 / 256
- © PUF - 20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 159 / 256
- © PUF -
il n’en va pas de même dans l’église : l’ordre qui lui est associée est un « droit », en ce que sa validité est « garantie extérieurement par la chance d’une contrainte […], grâce à l’activité d’une instance humaine, spécialement instituée à cet effet, qui force au respect de l’ordre et châtie la violation » – la spécificité de cet ordre étant, par ailleurs, que cette contrainte utilisée « pour garantir ses règlements » est d’ordre psychique, « par dispensation ou refus des biens spirituels du salut (contrainte hiérocratique) » (Weber, 1971, p. 57).
Le charisme de fonction et l’esprit de la bureaucratie
La contribution du charisme de fonction à la formation de la bureaucratie légale-rationnelle
l’analyse du charisme de fonction resterait d’une portée limitée si elle ne renvoyait qu’à une sociologie implicite du catholicisme, – qui plus est d’un catholicisme antérieur au xiie-xiiie siècles. mais Weber a indiqué lui même la voie d’un élargissement de la pertinence du concept, en le désignant comme le lieu initial du déploiement de la bureaucratie. l’achèvement du développement du christianisme primitif est, en effet, comme l’a souligné Wolfgang schluchter, « la formation de l’église chrétienne, la première bureaucratie rationnelle que connaît l’histoire mondiale » (schluchter, 1988, p. 248). or, le charisme de fonction apparaît précisément comme l’opérateur du passage à la bureaucratie. il a contribué, en effet, à cette formation de deux manières : en configurant d’abord une organisation rationnelle et en la conformant à un mode de fonctionnement légal ; en propo-sant ensuite un fondement à la domination bureaucratique.
la première contribution du charisme de fonction à la forma-tion de la bureaucratie, est, sur le versant légal-rationnel, d’avoir d’abord poussé à un détachement entre l’office et la personne, de sorte que la dépersonnalisation qui en résulte interdise une appro-priation quelconque de la fonction. sans doute, aura-t-il fallu pour que ce développement soit complet que fût affirmé le character indele-bilis du prêtre – et ceci n’est réalisé précisément que tardivement, et probablement pas avant le xiiie siècle d’innocent iii. selon Weber, ce « character indelebilis » a permis la bureaucratisation :
« la théorie catholique du character indelebilis du prêtre avec sa séparation rigoureuse entre le charisme de fonction et la dignité de la personne constitue l’exact opposé du rejet puritain du charisme de
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 158 / 256
- © PUF -
159L’autorité du présent
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 159 / 256
- © PUF -
fonction. ici nous rencontrons la forme la plus radicale d’objectivation du charisme et de sa transformation en une qualification qui est intrinsèque à quiconque est devenu un membre de la hiérarchie des offices […]. cette objectivation a été le moyen par lequel un mécanisme hiérocratique a été implanté dans un monde qui voyait partout devant lui des capacités magiques. ce n’est que lorsque le prêtre a pu être absolument dépravé, sans que pour autant cela remette en question sa qualification charismatique, que la bureaucratisation de l’église a été possible. » (Weber, 1972, p. 776).
la formule de délégation juridique de la succession aposto-lique, au principe du charisme de fonction, a, ensuite, parti-cipé à rationaliser et formaliser l’accès à l’office, en instaurant des formes de vérification des compétences par le biais d’une éduca-tion charismatique, et en substituant à une opération initialement « magique » d’ordination, une procédure seulement formelle37. perfectionnée par les canonistes, cette formule a également organisé les ministères autour d’un cosmos de règles abstraites, définissant une hiérarchie interne des offices dans l’église, des compétences et, de manière plus générale, un mode de conduite légitime, rationnel et légal.
enfin, et plus encore sans doute, le charisme de fonction a ouvert la voie à l’idée, tout comme à la pratique, « d’une connaissance, d’une création et d’un contrôle rationnels » (Weber, 1992, p. 354) du droit, caractéristique de la domination légale. dans ce type de domination légale, Weber, affirme en effet que
« tout droit est dans son essence un cosmos de règles abstraites, normalement décidées intentionnellement : justice, application de ces règles au cas particulier, administration, surveillance rationnelle des intérêts prévus par les règlements du groupement dans la limite des règles juridiques et selon des principes généralement déterminés, lesquels rencontrent l’approbation, ou du moins ne rencontrent aucune désapprobation, auprès des règlements du groupement » (Weber, 1971, p. 223).
mais, on a vu que l’autorité charismatique des ministres catho-liques dans la prononciation du dogme et dans les actes sacramen-tels de leur compétence supposait que se manifestât l’esprit sous la forme d’une réception. et Weber a insisté, dans sa réinterpré-tation anti-autoritaire du charisme, sur le fait que la dimension
37. voir Weber, 1972, p. 675.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
Jean-Philippe Heurtin160
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 160 / 256
- © PUF - 20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 161 / 256
- © PUF -
d’approbation et de contrôle était en germe dans la reconnaissance des directives charismatiques :
« de même, la reconnaissance des directives juridiques charisma-tiques devient alors, dans la communauté, la représentation que la communauté peut établir, reconnaître et abroger le droit selon sa volonté, aussi bien en général que pour le cas particulier – alors que les cas de litige sur le droit “adéquat” se réglaient, sous une domination authentiquement charismatique, certes souvent dans les faits par une décision de la communauté, mais sous la pression psychologique ressortant de ce qu’il n’y a qu’une unique décision conforme au devoir et adéquate. on s’approche ainsi du traitement du droit de la représentation légale. » (Weber, 1971, p. 275, traduction modifiée).
ce que nous avons pu découvrir, c’est que cette dimension n’est nullement le fait d’un développement dans « un sens non autori-taire » du charisme, mais qu’elle est la traduction même du caractère pneumatique des actes ecclésiaux que signifie la procédure de recep-tio, et qui constitue leur autorité même.
Le charisme de fonction comme fondement invisible de la légitimité légale-rationnelle
mais le charisme de fonction a contribué également d’une seconde manière à la formation historique de la bureaucratie occidentale, en proposant un fondement au type d’autorité qu’elle cherche à imposer. À certains égards, on peut même dire, que le modèle de l’église catholique et son charisme de fonction permet – aurait permis – de lever certaines des ambiguïtés et de résoudre certaines des apories de l’idéal-type de la domination légale rationnelle tel que l’a concep-tualisé Weber. la difficulté majeure, souvent soulignée, de la construc-tion wébérienne de ce type38 est qu’en effet, on ne comprend guère les fondements de la domination. cette difficulté a trait à la place de la croyance. la croyance semble, en effet, dans ce type, s’orienter par rapport à un ordre impersonnel conforme à des règles :
« la validité de cette légitimité peut principalement revêtir : un caractère rationnel, reposant sur la croyance en la légalité des règlements arrêtés et du droit de donner des directives qu’ont ceux qui sont appelés à exercer la domination par ces moyens (domination légale). […] dans le cas de la domination statutaire [satzungsmäßig], on obéit à l’ordre
38. voir par exemple, ricœur, 1997 ; colliot-thélène, 1992.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 160 / 256
- © PUF -
161L’autorité du présent
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 161 / 256
- © PUF -
impersonnel, objectif, légalement arrêté, et aux supérieurs qu’il désigne, en vertu de la légalité formelle de ses règlements et dans leur étendue. » (Weber, 1971, p. 222).
on ne doit pas, dans ce cadre, obéissance aux autorités en tant qu’elles sont des individus, mais en tant qu’elles sont représenta-tives de l’ordre impersonnel. dans le type le plus pur de domina-tion légale – la domination par le moyen de la direction administrative bureaucratique –, cette domination est exclusivement identifiée par les moyens auxquels elle a recours :
« par conséquent, le détenteur légal type du pouvoir, le “supérieur”, lorsqu’il statue, et partant lorsqu’il ordonne, obéit pour sa part à l’ordre impersonnel par lequel il oriente ses dispositions. […] les membres du groupement, en obéissant au détenteur du pouvoir, n’obéissent pas à sa personne mais à des règlements impersonnels ; par conséquent ils ne sont tenus de lui obéir que dans les limites de la compétence objective, rationnellement délimitée, que lesdits règlements fixent. » (Weber, 1971, p. 223).
dans la même logique, aucune des règles, énumérées par Weber (1971, pp. 226-228), concernant les titulaires de fonction adminis-trative, n’a de rapport avec la croyance. dans la domination légale, il y a une indifférence de la définition des dirigeants au type – ou plutôt une hétérogénéité au type –, alors que dans la domination tradition-nelle ou charismatique, il y a une définition qui est interne au type de domination39. on ne voit, dès lors, pas ce qui fonde véritable-ment la croyance en la légitimité des dirigeants. comme l’a souligné catherine colliot-thélène,
« la croyance en la sainteté de la tradition, à la vertu héroïque ou la valeur exemplaire du chef ou du prophète, dans le cas de la domination charismatique, médiatise l’obéissance des dominés à l’ordre des pratiques dans lequel ils s’intègrent. il est par contre impossible de discerner pour la domination légale ce qui constitue cette instance extra-positive d’où procède sa validité dans l’esprit de ceux qui s’y plient. » (colliot-thélène, 1992, pp. 229-230).
39. ainsi, dans la domination traditionnelle, « le détenteur du pouvoir (ou divers détenteur du pouvoir) est considéré comme conforme à l’ordre traditionnel. on lui obéit en vertu du statut qui lui est conféré par la tradition ». de même, dans la domination cha-rismatique : « nous appellerons charisme une certaine qualité d’une personnalité indivi-duelle, en vertu de laquelle elle est revêtue d’une aura extraordinaire et douée de pouvoirs surnaturels ou surhumains ou tout au moins exceptionnels, inaccessibles au commun des mortels ; ou encore qui est considéré comme envoyé par dieu ou comme un exemple, et en conséquence de quoi, cet individu est considéré comme un “chef”. »
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
Jean-Philippe Heurtin162
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 162 / 256
- © PUF - 20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 163 / 256
- © PUF -
c’est dire que livré à la seule logique légale rationnelle, ce type de domination ne donne aucune prise à sa reconnaissance. pour qu’elle soit pleinement légitime, il faut donc à la domination légale rationnelle adjoindre des raisons individuelles et des justifi-cations collectives qui viennent donner un objet à la croyance, et donc à la reconnaissance. c’est ce que Weber remarque quand il écrit que « la domination bureaucratique a donc fatalement à sa tête un élément au moins qui n’est pas purement bureaucratique » (Weber, 1971, p. 227). tout se passe donc comme si la rationa-lité bureaucratique est, comme le suggère ricœur, une rationalité limitée fonctionnant au sein d’un système qui suit des règles diffé-rentes (ricoeur, 1997, p. 276). cet « élément au moins qui n’est pas purement bureaucratique » peut, à l’évidence, être de nature traditionnelle (comme dans le cas des monarchies constitution-nelles), mais, il est possible de le penser aussi et surtout à partir de la notion de charisme de fonction. l’hypothèse que nous formons est donc que c’est cette notion qui, en particulier dans les sociétés modernes, fournit – à l’évidence au prix de sa sécularisation – le fondement de la légitimité dans les formes d’organisation relevant de la légalité rationnelle.
Weber a lui-même ouvert la possibilité d’une telle construction, en indiquant les voies d’une sécularisation de la notion. comme avec la notion de charisme personnel telle que développée par Weber, ces voies de sécularisation ont partie liée avec une transformation de l’économie de la reconnaissance. la reconnaissance est l’enjeu des développements de la section 2 du chapitre ix de la deuxième partie de Wirtschaft und Gesellschaft. Weber, dans cette section, parcourt tout le développement des procédures de désignation depuis celle des magistrats romains, puis des empereurs, des rois germaniques, des papes et des évêques, jusqu’aux formes plébiscitaires et enfin démocratiques du choix des chefs partisans dans les régimes parle-mentaires (Weber, 1972, p. 664 sq.). cette ligne de développe-ment peut être éclairée par la section du chapitre 3, intitulée : « le charisme réinterprété en dehors de toute relation de domination ». de manière caractéristique, la sécularisation du concept de charisme, en abandonnant justement la réduction du charisme à un système de domination, débouche sur une interprétation du charisme en un sens non autoritaire :
« le principe charismatique de légitimité, interprété dans son sens premier comme autoritaire, peut être interprété au contraire dans un sens antiautoritaire. la validité effective de l’autorité charismatique
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 162 / 256
- © PUF -
163L’autorité du présent
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 163 / 256
- © PUF -
repose en fait entièrement sur la reconnaissance, à condition que celle-ci soit confirmée, par ceux qui sont dominés. cette reconnaissance est conforme au devoir envers celui qui est qualifié charismatiquement, et par conséquent légitime. mais, dans une rationalisation croissante des relations du groupement, il est aisé de concevoir que cette reconnaissance est considérée comme le fondement de la légitimité au lieu d’en être la conséquence (légitimité démocratique). […] le détenteur du pouvoir est alors le chef librement élu. » (Weber, 1971, p. 275).
cette réinterprétation du charisme suppose, on le voit, un déplacement par rapport au ressort de l’autorité charismatique, telle que définie par Weber dans sa typique des formes de domina-tion. celle-ci, comme on l’a vu, ne faisait en aucune manière de la reconnaissance la source de la légitimité – la reconnaissance est d’abord reconnaissance du charisme déjà-là. or, la réinterpréta-tion que propose Weber fait de cette reconnaissance le fondement même de la légitimité « au lieu d’en être la conséquence ». cette réinterprétation apparaît très curieuse, et est, au vrai, incompréhen-sible, dans l’économie du concept de charisme personnel. elle ne peut, en fait, se comprendre véritablement que dans le cadre du seul charisme de fonction – au prix, donc d’une sécularisation de l’élec-tion, désormais dépourvue de sa qualité de manifestation de l’esprit saint. l’élection n’est plus, dans cette réinterprétation, une recon-naissance du charisme personnel, mais est proprement la procédure qui confère le charisme :
« celui qui était détenteur légitime du pouvoir en vertu de son charisme propre devient alors détenteur du pouvoir par la grâce des gouvernés qui l’élisent et l’installent librement (dans la forme) selon leur gré, voire, éventuellement, l’écartent – de même que la perte du charisme et de sa confirmation a entraîné la perte de la légitimité authentique. » (Weber, 1971, p. 275, traduction modifiée).
dans ces évolutions, ce qui est, malgré tout, perdu, c’est la dimen-sion tant de l’extra-quotidien (außeralltäglich) que de l’extra-ordinaire (außerordentlich)40. dans les passages qu’il consacre à l’objectivation du charisme, Weber n’emploie plus que le terme d’außergewöhnlich (qui sort de l’ordinaire, du commun), renvoyant à l’idée que ces offices ne sont pas « accessibles à tous » (Weber, 1972, pp. 670-671), et qu’en définitive, on a affaire à une élite sélectionnée – en particulier via
40. ces termes ne sont, de manière significative, pas employé dans les passages que Weber consacre au charisme de fonction.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
Jean-Philippe Heurtin164
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 164 / 256
- © PUF - 20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 165 / 256
- © PUF -
une « éducation charismatique »41. c’est ce caractère qui fait dire à Weber que l’on a affaire encore à une forme de charisme.
Conclusion : une interprétation du plaidoyer wébérien pour le chef charismatique
la manière dont on a cherché à préciser les contours concep-tuels du charisme de fonction a permis de le faire apparaître comme un élément sous-jacent mais invisibilisé de la construction concep-tuelle de la domination légale-rationnelle. elle peut permettre aussi de dessiner la place d’une « légitimité démocratique » au sein même des bureaucraties modernes. on a vu que Weber introduisait cette expression dans sa « réinterprétation du charisme en dehors de toute relation de domination ». l’introduction de cette légiti-mité démocratique est explicitement une tentative pour penser une relation de groupement qui s’éloigne du cadre de la domination, et ce qu’a en vue Weber, c’est bien une relation où, écrit-il non sans ambiguïté, l’élu « devient le “serviteur” de ceux qu’il domine » (Weber, 1971, p. 352). mais, cette caractérisation renvoie bien à la forme symbolique, élaborée avec le charisme de fonction dans le christianisme primitif, où le titulaire d’une fonction ecclésiale était à la fois « élu », et se présentait comme au service de la commu-nauté – on se souvient, à cet égard, que « ministre » signifie précisé-ment « serviteur ». une traduction historique de cette conception se trouve, chez Weber, dans les descriptions de « démocratie directe » des townships nord-américain ou de certains cantons suisses :
« une fois appliqué au chef, le principe d’“élection” comme interprétation du charisme peut aussi s’appliquer à la direction administrative. les fonctionnaires élus, qui sont légitimes en vertu de la confiance de ceux qu’ils dominent et qui, par suite, peuvent être révoqués par une déclaration de défiance de ceux-ci, sont tout à fait représentatifs des “démocraties” d’un certain type, par exemple en amérique. » (Weber, 1971, p. 350).
sans doute, Weber reste-t-il sceptique sur la portée de tels exemples, et leur capacité à servir de modèle à des administrations de taille plus large. plus profondément, comme le montre colliot-thélène, il s’agit de modèles qui tendent à la réduction, voire
41. voir à ce sujet Weber, 1972, pp. 677-679.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 164 / 256
- © PUF -
165L’autorité du présent
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 165 / 256
- © PUF -
à l’invisibilisation de la domination, et non à son élimination42. on peut penser que ce scepticisme tient aussi à la difficulté qu’a eu Weber à distinguer la domination de l’autorité. or, le charisme de fonction, au moins dans sa forme primitive, renvoie – du moins a-t-on cherché à le montrer – à une forme politique qui est sans doute autoritaire, mais sans domination : il suppose la reconnais-sance d’une autorité, et engendre bien une obéissance, mais une obéissance, exempte de contrainte, une « obéissance libre ». de ce point de vue, les formes de démocratie directe cherchent bien à minimiser la domination et l’autorité (en particulier via les moyens techniques décrits par Weber : durée réduite de la fonction, droit de rappel, mandat impératif, etc.), mais les procédures électorales des démocraties représentatives modernes, en particulier dans les cas de « représentation libre », minimisent la domination sans toucher au caractère d’autorité sur le groupement. dans ces derniers cas, en effet, comme le note Weber, le représentant est alors « le maître choisi par les électeurs et non leur “serviteur” » (Weber, 1971, p. 301). et cela, à nouveau, ne peut se comprendre que si les représentants élus sont reconnus comme dépositaires d’un charisme de fonction.
on saisit dès lors la logique profonde du plaidoyer wébérien pour une démocratie plébiscitaire, et son vœu de voir émerger des chefs charismatiques. il est clair que si cet appel est, pour lui, la dernière chance d’une résistance à l’empire de la bureaucratie, et à l’anéan-tissement de toute forme d’individualisme et de « vraie liberté »43, il peut se laisser interpréter comme le vœu de faire (ré)apparaître à l’intérieur de la bureaucratie un porteur de charisme de fonction et son autorité dont le ressort électif est étranger aux mécanismes de la rationalité bureaucratique, dans la visée d’en contrecarrer la puissance mortifère – quand elle est devenue l’« ultime et unique valeur » qui décide « de la manière dont les affaires doivent être menées » (Weber, 2004, p. 336) . il ne saurait être question, en effet, d’entendre l’appel au Führer comme l’attente d’un personnage au charisme personnel, extérieur à la sphère de l’état. là-dessus, Weber est particulièrement clair, tant est grande sa détestation de l’irrationalité des masses, se soulevant, soit d’elles-mêmes, soit conduites par un leader disposant d’un charisme seulement personnel. au contraire, le chef charis-matique, l’homme politique de la profession/vocation, n’est une figure intéressante pour Weber, que s’il « participe au pouvoir et à la
42. voir colliot-thélène, 2014.43. voir Weber, 2004, p. 337 et passim.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
Jean-Philippe Heurtin166
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 166 / 256
- © PUF - 20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 167 / 256
- © PUF -
responsabilité dans l’État » (Weber, 2004, p. 352). le chef charisma-tique est intérieur à l’état, et apparaît précisément comme une figure mixte qui ressortit à la fois de la domination charismatique et de la domination légale, comme une forme de transition entre l’ordre proprement charismatique et l’ordre purement légal-bureaucratique44. ainsi, le président élu, appartient-il à l’ordre légal-rationnel, dans la mesure même où son poste – son office – s’inscrit dans un cosmos de règles abstraites, qui définissent sa compétence et sa place dans la hiérarchie bureaucratique (Weber, 1971, pp. 271-272, 276-277, 223) ; mais son élection marque la reconnaissance du caractère charismatique de sa fonction.
la compréhension de la place du charisme de fonction au sein même de la domination légale permet de comprendre enfin la nature de l’autorité du détenteur du pouvoir supérieur. on a spécifié l’auto-rité associée au charisme de fonction, comme autorité du présent. or, le plaidoyer que max Weber lance en faveur de l’homme poli - tique reprend précisément des éléments centraux de ce type d’auto-rité. en effet, quand, dans la conférence sur « le métier et la vocation politique », Weber cherche à thématiser les « qualités essentielles et décisives pour l’homme politique », il énumère « la passion, le senti-ment de la responsabilité, le coup d’œil » (Weber, 2003, p. 182). ces trois éléments apparaissent, de fait, comme les principes essentiels au nouage du passé et du futur dans le présent. la passion, poursuit, ainsi Weber doit s’entendre « au sens de l’attachement à la cause : se dévouer passionnément à une “cause”, au dieu ou au démon qui l’ordonne » (Weber, 2003, p. 182). or, la cause est un élément antérieur dans le mouvement de l’action : elle est l’impulsion passée qui motive l’engagement. mais le futur est également présent dans les qualités de l’homme politique authentique, et qui apparaît sous l’espèce des conséquences de l’action :
« le partisan de l’éthique de responsabilité comptera justement avec les défaillances communes de l’homme […], et il estimera ne pas pouvoir se décharger sur les autres des conséquences de sa propre action pour autant qu’il aura pu les prévoir. il dira donc : “ces conséquences sont imputables à ma propre action”. » (Weber, 2003, p. 193).
si l’homme politique qui agit selon l’éthique de la conviction est tout entier orienté vers le futur, et la poursuite de sa cause, celui
44. Je reprends ici l’expression d’Yves sintomer (1999, p. 110), qui interprète ce caractère mixte comme une imprécision sémantique, alors qu’il s’agit selon nous d’un caractère inhérent au charisme de fonction.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 166 / 256
- © PUF -
167L’autorité du présent
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 167 / 256
- © PUF -
qui agit selon l’éthique de la responsabilité doit « assumer les consé-quences (prévisibles) de son action » (Weber, 2003, p. 192). mais cette maxime suppose un mouvement de retour du futur dans le présent – à la manière dont l’esprit saint, dans la théologie catholi-que et orthodoxe rend présent les eschata dans le présent ecclésial. cette importance du présent, est enfin affirmée dans la qualité du coup d’œil : ce coup d’œil (augenmaß), c’est l’intuition du présent, le sens de la mesure et des réalités présentes, un sens du kairòs, de l’occasion et de l’instant présent.
Jean-philippe heurtinUniversité de Strasbourg/SAGE
références BiBlioGraphiques
Barth K., 1969, La Théologie protestante au dix-neuvième siècle. Préhistoire et histoire, Genève, labor et fides.
Berman h. J., 2002, Droit et révolution, aix, librairie de l’université d’aix.Breuer s., 1996, « le charisme de la raison », Annales d’Histoire
Économique et Sociale, 51, 6, pp. 1289-1301. colliot-thélène c., 1992, Le Désenchantement de l’État. De Hegel à Max
Weber, paris, minuit.colliot-thélène c., 2014, « démocratie et domination charisma-
tique », in Bernadou v., Blanc f., laignoux r., roa Bastos f. (eds), Que faire du charisme. Retour sur une notion de Max Weber, rennes, pur, 2014, pp. 87-108.
congar Y., 1966, « composantes et idée de la succession apostolique », Œcumenica, pp. 61-80.
congar Y., 1970, « pneumatologie ou “christomonisme” dans la tradi-tion latine ? », in Ecclesia a Spiritu Sancto edocta. Mélanges théologiques. Hommages à Mgr. Gérard Philips, Gembloux, duculot, pp. 394-416.
congar Y., 1972, « la réception comme réalité ecclésiologique », Concilium, 77, pp. 51-72.
congar Y., 1973, « rudolph sohm nous interroge encore », Revue des sciences philosophiques et théologiques, 57, pp. 263-294.
disselkamp a., 2006, « la typologie église-sectes-mystique selon ernst troeltsch », L’Année sociologique, 56, 2, pp. 457-474.
faivre a., 2007, « la question des ministères à l’époque paléochré-tienne. problématiques et enjeux de la périodisation », in delage p.-G. (ed.), Les Pères de l’Église et les ministères. Évolutions, idéal et
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
Jean-Philippe Heurtin168
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 168 / 256
- © PUF - 20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 169 / 256
- © PUF -
réalités, actes du iiie colloque de la rochelle, 7-9 septembre 2007, association histoire et culture, la rochelle, 2008, pp. 3-38.
Gaudemet J., 1979, Les Élections dans l’Église latine des origines au xvie siècle, paris, lanore.
Gaudemet J., 1985, « pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction. quelques repères historiques », L’Année canonique, 29, pp. 83-98.
Gaudemet J., 1989, « théologie et droit canonique. les leçons de l’his-toire », Revue du droit canonique, 39, 1-2, pp. 3-13.
Gaudemet J., 1994, Église et Cité. Histoire du droit canonique, paris, cerf.Goguel m., 1947, « pneumatisme et eschatologie dans le christianisme
primitif (premier article) », Revue de l’histoire des religions, 133, 1, pp. 103-161.
haley p., 1980, « rudolph sohm on charisma », The Journal of Religion, 60, 2, pp. 185-197.
hanke e., 2001, « max Weber “herrschaftssoziologie”. eine werkges-chichtliche studie », in hanke e., mommsen W., 2001 (eds), Max Webers Herrschaftssoziologie. Studien zu Entstehung und Wirkung, tübingen, mohr siebeck, pp. 19-46.
harnack a. von, 2003, Marcion. L’Évangile du Dieu étranger. Une monogra-phie sur l’histoire de la fondation de l’Église catholique, paris, cerf, [1ère édition, 1921].
hatscher, c. r., 2000, Charisma und res publica: Max Webers Herrschaftssoziologie und die Römische Republik, stuttgart, steiner.
Karsenti B., 2011, « autorité et théologie. peterson et la définition chrétienne du dogme », Archives de philosophie, 74, pp. 149-168.
Kojève a., 2004, La Notion de l’autorité, paris, Gallimard.Kroll t., 2001, « max Webers idealtypus der charismatischen herrschaft
und die Zeitgenössiche charisma-debatte », in hanke e., mommsen W., (eds), Max Webers Herrschaftssoziologie. Studien zu Entstehung und Wirkung, tübingen, mohr siebeck, pp. 47-63.
peterson e., 1925, « qu’est-ce que la théologie ? », in Le Monothéisme : un problème politique et autres Traités, traduit de l’allemand par anne- sophie astrup avec la collaboration de Gilles dorival pour le latin et le grec, préface de Bernard Bourdin, paris, Bayard, 2007, pp. 127-149.
peterson e., 1928, « l’église », in Le Monothéisme : un problème politique et autres Traités, traduit de l’allemand par anne-sophie astrup avec la collaboration de Gilles dorival pour le latin et le grec, préface de Bernard Bourdin, paris, Bayard, 2007, pp. 171-183.
riesebrodt m., 1999, « charisma in max Weber’s sociology of religion », Religion, 29, 1, pp. 1-14.
rouco-varela a., 1969, « die Katolische reaktion auf das “Kirchenrecht i” rudolph sohms », in scheuermann a., may G., eds, Ius Sacrum.Klaus Mörsdorf zum 60. Geburtstag, münchen, f. schöningh, pp. 15-52.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 168 / 256
- © PUF -
169L’autorité du présent
20 mars 2014 09:03 - L’Année sociologique vol. 64/2014 - n° 1 - Collectif - L’Année sociologique - 135 x 215 - page 169 / 256
- © PUF -
sachot m., 2011, L’Invention du Christ. Genèse d’une religion, paris, odile Jacob, pp. 209-210.
schluchter W., 1988, Religion und Lebensführung, band 2, Studien zu Max Webers Religion- und Herrschaftssoziologie, frankfurt-am-main, suhhrkamp.
sintomer Y., 1999, La Démocratie impossible ? Politique et modernité chez Weber et Habermas, paris, la découverte.
sohm r., 1887, Kirchengeschichte im Grundriss, leipzig, G. Böhme.sohm r., 1892, Kirchenrecht, leipzig, duncker & humbolt.taubes J., 2009, Eschatologie occidentale, paris, l’éclat.turner s., factor r., 1994, Max Weber: The Lawyer As Social Thinker,
london, routledge. vauchez a., 2012, ed., Prophètes et prophétisme, paris, seuil.villemin l., 2003, Pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction. Histoire théologi-
que de leur distinction, paris, cerf.Wang r., 1997, Cäsarismus und Machtpolitik. Ein historisch-bibliogra-
phische Analyse von Max Weber Charismakonzept, Berlin, duncker & humblot.
Weber m., 1970, Le Judaïsme antique, paris, plon.Weber m., 1971, Économie et société, paris, plon.Weber m., 1972, Wirtschaft und Gesellschaft, tübingen, mohr.Weber m., 1992, « essai sur quelques catégories de la sociologie compré-
hensive », in Essais sur la théorie de la science, paris, press pocket, pp. 301-364.
Weber m., 1996a, Sociologie des religions, paris, Gallimard. Weber m., 1996b, « l’éthique économique des religions mondia-
les (1915-1920) », in Weber m., 1996a, pp. 433-434. Weber m., 1996c « l’état et la hiérocratie », in Weber m., 1996a,
pp. 241-328. Weber m., 2003, Le Savant et le politique, paris, la découverte.Weber m., 2004, « parlement et gouvernement dans l’allemagne
réorganisée (1917) », in Oeuvres politiques (1895-1919), paris, albin michel, pp. 307-455.
Zizioulas J., 1981, L’Être ecclésial, paris, labor et fides.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 03
/05/
2014
10h
12. ©
P.U
.F.
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 03/05/2014 10h12. ©
P.U
.F.