The Influence of Aristide Cavaillé-Coll on French Romantic Organ Building and Organ Music
« Passé présent : Les Français et leur Révolution », EspacesTemps, n° 38-39, 1988, p. 25-35,...
Transcript of « Passé présent : Les Français et leur Révolution », EspacesTemps, n° 38-39, 1988, p. 25-35,...
Miroirs de la mémoire
Passé présent : les Français
et leur Révolution.
Une enquête qualitative, j
Collectif d'analyse de l'enquête*
L'enquête, dont ce numéro d' EspacesTemps publie les premiers résultats, a pour objectif de répondre à trois questions principales. 1. Quelle est l'image que les Français se font, deux cents ans après,
de leur Révolution ? 2. Quelles relations cette image entretient-elle avec l'ensemble du système de
représentations sociales, et notamment politiques, des enquêtes ? 3. Quelle influence les cérémonies du Bicentenaire peuvent-elles avoir sur cette
mémoire ? En d'autres termes s'agit-il d'une représentation définitivement fixée ou bien d'un ensemble en mouvement et donc d'un enjeu politique ? En lançant l'enquête, notre souci n'était donc pas de dresser un état de la
connaissance de la période révolutionnaire, mais de saisir l'image de celle-ci, afin de pouvoir mesurer en quel sens elle sera peut-être modifiée par la commémoration.
La représentation qu'ont les Français de la Révolution est-elle conforme aux stéréotypes courants ou présente-t-elle des surprises ? C'est ce que tente de préciser l'enquête qualitative menée par EspacesTemps sur la perception de la révolution. Les résultats font apparaître deux tendances contradictoires : un maintien des clivages traditionnels mais aussi de nouvelles manières de relire l'héritage révolutionnaire. * Yannick Bosc, Hélène Dupuy,
| Patrick Garcia, Serge Leroux, Isabelle Lespinet, Jacques Lévy, ' Brigitte Marin et Marie-Flore Mattei.
Le consensus, de la Bastille à la République.
Les enquêteurs se sont toujours gardés de suggérer des événements précis au cours des entretiens. Pour autant, soit spontanément, soit après relance, un certain nombre d'événements, de personnages, de groupes sociaux, de lieux, sont apparus comme illustration du propos ou bien encore comme véritable résumé de la révolution.
Des événements et des hommes. Cité explicitement par la plupart des enquêtes, le 14 juillet apparaît comme un véritable point de cristallisation de la mémoire collective et comme un épisode éminemment positif. La prise de la Bastille est « une fête », « un élan » des « petits » contre le symbole de « l'arbitraire » ; elle se déroule dans « la joie » et « l'unanimité ». Prendre la citadelle revient à « franchir une barrière vers la liberté ».
Cliché appris sur les bancs de l'école primaire que réactive la fête nationale ? Certes, mais l'événement a aussi valeur de véritable résumé de la Révolution, non seulement parce que beaucoup d'enquêtes ne conçoivent la Révolution que
EspacesTemps 38-39/1988, pp. 25-35
« La prise de la Bastille, c'est ça pour moi la Révolution, avec tout ce que ça comporte derrière, mais c'est là qu'elle a vraiment eu lieu. » (Commerçant.)
MIROIRS DE LA MÉMOIRE Passé présent : les Français et leur Révolution.
comme un épisode extrêmement court, mais surtout parce que le 14 juillet apparaît à leurs yeux comme l'instant le plus limpide, le moins discutable, le moins sanglant. Le 14 juillet 1789 est l'événement consensuel par excellence car il est perçu comme un moment d'unanimité nationale qui regroupe l'ensemble de la population.
Une enquête en deux vagues.
L'équipe qui s'est constituée autour de la revue pour mener l'enquête a lancé une série d'entretiens semi-directifs auprès d'un échantillon significatif de la population composé d'une centaine d'individus répartis sur le territoire national. Outre les informations d'usage (âge, sexe, profession...), les appartenances religieuse, syndicale et politique ainsi qu'une indication de vote (entre R. Barre, J. Chirac, J.-M. Le Pen, P. Juquin, A. Lajoinie, M. Rocard, F. Mitterrand ou autres) étaient demandées aux enquêtes (dans le texte de l'article, les mentions entre parenthèses ont la signification suivante : B, déclare voter pour R. Barre ; D, sentiment d'appartenance à la droite ; F N, déclare voter pour le Front National ; M, déclare voter pour F. Mitterrand ; R, favorable à M. Rocard ; NPOP, ne se prononce pas sur ses opinions politiques). Les entretiens ont été menés en février 1988 par F. Ayat (région de Toulouse), Y. Bordes (région de Bourges), F. Buchheit (région de Strasbourg), £. Folz (région de Lille), C. Lecoq (région de Rennes), S. Mariani (région de Lyon), B. Marin (région d'Aix-Marseille). N. Bencherasi, Y. Bosc, H. Dupuy, P. Iltis, S. Leroux, I. Les- pinet, J.-L. Margolin et L. Mercier ont participé à leur collecte en Ile-de-France. Le collectif d'analyse de l'enquête, auteur de cet article, est composé de Y. Bosc, H. Dupuy, P. Garcia, S. Leroux, I. Lespinet, J. Lévy, B. Marin et M.-F. Mattei (coordination de l'enquête : P. Garcia). Cet article rend compte d'un premier et partiel dépouillement. Il sera naturellement suivi d'autres publications. L'analyse servira de base à la réalisation d'un sondage quantitatif effectué en septembre/octobre 1988 auprès d'un échantillon représentatif de la population (1000 personnes). Une opération identique sera menée au terme des cérémonies du Bicentenaire afin de mesurer les effets de la commémoration sur les représentations collectives de la Révolution. Enfin, à l'issue de l'enquête, une exposition sur les trois commémorations de la Révolution (1889, 1939, 1989) sera réalisée à la Maison de La Villette. Nous tenons à remercier de leur aide la Maison de La Villette et sa directrice scientifique E. Philipp, la Commission Nationale de Recherche Historique pour le Bicentenaire de ta Révolution Française, la Mission Interministérielle pour le Bicentenaire et l'Association « Liberté, Egalité, Fraternité » sans lesquelles ce programme de recherche n'aurait pu être réalisé, ainsi que Messieurs M. Agulhon, R. Girardet, J. N. Jeanneney, C. Langlois, R. Rémond et M. Vovelle qui ont accepté de former notre conseil scientifique.
Avec la prise de la Bastille, toute une série d'événements jouit d'un statut positif, mais leur fréquence d'apparition est moindre. Il s'agit de la Nuit du 4 Août, du Serment du Jeu de Paume, des Etats Généraux, des Cahiers de Doléances, et de l'apostrophe de Mirabeau.
La commode idéalisation du 14 juillet s'inscrit en contrepoint de l'embarras que suscite la période terroriste. Celle-ci apparaît spontanément dans plus de la moitié des entretiens. C'est un moment répulsif toujours regretté, même s'il est quelquefois dit nécessaire. Trois positions divisent l'opinion. 1. « La force des choses » (Saint-Just). La Révolution est un craquement de la société, elle s'accompagne d'un véritable effet de souffle « tellement que ça coupe des têtes ». Dans la petite partie de l'opinion qui accepte la nécessité de la Terreur, il y a toujours le sentiment de devoir se justifier : « On ne pouvait pas laisser les Français dans une telle situation, la Terreur était nécessaire, des gens complotaient. Mais il est vrai qu'on est peut-être allé trop loin. Je pense qu'elle était néanmoins nécessaire. » Ce
« Quand on fait une révolution, il y a ceux qui sont pour, et ceux qui sont violemment contre ; il faut tailler dans le vif. Le peuple n'était pas prêt à accepter le méandre, il a accepté la Terreur, et qu'on coupe la tête aux privilégiés ; il n'aurait sans doute pas accepté qu'on coupe la tête au peuple. » (Retraité.)
26
Une enquête qualitative
type d'opinion provient en général de militants socialistes. La Révolution apparaît alors comme un héritage qu'il convient d'autant plus de défendre que la stratégie politique actuelle exclut son retour. Ce maximalisme de la parole révolutionnaire est peut-être la réaction de la base socialiste devant les tentatives de recentrage du PS dans la société française. Elle est aussi liée à l'influence de l'école de la IIIe République, explicitement revendiquée dans plusieurs entretiens, et à la prégnance de l'historiographie jacobine. La Révolution est alors vue comme un « bloc » à défendre dans son ensemble. 2. La Terreur, oui mais... Chez les communistes et compte-tenu de l'échantillon dépouillé, le discours sur la Terreur est sensiblement différent. Quand il ne s'agit pas d'un rejet pur et simple, on assiste au développement d'une argumentation qui n'est pas sans rappeler le discours des militants communistes face aux drames qui ont marqué le « socialisme réel ». Pour eux, le discours sur la Révolution n'est pas un discours au passé, c'est un discours actualisé, vécu à l'aune de leur propre expérience militante. Au travers de la Révolution Française, c'est la question du rôle de la violence dans l'histoire qui est posée, la difficulté d'associer désir de libération et aspiration à une société plus juste avec la réalité de sa concrétisation.
L'autre expression de cette position médiane est le rejet parallèle des excès : « Elle a fait des victimes de tous bords, de tous les milieux ». La Terreur, dans la conscience de gauche, est « une bavure », un moment trouble-fête, même si l'histoire en a connu de pires. 3. Le regret et la nausée. La condamnation totale est l'attitude majoritaire du corpus. Les plus modérés remettent en cause l'utilité du recours à la violence : « Pas forcément utile pour changer les choses », « guillotiner, ça n'apporte pas grand chose ». La répulsion va jusqu'à la nausée quand la Terreur s'incarne dans la guillotine. Il est alors question « d'assassinats », de « dénonciations », « de morts innocents ». Période noire, la Terreur est même souvent exclue de la Révolution : « Période post-révolutionnaire marquée d'exécutions sommaires et de jugements hâtifs. »
La Terreur s'inscrit donc dans une « mémoire honteuse » de la Révolution. Elle est cependant largement occultée au profit des acquis de la Révolution. Le rejet de la Terreur ne signifie nullement un rejet de la Révolution, une promotion de la contre-révolution.
Malgré le développement des thèses révisionnistes, la Vendée et la contre- révolution ne semblent pas bénéficier d'une large popularité. L'image que les Français préfèrent garder de la Révolution est celle d'un élan unanime. Les Chouans, qui ne sont guère évoqués spontanément, sont perçus négativement, au même titre que la Terreur, pour leurs excès, leur violence, et les enquêtes dénoncent volontiers leur archaïsme : « Des contre-révolutionnaires, des esprits fermés. Ils considéraient le roi comme un dieu auquel il ne fallait pas toucher, ils étaient assez archaïques. » Enfin les Chouans sont condamnés en raison des motifs mêmes de leur combat. Ce sont des « royalistes bretons, peu sympathiques, défendant leur petit fief, leur petit château, exploitant les autres », ou encore « un peuple manipulé par une noblesse qui tente de défendre ses privilèges ». Un seul enquêté évoque « la jeune noblesse massacrée » ce qui exclut d'ailleurs les contingents paysans de la rébellion. On peut mesurer le peu d'effet des thèses développées par P. Chaunu, comme le silence de l'enseignement sur cet épisode terrible de la Révolution. Comme le dit l'un des enquêtes, « il faut faire un choix » et ce choix est celui des acquis de la Révolution dont on préfère oublier qu'elle n'a pas été la belle levée unanime d'un peuple.
Les guerres de la Révolution ne sont guère évoquées. Certes, un enquêté évoque « le pillage de l'Europe », et un autre reproche à la Marseillaise « son aspect guerrier ». A l'inverse, dans certains entretiens, les guerres sont justifiées comme « guerres à la contre-révolution » et d'« exportation des idées révolutionnaires » ; on célèbre alors « le patriotisme extraordinaire des Sans-Culottes qui mirent les étrangers dehors ». Mais, la période révolutionnaire n'est jamais spontanément présentée comme une période de guerre extérieure.
« Je ne suis pas attachée à la Terreur, aux massacres. Il y avait peut-être quelques décisions très dures à prendre. Cela me fait mal. C'est extrêmement délicat de juger maintenant. » (Retraitée.)
« La Terreur est le moment que j'aime le moins, où tout a dérapé dans le sang. » (Courtier en assurances, 34 ans.)
« Le peuple en avait assez. Il s'est mis en colère une bonne fois pour toutes, et la Révolution était en route. C'est quelque chose de très beau. » (Secrétaire, 48 ans.)
« La Révolution Française a été utile pour les grandes idées qu'elle a dégagées. » (Secrétaire de mairie, 42 ans.)
27
MIROIRS DE LA MÉMOIRE Passé présent : les Français et leur Révolution.
Cette vision globale d'une révolution dont on préfère garder en mémoire les moments les plus consensuels, quitte à les désincarner, se retrouve-t-elle dans le panthéon des figures emblématiques de la Révolution ? L'évocation de ces figures emblématiques ] ne s'accompagne pas toujours d'un discours. Seuls Robespierre et Louis XVI font volontiers l'objet d'un développement.
Robespierre est « le premier qui vient à l'esprit ». « Etre raffiné, très pur, remuant les foules », il suscite à l'évidence l'engouement des électeurs communistes sans que son aura se limite pour autant à cette partie de l'opinion. On lui reconnaît volontiers la « lucidité », la « pureté », mais ses qualités politiques sont balancées par son manque d'humanité. A droite, Robespierre devient souvent un « fanatique » associé au sang, à la guillotine, à la Terreur. Comme la période terroriste, Robespierre est condamné pour ses excès, même s'il rencontre un soutien plus large, du fait de ses qualités politiques, que la Terreur elle-même.
Si les enquêtes ne sont pas nostalgiques de l'Ancien Régime, ils n'en évoquent pas moins parfois Louis XVI comme une victime. Louis XVI est « un serrurier, un pauvre homme qui a payé pour tout le monde », « un roi plutôt faible » dont la fuite était « dérisoire ». Seule une Vendéenne catholique pratiquante et votant à droite pense que sa « mort a révolté le peuple ».
Dans les deux cas, les clichés s'expriment donc fortement.
Une révolution sublimée.
La tendance qui se dessine dans l'étude des événements cités est confirmée lorsque l'on aborde le jugement global sur la Révolution. Les enquêtes définissent en premier lieu la Révolution Française comme un événement mettant fin à l'Ancien Régime. Un second mode de définition porte sur les acquis de la Révolution et un troisième sur son déroulement, ou encore sur son processus interne.
La Révolution Française est bénéfique car elle met fin à un Ancien Régime toujours décrit en termes négatifs, caractérisé par l'« oppression », « la misère noire », « l'injustice ». La Révolution est expliquée, voire définie, par ses causes : « l'usure d'un peuple », le « ras-le-bol » de « gens arrivés à bout ». L'injustice de l'époque, marquée par l'opposition peuple/privilégiés appelait une rupture qui, pour les personnes interrogées, était inévitable. L'idée même de rupture est liée à l'image que l'on se fait d'une révolution : « c'est le moment où ça change », « le passage d'un ancien système à un nouveau système », « un basculement formidable », « un grand chambardement », « un changement produit d'un seul coup ». Nous sommes loin ici des problématiques rupture/longue durée sur lesquelles s'opposent les spécialistes. La Révolution trouve dans cette charge contre l'Ancien Régime une définition, mais aussi une légitimation : elle est positive car portée par des aspirations justes comme « le besoin d'être respecté, d'avoir des droits, de ne pas être exploité ».
Dès lors, il est logique de la trouver définie non seulement par ses acquis intégrés dans l'héritage historique national et dans le patrimoine de l'humanité, mais aussi perçue comme le terreau dans lequel la société contemporaine s'enracine. Un consensus s'établit sur cet acquis, à savoir les principes reliés au triptyque « Liberté, Egalité, Fraternité », et leur application dans les institutions : « c'est le début de la République », « c'est être citoyen et non plus sujet ». La Révolution ouvre ainsi une nouvelle époque : « on entre dans l'histoire contemporaine », « c'est une nouvelle ère » et on tire fierté de cet héritage car « grâce à la Révolution, la France devient le phare des autres nations ».
Quant aux moyens mis en œuvre pour réaliser la rupture et construire l'héritage, ils ne sont que rarement utilisés pour caractériser globalement la Révolution. Son déroulement est généralement mal connu, sinon ignoré, et ne pèse pas dans le jugement global. Mais ce processus est aussi souvent occulté car l'idéal, que l'on veut retenir, est à dissocier de la violence condamnable volontiers rejetée sur quelques « malfaiteurs » ou sur le seul personnel politique du temps afin de dédouaner le « peuple ».
1 Les personnages le plus fréquemment cités sont : Robespierre, souvent accompagné de Danton, Louis XVI, Napoléon, Marat, Marie-Antoinette.
« La Révolution, c'est bien parce que c'est la République. » (Conducteur d'autobus, nationalité tunisienne.)
« La Révolution Française est l'événement le plus important depuis la naissance du Christ. » (Retraité.)
28
Une enquête qualitative
Commencée à la Bastille contre l'Ancien Régime, terminée à la République, dans l'héritage, c'est une Révolution Française consensuelle et sans parcours qui transparaît de cette première analyse de l'enquête.
Commémorer : une fête surfaite ?
Si la Révolution Française ne figure pas au premier rang des préoccupations des Français, tant il est vrai que, « dans la vie quotidienne, on ne se souvient pas tous les jours de la Révolution Française », il n'en demeure pas moins que presque tous les enquêtes souhaitent que l'on fête le bicentenaire de l'événement. Certes, par sa seule présence, l'enquêteur fait prendre un tel relief à l'objet de l'enquête qu'il devient difficile, dans ces circonstances, d'avouer son désintérêt, et plus encore d'affirmer son opposition à la valorisation de l'événement par une commémoration. Aussi, rares sont ceux qui pensent qu'« on a oublié tout ça » (préretraitée, FN), et que « remettre ça sur la table n'est pas utile », ou qui, indifférents à la particularité de 89, se contenteraient d'une commémoration comme les autres : « c'est comme toutes les commémorations, faut les faire, sans plus » (femme au foyer, 30 ans, D). La majorité des enquêtes en revanche souligne l'utilité, la nécessité d'une célébration.
En premier lieu, l'importance du temps écoulé frappe les imaginations, et vient légitimer la fête : c'est un grand anniversaire, « deux cents ans, c'est un chiffre » et il convient de « marquer le coup ». Les enquêtes soulignent à la fois l'importance de la Révolution Française dans le patrimoine historique et culturel national, et la nécessité de réactiver, dans notre société d'aujourd'hui, certaines valeurs issues de 89. La commémoration, en effet, est d'abord envisagée comme un remède à l'oubli ; elle est « nécessaire à la mémoire » (commerçant, communiste) d'une « période que les gens aiment vraiment » (étudiant, R), et permettra ainsi de rendre hommage à « ceux qui ont pu nous apporter quelque chose de positif » (femme au foyer, B). Evénement fondateur, aux sources de notre société contemporaine, la Révolution Française doit être dignement fêtée afin de demeurer présente à l'esprit des Français, afin de maintenir son rang dans leur patrimoine culturel comme élément d'identité nationale : commémorer doit avant tout remémorer. Mais certains signalent bien qu'une commémoration, en tant qu'événement politique, est aussi destinée à engager aujourd'hui les Français dans le mouvement de leur société, qu'elle soit « nécessaire pour renforcer l'unité de la nation autour d'un événement qui rassemble les Français », qu'elle soit destinée à prolonger la Révolution Française en incitant les Français à fortifier et développer ses acquis car « cela donnera l'occasion de revenir à une source importante de notre histoire récente, et cela peut nous éclairer sur ce qu'il faudrait faire pour parachever l'œuvre de la Révolution Française » (retraité de l'armée, R), ou encore, position extrême, à remettre la Révolution à l'heure du jour : « il faudrait la fêter par une autre révolution, au moins une révolution des mentalités, car ce n'est pas la peine de parler de révolution et de s'appesantir sur le passé si on n'évolue pas à l'heure actuelle » (commis administratif, 31 ans, NPOP). Du reste, cet aspect idéologique de la commémoration ne va pas sans susciter des inquiétudes quant à d'éventuelles récupérations au profit de tel ou tel parti, la commémoration, enjeu politique, prenant déjà, aux yeux de certains, « mauvaise tournure ».
Au vu de ces objectifs assignés à la commémoration, les enquêtes ont des attentes, des désirs. A la commémoration-remémoration répondent des exigences didactiques. Les Français souhaitent, à l'issue de la commémoration, en mieux connaître les différents événements : conférences, débats accessibles au grand public, diffusion de films historiques, émissions télévisées, reconstitutions historiques variées, expositions, publications, permettraient de « s'informer avec intelligence, avec lucidité ». En revanche, c'est dans les mouvements de foule, les manifestations de rue, dans l'organisation d'une grande fête populaire qu'ils espèrent retrouver un peu de l'esprit de 89 : « on boira un coup, on dansera, on fera semblant d'être aussi révolutionnaire qu'à l'époque, on chantera la Mar-
Une commémoration, pour quoi faire ? « II faut se remettre 89 en mémoire, et surtout ne pas oublier qu'il faut être vigilant, car il y a beaucoup de choses qui sont remises en cause, et cela peut aller jusqu'à la remise en cause de notre liberté. C'est pour cela qu'il faut reparler de 89. » (Retraité.)
Comment commémorer ? « II faut expliquer aux gens ce que la Révolution a réalisé, tout ce qui en découle. Je voudrais aussi qu'il y ait une grande fête populaire pour que la jeunesse puisse pleinement y participer. Je voudrais quelque chose de concret, qui ne fasse pas snob. » (Retraitée.)
« Le bicentenaire, c'est un débat un peu idéologique. Célébrer est une bonne chose ; c'est l'occasion de rappeler les idées de liberté, d'égalité. Si ce n'est pas trop récupéré par certains partis politiques, c'est aussi bien. » (Etudiante.)
29
MIROIRS DE LA MÉMOIRE Passé présent : les Français et leur Révolution.
seillaise ». Paris est très largement favorisé dans l'évocation festive des « grands cortèges » bariolés « avec des drapeaux, des déguisements », le « carnaval ». Une « fête extraordinaire », faite « d'engouement populaire », qui ne se limite pas à « un défilé de chars et à quelques pétards mouillés » mais qui serait jointe à une « réflexion sur ce que la Révolution, deux cents ans après, représente encore dans notre société ». Alors, peut-être, les « Français pourraient se reconnaître dans ce passé historique très lourd et en même temps formidablement révélateur » (secrétaire, M).
Pas de tombeau pour la Révolution Française.
Pourtant, rares sont les Français qui ont une véritable connaissance historique de la Révolution Française. Les souvenirs scolaires sont lointains, et l'information sur l'événement généralement assez légère. Il n'y a cependant pas de Français, aussi ignorant de la question soit-il, qui n'ait rien à dire sur la Révolution Française, car c'est alors moins le récit des événements qui retient son attention que les traces que ce « grand bouleversement » a laissé dans la société actuelle. Les Français d'aujourd'hui ont le sentiment d'avoir recueilli un héritage de la Révolution Française : « si je suis ici en étant non asservie à un certain pouvoir, à certaines personnes, c'est justement à cause de cette Révolution » (commerçante, 24 ans, D).
Cet héritage tient tout d'abord en un certain nombre de changements radicaux, par rapport à la société d'Ancien Régime, sur lesquels a pris corps la société contemporaine. La grande majorité des enquêtes voient dans la Révolution un moment fondateur, celui de la mise en place de principes, de valeurs définitives qui aujourd'hui rassemblent les Français. En ce sens, la Révolution « a donné une identité à la France ». Ce patrimoine, issu directement de la Révolution Française, immuable, comme pétrifié par la reconnaissance unanime de son bien- fondé, aux origines de notre société actuelle, et comme tel voué à un culte, tient en quelques mots : Droits de l'Homme, République, représentation et participation politique, démocratie, justice, droit de vote, citoyenneté, unité de la France. Les enquêtes n'insistent guère sur un héritage totalement accepté, estimé, et dont on souligne surtout le caractère originel : « la Révolution Française est le point de départ de la vie politique et de notre mentalité » (instituteur, 25 ans, R), « personne ne s'est conduit, après la Révolution Française, comme on pouvait se conduire avant, en tant qu'individu, en tant qu'être social, et en tant que Français » (cadre commercial, D), « tout ce que l'on a maintenant, c'est issu de la Révolution : le gouvernement, la participation, la patrie, le droit de vote, la justice » (employé, M).
Cependant, la part la plus importante de l'héritage de la Révolution Française, les Français ne l'ont pas recueillie passivement. Les enquêtes montrent bien que de 1789 à 1988, ce patrimoine fut non seulement maintenu, mais encore accru, et qu'il est susceptible de nouveaux prolongements : « La Révolution n'est pas terminée ». La Révolution Française est alors vue comme le point de départ de changements intervenus ultérieurement, et particulièrement au XIXe siècle, voire comme l'origine d'une société où l'impulsion donnée par la Révolution n'a pas encore trouvé son aboutissement. Il convient alors de parachever l'œuvre révolutionnaire. La Révolution Française, point de référence, interroge les Français sur le monde dans lequel ils vivent. Qu'a-t-on fait, en deux cents ans, de l'héritage révolutionnaire ? L'a-t-on fait fructifier, l'a-t-on prolongé, développé ? Où en est-on par rapport aux principes énoncés dans les grands textes révolutionnaires ? Telles sont les questions qui affleurent dans les discours des enquêtes. Ceux-ci ont le sentiment d'être les bénéficiaires de la Révolution Française dans le sens où « certains droits apparaissent actuellement évidents », où la France est le « pays des Droits de l'Homme », « un pays libre, égal pour tous », et où elle a acquis une place privilégiée en Europe au nom des conquêtes humanitaires datant de la Révolution. Beaucoup pensent donc qu'ils n'ont pas à se plaindre, même si la Révolution Française n'a pas tout changé. La devise répu-
« Les gens de 89 disaient bien ce qu'ils pensaient. Quand on voit le débat politique actuel, c'est désolant. C'est creux, c'est vide. On recherche des gens comme ceux de 89. Voyez-vous un homme politique actuel capable de faire les discours de l'époque de 89 ? Moi, je n'en vois qu'un, c'est Mitterrand. » (Retraité.)
« En gros, la France peut se vanter du fait que ses citoyens sont libres, égaux, fraternels. Je reconnais que nous vivons dans un pays privilégié par rapport à d'autres pays. En gros, on n'a pas à se plaindre. Mais ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas le paradis. Il y aurait certainement encore beaucoup de choses à faire. » (Secrétaire, 23 ans.)
30
Une enquête qualitative
blicaine « Liberté, Egalité, Fraternité » est dite utopique, mais d'actualité (« c'est plus de l'histoire, c'est de l'instruction civique » nous dit un instituteur de la région lyonnaise) : « belle dans le principe, la devise n'est pas toujours appliquée » (secrétaire, NPOP), et dans la pratique, « pour faire valoir son bon droit, il faut toujours se battre, il faut toujours réclamer, il faut toujours revendiquer » (secrétaire, M). Il en va de même pour les Droits de l'Homme : « c'est un idéal, on sort de là avec du bonheur plein les poches ». Le discours politique actuel trouve là des résonnances. L'égalité s'entend le plus souvent comme une « égalité des chances », ou comme « équité économique », « fraternité » renvoie au ressassé « solidarité » et suscite des développements sur le racisme. Les trois termes sont essentiellement articulés autour des problèmes de l'économie et du racisme. Ainsi, la liberté apparaît à plusieurs reprises comme le droit au travail sans discrimination. Si certains comparent leur propre volonté de changement à celle qui s'est exprimée « pendant la Révolution Française », tous, loin de là, ne voient pas dans une nouvelle révolution la solution aux mécontentements. Ils y préfèrent plutôt un prolongement, un perfectionnement des acquis révolutionnaires suivant une douce évolution.
La référence à la Révolution Française est également opérante lorsque l'on évoque les partis politiques aujourd'hui. Du reste, L. Jospin, lors de la soirée électorale télévisée du premier tour des dernières présidentielles n'interdisait-il pas à B. Mégret (directeur de campagne de J.-M. Le Pen) de parler des Droits de l'Homme que sa famille politique avait inventés alors que les « ancêtres » de B. Mégret étaient encore royalistes. A l'exception des royalistes et de l'extrême- droite, tout l'échiquier politique français est au rendez-vous des héritiers de la Révolution Française. Communistes et socialistes arrivent en première place. Pour d'autres, moins nombreux, il n'y a plus de parti révolutionnaire en France car le PCF, seule véritable force révolutionnaire, est en perte de vitesse, ou bien tous les partis revendiquant l'héritage fondateur de la Révolution, et particulièrement la République, peuvent à bon droit se réclamer de 89, du PS au RPR. Les idéaux de la Révolution Française sont donc encore aujourd'hui représentés par certains partis politiques. Dans le même sens, les enquêtes n'hésitent pas à rapprocher la Révolution Française d'autres événements historiques plus tardifs où éventuellement ces partis ont eu un rôle à jouer.
« C'est une belle devise mais on n'a toujours pas terminé de la mettre en pratique, aussi bien pour la liberté que pour l'égalité et encore moins pour la fraternité. » (Retraité.)
La révolution n'aura pas lieu.
Interrogés sur les événements historiques qu'ils rattachent à la Révolution Française, les enquêtes offrent une palette très large d'associations d'idées2 qui est tout aussi révélatrice de leur vision de la Révolution que de toute autre révolution.
Il apparaît tout d'abord que l'historiographie est gallo-centriste et que les révolutions du XIXe siècle français sont souvent liées à la Révolution Française. Elles sont d'autant plus volontiers citées qu'elles sont éloignées : on insiste davantage sur 1830 et 1848 que sur la Commune. Plus une révolution est éloignée chronologiquement, plus elle est mythifiée ; plus elle est inoffensive, plus on s'y réfère. Il en est de même pour la révolution industrielle qui s'inscrit dans le long terme. Outre l'emprise de l'histoire nationale, l'actualité est un facteur déterminant dans le choix de l'événement historique relié à la Révolution Française. La révolution iranienne, par exemple, est plusieurs fois citée, en liaison avec le contexte politique international. La référence à l'Amérique du Sud renvoie en revanche à la culture politique des années 70. Enfin, le mode d'apprentissage n'est pas à négliger : les étudiants citent plus volontiers la Révolution anglaise de 1688 ou l'Indépendance américaine, et les générations qui ont vécu la Seconde Guerre Mondiale font référence à l'expérience de la Résistance. La récurrence de la Révolution Russe, de loin la plus citée, est-elle imputable à sa place privilégiée dans l'enseignement, ou à sa propre inspiration de la Révolution Française ?
L'appréciation sur la Révolution Russe est très liée au clivage politique traditionnel français. A gauche, il s'agit généralement d'une « véritable révolution »,
2 Les événements le plus fréquemment cités sont : la Révolution Russe, la révolution iranienne, l'Indépendance américaine, les révolutions en Amérique du Sud, la Commune, 1830, 1848, la révolution industrielle, la révolution culturelle en Chine, la guerre de 193945, mai 68, l'Espagne de 1936, la révolution anglaise.
« Quand toutes les possibilités d'évolution sont bloquées, à partir du moment où la pression est suffisamment forte, il se passe une révolution. Mais le résultat de cette révolution n'est pas forcément celui qu'on attend ; elle est souvent récupérée. » (Retraité.)
31
MIROIRS DE LA MÉMOIRE Passé présent : les Français et leur Révolution.
d'« une révolution réussie », voire de « la seconde grande révolution de l'histoire de l'humanité ». En revanche, à droite, si on ne nie pas la filiation entre les deux révolutions, on souligne les divergences. La Révolution Russe n'aboutit à pas un régime républicain, mais établit « un régime foncièrement différent du régime français : le communisme » ; le pouvoir est confisqué par quelques- uns au profit d'« une bureaucratie autoritaire et totalitaire ». Pour les détracteurs comme pour les admirateurs, la comparaison entre la Révolution Russe et la Révolution Française permet de souligner les aspects positifs de cette dernière, et surtout la prise du pouvoir par le « peuple ». De même, la principale critique à l'égard de la révolution iranienne réside dans son caractère antidémocratique — « un peuple victime de ses dirigeants » — d'autant qu'il se double d'un caractère religieux qu'unanimement les enquêtes définissent comme « fanatique ». A l'opposé de la Révolution Russe, considérée comme aussi violente que la Révolution Française, la Révolution Anglaise est synonyme de révolution « douce » parce que « parlementaire » et de « bonheur ». Il semblerait que l'enseignement français ait repris à son compte les analyses de Burke 3. Enfin, on retient surtout de l'Indépendance américaine la notion de liberté, associée à la Révolution Française, et l'incertitude chronologique conduit souvent l'enquêté à faire de l'Indépendance un rebondissement de la Révolution Française. Parfois enfin, la Révolution Française est associée à des guerres (guerres de religion, de Cent ans, Première et Seconde Guerres Mondiales). La guerre est alors perçue comme une véritable rupture.
D'emblée, les enquêtes portent majoritairement un jugement plutôt positif sur la révolution en général, même s'ils nuancent leur point de vue par quelques réserves. Le plus souvent, la révolution est valorisée : « C'est bien parce que c'est un pas en avant de manière générale » (commerçant, communiste). En revanche, lorsqu'elle est conspuée, elle l'est de façon virulente : « Une révolution, c'est pire qu'une guerre, c'est que de la politique, que de l'horreur » (retraité, NPOP). Les avis partagés jouent presque constamment sur le doublet révolution/évolution : « Je préfère l'évolution à la révolution, mais il y a des moments où on ne peut l'éviter ». La position médiane conduit à voir dans toute révolution une dualité : « Toute révolution se sépare en deux aspects, l'un sanguinaire, l'autre idéaliste ». Simultanément se forge une définition du terme « révolution », grâce au vocabulaire employé spontanément. Le synonyme de loin le plus répandu est « changement » tandis que « mouvement » est moins usité. Par le premier terme, on considère la Révolution comme aboutie, et donc classée, la métonymie soulignant le résultat. En revanche, rares sont ceux qui emploient le terme « mouvement » qui suppose une révolution en action. Le vocabulaire concernant les acteurs d'une révolution est tout aussi indicatif. La dénomination la plus commune, « les gens », privilégie l'anonymat, l'absence de caractérisation sociale, la neutralité politique, même s'il s'agit sans doute d'un processus d'identification, le terme connotant l'« homme de la rue », voire le « nous » des classes moyennes. Quant au terme de « peuple », son utilisation semble liée à deux situations de parole. La première est celle de l'ouvrier immigré qui ressent une parenté avec le peuple révolutionnaire, notamment celui de 1789, sous-entendant une société divisée en classes. La seconde émane de tout individu dont le discours reproduit celui de l'histoire scolaire du XIXe siècle, tel qu'il a été transmis, et sans appropriation. On rencontre dans cette catégorie de jeunes étudiants, ou des personnes âgées durablement marquées par l'école de la IIIe République. L'emploi très peu répandu du terme « masse » est sans doute à mettre en rapport avec la perte de vitesse d'un certain discours politiquement de gauche. Enfin, « foule » est toujours connoté péjorativement.
Les causes généralement évoquées pour toute révolution sont le « ras le bol », le « mécontentement » : « A partir du moment où il y a une révolution, c'est qu'il y a une situation pénible pour les gens » (étudiant, R). Lorsque le discours sur la révolution est en prise avec une pratique militante, le locuteur précise qu'« une révolution ne se fait pas en levant le petit doigt, sous prétexte que les dirigeants l'ont décidée ; il faut un certain engouement des gens » (militant communiste). Si la majorité des enquêtes a une vision positive de la révolution
3 • Edmund Burke (v. 1729-1797), auteur des Réflexions sur la Révolution en France, ouvrage contre-révolutionnaire.
« J'ai quelque chose en moi de révolutionnaire car j'ai toujours été éprise de justice et de liberté. » (Retraitée.)
32
Une enquête qualitative
en général, c'est sans doute parce que la révolution n'est pas pensée comme processus révolutionnaire, mais comme un « changement », un « point de non- retour ». Les préjugés favorables ou défavorables interviennent dans la définition donnée de la révolution. La révolution est dénoncée parce qu'il s'agit d'« un mouvement de masses endoctrinées, d'une rencontre de deux mystiques, révolutionnaire et contre-révolutionnaire, qui se termine dans le sang » (retraité, G), ou encore parce que « les masses qui se révoltent n'ont pas souvent le poids qu'il faut pour faire le changement ; le pays s'en trouve plus affaibli que remonté ». A l'opposé, la révolution est distinguée du « coup d'Etat », « c'est un mouvement collectif, c'est penser le changement, c'est un rapport de force » (OS, nationalité béninoise, NPOP). Changement radical de régime, la révolution est aussi un changement du mode de vie : « un changement de société, c'est- à-dire passer d'un système à un autre ».
D'une idée plutôt positive de la révolution à la possibilité, voire la nécessité, de la faire aujourd'hui, voilà un pas que ne franchit pas la majorité des enquêtes. La moitié d'entre eux ne se prononcent pas et ce silence est éloquent sur l'absence d'idée de révolution dans l'univers mental quotidien des enquêtes. Les avis négatifs reposent sur une analyse du contexte politique et social actuel, qui ne semble pas porteur d'idées révolutionnaires. Lorsque l'enquêté pense qu'il y a effectivement place pour une révolution aujourd'hui, la réflexion se cantonne autour du virtuel, de l'éventuel, voire du rituel : « II faudrait en faire tous les 50 ou 100 ans », « ça a existé, ça existera toujours ». Un enquêté analyse toutefois le contexte actuel comme révolutionnaire, car « le chômage est insupportable » : en l'occurence l'analyse est élaborée par un membre du PCF de la banlieue rouge de Paris.
Une typologie complexe.
Trois critères ont été retenus pour une analyse synthétique des entretiens : 1. le jugement global que les enquêtes portent sur la Révolution Française ; 2. leur opinion sur la réalisation, aujourd'hui, de l'idéal révolutionnaire ; 3. la famille politique qui leur paraît à l'heure actuelle la plus proche des révolutionnaires de 1789.
« Je pense que les Jacobins rappellent la gauche actuelle, la gauche assez extrémiste. Les Girondins représentent un peu les socialistes aujourd'hui, mais de toute façon, que ce soit la droite ou la gauche actuelle, elles auraient pris part à la Révolution pour s'opposer à la monarchie absolue. » (Caissière grande surface, 23 ans.)
Jugement.
Rares sont les personnes qui portent un jugement de valeur totalement négatif sur la Révolution Française. Pour ces dernières, elle est inutile, et surtout le cours de l'histoire peut changer sans révolution car « les choses auraient de toutes façons évolué » ; elle est donc évitable. Pour justifier cette position, l'accent est mis sur l'affaiblissement économique du pays dû aux retombées de la « guerre civile », et plus encore sur les « massacres commis ». La Révolution Française est, dans ce système de représentation, avant tout destructrice et sanglante.
Mais pour la plupart des enquêtes, le jugement émis est positif. La Révolution Française est l'expression nécessaire d'un « ras-le-bol ». Elle a permis la libération du peuple, et surtout elle a défini les valeurs sur lesquelles repose la société française d'aujourd'hui.
Il faut toutefois faire une distinction entre les personnes qui considèrent la Révolution comme « inévitable », « utile », « nécessaire » sans aucune restriction, et qui, même lorsqu'elles mentionnent des exactions, prennent ces données factuellement sans porter aucun jugement moral, et celles qui, tout en utilisant les mêmes qualificatifs, nuancent leur discours en introduisant, pour les déplorer, les excès perpétrés.
Une quatrième catégorie a été retenue. La Révolution Française est alors jugée positivement dans la mesure où elle a été « utile », mais « on aurait pu en faire l'économie ».
33
MIROIRS DE LA MÉMOIRE Passé-présent : les Français et leur Révolution.
Classification descendante des types.
Jugement global sur la Révolution Française
Jugement totalement négatif '(3) A
Jugement totalement positif (13) B
Corpus (n° 29)
'Jugement positif nuaneé par les « excès » commis (11) C
Jugement positif, mais la Révolution Française aurait pu être évitée (2)
Dans la société actuelle réalisation des idéaux révolutionnaires (IR)
Les partis politiques actuels héritiers des idéaux révolutionnaires
IR non réalisés (2) IR en partie réalisés (1)
— — JR non réalisés (1)
___ IR totalement réalisés (3) _ «_ _ IR en partie réalisés (7) IR très partiellement réalisés (2) __ IR totalement réalisés (4) ___ IR en partie réalisés (6) IR très partiellement réalisés (1)
IR totalement réalisés (1) IR en partie réalisés (1)
Aucun lien l'existé (2) La gauche (1)
A C A J B J C D B C
D ,
Les même* clivages existent (1) Tous sauf It's extrêmes (1)
Le PS (I) Tous sauf les extrêmes (1)
La gauche (6) Tous sauf les extrêmes (1)
. La gauche (1) rLes mêmes clivages existent (1)
— Tous sauf les extrêmes (1) , — La gauche (2)
Tous les partis (1) Tous sauf les extrêmes (!)
La gauche (3) L'extrême droite (1)
Les mêmes clivages existent (1) Les mêmes clivages existent (!)
Aucun lien n'existe (1)
B G A D G
D. E D E A D E C D E F A A
Les partis politiques actuels héritiers de la Révolution.
Révolutionnaires Contre-révolutionnaires
Révolution Française Aujourd'hui
B Révolution
naires
Contre-
révolutionnaires Révolution
naires
Contre- révolutionnaires
1
C
Tous les. partis Révolutionnaires
Contre- révolutionnaires
Extrême-gauche
Autres
Extrême-droite
F.xtrêmr-gaurhe
Autres
L\lrème-<lroitr D
naires
Contre- révolutionnaires
naires
Contre- révolutionnaires
E
L
PC (PS)
Autres
Extrême-gauche
PS
Autres
34
Une enquête Qualitative
Réalisation de l'idéal révolutionnaire.
Peu de personnes pensent que la Révolution Française, moment de l'histoire totalement méconnu ou perçu comme un événement beaucoup trop lointain, n'a plus aucune incidence aujourd'hui. Pour la grande majorité, la Révolution a établi les fondements de la société française actuelle, et pour une partie non négligeable de la population, les principes inhérents aux idéaux révolutionnaires sont effectivement réalisés aujourd'hui. Cependant, des restrictions sont formulées : « il existe encore des petits et des gros », « des gens en dominent encore d'autres » ; mais surtout une certaine réserve est émise quant à la réalité de l'application du triptyque « Liberté, Egalité, Fraternité ».
« Les socialistes et les communistes sont les héritiers des Révolutionnaires de 89. Ce sont les descendants, ce sont les arrières-arrières-petits-enfants de tous ces gens-là, forcément. » (Retraitée.)
Héritage politique.
A. Idée extrêmement rare : les données politiques d'aujourd'hui sont les mêmes que pendant la Révolution. B. Il n'y a aucun lien entre les données politiques d'aujourd'hui et celles de la Révolution. Opinion peu représentée, mais souvent associée à un jugement négatif sur la Révolution Française, et à l'absence de réalisation de l'idéal révolutionnaire. C. Les partis politiques actuels, sans exclusion, sont héritiers des révolutionnaires de 1789. Les contre-révolutionnaires n'ont pas d'héritiers aujourd'hui. D. A l'exception de l'extrême-droite et de l'extrême-gauche, les partis actuels sont les héritiers des idéaux révolutionnaires. Idée relativement courante associée à un jugement positif ou globalement positif sur la Révolution, et à une réalisation plus ou moins grande de l'idéal révolutionnaire aujourd'hui. E. Les partis de gauche, notamment le parti communiste (le plus souvent cité) sont les descendants directs des idéaux de 1789. Opinion la plus répandue, et associée aux mêmes données qu'en D. F. Seule l'extrême-droite représente l'idéal révolutionnaire. G. Les socialistes seuls, l'extrême-gauche étant rejetée, sont issus de la Révolution Française.
Avant de dépouiller les entretiens et d'en analyser les contenus, nous pensions qu'un clivage apparaîtrait dans le système de représentation de la Révolution Française des enquêtes selon l'appartenance politique, la classe d'âge ou encore le niveau d'études. Or l'étude approfondie des enquêtes a rendu caduque cette hypothèse de départ, faisant ressortir que les représentations sont indépendantes des facteurs postulés.
« A l'exception d'une petite minorité de royalistes, de gens d'extrême-droite ou d'extrême-gauche, la grande majorité des Français se reconnaît dans la Révolution Française, et les Français en général sont profondément républicains. UDF, RPR, PS et Radicaux sont les familles politiques les plus proches des idéaux de 89 car ils sont pour le maintien de la République. » (Etudiant.)
35













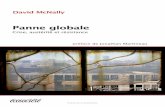











![[Ed]. Où en est l’histoire du temps présent ? Notions, problèmes et territoires, Dijon, Université de Bourgogne, 1998.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633562d302a8c1a4ec01bf3f/ed-ou-en-est-lhistoire-du-temps-present-notions-problemes-et-territoires.jpg)






