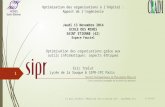La Sibérie, pays hospitalier ?
-
Upload
paris-sorbonne -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of La Sibérie, pays hospitalier ?
Cet ouvrage est issu des contributions d’un colloque international qui s’est tenu à Lyon, à l’Institut des Sciences de l’Homme, en novembre 2010. C’est au siècle des Lumières que s’invente la Sibérie comme objet de savoir troublant et fascinant. Vue de l’Occident, la Sibérie incarne la Russie à l’extrême. Mais comment concilier la présence de populations « barbares » avec le mythe du Bon Sauvage ? comment faire coexister l’importance des rituels d’hospitalité, dont rendent compte des voyageurs avec le discours sur le despotisme éclairé dans l’empire du knout ? comment, enfin, comprendre que cette région soit une terre d’exil et de châtiment, alors même qu’elle véhicule des représentations idéalisantes, voire utopiques ? Les approches littéraires, historiques et ethnologiques de chercheurs venus de Russie et de France se complètent pour faire sortir de l’ombre un vaste corpus de récits de voyage, de mémoires, de romans, de drames et d’articles de presse consacrés à la Sibérie aux xviiie et xixe siècles.
Sarga Moussa, directeur de recherche au CNRS (UMR LIRE, CNRS - Université Lyon 2), est spécialiste du récit de voyage et de l’orientalisme littéraire au xixe siècle.
Alexandre Stroev, professeur de littérature générale et comparée à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux relations franco-russes au xviiie siècle.
L’in
vent
ion
de la
Sib
érie
par
les
voya
geur
s et
écr
ivai
ns fr
ança
is (X
VIII
e -XIX
e si
ècle
s)
L’invention de la
Sibériepar les voyageurset écrivains français
(XVIIIe-XIXe siècles)Sous la direction de
Sarga Moussa et Alexandre Stroev
L’invention de la
Sibériepar les voyageurset écrivains français
(XVIIIe-XIXe siècles)Sous la direction de
Sarga Moussa et Alexandre Stroev
INSTITUT D’ÉTUDES SLAVES
ISSN 0765-0213ISBN 978-2-7204-0525-9
K 50III.14 20 €
L’invention de la Sibériepar les voyageurs et écrivains français
(xviiie-xixe siècles)
publié sous la direction de Sarga MOUSSA et Alexandre STROEV
PARISINSTITUT D’ÉTUDES SLAVES
9, rue Michelet (VIe)
DE L’EST 50cultures & sociétés
Eur’ORBEM
La Sibérie, pays hospitalier ?
Galina KAbAKoVAUniversité Paris-Sorbonne
À proximité de la frontière sibérienne, je cédai sans raison à une appréhen-sion peut-être normale. En effet, quand je me rendis compte de la cruautéet de la misère, je devins très nerveux. Jusqu’à présent, j’avais été sous la pro-tection de la Providence ; bien que lui en étant reconnaissant pour le passé,je ne pouvais l’être pour le futur puisque je ne savais raisonnablement pascomment, où et quand mon pèlerinage prendrait fin.
Ainsi s’exprime, avant de fouler le sol asiatique, un capitaine de la Marine anglaise,John Dundas Cochrane (1780-1825), randonneur infatigable qui forme un pro-jet fou mais très moderne : celui de faire le tour du monde à pied, en passant del’Asie en Amérique par le détroit de béring. Le « voyageur pédestre » ne réussirapas son pari car son périple, qui va durer trois ans, de 1820 à 1823, s’arrêtera auKamtchatka pour cause… de mariage contracté avec une belle Kamtchadale (ouRusse), Ksenia Loginova.
La découverte de la Sibérie est un vrai défi même pour les voyageurs aguerriscomme Cochrane ou son compatriote James Holman (1786-1857), que Cochranecroise à Moscou sur le chemin du retour. Pour les deux britanniques, l’expériencesibérienne représente une aventure personnelle qui a pour objectif de découvrir lepays et ses habitants. Ils n’ont pas de prétentions scientifiques, mais cherchent plutôtà repousser les limites de l’humain et à prouver au monde et à eux-mêmes qu’il estpossible, pour l’un, de parcourir des milliers de kilomètres à pied, et, pour l’autre,d’endurer le climat sibérien et les difficultés du voyage quand on est aveugle et souf-frant de rhumatismes – il est d’ailleurs connu en Angleterre comme « the BlindTraveller ». Les deux voyageurs se lancent dans cette aventure en solitaire en sup-posant qu’il sera plus facile de relever ce défi d’homme à homme qu’en groupe.Leurs récits sont publiés presque simultanément : le livre de Cochrane voit le jouren 1824 et connaît cinq éditions en cinq ans. Il est traduit à la même époque enallemand, en néerlandais et en russe (mais en français seulement en 1993). Lerécit de Holman paraît en 1825 et rencontre également un franc succès.
Dans cet article, nous allons également nous intéresser à quelques voyageursfrançais qui traversent la Sibérie dans la deuxième moitié du xVIIIe siècle, maisavec des motivations autres que le tourisme. Jean Chappe d’Auteroche (1722-1769) se rend en Sibérie en 1761 pour observer le passage de Vénus sur le Soleil ;Jean-baptiste barthélemy de Lesseps (1766-1834) a pour mission de déposer la
L’invention de la Sibérie, Paris, Institut d’études slaves, 2014, pp. 126-137.
La Sibérie, pays hospitalier 127
documentation concernant l’expédition de La Pérouse à Versailles. En 1787-1788, en partant de Petropavlovsk au Kamtchatka, il met treize mois à traverserla Sibérie, d’est en ouest, et ensuite toute l’Europe pour arriver à Versailles à lami-octobre 1788. Il n’est pas impossible que sa fonction ne se soit pas limitée àcelle de messager et qu’il ait profité de son séjour involontairement prolongé auKamtchatka et de sa traversée de la Sibérie pour étudier les possibilités de déve-lopper le commerce dans cette partie de l’Empire. Enfin le dernier témoin qui vaattirer notre attention, François Auguste Thesby de belcourt, se retrouve en Sibé-rie contre son gré, car il a été fait prisonnier au siège de Cracovie en 1769 etdéporté à Tobolsk pour trois ans. Il décrit les malheurs de la vie d’un prisonnieren Sibérie dans sa Relation ou Journal d’un officier françois au service de la confé-dération de Pologne, pris par les Russes et relégué en Sibérie, parue en 1776, à Ams-terdam, semble-t-il 1.
La Sibérie, pour plusieurs de ces auteurs et bien d’autres encore, représente laquintessence de la Russie, sa partie soigneusement gardée par l’État russe : lesagents de l’administration étudient avec une grande rigueur tous les passeports àl’entrée d’Ekaterinbourg, « la clef de la Sibérie 2 », et procèdent à leur vérificationà l’entrée de toutes les grandes villes, que ce soit Tobolsk ou Irkoutsk. Pénétrer en
1. L’ouvrage n’est signé que par les initiales Th.** de b.***.2. John Dundas CoCHRANE, Récit d’un voyage à pied à travers la Russie et la Sibérie tartare des frontières de Chine à la
mer Gelée et au kamtchatka, boulogne, éd. du Griot, 1993, p. 68.
Tobolsk[Cornelis de bRUyN], Voyages de Corneille le Bruyn par la Moscovie, en Perse,
et aux Indes Orientales, Paris, J.-b.-Cl. bauche, 1718, t. 3.
Galina Kabakova128
Voyage russe sur les chiens en Sibérie. Les chasseurs bouriates.La femme mongole et le prêtre. Toungouze sacrifie un mouton.
In John HARRIS, Navigantium atque Itinerantium Bibliotheca : or, A Compleat Collection ofVoyages and Travels, Londres, T. bennet, 1748 (1705)
La Sibérie, pays hospitalier ? 129
En effet, dans un pays où l’infrastructure est inexistante, le voyageur ne peutcompter que sur l’hospitalité de la population et la bienveillance des autorités.Cochrane en fait un éloge enthousiaste : finalement, « à cause » du concours del’empereur Alexandre Ier et de l’hospitalité des peuples de la « Tartarie sibé-rienne », il ne peut effectuer le voyage entièrement à pied mais se voit obligéd’accepter les différents moyens de locomotion qui lui sont proposés. C’est encorelui qui formule la loi de l’hospitalité :
3. Ibid., p. 255.
John WEbbER, L’intérieur d’un habitat d’hiver au Kamtchatka, 1776 in James CooK, Voyage to the Pacific Ocean, Londres, 1785.
Sibérie revient en quelque sorte à pénétrer au cœur de l’Empire russe. Ainsi, il nes’agit pas que de se mettre soi-même à l’épreuve mais aussi de mettre à l’épreuvela Russie qui ne cesse de susciter des sentiments contradictoires. Le capitaineCochrane, ardent défenseur de la Russie, évoque ses inquiétudes quant au projetfou de Holman dont celui-ci lui fait part et souhaite voir le dénouement heureuxde son aventure périlleuse. « Qui dira alors, s’exclame-t-il, que la Sibérie est unerégion sauvage, inhospitalière et infranchissable, si même un aveugle peut la tra-verser en toute sécurité ? 3 »
Galina Kabakova130
En Russie, lorsqu’un voyageur autochtone ou étranger prend congé de ses amis et queceux-ci sont prévenus de son départ, il trouve toujours dans sa chambre toutes les pro-visions nécessaires à son voyage et on lui indique la chambre chez un autre ami où ilpourra rester aussi longtemps qu’il lui plaira 4.
Cette hospitalité est-elle toujours spontanée et vient-elle du fond du cœur ?Certainement pas. En règle générale, les paysans russes comme les indigènes rem-plissent leur obligation d’accueillir des personnes officielles, des militaires ou descolporteurs, de les loger et nourrir gracieusement. Et pourtant, dans ces récits devoyage, pour peu qu’ils soient sincères, on trouve des épisodes où les indigènesne se pressent pas d’ouvrir grand la porte de leur maison au voyageur ni de luidonner une miche de pain. Le capitaine écossais en fait les frais à plusieursreprises : d’abord, dans la partie européenne, aux environs de Vladimir, lorsqueles vieux croyants le rouent de coups, ensuite en Sibérie, à biriktchoul où la maî-tresse de maison n’accepte de servir du lait que lorsqu’il lui propose de le lui payeren monnaie sonnante et trébuchante. Très probablement elle aussi appartient àla communauté des schismatiques, car ceux-ci refusent la nourriture même à unpassant exténué, à moins qu’il ne la paie au double de sa valeur.
En général, les visiteurs ne sont pas dupes de la sincérité de l’accueil : ils sontconscients qu’ils sont reçus selon les termes de la fameuse podorojnaïa (feuille deroute) qui ne fait pas de miracles à tous les coups et grâce aux lettres de recom-mandation qu’ils ont obtenues. Si le maître de maison hésite à recevoir le voya-geur, celui-ci fait ainsi valoir ses droits. En même temps, l’obligation de recevoirpèse très lourd car les officiels russes en usent et abusent. Cela étant, l’étrangerpeut se retrouver au milieu d’un hameau déserté par la population qui craint devoir ses chevaux réquisitionnés ; ou bien les habitants, y compris femmes et jeunesfilles, redoutent qu’on les utilisent comme postillons 5. Lesseps de son côté, relatela fuite d’un chamane koriak qui craint d’être spolié. Sa fuite n’arrange rienpuisque le vice-consul se sert généreusement de poissons dans sa cave, sans étatd’âme 6. Exaspérés par les réquisitions massives, en l’occurrence 390 chiens requispour l’expédition de Lesseps, les Kamtchadales affamés envoient en 1788 unedélégation à Irkoutsk avec une requête où ils demandent d’annuler les yassak(impôts en nature) impayés depuis 1775, de lever cet impôt en fonction du nom-bre effectif d’âmes imposables et surtout de les débarrasser de la foule de fonc-tionnaires qui les ruinent et les empêchent de travailler 7. Il y a tout lieu de penserque de telles scènes pouvaient se produire dans n’importe quel coin de l’Empire,
4. Ibid., p. 107.5. Jean CHAPPE D’AUTERoCHE, Voyage en Sibérie fait par ordre du roi en 1761, Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1769,
vol. 2, p. 277. 6. Journal historique du voyage de M. de Lesseps depuis l’instant où il a quitté les frégates françoises au port Saint-Pierre et
Saint-Paul du Kamtchatka, jusqu’à son arrivée en France, le 17 octobre 1788, Paris, Imprimerie royale, 1790, vol. 2,p. 4.
7. <http://www.npacific.ru/np/library/publikacii/solnce/chast1_1.htm>
La Sibérie, pays hospitalier ? 131
du Kamtchatka aux frontières occidentales. Cochrane qui arrive au Kamtchatka35 ans plus tard, relate la peur des Kamtchadales d’inviter un étranger dans leurdemeure, car selon l’ancienne coutume, celui-ci aurait droit de se l’approprier etd’en expulser ses propriétaires 8.
Néanmoins, nos voyageurs ont une opinion globalement positive de l’hos -pitalité sibérienne qu’ils constatent dans toutes les couches de la société. « Leurhospitalité est sans limite, et, peut-être, depuis le palais jusqu’à la chaumière, estégale à celle de tout autre peuple dans le monde 9 ». L’observation de Holmanest d’autant plus précieuse, étant donné son parcours : il sait mieux quequiconque que la roue de la fortune peut tourner et celui qui était reçu à brasouverts par tous les notables devient du jour au lendemain persona non grata surl’ordre de l’empereur, la maison jadis si accueillante du gouverneur général deTobolsk restant fermée à son passage. Pourtant James Holman n’en tient pasrigueur aux Russes.
Seul le malheureux confédéré 10 Thesby de belcourt, qui purge son exil àTobolsk pendant trois ans, ne trouve pas à son goût l’hospitalité sibérienne, quiprend à ses yeux des allures perverses, grand thème de la littérature viatique desxVIIIe-xIxe siècles. Certes, avec ses camarades d’infortune, il est reçu quotidien-nement par le gouverneur de Tobolsk, qui de surcroît offre à chacun une pelissede grèbe et deux chemises. Mais, pour Thesby, ce geste n’a rien d’amical et, en lefaisant, le gouverneur les traite en laquais. Pour mieux les humilier en les accueil-lant chez lui, il saisit chaque occasion pour clamer sa haine pour tous ces Françaisqui, à l’instar du baron de Tott, servent la cause des Turcs ou, comme Thesby debelcourt et ses compagnons, celle des Polonais confédérés. Et il finit par ne plusrecevoir les exilés chez lui et réduire leur solde au gré de ses humeurs, qui dépen-dent des victoires et des défaites des troupes russes dans la guerre contre la Porteottomane 11.
À la lecture de ces témoignages, on se rend compte que l’hospitalité comporteplusieurs degrés d’intimité : il y a des dîners officiels et privés auxquels sontconviés (ou pas) les étrangers de passage. Il existe aussi des cérémonies particu -lières auxquelles ils n’ont pas toujours accès. Ainsi l’abbé Chappe d’Auterocheregrette de ne pas être invité à la célébration d’un mariage à Tobolsk, malgré toutl’intérêt qu’il y portait ; d’après lui, les Sibériens ont peur de paraître ridicules àses yeux et d’être présentés en tant que tels dans son ouvrage ; c’est pour cette
8. J. D. CoCHRANE, op. cit., p. 198.9. James HoLMAN, Travels through Russia, Siberia, Poland, Austria, Saxony, Prussia, Hanovre (1822-1824), Londres,
Geo b. Whittaker, 1825, vol. 1, p. 306.10. Il s’agit de la Confédération de bar, groupe d’insurgés polonais qui, en 1768, s’étaient opposés à l’ingérence russe en
Pologne. Thesby de belcourt, avec d’autres volontaires français, s’était enrôlé au service des Confédérés polonais en1769.
11. [François-Auguste THESby DE bELCoURT], Relation ou Journal d’un officier françois au service de la Confédération dePologne, pris par les Russes & relégué en Sibérie, Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1776, pp. 84-85, 89-90.
Galina Kabakova132
Habitations d’hiver et d’été au Kamtchatkain James CooK, Voyage to the Pacific Ocean, Londres, 1785.
Jean-baptiste LE PRINCE, Iourte ou habitation souterraine des Kamtchadals pendant l’hiver,in Jean CHAPPE D’AUTERoCHE, Voyage en Sibérie fait par ordre du roi en 1761,
Paris, Debure père, 1768, t. 2.
La Sibérie, pays hospitalier ? 133
Les traineaux russesin Charles eodore MIDDLEToN, A New and Complete System of Geography Containing a Full, Accurate,
Authentic and Interesting Account and Description of Europe, Asia, Aic and America,Londres, J. Cooke, 1750.
Le chamane en prêtre du diable au pays des ToungouzesNicolas WITSEN, Noord en Oost Tartarye, Amsterdam, 1705.
Galina Kabakova134
raison également qu’il ne peut pas observer la fête du « saint de la famille »,probablement la fête patronale 12.
Certaines cérémonies choquent la sensibilité occidentale. Lesseps a plusconfiance que l’abbé dans les Russes, et il est convié aux noces à Nijnekamtchatsk ;au Kamchatka, où il séjourne pendant six mois, il assiste également à deuxspectacles où les danseurs miment avec une très grande précision le compor -tement de l’ours et où la célèbre danseuse kamtchadale s’adonne à une danseextatique – il les trouve particulièrement sauvages, fatigants autant pour lesacteurs que pour le spectateur et même dégoûtants 13.
Les descriptions des réceptions ne manquent pas d’intérêt ethnographiqueet historique. on apprend, par exemple, que pour rendre honneur à un invité demarque, on l’installe pour la nuit dans le coin noble de la pièce, sous les icônes eten face du feu. À table, après une chasse réussie, les yakoutes lui servent le mor-ceau de choix : la moelle des pattes de devant, crue et encore chaude 14 ou lamoelle de renne crue 15, et chez les Kamtchadales, le régal suprême consiste enune tête de saumon tchavytcha, enfoui pendant quelque temps en terre jusqu’àce qu’il s’avarie 16. L’alcool règne sans partage au cœur de la réception, chez lesindigènes plus encore que chez les Russes. bien traiter son hôte signifie avanttout l’enivrer complètement et le couvrir de présents. Pour les Russes qui avaientintroduit cette désastreuse coutume ayant perverti la population indigène, sur-tout en Extrême-orient, cette hospitalité n’a rien de désintéressé : les Cosaquessaoulent les Kamtchadales pour leur soutirer de précieuses fourrures et l’admi-nistration locale le fait pour « huiler » les rapports ou, comme le dit Lesseps,pour « apprivoiser les esprits sauvages 17 ».
on découvre également des témoignages sur la façon de boire chez les Russes,comme cette page d’anthologie chez Chappe d’Auteroche, où il décrit le brou-haha des santés portés incessamment à table, scène que Catherine II, en colère,décortique dans son Antidote. Malheur à l’étranger, explique l’abbé, qui aimeraitse soustraire à l’obligation de boire tous les verres, il serait immédiatement rappeléà l’ordre. Et Thesby de belcourt, de son côté, montre le risque que court unconvive qui refuserait de consommer les boissons servies : le gouverneur deTobolsk oblige ses hôtes à se soûler et finit par les bastonner.
Les voyageurs décrivent également d’autres particularités de l’hospitalitérusse, telle la distinction des rangs « observée avec la plus scrupuleuse délica -tesse 18 », attestée également par Chappe d’Auteroche. Holman mentionne la
12. CHAPPE D’AUTERoCHE, op. cit., vol. 2, p. 387.13. Journal historique, vol. 1, pp. 103-104, 233-235.14. J. D. CoCHRANE, op. cit., p. 122.15. Journal historique, vol. 1, p. 246.16. Ibid., p. 89.17. Ibid., vol. 2, pp. 98-99. Lesseps assiste à une scène où le père koriak offre une triple rasade à son fils âgé seulement de
six ou sept ans.18. Journal historique, vol. 1, p. 200.
La Sibérie, pays hospitalier ? 135
19. J. HoLMAN, op. cit., vol. 2, p. 86.20. CHAPPE D’AUTERoCHE, op. cit., vol. 2, pp. 372-373.
Charles eodore MIDDLEToN, Mœurs des femmes de Sibérie, op. cit.
coutume, hors d’usage dans d’autres coins de la Russie mais toujours préservéeen Sibérie, d’accueillir tout le monde pendant trois jours à l’occasion de grandesfêtes 19, Chappe d’Auteroche relate la coutume – qu’il trouve par ailleurs ridicule– de faire le tour des maisons en offrant des œufs avec un baiser sur la bouche encélébrant ainsi Pâques 20.
Galina Kabakova136
Comme dans d’autres récits de voyage en Russie, les auteurs ne manquent pasde critiquer les rites de l’hospitalité sibérienne. L’abbé Chappe d’Auteroche trouveles manières de table ridicules et s’émeut de l’absence des femmes qui, pour lui,est un exemple éclairant de la façon dont les femmes sont traitées en Russie engénéral. Thesby de belcourt décrit aussi des réceptions où les femmes ne fontque servir les hommes.
on peut néanmoins supposer, avec Catherine II, que dans ces descriptions ilest question des banquets dans un milieu modeste, qui conserve plus longtempsl’usage de la séparation des sexes attesté pour l’époque antépétrovienne. L’abbé nese contente pas d’être un simple observateur, il est obsédé par l’idée d’apporter lacivilisation au fin fond de cet État peu policé, dans les « contrées barbares » oùles hommes tyrannisent leurs femmes, de moderniser les mœurs russes même s’ilest conscient de l’audace de cette expérience. Ainsi organise-t-il, à Ekaterinbourg,considérée comme une ville assez civilisée grâce à la présence des Allemands, unesauterie où les rôles sont inversés : les femmes, au lieu de servir les hommes, sontinstallées à table et les hommes les servent « ainsi que cela se pratique en Europe ».Même si l’abbé reste fort satisfait de son idée, il ne cache pas qu’une grande partiede l’assemblée, à commencer par les jeunes, s’est retirée, ce qui a permis auxhommes de prendre place à table. Il poursuit sa mission civilisatrice dans la maisond’un Français, M. Cléopet, dans un village minier, où cette fois-ci il expérimentela mixité sociale : vers la fin du dîner on fait venir toutes les filles du village, etl’abbé danse avec une belle paysanne en choquant l’assemblée, mais à la fin, affirme-t-il, tout le monde danse ensemble sans distinction de classe 21.
Le jugement sur l’hospitalité débouche inévitablement sur la question de la civi-lisation. L’avis de l’abbé est sans appel : les mœurs européennes n’ont fait que peude progrès en Russie car elles sont antinomiques avec le despotisme. La vie de sociétéest inconnue au-delà de Moscou, et les sentiments humains ne peuvent pas se déve-lopper dans un pays qui ignore tout de la liberté. Lesseps est plus nuancé : il constatel’indifférence de certains peuples, comme les Koriaks, aux avantages de la vie poli-cée. Il remarque qu’« une sorte de convention d’individu à individu qui retracel’antique hospitalité » n’est pas une coutume séculaire ou une dette sacrée chez cepeuple qui l’obligerait à recevoir des étrangers, mais le résultat de l’action civili-satrice du commandant de la forteresse d’Ijiguinsk, Gaguen, qui contribue ainsià établir des liens entre les Koriaks et les Russes 22. Mais, grâce à son séjour pro-longé au Kamtchatka, il voit également que « civilisation », identifiée à la pré-sence russe dans la région, ne rime pas forcément avec vertu, et les Kamtchadales,à la différence des Cosaques peu scrupuleux, n’ont pas perdu les sentimentsd’honneur et d’humanité 23. Et même si les officiers s’efforcent de donner de bonsexemples de la civilisation, ils ne réussissent pas toujours.21. Ibid., pp. 541-543.22. Journal historique, vol. 2, pp. 78-80.23. Ibid., vol. 1, pp. 95-96.
La Sibérie, pays hospitalier ? 137
Plusieurs voyageurs pourraient adhérer à la vision assez pessimiste d’un grandpays ou plutôt d’un pays d’une grande étendue, où la civilisation s’effiloche au fildes kilomètres, comme le pensait Talleyrand à propos des États-Unis.
C’est un spectacle neuf pour le voyageur, qui partant d’une ville principale où l’étatsocial est perfectionné, traverse successivement tous les degrés de civilisation et d’in-dustrie qui vont toujours en s’affaiblissant, jusqu’à ce qu’il arrive en très peu de jours àla cabane informe et grossière construite de troncs d’arbres nouvellement abattus. Untel voyage est une sorte d’analyse pratique et vivante de l’origine des peuples et desÉtats : on part de l’ensemble le plus complexe pour arriver aux éléments les plus simples[…] et il semble que l’on voyage en arrière dans l’histoire des progrès de l’esprit humain.Si un tel spectacle attache fortement l’imagination, si l’on se plaît à retrouver dans lasuccession de l’espace ce qui semble n’appartenir qu’à la succession des temps, il fautse résoudre à ne voir que très peu de liens sociaux, nul caractère commun, parmi deshommes qui semblent si peu appartenir à la même association 24.
Cochrane, dans un moment de mélancolie, se souvient de cette réflexion,mais sa conclusion n’est pas forcément la même. Si les formes de vie, la culturematérielle dans ce périple de l’ouest vers l’est vont en se simplifiant, il n’en est pasde même pour les sentiments humains : l’homme « barbare », c’est-à-direl’homme à l’état « naturel » conserve humanité et compassion, il partage sonrepas avec un étranger même lorsqu’il est affamé. « Civilisation », elle, rime aveccupidité et vanité. Il quitte la Sibérie avec regret :
Les sensations que j’avais éprouvées en quittant le quart du globe le plus favorisén’étaient rien en comparaison de celles que je ressentais à présent. Je pensais alors quej’allais seulement vers la misère, le vice et la cruauté, alors que je savais maintenant queje quittais la patrie de l’humanité, de l’hospitalité et de la gentillesse 25.
Les monts d’oural représentent alors « la barrière entre la vertu et le vice »,mais ni l’une ni l’autre ne résument à eux seuls le sens de l’existence. Cochranesouhaite sincèrement retourner en Sibérie et finir ses jours dans ce pays lointain26.Son compatriote James Holman va encore plus loin en réfutant l’idée reçue quela civilisation est incompatible avec l’hospitalité, il croit trouver l’une et l’autreau-delà de l’oural 27.
Si l’on revient au début de notre parcours, on peut se demander si la Sibériea tenu toutes ses promesses : s’est-elle montrée comme un pays hospitalier, oùmême un aveugle peut voyager sans danger ? Hélas non : Holman, ce patriote del’hospitalité russe, fut arrêté à Irkoutsk et, sous prétexte d’insécurité, reconduitgentiment à la frontière. La Sibérie reste un pays jalousement préservé…
24. J. D. CoCHRANE, op. cit., pp. 260-261.25. Mémoire sur les relations commerciales des États-Unis avec l’Angleterre par le citoyen Talleyrand lu à l’Institut National,
le 15 Germinal, An V (cité d’après la ressource électronique<http://www.le-prince-de-talleyrand.fr/memoiresrelations.html>
26. Ibid., pp. 248-249.27. J. HoLMAN, op. cit., vol. 2, pp.179-180.
Cet ouvrage est issu des contributions d’un colloque international qui s’est tenu à Lyon, à l’Institut des Sciences de l’Homme, en novembre 2010. C’est au siècle des Lumières que s’invente la Sibérie comme objet de savoir troublant et fascinant. Vue de l’Occident, la Sibérie incarne la Russie à l’extrême. Mais comment concilier la présence de populations « barbares » avec le mythe du Bon Sauvage ? comment faire coexister l’importance des rituels d’hospitalité, dont rendent compte des voyageurs avec le discours sur le despotisme éclairé dans l’empire du knout ? comment, enfin, comprendre que cette région soit une terre d’exil et de châtiment, alors même qu’elle véhicule des représentations idéalisantes, voire utopiques ? Les approches littéraires, historiques et ethnologiques de chercheurs venus de Russie et de France se complètent pour faire sortir de l’ombre un vaste corpus de récits de voyage, de mémoires, de romans, de drames et d’articles de presse consacrés à la Sibérie aux xviiie et xixe siècles.
Sarga Moussa, directeur de recherche au CNRS (UMR LIRE, CNRS - Université Lyon 2), est spécialiste du récit de voyage et de l’orientalisme littéraire au xixe siècle.
Alexandre Stroev, professeur de littérature générale et comparée à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux relations franco-russes au xviiie siècle.
L’in
vent
ion
de la
Sib
érie
par
les
voya
geur
s et
écr
ivai
ns fr
ança
is (X
VIII
e -XIX
e si
ècle
s)
L’invention de la
Sibériepar les voyageurset écrivains français
(XVIIIe-XIXe siècles)Sous la direction de
Sarga Moussa et Alexandre Stroev
L’invention de la
Sibériepar les voyageurset écrivains français
(XVIIIe-XIXe siècles)Sous la direction de
Sarga Moussa et Alexandre Stroev
INSTITUT D’ÉTUDES SLAVES
ISSN 0765-0213ISBN 978-2-7204-0525-9
K 50III.14 20 €