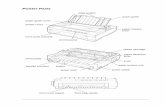« La réforme transcendantale du possible, de l’Analytique des concepts à l’Analytique des...
-
Upload
univ-tlse2 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of « La réforme transcendantale du possible, de l’Analytique des concepts à l’Analytique des...
LA RÉFORME TRANSCENDANTALE DU POSSIBLE, DEL'ANALYTIQUE DES CONCEPTS À L'ANALYTIQUE DES PRINCIPES Claudia Serban P.U.F. | Revue de métaphysique et de morale 2013/4 - N° 80pages 557 à 580
ISSN 0035-1571
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale-2013-4-page-557.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Serban Claudia, « La réforme transcendantale du possible, de l'Analytique des concepts à l'Analytique des principes »,
Revue de métaphysique et de morale, 2013/4 N° 80, p. 557-580. DOI : 10.3917/rmm.134.0557
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour P.U.F..
© P.U.F.. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.14
7.17
4 -
28/0
1/20
14 1
4h32
. © P
.U.F
. D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.147.174 - 28/01/2014 14h32. ©
P.U
.F.
Dossier : puf328441_3b2_V11 Document : RevMet_04_328441 - © PUF -Date : 25/10/2013 10h49 Page 557/130
La réforme transcendantale du possible,de l'Analytique des conceptsà l'Analytique des principes
RÉSUMÉ. – L'article se propose de restituer les étapes et les enjeux de l'élaboration,dans la philosophie critique de Kant, d'une nouvelle acception, transcendantale, dupossible. Cette élaboration est solidaire du passage de la logique formelle à une logiquetranscendantale qui tient compte de la différence (elle-même transcendantale) entreentendement et sensibilité. Le possible ne se définit plus seulement par rapport auxexigences formelles du concept, mais aussi par rapport aux conditions de l'intuition :plus qu'un ens rationis non contradictoire, il est objet d'expérience possible, ou phéno-mène susceptible d'être donné dans le temps et dans l'espace. Quels sont alors sesrapports avec le noumène ou avec les différentes figures du Rien présentées par Kant àla fin de l'Analytique transcendantale ?
ABSTRACT. – The article follows the elaboration of the new, transcendental compre-hension of possibility in Kant's critical philosophy, elaboration which is parallel to thepassage from formal to transcendental logic. Insofar the transcendental differencebetween understanding and sensibility is taken into account, the possible is no longerexclusively defined in relationship to the formal conditions of the concept (non-contra-diction): the crucial reference to intuition makes that, beyond a mere ens rationis, itnames the object of possible experience, the phaenomenon that can be given in time andspace. How is the possible then to be ranged in respect to the noumenon and to thefigures of Nothing that Kant presents at the end of the Transcendental Analytic?
L'Analytique transcendantale de la Critique de la raison pure, dans son ossa-ture invisible reliant jugements, catégories, schèmes et principes, élabore unenouvelle signification, transcendantale, du possible, caractérisée par la doubleréférence inédite au phénomène et à la subjectivité. À la compréhension tradi-tionnelle du possible à partir de la non-contradiction, Kant substitue une accep-tion transcendantale qui intègre l'exigence d'un accord avec les conditionsformelles de l'expérience dans leur dualité constitutive – selon l'intuition etselon le concept – et intériorise ainsi la différence transcendantale entre sensibi-lité et entendement. Et la forme de l'expérience étant précisément la condition dela phénoménalité, tout possible est désormais un phénomène possible, dansl'horizon dominant de la conception que Kant se fait de l'objectivité.
Revue de Métaphysique et de Morale, No 4/2013
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.14
7.17
4 -
28/0
1/20
14 1
4h32
. © P
.U.F
. D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.147.174 - 28/01/2014 14h32. ©
P.U
.F.
Dossier : puf328441_3b2_V11 Document : RevMet_04_328441 - © PUF -Date : 25/10/2013 10h49 Page 558/130
I . L'AMORCE DU SENS TRANSCENDANTAL DU POSSIBLEDANS LA DISSERTATION DE 1770
Avant de passer à l'examen détaillé du sens que reçoit le possible dansl'espace et selon les gradations de l'Analytique transcendantale, nous tâcheronsd'abord de retracer sa genèse (parallèle à celle du possible comme opérateurontothéologique1) dans les écrits précritiques.
La dissertation latine de Kant de 1770, De mundi sensibilis atque intelligibilisforma et principiis, accomplit un premier pas2 en direction de la significationtranscendantale de la possibilité, par sa visée de mettre au jour le propre de lasensibilité en tant que mode spécifique de représentation. Dès lors, si, selon ladéclaration du § 1, « irreprésentable et impossible signifient communément lamême chose (cum irrepraesentabile et impossibile vulgo eiusdem significatushabeantur) 3 », tout l'enjeu consiste à montrer que la représentation – et, dumême coup, l'irreprésentable – ne se définit pas uniquement en relation avecl'entendement. Mais en dépit de la reconnaissance du caractère sui generis de lareprésentation sensible, la réhabilitation plénière de la sensibilité est loin d'êtreaccomplie en 1770. Car Kant admet encore, à cette époque, un usage réel del'entendement : celui-ci représente les choses « telles qu'elles sont (uti sunt) »,alors que la représentation sensible les montre seulement « telles qu'elles appa-raissent (uti apparent) 4 ». Par conséquent, c'est l'entendement qui demeurel'instance souveraine de l'expérience5 : «De l'apparence à l'expérience, il n'y adonc pas d'autre passage que par la réflexion selon l'usage logique de l'entende-ment6. » Rien n'anticipe à ce stade un éventuel dédoublement des conditions del'expérience selon l'intuition et le concept. Avant l'Esthétique transcendantale,
1. Dans la Nova dilucidatio de 1755 et dans le Beweisgrund de 1763, la considération ontologiquedu possible sert en effet la cause de la théologie rationnelle : le « fondement de preuve » kantien envue d'un argument de l'existence de Dieu pose l'existence de l'être nécessaire en prenant commepoint de départ l'indigence ontologique du possible. Qu'il nous soit permis de renvoyer sur ce point ànotre contribution : « L'ontothéologie du possible : Kant critique de Leibniz », à paraître en 2013 dansles Actes du Xe Congrès de la Société d'études kantiennes de langue française «Kant : Théologie etreligion », aux éditions Vrin, dans la collection « Les années Kant ».
2. Pour une évaluation globale de l'apport des écrits précritiques dans l'édification du senstranscendantal de la possibilité, nous renvoyons à l'étude d'Angel Luis GONZÁLES (l'une des rares àêtre consacrée au concept de possibilité en tant que tel) : « La nocion de posibilidad en el Kantprecritico (I) », Anuario filosofico, Universidad de Navarra, 2/1981, pp. 87-115. Cette étude, qui selontoute apparence devait être poursuivie et prolongée par son auteur, est malheureusement restée sanscontinuation.
3. I. KANT, Dissertation de 1770, trad. Paul Mouy, Paris, Vrin, 1995, pp. 22-23 ; Ak. II, 388.4. I. KANT, Dissertation de 1770, § 4, op. cit., pp. 36-37 ; Ak. II, 392.5. Définie ici comme « la connaissance réfléchie qui naît de plusieurs apparences confrontées par
l'entendement » (I. KANT, Dissertation de 1770, § 5, op. cit., pp. 39-40 ; Ak. II, 394).6. Ibid.
558 Claudia Serban
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.14
7.17
4 -
28/0
1/20
14 1
4h32
. © P
.U.F
. D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.147.174 - 28/01/2014 14h32. ©
P.U
.F.
Dossier : puf328441_3b2_V11 Document : RevMet_04_328441 - © PUF -Date : 25/10/2013 10h49 Page 559/130
la différence entre le sensible et l'intelligible ne semble donc être énoncée parKant que pour affermir et renforcer l'entendement7, et il n'y a pas de compossi-bilité ou de synergie des deux modes de représentation qui soit envisagée.
Sur cet arrière-fond de la pensée kantienne de 1770, il n'est pas étonnant devoir que le possible n'apparaît dans la Dissertation qu'en relation avec l'entende-ment : par là, c'est résolument le sens catégorial de la possibilité qui s'esquisse,mais pas encore son sens véritablement transcendantal. Nous pouvons ainsi lireau § 8 de la Dissertation :
La philosophie première, contenant les principes de l'usage de l'entendement pur, est laMÉTAPHYSIQUE. La science propédeutique qui la précède est celle qui enseigne ladifférence entre la connaissance sensible et la connaissance intellectuelle ; nous endonnons un échantillon dans cette dissertation. Donc, en métaphysique, on ne trouvepas des principes empiriques, alors il faut chercher les concepts qu'on y rencontre, nondans les sens, mais dans la nature même de l'entendement pur, non comme desconcepts innés, mais comme abstraits des lois qui siègent en lui (par réflexion sur sesactions à l'occasion de l'expérience), donc acquis. De ce genre sont la possibilité,l'existence, la nécessité, la substance, la cause, etc., avec leurs opposés et dérivés ; ilsn'entrent jamais comme parties dans aucune représentation venue des sens, donc ilsn'ont pu être abstraits d'aucune matière8.
La possibilité fait ici son apparition en tant que concept fondé dans « la naturemême de l'entendement pur ». De manière significative et préfigurant la doctrinede l'acquisition originaire qu'explicitera, en 1790, la Réponse à Eberhard, Kants'oppose ici avec fermeté à tout innéisme d'inspiration leibnizienne9. Car tout enayant une origine pure, les concepts qui sont mentionnés (les futures catégories,dont la liste est laissée ici incomplète mais ouverte) sont pourtant acquis, ils sontle résultat d'une certaine abstraction, même s'il ne s'agit pas d'une abstractionempirique. C'est en réfléchissant sur ses actes dans son fonctionnement suscitépar l'expérience que l'entendement dégage la légalité qui lui est propre et lesconcepts purs qui sont à la base de cette légalité.
7. Selon la fameuse déclaration du § 24 : « Toute la méthode de la métaphysique relative auxsensibles et aux intelligibles revient essentiellement à ce précepte : prendre grand soin que lesprincipes propres de la connaissance sensible ne sortent pas de leurs limites propres et n'aillentpas souiller les intelligibles » (I. KANT, Dissertation de 1770, op. cit., p. 91 ; Ak. II, 411, souligné parKant).
8. I. KANT, Dissertation de 1770, op. cit., p. 43 ; Ak. II, 395, souligné par Kant.9. En effet, dans les Nouveaux Essais sur l'entendement humain (texte paru, comme on le sait, du
vivant de Kant, en 1765), Leibniz situe explicitement le possible parmi les idées innées de notreesprit : « L'idée de l'être, du possible, du même, sont si bien innées qu'elles entrent dans toutes nospensées et raisonnements, et je les regarde comme des choses essentielles à notre esprit » (G.W. LEIBNIZ, Nouveaux Essais sur l'entendement humain, prés. par Jacques Brunschwig, Paris GF,1990, livre I, chapitre 3, § 3, p. 79 ; éd. Gerhardt, tome V, p. 93).
La réforme transcendantale du possible 559
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.14
7.17
4 -
28/0
1/20
14 1
4h32
. © P
.U.F
. D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.147.174 - 28/01/2014 14h32. ©
P.U
.F.
Dossier : puf328441_3b2_V11 Document : RevMet_04_328441 - © PUF -Date : 25/10/2013 10h49 Page 560/130
Concernant l'ébauche inchoative de la table des catégories qui nous est livréeici, il est à noter que la liste de Kant procède en quelque sorte à rebours parrapport à l'ordre d'exposition de la Critique de la raison pure, puisqu'ellecommence avec les catégories de la modalité, voire avec la première d'entreelles, la possibilité (pour mentionner ensuite les deux autres : existence et néces-sité), et se poursuit avec les deux premières catégories de la relation. Kant secontente donc d'invoquer à cet endroit ce qu'il appellera par la suite des catégo-ries dynamiques et passe sous silence les catégories mathématiques de la quan-tité et de la qualité. En même temps, il situe les futures catégories modales(catégories de la liaison subjective ou métaphysique10) en première position.
Or, bien que la possibilité soit posée ici en rapport avec l'entendement pur,Kant ne reconduit pas immédiatement, dans la Dissertation de 1770, la possibi-lité à la non-contradiction. Et même, lorsque, dans sa cinquième et dernièresection, il traite «De la méthode relative aux sensibles et aux intelligibles enmétaphysique » et se propose de dénoncer « l'échange frauduleux des sensibleset des intelligibles », Kant conteste la réduction du possible au non-contradic-toire : «Que tout ce qui n'enveloppe pas de contradiction est, de ce fait, possible,on le conclut faussement en tenant pour objectives les conditions subjectives dujugement11. » La critique que subit à cet endroit le principe de contradiction estsignificative, et elle se retrouvera dans la première Critique : son ressort consisteà dévoiler la considération du temps que ce principe mobilise implicitement. Lefonctionnement du « grand principe » leibnizien (et aristotélicien) suppose demanière irréductible une référence à la temporalité : «Mais le concept du tempsse rattache à ce jugement primitif dans la mesure où des contradictoires étantdonnés en même temps dans le même sujet, l'impossibilité qui apparaît s'énonceainsi : tout ce qui, en même temps, est et n'est pas, est impossible12. »
Le temps fait donc acte de présence dans la définition de l'impossible selon leprincipe de contradiction. Mais par là, nous avons déjà quitté l'horizon du purconcept. Sommes-nous donc dans la subreption métaphysique, dans la souillurede l'intelligible par le sensible ? L'affirmation de Kant semble aller dans le senscontraire : ici, l'intervention du « principe formel du monde sensible » qu'est en1770 le temps (avant l'espace) est exigée par le fonctionnement même du prin-cipe de contradiction. Le monopole de l'intellect pour la détermination du pos-sible est par là quelque peu ébranlé, même si la visée propre de la Dissertationn'est pas la synergie entre entendement et sensibilité, mais leur nette séparation.
10. Selon l'importante note de 1787 qui figure en B 201-202 dans la Critique de la raison pure.11. I. KANT, Dissertation de 1770, § 28, op. cit., p. 103 ; Ak. II, 416, souligné par Kant.12. Ibid.
560 Claudia Serban
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.14
7.17
4 -
28/0
1/20
14 1
4h32
. © P
.U.F
. D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.147.174 - 28/01/2014 14h32. ©
P.U
.F.
Dossier : puf328441_3b2_V11 Document : RevMet_04_328441 - © PUF -Date : 25/10/2013 10h49 Page 561/130
I I . LE REMANIEMENT DU POSSIBLEDANS L'ANALYTIQUE TRANSCENDANTALE
Le sens transcendantal du possible se construit dans la première Critiqueen plusieurs étapes, qui correspondent aux différents moments ou niveaux del'Analytique : jugements, catégories, schèmes, principes, jusqu'à l'intérieur desproblématiques transversales (et intimement liées) de la distinction entre phéno-mènes et noumènes et de l'amphibolie des concepts de la réflexion. Toutd'abord, c'est la « fonction logique de l'entendement » (pour reprendre le titre du§ 9 selon la numérotation de la deuxième édition), telle qu'elle s'exerce dans lejugement, qui nous permet d'anticiper sur ce qui fera le propre des catégories dela modalité, parmi lesquelles la possibilité viendra en premier :
La modalité des jugements est une fonction tout à fait particulière de ceux-ci, quipossède en elle ce caractère distinctif qu'elle ne contribue en rien au contenu du juge-ment (car en dehors de la quantité, de la qualité et de la relation, il n'y a rien d'autre quiconstituerait le contenu d'un jugement), mais concerne seulement la valeur de la copuleen rapport avec la pensée en général. Les jugements problématiques sont ceux où l'onadmet l'affirmation ou la négation comme simplement possibles (au gré de chacun) ;les assertoriques, ceux qui correspondent au cas où elles sont considérées commeréelles (vraies) ; les apodictiques, ceux où l'on tient affirmation ou négation pour néces-saires13.
Cet éclaircissement du statut de la modalité du jugement contient les traits fonda-mentaux qui caractériseront par la suite les catégories modales et les principescorrespondant à ces dernières à l'intérieur de la « table physiologique des prin-cipes » (selon l'expression du § 21 des Prolégomènes). Tout d'abord, Kant pré-cise que la synthèse modale ne concerne pas le contenu du jugement : celarevient à reconnaître que les catégories de la modalité ne sont aucunement des« prédicats réels » – affinité essentielle qu'elles ont avec le sens kantien de l'êtreou de l'existence (Sein ou Dasein). Par ailleurs, les modalités ont affaire directe-
13. I. KANT, Critique de la raison pure (ci-après abrégée CRP), trad. Alain Renaut, Paris, Aubier,1997, A 74-75/ B 99-100. Kant accompagne ce passage d'une note assez étrange : «Comme si lapensée était, dans le premier cas, une fonction de l'entendement, dans le second, une fonction de lafaculté de juger, dans le troisième une fonction de la raison. Remarque qui ne deviendra claire quedans la suite. » Faisant ainsi correspondre chaque moment modal à l'une des facultés de l'espritentrant dans la triade entendement – faculté de juger – raison, Kant identifie implicitement lapossibilité au moment de l'entendement, l'effectivité au moment de la faculté de juger et la nécessitéau moment de la raison. Il parle aussi, un peu plus loin dans le texte de la Critique, de « ces troisfonctions de la modalité comme constituant aussi autant de moments de la pensée en général » (CRP,A 76/ B 101).
La réforme transcendantale du possible 561
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.14
7.17
4 -
28/0
1/20
14 1
4h32
. © P
.U.F
. D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.147.174 - 28/01/2014 14h32. ©
P.U
.F.
Dossier : puf328441_3b2_V11 Document : RevMet_04_328441 - © PUF -Date : 25/10/2013 10h49 Page 562/130
ment à l'être dans la mesure où elles expriment, nous dit Kant, « la valeur de lacopule en rapport avec la pensée en général » : elles sont donc, de manièreconstitutive, modalités de l'être14, ou modalités positionnelles15. D'où la dualitéintrinsèque des catégories modales, évoquées ici en relation avec les jugementsmodaux qui leur correspondent : elles sont à la fois les opérateurs d'une synthèsepurement subjective, sans apport « réel », et les explicitations du sens positionnelde l'être16.
La mention qui est faite du possible à ce stade l'Analytique des concepts (aumoment où le passage à la logique transcendantale est seulement amorcé àtravers l'exploration du « fil conducteur » fourni par la table des jugements)ouvre déjà sur la modification que Kant va faire subir au concept traditionnelde possibilité, et cela en notant, au sujet de la proposition problématique,qu'elle « exprime une possibilité logique (qui n'est pas objective) »17. Kant faitsigne ici, de la manière la plus allusive, vers une dualité qui scinderait le champ
14. Ce n'est donc pas par hasard que HEIDEGGER, in « La thèse de Kant sur l'Être », aborde lequatrième groupe des principes « dans l'unique intention de faire voir comment se manifeste dans cesprincipes le concept-clef de l'Être comme position », et reconnaît en même temps que les Postulats dela pensée empirique sont « les principes qui “expliquent” vraiment les modalités de l'Être » (trad.Lucien Braun et Michel Haar, in Questions I et II, Paris, Gallimard, Tel, 1990, p. 403 ; MartinHeidegger Gesamtausgabe, Tome 9 : Wegmarken, éd. par Friedrich-Wilhelm von Hermann, Franc-fort, Klostermann, 1976, p. 465).
15. Voir à ce sujet, dans les Reflexionen zur Metaphysik, la Réflexion 5557 : «Möglichkeit,Wirklichkeit und Notwendigkeit sind nicht Determinationen, sondern Modalität der Position desDinges mit seinen Praedicaten [La possibilité, l'effectivité et la nécessité ne sont pas des détermina-tions, mais “expriment” la modalité de la position de la chose avec ses prédicats] » (Ak. XVII, 232).L'être comme position serait donc susceptible de diverses modalisations, au lieu de s'identifiersimplement à l'effectif. D'autre part, comme le remarque Bernard ROUSSET: « […] nous aimerionstrouver une description plus précise des actes du sujet posant le possible, l'effectif et le contingent, etune justification plus étendue des motifs de ces positions : pour cela, il faudrait une phénoménologieau sens husserlien, enrichie de tous les apports de la psychologie et de la méthodologie des diversessciences. Mais Kant estimait suffisant pour la constitution de l'objectivité scientifique de pouvoirainsi éliminer la double confusion faite par ses prédécesseurs : par les Leibniziens, qui ne distin-guaient pas assez le possible, le réel et le nécessaire, parce qu'ils en faisaient trois aspects du logique ;par Newton, qui identifiait mouvement réel et mouvement absolu, parce qu'il ignorait la réalitéphénoménale et la vérité scientifique de l'absolu » (La Doctrine kantienne de l'objectivité, Paris, Vrin,1967, pp. 243-244, note).
16. Ces deux dimensions nous semblent tout aussi importantes, ce pourquoi nous ne pouvons pasfaire nôtre l'interprétation donnée par Frank Pierobon du sens de cette synthèse subjective comme« restauration de l'analyticité du jugement », « synthéticité se retournant sur elle-même et s'annu-lant », ou « clôture auto-référentielle » (Frank PIEROBON, Kant et la fondation architectonique de lamétaphysique, Grenoble, Jérôme Millon, 1990, pp. 376 et 378). La synthèse subjective qui est enquestion dans les Postulats est pour Kant essentiellement position de l'objet, même si elle s'accomplità l'intérieur d'un système de coordonnées subjectives. Le subjectif serait ainsi plutôt, selonl'expression heureuse de Jocelyn Benoist, le « sens ultime de la synthèse », où « au concept est ajoutéle type d'usage qu'en fait la subjectivité, dans son rapport à l'objet » (Jocelyn BENOIST, « Jugement etexistence chez Kant », in Quaestio 3-2003, Bari, Brepols, pp. 207-228, pp. 224-225, souligné parl'auteur).
17. CRP, A 75/B 101.
562 Claudia Serban
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.14
7.17
4 -
28/0
1/20
14 1
4h32
. © P
.U.F
. D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.147.174 - 28/01/2014 14h32. ©
P.U
.F.
Dossier : puf328441_3b2_V11 Document : RevMet_04_328441 - © PUF -Date : 25/10/2013 10h49 Page 563/130
même du possible, en opposant possibilité logique et possibilité objective. Ladistinction entre ces deux types de possibilité n'est toutefois pas le propre de lapensée de Kant (même s'il lui donnera par la suite une signification inédite) ;elle se retrouve dans toute métaphysique soucieuse d'articuler l'ordre desessences et celui des existences, depuis les ontologies médiévales jusqu'à Leib-niz, Wolff ou Baumgarten. Et il s'agit d'ailleurs d'une différence que la tabledes catégories ne retiendra pas explicitement lorsque, dans le quatrième groupeque représentent les catégories de la modalité, elle placera en première positionle couple Possibilité – Impossibilité, sans aucune détermination supplémentaire,suivi par les couples catégoriaux Existence – Non-existence et Nécessité –
Contingence.Bien que, selon l'expression des Prolégomènes, la table des catégories soit
déjà une table transcendantale18, et non plus simplement logique, il faudra néan-moins attendre l'Analytique des principes pour être mis en présence d'un sensvéritablement transcendantal du possible. Le lieu de ce tournant n'est autre quecelui où se consomme le partage définitif entre logique formelle et logique trans-cendantale : le schématisme, qui inaugure précisément la mise en œuvre desprincipes synthétiques de l'entendement pur. Regardons donc la forme que revêtle possible dans ce nouveau contexte : « Le schème de la possibilité est l'accordde la synthèse de différentes représentations avec les conditions du temps engénéral […], donc la détermination de la représentation d'une chose relativementà un temps quelconque19. » À cet endroit, le « plus » transcendantal qui est ajoutéau sens catégorial de la possibilité par sa schématisation revient à l'exigenceprimordiale d'une temporalisation, qui réclame que ce qui est possible soit com-patible avec les conditions intuitives formelles du temps.
Ainsi, avec le schématisme, c'est la sensibilité qui fait irruption pour co-déter-miner le sens de la catégorie modale du possible, en y insérant la condition del'accord avec la forme pure du sens interne qu'est le temps. Kant dépasse par cegeste radical le simple conditionnement logique du possible par le principe decontradiction : dans une logique transcendantale, le critère de la non-contradic-tion montre son insuffisance pour assurer le sens plénier du possible. L'illustra-tion que donne Kant du schème de la possibilité contient d'ailleurs une critiqueimplicite de la prétendue suffisance de ce principe :
Le schème de la possibilité est l'accord de la synthèse de différentes représentationsavec les conditions du temps en général (comme, par exemple, celle selon laquelle ce
18. I. KANT, Prolégomènes à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science,trad. Louis Guillermit, Paris, Vrin, 2001 [1986], pp. 71-72 ; Ak. IV, 302-303.
19. CRP, A 144/B 184.
La réforme transcendantale du possible 563
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.14
7.17
4 -
28/0
1/20
14 1
4h32
. © P
.U.F
. D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.147.174 - 28/01/2014 14h32. ©
P.U
.F.
Dossier : puf328441_3b2_V11 Document : RevMet_04_328441 - © PUF -Date : 25/10/2013 10h49 Page 564/130
qui est contraire ne peut se trouver dans une chose en même temps, mais seulementde façon successive) 20.
Kant dévoile ici le ressort central de sa critique du principe de contradiction etde son incapacité à régir le champ des jugements synthétiques, par la mise à nudu recours implicite à une considération du temps au cœur de sa formulationtraditionnelle (dans la condition « en même temps »). Il est montré par là quel'accord d'une représentation conceptuelle avec les conditions du temps nousfait sortir du domaine du pur entendement, en supposant la prise en compte, aumoins formelle, de la sensibilité.
Mais même si le schématisme nous fait accomplir un pas considérable endirection de la conquête du sens transcendantal du possible, c'est seulementavec les Postulats de la pensée empirique en général que ce sens est explicite-ment posé. En effet, cette définition d'un possible proprement transcendantal,c'est seulement le premier Postulat21 de la pensée empirique qui la donne : « Cequi s'accorde avec les conditions formelles de l'expérience (quant à l'intuitionet aux concepts) est possible22. »
La richesse remarquable de ce Postulat qui pose le sens plénier du possibletranscendantal mérite de notre part une analyse des plus minutieuses et atten-tives. Un premier regard, fût-il hâtif, nous dévoile déjà le progrès majeur qui estaccompli ici par rapport au schématisme : si le schématisme, en tant que préa-lable nécessaire à la mise en place du système des principes synthétiques, avaitpu légitimer l'exigence d'un accord avec les conditions du temps, et avait ainsidemandé au possible d'être temporalisable, les Postulats nous font acccéderd'emblée à un niveau plus élevé23 de la logique transcendantale, puisqu'ils
20. Ibid.21. Selon le § 38 de la Logique éditée par Jäsche, « un postulat est une proposition pratique
immédiatement certaine » (I. KANT, Logique, trad. Louis Guillermit, Paris, Vrin, 1997, pp. 122-123 ;Ak. IX, 112-113).
22. CRP, A 218/B 266.23. Pour HEIDEGGER, à la différence d'une riche tradition exégétique qui privilégie le plus souvent
les Analogies de l'expérience, les Postulats représentent le point culminant de l'Analytique desprincipes : « Le quatrième groupe des principes synthétiques de l'entendement pur est antérieur auxautres quant à l'ordre de dignité » (Qu'est-ce qu'une chose ?, trad. Jean Reboul et Jacques Taminiaux,Paris, Gallimard, 1988, p. 247 ; Martin Heidegger Gesamtausgabe, tome 41 : Die Frage nach demDing, éd. par Petra Jaeger, Francfort, Klostermann, 1984, p. 243). Et ils sont caractérisés au mêmeendroit dans les termes suivants : « Les postulats ne sont que des énoncés de l'exigence qui résidedans l'essence de l'expérience. L'essence de l'expérience se fait donc valoir comme le critère auquelse mesurent les modes de l'être-là et par là l'essence de l'être » (Qu'est-ce qu'une chose ?, ibid.,p. 244 ; Martin Heidegger Gesamtausgabe, tome 41, p. 240) ; ou encore, dans « La thèse de Kant surl'Être » : « Les postulats désignent ce qui est par avance exigé pour la position d'un objet del'expérience » (Martin HEIDEGGER, Questions I et II, op. cit., p. 408 ; Martin Heidegger Gesamtaus-gabe, tome 9, p. 468). Le statut particulier des Postulats parmi les principes est également soulignépar Frank Pierobon, qui considère que « les Postulats contiennent toute la table des Principes, y
564 Claudia Serban
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.14
7.17
4 -
28/0
1/20
14 1
4h32
. © P
.U.F
. D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.147.174 - 28/01/2014 14h32. ©
P.U
.F.
Dossier : puf328441_3b2_V11 Document : RevMet_04_328441 - © PUF -Date : 25/10/2013 10h49 Page 565/130
réclament l'accord avec les conditions formelles cette fois-ci de l'expérience,selon la double dimension de l'intuition et du concept. Par là, le possible nes'évalue plus seulement à l'aune du temps, mais sa mesure véritable devientdésormais la forme même de l'expérience. Et le dédoublement des conditionsformelles de l'expérience selon l'intuition et le concept inscrit puissamment aucœur du possible les effets de la découverte kantienne de la différence transcen-dantale entre sensibilité et entendement, différence qui introduit une conditionsupplémentaire au niveau de la constitution de l'objectivité.
L'exploration des conditions de possibilité (Möglichkeitsbedingungen) del'expérience, en tant que tâche centrale de la première Critique, nous révèledonc en fin de compte la possibilité elle-même comme conditionnée, par cetteréférence nécessaire à la forme de l'expérience ou à l'expérience possible. Maisce conditionnement transcendantal du possible nous livre le paradoxe, nonseulement d'une prétention de limitation du possible, mais surtout de la circula-rité apparente24 de cette limitation, dans la mesure où le conditionnement dupossible est relatif à l'expérience elle-même possible. Afin de donner un sens àce paradoxe que nous livre l'énoncé du premier Postulat de la pensée empi-rique, nous allons nous tourner dans un premier temps vers le statut même dece principe de la modalité, qui retrouve et réinvestit les remarques faites aupara-vant au sujet de la modalité des jugements. Voici ce que nous dit Kant à cepropos :
Les principes de la modalité ne sont pas objectivement synthétiques, puisque lesprédicats de la possibilité, de l'effectivité et de la nécessité n'étendent pas le moins dumonde, en ajoutant encore quelque chose à la représentation de l'objet, le conceptauquel on les applique. Dans la mesure où ils sont pourtant toujours bien synthétiques,ils ne le sont que de façon subjective, c'est-à-dire qu'ils ajoutent au concept d'unechose (du réel) dont par ailleurs ils ne disent rien, la faculté de connaître où il trouveson origine et son siège : de la sorte, pourvu que ce concept s'articule dans l'entende-ment avec les conditions formelles de l'expérience, son objet est dit possible25.
compris eux-mêmes » (Frank PIEROBON, Kant et la fondation architectonique de la métaphysique,op. cit., p. 379).
24. Cette circularité reflète sans doute ce que Rüdiger BUBNER appelle « L'auto-référence commestructure des arguments transcendantaux » (Les Études philosophiques, 4/1981, pp. 385-397).
25. CRP, A 233/B 286 (traduction modifiée). À part le fait d'être synthétiquement subjectifs, lesprincipes de la modalité sont des principes dynamiques (tout comme les catégories de la modalité,avec celles de la relation, sont des catégories dynamiques, et non pas mathématiques), et en tant quetels, selon une importante précision de l'Appendice à la Dialectique transcendantale, des principesseulement régulateurs (dans une proximité, renforcée par la dénomination de postulats, avec lesprincipes relevant de la raison), et non pas constitutifs : « Nous avons dans l'Analytique transcendan-tale distingué parmi les principes de l'entendement les principes dynamiques, en tant que principessimplement régulateurs de l'intuition, et les principes mathématiques, qui par rapport à celle-ci sontconstitutifs » (CRP, A 664/B 692).
La réforme transcendantale du possible 565
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.14
7.17
4 -
28/0
1/20
14 1
4h32
. © P
.U.F
. D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.147.174 - 28/01/2014 14h32. ©
P.U
.F.
Dossier : puf328441_3b2_V11 Document : RevMet_04_328441 - © PUF -Date : 25/10/2013 10h49 Page 566/130
Cet éclaircissement rappelle le fait que, tout comme l'être, le possible n'est pasun prédicat réel, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à la teneur chosique de la resou de l'objet. Dans cette optique, il importe de souligner le traitement kantienspécifique de la réalité comme catégorie de la qualité (donc objectivement ouréllement synthétique), en la distinguant de la Wirklichkeit (catégorie kantiennede la modalité que nous préférons rendre par « effectivité », alors que, le plussouvent, le même terme de réalité est employé dans les traductions françaisesdisponibles pour restituer de manière indifférenciée Realität et Wirklichkeit26).
D'autre part, l'exclusion des catégories de la modalité de la sphère des prédi-cats réels nous invite à nous demander quelle relation la possibilité, l'effectivitéet la nécessité entretiennent, de fait, avec l'être27. On pourrait croire que le senspositionnel de l'être revient à identifier ce dernier sans reste à l'effectivité. Maisc'est là une thèse qui porte plutôt sur l'être (Sein) comme existence (Dasein), cequi n'exclut pas qu'il puisse y avoir des modalités de l'être, donc des modalitésde la position dans lesquelles l'être (pris en un sens plus large, mais qui nedépasse toutefois pas le cadre de la pensée empirique) se décline. La note quisuit l'extrait cité plus haut est particulièrement éclairante en ce sens :
Par l'effectivité d'une chose, je pose certes davantage que la possibilité, mais non pasdans la chose ; car la chose ne peut jamais contenir dans son effectivité plus que cequi était conçu dans sa possibilité complète. Dans la mesure, toutefois, où la possibi-lité était simplement une position de la chose relativement à l'entendement (à sonusage empirique), l'effectivité est en même temps une liaison de cette chose avec laperception28.
Les principes de la modalité, nous le voyons, non seulement ont un statutsimilaire à celui du prédicat particulier qu'est l'être, mais ils permettent en plusde mieux comprendre la thèse de Kant sur l'être comme position, dans la
26. Sur le rapport critique entre réalité et effectivité, voir la présentation qu'en donne Heideggerdans son cours fribourgeois sur Kant de 1935-1936 : « Ce qui dans l'ordre de l'entendement purpourrait encore être ajouté au possible par la pensée, c'est seulement l'impossible, mais non l'effectif.Ce qui s'appelle effectif ne s'accomplit et ne s'avère pour nous que dans le rapport de lareprésentation à l'offrande d'un réel à la sensation. Nous voici au point d'où naît la fausseinterprétation du concept de réalité. Puisque le réel, et ce en tant que donné, est seul à confirmerl'objectivité d'un objet, on a assimilé, illégitimement, la réalité à l'effectivité. Mais la réalité n'estqu'une condition de la donation d'un effectif, elle n'est pas encore l'effectivité de l'effectif » (MartinHEIDEGGER, Qu'est-ce qu'une chose ?, op. cit., p. 245 ; Martin Heidegger Gesamtausgabe, tome 41,p. 241).
27. La Réflexion 5142 dépeint laconiquement cette relation : « Sein und Nichtsein ist das erste ;logisch, copula, synthetisch, analytisch ; real : Möglichkeit, Wirklichkeit, Nothwendigkeit [L'être et lenon-être sont ce qu'il y a de premier ; logiquement, c'est la copule, synthétique ou analytique ;réellement : possibilité, effectivité, nécessité] » (Ak. XVII, 102).
28. CRP, A 235/B 287 (traduction modifiée).
566 Claudia Serban
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.14
7.17
4 -
28/0
1/20
14 1
4h32
. © P
.U.F
. D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.147.174 - 28/01/2014 14h32. ©
P.U
.F.
Dossier : puf328441_3b2_V11 Document : RevMet_04_328441 - © PUF -Date : 25/10/2013 10h49 Page 567/130
mesure où les catégories modales ne sont rien d'autre que des modalités de laposition de l'objet 29. De ce point de vue, la possibilité elle-même est éminem-ment une modalité de la position de l'objet, et la différence fondamentalepasserait alors entre la possibilité comme position de la chose relativement ausimple entendement, pris toutefois dans son usage empirique, et l'effectivitécomme liaison avec la perception. Cette considération ne doit pas nous trompersur le sens positionnel du possible puisque, même s'il est dit relatif au seulentendement, l'usage empirique de l'entendement, auquel Kant fait ici réfé-rence, renferme déjà, comme nous l'avons vu, l'exigence de l'accord avec lesconditions formelles de la sensibilité.
En même temps, au-delà de cette nouvelle manière d'opposer possibilité eteffectivité, l'acquis fondamental de cette explicitation du possible à partir ducaractère positionnel de l'être est d'après nous sa reformulation en termes depossibilité, non plus seulement du concept, mais d'un objet pour le concept.C'est un aspect sur lequel insiste d'ailleurs l'« Éclaircissement » qui suit l'énon-ciation des Postulats de la pensée empirique :
Quand le concept d'une chose est tout à fait complet, je peux cependant demanderencore, à propos de cet objet, s'il est simplement possible ou s'il est aussi effectif, oubien, dans ce dernier cas, s'il est également nécessaire. Par là, nulle déterminationsupplémentaire ne se trouve pensée dans l'objet lui-même, mais la question se posesimplement de savoir quel rapport cet objet (muni de toutes ses déterminations) entre-tient avec l'entendement et son usage empirique30.
Il appert ainsi que la question de la possibilité s'adresse éminemment, selonKant, à l'objet du concept plutôt qu'au concept lui-même. C'est ce qui luipermet de dire un peu plus loin, à propos des trois catégories de la modalité,qu'en dépit de ce que pourrait laisser croire leur portée synthétique uniquementsubjective, « elles […] doivent se rapporter aux choses et à leur possibilité31 ».
Nous nous rapprochons ainsi du sens critique de la possibilité objective quel'Analytique des concepts opposait lapidairement à la possibilité logique. Lepoint crucial auquel nous confronte le Postulat de la possibilité, et par lequeladvient la rupture kantienne par rapport à toute ontologie pré-critique, c'est la
29. À ce sujet, les Pölitz-Vorlesungen comportent l'explication suivante : « L'existence, lapossibilité, l'effectivité et la nécessité sont des espèces particulières de catégories qui ne contiennentnullement les prédicats des choses mais ne sont que les manières de poser les prédicats des choses »(I. KANT, Leçons de métaphysique, trad. Monique Castillo, coll. « Le Livre de Poche », 1993, p. 155,traduction modifiée ; Ak. XXVIII, 554).
30. CRP, A 219/B 266.31. CRP, A 219/B 267.
La réforme transcendantale du possible 567
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.14
7.17
4 -
28/0
1/20
14 1
4h32
. © P
.U.F
. D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.147.174 - 28/01/2014 14h32. ©
P.U
.F.
Dossier : puf328441_3b2_V11 Document : RevMet_04_328441 - © PUF -Date : 25/10/2013 10h49 Page 568/130
relativité de toute possibilité objective à la forme de l'expérience. En ce sens,nous pouvons lire, toujours au sein de l'« Éclaircissement » des Postulats :
La forme objective de l'expérience en général contient toute synthèse qui est requisepour la connaissance des objets. Un concept qui contient en lui une synthèse est àconsidérer comme vide et ne se rapporte à aucun objet, si cette synthèse n'appartientpas à l'expérience […]. Car où veut-on chercher le caractère de possibilité pour unobjet qui a été pensé au moyen d'un concept synthétique a priori, si on ne le fait pas àpartir de la synthèse qui constitue la forme de la connaissance empirique des objets ?Que, dans un tel concept, ne doive être contenue aucune contradiction, c'est là, certes,une condition logique nécessaire ; mais pour la réalité objective du concept, c'est-à-dire pour la possibilité de son objet, c'est largement insuffisant 32.
Ces riches considérations nous apprennent d'abord que l'expérience possibleépuise toutes les configurations du champ de l'objectivité – raison pourlaquelle, en retour, l'objectivation doit nécessairement intégrer la référenceconstitutive à l'expérience possible. Elles font également signe vers le ressortqui oriente le traitement critique du possible vers la thématisation d'une possibi-lité objective. En effet, Kant accuse ici l'insuffisance de la prise en compte dela simple non-contradiction du concept, c'est-à-dire de la seule possibilité duconcept : à cette première possibilité, grâce à laquelle le concept se trouvepensé, il oppose le besoin de passer à l'appréciation de la réalité objective duconcept, qu'il voit synonyme de la possibilité de son objet. La possibilitélogique d'un concept ne supplée pas le vide de ce concept ou son manqued'objet, puisqu'elle est simplement analytique ou tautologique : tout ce qu'elledit de ce concept, c'est qu'il peut être pensé, mais elle ne permet pas encore deprendre le chemin de l'objet. La Denkbarkeit n'est pas encore la Möglichkeit àproprement parler. Ce pourquoi, selon une affirmation capitale de la premièreCritique, « une catégorie pure ne suffit pas pour former un principe synthétiquea priori » : la catégorie n'est que la donnée analytique d'une forme de pensée,et elle ne peut jamais assurer par elle-même sa propre réalité objective en vertude sa seule possibilité logique33.
D'où vient alors la réalité objective des catégories pour Kant ? Le traitementkantien de cette notion fondamentale de réalité objective34 mérite un bref exa-
32. CRP, A 220/B 267-268.33. « […] sans l'expérience cette possibilité est une liaison arbitraire de pensées qui, bien que ne
contenant certes aucune contradiction, ne peut en tout cas prétendre à aucune réalité objective, ni parconséquent à la possibilité d'un objet tel qu'on veut le penser en l'occurrence » (CRP, A 223/B 270).
34. Pour une étude comparée de la réalité objective selon Kant et Descartes, nous renvoyons àl'analyse de Hans Wagner : «Realitas objectiva (Descartes-Kant) » (Zeitschrift für philosophischeForschung, 1967, pp. 325-340) et à celle de Jocelyn Benoist : « La réalité objective ou le nombre duréel » (in Michel FICHANT et Jean-Luc MARION (dir.), Descartes en Kant, Paris, Puf, coll. « Épimé-
568 Claudia Serban
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.14
7.17
4 -
28/0
1/20
14 1
4h32
. © P
.U.F
. D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.147.174 - 28/01/2014 14h32. ©
P.U
.F.
Dossier : puf328441_3b2_V11 Document : RevMet_04_328441 - © PUF -Date : 25/10/2013 10h49 Page 569/130
men, surtout si l'on pense à l'emploi cartésien de cette notion dans la troisièmedes Méditations métaphysiques. Pour Descartes, on le sait, la réalité objectiveest le ressort qui permet de passer de l'idée, comprise selon le modèle del'image, à son objet, entendu comme sa cause. Il n'en est pas du tout de mêmeselon Kant : une des thèses fondamentales de la Critique de la raison pureénonce en effet que « la possibilité de l'expérience est […] ce qui donne de laréalité objective à toutes nos connaissances a priori35 ». L'instance suprême dela possibilité objective (que nous pouvons assimiler ici à la possibilité desobjets de l'expérience) est la même que celle de la réalité objective36 descatégories : c'est la forme de l'expérience ou l'expérience possible37. Le senstranscendantal de la possibilité, c'est, nous le comprenons à présent, de signifiertacitement la possibilité de l'expérience.
Cet avatar de la possibilité objective qu'est la réalité objective du conceptnous renvoie donc toujours à ce référent ultime, posé par le premier Postulat dela pensée empirique, qu'est la forme de l'expérience. Si l'énoncé du Postulat dela possibilité distribue ces conditions formelles de l'expérience selon les deuxaxes de l'intuition38 et du concept, pour ce qui est des exigences qui relèventdu concept, nous avons déjà pu noter qu'elles impliquent la non-contradiction,la possibilité d'être pensé (Denkbarkeit), comme nécessaire mais insuffisante.Le schématisme revient à compléter la condition de la concevabilité par l'exi-gence d'un accord avec les conditions du temps, exigence qui inscrit la tempo-ralisation au cœur de tout possible véritable. Ce que le sens transcendantal dupossible, tel qu'il est parachevé par les Postulats de la pensée empirique,apporte de plus par rapport à ces déterminations, c'est l'exigence d'une spatiali-sation possible, ou d'une construction possible dans l'espace. Cette exigence
thée », 2006, pp. 179-196). Des deux interprétations, nous agréons plutôt le diagnostic de HansWagner, qui insiste sur le fait que Kant opère une immanentisation (et une subjectivation) dufondement de la réalité objective de la connaissance, alors que Jocelyn Benoist n'y voit qu'« uneseule et même détermination quantitativiste de la réalité, simplement transférée du plan (directement)ontologique au plan transcendantal » (art. cit., p. 195).
35. CRP, A 156/B 195, souligné par Kant.36. Celle-ci reçoit par conséquent le sens d'une « application à des objets qui peuvent nous être
donnés dans l'intuition, mais uniquement comme phénomènes » (CRP, B 150-151).37. « Ce n'est donc qu'autant que ces concepts expriment a priori les rapports des perceptions
dans chaque expérience que l'on reconnaît leur réalité objective, c'est-à-dire leur vérité transcendan-tale, et cela indépendamment, certes, de l'expérience, mais non pas cependant indépendamment detoute relation à une forme de l'expérience en général » (CRP, A 221-222/B 269).
38. Le caractère fondamental de cette référence à l'intuition est souligné par Jules VUILLEMIN, quifait voir que, au sein de la correspondance qu'entretient chacun des Postulats avec l'un des groupes deprincipes synthétiques déjà dégagés par l'Analytique, « le possible correspond aux axiomes del'intuition » (« La théorie kantienne des modalités », in Akten des 5. Internationalen Kant-Kongresses,Mainz 4.-8. April 1981, Partie II : Vorträge, Bonn, Bouvier, 1982, pp. 149-167, p. 150). Cf. aussiFrank PIEROBON, op. cit., p. 379.
La réforme transcendantale du possible 569
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.14
7.17
4 -
28/0
1/20
14 1
4h32
. © P
.U.F
. D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.147.174 - 28/01/2014 14h32. ©
P.U
.F.
Dossier : puf328441_3b2_V11 Document : RevMet_04_328441 - © PUF -Date : 25/10/2013 10h49 Page 570/130
(qui n'est pas sans poser problème, car elle ne nous dit rien de la possibilitépropre aux objets du sens interne, comme les émotions ou les sentiments39)transparaît de l'exemple donné par l'« Éclaircissement » du premier Postulat :
Que, dans un tel concept, ne doive être contenue aucune contradiction, c'est là, certes,une condition logique nécessaire ; mais pour la réalité objective du concept, c'est-à-dire pour la possibilité de son objet, c'est largement insuffisant. Ainsi, dans le conceptd'une figure comprise entre deux lignes droites, il n'y a pas de contradiction, car lesconcepts de deux lignes droites et de leur rencontre ne contiennent la négationd'aucune figure ; au contraire, l'impossibilité ne repose pas sur le concept en lui-même, mais sur sa construction dans l'espace, c'est-à-dire sur les conditions del'espace et de sa détermination, conditions qui, à leur tour, ont leur réalité objective,c'est-à-dire se rapportent à des choses possibles, parce qu'elles contiennent a priori laforme de l'expérience en général 40.
Cette promotion de l'espace comme constituant le reste décisif des conditionsformelles de l'expérience qui régissent la possibilité objective, à côté de la non-contradiction comme possibilité logique du concept et de sa temporalisationpossible, nous met en présence d'acquis qui remontent aux écrits précritiquesde Kant visant la réhabilitation du critère de la spatialité comme originaire etirréductible. En effet, déjà dans l'opuscule de 1768 intitulé Du premier fonde-ment de la différence des régions de l'espace, tout en attribuant une surprenantefiliation leibnizienne à sa démarche41, Kant avait soigneusement tâché de sépa-rer signification conceptuelle et signification spatiale, pour démontrer l'irréduc-tibilité de l'espace42 à des critères purement logiques. Des échos de ce résultatprécoce se retrouvent au § 13 des Prolégomènes 43, dans l'analyse du paradoxe
39. Nous remercions Raphaël Ehrsam d'avoir attiré notre attention sur cette difficulté, sur laquellenous reviendrons un peu plus loin.
40. CRP, A 220-221/B 267-268.41. Kant se revendique en effet dans cet opuscule de l'idée leibnizienne d'une Analysis situs et
affirme : « Je cherche ici philosophiquement le premier fondement de ce dont il a conçu le projet » (I.KANT, Du premier fondement de la différence des régions dans l'espace, in Quelques opusculesprécritiques, trad. Sylvain Zac, Paris, Vrin, 1970, p. 91 ; Ak. II, 377). Les conséquences qui sedégagent de la promotion de l'espace en tant que critère de différenciation sui generis vont pourtantmanifestement à l'encontre de certaines thèses leibniziennes fondamentales, dont le principe del'identité des indiscernables.
42. Toutefois, en 1768, l'espace est loin d'avoir conquis son statut critique de forme pure del'intuition ; il n'est même pas un « principe formel du monde sensible », comme ce sera le cas en1770, mais un « concept fondamental » qui « conditionne la possibilité » de toute sensation extérieure(I. KANT, «Du premier fondement de la différence des régions dans l'espace », in Quelques opusculesprécritiques, p. 98 ; Ak. II, 383)
43. Kant conclut à cet endroit : «Aucun concept n'est à lui seul capable de rendre concevable ladifférence entre deux choses qui tout en étant semblables et égales n'en sont pas moins incongruentes(par exemple des escargots dont l'enroulement est inverse), nous ne pouvons le faire qu'en recourantau rapport à la main droite et à la main gauche, rapport qui est du ressort immédiat de l'intuition » (I.
570 Claudia Serban
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.14
7.17
4 -
28/0
1/20
14 1
4h32
. © P
.U.F
. D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.147.174 - 28/01/2014 14h32. ©
P.U
.F.
Dossier : puf328441_3b2_V11 Document : RevMet_04_328441 - © PUF -Date : 25/10/2013 10h49 Page 571/130
des objets symétriques44 qui entend montrer que, pour des objets identiquesselon leur concept, tels deux triangles sphériques situés dans deux hémisphèresou des volutes inversement roulées, leur orientation ou leur disposition diffé-rente dans l'espace selon la droite et la gauche ne constitue pas moins unedifférence objective, qui fait que, par exemple, le gant destiné à la main gauchen'est pas approprié à être porté sur la main droite.
Cette mise en évidence du caractère originaire du critère spatial pour lechamp de l'objectivité débouche sur une critique du principe leibnizien desindiscernables, principe selon lequel toute différence objective est une diffé-rence conceptuelle. L'opposition de Kant à ce principe qui est le lieu par excel-lence de l'excès logiciste de Leibniz revêt de notre point de vue le sens d'unélargissement significatif du domaine du possible, puisque là où Leibniz, insen-sible à l'originarité des déterminations spatiales, voyait une seule chose (parexemple, non pas deux volutes ou deux triangles, orientés vers la gauche ouvers la droite, mais un seul et même triangle ou une seule volute), Kant permetde reconnaître que chacun des deux objets symétriques est un objet à partentière. Le possible se trouve en conséquence enrichi (et non pas, comme onpourrait le croire, seulement appauvri) par l'intégration de la spatialité commeforme pure parmi ses conditions constitutives.
Une conséquence analogue se dégage d'un autre acquis important de lapériode précritique de Kant, à savoir la découverte des grandeurs négatives,dont témoigne l'écrit de 1763, Essai pour introduire en philosophie le conceptde grandeur négative. Dans cet opuscule, Kant entend montrer qu'à côté del'opposition logique (la contradiction), il existe un autre type d'opposition suigeneris : l'opposition réelle45. Ce deuxième type d'opposition est illustré àl'aide d'un exemple témoignant de l'intérêt pour la dynamique inspiré par
KANT, Prolégomènes à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science, p. 50 ; Ak.IV, 286).
44. En 1768, Kant privilégiait l'aspect de la non-congruence, en avançant la définition suivante :« J'appelle corps non congruent à un autre, un corps qui est tout à fait égal et semblable à celui-ci,sans toutefois pouvoir être enfermé dans les mêmes limites » (I. KANT, «Du premier fondement de ladifférence des régions dans l'espace », in Quelques opuscules précritiques, p. 91 ; Ak. II, 382).
45. «Deux choses sont opposées entre elles lorsque le fait de poser l'une supprime l'autre. Cetteopposition est double : soit logique (par la contradiction), soit réelle (sans contradiction). On n'aconsidéré jusqu'ici que la première opposition ou opposition logique. Elle consiste à affirmer et à nierquelque chose dans un même sujet. La conséquence de cette connexion logique n'est absolument rien(nihil negativum irrepraesentabile), comme l'énonce le principe de contradiction […]. La deuxièmeopposition, l'opposition réelle, est telle que deux prédicats d'un sujet sont opposés, mais sanscontradiction. Certes, ce qui a été posé par l'un est ici aussi supprimé par l'autre, mais la conséquenceest quelque chose (cogitabile). […] La conséquence en est également Rien, mais en un autre sens quela contradiction (nihil privativum, repraesentabile) » (I. KANT, Essai pour introduire en philosophiele concept de grandeur négative, trad. Roger Kempf, Paris, Vrin, 1980, pp. 19-20 ; Ak.II, 171-172,souligné par Kant).
La réforme transcendantale du possible 571
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.14
7.17
4 -
28/0
1/20
14 1
4h32
. © P
.U.F
. D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.147.174 - 28/01/2014 14h32. ©
P.U
.F.
Dossier : puf328441_3b2_V11 Document : RevMet_04_328441 - © PUF -Date : 25/10/2013 10h49 Page 572/130
Leibniz : celui de deux forces physiques de direction opposée, dont l'une annulel'action de l'autre et réduit son résultat à zéro. Aux yeux de Kant, ce zéro finaln'est cependant pas rien, puisqu'il est justement le résultat d'une oppositionréelle, de même que les forces qui se trouvent en opposition ne sont pas nullesou inexistantes : elles agissent seulement de telle manière que l'une annulel'action de l'autre et sont ainsi chacune la grandeur négative de l'autre. Cetexemple emprunté à la dynamique nous montre que le zéro de réalité peut êtrele résultat d'une opposition de principes non moins actifs car, des deux forces,l'une ne peut être dite négative que relativement à l'autre, qu'elle neutralise,tandis qu'en soi elle est tout autant positive. Qui plus est, la reconnaissance dela présence active de deux forces physiques en dépit du fait que le résultat finalde leur action conjointe est égal à zéro, dépend elle aussi d'une prise en comptede la spatialité. Car pour pouvoir entrer en opposition réelle, les forces enquestion ont besoin de s'opposer dans l'espace.
Kant mentionne également, toujours pour exemplifier sa découverte des gran-deurs négatives, le cas de ce que l'on pourrait appeler des « phénomènes néga-tifs », tels le froid, l'ombre ou l'obscurité, la haine, le démérite etc. À leur tour,ces phénomènes ne se réduisent pas à de simples privations ; leur efficienceintrinsèque les révèle comme de véritables réalités ; en eux, quelque choseapparaît bien. De cette manière, les grandeurs négatives élargissent elles aussile champ du possible et permettent de comprendre comme réalité ou commephénomène ce que Leibniz, Wolff et Baumgarten concevaient comme purenégation ou privation.
Nous avons jugé utile la présentation de tous ces exemples pour montrer lesconséquences immédiates de la définition transcendantale du possible, et surtoutpour prouver que le caractère apparemment restrictif 46 de cette nouvelle défini-tion n'exclut pas, de fait, un élargissement et un enrichissement du champ de lapossibilité. Nous avons pu ainsi donner une épaisseur et un contenu au remanie-ment transcendantal du possible, qui pose l'exigence de l'accomplissement detoutes les conditions de possibilité de l'expérience. Mais, parmi ces conditionsformelles, est-ce que toutes, c'est-à-dire, les intuitions pures et la non-contradic-tion du concept, détiennent le même rang ?
En posant cette question, nous nous rapprochons des implications les plusprofondes du premier Postulat de la pensée empirique. Si nous avons déjàévoqué le paradoxe d'une limitation (au moins apparente) du possible en fonc-
46. Selon le diagnostic de Gottfried MARTIN: « Pour Kant, l'intuition est en plus, avec précision,ce qui restreint le domaine de l'existence logique et du concevable sans contradiction, au domaine del'existence mathématique et de la construction possible » (Science moderne et ontologie traditionnellechez Kant, trad. Jean-Claude Piguet, Paris, Puf, 1963, p. 33).
572 Claudia Serban
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.14
7.17
4 -
28/0
1/20
14 1
4h32
. © P
.U.F
. D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.147.174 - 28/01/2014 14h32. ©
P.U
.F.
Dossier : puf328441_3b2_V11 Document : RevMet_04_328441 - © PUF -Date : 25/10/2013 10h49 Page 573/130
tion des conditions formelles de la sensibilité, il faut savoir que Kant en a eului-même une conscience des plus aiguës :
C'est une chose fort remarquable que nous ne puissions nous apercevoir de la possibi-lité d'aucune chose d'après la simple catégorie, mais qu'il faille toujours disposerd'une intuition pour y présenter la réalité objective du concept de l'entendement […].Aussi longtemps que l'on manque donc d'intuition, on ne sait pas si, par l'intermé-diaire des catégories, on pense un objet ou si peut même leur être assigné un quel-conque objet, et ainsi se confirme qu'elles ne sont pour elles-mêmes jamais desconnaissances, mais de simples formes de pensée en vue de produire des connais-sances à partir des intuitions données. De là vient aussi qu'à partir de simples catégo-ries nulle proposition synthétique ne peut être forgée47.
L'intégration du rapport à l'intuition dans l'acception transcendantale du pos-sible apparaît ici encore comme régie par le souci de fonder une possibilitéobjective 48 ou, ce qui revient au même, d'assurer la réalité objective duconcept. En même temps, Kant prend le soin d'articuler la problématique dupossible avec celle des jugements synthétiques ou, plus largement, de la syn-thèse49. L'intervention nécessaire du rapport aux formes de l'intuition est ainsirenvoyée à l'incapacité des catégories à fonder par elles-mêmes des principes
47. CRP, B 288-289.48. C'est pourquoi, comme le souligne Jules Vuillemin, il faut «mettre en correspondance le
principe de la possibilité non seulement avec les axiomes de l'intuition, mais avec l'analogie de lasubstance », puisque « la possibilité d'une chose ne peut être tirée du seul concept de cette chose, maisje dois me la représenter dans sa permanence » (Jules Vuillemin, art. cit, p. 152).
49. Dans ses Reflexionen zur Metaphysik, Kant parle plusieurs fois de critères synthétiques de lapossibilité, voire de possibilité synthétique : « Ce qui s'accorde avec les conditions analytiques de lapensée, est logiquement possible ; ce qui s'accorde avec les conditions synthétiques [de la pensée] estréellement possible (real). La possibilité logique sans la possibilité réelle est un concept vide sanscontenu, c'est-à-dire sans rapport à l'objet (Objekt) » (« Réflexion 4801 », in I. KANT, Manuscrit deDuisbourg (1774-1775). Choix de réflexions des années 1772-1777, trad. François-Xavier Chenet,Paris, Vrin, 1988, p. 137 ; Ak. XVII, 723), et encore plus significativement : « Il est facile decomprendre (einzusehen) le critère analytique de la possibilité, l'absence de contradiction. Le critèresynthétique de la possibilité ne peut pas être compris (eingesehen werden) à partir de [simples]concepts. Les conditions synthétiques de la possibilité sont en même temps les conditions de lapossibilité des objets (Gegenstände) de l'expérience. Mais il ne s'agit pas là de la possibilité deschoses en soi » (« Réflexion 5184 », in I. KANT, Manuscrit de Duisbourg, p. 167 ; Ak. XVIII, 111-112). Pour la possibilité synthétique, nous pouvons indiquer la Réflexion 4567, qui note lapidaire-ment : « Possibilitas synthetica, Analytica (Ak. XVII, 627), mais surtout la Réflexion 5556, quiaffirme : «Die analytische Möglichkeit beruht auf dem Satze des Widerspruchs und ist die Möglich-keit des Begriffes ; die synthetische Möglichkeit, die hinzu kommen muss, d. i. dass dem Begriffe einGegenstand korrespondieren könne, darauf, dass etwas den Bedingungen eines Gegenständes derErfagrung (überhaupt) gemäss sei. (Nur in der Erfahrung kann ein Obiect gegeben werden.) [Lapossibilité analytique repose sur le principe de contradiction et est la possibilité du concept ; lapossibilité synthétique, qui doit s'y ajouter pour qu'au concept corresponde un objet, repose sur laconformité aux conditions d'un objet de l'expérience (en général). (C'est seulement dans l'expériencequ'un objet peut être donné.)] » (Ak. XVII, 232).
La réforme transcendantale du possible 573
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.14
7.17
4 -
28/0
1/20
14 1
4h32
. © P
.U.F
. D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.147.174 - 28/01/2014 14h32. ©
P.U
.F.
Dossier : puf328441_3b2_V11 Document : RevMet_04_328441 - © PUF -Date : 25/10/2013 10h49 Page 574/130
synthétiques. La catégorie, pure donnée analytique de l'entendement, constituecertes une pensée, mais elle n'est pas encore une connaissance : sa possibilitéformelle ou logique reste, nous l'avons vu, une possibilité vide. Or, la possibi-lité vide n'en est pas réellement une50 ; c'est ce que montrera également le casdu noumène.
Mais avant d'arriver au chapitre portant sur le « Principe de la distinction detous les objets en général en phénomènes et noumènes », examinons une autreprécision apportée par la «Remarque générale sur le système des principes »qui précède ce chapitre :
Encore plus remarquable est-il cependant que, pour comprendre la possibilité deschoses suivant les catégories et donc pour démontrer la réalité objective des cesdernières, nous ayons besoin, non simplement d'intuitions, mais même toujoursd'intuitions externes51.
C'est ici que réside, à nos yeux, l'aspect le plus surprenant et sans doute le plusénigmatique52 de la nouvelle acception du possible selon l'Analytique transcen-dantale. L'insistance sur l'intuition externe semble en effet suggérer que lapossibilité des objets du sens interne suppose et requiert une sorte de spatialisa-tion, comme celle que le langage courant opère lorsque l'on dit qu'un sentimentremplit le cœur, une émotion envahit, etc. L'affirmation de la nécessité d'une« intuition externe dans l'espace53 » ne peut ainsi constituer qu'une radicalisa-tion par rapport au Postulat de la possibilité lui-même, qui se limitait à invoquerindifféremment les conditions formelles de l'expérience et acceptait ainsi tacite-
50. Au sens transcendantal, la possibilité est éminemment possibilité réelle ou objective, ce quijustifie l'incapacité du concept à assurer la fondation plénière de la possibilité : «Die Möglichkeit derDinge nach blossen Categorien lässt sich nicht einsehen [La possibilité des choses ne se laisse pasapercevoir d'après de simples catégories] » (Réflexion 5150), ou encore : «Die Möglichkeit derSachen nur durch Anschauung oder als Princip der Erfahrung [La possibilité des choses seulementpar l'intuition ou comme principe de l'expérience] » (Réflexion 5180), Ak. XVII, 103 et 110.
51. CRP, B 291. Cet extrait peut être rapproché avec profit d'un passage de la Préface desPremiers principes métaphysiques de la science de la nature où Kant écrit : « Il est, en effet, trèsremarquable (ce qu'on ne peut ici exposer en détail) que la métaphysique générale toutes les fois qu'illui faut des exemples (des intuitions) pour procurer une signification aux purs concepts de l'entende-ment, doive toujours les emprunter à la théorie générale des corps, par conséquent à la forme et auxprincipes de l'intuition extérieure ; et quand ceux-ci ne se trouvent pas parachevés, elle erre à tâtons,instable et chancelante parmi une foule de concepts dépourvus de sens » (I. KANT, Premiers principesmétaphysiques de la science de la nature, trad. Jean Gibelin, Paris, Vrin, 1990, p. 21 ; Ak. IV, 478).
52. Heidegger voit dans ce fragment, selon l'Introduction à son Interprétation phénoménologiquede la Critique de la raison pure, « l'énigme de la déchéance (Verfallen) du Dasein » – de sa dispersiondans l'extériorité, nous pourrions dire (Martin HEIDEGGER, Interprétation phénoménologique dela Critique de la raison pure, trad. Emmanuel Martineau, Paris, Gallimard, 1982, p. 79 ; MartinHeidegger Gesamtausgabe, Tome 25 : Phänomenologische Interpretation von Kants Kritik derreinen Vernunft, éd. par Ingtraud Görland, Francfort, Klostermann, 1977, p. 68).
53. CRP, B 292.
574 Claudia Serban
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.14
7.17
4 -
28/0
1/20
14 1
4h32
. © P
.U.F
. D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.147.174 - 28/01/2014 14h32. ©
P.U
.F.
Dossier : puf328441_3b2_V11 Document : RevMet_04_328441 - © PUF -Date : 25/10/2013 10h49 Page 575/130
ment que les objets du sens interne sont possibles pour autant qu'ils sont donnés(seulement) dans le temps. À présent, l'idée d'un objet donné exclusivementdans le sens interne semble être remise en question, et le recours nécessaire àdes intuitions externes revient à une exigence constitutive de spatialisation quifrappe même les objets qui ne sont pas donnés dans l'espace à proprementparler.
Cette radicalisation s'explique sans doute par le fait que la « Remarque sur lesystème des principes », ici en question, est un ajout de la deuxième édition dela Critique de la raison pure, tout comme la très importante insertion, au cœurde l'éclaircissement du Postulat de l'effectivité, de la célèbre «Réfutation del'idéalisme ». La parenté de ces deux additions de 1787 est d'ailleurs manifeste :Kant utilise le même argument54 qui constitue le ressort de sa réfutation del'idéalisme pour démontrer la nécessité de recourir à une intuition externe dansle cas de la possibilité – à savoir, que seule une intuition externe dans l'espaceest à même de fournir une véritable représentation de la permanence55. Si, audépart, le schématisme posait une première exigence de temporalisation dupossible, à présent la réfutation kantienne de l'idéalisme conduit à destituer lapréséance du temps au profit du primat écrasant de l'espace.
Un même mécanisme régit donc le rôle central que reçoit l'intuition externedans la Réfutation de l'idéalisme et dans la spécification du sens transcendantalde la possibilité. Et c'est ici que se situe, d'après nous, la véritable limitationkantienne du possible, au moment où l'espace affirme son privilège immensesur le temps. Puisque cela revient à nier au temps, comme forme du sensinterne, toute véritable capacité donatrice, nous croyons pouvoir soutenir qu'endernière instance, c'est l'univocité de la donation chez Kant, rabattue sur lemodèle de l'intuition externe, qui opère la restriction la plus significative duchamp du possible56. Une fois admis ce primat du sens externe, ce qui est un
54. La Réfutation de l'idéalisme, on le sait, fournit une preuve (négative) de l'existence d'unmonde extérieur en démontrant la réalité objective de l'intuition externe et transforme ainsisensiblement la question même de l'extériorité. Cette manière de procéder sera poussée encore plusloin dans l'Opus postumum kantien, où la réalité objective du sens externe est censée suffire pourprouver la présence aux sens de la matière comme « élément cosmique » (I. KANT, Opus postumum,trad. François Marty, Paris, Puf, coll. « Épiméthée », 1986 ; voir par exemple : p. 58, Ak. XXI, 221 ; oupp. 73-74, Ak. XXII, 554-555 ; ou encore p. 91, Ak. XXII, 360 et p. 110, Ak. XXII, 513-514).
55. Comme le note Kant : « Toute cette remarque est de grande importance, non seulement pourconfirmer notre précédente réfutation de l'idéalisme, mais bien davantage encore, quand il va êtrequestion de la connaissance de nous-mêmes par la simple conscience intérieure et de la déterminationde notre nature sans l'aide des intuitions empiriques extérieures, pour nous indiquer les limites d'unetelle connaissance » (CRP, B 293-294). En termes phénoménologiques, cela veut dire en définitiveque, pour Kant, le vécu n'est jamais (le) phénomène : l'apparition est toujours apparition dansl'extériorité.
56. C'est le point visé par Michel Henry dans sa Généalogie de la psychanalyse, dans le chapitreintitulé « La subjectivité vide et la vie perdue : la critique kantienne de l'âme », lorsqu'il reproche à
La réforme transcendantale du possible 575
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.14
7.17
4 -
28/0
1/20
14 1
4h32
. © P
.U.F
. D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.147.174 - 28/01/2014 14h32. ©
P.U
.F.
Dossier : puf328441_3b2_V11 Document : RevMet_04_328441 - © PUF -Date : 25/10/2013 10h49 Page 576/130
objet possible doit désormais, de manière fondamentale, pouvoir être donnédans l'intuition externe. Cela révèle la solidarité étroite qui relie chez Kant lepossible et le phénomène, « objet indéterminé d'une intuition empirique ».
I I I . POSSIBLE ET IMPOSSIBLE, PHÉNOMÈNE ET NOUMÈNE
Le « concept suprême » de l'objet en général (Gegenstand überhaupt) connaîtchez Kant, comme on le sait, des divisions concurrentes : notamment57, celle enpossible et impossible58 et celle en phénomènes et noumènes. Même s'il s'agitde divisions qui se recoupent plutôt que de se superposer, dans le chapitre del'Analytique des principes traitant «Du principe de la distinction de tous lesobjets en général en phénomènes et noumènes », Kant s'attarde longuement surla possibilité et les autres catégories de la modalité :
La possibilité, l'existence, la nécessité, personne n'a pu encore les définir que par uneflagrante tautologie, à chaque fois qu'on a voulu puiser leur définition dans l'entende-ment pur. Car l'illusion qui consiste à substituer la possibilité logique du concept(quand il ne se contredit pas lui-même) à la possibilité transcendantale des choses(quand au concept se trouve correspondre un objet) ne peut abuser et satisfaire quedes esprits inexpérimentés 59.
Le sens d'une telle réflexion dans le contexte de la mise au jour de l'oppositionentre phénomènes et noumènes se laisse saisir lorsque l'on s'aperçoit que lenoumène, tout comme la catégorie prise en elle-même, exprime seulement unepossibilité logique, pour autant que son concept n'est pas contradictoire. Maissa simple possibilité d'être pensé ne nous donne pas encore sa réalité objective,ou la possibilité réelle (appelée ici transcendantale) d'un objet qui lui corres-ponde, car l'intuition, source unique de réalité objective, lui fait défaut. C'est làque se situe la raison de l'exil du noumène dans la nuit de l'inconnaissable etde la promotion du phénomène en seul objet de la connaissance synthétique.
Kant « le paralogisme subtilement inclus dans la dénomination du sens interne », qui serait à son tourun « sens de l'extériorité, un sens externe » (Michel HENRY, Généalogie de la psychanalyse, Paris,Puf, coll. « Épiméthée », 1985, p. 139).
57. Nous laissons de côté ici la troisième division, représentée par la polarité quelque chose / rien,même si nous l'utiliserons lorsque nous discuterons la table du Rien.
58. Pour le caractère fondamental de cette première division du domaine de l'objectivité, voir letémoignage lapidaire des Réflexions 5140 et 5143, qui notent respectivement : «Obiect überhaupt istMöglich oder Unmöglich [L'objet en général est possible ou impossible] » et «Obiect entwederMöglich oder Unmöglich [L'objet – ou bien possible ou bien impossible] » (Ak. XVII, 102).
59. CRP, A 244/B 302 (traduction modifiée).
576 Claudia Serban
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.14
7.17
4 -
28/0
1/20
14 1
4h32
. © P
.U.F
. D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.147.174 - 28/01/2014 14h32. ©
P.U
.F.
Dossier : puf328441_3b2_V11 Document : RevMet_04_328441 - © PUF -Date : 25/10/2013 10h49 Page 577/130
Sans une intuition qui atteste sa réalité objective, la possibilité logique dunoumène, tout comme celle de la catégorie, n'est rien :
L'Analytique transcendantale obtient donc cet important résultat : elle montre quel'entendement ne peut a priori rien faire de plus que d'anticiper la forme d'uneexpérience possible en général, et que, dans la mesure où ce qui n'est pas phénomènene peut être un objet de l'expérience, l'entendement ne peut jamais outrepasser leslimites de la sensibilité, à l'intérieur desquelles seulement des objets nous sontdonnés. Ses principes sont seulement des principes de l'exposition des phénomènes,et le nom orgueilleux d'une ontologie qui prétend donner des choses en général desconnaissances synthétiques a priori […] doit faire place au nom plus modeste d'unesimple analytique de l'entendement pur60.
Si démesurée que puisse sembler l'étonnante modestie de vouloir remplacerl'ontologie traditionnelle par une analytique de l'entendement pur61, il est fon-damental pour notre propos de comprendre ce qui permet à Kant de s'arrogerun tel mérite ; autrement dit, de voir ce que sa philosophie critique a d'absolu-ment nouveau par rapport à toute autre ontologie du passé ou « philosophietranscendantale des Anciens62 ». À cette fin, il importe de reconnaître que ceque pose Kant, c'est beaucoup plus que la relativité de l'objet de l'ontologie àla connaissance, déjà accomplie par des ontologies scolastiques et par la méta-physique allemande d'école. Car Kant accuse constamment l'insuffisance d'unetelle référence au seul pensable. L'objet de la nouvelle ontologie (phénoménale,voire phénoménologique) qu'est l'Analytique transcendantale n'est pas l'étanten tant qu'il est taillé à la mesure de la connaissance, en tant que pensable ouconnaissable, mais, comme l'extrait que nous venons de citer le dit explicite-ment, c'est le phénomène – c'est-à-dire, l'objet donné dans une intuition. Lephénomène en tant que ce qui se donne dans l'intuition est le seul objet de laconnaissance synthétique, le seul donc où les concepts purs de l'entendementgagnent leur réalité objective. Nouvel objet de la connaissance ontologique, il
60. CRP, A 246-247/B 303.61. Dans l'Interprétation phénoménologique de la Critique de la raison pure de Kant, nous en
trouvons la justification suivante : « C'est parce que la connaissance transcendantale est une connais-sance ontologique que Kant peut assimiler la philosophie transcendantale à l'ontologie. » C'estpourquoi Heidegger appelle ce que nous nommons ici possibilité transcendantale, possibilitéontologique : « La possibilité transcendantale est la possibilité ontologique à la différence de lapossibilité simplement logique », dans la mesure où « la possibilité transcendantale est pour Kant lapossibilité réale (reale) par opposition à la possibilité logique » (Martin HEIDEGGER, Interprétationphénoménologique de la Critique de la raison pure de Kant, op. cit., p. 179 ; Martin HeideggerGesamtausgabe, tome 25, p. 186).
62. C'est un point que nous avons exposé sous une forme plus développée dans notre contribution« Le statut du possible dans le discours critique de Kant et “la philosophie transcendantale desAnciens” », Les études philosophiques, no 2/2013, pp. 159-177.
La réforme transcendantale du possible 577
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.14
7.17
4 -
28/0
1/20
14 1
4h32
. © P
.U.F
. D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.147.174 - 28/01/2014 14h32. ©
P.U
.F.
Dossier : puf328441_3b2_V11 Document : RevMet_04_328441 - © PUF -Date : 25/10/2013 10h49 Page 578/130
ne s'identifie plus simplement à ce qui est pensable, mais ajoute à cette condi-tion de sa concevabilité la nécessité de l'accord avec les conditions formelles del'intuition. L'objet de la nouvelle ontologie doit pouvoir être donné dans letemps, et a fortiori dans l'espace. Ses contours sont donc tracées par l'Esthé-tique transcendantale63 ; la temporalisation et la spatialisation sont tout aussiintimement inscrites dans sa constitution que le fait d'être pensable. Nous pou-vons, certes, à partir de cette restriction à la phénoménalité du champ de laconnaissance ontologique, critiquer, comme nous l'avons fait, l'univocité de lacompréhension kantienne de la donation, qui limite considérablement la typo-logie des phénomènes par la surenchère de l'intuition externe, mais nous nepouvons pas contester la radicalité de cette refonte de l'ontologie64.
Dans cette perspective, le possible dans son acception transcendantale s'iden-tifie en fin de compte avec ce qui constitue un phénomène possible65. Mais y a-t-il un recoupement parfait entre la distinction du possible et de l'impossible etl'opposition entre phénomènes et noumènes ? Plus précisément, le noumènetombe-t-il entièrement du côté de l'impossible ?
Le passage de l'Analytique transcendantale où, après la Remarque surl'amphibolie des concepts de la réflexion, Kant élève la division en possible etimpossible au concept suprême qu'est celui de l'objet en général, est suivi parla table du Rien, lieu privilégié de la doctrine kantienne de l'impossible : ellenous permet, en effet, de décider du caractère possible ou impossible du nou-mène précisément parce que la première figure du Rien exposée par Kant, l'ensrationis, défini comme concept vide sans objet, est expressément présentécomme l'avatar du noumène. Or, l'être de raison « ne peut être mis au nombredes possibilités, parce qu'il est une simple fiction (bien que non contradic-toire) 66 ». La seule possibilité qu'a le noumène d'être pensé – sa Denkbarkeit –ne suffit pas pour le considérer comme véritablement – comme réellement ouobjectivement – possible : il reste plutôt, tout comme la simple catégorie sans
63. Pour cette raison, Gérard GRANEL peut affirmer (in L'Équivoque ontologique de la penséekantienne, Paris, Gallimard, 1970, p. 95) que « l'Esthétique transcendantale est une ontologie », endélocalisant ainsi la refonte critique de l'ontologie par rapport à l'Analytique.
64. Pour nous, il ne s'agit donc aucunement d'une « prétendue ontologie », comme le considèreJocelyn BENOIST, prêt à reconduire le tournant kantien à ses préfigurations médiévales (« Sur uneprétendue ontologie kantienne : Kant et la néo-scolastique », in Kant et la pensée moderne, PressesUniversitaires de Bordeaux, 1996, pp. 137-163). Nous préférons parler d'ontologie phénoménale ouphénoménologique pour désigner la théorie de l'étant comme objet et de l'objet comme phénomènequi sous-tend l'entreprise critique de Kant.
65. Nous rejoignons par là le constat de Jean-Luc MARION dans Étant donné, au § 19 dont lapremière section, intitulée « Possibilité et phénoménalité », note au sujet du premier Postulat de lapensée empirique : « L'étonnant revient ici au lien intime que Kant établit entre la possibilité et laphénoménalité […]. Ici, la possibilité dépend donc de la phénoménalité » (Étant donné, Paris, Puf,coll. « Épiméthée », 2005 [1997], p. 253).
66. CRP, A 291/B 348.
578 Claudia Serban
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.14
7.17
4 -
28/0
1/20
14 1
4h32
. © P
.U.F
. D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.147.174 - 28/01/2014 14h32. ©
P.U
.F.
Dossier : puf328441_3b2_V11 Document : RevMet_04_328441 - © PUF -Date : 25/10/2013 10h49 Page 579/130
réalité objective, un possible vide, car il ne vérifie qu'à moitié les conditions del'objectivité, en séparant analytiquement l'intuition du concept67. De fait, si lepossible se trouvait réduit à l'intelligible ou à ce qui est concevable, les nou-mènes pourraient être dits possibles, et ce sans aucune réserve. Mais ce seraitoublier que, pour Kant, la possibilité de tout objet est relative à la com-possibi-lité des conditions formelles de l'entendement et de la sensibilité, donc à lasynergie du concept et de l'intuition68. Et c'est parce que la doctrine de l'objeten général ne peut faire abstraction des conditions de donation de l'objet que lenoumène comme ens rationis, le simplement pensable, s'identifie pour Kant àune figure du Rien.
Il revient ainsi à l'obscure table du Rien69 de nous éclairer, en définitive, ausujet du décalage que manifeste l'entreprise transcendantale kantienne par rap-port aux ontologies traditionnelles qui font déjà le pas de mesurer l'étant àl'aune de la connaissance (et donc de réduire l'ens à l'obiectum) : pour Kant, lepur cogitabile, l'en rationis, n'est pas un aliquid, mais une figure du nihil.
Nous conclurons donc brièvement sur la manière dont s'entrecroisent, ausein de la théorie kantienne de l'objectivité, les trois divisions concurrentes dudomaine de l'objet en général (Gegenstand überhaupt) : possible – impossible,phénomène – noumène, quelque chose – rien. C'est parce que, conformémentaux exigences de la pensée empirique, le possible devient chez Kant synonymede ce qui peut se phénoménaliser, et cela dans les strictes conditions où unedonation de l'objet peut avoir lieu pour nous, que le noumène se trouve exclude champ de la possibilité (réelle ou objective) et renfermé dans la table du
67. Il est important de souligner ici que la forme vide de l'intuition est pour Kant une figure durien – l'ens imaginarium – tout autant que la forme vide de la pensée qu'exprime l'ens rationis. Cen'est qu'à partir de ce fait fondamental qui veut que les conditions formelles de l'expérience, à l'aunedesquelles tout objet, tout aliquid doit se mesurer, ne soient en soi rien, que s'explique, autrement quepar une symétrie externe avec la table des catégories, le caractère quadriparti de la table du Rien : leRien renvoie ainsi aux formes subjectives de l'expérience et aux pseudo-objets qui n'en tiennent pascompte en omettant l'une d'entre elles ou les deux. En ce sens, nous pouvons invoquer la précieusereformulation de la table du rien dans la Réflexion 5156 : «Nihil. 1, negativum, 2, privativum, 3,conceptus inanis, 4, intuitus mere formalis » (Ak. XVII, 105). Le conceptus inanis, qui remplace icil'ens rationis, est, selon la Réflexion 3997, celui « cui non respondit obiectum [auquel ne correspondaucun objet] » (Ak. XVII, 380).
68. Cohen note à cet égard : « la possibilité est une détermination synthétique du rapport quiconcilie intuition et pensée » (Hermann COHEN, La Théorie kantienne de l'expérience, trad. ÉricDufour et Julien Servois, Paris, Cerf, 2001, p. 476).
69. La conception kantienne du Rien est brillamment analysée par Ernesto MAYZ VALLENILLA (LeProblème du néant chez Kant, Paris, L'Harmattan, 2000, et «Kant's Begriff des Nichts und seineBeziehungen zu den Kategorien », Kant-Studien, 1965, pp. 342-348). Voir aussi Ernst VOLLRATH,«Kants These über das Nichts », Kant-Studien, 1970, pp. 50-65 ; Michel FICHANT, « La “Table duRien” dans la Critique de la raison pure de Kant », Cahiers de philosophie de l'Université de Caen, n° 43, 2007, pp. 297-318, ainsi que la présentation de la table du Rien par Claude ROMANO dans LeNéant. Contribution à l'histoire du non-être dans la philosophie occidentale, sous la dir. de JérômeLaurent et Claude Romano, Paris, Puf, coll. « Épiméthée », 2006, pp. 415-428.
La réforme transcendantale du possible 579
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.14
7.17
4 -
28/0
1/20
14 1
4h32
. © P
.U.F
. D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.147.174 - 28/01/2014 14h32. ©
P.U
.F.
Dossier : puf328441_3b2_V11 Document : RevMet_04_328441 - © PUF -Date : 25/10/2013 10h49 Page 580/130
Rien. La contribution insigne de Kant à l'histoire philosophique du concept depossibilité réside ainsi dans cette double référence inédite au phénomène et à lasubjectivité70 qui marque le passage vers une ontologie d'un type nouveau –
une ontologie non plus universelle, mais, si le mot peut convenir ici, régionale– astreinte à l'être « pour nous (hommes) », à l'être comme phénomène, à l'êtretel qu'il se donne à nous.
Claudia SERBANFondation Thiers/CNRS
70. À la lumière de cette conclusion, la phénoménologie allemande de la première moitié duXXe siècle – celle de Husserl comme celle de Heidegger, pour nommer seulement ses représentants lesplus importants – nous apparaît comme la grande héritière du traitement kantien du possible. C'estune hypothèse que nous réservons à des travaux ultérieurs.
580 Claudia Serban
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.14
7.17
4 -
28/0
1/20
14 1
4h32
. © P
.U.F
. D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.147.174 - 28/01/2014 14h32. ©
P.U
.F.