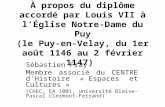LA FRISE IONIQUE À MASQUES SCÉNIQUES DU PROPYLON DU SÉBASTEION D'APHRODISIAS
-
Upload
paris-sorbonne -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of LA FRISE IONIQUE À MASQUES SCÉNIQUES DU PROPYLON DU SÉBASTEION D'APHRODISIAS
Cet article est disponible en ligne à l’adresse :http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=ARCH&ID_NUMPUBLIE=ARCH_061&ID_ARTICLE=ARCH_061_0033
La frise ionique à masques scéniques du Propylon du Sébasteion d’Aphrodisiaspar Nathalie DE CHAISEMARTIN
| Presses Universitaires de France | Revue archéologique2006/1 - n° 41ISSN 0035-0737 | ISBN 213055847X | pages 33 à 82
Pour citer cet article : — de Chaisemartin N., La frise ionique à masques scéniques du Propylon du Sébasteion d’Aphrodisias, Revue archéologique 2006/1, n° 41, p. 33-82.
Distribution électronique Cairn pour Presses Universitaires de France .© Presses Universitaires de France . Tous droits réservés pour tous pays.La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
LA FRISE IONIQUE À MASQUES SCÉNIQUESDU PROPYLON DU SÉBASTEION
D’APHRODISIAS
par Nathalie de Chaisemartin
La frise ionique à masques scéniques du propylon du Sébasteion1, sanctuaire dédié àAphrodite et à la famille impériale julio-claudienne, a été rendue au jour de 1981 à 1983 lorsdes fouilles conduites par le Pr K. T. Erim2. Elle appartient à l’ordre ionique de la structure à
Résumé. – La frise ionique du propylon du Sébasteiond’Aphrodisias, datable de la première phase de déve-loppement du complexe, sous Tibère, présente unedouble série paratactique de masques scéniques issusdu répertoire tragique et comique – identifiables grâceaux indications de Pollux –, et de têtes satyriques etdionysiaques dans une proportion équilibrée. Lesmodèles issus du répertoire traditionnel attique sonttraités dans un style miniaturiste et humoristique quiles éloigne des grands masques romains du théâtrede Marcellus et les rapproche des masques votifs etdécoratifs de terre cuite produits par les ateliers tardo-hellénistiques d’Asie Mineure comme Myrina et Ami-sos. Leur présence sur un monument abritant lesstatues de la famille d’Auguste s’explique peut-être parles ultimes paroles de l’empereur en l’honneur de quiest édifié le Sébasteion.
Mots clés. – Turquie. Aphrodisias. Sanctuaire. Sébasteion.Architecture. Décor architectural. Ordre ionique. Frise.Iconographie. Masque. Tragédie. Comédie. Satyre. Dio-nysisme. Époque romaine. Ier s. av. / Ier s. apr. J.-C.
The Ionic Frieze with Scenic Masks of the SebasteionPropylon of Aphrodisias.
Abstract. – The Ionic frieze on the Sebasteion inAphrodisias belongs to the first phase of developmentof the complex, dated to the reign of Tiberius, and isdecorated, in equal measure, with a double paratacticseries of scenic masks of the tragic and comic repertoire– according to Pollux’ identification –, and of satyricand Dionysiac heads. The patterns borrowed from thetraditional Attic repertoire are treated in a miniaturisticand humoristic style which is not present in the bigRoman masks of the theatre of Marcellus but which canbe compared with the votive and ornamental terracottamasks produced by Late Hellenistic workshops of AsiaMinor like Myrina and Amisos. Their presence on amonument which sheltered the statues of the imperialfamily of Augustus might be justified by the last wordsof the emperor in honor of whom the Sebasteion wasbuilt.
Key-words. – Turkey. Aphrodisias. Sanctuary. Sebas-teion. Architecture. Architectural sculpture. Ionic order.Frieze. Iconography. Mask. Tragedy. Comedy. Satyr.Dionysiac. Roman period. Irst BC / Irst AD.
REV. ARCH. 1/2006
1. Je remercie chaleureusement les Prs Ch. Ratté etR. R. R. Smith, codirecteurs de la mission archéologiquede la New York University à Aphrodisias, de m’avoir ac-cordé l’autorisation de publier cette étude sur la frise àmasques du propylon du Sébasteion, qui m’avait été confiéepar le regretté Pr K. T. Erim, son découvreur.
2. K. T. Erim, Fasti archeologici, 32-33, 1977-1978,no 8676 ; 34-35, 1979-1980, no 9216-9217 ; Aphrodisias,
1980, III. Kazi Sonüçlari Toplantisi, Ankara, 1981, p. 21-24 (désormais cité KST) ; IV. KST, Ankara, 1982, p. 307,fig. 10-11 ; Aphrodisias, City of Venus Aphrodite, NewYork / Londres, 1986, p. 106-123 ; F. Hueber, Der Bau-komplex einer julisch-claudischen Kaiserkultanlage inAphrodisias, dans J. de La Genière, K. T. Erim éd.,Aphrodisias de Carie, Colloque du Centre de Recherchesarchéologiques de l’Université de Lille III, 13 novembre 1985,
claire-voie qui ferme le côté Ouest du complexe, et domine de quelques marches la rue princi-pale Nord-Sud d’Aphrodisias. Elle apparaît comme un élément essentiel de l’originalité archi-tecturale du propylon, qui se présente à son tour comme l’ouverture harmonique vers uncomplexe unique en son genre dans le monde romain.
Aisément reconstituable malgré un bloc manquant et la destruction de quelques-uns desmasques, elle permet de définir une typologie des masques conservés à partir de la liste de Pol-lux et d’en comparer les modèles avec les masques scéniques d’époque hellénistique en diversmatériaux classés et étudiés par l’équipe de T. B. L. Webster3, ainsi qu’avec la série proto-hellénistique de la nécropole de Lipari publiée par L. Bernabò Brea4. Enfin, la frise du propylondoit être analysée dans le contexte de la décoration architecturale en Asie Mineure à l’époquejulio-claudienne, où ce modèle de frise paratactique semble rare par rapport aux frises à mas-ques reliés par des guirlandes. On peut en tirer quelques conjectures sur les intentions descommanditaires et les influences qui ont guidé leur choix.
LA STRUCTURE DU PROPYLON
Les déploiements de panneaux sculptés des pseudo-portiques à triple niveau qui enca-drent la voie sacrée menant à la terrasse du temple ont généralement détourné l’attention del’architecture originale du propylon : il n’en reste de fait sur place que le podium surplombant larue principale Nord-Sud de ses volées de marches, ennoyées aujourd’hui par les remontées ducours d’eau qui traverse le site (fig. 1).
Pourtant l’élévation restituée proposée par F. Biller, U. Outschar et F. Hueber5 (fig. 2)donne une bonne idée de cette structure à supports libres sur deux niveaux, dont les deux balda-quins tétrastyles encadrés d’entablements saillants sur deux colonnes présentaient une série destatues et de bustes de la famille d’Auguste et de ses ancêtres Énée et Aphrodite Prométôr6.Large d’environ 15 m, elle fait un léger angle par rapport à la perpendiculaire de la voie, et sescolonnades ionique et corinthienne se superposaient sur un podium à quatre piédestaux degrands orthostates, qui joint au Sud la structure perpendiculaire du pseudo-portique méridional.
Les auteurs qui ont traité de la chronologie relative des éléments du Sébasteion7 ontgénéralement considéré que le propylon avait été construit antérieurement au portique Sud, ce
34 Nathalie de Chaisemartin
Paris, Recherches sur les Civilisations, 1987, p. 101-102, et U. Outschar, Betrachtungen zur kunstgeschicht-lichen Stellung des Sebasteions in Aphrodisias, ibid.,p. 107-122.
3. T. B. L. Webster, R. Green, A. Seeberg, MonumentsIllustrating New Comedy, 1-2, 3e éd. (Bull. Inst. Cl. St.,suppl. 50), Londres, 1995.
4. L. Bernabò Brea, Menandro e il teatro greco nelle terre-cotte liparesi, Gênes, 1981 ; L. Bernabò Brea, M. Cavalier,Maschere e personaggi del teatro greco nelle terrecotte liparesi(Biblioteca archeologica, 32), Rome, 2001.
5. U. Outschar, ibid., restitution de l’élévation, p. 115,fig. 2.
6. J. M. Reynolds, Ruler-cult at Aphrodisias in the LateRepublic and under the Julio-Claudian Emperors, dansA. Small éd., Subject and Ruler : The Cult of the Ruling Powerin Classical Antiquity (JRA, suppl. 17), Ann Arbor, 1996,p. 41-50.
7. F. Hueber, loc. cit., p. 104 ; J. M. Reynolds, New Evi-dence for the Imperial Cult in Julio-Claudian Aphrodisias,ZPE, 43, 1981, p. 317-327 ; R. R. R. Smith, The ImperialReliefs from the Sebasteion at Aphrodisias, JRS, LXXVII,1987, p. 88-138.
qui expliquerait que le dernier masque de la face Sud du bloc d’entablement en avancée ait étébûché pour s’appliquer à la structure à pilastre d’angle Sud-Ouest du portique8. Au Nord, lemur de fermeture occidental du pseudo-portique est construit en même temps ou juste aprèsle propylon qu’il prolonge. J. M. Reynolds considère que cette première phase de constructiondu Sébasteion serait datable de la première décennie du règne de Tibère (14-25 apr. J.-C.).Cependant les dédicaces inscrites sur l’entablement ionique du propylon pourraient dater de laseconde phase de construction.
L’ensemble, à travers lequel se découvrait la perspective du sanctuaire, devait présenterune certaine analogie avec les compositions de peintures murales du second style9, où unecolonnade articulée, peuplée de figures idéales, fait partiellement écran devant des paysagesd’idylle, des jardins sacrés, des colonnades fuyant dans le lointain10. L’absence de mur de fond
La frise ionique à masques scéniques du propylon du Sébasteion d’Aphrodisias 35
8. Pourtant la partie inférieure de ce pilastre sembleavoir été entaillée au contact du piédestal de l’avancée.
9. R. A. Tybout, Aedificiorum figurae, Untersuchungenzu den Architekturdarstellungen des frühen zweiten Stils, Ams-terdam, 1989.
10. Par ex. la paroi Sud de l’apodyterium de la Casadel Criptoportico de Pompéi : V. Spinazzola, Le arti decora-tive in Pompei e nel Museo Nazionale di Napoli, Mi-lan / Rome / Venise / Florence, 1928, p. 435-593 ; E. LaRocca, M. et A. de Vos, Guida archeologica di Pompei, Vé-
1. Aphrodisias, vue du propylon du Sébasteion.
et de baies le distingue clairement des modèles de portes de ville et d’arcs honorifiquesromains (comme la Porta Borsari à Vérone11 ou la porte de Mazaeus et Mithridates àÉphèse12) évoquant la poterne d’une place-forte. Les projections latérales de l’entablement surdeux colonnes et le mouvement à retrait médian entre deux demi-frontons des couronnementsrappellent les partis pris architecturaux de la frons scaenae tardo-hellénistique du théâtred’Aphrodisias, tandis que la partie centrale en retrait est couronnée d’un fronton à rampantscourts sous un couronnement horizontal, d’un type surtout connu dans l’Occident romain àtravers les architectures scéniques peintes.
36 Nathalie de Chaisemartin
rone, 1976, p. 202-203 ; Ch. Berns, FrühkaiserzeitlicheTabernakelfassaden, Zum Beginn eines Leitmotivs urbanerArchitektur in Kleinasien, dans Ch. Berns et al. éd., Patrisund Imperium (BABesch, suppl. 8), Louvain / Paris / Dud-ley (Mass.), 2002, p. 165, fig. 7.
11. G. Cavalieri Manasse, La cinta muraria di Verona,dans Il Veneto nell’età romana, II, Vérone, 1987, p. 7-12.
12. W. Alzinger, Augusteische Architektur in Ephesos,Vienne, 1974, p. 9-16.
2. Aphrodisias, restitutiondu propylon du Sébasteion.Cl. F. Biller, U. Outschar.
Leur schéma général peut être envisagé comme un dédoublement des structures depropylées à baldaquin sur colonnes dont l’exemple le plus marquant, daté de 50 av. J.-C., estle propylon d’Éleusis13 construit par Appius Claudius Pulcher. Deux études récemmentpubliées dans les actes du colloque de Cologne sur l’architecture urbaine d’Asie Mineure,Patris und imperium14, s’intéressent justement à ces structures combinant des baldaquins àcolonnes. Toutes deux évoquent le propylon du Sébasteion, celle de Ch. Berns soulignant saparenté de structure avec le mur de scène triumviral du théâtre d’Aphrodisias, celle deM. Ortaç montrant qu’il marque une étape dans l’évolution des portes monumentales enAsie Mineure. Toutefois aucune des deux n’insiste sur l’absence du mur percé de portes quicaractérise normalement un propylon, et le fait que l’accès à claire-voie au Sébasteion dévoilecomplètement aux passants de la voie Nord-Sud la perspective du monument.
Le propylon de l’agora inférieure de Sagalassos15, datant de l’époque tibérienne etcontemporain de celui du Sébasteion d’Aphrodisias, présente une structure analogue, avecune colonnade ionique surmontée d’une frise à guirlandes, masques et protomés d’animauxassez caractéristique du travail des sculpteurs aphrodisiens pour qu’on soit tenté de leur enattribuer la création. Pour une visibilité optimale, ce propylon se place à mi-hauteur des largesvolées de marches conduisant à l’agora commerciale et, par la verticalité de son élévation,coupe leurs horizontales successives. Plus tard, au IIe siècle, ces propylées à baldaquinsouverts seront repris dans plusieurs cités d’Asie Mineure : porte du port16 et ported’Hadrien17 à Éphèse, porte Nord de la voie sacrée à Milet (Hafentor)18, « Agora Gate »d’Aphrodisias19 et, dans l’Antiquité tardive, porte orientale à arcades sur baldaquins du stadede Milet20.
On a pu proposer de restituer dès l’époque augustéenne une structure de ce genre àRome21, constituant l’accès monumental Sud du Forum et formant un arc à triple baie entre laPorticus Gai et Luci et la face Nord-Est du temple du Divin César. À la perpendiculaire del’extrémité de la basilique Aemilia, quatre soubassements de socles rectangulaires – dont ledernier s’appuyait directement sur les marches du temple – devaient soutenir quatre balda-quins supportant un entablement rectiligne couronné de sculptures.
La frise ionique à masques scéniques du propylon du Sébasteion d’Aphrodisias 37
13. H. Hörmann, Die inneren Propyläen von Eleusis, Ber-lin / Leipzig, 1932 ; G. Sauron, L’histoire végétalisée, Paris,2000, p. 161-176, fig. 78.
14. Ch. Berns, loc. cit., et M. Ortaç, Zur Veränderungder kleinasiatischen Propyla in den frühen Kaiserzeit inBauform und Bedeutung, dans Berns et al. éd., op. cit.,p. 175-186.
15. L. Vandeput, The Architectural Decoration in RomanAsia Minor, Sagalassos : A Case Study (Studies in EasternMediterranean Archaeology, I), Louvain, 1997, p. 58-63,pl. 22-24.
16. Restitution dans W. Oberleitner éd., Ephesos undSamothrake, cat. expo., Vienne, 1978, p. 60-61, fig. 40.
17. H. Thür, Das Hadrianstor in Ephesos (Forschungen inEphesos, XI/1), Vienne, 1989.
18. G. Kleiner, Die Ruinen von Milet, Berlin, DAI Istan-bul, 1968, p. 54, fig. 31.
19. K. T. Erim, op. cit., p. 123-130, et hypothèse de res-titution de Ch. B. Rose, p. 183.
20. G. Kleiner, ibid., p. 112, fig. 83.21. F. Coarelli, Il Foro Romano, Il periodo repubblicano e
augusteo, Rome, 1985, p. 285-308 ; E. Nedergaard, Zurproblematiker Augustusbögen auf dem Forum romanum,dans M. Henig éd., Kaiser Augustus und die verlorene Repu-blik, cat. expo., Berlin, 1988, p. 224-238.
LA DOUBLE INSCRIPTION DÉDICATOIRE
La dédicace du monument22 en capitales élégantes se présente en version abrégée ducôté Ouest sur les architraves antérieures des deux baldaquins : sur le bloc Nord sont indiquésles noms des constructeurs, tandis que le bloc Sud porte la dédicace à Aphrodite, aux empe-reurs et au peuple du propylon et de son décor statuaire. Le côté Est aligne sur ses 5 blocs defrise architravée23 une version plus complète du texte : les dédicants sont deux frères, EusébèsPhilopatris et Ménandros, fils de Ménandros fils d’Eunikos, auxquels s’ajoute Apphias, sœurde Ménandros et épouse d’Eusébès. Celui-ci porte le surnom de Philopatris, qui lui a sansdoute été décerné pour son évergétisme, car il avait probablement aussi offert un premier éta-blissement thermal à la ville, à l’emplacement des futurs Thermes d’Hadrien24. Peut-êtredevrait-on rapprocher cette famille de celle de Diogénès fils de Ménandros, dédicant du por-tique tibérien voisin, et situer ces personnages dans la lignée des notables donateurs des monu-ments du centre urbain d’Aphrodisias.
Il est clair que le propylon appartient, comme le pseudo-portique Nord, à une premièrephase de construction, dans la première décennie du règne de Tibère25. Elle est de peu anté-rieure à celle du temple et du pseudo-portique Sud édifié par d’autres commanditaires. Enrevanche, l’inscription de dédicace du portique Nord évoque une restauration de celui-ci oude l’ensemble qui pourrait être due aux suites d’un séisme sous le règne de Claude, probable-ment celui de 40 apr. J.-C., et qui implique dans le financement du monument une autregénération de membres de la même famille de donateurs. Le problème est donc de détermi-ner si le propylon était alors déjà terminé ou encore en cours d’édification, ses dédicaces sem-blant postérieures à la mort de Livie. Il faudrait se demander aussi si la constructiondu Sébasteion avait commencé antérieurement ou postérieurement au grave séismede 17 apr. J.-C.
Si elle est postérieure, comme c’est le cas pour l’aile Nord de l’agora Sud ou « Portiquede Tibère », les deux monuments pourraient avoir fait partie d’un grandiose programme éver-gétique du clan des Diogénès, Ménandros et Eusébès.
38 Nathalie de Chaisemartin
22. J. M. Reynolds, The Origins and Beginning ofImperial Cult at Aphrodisias (Proceedings of the CambridgePhilological Society, 206), 1980, p. 70-84, pl. 1 . 11 ; NewEvidence for the Imperial Cult in Julio-Claudian Aphrodi-sias, ZPE, 43, 1981, p. 317-327 ; The Inscriptions, dansAphrodisias de Carie, op. cit., p. 83 ; Further Information onImperial Cult at Aphrodisias, Studi Class., 24, 1986, 111-122 ; R. R. R. Smith, The Imperial Reliefs from the Sebas-teion at Aphrodisias, JRS, 77, 1987, 90.
23. K. T. Erim, op. cit., p. 112 et fig.
24. J. M. Reynolds, The Dedication of a Bath Buildingat Carian Aphrodisias, Studia in honorem Georgii Mihailov,Institute of Thracology, Sofia University / St. KlimentOhrdiski University Press, 1994, p. 397-402.
25. Notons que l’ouvrage de Webster-Green-Seeberg,op. cit., 1995, p. 394, 5 DS 1, le classe dans la période 5,c’est-à-dire postérieurement à 50 apr. J.-C.
RECONSTITUTION DE LA FRISE ARCHITRAVÉE IONIQUE
La frise architravée suit l’articulation de la structure entre les avancées extrêmes et lesblocs en ligne de la colonnade Est (fig. 13, en haut), avec deux séries de trois blocs garnissantles aediculae : ceux de la face antérieure sont en forme de T, les blocs en retour s’encastrent enpointe entre deux des blocs trapézoïdaux de la frise architravée orientale. Sur les 11 blocsd’origine, seul le bloc PS I26 n’a pas été retrouvé. Il formait le retour gauche d’un des balda-quins, comme le bloc PS E. La mauvaise conservation des angles postérieurs de celui-ci nepermet pas de lui attribuer un emplacement certain, ce qui fait que les deux blocs sont àl’heure actuelle interchangeables, en attendant que des fouilles ultérieures rendent au jour lebloc PS I. Plusieurs sont fragmentés (PS A, B, I, J, K), restaurés pour certains, et la plupartsont conservés dans le passage entre la maison de fouilles et la place du musée de site, sauf lebloc PS F central posé sur le socle du baldaquin Sud (fig. 1).
Les points de chute ayant été notés lors de la fouille, il est aisé de restituer à partir durelevé schématique des lits d’attente – reconstitués pour les blocs fragmentés – la séquence desblocs (fig. 3). L’avancée PS K (fig. 12) est située au Nord et l’avancée PS A (fig. 3) au Sud, enraison de la forme de leur terminaison postérieure déterminant au Sud l’angle de la frise archi-travée orientale, et venant s’encastrer au Nord entre le dernier bloc de celle-ci et le premier dumur terminal du pseudo-portique Nord. Les blocs de façade des aediculae sont les blocs PS H(fig. 10) au Nord et PS D (fig. 6) au Sud, caractérisés par leurs angles antérieurs ornés d’aiglescorniers. Les blocs en retour, dont trois seulement sont conservés – PS C (fig. 9), PS E(fig. 10), PS G (fig. 9) –, formaient deux paires symétriques. Leur point de chute et la disposi-tion de leurs trous de scellement permettent de les disposer perpendiculairement aux précé-dents, leur pointe postérieure s’engageant entre les éléments de la frise architravée continueorientale.
TECHNIQUE ET TRAITEMENT DE LA FRISE ARCHITRAVÉE
La frise architravée comprend, de bas en haut, trois fasces de largeur décroissante, bor-dées d’une sobre ciselure. Le corps de moulures qui fait la transition entre l’architrave et lafrise comporte un mince quart-de-rond et un ovolo surmonté d’une gorge à bord inférieur vifqui se termine par un listel.
La frise ionique à masques scéniques du propylon du Sébasteion d’Aphrodisias 39
26. La mention PS « propylon » du Sébasteion précèdele numéro d’ordre du bloc dans la restitution, indiqué parune lettre du Sud au Nord. Par commodité, nous avons
numéroté les masques de dr. à g., dans le même sens, à lasuite de la lettre désignant le bloc, en précisant l’orientationdes faces pour les avancées A et K.
Au-dessus, la frise en retrait forme à sa partie supérieure un congé terminé par un listelétroit et un ovolo terminal, large et fortement galbé. La sobriété de ces moulures encadre entreleurs lignes horizontales les masques en haut-relief qui paraissent posés au-dessus du corps demoulures intermédiaire et non suspendus à la face verticale du bandeau de frise. Ce mode deprésentation s’apparente à celui des masques figurés dans certains décors scéniques ou archi-tecturaux de la peinture pompéienne, où ils semblent posés au hasard dans le décor après lareprésentation scénique. La barbe des masques de Dionysos sur le bloc PS A1 et celle duSilène sur le bloc PS B2 (fig. 4) descendent sur le listel, le masque comique (Lykomedeios) dubloc PS A3 (fig. 3) est posé de guingois. La calotte crânienne des masques dépasse l’aplombde la moulure supérieure pour accentuer cette impression de réalisme, et certains éléments dela coiffure empiètent sur le corps de moulures supérieur. Le menton plat prolongé parl’horizontale des maxillaires souligne aussi leur caractère artificiel, contrairement au traitementstatuaire des masques et des têtes de personnages scéniques de la frise du « Portique deTibère » voisin dont le visage est ovalisé.
Les masques sont traités avec autant de soin que les faces visibles tout entières des blocs.Les fasces d’architrave sont traitées à la gradine fine et polies, tandis que les fonds de la friserestent au stade du ravalement à la gradine, pour faire ressortir les masques dont le visageest finement poli. Le trépan est largement employé pour évider les pupilles et les bouches auxformes et aux ouvertures très variées. Les mèches sont séparées par des canaux de trépanirréguliers et soigneusement ravalés, et les fortes courbes des bourrelets sourciliers sont accen-tuées au trépan. Un soin particulier est donné au modelé des chairs sur le front et les joues desmasques, qui devaient pourtant être vus d’assez loin.
L’ensemble du travail, d’une réelle qualité documentaire et expressive, semble homo-gène et sans grande différence de finitions entre les blocs plus ou moins en vue. Il semble avoirété exécuté par un même atelier d’artisans comprenant un maître d’œuvre et des aides qui exé-cutent avec moins de brio les motifs plus faciles de visages jeunes et sérieux : satyres, Orien-taux, personnages dionysiaques.
Il faut peut-être aussi mettre en rapport avec la frise du propylon du Sébasteion un blocde frise à masques sans architrave trouvé hors contexte (fig. 22) et dont le mode d’exécutionet le style des masques est assez voisin. Il comporte une moulure supérieure à ovolo et deuxmasques : celui de gauche figure un jeune premier tragique avec un onchos aux anglaises cala-mistrées ; celui de droite, une nourrice de tragédie portant la coiffe courte caractéristique. Lesproportions du bloc et des masques sont analogues à celles de la frise du propylon, malgré unécart plus grand de ces derniers. Peut-être la frise à masques se prolongeait-elle sur le mur enretour Ouest du portique Nord, mais il pourrait s’agir aussi de l’unique élément survivantd’une autre frise de même modèle.
40 Nathalie de Chaisemartin
CATALOGUE DES BLOCS DE LA FRISE ARCHITRAVÉE IONIQUEÀ AIGLES ET MASQUES SCÉNIQUES
La fouille du propylon ayant été menée du Sud au Nord, l’ordre des blocs a été enregistrédans ce sens, mais nous avons préféré numéroter les masques de gauche à droite. Les masquesdes blocs d’avancées des extrémités PS A et PS K sont décrits en partant de la face Nord27.
La bibliographie concernant l’ensemble de la frise étant donnée dans la note 2,n’apparaîtront dans les fiches que les références concernant particulièrement le bloc ou un desmasques qu’il porte.
PS A – BLOC DE L’AVANCÉE SUD (fig. 3 a-d)
Prov. : Ouest du Sébasteion, fouilles K. T. Erim, 1981, nos 81-121 et 122, 83-103.Loc. : Angle Sud-Est de la place du musée d’Aphrodisias, à l’Est du Sébasteion.Bibl. : N. de Chaisemartin, Le retour des Troyens : l’exemple d’Aphrodisias, dans
V. Fromentin, S. Gotteland éd., Origines gentium, Ausonius, Études, 7, Paris-Bordeaux, 2001,p. 200, fig. 7 (tête d’Oriental).
Photo : Aphrodisias Archive, fragment Ouest face Nord : nég. no 1982.30.2 ; fragmentOuest, face Sud : nég. no 1982.30.7. NC28 82-2-32/33 ; 82-6-32a ; 83-7-23.
Cons. : En trois morceaux. Chanfrein et masques endommagés, aigles des angles anté-rieurs et masque de la face Ouest détruits. Troisième masque de la face Sud bûché.
Dim. : Bloc, L. max. 1,90 m, l. max. 0,60 m, H. max. 0,67 m.Masques, H. 0,22 m, l. 0,16 m. Entraxe : entre 0,43 m et 0,50 m.Mat. : Marbre blanc d’Aphrodisias.Tech. : Architrave à fasces polies et ciselures. Ciseau grain d’orge sur le fond de la frise.
Pupilles et détails des chevelures au trépan.Desc. : Bloc de frise architravée ionique en avancée, décorée sur trois côtés de masques
et d’aigles corniers aux angles antérieurs du bloc. Soffitte à cartouche à la face inférieure.Face Nord : 1 - Jeune Oriental aux boucles longues, coiffé d’un bonnet phrygien
(Pâris ?). 2 - Tête à barbe calamistrée et bandeaux retroussés au-dessus d’un ruban frontal :type d’hermès de Dionysos Pogôn. 3 - Gorgone à chevelure longue, ailes sur le crâne et ser-pents noués sous le menton.
La frise ionique à masques scéniques du propylon du Sébasteion d’Aphrodisias 41
27. Abréviations : Prov. = provenance, Loc. = lieu deconservation, Bibl. = bibliographie, Photo = archives pho-tographiques, Cons. = état de conservation, Dim. = dimen-sions, Mat. = matériau, Tech. = données techniques,Desc. = Description, FA = face antérieure, FLG = face la-
térale g., FLD = face latérale dr., FS = face sup., FP = facepost., FI = face inf.
28. NC indique les photographies de l’auteur, numéro-tées par leur millésime suivi du numéro de pellicule et decelui du cliché.
42 Nathalie de Chaisemartin
a. Bloc PS A face Sud, partie antérieure avec aigle d’angle,Lykomedeios et masque tragique.
b. Partie postérieureavec masque bûché.
c. Bloc PS A face Nord,partie médiane : Oriental / Troyen.
d. Bloc PS A face Nord, partie antérieure :Hermès, Gorgone.
3. Bloc PS A1 et A2.
Face Ouest : 1 - Masque non identifiable.Face Sud : 5 - Lykomedeios. 6 - Masque tragique, visage joufflu et comme gonflé, onchos
aux minces boucles calamistrées : pourrait évoquer le second crasseux (deuteros pinaros).7 . Masque non identifiable.
PS B – BLOC DE FOND DU RENTRANT SUD (fig. 4)
4. Bloc PS B 1 et 2.
Prov. : Ouest du Sébasteion, fouilles K. T. Erim, 1981, nos 81-160 et 162.Loc. : Angle Sud-Est de la place du musée d’Aphrodisias.Photo : Aphrodisias Archive, partie g. : nég. no 1981.52.18 ; partie dr. : nég.
no 1981.32.5. NC 82-2-34 ; 82-5-0/1 ; 82-6-0a.Cons. : En deux morceaux. Épaufrures sur le chanfrein et les parties saillantes des
masques (coiffures).Dim. : Bloc, L. max. 2,72 m, l. max. 0,60 m, H. max. 0,64 m. L. frise 2,69 m. Masques,
H. 0,23 m. Entraxe : 0,45 à 0,47 m.Mat. : Marbre blanc d’Aphrodisias.Tech. : Architrave à fasces polies et ciselures. Fond de la frise au ciseau grain d’orge,
détails des masques au trépan. Encoches de scellement sur les faces latérales.Desc. : Bloc de frise architravée trapézoïdal, la face postérieure à deux fasces
d’architrave, porte sur le bandeau de frise le début de la dédicace continue : E£sebQ(V).La frise antérieure est ornée de 5 masques : 1 - Masque comique d’un homme d’âge
moyen, les sourcils froncés symétriques, les yeux louches, la bouche en porte-voix, la stéphanétraversant le front – on peut penser à l’esclave frisé therapôn oulos – ; 2 - Jeune femme à l’ex-pression triste ; bandeaux ondulés cernant le visage, le crâne semble pris dans un bonnet – seraitla femme pâle aux cheveux tombants (katakomos ochra) – ; 3 - Jeune satyre sérieux (oreilleshumaines) ; 4 - Jeune premier comique à l’expression calme, coiffé d’une stéphané en rouleaurégulier : Mélas néaniskos ; 5 - Silène camus (Simos) aux oreilles pointues, couronné de lierre.
La frise ionique à masques scéniques du propylon du Sébasteion d’Aphrodisias 43
a. Partie gauche : Thérapôn oulos,katakômos ochra, satyre rieur.
b. Partie droite :Mélas néaniskos, silène couronné.
PS C – BLOC LATÉRAL SUD DU BALDAQUIN MÉRIDIONAL (fig. 5)
Prov. : Ouest du Sébasteion, fouilles K. T. Erim, 1981, no 81-158.Loc. : Angle Sud-Est de la place du musée d’Aphrodisias.Phot. : Aphrodisias Archive : nég. no 1981.32.4 ; NC 82-6-2a.Cons. : Extrémité droite manquante, moulures endommagées.Dim. : Bloc, L. max. 1,40 m, l. max. (FA) 0,55 m, H. max. 0,64 m. Masques,
H. de 0,19 à 0,21 m.Mat. : Marbre blanc d’Aphrodisias.Tech. : Face postérieure sommairement traitée. Architrave semi-polie, avec ciselures au
bord des fasces, fond de la frise au ciseau grain d’orge, masques polis avec détails au trépan(globes oculaires).
Desc. : Bloc de frise architravée du côté Sud du baldaquin méridional. Frise portant3 masques :
1 - Masque féminin à l’expression vivace, bouche fermée. Les boucles longues sont coif-fées d’un foulard noué en marmotte : courtisane au foulard (Diamitros hetaira).
2 - Papposilène de type socratique, chauve, les sourcils très incurvés (masque à deuxprofils), les oreilles pointues et la barbe longue, couronné de branches de lierre.
3 - Jeune Pan à l’expression sardonique, bourrelet sourcilier très accentué, oreilles ani-males et cornes caprines dressées au centre du front, entre les mèches en brosse.
PS D – BLOC ANTÉRIEUR DU BALDAQUIN MÉRIDIONAL (fig. 6)
Prov. : Ouest du Sébasteion, fouilles K. T. Erim, 1982, no 82-120.Loc. : Angle Sud-Est de la place du musée d’Aphrodisias.Phot. : Aphrodisias Archive, nég. no 1982.2 .10 ; NC 82-2-31a.
44 Nathalie de Chaisemartin
5. Bloc PS C : Diamitros hetaira,papposilène, Pan sardonique.
Cons. : Complet, angle supérieur droit et aigles corniers détruits, épaufrures sur lesmasques.
Dim. : Bloc, L. max. 2,75 m, l. max. 0,63 m, H. max. 0,67 m. Masque 1, H. 0,22 m.Visage, 0,15 × 0,15 m. Entraxe des masques : 0,47 m.
Mat. : Marbre blanc d’Aphrodisias.Tech. : Face postérieure à bandeau d’architrave plat et moulures ébauchées. Décor
d’angle avec aigles aux angles du bloc. Face antérieure : moulures et fond de la frise poliscomme les motifs. Cernure au trépan autour du visage du masque 4.
Desc. : Inscription sur les deux fasces supérieures de l’architrave :BAfrodBthi qeobV SebastobV t²i DPmwi tq prppulon kaa t1V
Cn a£tÅ tim1VFrise à aigles d’angle et 5 masques, de g. à dr. :1 - Visage juvénile couronné d’une mitra et de feuilles et corymbes de lierre : Ariane ou
ménade.2 - Masque féminin, sourcils dissymétriques indiquant un masque comique à double
expression. La stéphané entourant le front de mèches ondulées striées en esses se prolonge parde larges ondulations descendant jusqu’au bord de la moulure. Le crâne est enserré d’un mou-choir d’où s’échappe un toupet en éventail. Le masque pourrait être celui d’un des types defausse vierge (pseudokoré) de la comédie ancienne.
3 - Jeune satyre à l’expression sérieuse, petites cornes et mèches en éventail.4 - Masque d’adolescent tragique, l’onchos de fines anglaises ondulées descend au ras des
sourcils très inclinés et forme deux étages de boucles sur les côtés du visage. Il pourrait être lejeune homme frisé (oulos néaniskos) ou le semi-frisé (paroulos).
5 - Jeune satyre à l’expression triste : rides frontales et bourrelet sourcilier accentué.Menton en galoche, glandes devant les oreilles, mèches en éventail entre les cornes.
Traces des serres et du bout des ailes des aigles corniers.
La frise ionique à masques scéniques du propylon du Sébasteion d’Aphrodisias 45
6. Bloc PS D : Dionysos, seconde pseudokoré, satyre sérieux, oulos néaniskos tragique, satyre triste.
PS E – BLOC LATÉRAL NORD DU BALDAQUIN MÉRIDIONAL (fig. 7)
Prov. : Fouilles K. T. Erim, 1981, extrémité Ouest du Sébasteion, no 81-157.Loc. : Angle Sud-Est de la place du musée d’Aphrodisias.Photo : NC 82-2-35a ; 82-6-3a.Cons. : Bloc endommagé au centre et aux angles, chanfrein détruit, masques épaufrés.Dim. : Bloc, L. max. 1,50 m, l. max. 0,53 m, H. max. 0,53 m. Masques, H. 0,22 m.Mat. : Marbre blanc d’Aphrodisias.Tech. : Architrave à fasces bordées de ciselures, moulure médiane en doucine, frise à fond
poli. Face postérieure portant 2 bandeaux séparés par une moulure simplifiée. L’épaisseur desmasques n’excède pas celle du chanfrein supérieur. Globes oculaires évidés au trépan.
Desc. : Frise architravée à 3 masques, de gauche à droite :1 - Masque de jeune homme tragique à l’expression calme, l’œil g. et la bouche du
même côté descendent légèrement. L’onchos est garni de boucles calamistrées encadrant levisage. Pourrait être l’hapalos néaniskos ou jeune homme délicat.
2 - Masque comique à stéphané, grands yeux écarquillés, bouche en porte-voix et men-ton saillant. Oreille droite percée. Correspondrait au Sphénopogôn de Pollux.
3 - Masque juvénile au visage massif, les sourcils froncés et l’expression animée. Coiffurede mèches souples en désordre sur le front : Mélas néaniskos comique.
PS F – BLOC DU RENTRANT CENTRAL (fig. 8)
Prov. : Extrémité Ouest du Sébasteion, fouilles K. T. Erim, 1981, no 81-173.Loc. : Angle Sud-Est de la place du musée d’Aphrodisias.Bibl. : K. T. Erim, Aphrodisias, 1986, p. 110-111 ; U. Outschar, loc. cit., p. 121, fig. 11.
46 Nathalie de Chaisemartin
7. Bloc PS E :hapalos néaniskos tragique,sphénopogôn, ochrosnéaniskos (?).
Photo : Aphrodisias Archive : nég. no 1981.22.9 ; NC 82-4-21a.Cons. : Intégrale.Dim. : Bloc, L. max. 3,19 m, l. max. (FS) 0,58 m, H. max. 0,67 m. Frise (FA),
L. 2,53 m. Entraxe des masques : 0,46 m en moyenne.Masques, H. 0,24 m, l. 0,18 m.Mat. : Marbre blanc d’Aphrodisias.Tech. : Face postérieure avec section d’inscription sur la frise et la première fasce
d’architrave. Traces d’inscription martelée sur les 2e et 3e fasces. Faces latérales du bloc enbiseau. Face antérieure, fasces d’architrave et frise polis.
Desc. : Bloc de frise architravée à face postérieure inscrite[t]obV stop t²i DPmwi stop tq prppulon(M@na)ndroV od Men0ndrou to¢ E£nBkou|Frise à 5 masques, de g. à d. :1 - Masque féminin à l’expression sérieuse, mitra frontale et couronne de lierre : Ariane
ou Ménade.2 - Masque de femme mûre au visage plein, la bouche largement ouverte, coiffée de ban-
deaux remontants vers un nœud de ruban en haut du crâne. Des mèches ondulées encadrentles joues. La coiffure à nœud sommital rappelle celle de la première pseudo-vierge (pseudokoré)de la comédie ancienne, mais le visage et ses pommettes bien marquées peuvent être attribuésà l’une ou l’autre des « bavardes » (lektiké).
3 - Papposilène chauve et barbu, à l’expression sardonique, couronné de lierre.4 - Masque à deux profils de serviteur comique, les sourcils incurvés dissymétriques, le
nez camus, la bouche en porte-voix, coiffé d’une speira striée : Hégémôn thérapôn.5 - Héraklès imberbe, coiffé de la léonté, avec une expression de colère rentrée.
La frise ionique à masques scéniques du propylon du Sébasteion d’Aphrodisias 47
8. Bloc PS F : Ménade, lektiké, papposilène couronné, hégemôn thérapôn, Héraclès.
PS G – BLOC LATÉRAL SUD DU BALDAQUIN SEPTENTRIONAL (fig. 9)
Prov. : Extrémité Ouest du Sébasteion, fouilles K. T. Erim, 1981, no 81-172.Loc. : Angle Sud-Est de la place du musée d’Aphrodisias.Photo : Aphrodisias Archive, nég. no 1982.30.9 ; NC 82-5-3.Cons. : Angle supérieur gauche et chanfrein endommagés.Dim. : Bloc, L. max. 1,60 m, l. max. 0,60 m, H. max. 0,62 m. Têtes, H. 0,21 m,
l. 0,16 m.Mat. : Marbre blanc d’Aphrodisias.Tech. : Fasces d’architrave à feuillure et gradine. Corps de moulure, ovolo supérieur et
fond de la frise polis. Masques polis, détails au trépan.Desc. : Frise architravée. Trois masques semblent reposer sur le corps médian de
moulures :1 - Jeune femme au visage régulier, fossette au menton, cheveux en bandeaux étagés
noués au-dessus du front – peut-être la concubine (pallaké) de la Comédie nouvelle.2 - Masque tragique de jeune homme aux sourcils froncés, à l’expression tendue. Onchos
de mèches bouclées courtes sur les côtés : mélas néaniskos.3 - Masque probablement tragique de jeune femme au visage sévère, coiffée de mèches
coupées en deux rangs : jeune fille aux cheveux coupés – en signe de deuil – de Pollux, peut-être Électre.
48 Nathalie de Chaisemartin
9. Bloc PS G : Pallaké, panchrestos tragique, kourimos (héroïne en deuil) ;Courtoisie M. A. Dugesi, Aphrodisias Excavations, New York University.
PS H – BLOC ANTÉRIEUR DU BALDAQUIN SEPTENTRIONAL (fig. 10)
Prov. : Extrémité Ouest du Sébasteion, fouilles K. T. Erim, 1981, nos 81-129 et 152.Loc. : Angle Sud-Est de la place du musée d’Aphrodisias.Bibl. : U. Outschar, loc. cit.Photo : Aphrodisias Archive, nég. no 1982.31.12 ; NC 82-6-4a.Cons. : En deux morceaux. Les angles, les moulures et les fasces inférieures d’architrave
sont endommagés ainsi que les masques et les aigles d’angle.Dim. : Bloc, L. max. 2,38 m, l. max. 0,56 m, H. max. 0,67 m. Masques, H. 0,23 m.Mat. : Marbre blanc d’Aphrodisias.Tech. : Face postérieure à bandeaux lisses et moulure sommaire. Face antérieure avec
inscription gravée sur l’architrave semi-polie. Frise à fond et motifs polis, détails au trépan :yeux, bouches, cernure au bas de l’ovale des masques.
Desc. : L’architrave porte inscrite sur ses deux fasces supérieures la dernière partie de ladédicace
[E£s]ebQV filppatriV kaa M@nandroV[od Men]0ndrou to¢ E£nBkou k[aa BApfBaV Men0]ndrou.La frise surmontée d’un ovolo porte à l’angle dr. les restes de l’aile d’un aigle cornier et
cinq masques de gauche à droite :1 - Dionysos à couronne de corymbes et de feuilles de lierre, visage plein, mèches laté-
rales pendantes.2 - Masque tragique à bouche en porte-voix et onchos à boucles calamistrées encadrant le
visage.3 - Jeune satyre sérieux aux oreilles caprines, couronné de pin.
La frise ionique à masques scéniques du propylon du Sébasteion d’Aphrodisias 49
10. Bloc PS H : Aigles d’angle, Dionysos, pinaros tragique, satyre sérieux couronné,koré tragique, satyre rieur couronné de pin.
4 - Masque de femme jeune, aux sourcils obliques, les yeux très grands, la bouche enporte-voix. Les cheveux ondulent librement en bordure du front et forment de longuesboucles latérales. Pourrait être la koré tragique.
5 - Satyre souriant, aux pommettes saillantes, couronné de corymbes et de feuilles delierre.
PS J – BLOC DE FOND DU RENTRANT NORD (fig. 11)
Prov. : Extrémité Ouest du Sébasteion, fouilles K. T. Erim, 1981, nos 81-159 et 161, etW. PRO 1-82-10.
Loc. : Angle Sud-Est de la place du musée d’Aphrodisias.Bibl. : U. Outschar, loc. cit.Photo : Aphrodisias Archive, nég. no 1981.52.20 (partie dr.) ; NC 85-6-34 (partie g.),
82-2-35a (partie dr.) ; 82-6-1a ; 82-5-2.Cons. : En trois morceaux, dont deux raccordés. Architrave endommagée au bord infé-
rieur. Deux masques de la partie gauche détruits.Dim. : Bloc, L. max. 3,10 m, l. max. 0,57m, H. max. 0,57 m. Frise, L. 2,57 m.Mat. : Marbre blanc d’Aphrodisias.Tech. : Face postérieure moulurée et inscrite. Moulure et fond de la frise à la face anté-
rieure polis, détails des masques au trépan.Description : La face postérieure de l’architrave porte à sa fasce supérieure la fin d’une
dédicaceg[un]Q E£sebo¢V.Frise à cinq masques, les deux premiers ne sont pas identifiables :3 - Masque au visage triste, yeux obliques, nez fin, front barré d’un pli. Chevelure désor-
donnée aux longues mèches rejetées en arrière à partir du milieu du front : pourrait être lemasque de l’épiseistos deutéros comique, le fanfaron qui secoue sa chevelure.
4 - Satyre joufflu riant, aux oreilles caprines.5 - Masque de barbon comique au crâne chauve et à la barbe calamistrée. Visage à deux
expressions, avec les yeux dissymétriques, le nez camus, la bouche aux dents apparentes : onpeut hésiter entre le pornoboskos et l’hermônios prôtos.
50 Nathalie de Chaisemartin
11. Bloc PS J, partie Sud :Deutéros épiseistos,satyre joufflu rieur, Hermônios.
PS K – BLOC DE L’AVANCÉE NORD (fig. 12)
Prov. : Extrémité Nord-Ouest du Sébasteion, fouilles K. T. Erim, 7 septembre 1983.Loc. : Angle Sud-Est de la place du musée d’Aphrodisias.Bibl. : U. Outschar, loc. cit.Photo : NC 83-8-25a/26a.
Cons. : L’extrémité Ouest et la face Sud ont perdu leurs aigles d’angle et leurs masques.Chanfrein endommagé.
Dim. : Bloc, L. max. 1,90 m, l. max. 0,58 m, H. max. 0,62 m. Masque 1, H. 0,25 m ;masque 3, H. 0,18 m.
Mat. : Marbre blanc d’Aphrodisias.Tech. : Bloc taillé en biseau aux angles postérieurs. Soffite à cartouche à la face infé-
rieure. Architrave à fasces bordées de ciselures, fond de la frise au ciseau grain d’orge, motifspolis. Détails au trépan : yeux, bouches, mèches de cheveux.
Desc. : Bloc d’avancée à 3 faces décorées, avec un masque probablement tragique enca-dré de deux aigles corniers à l’extrémité et trois masques sur chaque face latérale.
Face Nord :1 - Masque à bouche en porte-voix, yeux obliques, onchos à boucles calamistrées enca-
drant le visage plein. Pourrait être le masque tragique de l’un des deux « crasseux » (pinaros)ou de leur correspondant comique, le campagnard (agroikos).
2 - Marsyas au front couronné de longues mèches flottantes. Nez camus, barbe enéventail.
3 - Masque enfantin aux yeux obliques. La bouche est en porte-voix, les cheveuxforment des bouclettes sur le front et des mèches ondulées encadrant le visage rond : on peutpenser à la petite servante comique aux cheveux courts (habra perikouros), ou au très jeunepremier comique, l’hapalos néaniskos.
La frise ionique à masques scéniques du propylon du Sébasteion d’Aphrodisias 51
12. Bloc PS K, face Nord :Agroikos, Marsyas,Hapalos neaniskosou habra perikouros
52 Nathalie de Chaisemartin
13.P
ropo
sitio
nde
rest
itutio
nde
lafr
ise
dupr
opyl
ondu
Séb
aste
ion
:ide
ntifi
catio
nde
sm
asqu
essc
éniq
ues.
La frise ionique à masques scéniques du propylon du Sébasteion d’Aphrodisias 53
Catégorie Type de masques No frise No Pollux
Masquestragiques
Oriental A1Gorgone A3 2 .10Crasseux (Pinaros) A6 H2 11Femme pâle aux longs cheveux Katakomos ochra B2 23J. homme frisé (oulos) D4 8J. homme délicat (hapalos neaniskos) E1 10J. homme pâle (ochros neaniskos) ? E3 13-14Héraklès F5Jeune fille aux cheveux coupés G3 26-27Panchrestos ? tragique G2 7Koré tragique ? H4 28Second pinaros tragique ? ou campagnard comique ? K1 T 12
C 14
Masquescomiques
Panchrestos G2 10Mélas néaniskos B2 11Lykomedeios A5 7Sphénopogôn E2 6Hermônios prôtos J5 5Hégemôn thérapôn F4 22Oulos thérapôn B1 24Épiseistos deutéros J3 16Diamitros Hétaira C1 41Pseudokoré 2 D2 35Pallaké G1 37Lektiké F2 31
Masquessatyriques
Dionysos jeune couronné H1 D1Dionysos Pogôn A2Ménade / Ariane F5Satyre rieur couronné de lierre H5Pan sardonique C3Satyre jeune rieur B3Satyre jeune triste D5Satyre jeune sérieux D3Satyre joufflu rieur J4Satyre joufflu couronné H5Papposilène C2Papposilène couronné F3Silène couronné B5Marsyas K2
14. Tableau typologique des masques scéniques de la frise du propylon du Sébasteion.
TYPOLOGIE DES MASQUES DE LA FRISE
Il faut préalablement mettre à part la tête PS A2 qui reprend un modèle d’hermès figu-rant un Dionysos Pogôn de style archaïsant, que l’on peut comparer au masque de Dionysoscachant ses cornes sous un foulard du Vase Lante29. Les 39 autres masques conservés sur les51 d’origine reproduisent des masques scéniques que l’on peut tenter d’identifier en repartantdu catalogue de Julius Pollux30 et des propositions faites dans les travaux successifs deT. B. L. Webster et de son équipe, ainsi que par L. Bernabò Brea. Un schéma de la suite desblocs (fig. 13) et un tableau typologique (fig. 14) donnent l’identification des masques quenous proposons par hypothèse. Par rapport à la frise du « Portique de Tibère » d’Aphrodisias,où les vrais masques sont peu nombreux et les personnages scéniques souvent « contaminés »par des modèles de têtes masculines et féminines provenant de la sculpture classique, on noteun parti pris de précision dans le rendu des masques, leur expression, leurs déformationscaractéristiques et leurs attributs distinctifs, qui rend cet ensemble de masques précieux pourl’étude de la permanence de la tradition théâtrale grecque à l’époque julio-claudienne.
Les masques de la frise du propylon comprennent 15 masques liés au drame satyrique,12 masques tragiques dont 8 clairement identifiés et 12 masques comiques bien reconnais-sables ; mais 4 masques restent d’identification hypothétique ou peuvent être interprétéscomme masques comiques ou tragiques. Il est vraisemblable qu’à l’origine la proportion devaitêtre à peu près égale entre les genres du théâtre classique grec. En revanche, on peut soulignerque, si les personnages comiques sont bien différenciés et fidèles dans l’ensemble aux indica-tions données par Pollux, si les personnages du drame satyrique, comprenant une importantesérie de jeunes Satyres, présentent des caractères physiognomoniques variés et précis, les per-sonnages tragiques signalés par leur coiffure à onchos présentent un aspect plus générique,comme sur certaines plaques Campana ou certaines antéfixes du Nord de l’Italie31.
Un article de J. Jory32 a présenté récemment une répartition différente de ces masques,qui les classe selon qu’ils ont « closed or only partially open mouths ». L’ouverture des bouchespermettrait selon l’auteur de distinguer les masques de pantomime de ceux du théâtre parlé.Pour lui, 19 des masques du propylon sont des masques du théâtre parlé et 15 des masques depantomime. Ces masques aux bouches fermées comprennent surtout des personnages du
54 Nathalie de Chaisemartin
29. E. Angelicoussis, The Woburn Abbey Collection ofClassical Art (CSIR, Great Britain, III,3 = Monumenta ArtisRomanae, XX), Mayence / Rhin, 1992, p. 103, fig. 376-377.
30. Julius Pollux, Onomasticon, éd. E. Bethe, PollucisOnomasticon, Lexicographi graeci, IX, Berlin, 1900, L. IV,§ 133-154, p. 241-246 (désormais cité : Pollux, éd. Bethe,1900) ; L. Bernabò Brea, op. cit., traduction de Pollux pourles masques de comédie : p. 143, 154, 196, 208 ; Y. Souka-ras, R. Loisy, Catalogue des masques de théâtre d’après Ju-lius Pollux, dans Ch. Landes éd., Le goût du théâtre à Rome
et en Gaule romaine, cat. expo., Lattes, 1989, p. 103-108 ;P. Ciancio Rossetto, Le maschere del teatro di Marcello,Bull. Com. Arch. Roma, LXXXVIII, 1982-1983, p. 42-43et n. 116.
31. M. T. Strazzulla, Le terrecotte architettoniche della Ve-netia (Studia Archeologica, 44), Rome, 1987, p. 280 sq.,pl. IV-V, type IX par ex.
32. J. Jory, Some Cases of Mistaken Identity ? Panto-mime Masks and their Context, Bull. Inst. Cl. St., 45,2001, p. 12-13.
thiase ainsi qu’Attis (portant le bonnet phrygien) et Héraclès, personnages caractéristiques durépertoire de ces pantomimes. Toutefois, ces masques ne portent pas, sur la frise du propylonaphrodisien, les hautes coiffures proches des onchoi tragiques qui caractérisent les quelquesexemples de masques de pantomime présentés en comparaison. On remarque du reste que lepersonnage comique de la diamitros hétaira (courtisane au foulard), reconnaissable à sa mar-motte nouée au sommet du front, a justement la bouche fermée sur le bloc PS C (fig. 5).
LES MASQUES TRAGIQUES
Masques tragiques masculins
Les masques masculins portant le haut onchos en ogive à boucles calamistrées tombantau bas des joues sont le PS A6, face Sud (fig. 3), PS D4 (fig. 6), PS E1 (fig. 7), PS H2(fig. 10) et PS K 1 (fig. 12).
Le masque PS A6 a une face large, un front saillant aux sourcils tombants et un nezencadré de plis de chair. Il pourrait correspondre au « crasseux » (pinaros) qui, selon Pollux,est « gonflé, livide, triste, le cheveu blond et sale »33.
Le PS D4 a des sourcils très en oblique, un visage carré à l’expression lamentable. Sesanglaises latérales sont divisées en deux séries superposées comme sur les masques de lamosaïque de seuil de la Maison du Faune à Pompéi et sur le masque 73 du relief du MuséeSaint-Raymond à Toulouse. L’expression et la coiffure correspondraient bien au « frisé »(oulos) du catalogue de Pollux34.
Le visage large du PS E1 a une expression sereine, des yeux très écarquillés et unebouche modérément ouverte, peut-être pour éviter un effet de répétition avec la tête PS E3voisine, à moins que l’hypothèse d’un masque de pantomime proposée par J. Jory ne lui soitapplicable. La division des boucles latérales en deux étages est très peu marquée. Sa majes-tueuse mélancolie évoque le jeune homme délicat (hapalos néaniskos) de tragédie, que Polluxcompare à un jeune dieu35.
Le masque PS H2 est très proche et pratiquement identique au PS A6 (pinaros), sauf depetites mèches descendant sur le front.
Le masque PS K1, à la face lunaire, écarquille ses yeux aux paupières très marquées(fig. 12). Il correspondrait au type du campagnard comique (agroikos), s’il ne portait pas unonchos à petites anglaises serrées et mèches latérales crêpelées qui évoque deux masquesdu Musée des Thermes36. Il s’agit probablement d’une contamination entre deux types demasques.
La frise ionique à masques scéniques du propylon du Sébasteion d’Aphrodisias 55
33. Soukaras-Loisy, loc. cit., p. 103, no 11.34. Ibid., p. 103, no 8.35. Ibid., p. 103, no 10.36. Provenant d’un « acquisto Simonetti » et parfois
considérés comme provenant de la Villa Hadriana. Datésdu IIIe siècle par M. Cima, dans A. Giuliano éd., Museo Na-zionale Romano, Le Sculture, I,2, Rome, 1979, p. 364, no IV,59, et R. Paris, ibid., I,1, 1981, p. 7, no 8.
Un des masques les mieux conservés, PS G2, figure un jeune homme aux sourcils fron-cés et à l’expression véhémente. Il est coiffé d’un onchos bas garni de boucles en S, mais sansmèches longues latérales. Un masque à suspendre de type voisin, mais dont l’expression tra-gique est plus accentuée, provient de Pompéi37, mais il est identifié comme celui d’unehéroïne. On retrouve aussi le même type sur la frise hellénistique provenant du théâtre de Dio-nysos à Athènes38. Deux masques fragmentaires provenant des arcatures du théâtre de Marcel-lus39 portent une coiffure frontale analogue plus courte et à deux rangs de mèches, mais leurexpression paisible ne permet guère de les classer parmi les masques tragiques. Ce jeune pre-mier reste donc difficile à classer : on peut y voir un panchrestos comique40, mais son voisinageavec le masque de jeune fille en deuil peut aussi faire penser à un couple tragique d’Oreste etÉlectre.
De même, il est difficile d’identifier le masque PS E3. Sa tête massive et son expressioncalme contrastent avec une chevelure en désordre : on peut penser au jeune homme pâle tra-gique (ochros), que Pollux décrit comme musclé et poilu, mais aussi au jeune homme frisé(oulos neaniskos) comique, dans une version sans stéphané.
On note aussi que, parmi les masques masculins tragiques du propylon, aucun ne faitpartie des vieillards ni des masques « privés des attributs de l’acteur ».
Il faut probablement mettre au nombre des masques tragiques celui d’Héraclès (PS F5)dont le visage dissymétrique a un profil gauche plus crispé (fig. 8). En général, les masques àdouble expression sont plutôt des masques comiques ou satyriques. Toutefois, L. BernabòBrea classe parmi les masques tragiques un Héraclès de Lipari41 assez comparable, sauf auniveau de la bouche largement ouverte, comme elle l’est du reste pour les deux variantes dumême modèle sur la frise du « Portique de Tibère ». Pour J. Jory42, ce serait évidemment unmasque de pantomime, en raison de sa bouche fermée.
On a du mal aussi à classer l’oriental au bonnet phrygien PS A7 (fig. 3) de l’avancéeSud : son visage érodé ne favorise pas les comparaisons et se rapproche des types d’Orientauxde la frise Nord du « Portique de Tibère », que nous avons mis au nombre des masques comi-ques en raison de leur expression peu marquée. Notons que J. Jory y voit des masques de pan-tomime figurant Attis43, alors que L. Bernabò Brea les identifie comme de jeunes hérostroyens, les mettant au nombre des masques tragiques44. Ennius aurait du reste emprunté aucycle troyen certains sujets de tragédie, et Pomponius Secundus écrit un Aeneas. À l’époqued’Auguste, les légendes troyennes étaient alléguées comme fondement de l’identité ancestrale
56 Nathalie de Chaisemartin
37. Musée de Naples, inv. 6613 ; M. Bieber, TheHistory of the Greek and Roman Theatre, Princeton, 1961,p. 157, fig. 567 ; T. B. L. Webster, Monuments Illustra-ting Tragedy and Satyr Play, 2e éd. (Bull. Inst. Cl. St.,suppl. 20), Londres, 1967, p. 92, no NS 5 (désormaiscité MSTP) ; E. J. Dwyer, Pompeian Oscilla Collec-tions, RM, 88, 1981, no 117, p. 282, pl. 118, fig. 2 aucentre.
38. O. Walter, Beschreibung der Reliefs in kleinen Akropo-lismuseum in Athen, Vienne, 1923, p. 209, no 412-412a ;Webster, MTSP, p. 37, no AS 18.
39. Ciancio Rossetto, loc. cit., p. 21-22, no 2-3, pl. X-XI-XIII, 2.
40. Bernabò Brea, op. cit., type du panchrestos 2, p. 158,fig. 244-245.
41. Ibid., p. 36, no A 6b, fig. 14-16.
42. Jory, loc. cit., p. 12-13.
43. Ibid., p. 13.
44. Bernabò Brea, op. cit., p. 39-40, nos A10, A11, A13,fig. 20-21-23 et pl. 4,3.
des Romains45, et particulièrement des Julii qui se disaient descendre du fils d’Énée. Mais ellesservaient aussi à légitimer l’autorité romaine sur l’Asie Mineure, et réciproquement aux citésde la région, comme Alexandria Troas et probablement Aphrodisias, qui place justement dansle propylon les figures d’Énée et d’Aphrodite, à revendiquer une suggeneia avec les Romains46.
Masques tragiques féminins
Le masque féminin PS B2 (fig. 4, partie g.), avec sa coiffure à ondulations symétriquesde part et d’autre d’une raie, semble pouvoir être identifié comme le masque féminin de lakatakomos ochra tragique, remarquable selon Pollux47 par sa pâleur et ses longs cheveuxdéfaits. Un masque conservé au musée de Cefalù pourrait lui être comparé48, avec cependantun front plus dégagé. Toutefois un modèle voisin est utilisé pour la fausse vierge de l’AncienneComédie49, avec un chignon ou queue de cheval en arrière des bandeaux50.
Le masque féminin PS G3 (fig. 9), aux traits sévères et à l’expression inquiète, porte unecoiffure aux mèches coupées court sur deux rangs autour du crâne. Il pourrait correspondre àl’un des deux masques nos 26 et 27 de Pollux51, représentant des héroïnes aux cheveux coupésen signe de deuil. Pollux précise que la deuxième porte « un cercle de boucles dont la quantitémanifeste son désespoir ». Le voisinage du masque masculin PS G2 pourrait faire penser à uncouple Oreste-Électre.
Le masque PS H4, mal conservé à la partie supérieure, a une expression triste (sourcilstombants) sur un visage juvénile. Les cheveux sont divisés en bandeaux, les mèches latéralesabondantes. On peut penser à l’une des jeunes filles tragiques, comme la jeune fille pâle ou latrès jeune fille52, mais cela peut être aussi un masque comique.
Quant à la Gorgone PS A5 (fig. 3), elle peut faire partie des masques tragiques,puisque Pollux la place dans cette catégorie parmi les « personnages démunis des attributshabituels de l’acteur »53. Certes, le masque de la Gorgone peut prendre une valeur apotro-païque et était utilisé à l’époque hellénistique aussi bien dans le décor domestique54 que danscelui des armes et des monuments funéraires55. C’est aussi un motif utilisé sur les antéfixes
La frise ionique à masques scéniques du propylon du Sébasteion d’Aphrodisias 57
45. Voir le texte éclairant de Virgile, Géorgiques, 2,v. 385-389, éd. H. Goelzer, Paris, Les Belles Lettres, 1926,p. 82.
46. N. de Chaisemartin, Afrodisia, Roma e i Troiani,dans Omaggio a M. Floriani-Squarciapino, Arch. Cl., 49,p. 29-46 ; Le retour des Troyens : l’exemple d’Aphrodisias,dans V. Fromentin et S. Gotteland éd., Origines gentium(Ausonius, Études, 7), Paris / Bordeaux, 2001, p. 187-206.
47. Pollux, éd. Bethe, 1900, IV, § 141, p. 243 ;Soukaras-Loisy, loc. cit, p. 104, no 28.
48. Musée de Cefalù, no 104 ; Bernabò Brea, op. cit.,p. 121, fig. 196-197 ; Bernabò Brea - Cavalier, op. cit.,p. 152, fig. 205.
49. T. B. L. Webster, J. R. Green, Monuments Illustra-ting Old and Middle Comedy, 3e éd. (Bull. Inst. Cl. St.,suppl. 39), 1978, p. 24, modèles X et XA.
50. Voir le masque d’Amisos au Louvre : S. Besques,Musée du Louvre, Catalogue raisonné des figurines et reliefs enterre cuite grecs, étrusques et romains, III, Paris, 1972, p. 87,no D 509, pl. III a.
51. Pollux, éd. Bethe, 1900, IV, § 140, p. 243 ;Soukaras-Loisy, loc. cit., p. 104, nos 26 et 27.
52. Ibid., p. 104, no 23 ou 28.53. Pollux, éd. Bethe, 1900, IV, § 142, p. 243 ;
Soukaras-Loisy, loc. cit., p. 104.54. Voir à Délos les Gorgones de stuc moulé et peint al-
ternant avec des têtes casquées (de Persée ?) qui formentune frise au haut des murs d’une pièce d’habitation :M. Bulard, Peintures murales et mosaïques de Délos,Mon. Piot, 1907-1908, p. 157, no 7.
55. Voir les décors d’une porte de monument funérairede Hadra (J. Mac Kenzie, The Architecture of Petra (BritishAcademy, Monographs in Archaeology, 1), Oxford, 1990,p. 68, pl. 197 b), le mascaron des clefs d’arc du tétrapyle
de terre-cuite56 et pour des masques décoratifs à suspendre comme l’exemplaire de Centuripeau Musée archéologique de Syracuse57, dont le visage se rapproche de représentationsd’Alexandre. Avec le « Portique de Tibère » et le propylon du Sébasteion, les sculpteurs aphro-disiens le font passer dans le décor de marbre de monuments publics, et il aura par la suiteun développement important dans le décor architectural en Asie Mineure.
LES MASQUES COMIQUES
Contrairement à l’interprétation très libre des personnages comiques sur la frise du« Portique de Tibère », les masques comiques du propylon du Sébasteion restent remarquable-ment fidèles aux modèles légués par la tradition théâtrale hellénique. Dans bien des cas, onretrouve les mêmes modèles parmi les masques des tombes de Lipari, datables du IIIe siècleav. J.-C., mais aussi parmi les masques classés par T. B. L. Webster dans ceux de l’AncienneComédie.
LES MASQUES DE JEUNES PREMIERS COMIQUES
Le masque PS B2 (fig. 4) correspond, avec sa stéphané de cheveux lissés en arrière, à ladescription du jeune premier brun de Pollux (mélas neaniskos)58, qui se distingue du panchrestospar ses sourcils non contractés et son air plutôt calme et intellectuel59. Le même modèle carac-térise deux têtes de terre cuite hellénistiques de Pergame60 et un masque du Louvre61 de prove-nance italienne aux yeux plus dissymétriques, identifié comme l’hapalos néaniskos (adolescentdélicat). Un relief décoratif (pinax) de Vienne62 montre les masques d’un père de comédie,d’une jeune première et de ce même jeune homme mélancolique.
Nous avons vu plus haut que le masque masculin PS E3 pourrait par élimination êtreidentifié comme un jeune premier frisé (oulos néaniskos), mais son expression ne cadre pasvraiment avec le signalement de Pollux. En revanche, les proportions du visage et la forme dela bouche s’accorderaient bien avec le caractère décidé des masques de Lipari représentant lepersonnage63.
Un masque masculin, PS J1 (fig. 11), présente une expression farouche : un pli barreson front et ses sourcils s’inclinent vers les tempes. La bouche entr’ouverte est cernée de plis,
58 Nathalie de Chaisemartin
du monument des Julii à Glanum : H. Rolland, Le mausoléede Glanum (Saint-Rémy-de-Provence) (Gallia, suppl. XXI),Paris, 1969, p. 30, pl. 16 et 61.
56. Strazzulla, op. cit., p. 250-251, type XIII, pl. VIII.57. G. Libertini, Centuripe, Catane, 1926, p. 63,
fig. 14.58. Pollux, éd. Bethe, 1900, IV, § 146, p. 244 ;
Soukaras-Loisy, loc. cit., p. 105, no 11.59. Webster-Green-Seeberg, op. cit., p. 17, no 11.60. E. Topperwein, Terrakotten von Pergamon (Pergame-
nische Forschungen, 3), Berlin, 1976, p. 123-124, fig. 518-519, pl. 75.
61. Webster, MNC2, p. 138, no IT 61 ; Besques, op. cit.,IV-1, Époques hellénistique et romaine, Italie méridionale - Si-cile - Sardaigne, Paris, 1986, p. 133, no E 350, pl. 132, D.
62. H. U. Cain, Chronologie, Ikonographie und Bedeu-tung der römischen Maskenreliefs, Bonner Jahrbücher, 188,1988, p. 153, no 50.
63. Bernabò Brea, op. cit., p. 169-176, fig. 266-272 etpl. XXVIII-XXIX.
ce qui lui conférerait plutôt une allure tragique. Les mèches très épaisses de sa chevelure sontrejetées en arrière et auréolent la tête en désordre, peut-être retenues par une couronne ou dia-dème très usé. Il faudrait probablement y voir une interprétation peu courante du type du sol-dat fanfaron, décrit par Pollux comme « le jeune homme qui secoue sa chevelure », ce qui cor-respondrait bien à la coiffure désordonnée du masque. Webster et son équipe y voient uneversion « new style » de l’épiseistos de la Comédie ancienne64. L’expression grandiloquente duvisage se retrouve sur certains des types d’épiseistos de masques en terre cuite, tels quel’exemplaire du British Museum C 749 ou celui de Copenhague65. Mais ceux-ci présententdes coiffures volumineuses plus proches des types d’Alexandre avec lesquels l’épiseistos tendaità s’identifier, comme c’est le cas du personnage aux mèches descendant sur le front reproduitplusieurs fois sur la frise du « Portique de Tibère ».
Sur le bloc K, un masque PS K3 au petit visage rond coiffé de bouclettes cochlidesautour du front, terminées par des anglaises latérales, semble celui d’un enfant : on peut lerapprocher d’un masque du Musée des Thermes66. Le type est souvent identifié commel’Hapalos néaniskos comique, mais on pourrait plutôt penser à la jeune servante aux cheveuxcourts (habra perikouros).
MASQUES DE VIEILLARDS ET D’ESCLAVES
Face à ces masques de jeunes gens, on trouve aussi sur la frise du propylon les masquespopulaires et cocasses de barbons et d’esclaves, qui tendent parfois à mêler leurs caractéristi-ques. On reconnaît sur le bloc d’avancée Sud le masque PS A5, posé traditionnellement detrois quarts sur la moulure, comme le Lykomedeios avec son front ridé, ses sourcils dissymétri-ques et son regard torve (fig. 3, à dr.). C’est un personnage d’intrigant délateur67, bien repré-senté par un masque de Smyrne68 affublé d’une couronne de banquet ; le même masque figureaussi sur la bordure de la mosaïque pompéienne aux colombes69. Un masque sur un relief pro-venant du théâtre de Stratonicée en donne une version encore plus caricaturale70.
Le masque PS E2 pourrait appartenir au type du sphénopogôn71, barbon retors aux yeuxécarquillés et à la barbe en pointe (fig. 7) dont on a un bel exemplaire provenant d’Athènes72.C. Robert73 le reconnaît dans un personnage au pilos de la Maison du Centenaire et dans une
La frise ionique à masques scéniques du propylon du Sébasteion d’Aphrodisias 59
64. Webster-Green-Seeberg, op. cit., II, p. 21, pl. 7 :Masque no 15, 1 AT (= Athènes) 50 ; 1 AT 50a = Mu-nich 739 (provenant d’Athènes aussi) et 1 AT 51a, le plusproche du masque d’Aphrodisias.
65. N. Breitenstein, Danish National Museum, Catalogueof Terracottas, Copenhague, 1941, p. 76, no 720, pl. 86.
66. Giuliano éd., op. cit., I,1, Rome, 1979, p. 7, no 7 etfig. 7 p. 6. Voir aussi un masque de la Villa Hadriana auMusée de Tivoli : DAI nég. 82-1353.
67. O. Navarre, Dionysos, Étude sur l’organisation maté-rielle du théâtre athénien, Paris, 1895, p. 159 sq. ; Webster-Green, Monuments Illustrating New Comedy, 1-2 (Bull. Inst.
Cl. St, Suppl. 24), Londres, 1969, p. 13, no 7 ; BernabòBrea, op. cit., p. 145-152.
68. S. Besques, op. cit., III, p. 253, no D 2003, pl. 327 b.69. Bernabò Brea, op. cit., p. 152, fig. 241.70. L. Budde, R. Nicholls, A Catalogue of the Greek and
Roman Sculpture in the Fitzwilliam Museum Cambridge, Cam-bridge, 1964, p. 74-75, no 121 (inv. GR 10-1865), pl. 40.
71. Webster-Green, MNC, 1, p. 13, no 6.72. Webster-Green-Seeberg, op. cit., II, p. 17-18,
no 1 AT 37e, pl. 5.73. C. Robert, Die Masken der neueren attischen Komoedie
(25. Hallisches Winckelmannsprogramm), Halle, 1911, p. 18-19, fig. 39-40.
statuette de Myrina au Louvre74. Un type très stylisé plus voisin de notre masque est repris surun masque de Myrina75 et un masque hellénistique tardif de l’Agora d’Athènes, dont la barben’est toutefois pas en pointe et que T. B. L. Webster76 classe parmi les serviteurs de comédie.Curieusement le masque du propylon porte un trou de trépan à l’oreille droite : on peut sedemander s’il ne s’agit pas de la reproduction d’un masque à suspendre comme celuid’Athènes qui porte en effet deux trous de suspension au niveau des oreilles.
Le masque PS J5 (fig. 11), avec son volumineux crâne chauve et sa barbe aux anglaisescalamistrées, correspond au type identifié par L. Bernabò Brea comme le premier Hermônios77
alors que C. Robert et M. Bieber y voyaient le type du pornoboskos, opinion reprise par la der-nière édition de Webster78. Sa coiffure est en fait trop soignée pour qu’on puisse l’assimiler àun ruffian de bas étage et l’Hermônios est certainement un personnage plus noble, malgré sonregard hargneux selon Pollux79. Deux masques, l’un au musée de Reggio di Calabria80, l’autreprovenant de Priène81, sont du même type, avec la barbe divisée en anglaises ; un masque de lamosaïque de la maison des masques à Délos82 leur correspond également. Une statuette mas-culine de Myrina portant une couronne de banquet montre que le personnage n’a aucuncaractère d’austérité83. Le masque d’Aphrodisias porte une protubérance au centre du frontqui doit avoir une valeur physiognomonique. Elle ressemble à la mèche subsistant sur le frontchauve du type du cuisinier Tettix, mais on peut la comparer aussi à la verrue frontale caracté-ristique de certains masques grotesques issus de l’atellane84, figurant peut-être des gloutonscomme Manducus.
Le masque le plus aisé à identifier est celui du serviteur principal (hégémôn therapôn)PS F4 avec ses deux sourcils dissymétriques et son nez écrasé (fig. 8). Sa place sur le bloc cen-tral souligne sa popularité. À Lipari, le type est fixé dès la fin du IVe siècle av. J.-C. : L. Ber-nabò Brea en donne divers exemples85. Un masque provenant du Céramique près duDipylon86 à Athènes est en Pentélique et d’une date voisine de celui du propylon. Enfin, onpeut citer aussi en comparaison un grand masque en marbre provenant de la tombe desCalpurnii près de la Porta Salaria87. Le type est également bien représenté parmi les masquesdes bordures de mosaïques pompéiennes.
Le masque comique masculin PS B5 représente l’esclave frisé (oulos thérapôn), au visageplus symétrique que le précédent (fig. 4 à gauche). Ce modèle populaire est connu par de
60 Nathalie de Chaisemartin
74. Besques, op. cit., II, Paris, 1963, no MYR 671,p. 142, pl. 173 e.
75. Ibid., no MYR 344, p. 192, pl. 228 e.76. T. B. L. Webster, Leading Slaves in New Comedy,
JdI, 76, 1961, p. 108-109, fig. 10.77. Bernabò Brea, op. cit., p. 151, masque 5.78. Webster-Green-Seeberg, op. cit., II, catalogue,
1 AT 40, p. 19 (prov. Égypte), 4 DT 20, p. 278, pl. 41(Myrina, Musée d’Athènes) et types d’Italie du SudITT 1,14,20, p. 83-87.
79. Pollux, éd. Bethe, 1900, IV, § 144-145, p. 244 ;Soukaras-Loisy, loc. cit., p. 105, no 5.
80. Bernabò Brea, op. cit., p. 151, no 5, fig. 240.81. Musée de Berlin, Bieber, op. cit., fig. 387.82. J. Chamonard, Les mosaïques de la maison des masques
(EAD, XIV), Paris, 1933, p. 31, no 9, pl. V,9 et VI ; Ph. Bru-neau, Les mosaïques (EAD, XXIX), Paris, 1972, p. 249, no V(côté Est), fig. 190, et p. 251, no IX, fig. 194.
83. Besques, op. cit., II, no MYR 316, p. 141, pl. 172 a.84. A. Desbat, Les masques gallo-romains en terre
cuite, usage et fonctions, dans Spectacula, II, Lattes, 1989,p. 249-251, fig. 7-8.
85. Bernabò Brea, op. cit., p. 200-203, fig. 329-337,pl. XXXIV,3.
86. Musée du Céramique, no Inv. 5634 ; Bieber, op. cit.,p. 245, fig. 810 ; Webster-Green, MNC (Bull. Inst. class.St., suppl. 24), 1969, p. 161-162, no AS 9.
87. Musée des Thermes, DAI nég. 6199 ; Bieber, op. cit.,p. 102, fig. 393 ; Webster-Green, MNC (Bull. Inst. Class.St., suppl. 24), 1969, p. 216, n. IS 37.
nombreuses reproductions88, provenant souvent de Sicile et de Campanie. Citons le relief deNaples89 représentant une scène de comédie où l’esclave soutient son jeune maître éméché, lapeinture d’Herculanum no 903790, un masque de la bordure de la mosaïque pompéienne del’enfant au tigre91, et un oscillum de Pompéi92. Il apparaît avec une couronne de banquet àdroite de la statue de Priape sur un des canthares du trésor de Hildesheim93. Deux masques deMyrina, en terre cuite94, et un masque à suspendre, en marbre, de la série de la Casa degliAmorini dorati à Pompéi95 reproduisent aussi les caractères de ce personnage, comparable auSganarelle de Molière dépassé par les frasques de son maître.
MASQUES COMIQUES FÉMININS
Les quatre masques comiques féminins conservés figurent des courtisanes, dont la pluspopulaire est la courtisane au foulard PS C1 (diamitros hétaira), traditionnellement coifféed’une marmotte nouée au sommet du front (fig. 5). Son visage solide exprime le bon sens etl’humour. Elle est assez différente des courtisanes coiffées en côtes de melon dépassant dubandeau que recense L. Bernabò Brea à Lipari96. Sa coiffure lui confère une connotation exo-tique, comme celle de l’Aphrodite de la Maison des Poseidoniastes de Béryte à Délos97, oud’autres figures féminines reliées au domaine alexandrin. Un masque à suspendre de Délos98
en présente une version soignée, mais banale, identique à un masque incomplet de Pergame99.Un masque du théâtre de Marcellus100 porte, comme ces derniers, de larges bandeaux ondulésque le foulard ne recouvre pas, comme à Aphrodisias. Il en est de même pour un masque enterre cuite expressif provenant d’Amisos au Louvre101 : plusieurs recoupements peuvent êtreétablis de fait entre les masques décoratifs en terre cuite d’assez grande taille (20 à 30 cm dehauteur) produits par les ateliers d’Amisos et les masques sculptés sur les frises d’Aphrodisias,qui en imitent le mode de stylisation. Le masque le plus proche du type de la courtisane dupropylon figure sur un pinax du British Museum102, mais on peut se demander si la coiffure neserait pas plutôt celle d’une nourrice de tragédie.
La frise ionique à masques scéniques du propylon du Sébasteion d’Aphrodisias 61
88. Bernabò Brea, op. cit., p. 204-205, fig. 239-341.89. Spinazzola, op. cit., p. 26, pl. 74.90. Bieber, op. cit., p. 92, fig. 324.91. Musée national de Naples, inv. 9981 ; Spinazzola,
op. cit., pl. 186 ; E. Pernice, Pavimente und figürliche Mosai-ken (Die hellenistische Kunst in Pompeji, VI), Berlin, 1938,p. 8 sq., pl. 59 à dr. ; Webster-Green-Seeberg, op. cit.,p. 235, no 3 NM2.
92. Spinazzola, op. cit., pl. 56 (Musée national de Na-ples, inv. 6634) ; Dwyer, loc. cit., p. 283, no 132, pl. 119,5.6.
93. E. Pernice, F. Winter, Das Hildesheimer Silberfund,Berlin, 1901, p. 39, pl. XIII en bas.
94. Besques, op. cit., II, no MYR 345-346, p. 192,pl. 228 h et 230 c.
95. Musée national de Naples, inv. 6627 ; Dwyer, loc.cit., p. 270, no 36, pl. 118, 3 ; F. Seiler, La casa degli Amori-
ni dorati (VI . 16,7 . 38) (Häuser in Pompeji, V), Munich1992, catalogue no 10, fig. 560 à g.
96. Bernabò Brea, op. cit., p. 230, no 41, pl. XLI,1.2.
97. Musée national d’Athènes, MN 3335. M. Bulard,BCH, XXX, 1906, p. 610-631, pl. XIII-XVI ; Ch. Picard,L’établissement des Poseidoniastes de Bérytos (EAD, 6), Paris,1920-1921, p. 121-124, fig. 99-100 ; Ph. Bruneau, J. Du-cat, Guide de Délos, 3e éd. (EFA, Sites et monuments, I), Paris1983, p. 72-73 (J. Marcadé), 176, fig. 47 et 177.
98. Antiquarium de Berlin, inv. 5165 ; Webster-Green-Seeberg, op. cit., II, p. 69, no DT 25.
99. Topperwein, op. cit., p. 122, no 506, pl. 74.100. Ciancio Rossetto, loc. cit., no 19, p. 31-32,
pl. XXXVI-XXXVII.101. Besques, op. cit., III, no D 509, p. 87, pl. 111 a.102. Cain, op. cit., no 33, p. 149, fig. 47.
Le masque de coquette PS D2 avec une coiffure complexe et apprêtée figurerait la faussevierge du catalogue de Pollux, qui ressemble à une jeune mariée. Les auteurs de l’édition 1995du catalogue de Webster font remarquer que ce modèle au toupet en arrière du crâne remonteaux masques attiques de la Comédie ancienne103, et présentent un joli masque de terre cuitetout à fait comparable provenant d’Attique104. On retrouve ce masque sur certains vases peintsde Gnathia105.
Le masque féminin PS F2 (fig. 8) offre une expression calme et un large visage auxjoues molles indiquant une femme d’âge moyen. Les bandeaux sont retroussés sur unruban noué au sommet du crâne que l’on retrouve sur un modèle de masque d’hétaïre del’Ancienne Comédie106. Toutefois les marques de l’âge empêchent de la confondre avec laplus jeune hétaïre qui porte un nœud de ruban plus important sur le devant du crâne107.On pourrait y voir une « bavarde » (lektiké), dont Pollux remarque les bandeaux « qui seserrent progressivement », ce qui correspondrait à l’aspect piriforme de sa coiffure sur lafrise. Ce personnage de mère de comédie reste rare parmi les masques de terre cuite :L. Bernabò Brea présente un masque de Cefalù108 qui lui ressemble de visage, mais dont letoupet noué au sommet du front lui fait reconnaître en elle la « frisée », autre type de mèrede comédie.
Le masque féminin PS G1 (fig. 9), au visage sérieux et à la bouche fermée, porte la coif-fure élaborée à nœud de mèches au sommet du front109 (crobilos) qui caractérise la pallaké(concubine) ; pourtant T. B. L. Webster110 considère ce modèle de masque comme celui de lapremière fausse vierge de la Comédie nouvelle. C’est le masque de la Samia sur les reliefs dePrinceton et du Latran111 figurant Ménandre préparant une mise en scène. Le motif apparaîtsur des terres cuites architecturales d’Italie112. Vers la fin de l’époque hellénistique, les « côtesde melon » des masques plus anciens de Lipari sont remplacés par des mèches torsadées éta-gées en bandeaux remontant de biais vers le haut du front où ils forment une coque terminaleà l’aplomb de celui-ci comme le montre une série de têtes provenant de Myrina113. Onretrouve le même modèle à Aphrodisias, avec une expression plus gaie toutefois, parmi lestêtes de la frise Nord du « Portique de Tibère » (no PT N2, 12a, 27).
On remarque que, parmi les types comiques, on a surtout choisi pour la frise du propylondu Sébasteion des personnages bien caractérisés par leurs coiffures et leurs attributs.
62 Nathalie de Chaisemartin
103. T. B. L. Webster, J. R. Green, Monuments Illustra-ting Old and Middle Comedy (Bull. Inst. Cl. St., suppl., 39),1978, p. 25, modèle XC.
104. Musée de Leipzig ; Webster-Green-Seeberg,op. cit., II, p. 29, no IAT 70(a), pl. 9.
105. T. B. L. Webster, Masks on Gnathia Vases, JHS,LXXX1, 1951, p. 222-232, pl. XLV e ; More DramaticMasks on Gnathia Vases, Ant. Kunst, 3, 1960, p. 30-35,pl. 9, fig. 2.
106. T. B. L. Webster, J. R. Green, Monuments Illustra-ting Old and Middle Comedy (Bull. Inst. Cl. St., suppl., 39),1978, p. 23, type W.
107. Bernabò Brea, op. cit., p. 229, fig. 393. Mosaïque
de l’Aventin au Musée du Capitole, inv. 392, H. Stuart Jo-nes, A Catalogue... of the Museo Capitolino, Oxford, 1912,p. 154, pl. 35 ; Webster-Green-Seeberg, op. cit., II, p. 186,no 3DM 4a.
108. Bernabò Brea, op. cit., p. 214-215, fig. 359.109. En grande partie manquant sur le bloc du propylon.110. Webster-Green-Seeberg, op. cit., p. 44-45,
type 35.111. Bieber, op. cit., fig. 316-317.112. Strazzulla, op. cit., p. 138-139, fig. 114, pl. 22.113. Besques, op. cit., II, Myrina, Paris, 1963, nos 1392,
1395 b, 1396, 1403, 1405, 1415, 1422, pl. 217.
L’ensemble reste assez proche des modèles des terres cuites hellénistiques, en particulier lesmasques de Pergame et de Myrina, et de l’atelier d’Amisos, mais aussi des masques décoratifsen marbre, en majorité datables, comme la frise, de la première moitié du Ier siècle apr. J.-C.
LES MASQUES SATYRIQUES
Notons tout d’abord que les masques liés au domaine du drame satyrique et du thiasedionysiaque ne portent que pour quelques-uns les déformations du masque scénique : c’est lecas pour les papposilènes PS C2 et F3, dont les bouches sont juste entr’ouvertes, et le Mar-syas PS K2, avec une bouche plus large. Le jeune Pan PS C3 présente bien les sourcils violem-ment arqués et un sourire sardonique, mais sans la bouche en porte-voix. Le satyre triste D5 atout juste les sourcils descendant vers les tempes. Les jeunes satyres PS H5 et B3 ont encoreles maxillaires carrés et les pommettes très saillantes du masque, mais le reste de la physio-nomie est, comme pour les autres satyres juvéniles B3, D3, et J4, davantage inspiré desmodèles de jeunes satyres de la sculpture hellénistique.
Ces personnages semblent souvent fonctionner par paires antithétiques et complémen-taires, comme les masques dionysiaques sur les hermès doubles. A. Allroggen Bedel114 a notéaussi cette tendance à apparier les masques selon des caractères contrastants dans les représen-tations des peintures vésuviennes, où du reste les masques satyriques et dionysiaques domi-nent dès l’époque du second style. Les satyres juvéniles alternent souvent sur un même blocavec des silènes chenus. De plus, les types comiques ont leurs correspondants dans la familledes satyres qui reprennent les caractéristiques physiognomoniques des différents jeunes pre-miers, de même que les silènes sont à mettre en parallèle avec les types de barbons.
Le Dionysos juvénile couronné de lierre PS H5 (fig. 10) répond au Dionysos PogônPS A6 (fig. 3) à caractère archaïsant, dont l’hermès constituait généralement l’élément cultuelcentral du décor sacro-idyllique où se déroulait l’action du drame satyrique115. Le petitmasque PS D1 (fig. 6) ne se différencie du Dionysos PS H5 que par son visage plus enfantin.Il a la même expression mélancolique que la jolie Ménade PS F5 (fig. 8) aux traits plus clas-siques, et nous serions tentée de l’interpréter comme une Ariane. Le type de cette Ariane oude ce Dionysos enfantin a été analysé par I. Manfrini-Aragno116 à partir notamment dumasque de bronze conservé à Mariemont117. On peut les rapprocher d’un masque deterre cuite de Centuripe118, d’un masque de Smyrne119 et de la ménade du canthare de Ber-thouville120. L’expression de PS D1 (fig. 6) rappelle le masque d’un pinax de Philadelphie121
La frise ionique à masques scéniques du propylon du Sébasteion d’Aphrodisias 63
114. A. Allroggen Bedel, Maskendarstellungen in derrömisch-kampanischen Wandmalerei, Munich, 1974, p. 67.
115. Voir les scènes du plafond de stuc du cubiculum Bde la villa de la Farnésine : M. R. Sanzi Di Mino éd., MuseoNazionale Romano, La villa della Farnesina in Palazzo Mas-simo alle Terme, Milan, 1998, p. 57-59, fig. 100-110.
116. I. Manfrini-Aragno, Bacchus dans les bronzes hellé-nistiques et romains, Lausanne, 1987, type II.
117. Ibid., p. 117, fig. 227 ; Landes éd., op. cit., p. 137et 141, no 16.
118. G. Libertini, op. cit., p. 63, fig. 14 en bas à g.
119. Besques, op. cit., III, no ED 1433, p. 194, pl. 275 d.
120. Cain, loc. cit., p. 173, fig. 57.
121. Ibid., p. 137, no 62, fig. 29.
marqué par un certain pathos. La coiffure de la Ménade dont la couronne cache la chevelureautour du visage est un motif moins fréquent, mais la double rangée de feuilles et la doublepaire de corymbes se retrouvent sur un masque en marbre à suspendre de la Casa degli AmoriniDorati à Pompéi122, qui présente un traitement voisin au niveau des yeux et une bouche plusouverte, avec des grappes de raisin pendant derrière les oreilles. Il est présent aussi parmi lestêtes de terre cuite comme celle d’une Ariane du Louvre123 et il semble populaire en AsieMineure comme le montre un masque de Smyrne124 à l’expression triste.
La « famille » des satyres et silènes se singularise sur la frise du propylon du Sébasteionpar un mélange entre des stéréotypes comme le papposilène couronné et des types rares, sou-vent issus de modèles hellénistiques en ronde bosse, traités avec beaucoup de souci du modelémalgré leur échelle modeste : l’origine des modèles reproduits pourrait être cherchée parmides représentations de bronze, en raison de l’aspect linéaire du rendu. On peut rapprocherl’ensemble de la série de huit masques satyriques décorant l’épaule du Vase Lante125 et quiprésentent un degré analogue de soin dans le travail des têtes, dont la hauteur est double decelles de la frise. Le parti-pris expressionniste et souvent caricatural qui les caractérise diffèrecependant de celui de la frise aphrodisienne, où l’on ne retrouve que sur le masque d’un jeunePan PS C5 les grimaces sardoniques des personnages du Vase Lante. L’ouvrage de P. Pensa-bene et M. Sanzi di Mino sur les antéfixes du Musée des Thermes126 remarque aussi cesfamilles de modèles de satyres aux expressions contrastées, qui, dans la symbolique hellénis-tique, étaient censés représenter l’homme à l’état de nature.
Le jeune satyre PS H1 (fig. 10) à la chevelure désordonnée couronnée de gros corymbesest une transposition en masque du satyre adolescent jouant avec une panthère, connu par denombreuses répliques en ronde bosse : le modelé des pommettes et des coins du large sourireévoquent aussi le Fauno colla Macchia de Munich127, plus enfantin que le faune à la panthère. Unmasque à suspendre de Pompéi128 présente la même physionomie juvénile avec une couronnemoins volumineuse ; en revanche, le satyre de bronze couronné de Vani en Géorgie129 a un visagedont le modelé peut être comparé à celui du satyre aphrodisien, de même que deux têtes de terrecuite de Smyrne au Louvre, dont le visage très soigné est auréolé de mèches mouvantes130.
Par contraste, le jeune Pan au rictus furieux PS C1 (fig. 5) présente un modelé heurtéencore plus marqué que sur les têtes de schéma voisin du « Portique de Tibère »131. Ses cornescaprines sont dressées au centre du front, et ses cheveux hérissés en grosses mèches. La ver-
64 Nathalie de Chaisemartin
122. Dwyer, loc. cit., p. 267, no 20, pl. 94,1.123. Besques, op. cit., II, no CA 2972, p. 162, pl. 197 h.124. Ibid., III, 1972, p. 194, no ED 1433, pl. 275 d.125. Angelicoussis, op. cit., no 82, p. 102-104, fig. 378-
379. Parce qu’il provenait de la Villa Hadriana, le VaseLante a été daté du règne d’Hadrien alors que sa forme, sesanses torsadées (à comparer avec le vase au thiase marindu Musée des Thermes) et la technique d’exécution deses masques suggéreraient plutôt une date au début del’Empire. Le goût d’antiquaire de l’empereur suffirait àexpliquer sa provenance, à moins qu’il ne s’agisse d’uneréédition, comme pour les grands masques de la Villareprenant les modèles du théâtre de Marcellus.
126. P. Pensabene, M. Sanzi di Mino, Museo NazionaleRomano, Le terrecotte, III,1, Antefisse, Rome, 1983, p. 92 sq.,nos 109, 111, 121, 127, 130-132, pl. 29.
127. R. R. R. Smith, Hellenistic Sculpture, Londres,1991, p. 143, fig. 153.
128. Dwyer, loc. cit., p. 267, no 23, pl. 95,1.129. O. Lordkipanize, La Géorgie et le monde grec,
BCH, 98, 1974, II, p. 927, fig. 16 b.130. Besques, op. cit., III, 1972, nos D 1436 et D 1437,
p. 194, pl. 275 g, h.131. Frise du portique Nord, têtes PT N 11a, 49a, 53a,
97a.
sion la plus précise et la plus expressive du modèle est donnée par une matrice d’Amisosconservée au Louvre132 et un masque fragmentaire du théâtre de Marcellus en reprend lescaractères133. Un masque du Vase Lante134 présente une version encore plus caricaturale etpresque terrifiante du même modèle, comme le masque figurant sur un pinax de Munich135.
Le masque de jeune satyre souriant PS B3 (fig. 4) est très endommagé, mais la forme del’ovale, les yeux très enfoncés près du nez et le saillant des pommettes le rapprochent du Faunocolla Macchia ; il a, comme lui, les oreilles placées très bas mais son sourire est moins accentué.Son expression devait être proche de celle du jeune Pan surmontant le petit hermès de bronzede Torre del Greco136. On peut le rapprocher aussi d’un masque de satyre de la Casa degliAmorini dorati 137, dont le visage paraît toutefois plus raide et plus caricatural.
Les deux satyres adolescents du bloc PS D (fig. 6) – l’un sérieux, l’autre triste, avec desarcades sourcilières en forte oblique – rappellent moins des modèles de la ronde-bosse que lesmasques stylisés de certaines séries de plaques Campana, où la chevelure des satyres formeune auréole décorative autour des visages.
Enfin, une autre paire de modèles est constituée par les satyres joufflus PS J2 (fig. 11),et PS H3 (fig. 10), dont le visage mélancolique est couronné d’aiguilles de pin. Il est plus diffi-cile de trouver des parallèles à ce dernier, car les satyres en ronde bosse couronnés de pin sonten général souriants et plus proches du type du masque PS H5, comme le montre un masquede satyre souriant sur un pinax de la Villa Albani138. En revanche, les yeux dissymétriques et lelarge sourire du satyre PS J2 font penser aux satyres souriants du Musée Chiaramonti, maisaussi au satyre flûtiste, dont une réplique a été retrouvée au bouleutèrion d’Aphrodisias. Onremarque que la série de masques du propylon ne comporte aucun satyre d’âge moyen (satyreDionysophore, satyre aux cymbales du groupe de l’invitation à la danse ou satyre luttant avecun hermaphrodite).
Le papposilène PS C2 (fig. 5) avec ses sourcils en accolade, sa barbe calamistrée et sesoreilles arquées vers l’avant est le plus banal des types représentés. Un cratère de Lipari139 lemontre accompagné de son surnom de Simos (le camus) et on le dénomme parfois, de nosjours, « socratique », puisque les pseudo-portraits de Socrate s’inspireraient de sa physionomie.Il correspond au cuisinier Maisôn dans le registre des masques comiques, mais était utilisé dèsl’époque archaïque comme masque apotropaïque décorant des éléments architecturaux deterre cuite : acrotères, antéfixes... Il alterne avec le masque de Marsyas sur le linteau du théâtrede Pergame140 (fig. 15) daté du IIe siècle av. J.-C. Les statuettes de terre cuite ont popularisé
La frise ionique à masques scéniques du propylon du Sébasteion d’Aphrodisias 65
132. Besques, op. cit., III, 1972, p. 88, pl. 112 a, c.133. Ciancio Rossetto, loc. cit., p. 26-27, no 10,
pl. XXII.134. Angelicoussis, op. cit., no 82, p. 103, fig. 378-379.135. Cain, loc. cit., no 39, p. 122, fig. 11.136. D. Gordon Mitter, S. F. Doeringer, Masterbronzes
from the Classical World, cat. expo. Fogg Art Museum,Mayence / Rhin, 1968, p. 296, no 294.
137. Maison de Ganymède (VII,13,4), pseudo-péristyle ; Musée national de Naples, inv. 6628 ; Webster,MNC (NS 14) ; Dwyer, loc. cit., p. 270, no 37, pl. 118, 3à dr.
138. Cain, loc. cit., p. 145, no 79, pl. 39.
139. Bernabò Brea, op. cit., pl. IX.
140. M. Fränkel, AvP, VIII,1, Die Inschriften, Berlin,De Gruyter, 1890, p. 136, no 236 ; R. Bohn, AvP, IV, DieTheater-Terrasse, Berlin, De Gruyter, 1896, p. 13 et fig.p. 1, pl. XXXIV ; G. Mendel, Musées impériaux ottomans,Catalogue des sculptures grecques, romaines et byzantines,Constantinople, II, 1912-1914, p. 47-49, no 287 ;W. Radt, Pergamon, Geschichte und Bauten, Berlin, 1988,p. 222, 291 (datation révisée : seconde moitié du Ier s.av. n. è).
son type, par exemple celle de Myrina au Louvre141 montrant un acteur vêtu d’un maillot defourrure et portant ce masque avec la même barbe ordonnée en anglaises. Ce Silène était sou-vent présent à l’époque hellénistique et au début de l’époque impériale dans le décor de lafrons pulpiti des théâtres, sous forme d’atlante (Pompéi) ou de statue-fontaine, couché sur uneoutre, et il apparaît aussi parmi les masques du théâtre de Marcellus142.
Le papposilène couronné de lierre PS F3 (fig. 8) dérive du même type, qu’il tire davan-tage vers la caricature, avec un visage ramassé, un nez très court et écrasé, un sourire inquié-tant et une barbe en désordre. On le trouve déjà parmi les masques en terre cuite de Lipari143
(sans couronne), parmi les masques à suspendre pompéiens144 et sur un pinax145, et parmi lesmasques du Vase Lante146.
Le troisième silène PS B5 (fig. 4) porte lui aussi une couronne de lierre, mais appartient àun type moins stylisé en masque et qui se rapproche du Silène Dionysophore lysippique par lemodelé du front et des joues, les oreilles discrètes, la couronne de corymbes et la barbe inculte ;toutefois sa bouche ouverte est bien caractéristique d’un masque. Des exemples de ce type peu-vent être cherchés parmi les têtes de terre cuite de Smyrne147, mais aussi sur une coupe du trésorde Hildesheim148 et un chapiteau de pilastre stuqué du théâtre de Fourvière149 à Lyon.
Enfin, le masque à l’opulente chevelure PS K2 (fig. 12) reprend un modèle plus fidèleaux masques réels du drame satyrique, exécutés en peau de chèvre avec une forte crinière
66 Nathalie de Chaisemartin
141. Besques, op. cit., II, no 670, p. 141, pl. 172 c.142. Ciancio Rossetto, loc. cit., p. 24-25, no 6, pl. XVII-
XVIII.143. Bernabò Brea, op. cit., p. 47, no B 5, fig. 36, pl. IX.144. Dwyer, loc. cit., p. 266, no 24, pl. 95,2 (Casa degli
Amorini dorati) ; Antiquarium de Berlin, DAI nég. 1935-3407.
145. Dwyer, ibid., pl. 128, no 3.
146. Angelicoussis, op. cit., Face 1, masque 2, p. 103,pl. 218, fig. 374-375.
147. Besques, op. cit., III, 1972, p. 195, no D 1449,pl. 277 f.
148. Pernice, Winter, op. cit., pl. 12,2, au centre.149. É. Espérandieu, Recueil général des bas-reliefs, statues
et bustes de la Gaule romaine, III, Paris, 1911, no 8206 ;Landes éd., op. cit., p. 247-248, no 121.
15. Relief votif à masque scénique de Notion.
cachant la partie postérieure du crâne de l’acteur. On désigne ordinairement ce satyre hirsutecomme Marsyas, bien que le masque n’ait guère de rapport avec les modèles de tête de Mar-syas en ronde bosse. Il figure sur le linteau du théâtre de Pergame150 et sur la frise ionique dubâtiment de scène d’Aphrodisias151, ainsi que parmi les masques du théâtre de Marcellus152, etson type avait été popularisé par la céramique à reliefs pergaménienne153, les plaques Campanade Vales154 et aussi par la toreutique, où on le retrouve sur le canthare aux quatre masques dio-nysiaques barbus de Hildesheim155.
La sélection typologique des masques de la frise du propylon montre donc le soucid’équilibrer le nombre des masques appartenant aux différents genres théâtraux et de varierleurs modèles, figurés le plus souvent une fois, à l’exception d’un type de masque tragiqueà onchos calamistré et des masques de Dionysos juvénile. On constate aussi que certainsmasques comme le campagnard PS K1 additionnent le visage d’un masque comique avecl’onchos d’un masque tragique, trahissant ainsi un certain manque de familiarité des artisansavec ces modèles traditionnels, mais vraisemblablement hors d’usage à l’époque tibérienne.
LA FRISE DE MASQUES SCÉNIQUES : MODÈLES ET INFLUENCES
1. LES ORIGINES DE LA FRISE DE MASQUES
Dès l’époque archaïque en domaine grec, des têtes féminines et des masques scéniques,souvent ceux de Silènes, sont utilisés dans l’ornementation architecturale de terre cuite, enparticulier sur les acrotères, les antéfixes156, les plaques de protection de charpente, parfois lesgargouilles, ces images présentant sans doute une valeur apotropaïque ou prophylactique.
Mais c’est à Athènes que le rituel d’offrande votive à Dionysos des masques utilisés pourla trilogie victorieuse du concours des Grandes Dionysies a progressivement entraîné la trans-position en pierre de ces offrandes périssables pour commémorer de manière pérenne, et pro-bablement plus visible au-dehors du naos, la victoire des chorèges. La stèle à inscription choré-gique du théâtre d’Aixoné (Glyphada), datant de 313-312 av. J.-C.157, présente un édiculeabritant l’image de Dionysos trônant tendant sa coupe à un jeune satyre. La frise del’entablement aligne plusieurs masques sommairement incisés, de face ou de trois-quarts, sans
La frise ionique à masques scéniques du propylon du Sébasteion d’Aphrodisias 67
150. F. Rumscheid, Untersuchungen zur kleinasiatischenBauornamentik des Hellenismus, Mayence / Rhin, 1994,no 233, pl. 135.
151. N. de Chaisemartin, D. Theodorescu, Recherchespréliminaires sur la frons scænae du théâtre d’Aphrodisias,dans Aphrodisias Papers, 2 (JRA, suppl. 2), Ann Arbor,1991, p. 52-53, fig. 9B.
152. Ciancio Rossetto, loc. cit., p. 25, no 9, pl. XX-XXI.153. J. Schäfer, Hellenistische Keramik aus Pergamon
(Pergamenische Forschungen, 2), Berlin, 1968, pl. 33,no E 62-64.
154. S. Tortorella, Le lastre Campana, dans L’art déco-ratif à Rome (Coll. EFR, 55), Rome / Paris, 1981, p. 86,fig. 8.
155. Pernice-Winter, op. cit., pl. 11,1.156. Masques tragiques et comiques au centre d’une pal-
mette sur les antéfixes campaniennes : Breitenstein, op. cit.,p. 99, pl. 130, no 943-944 (masque tragique), 945 (vieillardou esclave), 946 (vieillard du type du makropogôn).
157. Athènes, Musée épigraphique, inv. 13262 :M. A. Zagdoun, Fouilles de Delphes, Monuments figurés,Sculpture, IV,6, Reliefs, Paris, 1977, p. 59, fig. 41.
décor de liaison, qui sont le plus ancien témoignage de l’existence de frises à masques scé-niques dans l’architecture de pierre.
Plus tard, des reliefs votifs représenteront, disposés sur un ou plusieurs rangs, l’ensembledes masques liés à un spectacle : c’est le cas, entre autres, d’une plaque à trois masques pro-venant du théâtre de Dionysos à Athènes158, d’un relief provenant d’Amphipolis159 et d’unrelief de la villa de Chiragan à Martres-Tolosanes160.
Comme le montrent l’inclinaison des visages et la courbure du crâne, ces masques depierre imitent la forme des véritables masques scéniques emboîtant le crâne des acteurs. Parmiles 21 reliefs à masques du Musée de l’Acropole161 à Athènes, certains proviennent du théâtrede Dionysos et d’autres de la stoa d’Attale ; ils datent du début de la période hellénistique.Certains ont des mortaises de suspension, d’autres sont sculptés en très haut relief sur desdalles quadrangulaires. C’est le cas en Asie Mineure du masque comique accompagnéd’une dédicace d’un certain Métrodoros provenant du théâtre de Notion162 (fig. 15). Le reliefdaterait de la période hellénistique tardive.
Il est vraisemblable que ce genre de reliefs à masque unique a pu être utilisé sous formed’une série de métopes dans une frise dorique, mais, pour l’époque hellénistique, nous n’avonsqu’un témoignage indirect concernant ce type de frise163 : ce sont les seize masques sculptéssecondairement dans les métopes de la porte septentrionale du théâtre du Letôon en Lycie164,datable du milieu du IIe siècle av. J.-C. Ces masques auraient été ajoutés, au tournant du IIe auIer siècle, au décor de la porte, et parmi eux on relève quelques parentés typologiques avec lesmasques du propylon d’Aphrodisias : ce sont des masques particulièrement populaires, commecelui d’Héraclès – figuré barbu sur une des métopes du Létôon alors que celui d’Aphrodisias estimberbe – le cuisinier chauve (Maisôn), l’esclave aux deux profils (hégemôn thérapôn), le pan-chrestos, ainsi qu’un satyre joufflu. En revanche, les masques de tragédie, en particulier deux roisbarbus et deux masques à onchos, n’ont pas de correspondants dans la série du propylon. Mais,surtout, le traitement en à-plat des masques de Xanthos, avec des yeux exorbités et un volumeexagéré de la zone des maxillaires, dérive d’une conception différente de représentation dumasque, où la calotte crânienne n’est plus figurée. Ce type de masque plat deviendra la norme àl’époque impériale pour les éléments de décors muraux ou les bouches de fontaines.
Dans le décor architectural des monuments publics hellénistiques, la série paratactiquede masques scéniques reste rare à cette époque en Grèce comme en Asie Mineure, alors qu’ils
68 Nathalie de Chaisemartin
158. O. Walter, Beschreibung der Reliefs im kleinen Akro-polismuseum in Athen, Vienne, Österreischiches Archäolo-gisches Institut, 1923, no 412, p. 209-210.
159. Musée de Kavalla : Webster-Green-Seeberg,op. cit., no I BT 5, p. 34-35, pl. 11 ; Bernabò Brea -Cavalier, op. cit., p. 166, fig. 228.
160. Landes, op. cit., p. 186-187, no 73, fig. p. 189-190.161. Walter, op. cit., p. 209-213, en particulier la plaque
à 3 masques no 412 (trouvée en 1862, inv. 2291). Webster-Green-Seeberg, op. cit., I, p. 1-2.
162. BCH, 18, 1894, p. 216 ; Th. Macridy, Antiquitésde Notion, II, ÖJh., XV, 1912, p. 58, fig. 29 ; Webster-Green-Seeberg, op. cit., II, p. 274, no 4 DS 1, pl. 40.
H. 0,48 m, L. 0,63 m, ép. de la plaque 0,76 m, H. masque0,25 m ; photographié en 1984 à Izmir, Musée de Basma-hane, inv. 213.
163. À l’époque impériale, en revanche, les frises à tri-glyphes et masques en métope seront fréquentes sur lesmonuments tant publics que funéraires, en particulier enPamphylie et en Pisidie.
164. F. Rumscheid, Untersuchungen zur kleinasiatischenBauornamentik des Hellenismus, Mayence / Rhin, 1994,texte p. 281-282, Cat. p. 35, no 129, pl. 76,1 ; A. Badie,S. Lemaître, J.-Ch. Moretti, Le théâtre du Létôon de Xan-thos, État des recherches, Anatolia Antiqua, XII, 2004,p. 164, fig. 22.
sont plus couramment, à partir du milieu du IIe siècle, associés à des rinceaux ou à des guirlan-des sur des frises ioniques165. Il est intéressant de noter que la courte liste de décors à masquesdans les théâtres grecs donnée pour l’époque hellénistique par Ch. Schwingenstein166 com-prend uniquement des exemples provenant de théâtres d’Asie Mineure : linteau de Per-game167, frise de Mylasa168, frise de Philippes en Thrace169.
D’autres monuments publics que les théâtres peuvent cependant présenter à cetteépoque un décor de masques scéniques : c’est le cas du temple du marché supérieur à Per-game170 dont la corniche à rinceaux porte comme gargouille un masque de satyre au tournantentre le IIIe et le IIe siècle av. J.-C. On commence à voir les masques remplacer les têtes de lionscomme bouches de fontaine, comme le montre le bel exemple d’Aï Khanoum171. Dansl’architecture privée, des séries de masques de pierre ou de terre cuite peuvent aussi décorer lehaut des murs dans certaines maisons hellénistiques comme à Priène, dans la pièce 4 de lamaison de Priène sont désignées par des chiffres romains : il s’agit de la maison 20 où ils alter-nent avec des têtes de taureaux172 ou à Délos dans la maison au Sud-Ouest du Cynthe173.
En revanche, la vogue des masques scéniques va se développer autour de la Méditer-ranée durant la période hellénistique moyenne et tardive, d’abord dans le domaine des terrescuites funéraires dont le remarquable ensemble de la nécropole de Lipari nous donne une idéesuggestive, mais aussi dans celui du décor domestique où le thème dionysiaque devient prédo-minant dans le décor des pièces toreutiques comme dans celui de la vaisselle de terre cuite quisouvent les imite. Les transferts de modèles de masques scéniques seront, en conséquence,fréquents entre ces domaines des arts mineurs et la sculpture174.
2. UNE INFLUENCE PTOLÉMAÏQUE ?
La bibliographie récente a mis en évidence les liens entre le thème des masques scéni-ques, liés à la victoire agonale et aux fêtes panégyriques, et la propagande politique des Epigo-nes, en particulier des Ptolémées, dans le monde méditerranéen. À la suite d’Alexandre, lesmonarques hellénistiques s’identifient volontiers à Dionysos, promoteur d’un âge d’abon-dance et de bonheur. Le thème de la vie facile et festive (trAfh), qui jusque-là avait pour les
La frise ionique à masques scéniques du propylon du Sébasteion d’Aphrodisias 69
165. Frise à guirlandes et masques réemployée à la cita-delle de Cos et provenant peut-être du théâtre (G. Gerola,I monumenti medioevali delle tredici Sporadi, Ann. Sc.Atene, II, p. 43, fig. 36), frise du mausolée du Khazné àPétra (Mac Kenzie, op. cit., p. 141, pl. 25 a, 87 a).
166. Ch. Schwingenstein, Die Figurenausstattung dergriechischen Theatergebäudes (Münchener archäologische Stu-dien, 8), Munich, 1977, p. 43-44.
167. Webster, MTS, p. 120, no ZS 6 (434).168. J.-Ch. Moretti, Des masques et des théâtres
en Grèce et en Asie Mineure, Hommages à J. Marcadé,REA, 95, 1993, 1-2, p. 208, semble mettre en doutel’appartenance au théâtre de cette frise, attribution pro-posée par A. Hauvette-Besnault et M. Dubois, BCH, 5,1881, p. 37-38.
169. Webster, MTSP, p. 55, no XS1. Dans la listedonnée par J.-Ch. Moretti, loc. cit., cette dernière estcependant datée de la période antonine ou sévérienne.
170. J. Schrammen, Der grosse Altar, der obere Markt,AvP, III,1, Berlin, 1896, p. 110, pl. XXXIII ; Rumscheid,op. cit., p. 118-124, 281, cat. no 213 . 7, p. 58, pl. 126,4.
171. Webster-Green-Seeberg, op. cit., II, p. 133,no 2HS1.
172. Ibid., p. 214, no 3 DT 90.173. BCH, 85, 1961, p. 915-917 ; Webster-Green-
Seeberg, op. cit., II, p. 214, no 3 DT 91 et 3 DT 92.174. Voir l’éclairant article de S. Besques, Quelques
problèmes concernant les transferts de thèmes dans lacoroplathie du monde méditerranéen, BSNAF, 1984,p. 71-81.
Grecs du continent une connotation négative, liée à l’austérité du milieu en Grèce propre faceà l’abondance agricole de l’Asie Mineure ou de l’Italie du Sud, devient avec Ptolémée Phila-delphe un thème porteur de son imagerie de propagande175. La description par Kallixenos deRhodes transmise par Athénée de la procession triomphale de Ptolémée II176 en 279-278 oùdéfilent, au milieu de personnages allégoriques délivrant un message politique, les acteursmasqués représentant les membres du thiase dionysiaque, montre que Ptolémée Sôter, pèredu roi et fondateur de la dynastie, y était représenté par une statue colossale portant le cos-tume et les attributs de Dionysos. Dans ce contexte, les masques, liés aux rassemblementspanhelléniques durant lesquels des trêves étaient respectées par les cités belligérantes, peuventavoir pour rôle d’évoquer la paix entre les peuples.
Athénée177 décrit également la tente d’apparat de Ptolémée Philadelphe, décorée de figu-res groupées pour représenter des scènes de tragédie, de comédie et de drame satyrique. Il estdifficile de dire s’il s’agissait de personnages sculptés formant des « tableaux vivants » ou simple-ment de masques scéniques – ce mot correspondrait mieux au terme prpswpa utilisé parAthénée – regroupés avec des accessoires de manière à évoquer certaines pièces célèbres durépertoire hellénique. Dans cette hypothèse, le décor de la tente royale pourrait avoir inspiré lacréation des panneaux de marbre ornés de masques scéniques (oscilla et pinakès) si répandusdans le décor des portiques et jardins d’Italie de la fin de la période hellénistique à l’époque julio-claudienne, alors qu’ils restent introuvables autour de la partie orientale de la Méditerranée178.
Le développement, autour de l’Égée, de la mode des coupes hémisphériques en terrecuite à décor végétal et dionysiaque semble coïncider avec le moment où Athènes se réconcilieavec le pouvoir lagide. En 224 av. J.-C., des jeux sont organisés par la cité en l’honneur dePtolémée Évergète179, et on a pu supposer que le roi y avait alors séjourné et reçu divers hon-neurs180. Bon nombre de ces bols moulés à reliefs, qui ont été reproduits par divers ateliers dusecteur égéen, représentent des masques de silènes ou de vieillards comiques. À Pergame,parallèlement, ce sont des gobelets de céramique à reliefs qui portent un décor dionysiaqueavec des masques satyriques. Ils étaient fabriqués depuis 170 av. J.-C. pour les associationsd’Attalistes, et servaient au rituel du culte des rois pergaméniens, dont ils contribuaient à dif-fuser la propagande181.
Par ailleurs, la composition de la frise du propylon du Sébasteion présente un motif quidénoterait une possible influence de l’architecture ptolémaïque : les aigles corniers des angles
70 Nathalie de Chaisemartin
175. P. Zanker, Un art pour le plaisir des sens, Le mondefiguré de Dionysos et d’Aphrodite dans l’art hellénistique, Paris,2001, p. 6-13, 89.
176. Ibid., p. 392-413 ; E. E. Rice, The Grand Processionof Ptolemy Philadelphos, Oxford Classical and Philosophi-cal Monographs, Oxford University Press, 1983, p. 11 sq.
177. Athénée, Deipnosophistes, V,28,198d, éd. Ch. BurtonGulick, New York, II, p. 390-393.
178. Cain, loc. cit., p. 110.179. S. I. Rotroff, The Athenian Agora, XXII, Hellenistic
Pottery, Athenian and Imported Moldmade Bowls, Princeton,1982, p. 6-10.
180. F. Courby, Les vases grecs à reliefs, Paris, 1922,p. 262 sq., insiste sur l’importance d’Athènes commecentre de production principal de ce type de céramique.Rotroff, op. cit., p. 55-56, nos 99, 101, 102, 103-107,pl. 17-19. Voir aussi A. Laumonier, La céramique hellénis-tique à reliefs, 1, Ateliers « ioniens » (EAD, XXXI), Paris,1977, nos 3256, 3275, 3474, 3478, 8445, 8565, pl. 15, 98,118.
181. G. Hübner, Die Applikenkeramik von Pergamon(Pergamenische Forschungen, 7), Berlin, 1993, p. 174-182.
saillants de son articulation, qui contrastent par leurs proportions miniaturisées et leur exécu-tion cursive avec le travail précis des masques. Malgré leur piètre état de conservation, on peutnoter qu’ils semblent soutenir l’angle des blocs, les serres posées sur le corps de moulures etles ailes, plutôt verticales et effilées du bout, appliquées aux côtés perpendiculaires.
Figures emblématiques du monnayage lagide, les aigles sont souvent représentés sur desédifices ou des objets liés aux souverains hellénistiques, à commencer par les aigles d’or quisoutenaient le toit de la fameuse tente de Ptolémée II182. Vers 187 av. J.-C. au palais d’Hyrcanà Iraq al-Amir183, des aigles colossaux ornent les angles de l’entablement. Ils sont aussi pré-sents sur les frises à guirlandes de la Casa delle Colonne de Ptolémaïs184. Au mausolée royal duKhazné de Pétra, datable du second quart du Ier siècle av. J.-C., on retrouve des aigles auxangles du couronnement de la porte et en acrotères aux angles des demi-frontons de l’étagesupérieur185. Ces exemples ont parfois conduit à supposer une origine alexandrine à ce motif,mais on sait par ailleurs que des aigles dorés soutenaient les angles du toit du Capitole deCatulus à Rome achevé en 69 av. J.-C.186. Au théâtre d’Aphrodisias187, daté autour de 30av. J.-C., des protomés d’aigles sont sculptés sur les saillies de l’architrave et de la frise ioniquedu mur de scène, et soutiennent les avancées à pilastres de l’ordre corinthien supérieur. Ilsemble donc que les aigles d’angle s’insèrent dans le cadre plus vaste d’une architecture deprestige tardo-hellénistique certes bien représentée dans le secteur d’influence ptolémaïque,mais aussi en Asie Mineure, voire dans l’Italie tardo-républicaine.
3. LES MODÈLES DES MASQUES DE LA FRISE DU SÉBASTEION :
L’ATTIQUE, PERGAME ET ROME
Nous avons pu souligner dans l’étude typologique des masques le caractère volontiersconservateur et traditionnel des modèles adoptés, en tout cas pour la plupart des masquescomiques qui reproduisent des types hérités de la Comédie moyenne, voire ancienne, créés enAttique. Le style sobre et raffiné de la frise aiguille aussi vers une imitation des productionsnéo-attiques.
Pourtant leur caractère légèrement parodique les situe dans la tradition plus expression-niste des masques et surtout des têtes de personnages du thiase issus du répertoire hellénis-tique de Pergame. On retrouve sur la frise aphrodisienne les modèles du Silène chauve et duMarsyas hirsute qui soutiennent les guirlandes du linteau d’Apollodoros provenant de la porte
La frise ionique à masques scéniques du propylon du Sébasteion d’Aphrodisias 71
182. T. B. L. Webster, L’art hellénistique, Paris, 1969,p. 64-66, fig. 10.
183. E. Will, F. Larché, F. Zayadine, J. Dentzer-Feydy,F. Queyrel, Iraq al-Amir, Le château du Tobiade Hyrcan,Paris, 1991, chap. 4, 3e partie, Le décor architectural,p. 19, 158-159 et 243-251.
184. G. Pesce, Il Palazzo delle Colonne in Tolemaide diCirenaica, Rome, 1950, p. 27 sq., fig. 13-16, pl. VI et X ;H. Lauter, Ptolemais in Libyen, Ein Beitrag zur Baukunst
Alexandrias, JdI, 86, 1971, p. 149-178 (datation tardo-hellénistique).
185. Mac Kenzie, op. cit., p. 140-144, pl. 87.
186. A. M. Colini, Il Campidoglio nell’Antichità, Capi-tolium, 40,4, 1965, p. 175 sq. ; G. Sauron, Quis deum ?(BEFAR, 285), Rome, 1994, p. 169-248.
187. Chaisemartin, Theodorescu, loc. cit., p. 45-46,fig. 10 d.
72 Nathalie de Chaisemartin
16. Linteau inscrit à masques et guirlandes du propylon du théâtre de Pergame(fin IIe / début Ier siècle av. J.-C.). Cl. DAI.
17. Frise à masques et guirlandes provenant du gymnase de Pergame.
18. Frise ionique à masques et rosaces du théâtre d’Aphrodisias.
partie gauche partie droite
19. Théâtre d’Aphrodisias : linteau de niche à masques, rosaces et dédicace secondaire à Némésis.
d’accès Sud du théâtre de Pergame (fig. 16) et daté du tournant entre le IIe siècle et le Ier av. J.-C.188. L’autel de facture typiquement pergaménienne, dédié à Athènes par Pisthokratès etApollodoros vers 100 av. J.-C., porte d’ailleurs les mêmes masques associés à des guirlan-des189. Les masques à onchos de la frise du Sébasteion se rapprochent également des masquestragiques à perruque élaborée d’une série de blocs de frise provenant du gymnase de Pergame(fig. 17), traités dans un style plus expressionniste et reliés par des rameaux de lierre190. Unautre bloc de la même série porte le masque comique du Maisôn191.
À Aphrodisias, le décor de masques en série apparaît au théâtre vers 30-28 av. J.-C.C’est le premier exemple de leur utilisation dans le décor des théâtres impériaux micrasia-tiques192. Trois masques ornent deux blocs de la frise ionique surmontant l’intervalle entre lesdoubles ædiculae sur quatre colonnes et les simples sur deux colonnes de la frons scænae(fig. 18), ainsi qu’un linteau de niche de même facture portant une dédicace à Némésis(fig. 19), restitué au second niveau corinthien. Les masques sont, dans les deux cas, disposéssymétriquement par trois et associés à des rosaces, motif courant dans la céramique hellénis-tique à reliefs. Sur les blocs symétriques de la frise ionique, deux Marsyas hirsutes encadrentun masque de petite courtisane portant une couronne de banquet. Sur le linteau de niche sub-siste un masque à couronne de banquet, qui peut figurer une courtisane ou un jeune premierbrun à l’expression pathétique. L’autre masque conservé, en position centrale, figure un jeunesatyre à l’expression ricanante assez proche du jeune Pan du bloc PS C1. Ces masques à petiteéchelle (0,19 m de hauteur moyenne pour la frise ionique et 0,15 m pour le linteau) semblentincrustés dans la frise sous la moulure supérieure et non posés sur la moulure inférieurecomme au propylon, mais leur exécution expressive et miniaturiste en fait des précurseursimmédiats des représentations de la frise du Sébasteion.
Il faut peut-être aussi tenir compte, dans l’analyse des modèles de la frise du propylon, d’unepossible influence des masques colossaux décoratifs dont Auguste avait fait orner, vers 13 av.J..C., les clefs d’arc du théâtre de Marcellus, peut-être à l’imitation du théâtre de Pompée si l’onen croit Pirro Ligotio193. Pour T. B. L. Webster et son équipe194, ces masques auraient de « closecounterparts in Athens » et leur mode de représentation se rattacherait aux modèles de masquesde la période proto-hellénistique, en particulier ceux de l’Ancienne Comédie attique. Le styleprécis et raffiné, typique de l’art augustéen, serait dû aux sculpteurs néo-attiques de Rome.
Une comparaison entre les masques du propylon et la série du théâtre de Marcellusmontre que, du point de vue du répertoire typologique, la série d’Aphrodisias équilibre le
La frise ionique à masques scéniques du propylon du Sébasteion d’Aphrodisias 73
188. R. Bohn, Die Theaterterrasse, AvP IV, Berlin, 1896,p. 1-16 et 46, fig. p. 1 et pl. XXXIV ; M. Fränkel, DieInschriften von Pergamon, AvP VIII,1, Berlin, 1890, p. 136,no 236 ; G. Mendel, Cat. Sculptures Constantinople, II, Paris,1912-1914, p. 46-47, no 287.
189. G. Welter, Datierte Altäre in Athen, 3, Der Rund-altar des Pistokrates und Apollodoros im Dionysosbezirk,ÖJh., Beiblatt, 1939, I, II, p. 36-37, fig. 10 ; Webster,MTSP, p. 60, no ZS2 ; id., Le monde hellénistique, Paris,1969, p. 146-153, fig. 38 ; P. M. Fraser, Rhodian FuneraryMonuments, Oxford, 1977, fig. 75 a.
190. W. Altmann, Die Arbeiten zu Pergamon 1902-1903,AM, XXIX, 1904, p. 192-196 ; F. Winter, Die Skulpturen,AvP VII,2, Berlin, 1908, p. 314-316, no 404, a-d ; Rum-scheid, op. cit., II, Cat., p. 65-66, no 258-259, pl. 139,5 ;Webster-Green-Seeberg, op. cit., p. 191, no 3 DS2.
191. Bieber, op. cit., p. 101, fig. 380.192. J.-Ch. Moretti, Des masques et des théâtres en
Grèce et en Asie Mineure, Hommages à J. Marcadé, REA,95, no 1-2, 1993, p. 9-32, p. 210-213.
193. Ciancio Rossetto, loc. cit., p. 75, n. 10.194. Webster-Green-Seeberg, op. cit., I, p. 68.
quota de masques lié à chacun des genres théâtraux classiques, alors que P. CiancioRossetto195 remarque que, sur les fragments de masques retrouvés lors des fouilles du théâtrede Marcellus, les masques tragiques représentent un tiers et les masques satyriques un quartdu nombre de masques comiques.
Il faut souligner que les masques tragiques du théâtre d’époque impériale sont plus diffi-ciles à distinguer les uns des autres que les masques comiques, le texte de Pollux n’étant pasassez précis à propos des coiffures. Ces masques semblent cependant mieux différenciés authéâtre de Marcellus que sur la frise aphrodisienne. En revanche, le répertoire comique est trèsanalogue et comprend de nombreux masques traditionnels de vieillards ou d’esclaves. Toute-fois, probablement en partie à cause de leur échelle, les masques comiques d’Aphrodisiasparaissent moins mouvementés, moins caricaturaux que ceux du théâtre de Marcellus. Demême, les masques des personnages juvéniles du thiase – Bacchante, Dionysos et satyres ado-lescents – sont traités à Aphrodisias avec plus de réalisme et d’élégance, et n’arborent pas,comme certains masques du théâtre de Marcellus, des visages aplatis, disproportionnés parrapport au volume de la coiffure. En revanche, leur mode de traitement linéaire et schématisé,avec des arêtes et des courbes d’un dessin accentué, rapprochent les masques scéniques duthéâtre de Marcellus des têtes de la frise nord du « Portique de Tibère », place méridionale ducentre urbain d’Aphrodisias, qui en sont plus proches que celles de la frise du propylon. Pour-tant les deux monuments, construits selon toute apparence par les membres d’un même clanfamilial, appartiennent à une même phase chronologique du développement de la citécarienne à l’époque de Tibère : il est clair que l’on a intentionnellement différencié par le styleles deux séries de frises sculptées.
4. LES MASQUES DU PROPYLON ET LES MASQUES À SUSPENDRE
Le caractère conservateur et marqué par la fidélité à la tradition théâtrale hellénique desmasques du propylon du Sébasteion va de pair avec le traitement détaillé et minutieux,presque miniaturiste, des caractéristiques de chaque personnage. Nous avons vu que ce stylecaractérise souvent les masques décoratifs ornant la vaisselle196 et les éléments de mobilier197
d’époque augustéenne provenant en particulier des villes vésuviennes. Les auteurs du derniercatalogue de représentations liées au théâtre comique198 soulignent du reste les liens étroitsentre le secteur égéen et la Campanie du point de vue de cette imagerie tardo-hellénistique,
74 Nathalie de Chaisemartin
195. Ciancio Rossetto, loc. cit., 1982, p. 43-44.196. S. Tassinari, Pots à anse unique, Étude du décor
des anses d’un type de récipient en bronze d’Herculanumet de Pompéi, Cronache Pompeiane, I, 1975, p. 190-203 ;ead., Il vasellame bronzeo di Pompei, Rome, 1993, p. 218-219.
197. Brasero de la maison du Faune à Pompéi, dont lacuve est ornée de trois masques (courtisane entre deuxÉros) sur ses longs côtés : E. Pernice, Gefässe und Geräte
aus Bronze (Die hellenistische Kunst in Pompeji), IV, Berlin,1925, p. 4, fig. 5, p. 5 ; N. Valenza, Le lucerne di bronzodel Museo di Napoli, dans A. Carandini éd., L’ins-trumentum domesticum di Ercolano e Pompei nella prima etàimperiale (Quaderni di cultura materiale, 1), Rome, 1977,p. 157-161, pl. LXX,1-2 ; E. De Carolis, Ercolano e Pompei,Arredi e oggetti di antiche dimore vesuviane, Portici, 2000,p. 24, 38-45, 74.
198. Webster-Green-Seeberg, op. cit., I, p. 63.
dont le répertoire de motifs dionysiaques était décliné dans tous les domaines de l’artisanatartistique.
Nous avons noté, par exemple, des correspondances assez précises entre les masques dupropylon et ceux qui décorent le Vase Lante provenant de la Villa Hadriana199. Ce vase de1,77 m de hauteur portait sur l’épaule des reproductions, hautes d’une trentaine de centi-mètres, de masques du drame satyrique, malheureusement très restaurées. Il donne une idéedes séries de masques accrochés aux murs ou suspendus par des chaînes dans les entrecolon-nements des portiques bordant les jardins-péristyles des riches demeures tardo-républicaines.Comme l’a montré H. U. Cain200, ils font partie des accessoires à la mode qui transforment cesjardins intérieurs en sanctuaires dionysiaques champêtres, évoquant une ambiance idylliqueaux connotations « rétro » liées à la pietas rustique de l’Âge d’or201. En terre cuite ou en marbre,ils sont plus fragiles que les médaillons suspendus (oscilla) et les pinakès quadrangulaires fixéssur des colonnettes, et se sont conservés en moindre nombre : ils n’ont fait l’objet d’aucuneétude comparable à celles qui ont été menées sur les oscilla et les pinakes à reliefs.
Des masques en marbre ont été retrouvés dans les demeures de Campanie, en particulierdans la Casa degli Amorini dorati à Pompéi202. À Sperlonga203, une série de masques provenantde la villa de Tibère a été considérée comme de fabrication rhodienne, sans doute par assimila-tion avec les groupes sculptés de la grotte. Le péristyle de la maison de la rue des Farges àLyon204 a livré un lot de masques à suspendre en terre cuite qui semble se rattacher au réper-toire traditionnel de l’atellane.
Or le trou de suspension à l’oreille du masque PS E2 tendrait à suggérer que certains desmasques du propylon pourraient dériver de modèles de masques à suspendre. Comme l’ontbien démontré les recherches de S. Besques, plusieurs ateliers de coroplathes en produisaienten Asie Mineure à la période tardo-hellénistique, par exemple à Smyrne205, à Tarse206 et sur-tout à Amisos (Samsun)207 dont on conserve au Louvre une série représentative. L’atelierd’Amisos est actif depuis le début du IIe siècle jusqu’à 72 av. J.-C. où la destruction de la citéralentit la production. Les masques figurant des personnages du thiase dionysiaque ont unmodelé particulièrement expressif, et semblent utiliser des cartons de tradition pergamé-nienne, en particulier celui du Marsyas (D 514) et du jeune Pan en colère (D 518, moule) quel’on retrouve sur la frise du propylon. Les masques comiques de la courtisane D 509 et d’unjeune premier D 510 sont d’assez grande taille (17 à 20 cm) et présentent un modelé très acci-denté du visage qui leur donne une expression vivace.
La frise ionique à masques scéniques du propylon du Sébasteion d’Aphrodisias 75
199. Sa datation du Ier quart du IIe siècle, fondée sur saprovenance, devrait être reconsidérée, surtout en raison desgoûts d’antiquaire de l’empereur Hadrien.
200. Cain, loc. cit., p. 162-165 sq.201. G. Sauron, Quis deum ? (BEFAR, 285), Pa-
ris / Rome, 1994, p. 710-711, p. 588-589 et 711.202. Seiler, op. cit., p. 120, fig. 205-208 ; Cat. no 10,
fig. 560 ; 30, fig. 535 ; 32, fig. 601-602 ; 33, fig. 600 ; 34,fig. 603-604-607 ; 36, fig. 608.
203. G. Jacopi, L’antro di Tiberio a Sperlonga (Monumentiromani, IV), Rome, 1963, p. 147-149, fig. 144-147.
204. A. Desbat, Masques gallo-romains en terre-cuitetrouvés à Lyon, Figlina, 2, 1977, p. 19-32.
205. Besques, op. cit., III, 1972, p. 250, no E/D 1970,pl. 324 d ; p. 253, no D 2006, pl. 328 a et 2007, pl. 328 e ;p. 255, no D 2023, pl. 329 b et 2026, pl. 329 h.
206. Ibid., p. 352, no E/D 3027, pl. 435 e ; no E/D 3028,pl. 433 f ; no E/D 3029, pl. 433 d.
207. Ibid., p. 83-87, nos D 494, 496-502, 507-510,pl. 107-111 ; Webster-Green-Seeberg, op. cit., II, Cata-logue, p. 210, no 3 DT 68-69-70.
On trouve, parmi les rares masques à suspendre en marbre publiés, des modèles assezvoisins : certains des masques de la Casa degli Amorini dorati, en particulier ceux de la petiteservante ou Ménade et du jeune satyre208, rappellent d’assez près le caractère naïf et pitto-resque des masques de l’atelier d’Amisos. Le musée d’Ostie conserve des fragments de mas-ques à suspendre209 taillés dans un marbre blanc très comparable à celui des carrièresd’Aphrodisias : le modèle d’un satyre rappelle précisément les masques d’Amisos D 514à D 516 du Louvre. Un fragment de tête de Pan aux caractéristiques voisines est conservé aumusée de Carthage210. Ces masques présentent un degré de précision dans le rendu et unefinesse de style qui les rapproche des masques du propylon.
Sur le site même du Sébasteion, une des fausses bases à guirlandes du portique Nord quisupportaient des figures allégoriques des peuples de l’empire porte un masque de jeune Noir(fig. 20) coiffé de bouclettes, censé évoquer le peuple nubien ou maurétanien. Le motif estproche de celui des têtes d’Africains ornant la patère d’or du trésor de Panagjuriste211. Bienque les représentations d’esclaves noirs fassent plutôt partie des grotesques hellénistiques quedes masques scéniques proprement dits, on a retrouvé à Aphrodisias212 un masque de terrecuite présentant une calotte crânienne développée et dont le visage est très proche de celui dumasque du portique septentrional du Sébasteion.
Comme l’a très justement souligné S. Besques213, les transferts de motifs sont monnaiecourante entre sculpture et coroplathie à l’époque hellénistique et sous l’Empire. Unerecherche pourrait être lancée pour vérifier, à travers l’analyse des marbres utilisés, si certains
76 Nathalie de Chaisemartin
20. Bloc d’une fausse base du pseudo-portique Nord du Sébasteion :Masque d’Africain.
208. Dwyer, loc. cit., p. 266-267, cat. no 21, pl. 94,et 22, pl. 95,3 ; Seiler, op. cit., cat. no 32-36.
209. Musée d’Ostie, réserve, Balcon, Paroi D, travée 4,no 14449.
210. Musée de Carthage, inv. 653.211. D. Zoncev, Der Goldschatz von Panagurischte, Ber-
lin, 1959 ; Id., The Gold Treasure of Panagurishte,
Archaeology, VIII, 1955, p. 218-227 ; J. Meyer-Petit,I. J. Venedikov, Découverte de l’art thrace, Trésors des muséesde Bulgarie, Cat. expo. Paris, mai-août 1974, no 325, Mus.arch. de Plovdiv no 3204 ; P. Zasoff et al., Zur thrakischenKunst im Frühellenismus, AA, 1985, 4, p. 595 sq., fig. 1 a.
212. Erim, op. cit., p. 152.213. Besques, loc. cit, p. 71-81.
masques à suspendre en marbre auraient pu être produits par les ateliers d’Aphrodisias dans lapremière moitié du Ier siècle apr. J.-C., d’après des modèles diffusés parallèlement par les ate-liers de coroplathes d’Asie Mineure.
La volonté de reproduire des modèles de masques liés à la tradition attique dansl’optique de s’insérer dans la tendance « rétro » de la décoration d’époque augustéenne214
expliquerait le modelé raffiné des masques du propylon et le caractère classicisant de la plupartd’entre eux : masques tragiques à onchos et anglaises calamistrées, jeunes gens portant la sté-phané de mèches lissées en arrière.
Le problème de l’origine des modèles de la frise du propylon du Sébasteion est évidem-ment compliqué par la circulation intensive, entre les centres d’artisanat artistique du mondeméditerranéen, des modèles de masques utilisés pour l’ornementation du décor mobilier. Lemodèle athénien étant la référence majeure de l’art augustéen, il est clair que le caractère tradi-tionnel des masques du propylon aphrodisien traduit la volonté du commanditaire de s’inscriredans les tendances légitimées par l’art aulique de Rome.
AUTRES BLOCS DE FRISE À MASQUESDÉCOUVERTS À APHRODISIAS
Il faut peut-être mettre en rapport avec la frise du propylon du Sébasteion un bloc de friseà masques sans architrave trouvé hors contexte (fig. 21) et dont le mode d’exécution et le styledes masques est assez voisin. Il comporte une moulure supérieure à ovolo et deux masques :celui de gauche figure un jeune premier tragique avec un onchos aux anglaises calamistrées ;celui de droite, une nourrice de tragédie portant la coiffe courte caractéristique. Les propor-tions du bloc et des masques sont analogues à celles de la frise du propylon, malgré l’entraxeplus grand de ces derniers. Peut-être la frise à masques se prolongeait-elle sur le mur en retourOuest du portique Nord, mais il pourrait s’agir aussi de l’unique élément survivant d’une autrefrise de même modèle.
D’autres blocs de frise hors contexte reprennent le modèle à moulure supérieure en ovololisse souligné d’un fin listel et pourraient dater de l’époque sévérienne. Deux blocs de facturevoisine, avec des masques aux yeux largement percés au trépan, ont une hauteur de 0,28 m.Le premier, provenant du Nord-Est du temple, porte une tête d’Héraclès couronné d’unebandelette et un médaillon de Méduse (fig. 22) ; le second porte un masque de Silène barbu etsouriant. Un autre Silène, accompagné d’un masque aux joues rondes, orne un bloc de hau-teur analogue, trouvé au pied de la muraille Sud. Du même secteur provient un second bloc
La frise ionique à masques scéniques du propylon du Sébasteion d’Aphrodisias 77
214. Webster-Green-Seeberg, op. cit., I, p. 68, souli-gnent l’ « antiquarian interest » pour les masques de la co-médie ancienne et moyenne à l’époque julio-claudienne.
21. Bloc de frise à masques : héros tragique, nourrice. Musée d’Aphrodisias.
22. Bloc de frise à masquesprovenant de la cour orientale du temple d’Aphrodite : Héraclès, Gorgone.
23. Bloc de frise à masque de Tyché. Musée d’Aphrodisias.
24. Bloc de la frise du « Portique de Tibère » PT 118 à têtes miniaturistesproches des masques du propylon du Sébasteion.
avec un masque ébauché d’hétairidion ôraion coiffé d’un nœud de mèches et d’anglaises enca-drant les joues. Un bloc conservé au musée montre également une tête de Tyché au visagedissymétrique, coiffée d’un voile et d’une couronne tourelée (fig. 23).
Une dernière série, haute de 0,33 m, comprend deux blocs portant des masques, en par-ticulier des satyres d’un schématisme caricatural qui rappelle le mode d’exécution des blocsquelque peu bâclés, mais pas nécessairement tardifs, de la partie méridionale de la BasiliqueSud-Ouest. Enfin, un fragment de bloc à tête féminine était réemployé dans la muraille auSud-Est du site.
Pourtant, malgré son succès à Aphrodisias, le décor de masques sans motif de liaisonreste rare dans l’Asie Mineure impériale. On peut seulement citer dans l’état actuel desdécouvertes un bloc de frise hadrianique réutilisé dans la basilique E1215 de Sagalassos, quiporte une série espacée de petites têtes de divinités : Marsyas, Satyre, Amazone et deux têtesjoviennes.
LA DATATION DE LA FRISE DU PROPYLON DU SÉBASTEION
Pour caler chronologiquement la frise du propylon, il est capital de comparer le travail desartisans – particulièrement les « mains » identifiables – à celui des exécutants des autres frisesà têtes et masques d’Aphrodisias. Les masques se situent indubitablement dans le style,influencé par les représentations toreutiques, des masques de la frise ionique du théâtre, maissont évidemment postérieurs à la disparition d’Auguste.
Une comparaison avec les masques et les têtes de personnages scéniques de la friseNord du « Portique de Tibère » (première phase du complexe, datée par sa dédicace entre 14et 27 apr. J.-C) montre que les masques du propylon en diffèrent notablement par leur fidélitéaux modèles helléniques, voire athéniens, remontant pour certains à la période hellénistiqueprécoce, celle de l’Ancienne Comédie : on peut cependant les rapprocher de quelques blocsde l’extrémité Est de son aile Nord montrant des têtes plus petites, traitées dans un style naïf.Soit elles appartiennent à la période finale de la construction (blocs des entraxes 3à 5 PT N 124-126), soit plus probablement à des compléments apportés lors d’une premièrerestauration attestée par les colonnes inscrites de Claudia Antonia : ces blocs PT N 92-93 secaractérisent par des têtes petites et ramassées avec le bas du visage plus carré, ce qui les rap-proche nettement des masques du propylon. Certaines sont exécutées d’une manière très voi-sine, par exemple le jeune satyre aux mèches en soleil du bloc PT N 118 (fig. 24), et l’ondoit se demander si les sculpteurs des têtes du propylon n’auraient pas également travaillé à
La frise ionique à masques scéniques du propylon du Sébasteion d’Aphrodisias 79
215. L. Vandeput, The Re-use of Hadrianic Architectu-ral Elements in Basilica E1 at Sagalassos, dans M. Wael-kens, Sagalassos, 1 (Acta Archaeologica Lovaniensia, Mono-
graphiae, 5), Louvain, 1993, p. 97-99, fig. 77. Aurait ap-partenu à un édifice dédié à Dionysos entre 115 et 125.
sculpter ces blocs. Mais le masque de divinité féminine diadémée (bloc PT N 124) estaccompagné d’autres têtes du style de l’atelier principal du « Portique de Tibère », ce quiconduit à supposer :
— soit que deux artisans au style différent ont travaillé en même temps sur ce bloc, l’artisandes masques du propylon donnant un coup de main occasionnel à ses collègues du « Por-tique de Tibère » ;
— soit que l’artisan du propylon a, lors d’une restauration, retaillé des têtes préexistantesendommagées.
Il n’est pas aisé, en revanche, de comparer les masques du propylon avec ceux qui ornentles orthostates de l’étage corinthien des portiques du Sébasteion : ces derniers étaient en effetpeu en vue et leur exécution reste au niveau de l’ébauche dans la plupart des cas. Les propor-tions et l’expression de ces masques se rapprochent beaucoup de celles des têtes ornant lesblocs de la frise Ouest et Sud-Ouest du « Portique de Tibère », datable de la période claudio-flavienne : la hâte dans l’exécution dont ils témoignent pourrait indiquer qu’ils appartiennent àla restauration du Sébasteion après un séisme ou à la phase finale de la construction docu-mentée par l’épigraphie. Quoi qu’il en soit, les masques du propylon paraissent antérieurs, parleur typologie comme par leurs proportions, à ces ébauches. Ils sont également difficiles à rap-procher des têtes « romantiques » et mouvementées des bases du portique Nord du Sébas-teion, en majorité empruntées aux modèles des Géants de l’autel de Pergame et traitées sui-vant un modelé tourmenté et vibrant. Les masques du propylon gardent au contraire la fixitéd’objets inanimés. Pourtant, la mise en œuvre du pseudo-portique Nord du Sébasteion doitêtre pratiquement contemporaine de celle du propylon, d’après leur structure et leur décorarchitectural respectifs.
L’aspect miniaturisé de ces masques très détaillés, qui devaient pourtant être vusd’assez loin, donne à penser que le propylon du Sébasteion n’a pas été construit dans la hâteou les difficultés de financement qui seraient responsables de la moindre qualité sculpturalede certains panneaux insérés dans les façades des pseudo-portiques. D’après les recoupe-ments épigraphiques216 et l’analyse des structures217, le propylon serait à situer chronologique-ment au début du règne de Tibère et avant la mort de Livie. La frise serait donc pratique-ment contemporaine de celle du « Portique de Tibère », et il n’est pas exclu que des artisans yayant travaillé soient venus ponctuellement à la rescousse de leurs collègues du monumentvoisin. Il n’en reste pas moins que le style maniériste et raffiné de ces masques montre qu’ilsappartiennent à une tradition artistique différente des autres têtes et masques aphrodisiens dedatation voisine.
80 Nathalie de Chaisemartin
216. J. M. Reynolds, The Origins and Beginning ofImperial Cult at Aphrodisias, Proceedings of Cambridge Phi-lological Society, 206, 1980, p. 70 ; ead., New Evidence forthe Imperial Cult in Julio-Claudian Aphrodisias, ZPE, 43,1981, p. 317-327 ; ead., Further Information on Imperial
Cult at Aphrodisias, dans Festschrift Pippidi, Studii Clasice,XXIV, 1986, p. 109-116.
217. Hueber, loc. cit., p. 105 ; Outschar, ibid., p. 108-109.
LA FRISE À AIGLES ET MASQUESDANS LE CONTEXTE DU SÉBASTEION
Si les masques de théâtre liés au culte dionysiaque sont devenus dans la seconde moitiédu Ier siècle av. J.-C. un thème dominant dans le domaine de la décoration de l’habitat, leurprésence peut étonner à l’entrée d’un sanctuaire officiel provincial construit pour Auguste et lagens Julia au début du règne de Tibère, d’autant qu’ils surmontent les statues et les bustes desmembres de la famille impériale disposés au rez-de-chaussée du propylon.
Évoquant la fête dionysiaque et les sanctuaires rustiques du dieu, qui formaient le décordes drames satyriques, ils illustrent l’idéologie du retour à la nature (rusticitas) et à la religionauthentique des ancêtres218, qui participe à l’imagerie du saeculum aureum.
Passant du domaine votif à celui de la philosophie, le thème des masques scéniques vaservir de support visuel à la pensée philosophique de la vie comme théâtre « skhnQ t bBoV »,liée à la tradition cynique et stoïcienne et aux suites de l’épicurisme qui firent florès à Rome auIer siècle av. J.-C.219. Les masques symbolisent dans ce contexte la dichotomie de la naturehumaine. L’idée était en germe avec les marionnettes évoquées dans le Philèbe de Platon, elleest souvent reprise par Cicéron et plus tard par Sénèque qui évoque l’ « humanae vitaemimus ». Après avoir bien joué sa partie dans le théâtre de la vie, sans perdre cependant ledétachement et l’impassibilité du sage devant l’adversité220, l’âme se libère par la mort etrejoint sa patrie céleste221. Très à la mode à la fin de l’époque hellénistique222, ce thème estrepris dans ses dernières paroles par Auguste, d’après Suétone223 et Dion Cassius224.
Le propylon étant dédié à Auguste divinisé et à ses successeurs, le choix de ce motif déco-ratif, rare en contexte public en dehors des théâtres, peut peut-être s’expliquer par l’évocationde ses derniers moments et, à travers le motif de l’aigle, de son apothéose.
Remarquant sur la frise du propylon des masques d’Héraklès et de Dionysos qui fontécho aux reliefs des portiques représentant des épisodes de la légende de ces demi-dieux admisdans l’immortalité des Olympiens, J.-Ch. Moretti225 propose, comme l’avait fait G. Sauron àpropos des sculptures de la Villa des Papyri à Herculanum226, de voir dans l’ensemble ducomplexe du Sébasteion l’évocation d’un « jardin des Bienheureux ».
Sans aller si loin, rappelons l’utile mise au point de H. U. Cain227 sur le contenu idéolo-gique des reliefs aux masques dans l’imagerie du début de l’Empire. Symboles de victoire dans
La frise ionique à masques scéniques du propylon du Sébasteion d’Aphrodisias 81
218. P. Zanker, Pompeji : Stadtbild und Wohngeschmack(Kulturgeschichte der antiken Welt, 61), Mayence / Rhin,1995, p. 24 sq., 175.
219. M. Gigante, Civiltà delle forme letterarie nell’anticaPompei, Naples, 1979, p. 115-120.
220. Ibid., A. Allroggen-Bedel, op. cit., p. 66 sq.221. Sauron, op. cit., p. 380-388.222. Ibid., p. 712.
223. Suétone, Vies, Divus Augustus, XCIX, éd. H. Ail-loud, Paris, Les Belles Lettres, 1931, p. 146.
224. Dion Cassius, LVI,4, cité par Gigante, op. cit.,p. 116.
225. Moretti, loc. cit., p. 216.226. G. Sauron, Templa serena, Contribution à l’étude
des comportements aristocratiques romains à la fin de laRépublique, MEFRA, 92, 1980, 1, p. 277-301.
227. Cain, loc. cit., p. 182 sq.
les concours panégyriques et liés aux trêves imposées par les festivités religieuses, ils sont, dansce contexte, souvent mis en pendant avec des thèmes triomphalistes évoquant la victoire mili-taire228 : « Das Motiv ist ein Zeichen für die Befriedung des orbis terrarum durch Rom ». Lethème apparaît du reste à Rome avec les jetons de pâte de verre229 probablement distribués lorsdes Ludi Victoriae Caesaris de 44 organisés par Octavien après la mort de César. Les masquesscéniques y figurent avec des pavots et des épis, des cornes d’abondance et des étoiles évo-quant le sidus Julius230. Les masques de théâtre paraissent ainsi associés aux prémices du règnepacifique d’Octavien-Auguste aussi bien qu’à sa fin, et rendent hommage à son œuvre enfaveur de la paix.
Le décor du propylon du Sébasteion apparaît en ce sens comme un manifeste de fidélitéenvers le pouvoir impérial romain, mais aussi envers la culture hellénique, et se place dans ledroit fil de la thématique idéologique augustéenne.
Nathalie de CHAISEMARTIN,Université de Paris IV - Sorbonne,
2, rue de Poissy,75005 Paris.
E-mail : [email protected]
82 Nathalie de Chaisemartin
228. Ibid., p. 187.229. M.-L. Vollenweider, Musée d’art et d’histoire de Ge-
nève, Catalogue raisonné des sceaux, cylindres, intailles et ca-
mées, II, Les portraits, les masques de théâtre, les symbolespolitiques, Mayence / Rhin, 1979, p. 207 sq.
230. Cain, loc. cit., p. 188-189.