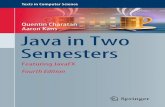La collégiale royale de Saint-Quentin et la musique
-
Upload
univ-tours -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of La collégiale royale de Saint-Quentin et la musique
David Fiala
La collégiale royale
de saint-quentin et la musique
Àun peu plus de cent cinquante kilomètres au nord de Paris, saint-quentin se trouve au centre d’un triangle formé par trois grandes cathédrales distantes de moins de cinquante kilomètres : Cam-
brai au nord, noyon au sud-ouest et Laon au sud-est. un peu plus loin, reims, à l’est, et Amiens, à l’ouest, sont à moins de cent kilomètres, et à peine plus pour Lille, au nord. Au cours du Moyen Âge, forte de cette situation géographique, de l’in-dustrie drapière de la ville et de la vénération pour son saint patron, la collégiale de saint-quentin devint un important chapitre de soixante-douze chanoines. Les immenses dimen-sions de l’église construite à partir du Xiiie siècle témoignent de son développement et de sa richesse. Grâce à l’appui direct de la monarchie et à sa place au cœur d’un réseau d’églises dans lesquelles la pratique musicale connut un intense déve-loppement du Xiiie au XViie siècle, cette église est de celles auxquelles furent attachés les plus illustres noms de musiciens de ces époques, en l’occurrence cinq compositeurs majeurs de la fin du Moyen Âge et du début de l’époque moderne : Guillaume de Machaut et Philippe de Vitry au XiV e siècle, puis Loyset Compère, Jean Mouton et Josquin desprez au début du XVie siècle. une liste aussi prestigieuse a très tôt retenu l’attention des historiens de la musique, si bien que, dès 1851, l’historien local Charles Gomart publiait, avec l’aide du musicographe belge François-Joseph Fétis, une synthèse sur « la maîtrise de l’église de saint-quentin et sur les célébri-tés musicales de cette ville » (Gomart 1851). Le musicologue Félix raugel réactualisa, vérifia et compléta cette étude dans un article offert en 1961 à heinrich besseler, alors le plus
grand expert en matière de musique du XV e et du début du XVie siècle (raugel 1961). Ces travaux ont réuni une grande partie des informations disponibles, avant tout tirées d’ou-vrages de seconde main.en effet, depuis la destruction des archives du chapitre de saint-quentin au cours d’un incendie survenu en 1669, l’histoire de l’église repose principalement sur des recherches entreprises dans la première moitié du XViie siècle par deux chanoines de la collégiale : Claude hémeré (1574-1650) et quentin de La Fons (vers 1591-1650). Le premier, qui fut bibliothécaire de la sorbonne entre 1638 et 1646, où il fut notamment chargé de cataloguer la bibliothèque du car-dinal de richelieu, publia deux ouvrages sur l’église de saint-quentin à dix ans d’intervalle (hémeré 1633 et 1643). Le second, chanoine de l’église, avait mis en chantier une Histoire du Vermandois qu’il dut se résoudre à limiter à une histoire de la ville saint-quentin, suivie d’une histoire de l’église de saint-quentin. il légua ses volumineux manus-crits à son neveu, Claude bendier, également chanoine de l’église, avec l’espoir que le chapitre soutiendrait leur publi-cation, mais ils demeurèrent à l’état manuscrit jusqu’à ce que Charles Gomart les édite, en trois tomes parus en 1854 et 1856 (La Fons 1649, date approximative de la fin de la rédaction des manuscrits, disparus depuis). sur cette base, bendier rédigea tout de même des mémoires dont les titres révèlent l’objectif de tous ces travaux : Défense des principales prérogatives de la ville et de l’Église royale de Saint-Quentin en Vermandois, par laquelle il est clairement justifié que cette ville est l’ancienne Auguste de Vermandois, et son église le siège
Labyrinthe à l’entrée de la basilique, vers 1495.saint-quentin, basilique.1
189
La c
ollé
gial
e ro
yale
de
sain
t-que
ntin
et l
a m
usiq
ueDa
vid
Fiala
primitif des évêques de ce diocèse (1671), ou encore : L’Église de Saint-Quentin en Vermandois, originairement épiscopale et royale de fondation, toujours maintenue dans les droits de juri-diction ordinaire contre les évêques de Noyon.toutes ces recherches, à commencer par celles d’hémeré − et jusqu’à une dernière synthèse encore publiée en 1772 par le chapelain de saint-quentin Louis-Paul Colliette (mort en 1786 ; Colliette 1772) −, furent en fait menées en concur-rence directe avec celles de Jacques Le Vasseur sur la cathédrale de noyon, chaque auteur cherchant à défendre la primauté de son église sur sa voisine et rivale. Cette concurrence omni-présente transparaît sous la plume de ces auteurs jusque dans leur évocation du service divin. Alors que Le Vasseur traite de ce sujet en commentant le (prétendu) proverbe « noyon bien sonnée, noyon bien chantée » (voir l’article « noyon »), les historiens de saint-quentin relatent une anecdote précise : séjournant à saint-quentin à la fin de l’année 1597, le cardinal et légat pontifical Alexandre de Médicis, futur pape Léon Xi, alors en mission diplomatique, aurait tant apprécié les offices auxquels il assista qu’il demanda à célébrer lui-même la grand messe de noël ; comme le relate, entre autres, Colliette :
l’extrême décence surtout, avec laquelle le Clergé de cette capitale faisait ses offices, le frappa ; il en loua hautement les ministres et disait avec admiration aux seigneurs de sa suite : “dans cette ville auguste, je n’entends partout que le chant des prières ou le son des cloches qui y appelle”. Urbs ista aut semper cantat, aut semper pulsat. (Colliette 1772, t. iii, p. 327 ; l’introduction de cet ouvrage revient longuement sur la rivalité entre Le Vasseur et hémeré, voir t. i, p. iii-viii).
La proximité entre cette formule : « cette ville est toujours soit en train de chanter, soit en train de sonner », et le proverbe allégué par Le Vasseur laisse supposer quelque plagiat. on ne sait lequel des érudits de noyon ou saint-quentin osa, dans ce cas, copier son collègue, mais dans l’ensemble, les écrits saint-quentinois sont d’une précision supérieure à ceux de Le Vasseur, qui semble avoir rédigé son livre avec l’intention de « doubler » son collègue hémeré. en 1633, alors que parais-saient les vastes Annales de Le Vasseur, hémeré publia une « table des doyens et principales personnalités de l’église de saint-quentin », un opuscule de 170 pages qui est en fait une liste chronologique sommairement commentée des chanoi-
nes les plus connus de l’histoire de l’église. son livre de 1643 replace cette « histoire de l’église par ses hommes illustres » au sein d’une trame d’histoire institutionnelle du chapitre, fondée sur une documentation assez riche, souvent citée en intégralité. Malgré la rigueur et le souci d’exactitude qui guident globalement Claude hémeré, mais aussi son conti-nuateur, quentin de La Fons, leurs informations souffrent d’indéniables limites, parfois émaillées d’erreurs manifestes qui, comme on le verra, ne simplifient pas la tâche de l’his-torien. Mais une fois soumis à une critique attentive, ces travaux s’avèrent d’une précieuse richesse d’information et permettent de reconstituer la vie musicale à saint-quentin avant le XViie siècle avec une précision finalement assez rare pour ce genre d’institutions.
Le chapitre et son personnel musical
À l’image de l’église qui l’abritait, le chapitre de saint-quen-tin était de vastes dimensions. Comme le rappelle La Fons, à la fin des années 1640 :
les Chanoines étoient anciennement 72 en nombre, réduits à présent à 60 ou environ, outre lesquels il y a 12 Chanoines de sainte-Pécinne, 8 Curés des paroisses dépendantes de laditte eglise et 80 Chapelains qui ont droit de séance dans ce chœur, sans les ruyers, Vicaires et enfants de chœur, de sorte que le tout peut revenir à près de 180 personnes de divers ordres, lesquels se trouvant assemblés pour la plus grande partie forment un clergé le plus beau qu’il se puisse voir en aucune autre eglise de France (La Fons 1649, t. i, p. 230 ; desgranges 2003, p. 116, indique qu’à la veille de la révolution, les chanoines étaient au nombre de quarante-quatre).
La Fons isole ici clairement, après les chanoines et chape-lains, le personnel musical de l’église : les « ruyers, vicaires et enfants de chœur » qu’il estime ici à une vingtaine de person-nes et auquel il consacre un chapitre entier un peu plus loin (La Fons 1649, t. i, p. 263-268).Les « ruyers », que les documents orthographient plus sou-vent « ruiers », parfois « ruriers » − en latin, ruarius, i −, étaient une dénomination particulière à saint-quentin, remontant à un ancien office unique qui s’était transformé avec le temps en une pluralité d’offices réservés à des chantres, comme l’explique La Fons :
190
Par succession de tems, le nombre s’en est tellement aug-menté qu’il y en a eu jusques à huit […] A présent, ruïers sont proprement, comme les vicaires, des chanoines pour faire l’office que les chanoines fesoient anciennement ; aussi ont-ils leur séance dans tout le milieu du chœur avec les Chanoines, dans les hautes chaires, et tous sont obligés de commencer les heures, chacun leur semaine, chanter les messes des obits ordinaires qui ne sont pas annuels, et porter la chape pour faire les offices d’incepteurs aux grands doubles (Idem, op. cit., p. 264).
Ces ruiers, dont seuls quelques rares noms sont connus et aucun pour avoir fait une carrière musicale (oudart Chébert, Jean Verricus, Jean Aninus, robert descaures et rassin Lanchart au début du XV e siècle ; Idem, op. cit., p. 265-266), formaient donc un groupe à part, en sus des vicaires-chantres qui, comme dans toutes les églises, assuraient le quotidien des célébrations chantées. une charte du début du XViie siècle qui a échappé à l’atten-tion des musicologues donne des détails sur les difficultés que connaissait alors le chapitre (après la prise de saint-quentin par les espagnols en 1557 puis les troubles de la Ligue) pour financer ces chantres, et confirme le rôle important qu’ils jouaient dans les célébrations. Par cette charte de janvier 1602, le roi henri iV autorise un des chanoines (qui sont alors, apprend-on, au nombre de soixante-quatre) à se démettre de sa prébende afin de transférer son revenu au rétablissement de deux ruiers que le chapitre ne parvenait plus à rémunérer (voir texte ci-contre). en échange de cette autorisation, le chapitre s’engageait à célébrer annuellement une messe solennelle le 28 septembre, jour de la naissance du dauphin. L’épi-taphe du chanoine en question indique qu’il mourut quelques jours après (« Cy-git aussi noble et scientifique personne, Me bon de sons, vivant prêtre, Chanoine de céans, Prince, seigneur et Vicomte de Gily, décédé le 13e jour de janvier 1602 » ; La Fons 1649, t. i, p. 96) ; la décision de supprimer sa prébende avait donc été prise, comme souvent dans ce genre de procédures, sur son lit de mort.
Charte du roi Henri IV autorisant la suppression d’une prébende de chanoine pour l’affecter à l’entretien de deux ruiers (vicaires-chantres), janvier 1602.(Ad de l’Aisne, b 2891)
henry par la grace de dieu roy de France et de navarre, a tous presens et advenir salut. Comme de tous temps pour la decoration et entretenement du divin service en l’eglise collegialle de sainct quentin en Vermandois les doyen, chanoine [sic] et chappittre eussent ordonné et estably quatre ruiers aux despens dudit chappittre, mais leur defaillant les moiens de leur entretenement a l’occasion des troubles et de la diminution de leur revenu, ils en auroient [sic] retranché douze [sic, manifestement pour deux] tellement qu’a present il n’y en a que deulx ; surquoy nostre cher et bien amé maistre bon de sons, chanoine prebendé de ladite eglise considerant que ladite eglise est l’une des plus grandes et mieulx fournie de ce royaume tousjours par cy devant regie, conduicte et gouvernée par personne entendues [sic] en musiques [sic], plain chant et ceremonies [longue rature] accoustumé d’estre gardees au cueur pendant le divin service et combien elle est aujourd’huy descheue de cette premiere splendeur par la diminution desdits deux ruiers, considerant aussy la necessité dudit chappittre et que, par les ruynes et miseres passeez qu’il a souffertes durant les dernieres guerres, il est reduict a telle extremité que les plus aisés chanoines sont aujourd’hui bien empechez de vivre et continuer leur divin service, icelluy bon est resolu de se deffaire et despouiller de sa prebende pour, avec nostre permission et consentement, en estre le revenu emploié a l’entretenement desdits deux ruiers, lesquelz, auparavant lesdits troubles, lesdits de chappittre y avoient entretenus charitablement […] pour la decence de leur eglise et ediffication de ceux qui devottement y abordent de touttes partz ; nous requerant ledit de sons voulloir accepter la rezination qu’il a faicte en noz mains de sadite prebende […] Attendu mesmes qu’il reste encorre en ladite eglise soixante quatre chanoine et qu’au lieu d’ung, il sera entretenu deux ruiers qui assiste [sic] et sont ordinairement a tout le service divin ; A la charge d’estre encores par chacun an celebré par les chanoines d’icelle eglise leur messe solemnelle pour la prosperité de notre treschier espouze la royne, du daulphin nostre treschier filz et de noz successeurs a l’advenir, le 28e jour de septembre jour et feste de saint Cosme, de saint damien et de la naissance nostre treschier filz le daulphin.A ces causes nous inclinant liberallement a la requeste et instante supplication que nous a faict maistre estienne de bellongne [boulogne], nostre conseiller et aumosnier ordinaire et doyen de ladite eglise, et dudit maistre bon de sons, chanoine en icelle, […] avons la resignation d’icelle prebende faicte en noz mains a l’intention que dessus approuvee et approuvons par ces presentes et […] voullons que les fruictz et revenus d’icelles soient affectez et doresnavant emploiez a la nourriture, sallaire et entretenement desdits deux ruiers ordonnez pour tenir le cœur de ladite eglise et lesquelz entendons y estre remis pour tousjours ; […] donné a Paris ou mois de janvier l’an de grace 1602 et de nostre regne le treiziesme.
191
Davi
d Fia
la
Cette charte semble indiquer que les ruiers étaient habituel-lement au nombre de quatre à la fin du XVie siècle, mais ils n’étaient pas les seuls chanteurs adultes au service de l’église. La Fons poursuit son évocation du personnel de l’église en ces termes :
Pour ce qui est des Vicaires, je ne crois pas que leur nombre ait été jamais limité, de sorte qu’il y en a eu tantôt plus, tantôt moins, selon les occasions qui se sont présentées et qui ont fait que souvent il s’en est trouvé jusqu’à dix et douze (Idem, op. cit., p. 266).
Les informations à leur sujet sont encore plus lacunaires que pour les ruiers. À la suite de la charte d’amortissement citée à l’instant, henri iV procéda quatre ans plus tard, en 1606, toujours sur le conseil de son aumônier Étienne de boulogne, doyen de l’église, à la suppression de deux autres prébendes qui furent affectées au revenu de quatre vicaires (Colliette, t. iii, p. 430-431). C’est là l’unique acte connu qui traite spécifiquement du financement des vicaires. Mais si, contrairement à bien d’autres églises, aucune trace de bulles pontificales réservant des revenus ou des bénéfices à l’entretien de vicaires-chantres n’a été retrouvée, une bulle datant de la fin du XiV e siècle, comme nombre des docu-ments de ce type, présente une procédure très voisine. Cet acte promulgué par benoît Xiii, qui avait été élu pape à Avi-gnon en 1394, au moment du schisme avec rome, réserve six chapelles aux anciens enfants de chœur de l’église. Voici le résumé que donne Colliette de la création de ces « cha-pellenies choriales » :
on doit aux soins du coûtre Jacques Kieret l’amortissement que fit benoît Xiii de six chapellenies de l’église de saint quentin aux enfans-de-chœur de cette basilique. Cet Anti-pape n’avoit pas encore été rejeté universellement en France, en l’année 1405. Ce ne fut que trois ans après qu’il y fut totalement abandonné. Le motif des chanoines, qui s’étaient concertés entr’eux et qui avoient demandé à Avignon la grace dont on parle, étoit fondé sur de très légitimes raisons. il leur paroissoit injuste que des enfans, qui avoient passé plusieurs années de leur plus tendre jeunesse dans l’étude pénible de la musique & du chant, n’eus-sent point d’autre récompense que le mérite de leurs peines. Le chapitre, d’autre part, épuisé par les dépenses immenses de la
construction de son église, ou par celles du culte divin, n’étoit pas en état de les récompenser à ses frais et ne prévoyoit point qu’il pût le faire plus facilement dans la suite. Ces considéra-tions, présentées à benoît Xiii, en furent favorablement reçues ; il réserva spécialement et uniquement pour les enfans qui auroient servi au chœur de saint quentin six chapellenies dont il énonce personnellement les titulaires actuels, sans qu’aucun clerc pût désormais prétendre à les obtenir, ni que les chanoi-nes pussent l’en pourvoir et pourvu qu’elles fussent du revenu de vingt livres tournois, somme considérable en ce temps, sans laquelle on ne pouvoit obliger un titulaire à résider. Ces béné-fices ont été depuis appelles chapellenies choriales […]. Mais, soit qu’à ces six chapellenies on en ait encore ajouté d’autres dans la suite, que l’on auroit pareillement réservées, soit qu’on les ait divisées en différentes portions, elles sont maintenant au nombre de sept. La bulle de benoît procura plus d’un avantage aux chanoines de saint quentin : outre qu’elle leur mettoit en mains un moyen toujours assuré de récompenser, sans qu’il leur en coûtât rien, leurs enfans-de-chœur, elle attacha encore ceux-ci au service de l’église par la suite et après surtout qu’ils auroient été pourvus des chapellenies réservées : car ce Pape ordonne que les titulaires de ces chapellenies seront obligés de résider dans leurs bénéfices et de servir dans l’église de saint-quentin. […] un dernier avantage qui revenoit au chapitre, c’est que par cette réserve le culte divin devenoit plus respecta-ble en son église, puisque le chant devoit être réglé et soutenu et les cérémonies observées par des personnes qui y avoient été dressées dès leur plus bas âge. (Colliette 1772, t. 2, p. 149-150, d’après hémeré 1633, p. 137 et hémeré 1643, p. 303-305)
en additionnant les ruiers et les vicaires, le nombre d’adultes chargés du chant à saint-quentin semble avoir été plutôt supérieur à ce qu’il était dans les églises comparables. Le seul document concernant le financement des vicaires montre au passage que le chapitre, en réservant des revenus de cha-pelains à ses anciens enfants de chœur, avait élaboré une politique de conservation des chanteurs qu’il formait. Les noms de tous ces officiers subalternes n’ont cependant guère retenu l’attention des anciens historiens du chapitre, plus occupés d’« hommes illustres » susceptibles de faire briller le nom de leur église.de même que les vicaires et ruiers de saint-quentin sont attestés en nombre relativement important à une date assez
La c
ollé
gial
e ro
yale
de
sain
t-que
ntin
et l
a m
usiq
ue
192
précoce, la maîtrise est citée dès avant 1400. Le chapitre organisa d’abord un collège de douze bons-enfants, fondé dès 1303 pour assurer un enseignement général à des enfants de la région (hémeré 1643, p. 261-263 ; La Fons 1649, t. 1, p. 390-394). Mais la première mention d’enfants de chœur proprement dits, participant aux offices et apprenant le chant et la musique en plus de leur formation générale, date de la fin du XiV e siècle. hémeré indique, à la suite d’une citation concernant l’année 1367, que le chanoine Pierre de Pacy avait légué « peu avant » quatre-vingts couronnes d’or à l’église pour sa fondation commémorative, qui furent employées pour la reconstruction de la maison des enfants de chœur en 1396 (hémeré 1643, p. 296 : « Petrus de Paciaco, consiliarius regis, decanus parisiensis et canonicus s.q. paulo ante legaverat eisdem ecclesiae 80 coronas auri pro anniversario fundando, quibus schola cantus sive domus symphoniacorum puerorum in integrum restituta est, anno 1396 »). de ce paragraphe un peu confus au plan chronolo-gique, il faut sans doute comprendre que le legs de Pacy date de « peu avant » 1396, et non de 1365 (Gomart 1851, p. 217) et encore moins 1356 (raugel 1961, p. 52, d’après hémeré 1633, p. 123). Conseiller du Parlement de Paris à partir de 1369, Pacy ne devint doyen de notre-dame de Paris qu’en 1385 et mourut en 1402. qu’il ait prévu sa fondation votive plus de trente avant sa mort semble improbable. son nom est d’ail-leurs cité en rapport avec la musique précisément dans les années 1390 : en août 1393, c’est à lui, doyen de notre-dame, que le duc de bourgogne Philippe le hardi avait fait acheter des orgues portatives pour la chapelle de son hôtel d’Artois à Paris (Wright 1978, p. 112).en somme, une maîtrise existait bel et bien avant 1396, puisque ses bâtiments furent alors « entièrement rénovés » grâce au don de Pierre de Pacy. une autre fondation citée par La Fons pourrait attester de son existence bien plus tôt au XiV e siècle : celle de simon de Laon qui, à en croire La Fons, mentionnait huit enfants de chœur (La Fons 1649, t. i, p. 267) ; ce chanoine vécut dans les années 1310 et 1320, mais rien ne confirme l’existence de la maîtrise à une date si précoce. en revanche, son fonctionnement après la réno-vation de son bâtiment est bien attesté : dès 1398, un autre dignitaire, l’évêque de Cambrai Gérard de dainville, fonda la distribution de deux deniers à chacun des six enfants de chœur lors des services à sa mémoire (La Fons 1649, t. i,
p. 267). Le nom d’un maître des enfants est connu quelques années après : le 16 février 1412, maître Pierre Goulin, « cho-riste ou maître des enfants de chœur de l’église », obtint l’autorisation d’être inhumé en la chapelle « de saint Pierre et de saint Paul, la plus rapprochée du portail près de la maison des enflés » (La Fons 1649, t. ii/1, p. 302). divers dons témoignent ensuite du fonctionnement régulier de la maîtrise, de ses revenus et de ses locaux. une série de docu-ments concernant la maîtrise sont notamment recensés, et parfois intégralement cités, dans un inventaire détaillé réa-lisé au XViiie siècle (Ad de l’Aisne, G 784, p. 857 à 878) : y sont signalés une quinzaine d’actes, datés de février 1435 (établissement par les exécuteurs du testament de Me Pierre, chanoine, d’une rente de 12 sous sur une maison à saint-quentin, afin de financer l’entretien des six enfants de chœur) aux années 1750. Les plus importants, qu’on évo-quera plus loin en détail, concernent la fondation réalisée en 1509 par le roi Louis Xii, qui assura un revenu pérenne à la maîtrise, alors clairement composée de huit enfants. en 1578, le chanoine quentin serre légua sa maison à la maîtrise, « pour le bon zèle et affection qu’il porte envers les enffans de chœur de la dicte eglise de saint-quentin, et desirant qu’ils soient a l’advenir plus commodément logés qu’ils ne sont », à la condition « que lesdits enfans de chœur seront tenus par chacun jour a tousjours apres son trespas dire le psaume De profundis et l’oraison inclina et fidelium » sur sa tombe. La maison en question ne convenant pas, la maîtrise déménagea en septembre 1588 dans une autre, située près du cloître, « pour la plus grande commodité et salubrité desdits enfans de chœur ».Les mentions documentaires des enfants de chœur de saint-quentin proviennent exclusivement d’actes de fondations votives, signalés par La Fons et hémeré ou recensés dans un autre inventaire de 1684 (Ad de l’Aisne, G 780), qui indi-que, par exemple, que le chanoine Mathieu desempleu avait demandé, par son testament daté de 1494, qu’après sa mort, « les enfans de cœur chantent tous les jours, après matines, sur sa tombe, le répons Ne recorderis domine avec la collecte Inclina ». un siècle plus tard, en 1593, le chanoine Jean de Guignicourt fonde une « messe haute du saint sacrement qui se doit dire tous les jeudy de chacune semaine et chanter par les enfans de chœur en musique » ainsi que « le Sancte deus, Sancte fortis domine qui se chante tous les jours apres
193
Davi
d Fia
la
complies par lesdits enfans de chœur devant le grand autel immediatement apres les prieres qu’ils font de la fondation de Louis douze derriere le grant autel dessous les chasses. » (Ad de l’Aisne, G 780, p. 183)
si ce type de documentation permet de retracer à grands traits l’évolution institutionnelle de la maîtrise, il ne nomme ni les enfants de chœur ni les maîtres de musique ou maîtres des enfants qui succédèrent à Goulin aux XV e et XVie siè-cles. Après lui, le premier maître des enfants connu est le compositeur Jean de bournonville, cité à ce titre en 1612, et la liste de ses successeurs est dès lors relativement complète, incluant les compositeurs François Fégueux (mort en 1624), Artus Aux Cousteaux (1631) Antoine du Cousu (1635), etc.Cette documentation demeure en outre très vague en matière d’exécutions musicales. il est question de « déchanter » dans le testament du doyen nicolas de saint-Just rédigé en 1332 (hémeré 1643, p. 267) ou d’orgues et de « modulation des voix et des orgues », dans le récit d’un conflit qui entraîna, en 1318, une interruption momentanée du service divin (Idem, op. cit., p. 271 : « organa in eadem basilica conticuerunt » et « quod organorum et vocum modulatione peragitur »). Mais il faut attendre la seconde moitié du XViie siècle pour trouver des évocations précises de la pratique musicale dans l’église de saint-quentin.Le journal tenu de 1649 à 1685 par le chanoine Charles de Croix (publié par h. Cardon en 1896 et 1898) contient de nombreuses allusions à la musique. Certaines restent assez générales : un motet à la louange du nouveau doyen est créé lors de sa réception en 1651 (Cardon 1896, p. 276-277) ; l’engagement d’un « clocmand du petit clochier », chargé de sonner les cloches, indique qu’il est également « obligé de chanter et psalmodier au chœur comme les autres vicaires » (Idem, op. cit., p. 332) ; en 1660, après un Te Deum en l’hon-neur du mariage du roi, « le chantre et le sous-chantre ont commencé l’introït qui s’est poursuivy en musique, ainsi que le reste de la messe » (Idem, op. cit., p. 336) ; à la mort d’un enfant de chœur en juin 1661, ses funérailles prévoient que « les 4 plus grands enfants de chœur en aubes le porteroient, que les 4 vicaires derniers nouvellement sortis de la maistrise porteroient le coing du drap des morts, […] que l’on diroit la messe en musique sur le corps, que le corps seroit mis dans le chœur durant qu’elle se chanteroit », toutes ces ques-
tions ayant longuement été débattues car « qui que ce soit du Chapitre n’avoit jamais veu mourir aucun enfant de chœur dans la maistrise » (Idem, op. cit., p. 343). d’autres allusions se font plus précises. Pour la remise du prix d’un concours d’archers au début juillet 1665, « toute la musique, à l’aigle [lutrin], chanta un motet de sainct quentin » (Idem, op. cit., p. 395). Lors de la réception de Louis XiV, en mai 1670, on chante d’abord un motet « fait à l’honneur du roy », dont le chanoine Croix donne tout le texte (Idem, op. cit., p. 447 : « o quintine, flos martyrum / Velut rosa, vel lilium », etc.), puis un autre pendant l’élévation et un Domine salvum fac regem ; Croix ajoute :
on les trouva bon et bien chantés, estant renforcés par sept chantres venus (par prière de nostre chapitre) de rheims, de Laon, de noyon, de Péronne. C’estoit deux basses, trois tailles et deux hautes-contre, outre nos chantres ordinaires qui estoient deux serpents, quatre tailles, trois hautes-contre et huit enfans de chœur. et le roy donna luy-mesme à Me d’oisys, maistre de musique, trois doubles pistoles faisant la somme de 66 livres (Idem, op. cit., p. 447-448).
Après des mentions d’innombrables Te Deum et de plusieurs passages de Louis XiV, comme en mars 1677, où « nostre musique chante 3 ou 4 motets » (Cardon 1898, p. 163), un autre récit de cérémonie fournit à nouveau l’effectif des musiciens en présence : le 1er janvier 1679, pour célébrer la paix de nimègue signée en août précédent, « les vespres et complies estant finies, l’on chanta le Te Deum tant désiré. il y avoit grande affluence de peuple. M. nicolas rous-sel, le plus ancien chanoine de nostre chapitre, fit l’office […] M. Charles Prévot gouvernoit la musique, pour lors composée de 8 enfants de chœur, de deux serpens, d’un bas-contre, trois tailles, et de trois hautes-contres, outre des ruiers : l’un nommé Jean Lejeune et l’autre Ant. Fontaine, tous deux prestres chapellains de la communauté de cette église, chantans la taille » (Idem, op. cit., p. 193). Le diman-che suivant, 8 janvier, alors que la paix était publiée dans la ville à grand renfort de trompettes, tymbales, et autres instruments, « nostre musique qui estoit sous le grand por-tail commança a chanter un motet composé par M. Charles Prévot, nostre maistre de musique, qui est : Domine, in vir-tute tuâ laetabitur Rex, etc. » (Idem, op. cit., p. 197).
La c
ollé
gial
e ro
yale
de
sain
t-que
ntin
et l
a m
usiq
ue
194
Les données précises fournies par le chanoine Croix en matière d’effectif choral dans les années 1670 pourraient bien correspondre à un cadre ancien de près de trois siècles, qui n’aurait connu qu’une inflation modérée entre les XiV e et XViiie siècles. sur l’ensemble de cette longue période, le personnel musical de saint-quentin semble en effet avoir été, bon an mal an, d’au moins une dizaine de chanteurs adultes et de six à huit enfants de chœur, ce qui correspond globalement aux données disponibles pour la plupart des églises de rang et d’une ambition musicale comparables. Mais de façon bien moins courante, le journal de Charles de Croix fait apparaître deux autres traits de continuité sur la longue durée qui fondent la spécificité de la vie musicale de l’église : la très forte présence du pouvoir royal, illustrée sous la plume du chanoine Croix par la visite presque sys-tématique de Louis XiV lors de ses campagnes militaires au nord du royaume, et la création de motets occasionnels, si rarement attestée avec précision dans les documentations capitulaires. Ces deux caractéristiques sont bien antérieu-res au XViie siècle. Avant de revenir sur les implications du statut royal de la collégiale de saint-quentin en matière de musique, en insistant sur le règne de Louis Xii, décisif en la matière, il faut s’arrêter sur un précédent exceptionnel du motet O Quintine, flos martyrum évoqué par Charles de Croix : le motet à saint quentin (Diligenter inquiramus / Martyrum gemma) de Guillaume de Machaut, créé plus de trois cents ans plus tôt.
guillaume de Machaut et Saint-Quentin
Peu d’églises d’europe peuvent revendiquer pour elles-mêmes la création d’œuvres musicales précises avant le XV e siècle, et même encore après, y compris lorsqu’on leur connaît une riche vie musicale. Mais trois siècles avant les motets dont le chanoine Croix relate la création à saint-quentin sous le règne de Louis XiV, le dix-neuvième des vingt-trois motets de Guillaume de Machaut (1300-1377) fait partie des quel-ques rares œuvres du XiV e siècle dont le contexte de création peut être circonscrit avec un assez haut degré de probabilité et de précision : si bien des incertitudes demeurent, il fut probablement composé pour l’église de saint-quentin.Ce motet, comme l’écrasante majorité de ceux du XiV e siècle, obéit à des principes compositionnels mis au goût du jour
par Philippe de Vitry dans les années 1320 et associés à un fameux traité anonyme intitulé Ars nova. il se compose de trois voix articulées par la plus grave d’entre elles (fig. 2) : la voix structurelle du ténor, qui cite une mélodie préexis-tante (le plus souvent empruntée au répertoire liturgique du plain-chant) selon un principe de répétition périodique que les musicologues appellent isorythmie. dans le motet n° 19 de Machaut, le ténor répète ainsi deux fois la dernière phrase d’un répons de l’office des matines de la saint-quentin, soit une série de 30 notes − la color − correspondant aux derniers mots du répons Sanctus namque : « a christo honoratus » (« honoré par le Christ »). Cette double énonciation mélo-dique de la color est combinée à la répétition d’une série de rythmes, appelée talea ; composée de 12 valeurs rythmiques, cette talea est répétée cinq fois pour correspondre au total des 60 notes des deux colores (12x5=60=30x2). dans cette configuration isorythmique, les mêmes notes ne se répètent donc jamais sur les mêmes rythmes. Au-dessus de ce ténor, les deux voix supérieures, librement composées, chantent chacune un poème différent en latin (voir textes et tra-ductions p. 196). Le plus long, celui de la voix de triplum, résume les épisodes de la vie du saint en 36 octosyllabes de rime unique en « -ia ». Le second poème, chanté par le mote-tus, est un texte de louange de 16 vers alternant huit et sept syllabes, selon un schéma de rime (abab-cbcb-dcdc-efef ) en quatre quatrains correspondant aux quatre phrases du texte.
Ce motet est la seule œuvre de Machaut destinée à un culte religieux particulier, si l’on excepte celles consacrées à la Vierge : sa célèbre messe et son dernier motet (n° 23, Inviolata genitrix / Felix virgo). Mais alors que, comme l’ont confirmé tous les travaux récents (notamment robertson 2002 ou bowers 2004), la Messe Nostre Dame était associée à une célébration liturgique (une messe mariale hebdoma-daire de la cathédrale de reims), le motet à saint quentin apparaît plutôt comme une œuvre de circonstance paralitur-gique, destinée à rehausser la solennité d’un service célébré à l’occasion d’un événement particulier, à l’image des motets évoqués bien plus tard par le chanoine Croix.
Comme l’a montré Anne robertson (robertson 2002), les motets de Machaut peuvent être lus comme un cycle évo-quant les souffrances et les joies d’un amant courtois, et, par
195
Davi
d Fia
la
la métaphore qu’induisent les chants religieux cités par le ténor, le parcours spirituel d’un chrétien en quête de l’amour divin. Après les dix-sept premiers motets, presque tous sur des textes de poésie amoureuse en français, et avant le groupe des trois derniers motets en latin à quatre voix, aux fortes résonnances politiques (n° 21 à 23), le motet n° 19 à saint quentin prend place au centre de ce qui pourrait être un triptyque d’œuvres de circonstances. Le motet n° 18 (Bone pastor) célèbre un certain « Guillaume » qualifié de « pasteur de reims » et « coiffé d’une mitre », qui désigne manifeste-ment Guillaume de trie, archevêque de reims de 1324 à 1334. Le motet n° 20, Biauté parée de valour / Trop plus est bele, associe deux poèmes de louanges en français,
Guillaume de Machaut, Motet n° 19 en l’honneur de saint QuentintriPLuMMartyrum gemma latria,tyranni trucis impia,quintine, sapientia,Verba spernens mavortia
Jubentis terribiliaMachinari supplicia,romanorum prosapiasenatorum celestia,
rictiovari soliaAffectans et pitaniaAdmovens superciliaAmbianensis propria
Gentis alacrimoniahumilitate socia,Victis volens martyriaoleique ledentia
Martyrii redolentia,quibus fit appoplecia,Prece cujus anadiadatur cecis et gracia
Cunctorum purgans viciainfirmorum perniciasospitati vestigiaClaudorum filocalia
Prebentur morbis gravia,Cujus fulget provinciaVirmandorum presentia,quo livor, avaricia
Cadunt, gula, luxuria,ira, fastus, accidiaMalaque cuncta noxia,quo viget pacientia,
Fides, spes et prudentia,quo simus ad palatiaCelorum refulgentia,ubi pax est et gloria.
triPLuMJoyau des martyrs de la foi ;insoumis au farouche tyran,Ô quentin, sagesse,Méprisant les propos belliqueux
de celui qui ordonnaitde terribles supplices ;rejeton célestedu sénat romain
Ébranlant le trônedu picard rictiovareFronçant les sourcilsdevant la frénésie
du peuple d’Amiens ;toi dont la compagne fut l’humilité,toi qui voulus laisser aux vaincusL’huile odorante de ton martyre,
témoignant de tes souffrances,Pour soulager les impotents ;toi dont les prières donnent aux aveuglesLe soulagement et la grâce,
tu purges les vices de tous ;Les maux de l’infirmité,Guéris par toi, disparaissent,La philocalie des boiteux
Jette l’opprobre sur les maladies.toi dont la présenceillumine la province du Vermandois,toi qui chasses l’envie, l’avarice,
La gloutonnerie, la luxure,La colère, l’orgueil, la tristesse,et tous les mauvais péchés,toi qui fais fleurir la patience,
La foi, l’espoir et la prudence,Puisses-tu nous faire accéderAux resplendissants palais célestes,où sont la paix et la gloire.
Motetusdiligenter inquiramusquintini preconia ;Congaudenter impendamusnumini suffragia.
Fuit vite mirabilisdespuit obnoxiaFuit deo laudabilis,Meruit suppedia.
illimis bacca fons eratbargueries nobilisAnimis deo veneratMollicies fragilis.
Colentes hunc karissimeexultabunt suaviter ;Canentes nobilissimedabunt laudes dulciter.
MotetusPleins de zèle consacrons-nousAux louanges de quentin ;Avec allégresse rendons hommageÀ la puissance divine.
il eut une vie admirable,Méprisa l’avilissement ;il fut digne des louanges de dieu,Mérita ses bienfaits.
un vase limpide était sa source,une noble « barguerie » ;Avec ardeur, il était venu à dieu,Fragile tendresse.
Ceux qui l’honorent le plus ardemmentexulteront de joie ;Ceux qui chantent avec le plus de noblessediront doucement ses louanges.
La c
ollé
gial
e ro
yale
de
sain
t-que
ntin
et l
a m
usiq
ue
Guillaume de Machaut,Martyrum gemma latria/Diligenter inquiramus/ A Christo honoratus, motet à trois voix,Paris, bnF, ms. français 1586, fol. 223v-224.
2
196
adressés à « la fleur des dames », « beauté parée de valeur », qui se terminent tous deux par le mot « Amen ». si la nature circonstancielle du motet n° 18 est évidente − l’hypothèse la plus simple étant de considérer qu’il fut composé dès 1324 pour célébrer l’élection ou l’entrée en fonction de Guillaume de trie à reims −, le motet n° 20 est tout sauf explicite à cet égard, même si A. robertson suggère d’y voir un adieu de Machaut à bonne de Luxembourg, veuve de Jean de Luxem-bourg, son ancien protecteur. il n’en est pas moins pertinent de supposer que les « Amen » qui concluent religieusement ce motet des plus profanes ont également pour fonction de clore l’ensemble du cycle, avant l’épilogue que forment les trois derniers motets politico-religieux. et quoi qu’il en soit, le voisinage des motets à Guillaume de trie (n° 18) et à saint
quentin (n° 19), les seuls à présenter des destinations aussi spécifiques, ne saurait être un hasard.Les textes du motet n° 19 de Machaut célèbrent la per-sonne de saint quentin et non l’église qui affirmait abriter son corps et a donné son nom actuel à l’ancienne Augusta Viromanduorum, capitale du Vermandois. si la collégiale de saint-quentin était évidemment le principal lieu de culte de ce martyr d’origine romaine, décapité en Picardie en 328 après avoir subi les persécutions du gouverneur local, rictiovare, ce saint était célébré dans bien d’autres églises. À ne considérer que le caractère très général des textes du motet de Machaut, il semble convenir à toute célébration en l’honneur du saint. Mais s’arrêter là serait ignorer un fait déterminant : en 1335 au plus tard, Machaut était titulaire d’une prébende de chanoine de saint-quentin, qui fut, tout au long de sa vie, son bénéfice le plus important après son canonicat à la cathédrale de reims. Cette prébende au cha-pitre de saint-quentin semble même avoir été le premier bénéfice d’un tel rang qu’il ait réellement détenu. Pour tenter de mesurer l’importance de ce fait, quelques précisions sur la carrière bénéficiale de Machaut (dont la documentation est synthétisée par earp 1995, p. 18-20) s’imposent.Comme y insiste à plusieurs reprises un article important pour la biographie du poète et compositeur (bowers 2004), Machaut mena avant tout une carrière de courtisan au ser-vice de grands princes de son temps, dont il fut notaire, aumônier ou secrétaire ; dans la hiérarchie ecclésiastique, il ne dépassa pas l’ordre de sous-diacre, ne cherchant appa-remment jamais à être ordonné prêtre, et sa production ne contient au total qu’une très faible proportion d’œuvres reli-gieuses. Les bénéfices qu’il obtint relèvent de récompenses accordées par la faveur princière à un brillant serviteur bien plus que d’une carrière de dignitaire de l’Église. C’est dans cette perspective qu’il convient de replacer l’obtention de son canonicat à saint-quentin dès avant 1335.tous les documents qui mentionnent des canonicats de Machaut avant 1335 sont des expectatives pontificales : sou-vent obtenues grâce au réseau d’influence d’un prince au sein de la curie pontificale, les bulles de ce type n’étaient pas des nominations prenant effet dès leur promulgation mais des actes censés garantir à leur détenteur l’obtention du prochain canonicat vacant dans l’église qui y était nommée. Ainsi, Machaut avait obtenu une expectative pour un cano-
197
Davi
d Fia
la
nicat à la cathédrale de reims en 1333, auquel il n’accéda en fait qu’en janvier 1338 (sur cette date, voir Idem, op. cit., p. 7, n. 17). Pour compliquer un peu les choses, cette précision en appelle une autre : dans un chapitre collégial, l’obtention d’un canonicat par réception et installation de son nouveau bénéficiaire (le fait de lui assigner une stalle dans le chœur) était une procédure distincte de la résidence. La procédure d’installation de Machaut à reims eut bien lieu en 1338, mais elle se fit par procuration, en l’absence du compositeur, qui suivit encore longtemps les cours de ses employeurs princiers sans résider durablement à reims − ni, donc, à saint-quen-tin. Comme le rappelle r. bowers, les chapitres de chanoines fonctionnaient couramment ainsi, en l’absence d’une bonne partie de leurs membres, et notamment de ceux qui, comme Machaut, avaient été nommés sur recommandation d’un prince. Ce dernier entendait bien conserver ces serviteurs auprès de lui, à sa cour, et c’est même précisément avec cette intention qu’il favorisait leur carrière ecclésiastique : leur offrir cette source de revenu supplémentaire, qui avait pour fonction essentielle de leur assurer une retraite confortable une fois leur carrière curiale achevée, était un des moyens les plus communs de récompenser leur fidélité. reconsidérant dans cette optique la biographie de Machaut, r. bowers défend de façon convaincante l’idée qu’après avoir fidèle-ment servi le roi de bohême, Jean de Luxembourg (de 1323 à la mort du roi en 1346), puis peut-être sa veuve, bonne de Luxembourg, Machaut aurait passé les années 1350 au service du roi de navarre, Charles ii le Mauvais, et n’aurait donc commencé à « faire sa résidence » au chapitre cathédral de reims qu’à la fin des années 1350, vers l’âge de soixante ans, et non dans les années 1340, comme la plupart des auteurs l’affirment ou le laissent entendre (Idem, op. cit., p. 3-18).Autant l’association de Machaut avec la cathédrale de reims a fait couler de l’encre et permis d’éclairer sa biographie et son œuvre, autant sa relation à la collégiale de saint-quen-tin reste mal connue. il faut dire que les données disponibles à ce sujet se résument, en tout et pour tout, à deux mentions d’archives datées de 1335 et 1362 (signalées et commentées par earp 1995, p. 18-19), qu’il faut compléter par une allu-sion littéraire de 1363. La première mention du canonicat de Machaut à saint-quentin apparaît de façon presque subreptice dans une bulle d’avril 1335 qui s’inscrit dans une série d’actes du nouveau pape benoît Xii visant à réguler
l’inflation d’expectatives produites dans les années précé-dentes : cet acte annulait plusieurs expectatives détenues par Machaut (dont deux pour les cathédrales de Verdun et d’Ar-ras) et l’autorisait à conserver la prébende qu’il détenait déjà à saint-quentin et son expectative à reims. Le fait qu’aucun document antérieur ne signale cette prébende canoniale de saint-quentin permet de formuler deux hypothèses : Machaut ne l’obtint qu’après le 4 janvier 1333, date du dernier document antérieur qui recense ses bénéfices ecclésiastiques ; elle ne résulte pas d’une nomination de la curie pontificale, dont la documentation, bien conservée et étudiée, aurait gardé trace. Le second de ces points est plus que probable, car le droit de collation des prébendes de saint-quentin (c’est-à-dire le droit d’y nommer les chanoines) revenait au roi de France. de ce fait, il n’est pas impossible que l’administra-tion papale n’ait pas été tenue informée de l’obtention de ce bénéfice par Machaut, qui pourrait donc éventuellement être intervenue avant 1333, comme on y reviendra. Mais en l’état des connaissances, on peut considérer que Machaut devint chanoine de saint-quentin vers 1334 au plus tard, vraisemblablement grâce à une charte de collation du roi de France, alors Philippe Vi de Valois. une telle nomination ne témoigne d’ailleurs pas nécessairement d’un lien direct entre Machaut et le roi, car elle pourrait, là aussi, résulter de l’appui de Jean de Luxembourg, un des plus puissants princes de la cour. Après la bulle de 1335, il faut attendre 1362 pour trouver la seule confirmation que Machaut était bien toujours cha-noine de saint-quentin : un document fiscal indique qu’il perçut alors le revenu annuel de sa prébende, d’un montant de 40 livres (« Compte des décimes du diocèse de noyon en 1362 » publié par Longnon 1908, vol. i, p. 196). Ceci ne signi-fie pas forcément qu’il remplissait les conditions de présence à saint-quentin pour être considéré comme un chanoine résident, et c’est bien à reims qu’il passait la plupart de l’an-née. Mais la perception de ce revenu suppose quand même qu’il rendait des visites régulières au chapitre.Aussi minces soient-elles, ces deux mentions d’archives suf-fisent à confirmer sans ambiguïté que Machaut fut chanoine de saint-quentin pendant plus de quarante ans. en revan-che, elles ne disent presque rien de la fréquence de ses visites ou de son investissement dans la vie de l’église. Machaut a lui-même glissé une allusion à ce sujet dans une de ses derniè-res œuvres, le Livre du Voir Dit, un poème autobiographique
La c
ollé
gial
e ro
yale
de
sain
t-que
ntin
et l
a m
usiq
ue
198
organisé autour d’une correspondance amoureuse entre le poète vieillissant et une jeune femme. dans ses lettres de l’automne 1363, il évoque un projet de visite à saint-quen-tin à la toussaint : le 17 octobre, écrit-il (lettre XXXV), il « pense être à la prochaine toussaint à saint-quentin, et de là aller chez monseigneur le duc [de normandie] ». il dut finalement renoncer à ce voyage, comme il l’annonce le 3 novembre (lettre XXVii) : « je ne suis pas allé à saint-quentin ni chez Monseigneur le duc, en raison d’un certain nombre d’ennemis qui sont en beauvaisis » (Machaut 1999, p. 573 et 593 ; pour la datation des lettres, voir Leech-Wilkinson 1993, p. 124-126). L’allusion demeure anecdotique, mais sa date n’en est pas moins révélatrice : la veille de la toussaint, 31 octobre, était en effet le jour de la fête de saint quentin, et il y a tout lieu de penser que Machaut avait l’intention d’assis-ter à cette célébration à saint-quentin.Au vu de ces informations, il est naturel de supposer, avec tous les spécialistes de Machaut, que son motet n° 19 fut composé pour l’église de saint-quentin ; reste à imaginer à quelle occasion cette composition put intervenir. Contraire-ment aux textes du motet n° 18, qui permettent d’identifier un dédicataire et de circonscrire une période de composi-tion (la décennie 1324-1334 pendant laquelle Guillaume de trie fut archevêque de reims), ceux du motet n° 19 n’of-frent guère de prise. ils sont à la fois simples et généraux, à l’exception du troisième quatrain du Motetus (vers 9-12), dont la compréhension est rendue difficile par une énigme lexicale : l’hapax bargueries (vers 11), un mot inconnu et donc intraduisible, dont la graphie ne présente aucune ambiguité dans les sept manuscrits qui transmettent le motet (voir, par exemple, fig. 2). si la déclinaison en « -ies » indique souvent en latin une qualité morale ou physique (comme mollicies, juste après), sa séquence non idiomatique « -gue- » trahit sans doute un emprunt à une langue vernaculaire (par exemple au « w » anglo-saxon) ; il pourrait notamment s’agir d’un nom propre désignant un lieu ou, plus vraisembla-blement (du fait de l’adjectif « noble » qui le qualifie), une personne. Cependant, ni les récits des actes et des miracles de saint quentin ni la documentation de l’église ne citent de toponyme ou de patronyme approchant, que ce soit en latin ou sous ses potentielles formes françaises. en élargis-sant l’enquête, il est certes possible de repérer, par exemple, des lignages nobles portant des noms de fiefs apparentés à
« bergerie » (Guillaume de La bergerie, commissaire du roi envoyé à Corbie en 1363 ; doublet de La barguerie, panetier de Charles V, etc.) ou encore une sainte bargaria, martyre citée parmi les onze mille vierges, dont des reliques étaient vénérées en bohême.Aucune de ces pistes (seules plausibles parmi bien d’autres) ne permet d’éclairer à coup sûr le sens du quatrain, mais on peut tirer des enseignements d’une analyse formelle du poème. ses quatrains se caractérisent en effet par une structuration systématique en deux distiques autonomes et symétriques, dont le parallélisme est souligné par des rimes internes (dès le début, diligenter-congaudenter, Quintini-numini ; aux vers 9-12, illimis-animis et bargueries-mollicies). dans le troisième quatrain, ce principe de symétrie suppose de comprendre bargueries comme une apposition au vers précédent. À supposer que l’emploi de ce mot inconnu soit une licence poétique permettant la rime interne avec molli-cies (de même qu’au vers 11, la forme animis, dans un emploi au pluriel bien attesté en latin classique, au sens d’ardeur ou d’audace, permet la rime avec illimis), on pourrait y voir, par exemple, une forme du français « bergerie », la désignation métaphorique du saint comme « noble bergerie » prolon-geant l’allusion pastorale du vers 9, où Machaut cite ovide (« Fons erat illimis, nitidis argenteus undis », dans le récit du mythe de la nymphe echo, Métamorphoses, livre 3, vers 407). il faut souligner à ce propos que tous les manuscrits donnent sans ambiguité, au vers 9, la leçon « bacca », et non « bucca » (bouche) substitué par la plupart des éditeurs modernes. Le choix de ce terme peu fréquent que le dictionnaire du Cange définit comme « vas aquarium » (vase à eau ; http://ducange.enc.sorbonne.fr/bACCA2) pourrait témoigner d’une recherche d’allitération avec « bargueries ». en invoquant d’autres racines de mots français, tels que « barguigner », « baragouin » voire « braverie », on peut aussi imaginer que ces vers évoquent le prosélytisme du saint et son activité de conversion : une parole courageuse bravant les autorités, par opposition à sa « tendre fragilité » intérieure, évoquée dans le distique suivant. Finalement, rien ne permet de conclure sur le sens exact de bargueries, et l’hypothèse d’une désignation toponymique ou anthroponymique demeure possible. Mais le fait qu’il se rapporte à la personne de saint quentin limite quelque peu l’espoir que son élucidation apporte un élément décisif sur la destination du motet.
199
Davi
d Fia
la
en l’absence d’information spécifique dans les textes du motet, ses circonstances de création restent affaire de conjec-tures et d’hypothèses, qui ont fait l’objet d’un réexamen récent (robertson 2002, p. 69-75). en laissant de côté l’idée (sans doute à jamais hypothétique) que Machaut aurait com-posé ce motet à l’occasion de sa réception comme chanoine de saint-quentin, l’autre principale hypothèse l’associe à un vaste ensemble de bas-reliefs de la vie de saint quentin, ins-tallés vers les années 1340 sur tout le pourtour externe (côté déambulatoire) d’un mur intérieur qui encerclait le chœur de l’église. Approfondissant cette séduisante conjonction artistique entre sculpture et musique (un motet de louange à saint quentin chanté devant des scènes représentant sa vie), A. robertson propose en outre de situer la création et / ou les exécutions du motet dans le cadre d’un important évé-nement ecclésiastique régional : les réunions plus ou moins régulières qui rassemblèrent entre 1331 et 1429 à saint-quen-tin des délégués des douze chapitres canoniaux de toute la province de reims (dont, évidemment, celui de la cathédrale de reims). du fait de ces assemblées, tenues d’abord le 1er, puis le 8 mai, saint-quentin fut un important centre de la vie ecclésiastique de la province.dans la conception unificatrice des motets de Machaut déve-loppée par A. robertson, ces réunions offrent un lien direct entre les motets 18 et 19 : en effet, leur mise en place résulte en large partie des relations conflictuelles entre les chanoines de reims et leurs archevêques, à commencer par Guillaume de trie. À partir des années 1330, toute référence religieuse conjointe à saint-quentin et reims − comme celle établie par les deux motets successifs de Machaut − peut évoquer ce contexte de tensions entre les chanoines de la province et certains de leurs évêques. Mais si ce cadre offre un lien entre les deux motets occasionnels de Machaut, ce n’est pas sans contradiction puisqu’il suppose que le motet 19 aurait été chanté lors de réunions de chanoines qui faisaient front contre l’archevêque de reims… auquel le motet 18 rend hom-mage. A. robertson tranche résolument cette contradiction : le motet 18 ne doit pas être compris comme une affirmation partisane mais comme un hommage distancié ; pour elle, Machaut était solidaire des chanoines de reims et pourrait même avoir été leur délégué aux réunions à saint-quentin.Ce scénario n’est pas impossible mais semble un peu forcé − le motet 18 s’ouvre quand même par : « Ô bon pasteur, toi qui
surpasses / tous les autres par tes mœurs / et par ta noblesse » − et mériterait un affinement chronologique (notons au passage que, selon hémeré 1643, p. 280, les assemblées s’interrom-pirent entre 1358 et 1364 puis entre 1369 et 1395). sans même parler du fait que Machaut ne devint chanoine de reims que trois ans après la fin de l’épiscopat de Guillaume de trie, l’idée qu’il se serait personnellement investi dans les affaires et les débats ecclésiastiques de sa région avant les années 1350 semble peu évidente (voir ci-dessus), et les rares documents relatifs à son canonicat à saint-quentin tendent à accrédi-ter cette idée. or le motet 19, d’un style très différent de ses derniers motets (21 à 23) des années 1359-1360, présente des traits communément associés à des périodes nettement antérieures. en dépit de la fragilité des considérations stylis-tiques en matière chronologique (notamment parce que des procédés peuvent évidemment être repris longtemps après leurs premières occurrences, avec ou sans intention intertex-tuelle), il semble en tout cas plus à sa place vers 1330 qu’après 1350. Ainsi, le motet de Machaut le plus étroitement associé à un culte particulier, qui emprunte son ténor au sancto-ral, date probablement d’une période où les relations de son auteur avec l’Église devaient surtout porter sur la recherche d’un canonicat pour assurer ses vieux jours.Plus précisément, les motets 18 et 19 partagent des parentés stylistiques avec des motets attribués à Philippe de Vitry, au point que Karl Kügle a suggéré que le motet 19 pourrait avoir été composé en hommage à Vitry (Kügle 1997, p. 119-124). il se trouve que Philippe de Vitry détint, lui aussi, un cano-nicat à saint-quentin, qu’il obtint (de toute évidence grâce à son statut dans l’administration royale) au plus tard en 1332. Les informations sur ses relations à saint-quentin sont toutefois encore plus minces que dans le cas de Machaut, et sa brillante carrière ultérieure (chanoine de notre-dame de Paris en 1349 puis évêque de Meaux en 1351) laisse penser que cette prébende fut très secondaire pour lui. La première rencontre entre Machaut et Vitry pourrait avoir eu lieu dès 1322 à reims, à l’occasion du couronnement de Charles iV, dont le fils Philippe avait pour pédagogue… Guillaume de trie (earp 1995, p. 12). en somme, plutôt que de situer les motets 18 et 19 dans le seul contexte ecclésiastique des cha-pitres de la province de reims, il semble indispensable de les considérer dans le cadre des réseaux qui unissaient l’orbite royale française (et ses plus puissants princes, dont Jean de
La c
ollé
gial
e ro
yale
de
sain
t-que
ntin
et l
a m
usiq
ue
200
bohême) aux églises les plus directement liées au pouvoir royal, au premier rang desquelles reims et saint-quentin. Pour le dire autrement, ces motets n’expriment sans doute pas seulement des options personnelles de Machaut, mais s’inscrivent dans un jeu politique qui ne devait pas échapper à l’attention des princes de l’orbite royale, qui avaient placé nombre de leurs serviteurs dans ces églises.un dernier élément conforte l’idée de dissocier la composi-tion de ce motet du cadre purement local de saint-quentin : le chant liturgique cité par le ténor présente en effet des variantes avec les versions transmises par deux anciens livres liturgiques locaux (de saint-quentin et beauvais) et semble globalement plus proche de versions transmises par des sources parisiennes (Clark 1996, p. 33, 63-64 et 198 ; robert-son 2002, p. 70, ajoute une version d’Amiens apparentée aux versions parisiennes repérées par A. Clark). Ce constat ne signifie pas forcément que l’œuvre n’était pas destinée à l’église du Vermandois, mais que Machaut travailla à partir d’un livre légèrement différent de ceux qui étaient disponi-bles dans l’environnement immédiat de l’église ; il est logique de supposer qu’il s’agissait d’un livre liturgique de la cour de Jean de Luxembourg.si Machaut obtint son canonicat de reims grâce à une expec-tative produite par le pape sur la recommandation de Jean de bohême, tout laisse penser que c’est sur la même recom-mandation, mais auprès du roi de France, qu’il obtint celui de saint-quentin. il ne fut d’ailleurs pas le seul serviteur de Jean de bohême à en détenir un. dans son ouvrage le plus complet, publié en 1643, Claude hémeré ne fait aucune allu-sion au compositeur mais cite, parmi les chanoines illustres sous le règne de Charles iV le bel (1322-1328), un certain nicaise de Wavrechin, chapelain du roi de bohême, et ajoute au passage quelques mots sur Jean de bohême (hémeré 1643, p. 275). Au regard du nombre de « chanoines illustres » identifiés par hémeré, l’oubli de Machaut étonne, même en tenant compte du fait que le poète ne fut probablement jamais chanoine résident à saint-quentin et ne laissa donc peut-être que peu de traces officielles dans les archives de l’église (il en va de même pour Vitry, qui n’est connu d’au-cun des historiens de saint-quentin). Mais le plus étonnant est que la vaste synthèse de 1643 omet un développement qui figurait dans la table chronologique de 1633, juste après la mention de Wavrechin, qualifié alors de premier chapelain
de Jean de bohême. Pour plus de clarté, il convient de repro-duire la présentation de ce passage (hémeré 1633, p. 105), en lui joignant une traduction :
1325 iohannes de Campis, decan[us] senonens[is] Canon[icus] s[ancti] q[uintini]nicasius de VVavrechin, regis bohemiae protocapellanus Can[onicus] s[ancti] q[uintini]nicolaus de Machaud, Clericus ejusdem regis, Canon[icus] s[ancti] quintini. sic à nostro caelo longissime positos, sua-vissimus beneficiorum nostrorum odor alliciebat. Pertraxit Augustam, & eadem unguenti fragrantia Celtiberos, & ioannes de Luna, hispanus Tholetanum canonicatum, cum sanquintiniensi permutat, anno 1334.Magister Petrus de Lemovici, Canonicus [etc.]
1326 eleemosyna Aegidii Lienart [etc.]
1325 Jean des Champs, doyen de sens, chanoine de saint-quentin.nicaise de Wavrechin, premier chapelain du roi de bohême, chanoine de saint-quentin.nicolas de Machaud, clerc du même roi, chanoine de saint-quentin. Ainsi, la très douce odeur de nos bénéfices alléchait les personnes les plus éloignées de nos cieux. Cette fragrance de l’onguent attira même des Celtes-ibères à saint-quentin, puis-que Johannes de Luna, espagnol, permuta en 1334 un canonicat de tolède avec celui qu’il détenait à saint-quentin.Maître Pierre de Limoges, chanoine [etc.][…]
1326 Aumône de Gilles Lienart, [etc.]
Ce passage (dont Machabey 1955, vol. 1, p. 30, donne une citation tronquée et confuse) est bien une référence à Guillaume de Machaut, le prénom nicolas étant une erreur manifeste (il est hautement improbable, pour ne pas dire impossible, qu’un autre Machaut que Guillaume ait été, au même moment que lui, à la fois chanoine de saint-quentin et serviteur du roi de bohême, d’autant que le prénom du frère de Machaut, Jean, est connu et que les nombreuses investigations sur leur patronyme n’ont jamais mis au jour de nicolas). Cette erreur d’hémeré n’est ni la première ni la dernière et son commentaire ironique sur l’éloignement de la bohême montre qu’il ignorait alors la biographie de Jean de Luxembourg, descendant direct de saint Louis (erreur
201
Davi
d Fia
la
qu’il répara dans sa publication révisée de 1643). de même, sa présentation de la chronologie doit être prise avec précaution. Les dates portées en marge dans la table de 1633 comme dans la synthèse de 1643 semblent d’abord renvoyer aux entrées qui leur font directement face. Autour de ces repères, il a réparti de façon plus ou moins précise les autres entrées, y compris celles qu’il ne pouvait dater qu’approximativement.La localisation des entrées « Wavrechin » et « Machaut » en 1325 offre certes une piste sur la possible date d’obtention de leurs bénéfices par ces deux serviteurs du roi de bohême. Mais la biographie assez bien connue de Wavrechin ne la confirme pas. La documentation publiée de la curie avi-gnonnaise, où il est cité à une dizaine de reprises de 1317 à sa mort en 1349, montre qu’il fit une belle carrière ecclésias-tique grâce à l’appui constant de la famille de Luxembourg, dont il fut un fidèle chapelain, d’abord au service de la com-tesse béatrice (qui le recruta sans doute dans la région de Valenciennes), puis de Jean, roi de bohême, et enfin, briè-vement, de baudouin, archevêque de trèves (burgard 1991, p. 226-228). Aucune mention de son canonicat à saint-quentin n’est cependant connue avant le 17 avril 1332, date à laquelle il reçut une expectative du pape Jean XXii pour une prébende à la cathédrale de Cambrai, dont le texte précise qu’il disposait alors de prébendes à saint-quentin en Vermandois, à notre-dame de Condé-sur-L’escaut et à saint-barthélemy de Liège (Fayen 1912, vol. 3, p. 567). À cette même date (et comme un troisième serviteur de Jean ier de bohême, le parisien robert du Palais), Machaut avait également reçu une expectative, dont le texte ne men-tionne pas de canonicat à saint-quentin. en revanche, le fait qu’hémeré ait apparemment trouvé mention de Machaut comme clerc du roi de bohême pourrait consti-tuer un dernier indice : Machaut ne semble désigné ainsi à la cour qu’avant 1330, date à laquelle il est qualifié d’aumô-nier, puis de notaire à partir de 1332 et de secrétaire à partir de 1333 (earp 1995, p. 8-9). sans fournir de certitudes, ces divers éléments conduisent à considérer que ça n’est pas en 1325 mais autour de ces années que Wavrechin et Machaut devinrent chanoines de saint-quentin, au plus tard en 1332 pour le premier et en 1334 pour le second.que Wavrechin ait eu des aptitudes musicales est très incer-tain, malgré le titre de « premier chapelain » que lui attribue hémeré, qui suppose l’existence d’un groupe structuré de
chapelains au sein d’un hôtel princier, comprenant éven-tuellement des chantres musiciens. il fut avant tout un clerc de la maison de Luxembourg, où il semble cité au moins une fois en lien avec l’administration financière de Jean ier de bohême (burgard 1991, loc. cit.). Mais il côtoya évidem-ment Machaut à la cour de ce prince et pourrait bien, à en croire la chronologie, avoir joué un rôle dans l’obtention du canonicat de Machaut à saint-quentin. Plus précisément encore, la présence dans la région de Jean de Luxembourg et sa cour est en fait attestée par la copie d’une lettre (dont l’original est hélas ! perdu) datée de noyon, le 1er mai 1334, et signée : « Par le roy, Guillaume de Machau » (earp 1995, p. 14). Coïncidence troublante, le secrétaire Machaut signa non seulement cette lettre au nom du roi de bohême à quelques encablures de saint-quentin, mais alors qu’était censé s’y ouvrir la deuxième assemblée des chanoines de la province de reims, qui semble avoir été finalement repor-tée. Au vu de la chronologie des documents concernant le canonicat de Machaut à saint-quentin, ce passage en Ver-mandois de la cour de Jean de Luxembourg (alors en guerre contre le duc de brabant) pourrait bien avoir été détermi-nant, et offre une datation plausible du motet 19.une dernière information concernant Wavrechin, qui pro-vient, cette fois, de saint-quentin même, montre qu’il y fut une personnalité active. décrivant un à un les bas reliefs de la vie de saint quentin répartis sur le mur de clôture du chœur, quentin de La Fons décrit ainsi le dernier de ces quinze compartiments :
Au quinzième et dernier espace, saint eloy trouve le corps de saint quentin, et l’ayant trouvé, il le met dans une belle châsse. Longtems après, ce corps est élevé dessus le grand autel et, du depuis encore [sic], par le roi saint Louis, qui porte son chef en ses propres mains. […] Aux deux côtés de ces espaces sont les figures de saint Louis, de ses deux enfants, d’un evèque, et d’un Chanoine derrière eux, qui est celle de Me nicaise de Vannechin, qui a fait cette dernière histoire, comme Me robert Listeur a fait faire la première, ainsi qu’il se reconnoît d’une ordonnance capitulaire du 22 octobre 1353. ils étoient tous deux Chanoines de cette eglise environ l’an 1340. (La Fons 1649, t. i, p. 86-88 ; l’épitaphe de robert Le Listeur, Idem, op. cit., p. 102, indique qu’il mourut en 1351, deux ans après Wavre-chin, que La Fons lit ici « Vannechin »).
La c
ollé
gial
e ro
yale
de
sain
t-que
ntin
et l
a m
usiq
ue
202
Ainsi, Wavrechin finança la réalisation du dernier bas-relief de la vie de saint quentin, qui était accompagné d’une légende gravée de trente-deux vers en français. on laissera aux spécialistes de la poésie de Machaut le soin de détermi-ner si ces vers (cités par La Fons 1649, t. i, p. 87) peuvent trahir quelque collaboration du poète :
L’an de grace sept cent et huictFust en janvier la tierche nuictsainct quentin trouvé. se avint :de sa tombe grande clarté vintqui la nuict truible enlumina,Comme s’il fust jour, et puis fina.Avec ce un aultre hault signeMonstra dieu ; car du sainct corps digneissut vray sang à grant doucheurdu dent, et adonc le pasteurConfert sainct eloy noblement,Le mit en fiertre sainctementderrière l’autel, où fust long-tems.Après en l’an XXViii ans,Mille et deux cents, ii jours en May,que plusieurs furent en esmayPour gueris, en la viese esgliseeslevé fut en grand devise,et puis passé ans XXiXde celui en l’ouvrage neuf ;Comme l’escriture ramembreLe second jour droict de septembresainct Louis la translationen fit par sa dévotionAu lieu où il est maintenant.Prions ly que sa main tenantAit à sa ville pour garderet veuille en pitié regardertous ceux qui l’esglise amerontet les droictures garderont,Par quoy puissent avoir le règneoù toute joye maintenant règne.
Les donateurs de toutes les scènes n’étant pas connus, rien n’interdit d’imaginer que Machaut figure parmi eux. Les études modernes concluent que c’est en 1316 que commença
le renforcement des piles du chœur, qui furent reliées, « par surcroît de précaution, au moyen du mur de clôture achevé l’an 1342 » (héliot 1967, p. 78). L’installation des bas-reliefs pourrait peut-être avoir commencé au fur et à mesure de l’édification du mur, dès la période où Wavrechin et Machaut devinrent chanoines de l’église, au début des années 1330, mais il semble plus probable de la situer dans la décennie suivante. en dehors des scènes financées par Le Listeur et Wavrechin, le seul autre relief daté par La Fons est le qua-trième, donné par le chanoine Pierre Thiart, mort en 1342 (La Fons cite son épitaphe à deux reprises, en la datant la première fois par erreur de 1322 ; La Fons 1649, t. i, p. 82 et 102).quoi qu’il en soit, un dernier élément dévoile un lien par-ticulier entre ce monument et la musique. L’ange jouant de l’orgue portatif (fig. 3) est un des rares vestiges de ce mur de clôture épargnés par le temps. déposé lors des travaux de restauration de l’édifice après la Première Guerre mondiale, il ornait, avec d’autres anges musiciens, la partie supérieure du parement externe du mur, à la cinquième travée nord du chœur (face au bras nord du second ou « petit » tran-sept, comme le montre un dessin du milieu du XiXe siècle ; informations communiquées par Christiane riboulleau, du service régional de l’inventaire du Patrimoine culturel au Conseil régional de Picardie). il est aujourd’hui difficile de dire si des anges occupaient les espaces libres au-dessus des reliefs à chacune des quinze travées, mais la préservation de quelques anges montre qu’au moins une d’entre elles présen-tait ce type de décor musical. Le choix de ce thème décoratif relativement commun ne doit sans doute pas être surin-terprété, mais s’ajoutant à l’ensemble d’éléments présentés jusqu’ici, il ne fait que renforcer l’association entre le motet et la décoration du mur de clôture du chœur.Ces quinze scènes en bas-relief présentent d’intrigantes cor-respondances avec le motet de Machaut, mais il serait exagéré de vouloir établir un lien trop direct. Certes, l’inauguration d’une scène offerte par le compositeur ou une cérémonie marquant le lancement ou l’achèvement du projet seraient autant de cadres séduisants à la création du motet, mais la chronologie demeure problématique. Pour diverses raisons, à commencer par sa parenté avec le motet 18, le motet 19 semble appartenir au début des années 1330, soit une dizaine d’années avant la datation probable des bas-reliefs. Mieux
203
Davi
d Fia
la
Ange jouant de l’orgue portatif, relief provenantdu décor de la clôture de chœur, milieu du XiV e siècle.saint-quentin, basilique.
3
vaut donc, en l’état actuel des connaissances, considérer que ces créations appartiennent simplement à un même mou-vement de renouvellement esthétique de la dévotion à saint quentin dans la collégiale homonyme. on pourrait imagi-ner que ce renouveau trouve son origine dans le millénaire de la décapitation de saint quentin, en 1328, mais aucun his-torien de l’église n’évoque de cérémonies commémoratives.Ce faisceau d’indices très divers, et même parfois contradic-toires, demeure difficile à synthétiser, mais on peut en retenir les points suivant : Machaut a situé l’une après l’autre, peu avant la fin du cycle de ses motets, deux pièces de louan-ges adressées l’une à l’archevêque de reims, Guillaume de trie, haut dignitaire très proche du pouvoir royal, et l’autre à saint quentin, martyr du Vermandois issu de l’aristocratie romaine mais persécuté par le représentant local du pouvoir impérial. Ce rapprochement, évidemment volontaire et donc significatif, entre en résonnance avec deux faits du début des
années 1330 : 1. le début d’un conflit ouvert entre l’archevêque de reims et les chapitres canoniaux de sa province, symbo-lisé par la réunion indépendante de délégués des chapitres à partir de 1331 à saint-quentin ; 2. l’obtention par Machaut, grâce à l’appui de ses protecteurs princiers, de deux cano-nicats à reims et à saint-quentin. Le constat d’ensemble est donc simple : les deux seuls motets de louange composés par Machaut ménagent deux parties qui furent en conflit au début des années 1330 et correspondent aux deux charges ecclésiastiques qu’il obtint alors, sans doute sans participer pour autant à la vie capitulaire avant de nombreuses années. en somme, on pourrait même envisager qu’ils aient été créés conjointement au cours d’une rencontre de conciliation (par exemple sous l’égide d’un prince de l’orbite royale de pas-sage en Picardie, comme Jean de Luxembourg en 1334). Ce genre de conjecture outrepasse cependant les informations disponibles pour le moment, qui autorisent principalement
La c
ollé
gial
e ro
yale
de
sain
t-que
ntin
et l
a m
usiq
ue
204
à établir un cadre général : le motet 19 de Machaut fut sans doute bel et bien composé pour la collégiale de saint-quen-tin, et probablement au début des années 1330.
Une « collégiale royale » aux XIVe et XVe siècles
L’apparition remarquablement rapprochée de Wavrechin, Vitry et Machaut comme chanoines de saint-quentin, sou-dain cités entre 1332 et 1334, invite à se demander s’il faut y voir une signification particulière. il est improbable que la musique ait été la première motivation de ces nominations, qui participent peut-être d’un processus du nouveau pouvoir royal (passé aux Valois avec le couronnement de Philippe Vi en 1328) pour placer des serviteurs fidèles dans un impor-tant chapitre d’une province où les chanoines manifestaient alors des velléités d’indépendance. saint-quentin étant une collégiale royale, dont le roi de France, son patron et pro-tecteur, nommait tous les chanoines, le fait d’y nommer des ecclésiastiques de la cour était monnaie courante, et presque la norme. Mais ces nominations semblent avoir sur-tout concerné jusqu’alors des détenteurs de hautes charges, ayant le plus souvent rang de conseillers, certains promis à un avenir d’évêques ou de cardinaux − vers 1300, le chapitre comptait parmi ses membres Michel du bec, créé cardinal en 1312, Philippe de Majorque, trésorier de saint-Martin de tours, ou Guy de Laon, aumônier de Philippe le bel, chanoine de notre-dame et trésorier de la sainte-Chapelle de Paris. tout au long du XiV e siècle, les aumôniers royaux se succédèrent au sein du chapitre (La selle 1995, passim, relève ainsi les canonicats de Guillaume de Feucherolles, Amaury Alain de Condé, Pierre de Proverville, Michel de Creney, la plupart à la fois chanoines de la sainte-Chapelle et de saint-quentin, auxquels on peut ajouter denis des Couleurs, aumônier de Charles Vi, et sans doute encore d’autres). il en alla de même pour les médecins royaux, d’ermandus de Ponte tremulo cité vers 1300, après d’autres sous le règne de saint Louis, jusqu’à evrard de Conti à la fin du siècle, ainsi que pour de nombreux juristes et finan-ciers, comme le chancelier de France Mathieu Ferrand ou le maître des comptes Jean de saint-Just sous le règne de Philippe Vi.Autrement dit, lors de l’obtention de son canonicat, Machaut était un officier de cour de rang moyen, serviteur d’un proche
allié du roi. Le nombre de chapelains de la famille royale identifiés par hémeré parmi les chanoines de saint-quentin laisse d’ailleurs supposer que ce type de nomination était des plus fréquentes puisqu’il cite : peu avant 1320, eustache, premier chapelain de la comtesse de blois ; en 1330 ou peu après, nicolas Corcherii (sans doute Cochery), premier cha-pelain du comte d’Alençon, frère du roi ; en 1334, Guillaume Fueillet, premier chapelain de la comtesse de hainaut, sœur du roi ; et vers 1360, Jean hemon, premier chapelain du dau-phin régent (hémeré 1633, p. 98, 107, 110, 128 ; aucun n’étant repris dans la publication de 1643). dans tous ces cas comme dans celui de Wavrechin, l’utilisation par hémeré du terme de protocapellanus, premier chapelain, a quelque chose de troublant pour tout historien de la musique, qui associe naturellement cette charge (celle qu’occupa, par exemple, le compositeur Jean de ockeghem à la cour de France dans la seconde moitié du XV e siècle) à l’existence d’une chapelle musicale. toutefois, en l’état actuel des connaissances sur les chapelles princières, on peine à croire que tous ces princes disposaient de groupes de chantres et il est plus prudent de voir là soit une interprétation anachronique des documents par hémeré, soit un usage précoce du terme sans lien avec un groupe rémunéré pour chanter les services religieux en musique. encore faut-il souligner que, pour ces périodes, « l’état actuel des connaissances sur les chapelles princières » se résume à bien peu de choses et que, malgré ses inexacti-tudes, hémeré demeure une source digne d’attention. un peu plus loin, son emploi du titre de protocapellanus pour nicaise dupuis est en tout cas indiscutable, puisque ce dernier dirigeait en effet la chapelle domestique du duc de bourgogne Philippe le bon, dont le riche effectif de chan-teurs est bien connu.ni les « premiers chapelains » cités par hémeré ni les nomi-nations de Machaut et Vitry ne permettent d’affirmer que les prébendes de saint-quentin furent régulièrement affectées à des musiciens de la cour dès le XiV e siècle. Mais ces éléments peuvent apparaître comme les signes avant-coureurs d’une évolution qui fit effectivement de l’église un lieu privilégié de nomination des chantres des chapelles de la cour royale. L’aboutissement de cette évolution est une législation établie à la fin du XVie siècle pour fixer la géographie ecclésiastique des chapitres du royaume dont un nombre précis de cano-nicats devaient être réservés en priorité aux musiciens de la
205
Davi
d Fia
la
cour. Par des lettres patentes publiées au mois de septem-bre 1571, le roi Charles iX ordonna d’affecter officiellement aux membres de sa chapelle de musique et de son oratoire un certain nombre de « dignités, Chanoinies, Prébendes et bénéfices ecclésiastiques de Collation royale et à sa nomi-nation » dans des églises étroitement liées au pouvoir royal, dont la liste est incluse dans le décret : juste après les saintes-Chapelles de Paris et dijon vient l’église de « saint-quentin de Vermandois », suivie des églises de saint-Vulfran d’Ab-beville, saint-Fursy de Péronne, saint-Florent de roye et de neuf autres églises, dont celles de Pontoise et de Poissy. Le même privilège fut confirmé par des décrets d’henri iii (octobre 1585) et henri iV (mars 1594), qui augmenta encore la liste des églises dont des prébendes devaient être réservées en priorité aux chapelains royaux par des lettres patentes du 9 mars 1606 (le détail de tous ces textes est cité et commenté par le principal historien ancien de la sainte-Chapelle du Palais : Morand 1790, p. 248-251 ; une partie de ces informa-tions sont déjà signalés par La Fons 1649, t. i, p. 150).Ces listes classent en partie les institutions par ordre d’im-portance, et saint-quentin y figure donc en très bonne place. surtout, elles montrent que la « collégiale royale » de saint-quentin était une « presque sainte-Chapelle ». Aux environs de 1248, année de la fondation de la sainte-Cha-pelle de Paris, Louis iX avait fait don à saint-quentin de fragments des reliques de la Passion qui étaient au cœur du trésor de la sainte-Chapelle (billot 1998, p. 28 et hémeré 1643, p. 232-233). Comme le rappelle le bas-relief offert par Wavrechin, le saint roi en personne avait ensuite assisté en 1257 à la dernière « translation » du corps du martyr et consa-cré l’édifice reconstruit. Ces actes hautement symboliques expliquent largement que les décrets cités par Morand pla-cent l’église de saint-quentin au rang des plus importantes saintes-Chapelles. du fait de son ancienneté, la collégiale picarde ne pouvait être considérée comme une sainte-Cha-pelle, puisque les institutions de ce type étaient (en dehors du cas très particulier de dijon) des fondations ex nihilo, qui supposaient la construction d’un nouvel édifice sur le modèle de celui élevé à Paris par saint Louis. Mais au regard de la vie capitulaire, saint-quentin partageait bien des caractéristiques de ces églises, à commencer par la très forte présence des officiers de cour (présence paradoxale, puisqu’ils étaient le plus souvent absents…) et l’attention constante
des souverains. Les ecclésiastiques de la cour qui furent à la fois chanoines de saint-quentin et de la sainte-Chapelle du Palais furent si nombreux qu’il est hors de propos de les énumérer. il suffira, pour en donner une idée, d’ajouter à ceux déjà évoqués ci-dessus deux dignitaires du XiV e siècle : Jean du Mont, Grand-Chantre de la sainte-Chapelle vers 1360, et Arnoul de Grand Pont, trésorier vers 1373 (hémeré 1633, p. 131-133).Au-delà de son statut voisin de celui des saintes-Chapelles, l’important est de comprendre quand et comment le cha-pitre de saint-quentin vint à figurer parmi ceux dont un nombre fixe de prébendes furent officiellement réservées par les rois de France à leurs chanteurs. Les décrets à cet égard datent, certes, de la seconde moitié du XVie siècle, mais il est évident qu’ils entérinaient et amplifiaient des pratiques qui avaient déjà cours. reste donc à savoir comment cette tradition s’était établie et à quand remontent les preuves d’une présence particulièrement marquée de la musique dans l’église.on peut admirer aujourd’hui, en haut du pan intérieur du mur de clôture dont il a déjà été question, les spectaculaires restes de peintures murales (fig. 4) représentant notamment la notation musicale de deux antiennes et une prose maria-les, réapparues en août 1917 suite à un incendie qui entraîna l’effondrement des voûtes maîtresses du chœur et détruisit les boiseries qui recouvraient tout le mur depuis 1808. Ces imposantes partitions de plain-chant peintes au-dessus des anciennes stalles, à l’identique de part et d’autre de la nef, permettaient à tous les officiers du chœur de les lire depuis leur place. dans une première étude, F. raugel considère que « la date de ces peintures ne semble pas devoir être fixée plus haut que le XV e siècle » (raugel 1925, p. 233) mais il écri-vit ensuite de façon péremptoire et sans explication qu’elles avaient été réalisées « autour de 1353 » (raugel 1961, p. 52). on peut supposer qu’il a déduit cette date de la chronologie du mur de clôture (et notamment d’une allusion de La Fons à une ordonnance capitulaire d’octobre 1353 ; La Fons 1649, t. i, p. 88). en l’absence de référence précise, il est en tout cas plus prudent de se contenter de noter que la graphie de ces peintures semble les situer dans la seconde moitié du XiV e ou au début du XV e siècle. Au vu des chants notés − l’un spé-cifique (une antienne des vêpres de la nativité de la Vierge, célebrée le 8 septembre), les deux autres bien plus répandus
La c
ollé
gial
e ro
yale
de
sain
t-que
ntin
et l
a m
usiq
ue
206
4
Peintures murales du chœur de la basilique, XV e siècle.saint-quentin, basilique.
(l’antienne Regina caeli et la prose du saint sacrement Ave verum corpus) − ces fresques doivent résulter de quelque fon-dation d’un riche donateur (que ni hémeré ni La Fons ne permettent d’identifier) qui accordait une importance par-ticulière à la qualité de l’interprétation collective des prières qu’il souhaitait faire chanter après sa mort. Aussi rares et impressionnantes qu’elles soient, elles ne révèlent cependant rien d’une pratique musicale polyphonique particulièrement plus développée qu’ailleurs. Mais en ajoutant à ces fresques
les anges musiciens du mur de clôture, et encore d’autres anges musiciens (fig. 5-7) installés sur un portail latéral de la collégiale au XV e siècle, l’ensemble du spectacle visuel offert par les murs de saint-quentin accordait manifestement une place inaccoutumée à la musique.L’accession de chantres de cour au statut élevé de chanoine n’avait en tout cas rien de commun au XiV e siècle. en dehors des cas de Machaut et Vitry, peut-être prémonitoires, les traces de musiciens liés à saint-quentin à cette époque se
207
Davi
d Fia
la
Anges jouant du rebec,relief provenant du décor du portail latéral ouest, XV e siècle.saint-quentin, basilique.
Anges jouant du psaltérion,relief provenant du décor du portail latéral ouest, XV e siècle.saint-quentin, basilique.
5 6
résument à deux cas. Le premier est celui d’un chantre ori-ginaire de la ville, qui servit la prestigieuse chapelle du pape Clément Vi : Jean de saint quentin (ou, comme le précise Étienne Anheim, Johannes Joannis de Marchi, de sancto quintino, ce qui confirme son origine et permet de le dis-tinguer d’un médecin homonyme cité à la même époque à Avignon). Ce prêtre du diocèse de noyon qui servait la curie dès 1317, sous Jean XXii, et figure parmi les chape-lains de benoît Xii (pape de 1334 à 1342), reçut en bénéfice la paroisse de saint-Germain de Prémont (à quelques kilo-mètres de saint-quentin) par une lettre qui le qualifie de « copiste et chantre de la chapelle pontificale » (tomasello 1983, p. 248). en 1339, il fut d’ailleurs chargé d’acheter du parchemin à Carpentras « pour transcrire les livres du pape ». sous le pontificat de Clément Vi, une supplique de 1343 indique qu’il était atteint d’une grave infirmité et deman-
dait le droit de choisir son confesseur in articulo mortis, mais il est encore cité en septembre 1344. il semble avoir fini sa vie dans la région d’Avignon, sans jamais devenir chanoine de saint-quentin, contrairement à un autre chantre de la chapelle pontificale, cité par hémeré parmi les chanoines illustres de la fin du XiV e siècle : « Willel. de ultraaquam, chapelain du pape et chanoine de Villeneuve-lès-Avignon » (hémeré 1643, p. 298). Ce Guillelmus de ultraaquam ou Guillaume d’outreau est effectivement connu pour avoir fait partie d’un groupe de quatre chanteurs du duc Louis ier d’Anjou restés au service du pape en 1382, alors que leur pro-tecteur partait à la reconquête de son royaume de naples (nádas 2003, p. 189). il figure sur toutes les listes de la cha-pelle pontificale d’Avignon conservées pour le pontificat de Clément Vii, en octobre et décembre 1382 puis en novembre 1393 (Günther 1964, p. 180 et 185) et obtint une prébende de
La c
ollé
gial
e ro
yale
de
sain
t-que
ntin
et l
a m
usiq
ue
208
7
Anges jouant de la flûte,relief provenant du décor du portail latéral ouest, XV e siècle.saint-quentin, basilique.
Cambrai en mai 1393. il ne figure plus parmi les chanteurs retenus dans la chapelle de benoît Xiii en octobre 1394, mais réapparaît comme scriptor (secrétaire) de la curie du pape d’obédience pisane Alexandre V, élu en 1409 (nádas 2007, p. 264). il côtoya donc à Avignon des compatriotes picards dont des œuvres sont connues − notamment Mathieu de saint-Jean, qui avait servi, comme lui, Louis ier d’Anjou puis Clément Vii −, mais aucune composition conservée ne lui est attribuée.Le nombre de chantres musiciens dont des liens à saint-quentin sont avérés ne croît guère avec le XV e siècle. Mais une affaire relatée par hémeré révèle que la faveur princière pouvait alors s’étendre de façon démesurée sur de modestes chantres. en 1416, la reine isabeau de bavière nomma Jean Jouffroy (ou Geoffroy, en latin Johannes Gaufridi), un jeune clerc et sommelier de la chapelle du duc de bourgogne Jean
sans Peur (dont il était encore enfant de chœur en 1412), à la haute responsabilité de coûtre (custos) de saint-quen-tin, laissée vacante par la promotion d’henri de savoisy à l’archevêché de sens (ce qui donne une idée du rang de cette dignité). hémeré s’indigne sans détour qu’on ait ainsi pu envisager de « consacrer une telle pourpre à ce singe » (« istam simiam haec purpura decedebat »), autrement dit : qu’on ait pu « donner une telle perle à ce pourceau » ! L’affaire sou-leva évidemment des oppositions et c’est finalement Louis de Melun, un autre futur archevêque de sens, qui hérita de la dignité (hémeré 1643, p. 308). Au cœur de la guerre civile qui faisait alors rage entre les Armagnacs et les bour-guignons, cette erreur d’appréciation de la reine résulta sans doute plus d’un signe de faveur envers le duc de bourgogne que d’un goût immodéré pour les talents du jeune Jouffroy, qui ne réapparut pas à saint-quentin et n’est plus cité que comme chapelain de la sainte-Chapelle de dijon en 1438 (sur sa carrière, voir Wright 1978, p. 96, 104, 121, 232-234). Cette anecdote annonce cependant un basculement dans l’histoire du chapitre de saint-quentin.suite au traité d’Arras signé entre le roi de France et le duc de bourgogne en 1435, par lequel les villes de la somme étaient cédées à Philippe le bon, le droit de collation des prébendes et des dignités de saint-quentin fut détenu jusqu’en 1470 par Philippe le bon puis (à partir de 1467) par son fils, Charles le téméraire. Parmi les chanoines nommés par ces princes (hémeré 1643, p. 316), on relève : toussaint de La ruelle, chapelain du duc (1439) ; Jean [recte hughes] Michot, aumônier de Charles, comte de Charolais (1452) ; nicaise du Puis, prévôt d’utrecht et premier chapelain de la chapelle domestique du duc, et Gilles Le brun, chapelain du comte de saint-Pol (1453) ; Jean Paille, chapelain d’An-toine de berghes (1456) ; Jean [recte innocent] de Cressy, conseiller et aumônier du duc, et nicolas dentis, bachelier en théologie et savant au service du duc (1468). dans son ensemble, cette liste apparemment relativement complète s’inscrit dans la lignée des pratiques antérieures en matière de distribution des bénéfices de saint-quentin, réservés aux plus hauts serviteurs ecclésiastiques des souverains ou de leurs alliés. Parmi ceux cités ci-dessus, seul toussaint de La ruelle faisait alors une carrière de chantre (voir l’article de d. Fiala, « in memoriam ») et il est probable qu’aucun d’entre eux ne résida finalement à saint-quentin, à l’exception
209
Davi
d Fia
la
de Jean Paille, dont l’épitaphe (relevée par La Fons 1649, t. i p. 106) indique qu’il mourut en 1507 et ordonna une riche fondation dans l’église, incluant une prière chantée par les enfants de chœur. en 1470, l’habitude de nommer des chantres musiciens aux prébendes de saint-quentin n’était manifestement pas encore installée, et c’est donc dans les décennies suivantes que s’opéra le changement. Cette évo-lution importante pour l’histoire sociale des musiciens se déroula dans la décennie 1500, par la volonté d’un souverain précis : Louis Xii, roi de France de 1498 à 1515.
Louis XII, bienfaiteur de la musique à Saint-Quentin
Peu d’évolutions majeures de l’histoire ancienne du mécénat musical sont aussi précisément connues et datées que celle initiée par Louis Xii à saint-quentin. Les informations à ce sujet sont en outre d’une importance particulière car, alors que ces années furent sans doute parmi les plus fastes de l’histoire de la chapelle royale, la documentation de la cour souffre d’irrémédiables lacunes, puisqu’aucune liste d’effectif n’a été conservée entre 1486 et 1514.La volonté royale se manifesta à saint-quentin par deux actions complémentaires : d’une part, la nomination comme chanoines de trois des plus grands compositeurs de l’his-toire de la musique de la renaissance − Loyset Compère, Jean Mouton et Josquin desprez ; d’autre part, la mise en place, en 1509, d’un système de financement pérenne pour la maîtrise. Ces deux décisions sont de toute évidence com-plémentaires mais il semble clair, ne serait-ce que par la chronologie des faits, que la seconde découle de la première : le soutien qu’apporta Louis Xii au financement de la maî-trise en 1509 était sans doute au moins en partie un geste de compensation visant à faire accepter au chapitre l’idée de recevoir en son sein un nombre croissant de chanteurs de la chapelle royale.Avant de se pencher sur l’histoire délicate des nominations de chantres royaux aux prébendes de saint-quentin autour de 1500, on commentera brièvement la charte de 1509 par laquelle le roi pérennisa le financement de la maîtrise. Par cet acte important (voir ci-contre), le roi affecta, à la demande du chapitre, tout le revenu d’une prébende dont le titulaire se désistait à l’entretien de huit enfants de chœur et de leur maître de musique. Charles Gomart, suivi par d’autres, écrit
que le chapitre aurait présenté cette requête à Louis Xii « à son avènement » (Gomart 1851, p. 219, puis raugel 1961, p. 53), mais c’est là une interprétation abusive d’un extrait d’une charte latine publié sans date par Colliette sous le titre de Libellus supplex ad regem pro morticinio unius praeben-dae san-Quintiniensis in favorem puerorum symphoniacorum (« requête au roi pour l’extinction d’une prébende de saint-quentin en faveur des enfants de chœur » ; Colliette 1772, t. iii, p. 211-212). Cet acte s’inscrit sans le moindre doute dans la procédure définie par la charte royale de janvier 1509 et ne permet en aucun cas de supposer que le roi fut solli-cité dès 1498. tous ces documents indiquent sans ambiguïté que la maîtrise existait bel et bien déjà mais était jusqu’alors financée de façon informelle sur les biens du chapitre, sans qu’aucun acte officiel ne garantisse ses revenus. La charte de Louis Xii avait pour objectif premier de lui offrir cette garantie, en lui assignant une source de revenu clairement définie. Comme toujours dans ce genre de chartes de fonda-tions, en échange de la faveur que constituait la réaffectation de ce canonicat, le fondateur exigeait la célébration et le chant d’un certain nombre de prières et oraisons pour le « salut et remède de son âme ». Aucune ne requiert de poly-phonie, mais le projet général de cette charte est clairement rappelé à la fin du texte : en remplaçant un unique chanoine par neuf personnes, l’église bénéficiera d’une « chanterie et musique plus armonieuse, excellente et agreeable a dieu ». Les archives conservent des résumés ou des copies d’autres documents qui assurèrent la mise en œuvre de cette fonda-tion (bulles de Georges d’Amboise de février 1509, arrêt de la chambre des comptes de mars suivant), dont une sentence du bailli de saint-quentin de juillet 1514 (Ad de l’Aisne, G 784, p. 868-869) mettant le chapitre en demeure de remplir ses obligations prévues dans l’acte de fondation, et notam-ment de faire « faire dedans ung an d’huy ung tableau ou epitaphe notable en cuivre, comme en tel cas appartient, eslevé sur ung pilier, au quel seront representés les personnes du roy et de la royne ».
La c
ollé
gial
e ro
yale
de
sain
t-que
ntin
et l
a m
usiq
ue
210
Lettres patentes données à Blois en janvier 1509, par lesquelles Louis XII affecte les revenus d’une prébende à l’entretien d’un maître de musique et huit enfants de chœur(Ad de l’Aisne, G 784, p. 859-865 ; copie du XViiie siècle d’un original perdu).
entre plusieurs eglises, chapelles ou monastères, nos prédecesseurs, comtes de Vermandois fonderent celle du glorieux saint Martyr et ami de dieu monseigneur saint quentin dudit comté de Vermandois, laquelle ils firent magnifiquement construire et ediffier, et si la fonderent de 72 prébendes et dignités […] desquelles prebendes de toute ancienneté la collation et totale dispense est demeurée a iceulx nos predecesseurs et successivement a nous ; et combien que ce soit l’une des principales eglises collegialles ou chapelles de nostre dit royaume et que en toutes autres églises colégiales ou chapelles mesmement en icelles qui sont de fondation royalle y ait fondation expresse de maistre et enfans de cuer […] touttes fois par l’insti-tution de la ditte eglise n’a esté faict aucune mention ni ordonnance desdits maistre et enffans de cuer en icelle eglise de saint quentin, et jusques icy ont esté entretenus, nourris et alimentés des biens du doyen et chappittre de ladite eglise, lesquels nous ont fait humblement remonstrer que a l’occasion des guerres qui par longtemps ont regné et courru audit pays de Vermandois, leurs dictes prebendes sont grandement diminuées de revenu, tellement qu’ils ne pourroient plus bonnement soustenir la despence, nourriture et entretenement dedits maistres et enffans de cueur […] en nous requérant […] avoir pour agréable la suppression de l’une des dittes prebendes d’icelle eglise de saint quentin, de laquelle maistre Jehan blavet dit Caumont […] s’offre se demestre et devestir pour icelle estre employée a l’entretenement et nourriture de ung maistre et huit enfans de chœur en icelle eglise, lequel maistre y seroit mis par iceulx de chapitre, et lesquels pour l’augmen-tation et accroissement du dit service divin se soubzmettent et chargent en ce faisant de faire et continuer a jamais en icelle eglise outre leur fondation le service et suffrage qui s’ensuit : c’est assavoir que incontinent apres que complies seront dictes, le cloquement sera tenu par chacun jour sonner six coups de bateau contre la plus grosse cloche de la dicte eglise, et que entre chacun coup y ait distance de dire ung Ave Maria, affin de inciter et convoquer le peuple d’aller a l’eglise,
et apres ladicte cloche sonnee, lesdits enffans s’en yront dessoubz les chasses des glorieulx martyrs qui reposent en icelle eglise, assavoir est : messeigneurs saint quentin, saint Victorice et saint Cassien ; et illec diront une antheyne desdits martyrs avec la collecte ; ce fait lesdits enffans diront une antheyne de nostre dame, avec la collecte tant qu’il plaira a dieu nostre Createur donner vie a nous et nostre tres chere et amee compagne la royne, et apres nostre deces, ou lieu d’icelle antheyne de nostre dame, diront ung De profundis avec les collectes appartenantes, sembla-blement les dits enffans seront tenus apres leur disner et souper durant la vie de nous et nostre dicte compaigne de dire l’oroison Quaesumus omnipotens Deus ut famulus rex noster Ludovicus, et apres nostre deces, ou lieu d’icelle oraison diront ung De profundis, avec la collecte appartenante, et se chargent lesdits de chappitre de faire mectre et rediger par escripts en ung beau tableau en françois affin que chacun l’entende, lequel ils feront attacher et mectre contre l’ung des pilliers pres du grant autel tout le suffrage et service cy-devant declaré, et pareillement le feront escripre dedans le martreloge, affin que ceux qui viendront apres ne puissent dire chose au contraire. scavoir faisons que nous, ces choses considerées […], que au lieu d’une prebende qui n’est que pour ung homme, ils seront neuf personnes a servir icelle eglise et en sera la chanterie et musique plus armonieuse, excellente et agreeable a dieu, avons eu pour agreable le consentement dudit Me Jehan de blavet dit Caumont, chanoine prebendé en ladicte eglise, et lequel a ce jourd’huy resigné sadicte prebende en nos mains pour estre supprimée et le revenu d’icelle employée a la nourriture et entre-tenement desdits maistre et huit enffans de cœur, a icelle eglise et en tant que mestier ou seroit pour plus ample seureté, consentons que nostre saint pere le pape ou nostre tres cher cousin et feal ami le cardinal d’Amboise, legat en France, ou autre ayant puissance quant a ce, supprime ladicte prebende pour la nourriture et entretenement desdits huit enffans de cœur et de leurdit maistre, a la charge que dessus.
211
Davi
d Fia
la
entre ses deux publications de 1633 et 1643, hémeré a pro-gressivement pris toute la mesure de la place de la musique à saint-quentin et de l’action déterminante de Louis Xii en cette matière. dans son opuscule de 1633, seule la charte de 1509 fait l’objet d’un rapide développement expliquant la conversion d’une prébende en « revenus pour huit des petits enfants, qui seraient instruits à déchanter par les modes musicaux dans l’église » (« conversit in annonam octo infantulorum, qui musicis modulis in ecclesia decantandis imbuuntur » ; hémeré 1633, p. 158-159). Ce passage est consi-dérablement étendu dans la somme de 1643, qui consacre plus d’une page à l’explication de cette fondation, en citant des extraits de la bulle du cardinal d’Amboise (hémeré 1643, p. 336-337). il établit ensuite le lien entre cette fondation et l’apparition contemporaine de musiciens talentueux au sein du chapitre, qu’il explique par le goût de Louis Xii pour la musique (Idem, op. cit., p. 337-338) :
Grand amateur de musique et de consonnance des voix, Louis [Xii] fut le premier à introduire des chanteurs de sa cour aux prébendes de saint-quentin, que les rois précédents n’attri-buaient qu’à leurs aumôniers, sommeliers et autres officiers de leur chapelle, mais rarement à des chanteurs ; ces derniers étant habitués au privilège de percevoir leur portion canoniale même en étant absents, les rois avaient coutume d’écrire en leur faveur au chapitre de saint-quentin. […] C’est pourquoi c’est surtout à la période de Louis Xii que nous eûmes pour chanoines et maîtres de l’école de chant des musiciens du plus grand talent : Josquin des Prez, Charles de Villars, Fromen-tin, Louis Compère, bournonville, etc. passés à la postérité par leurs écrits. et à cette époque furent introduites les modula-tions harmoniques dans certaines églises de France, comme à reims où l’on chantait en plaines notes égales jusqu’en 1465, quand fut envoyé de Cambrai un clerc du nom de Petit Jean qui enseignait l’art du chant et de la musique à l’école de Cam-brai et s’en vint à reims ; d’autres très riches églises résonnaient cependant de la modulation des voix et des orgues bien avant cette époque. Ainsi, l’évêque robert de Chartres, qui mourut en 1164, fut le premier à introduire la symphonie des voix dans son église ; et celle de saint-quentin était censée en user aux siècles les plus anciens, comme le montrent plusieurs exemples produits dans cette chronique.
si cette présentation générale de l’histoire de la musique à saint-quentin semble juste, et notamment son identifica-tion du rôle de Louis Xii en la matière, ici apparaissent des informations incertaines ou confuses qui ne feront que s’am-plifier dans l’autre développement qu’hémeré consacre à la musique, quelques pages plus loin : son évocation de Josquin desprez. qualifiant de « passage A » les pages sur Josquin et de « passage b » l’évocation du règne de Louis Xii citée à l’ins-tant, le biographe de Josquin, d. Fallows, affirme que, dans ce passage b, « tous les détails vérifiables s’avèrent corrects » (Fallows 2009, p. 15). en effet, comme d’autres faits qui y sont rapportés, l’anecdote concernant Petit Jean est relatée par divers auteurs. Pour autant, plusieurs détails de ce texte s’avèrent étrangement invérifiables, à commencer par la liste des musiciens censés avoir exercé leur art à saint-quentin à l’époque de Louis Xii. si les noms de Josquin et Com-père sont bien à leur place, les autres posent tous problème car aucun ne peut être identifié à l’époque de Louis Xii. Ainsi, toutes époques confondues, aucun Carolus de Villari (Charles de Villiers, Villers ou Villars) n’est connu comme musicien (et il ne peut s’agir d’une confusion avec Charles Villiers de L’isle Adam, évêque de beauvais mort en 1535). Pour ce qui est du nom Bornovillam (bournonville), on voit mal comment il ne renverrait pas à Jean de bournonville, qui fut effectivement maître des enfants de saint-quentin, mais un siècle après Louis Xii, autour de 1612. de même, le nom de Frumentinum (Frumentin, Fromentin, Fourmentin, etc.) évoque surtout celui du compositeur « Fourmentin » auquel quatre chansons parues à Paris entre 1559 et 1562 sont attribuées (sans indication de prénom). Ce dernier est probablement Philippe Fromentin, chantre du diocèse de noyon, cité comme vicaire et maître des enfants de la cathé-drale de reims en 1558 (Lesure 1999, p. 252), mais un Jacques Fourmentin ou Fromentin figure également parmi les musi-ciens présents aux obsèques du roi henri ii en 1559 (dont une liste recense « les petits chantres de chambre, [y] com-prins le joueur de lut nommez Jacques Fourmentin »), puis comme valet de chambre de Catherine de Médicis entre 1580 et 1585 (handy 2008, p. 148 et 155). Pour compliquer le tout, il faut signaler qu’un Fromentin fut bel et bien actif dans les milieux musicaux dès l’époque de Louis Xii, puisque la cathédrale de Cambrai engagea en avril 1503 un « ténoriste appelé Fromentin » (information communiquée par Alejan-
La c
ollé
gial
e ro
yale
de
sain
t-que
ntin
et l
a m
usiq
ue
212
dro Planchart d’après les actes capitulaires de la cathédrale conservés à la bibliothèque municipale de Cambrai, ms. 1064, fol. 448). Ainsi, à supposer qu’un bournonville ait aussi été actif dès cette époque (ce qui n’a rien d’impossible), la liste d’hémeré pourrait s’avérer moins inexacte qu’il n’y paraît, mais ces informations demeurent invérifiables pour l’instant.en somme, hémeré a bien identifié Compère et Josquin comme les principaux maîtres musiciens de cette époque mais le reste de sa liste laisse perplexe. on s’étonne en outre qu’il n’en dise nulle part un peu plus de Compère − les infor-mations de Gommart 1850, p. 251, et ses références en note à hémeré et Colliette trahissent une confusion pure et simple avec Josquin − et, surtout, ignore un troisième contempo-rain tout aussi fameux et important, Jean Mouton, alors qu’il avait sous les yeux, dans le pavement de l’église même, deux dalles funéraires que son collègue quentin de La Fons décrit précisément (La Fons 1649, t. i, p. 100-101) :
Plus bas, et assez proche de la porte du revestiaire, il y a deux sépultures : l’une est de Me Louis Compère, Chanoine et Chancelier de cette eglise, avec ces vers écrits tout à l’entour qui nous apprennent qu’il est mort le 16 d’août, l’an 1518.
L’autre est de Me Jehan de holluygue et porte cet écrit : « Cy-gist Me Jehan de holluygue, dit Mouton, en son vivant Chantre du roi, Chanoine de Thérouanne et de cette eglise, qui trespassa le pénultième jour d’octobre MdXXii. Priez dieu pour son âme. »
Manifestement, hémeré ne regardait pas le pavement quand il traversait l’église. heureusement, comme le rapporte La Fons dans son chapitre suivant (consacré, après les dalles du pavement, aux épitaphes murales), Compère avait aussi fait installer une épitaphe gravée sur une lame de cuivre sur un pilier de l’église (près de la chapelle notre-dame de Lorette ; La Fons 1649, p. 110-111) :
L’autre est de Pierre-Louis [sic] Compère, Chanoine et Chan-celier de cette eglise, dont le corps gît sous une grande pierre noire ; en cette épitaphe, sur une lame de cuivre est écrit :
et ici sont deux mains jointes ensemble, avec ces mots : Comme à Compère.
en dehors de l’inattention d’hémeré aux pavements qu’il foulait, il y a une autre explication au fait qu’il cite Com-père en oubliant Mouton. Le premier semble avoir été bien plus longuement et étroitement lié à l’église que le second, puisque son canonicat de saint-quentin est attesté dès novembre 1491 (d’après un document fiscal du diocèse de Coutances cité dans l’article « Compère » du New Grove Dic-tionary, rifkin et alii 2001) et que La Fons lui attribue le titre de « chancelier » (information dont aucune autre trace ne
hoc tegitur saxo Ludovicus Compater, unus Musarum splendor dulcisonumque decus.Mille annis jungas, quingentos, ter quoque senos, sextano [sic] Augusti morte solutus obit.quisquis praeteriens legis haec, subsiste parumper : Fer quamcumque potes manibus ejus opem.
sous cette pierre git Louis Compère, unesplendeur des muses et gloire des doux sons.Mille ans ajoutés à cinq cents et trois fois six,Le seizième d’août, délié par la mort, il expira.toi qui passes, lis ceci, et demeure un instant,Apporte toute assistance possible à ses mânes.
epitaphium Ludovici Compatris, quondam hujus ecclesiae celebris Canonici et musici, cantorisve eximii.Clauditur obscuro Ludovici Compatris antro rodenda à propriis hic caro verminibus : Musas, dum vixit, nobis confrater amœnas excoluit, manes sint ubi vita docet. Carmina quae tumulo sunt circumscripta legenti Annus quo periit proditur atque dies.L’an 1518, en août 16e jour ;
Épitaphe de Louis Compère, jadis célèbre chanoine de cette église, musicien et chanteur accompli.en cet antre obscur est enfermée de Louis CompèreLa chair destinée à y être rongée par sa propre vermine.de son vivant, confrère parmi nous, il cultiva les charmantes muses ; que ses mânes trouvent un séjour conforme à sa vie.Ces vers écrits autour de son tombeau montrent à qui les lit l’an et jour où il périt : L’an 1518, en août 16e jour
213
Davi
d Fia
la
8
Josquin desprez,Memor esto verbi tui, motet à quatre voix, superius,Motetti de la corona libro primo, Fossombrone, ottaviano Petrucci, 1514, fol. 2v.bologne, biblioteca internazionale della musica.
subsiste). À l’inverse, Mouton ne semble avoir obtenu son canonicat que tardivement, au point que certains auteurs supposent qu’il aurait pu hériter de celui laissé vacant par la mort de Compère en août 1518. Cette hypothèse est peu pro-bable, car, le 14 juin 1518, l’ambassadeur du duc de Ferrare Alphonse ier d’este à la cour de France, écrivait à son maître que « Mouton a été envoyé aujourd’hui en Picardie pour aller chez lui, et on ne sait quand il reviendra » (Lockwood 1979, p. 216), une allusion qui pourrait renvoyer à saint-quentin et indiquer que Mouton était bien chanoine de cette église avant la mort de son confrère.
hémeré, Josquin et les chaises musicales
si les épitaphes de Compère et Mouton dans la collégiale de saint-quentin signalent déjà cette église comme un haut lieu de la vie musicale religieuse en France au début du XVie siècle,
elles ne pèsent pas lourd face à ce qu’il faut bien appeler un casse-tête historiographique : le mythe de l’association de Josquin, le « prince des musiciens » de son temps, avec saint-quentin. Cette hypothèse est débattue depuis les tout premiers écrits musicologiques sur les compositeurs de cette période, dont le rapport de raphaël Kiesewetter publié en 1829 en réponse à un concours de l’académie royale des Pays-bas sur la contribution des musiciens néerlandais à l’art musical des XV e et XVie siècles. tout le problème de l’incertaine association de Josquin avec saint-quentin vient du second passage sur la musique à saint-quentin publié par le chanoine hémeré (récemment discuté par Fallows 2009, p. 14-16). Ce passage présente une célèbre anecdote, dont d’autres versions sont connues, sur Josquin et l’origine de l’un de ses plus beaux motets. hémeré a publié ce récit à la fois dans son livre de 1633 et, moyennant quelques modifications, dans celui de 1643. Ces deux versions du texte et leurs traductions sont présentées ci-contre.
La c
ollé
gial
e ro
yale
de
sain
t-que
ntin
et l
a m
usiq
ue
214
Le bénéfice de Saint-Quentin promis à Josquin et son motet Memor esto verbi tui
hémeré 1633, p. 161-162 [entre deux entrées datées en marge de 1543 et 1545]
hémeré 1643, p. 342
Josquinus à Pratis Magister symphoniae regiae sub Francisco. Canonicus sancti quintini. huic Francisco rege pollicito saepe primam praebendam vacaturam, aulicis autem aliis quietius, oculatiusque motum aquae praestolatis, et hora opportuniore in piscinam insilientibus, praevortentibusque atque excludentibus Josquinum expectato beneficio. in musicos hic modos composuit hunc versiculum. Memor esto verbi tui servo tuo Domine, in quo mihi spem dedisti, regique obtulit : rege demum verbi sui memore et promissi, praeben-dam vacantem conferente, mutavit ille symphonista numeros et versum et musicè hunc alium modulatus est. Bonitatem fecisti cum servo tuo Domine, secundum verbum tuum. Fuit ille cantandi arte clarissimus. i. infantulus Cantor in choro sancti quintini, tum ibidem musicae praefectus, postremo Magister sym-phoniae regiae.
Josquinus à Pratis symphoniae regiae Magister sub Fran-cisco cui rege pollicito saepe prebendam primam vacaturam in eadem ecclesia et aulicis aliis oculatius aquae motum praestolatis et in piscinam per Francisci beneficium insilien-tibus, praevortentibusque atque excludentibus Josquinum expectato promissoque Canonicatu, Ad musicos modos aptavit Josquinus hunc versiculum Memor esto verbi tui servo tuo Domine in quo mihi spem dedisti et coram rege decantavit. itaque rege verbi sui promissique memore et praebendam vacantem conferente, mutavit symphoniarchus numeros et versum et Musicè hunc alterum modulatus est Bonitatem fecisti com servo tuo, Domine, secundum verbum tuum. Fuit ille cantandi arte clarissimus, primo infantulus cantor in ecclesia sancti quintini tum ibidem musicae praefectus postremo capellae musicae regiae magister.
Josquin des Prez, maître de la musique royale sous François [ier]. Chanoine de saint-quentin. Comme ce roi François lui avait promis à plusieurs reprises la première prébende vacante mais que d’autres cour-tisans attendaient avec plus de calme et d’attention le « mouvement de l’eau* » et se ruaient « dans la piscine* » à une heure plus opportune, devançant et excluant Josquin du canonicat attendu, il composa alors sur les modes musicaux ce verset « souviens-toi de la parole que tu as donnée à ton serviteur, seigneur, dans laquelle j’ai mis mon espoir » et le présenta au roi : le roi se souvenant enfin de sa parole et de sa promesse et lui ayant octroyé la prébende, ce maître de musique changea profondément les vers et la musique et modula cet autre [motet :] « tu as fait le bien à ton serviteur, seigneur, comme tu l’avais dit ». très célèbre dans l’art du chant, il fut petit enfant chanteur dans le chœur de saint-quentin, puis maître de musique en ce même lieu, et enfin maître de musique du roi.
Josquin des Prez, maître de la musique royale sous François [ier] : alors que le roi lui avait promis à plusieurs reprises la première prébende vacante dans cette église et que d’autres courtisans attendaient avec plus d’attention le « mouvement de l’eau* » et se ruaient « dans la piscine* » pour obtenir le bénéfice de la part de François, devançant et excluant Josquin du canonicat espéré et promis, Josquin adapta aux modes musicaux ce verset « souviens-toi de la parole que tu as donnée à ton serviteur, seigneur, dans laquelle j’ai mis mon espoir » et le fit chanter devant le roi. Aussi, le roi s’étant souvenu de sa parole et de sa promesse et lui ayant octroyé la prébende, le maître de musique changea profondément les vers et la musique et modula cet autre [motet :] « tu as fait le bien à ton serviteur, seigneur, comme tu l’avais dit ». très célèbre dans l’art du chant, il fut petit enfant chanteur dans l’église de saint-quentin, puis maître de musique en ce même lieu, et enfin maître de musique du roi.
* n.b. : Les allusions de ce récit au « mouvement de l’eau » et à la « piscine », bien obscures aujourd’hui, illustrent le genre d’ironie que maniait un docteur de la sorbonne au XViie siècle ; hémeré fait ici allusion au chapitre V de l’Évangile selon saint Jean qui relate la guérison miraculeuse d’un paralytique par le Christ au bord de la piscine de bethsaïda : à Jérusalem, des infirmes se regroupaient autour de ce bassin « car l’Ange du seigneur descendait, en un certain temps, dans la piscine, et l’eau s’agitait. et celui qui le premier descendait dans la piscine après le mouvement de l’eau était guéri de son infirmité, quelle qu’elle fut ». dans un contexte de vie curiale, le « mouvement de l’eau » est une amusante métaphore de l’arrivée du roi et de son entourage, et « se ruer dans la piscine », comme on « se jette à l’eau » ou on « descend dans l’arène », consiste à fendre la foule pour approcher le roi et lui présenter sa requête. Les courtisans guettant le moment opportun pour réclamer une faveur royale sont donc ironiquement assimilés aux infirmes de Jérusalem attendant la venue d’un ange.
215
Davi
d Fia
la
La crédibilité de ce récit d’hémeré est sérieusement affai-blie par son évocation de François ier. d’un point de vue strictement chronologique, il n’est pas impossible que Jos-quin ait été, dans ses dernières années, en contact avec François ier, mais il est invraisemblable qu’une telle fin de vie « à la Léonard de Vinci » n’ait laissé aucune autre trace, d’autant qu’on dispose de documents sur la chapelle royale entre l’avènement de François ier en 1515 et la mort de Josquin en 1521. en outre, deux autres auteurs relatent cette même anecdote sur l’origine du motet Memor esto verbi tui de Josquin non pas en relation avec François ier mais avec son prédécesseur, Louis Xii (textes réunis dans osthoff 1965, vol. 1, p. 207). en revanche, aucun de ces deux récits n’indique quel bénéfice avait été promis à Jos-quin, hémeré étant le seul à spécifier qu’il s’agissait d’une prébende de saint-quentin. Le premier de ces textes, publié par le théoricien de la musique heinrich Glaréan dans son principal traité (Dodecachordon, 1547), semble particulièrement fiable puisque l’auteur avait passé les années 1517-1522 à Paris et y avait côtoyé des musiciens sans doute bien informés. Le second récit, publié par opmeer en 1611, fournit un détail supplémentaire sur la composi-tion du motet mais n’ajoute aucun élément biographique aux autres versions. Pour achever de semer le trouble, une anecdote similaire figure encore dans des lettres rédigées en 1516-1517 par un ambassadeur vénitien à la cour du roi d’Angleterre, qui racontent que dionisio Memo, l’orga-niste vénitien favori du roi henri Viii, offrit un motet sur le texte « Memor esto verbi tui » à son employeur pour lui rappeler une promesse non tenue. que Memo se soit inspiré de Josquin pour agir ainsi est probable, ce qui confirme que l’anecdote concernant Josquin doit se situer avant 1516. son motet était d’ailleurs déjà paru dans le premier livre des Motetti de la corona de l’imprimeur otta-viano Petrucci, dont la première impression porte la date du 17 août 1514 (fig. 8).L’imbroglio de ces quatre récits de l’origine du motet Memor esto verbi tui est discuté par r. C. Wegman (Wegman 1999, p. 324-328), qui qualifie leurs divergences et leurs incohé-rences de « cas d’école de transmission orale ». sa conclusion prudente sur la foi à accorder à cette histoire pour la bio-graphie de Josquin s’appuie notamment sur un argument (Idem, op. cit., p. 327) :
La seule façon de corroborer les récits de Glaréan, opmeer et hémeré serait d’identifier le bénéfice que Louis Xii aurait accordé à Josquin (ce qui permettrait aussi de dater Memor esto). Mais Louis régna de 1498 à 1515, et on ne connaît aucun bénéfice reçu par Josquin pendant ces années.
il se trouve que cette question posée en 1999 a reçu une réponse en 2001 avec la découverte de la première mention, justement au début des années 1500, d’un bénéfice de Jos-quin… à la collégiale de saint-quentin. deux documents notariaux découverts en italie (Merkley 2001) permettent de reconstituer les grandes lignes d’un « petit arrangement entre amis » qui n’impliqua pas moins de deux compositeurs de premier plan − Loyset Compère et Josquin −, un chanteur de renom − Pierre du Wez, chantre de la chapelle des ducs de bourgogne de 1465 à 1494 −, et un juriste − baude Le Clerc, doyen de la collégiale notre-dame de Condé-sur-l’escaut, qui eut également des liens avec la cour de bourgogne-habs-bourg. Par ces deux actes passés le 30 mai 1503 devant un notaire de Ferrare, Josquin, qualifié de chanoine de saint-quentin, désigne baude Le Clerc comme son procureur afin de procéder à la résignation de sa prébende de saint-quentin. Les deux procurations, qui mentionnent chacune une pro-cédure un peu différente, semblent avoir été conçues pour être utilisée alternativement, en fonction de l’évolution de la situation et des opportunités. La première assigne deux tâches à Le Clerc : 1. résigner la prébende de Josquin à saint-quen-tin afin de la permuter avec Loyset Compère, qui cède en échange sa chapellenie perpétuelle de l’hôpital du saint-esprit à douai ; 2. obtenir des lettres de nomination de Josquin à la prévôté, canonicat et prébende de la collégiale notre-dame de Condé-sur-l’escaut. La seconde procuration fixe un objec-tif plus général : Le Clerc y est également chargé de résigner la prébende de Josquin à saint-quentin, mais afin de procé-der à « une permutation simple, triple ou quadruple avec tout bénéfice que toute personne accepterait d’échanger […] afin que ledit contractant [Josquin] obtienne la prévôté, canonicat et prébende de la collégiale notre-dame de Condé-sur-l’es-caut détenue par Pierre du Wez » (Merkley 2001, p. 550-560). Ainsi, les documents qui montrent que Josquin fut chanoine de saint-quentin sont aussi ceux qui planifient sa démission, et on peut en déduire que le compositeur ne résida jamais durablement à saint-quentin à la fin de sa vie.
La c
ollé
gial
e ro
yale
de
sain
t-que
ntin
et l
a m
usiq
ue
216
La découverte d’un projet d’échange d’une prébende de saint-quentin détenue par Josquin au printemps 1503 rehausse considérablement la crédibilité du témoignage d’hémeré, seul auteur à avoir publié cette information. Certes, il se trompa sur l’identité du roi qui avait conféré cette prébende à Josquin ; mais si cette erreur jette la sus-picion sur d’autres éléments de son récit, elle montre aussi qu’hémeré ne se contente pas ici de répéter Glaréan ou opmeer. en somme, il n’avait sans doute pas trouvé d’in-formations de première main dans les archives de son église, et son récit demeure donc une synthèse de témoignages émaillés d’incertitudes. Mais le seul fait qu’il ait souligné l’association de Josquin avec saint-quentin ouvre une piste biographique importante.La découverte des procurations actées par Josquin à Ferrare à la fin mai 1503 permet de circonscrire l’obtention de sa pré-bende à saint-quentin entre 1498 et cette date, mais d’autres informations invitent à préciser encore cette chronologie, car il est très probable que Josquin fit au moins un bref passage à saint-quentin dans ces années, très précisément les 16, 17 et 18 novembre 1501. il n’était alors pas en compagnie de la cour de France, mais dans la suite d’un autre prince qui enta-mait alors un long voyage : Philippe le beau de habsbourg, archiduc d’Autriche et duc de bourgogne, petit-fils de Char-les le téméraire, fils de l’empereur Maximilien ier et père de Charles quint. Philippe venait alors de quitter bruxelles, capitale de ses territoires, pour se rendre avec toute sa cour jusqu’en espagne afin de visiter les territoires dont devait hériter sa femme, Jeanne de Castille. Ce mémorable voyage dura près de deux ans, la cour séjournant en espagne toute l’année 1502, avant de regagner les Pays-bas par Perpignan et Lyon (qu’elle atteignit le 22 mars 1503), puis par la savoie, innsbruck et l’Allemagne. il subsiste au moins quatre récits contemporains de ce voyage − outre un récit de seconde main inséré par Jean Molinet dans ses Chroniques et un long récit détaillé d’Antoine de Lalaing, un seigneur de la cour (Gachard 1876), deux autres récits anonymes ont été publiés (par Chmel 1841, p. 554-655, d’après un manuscrit conservé à Vienne, et par Godefroy 1649, t. ii, p. 713-735 [réédité par Zeller 1889], d’après plusieurs manuscrits de la bibliothèque nationale de France). Ces récits retracent précisément l’iti-néraire de la cour et signalent ça et là l’audition de messes en musique dans les églises de villes où elle séjournait. Le nom
de Josquin n’apparaît dans aucun d’entre eux, pas plus que dans les registres administratifs de la cour de bourgogne, dont il ne fit jamais officiellement partie. Mais sa présence parmi la très nombreuse suite de Philippe le beau est attestée par ailleurs.un des plus fameux moments de ce voyage fut la réception de la cour de Philippe le beau par Louis Xii à blois au début décembre 1501. Le 13 de ce mois, l’ambassadeur ferrarais bar-tolomeo de’ Cavalieri écrivit à son maître, le duc hercule d’este :
J’ai trouvé ici un chanteur appelé Josquin que votre excellence a envoyé en Flandre pour trouver des chanteurs […] il dit que l’archiduc lui a demandé de l’accompagner en espagne et que l’archiduc a écrit à votre excellence pour voir si vous accepterez de le lui prêter (parmi d’innombrables citations et discussions de cet extrait, voir osthoff 1962, p. 51 et Fallows 2009, p. 198-203).
sans entrer dans les arguties qu’a soulevées ce document, disons que les musicologues s’accordent à admettre que ce « chanteur appelé Josquin » est bien le compositeur Josquin desprez, aussi modeste et anodine que soit la manière dont il est désigné dans cette lettre. il est d’autant plus probable qu’il ait effectivement fait tout ou partie du grand voyage de la cour de bourgogne que la mention suivante de son nom le situe au printemps 1503 à Lyon, où se trouvait la cour de Philippe le beau, sur le chemin du retour vers les Pays-bas. Cette information provient d’une lettre d’un autre ambassadeur italien, au service du marquis de Mantoue, qui écrivit à son maître, le 12 avril 1503 de Lyon, qu’un serviteur du duc de Ferrare venait d’arriver de Paris en compagnie du chanteur Verbonnet et de Josquin. La suite est bien connue : Josquin se rendit à Ferrare (où il fit dresser les procurations déjà citées à la fin mai) mais ne dirigea la chapelle d’her-cule d’este qu’une année environ, jusque vers 1504, date à laquelle il obtint finalement, une fois l’échange de bénéfice effectué avec Compère et du Wez, la dignité de prévôt de la collégiale notre-dame de Condé-sur-l’escaut. C’est dans cette bourgade voisine de Valenciennes, région dans laquelle il avait des attaches familiales, qu’il semble avoir passé les quinze dernières années de sa vie, dans un anonymat relatif étonnant en comparaison de l’incroyable essor de sa renom-mée internationale.
217
Davi
d Fia
la
Jean Mouton,Messe Benedictus dominus, Kyrie à quatre voix,manuscrit enluminé, atelier Pierre Alamire, vers 1520.bruxelles, bibliothèque royale de belgique, Occo Codex, ms. iV.922, fol. 42v-43.
9
La c
ollé
gial
e ro
yale
de
sain
t-que
ntin
et l
a m
usiq
ue
218
Davi
d Fia
la
si, comme c’est probable, Josquin était du voyage de la cour de Philippe le beau, il séjourna donc à saint-quentin à la mi-novembre 1501, puis à la cour de France le mois suivant. il peut être tentant d’imaginer que c’est lors des fastueu-ses journées de réceptions officielles à blois que Josquin se « rua dans la piscine » (pour reprendre les termes d’hémeré) et obtint son canonicat à saint-quentin de Louis Xii, qu’il pourrait bien avoir servi dans les années précédentes (comme le souligne Fallows 2009, p. 196-197, qui refuse cependant d’admettre que l’anecdote sur la composition de Memor esto concerne Louis Xii et maintient − sans vraiment convaincre − qu’elle renvoie à Louis Xi ; voir Idem, op. cit., p. 91-94). il semble encore plus probable que c’est au cours de ces mois de voyage que fut conçu le projet d’échange de bénéfices signalé par les documents dressés à Ferrare en mai 1503. si, en 1501, Pierre du Wez ne faisait plus partie de la chapelle de bourgogne depuis plusieurs années, Josquin pourrait fort bien l’avoir croisé avant le départ de la cour, entre douai et Condé-sur-l’escaut, où du Wez devait rési-der, tout comme baude Le Clerc. Compère était, lui aussi, retiré de la chapelle royale, mais il semble avoir été lié à la visite de la cour de bourgogne, puisque son motet Gaude prole regia, dont le texte met en scène la Flandre et la France louant sainte Catherine, pourrait avoir été composé pour la réception de Philippe le beau à Paris le 25 novembre 1501, jour de sainte Catherine.en dehors d’une lourde erreur chronologique initiale, l’évocation de Josquin par hémeré concorde assez remar-quablement avec les informations disponibles. quant au dernier point de son texte, l’éventuelle formation de Josquin comme enfant de chœur de saint-quentin, on trouvera dans la biographie de d. Fallows (Idem, op. cit., p. 15-17) une synthèse mesurée des éléments en faveur ou en défaveur de cette hypothèse qui demeure indécise. hémeré n’était pas très au fait de l’histoire de la chapelle royale, mais pour ce qui est de saint-quentin, il avait tout de même à sa disposition des documents disparus depuis. en résumé, si des recherches récentes situent clairement des ascendants de Josquin dans le hainaut, aux alentours de tournai et de Condé-sur-l’escaut, où il se retira, il n’est pas impossible qu’il ait été formé à saint-quentin, ni même qu’il ait dirigé un temps la maîtrise, dont les maîtres ne sont pas connus à cette période. un manuscrit musical copié vers 1540 le
désigne même comme belga Veromanduus, « belge [du] Ver-mandois » et, plus intriguant encore, le chapitre cathédral de bourges, qui avait eu en 1508 l’idée (saugrenue, à cette époque) de recruter Josquin comme maître des enfants, fit rembourser en 1509 un de ses membres qui avait engagé des frais pour aller rencontrer le compositeur « en Picardie ». il peut y avoir là une erreur, mais les informations sur le mode de vie de Josquin pendant ses dernières années étant inexistantes, l’idée qu’il lui soit arrivé de résider ailleurs qu’à Condé et qu’il ait maintenu des liens avec saint-quentin n’a rien d’invraisemblable. enfin, le fait que Compère déte-nait une prébende de saint-quentin dès 1491 et qu’il y finit sa vie inspire un dernier commentaire : cet aîné de Josquin et Mouton, qui demeure encore un peu dans leur ombre aujourd’hui, exerça une forte influence sur le jeune Josquin (Fallows 2009, entre autres p. 43-45). il est dès lors tentant d’imaginer qu’il ait enseigné un temps à saint-quentin et y eut Josquin parmi ses élèves. de façon moins hypothétique, il joua sans doute un rôle déterminant dans la transforma-tion du chapitre de saint-quentin en un lieu d’asile pour les chantres de la cour de France.La biographie des trois « héros » de l’histoire de la musique à saint-quentin vers 1500 tourne en grande partie autour d’échanges de bénéfices et autres petits arrangements qui ne disent pas grand-chose de la présence sur place de ces compositeurs majeurs. Comme on le voit, le statut de collé-giale royale, pour prestigieux qu’il était, n’avait pas que des avantages. Les rois de France usèrent et abusèrent de leur droit de collation aux bénéfices de saint-quentin pour y nommer leurs meilleurs serviteurs, qu’ils autorisaient à per-cevoir les revenus de leur prébende in absentia, c’est-à-dire sans jamais (être obligé de) résider sur place. Parmi ces offi-ciers, les musiciens de la chapelle royale figurèrent en bonne place à partir du règne de Louis Xii. Mais si le chapitre comptait donc officiellement dans ses rangs une partie des meilleurs musiciens de France, ces derniers ne contribuaient en réalité que rarement à la pratique musicale quotidienne de l’église. Au mieux, ils se retiraient sur place pour passer au calme les dernières années de leur vie, comme le firent Mouton, Compère et quelques autres. Au pire, leur titre de chanoine de saint-quentin n’était pour eux qu’un bout de papier qu’ils cherchaient à échanger contre des bénéfices qui, pour diverses raisons, les intéressaient plus. La biogra-
La c
ollé
gial
e ro
yale
de
sain
t-que
ntin
et l
a m
usiq
ue
220
phie de Josquin offre un exemple saisissant de ce genre de tractations qui s’organisait, bien loin de saint-quentin, entre collègues et amis qui se fréquentaient dans les plus grandes cours européennes ; au vu de telles opérations, on se dit que le chœur de saint-quentin était moins constitué de stalles que de chaises musicales. Mais au-delà de cette boutade, aussi rares qu’aient été les chantres de la cour qui, comme Compère, résidèrent vraiment à saint-quentin, il ne fait pas de doute que la nomination de musiciens émi-nents à ces prébendes eut un impact réel sur la vie musicale de l’église, que la perte de toute la documentation du per-sonnel musical ne permet pas hélas ! de mesurer. Autour de 1550, le Stabat mater de Josquin était en tout cas chanté au moins deux fois par an, suite à des fondations de l’écolâtre Charlet et du chanoine Cappet (hémeré 1643, p. 358 : « sacri rhythmi stabat Mater in pervigilio Paschalis notis musicis Josquini a Pratis in ecclesiae navi sub vesperam decantandi, Charleto scholastico instituente. ejusdem rhythmi musice item concinendi, feria quaque sexta quadregesimali in sacello Laurentano, per n. Cappetum canonicum. »).Le nombre de chanoines de saint-quentin issus de la cha-pelle royale crût considérablement à compter de la période de Compère, Josquin et Mouton, au point qu’il devient illusoire de chercher à tous les repérer. Contrairement à une information répétée depuis Gomart 1850 (p. 254-255), il est très improbable que le chanoine simon Alard, qui occupa la dignité de chantre vers 1530, ait quoi que ce soit à voir ni avec le « Allart » qui apparaît dans la chapelle royale en 1515 (et qui désigne le chantre Michel Allart) ni avec l’auteur du motet Dum transisset Sabbatum publié à Paris chez Attain-gnant en 1539 puis assez largement diffusé, toujours sous le nom d’« Alart », sans prénom ni initiale. Mais bien d’autres noms sont connus.Plusieurs de ces chantres servirent la chapelle de plain-chant (et non la chapelle de musique) du roi François ier. Jean baillet fut ainsi pourvu d’une prébende à saint-quentin en janvier 1525. Cité comme aumônier des enfants de France de 1533 à 1540, il quitta sans doute la cour pour entrer à la sainte-Chapelle du Palais, où son décès est signalé en mars 1542 (Cazaux 2002, p. 99 ; brenet 1910, p. 91). L’épitaphe de son collègue nicolas Cueil se trouvait bien, elle, dans l’église de saint-quentin :
Ci gist Me nicolas Cuel, prêtre, chanoine de l’Église de céans, natif de Péronne, et chantre du roi François, lequel a fondé un annuel le jour de saint Claude et deux obits perpétuels, le 12 de novembre, auquel il trépassa l’an 1550, et l’autre le [lacune] jour de may ; priez dieu pour lui.
bien que natif de Picardie, sa première mention le situe en 1508 à la collégiale saint-barnard de romans-sur-isère où, en 1515, il est recruté comme chanteur pour suivre la cour en italie (Viallet 2001, p. 170-172 et 202). Après avoir servi la chapelle de plain-chant au moins jusqu’en 1532 (Cazaux 2002, p. 350), il se retira donc à saint-quentin, dont il devait être chanoine depuis longtemps, car La Fons affirme qu’il avait été chargé de superviser la réalisation du premier bréviaire imprimé de cette église, publié à Paris par l’impri-meur hemon Le Fèvre vers 1520 (sur tout ceci, voir La Fons 1649, t. i, p. 94, 242 et 295, et t. ii, p. 166 et 186).Les chantres de la chapelle de musique ne furent évidem-ment pas en reste. Georges Le Vasseur, chantre de la chapelle du pape Léon X vers 1514 puis haute-contre de la chapelle de François ier de 1517 au plus tard à 1533 au moins, obtint une prébende de saint-quentin en avril 1527 (Cazaux 2002, p. 313 et 362). La chanson Tout d’un accord attribuée à « Vas-soris » dans les Motetti novi et chanzoni franciose imprimés par Antico en 1520 pourrait bien être de sa composition. un peu après, en avril 1539, Jean Le Maçon est mentionné pour la première fois comme « chantre ordinaire de la chapelle du roi », dans le cadre d’une affaire portant sur une prébende de la collégiale saint-Fursy de Péronne qui lui avait été attri-buée par erreur, le lendemain même du jour où elle avait été donnée à un autre officier de la cour ! en avril 1546, il obtint une prébende de chanoine à saint-quentin (Cazaux 2002, p. 362) et figure encore parmi les hautes-contre de la chapelle présents aux obsèques de François ier en 1547. il ne se retira sans doute pas à saint-quentin puisque sa mort est enregistrée le 26 juin 1550, « environ 3 heures apres midi », dans un registre de la sainte-Chapelle de Paris, dont il était chanoine depuis une date inconnue (brenet 1910, p. 98). sous le règne de François ier, on peut encore citer Gilles Parrain alias Petonis, décrit comme haute-contre puis taille de la chapelle entre 1532 et 1547, qui résigna une prébende de saint-quentin le 1er juillet 1546 (Cazaux 2002, p. 369), ou Adrien dine (ou dyne) : ce dernier n’apparaît pas dans
221
2
Davi
d Fia
la
Jean Mouton,Messe L’oserai ge dire, Kyrie à quatre voix,manuscrit enluminé, atelier Pierre Alamire, vers 1520.bruxelles, bibliothèque royale de belgique, Occo Codex, ms. iV.922, fol. 83v-84.
La c
ollé
gial
e ro
yale
de
sain
t-que
ntin
et l
a m
usiq
ue
222
Davi
d Fia
la
l’effectif de la chapelle, mais c’est bien par une charte royale qu’il avait obtenu sa prébende en septembre 1539 ; chanteur de la sainte-Chapelle, il y reçut un don le 8 juin 1560 pour le dédommager de son absence « pendant le temps qu’il a été à saint-quentin » (brenet 1910, p. 102-105).Le règne de François ier donne une idée de la régularité avec laquelle fonctionnait déjà le système de collation des prében-des de saint-quentin aux chantres royaux et il serait vain de vouloir recenser tous leurs collègues des règnes ultérieurs. quelques cas suffiront. Jean durantel dit Gigot, haute-con-tre de la chapelle de musique à partir de 1546 au moins puis chanoine de la sainte-Chapelle en juin 1553, encore cité à la cour en 1572, devint chanoine de saint-quentin l’année suivante, et mourut en 1582 (Cazaux 2002, p. 354). Martin Pain (Pani), récompensé d’une prébende de saint-quentin par provision royale de Charles iX en date du 16 juin 1563, figurait toujours parmi les onze basses-contre de la chapelle d’henri iii en 1578 (brooks 2000, p. 517). Clément de Fon-taine, chantre de la chapelle de musique dans les années 1570 et chanoine de saint-quentin nommé en mai 1578 (handy 2008, p. 467 ; brooks 2000, p. 478), était apparenté à Mathieu Parnille, un autre membre de la chapelle qui reçut des bénéfices en Picardie.L’histoire mouvementée des années qui suivirent la prise de la ville par les armées espagnoles en 1557, suite à une lourde défaite des troupes françaises, fournit une trace supplémen-taire de l’imbrication du chapitre avec la chapelle royale et la sainte-Chapelle de Paris. Alors que les chanoines étaient exilés, principalement à Paris, et cherchaient des lieux où s’y réunir, ils trouvèrent à tenir leur assemblée à deux reprises, les 23 juin et 3 juillet 1559, « en la maison canoniale de Me Claude de sermisi, chanoine de la sainte-Chapelle, en la cour du Parlement », évidemment le compositeur de la cour de France, d’origine picarde (La Fons 1649, t. i, p. 462-464 ; voir aussi hémeré 1633, p. 163). un autre membre éminent de la chapelle royale eut également à intervenir dans les déboires de l’église dans ces années. en 1561, le chapitre de saint-quentin donna procuration à François Charlet et Antoine subject, chanoines, qui avaient pour mission d’aller réclamer à la duchesse de Parme, Marguerite d’Autriche, gou-vernante des Pays-bas, les reliques et ornements enlevés par les espagnols à l’église de saint-quentin suite à la bataille de 1557 (Archives nationales, L 739, pièce n° 139). Cet Antoine
subject dit Cardot, auquel le chapitre de l’église accordait alors toute sa confiance est un des chantres de la cour les plus en vue de toute la seconde moitié du XVie siècle. né à Chateaurenard, dans le diocèse d’Avignon, le 7 octobre 1514, il fut enfant de chœur à Avignon, dans la maîtrise de la paroisse saint-symphorien puis dans celle de la cathédrale notre-dame des doms. Cité comme basse-contre de la chapelle de François ier puis chantre de la chambre à partir d’henri ii, mentionné au moins jusqu’en 1572, il fit une car-rière ecclésiastique exceptionnellement brillante : nommé doyen de tarascon en 1559 au plus tard, il fut archidiacre d’Avignon puis évêque de Montpellier de 1573 à sa mort en 1596. en 1559, le roi François ii avait écrit au cardinal Jean du bellay pour lui demander d’obtenir à rome un canoni-cat à notre-dame de Paris pour Cardot, parce qu’il désirait « veoir ledit doyen de tarascon pourveu de quelque beneffice ou il se puisse retirer plus prés de mes maisons que n’est ledit tarascon » (Cazaux 2002, p. 376-377, ici corrigé et complété sur la base de trouillet 1912, p. 286-287).Après que Charles iX eut promulgué le décret de 1571 évoqué ci-dessus, l’affectation systématique de prébendes de saint-quentin aux chantres de la chapelle entraîna la nomination de quelques autres personnalités de premier plan, dont le compositeur didier Leschenet (mort en 1603), dont une quinzaine de chansons et un Magnificat sont conservés. sous-maître de la chapelle de musique de 1559 à 1578 envi-ron, il est qualifié en 1578 de « compositeur » de la chapelle et chanoine de saint-quentin, où il ne semble avoir jamais résidé : après s’être installé à Meaux en 1584, il devint grand chantre de la sainte-Chapelle en 1589. un des chantres qui finirent par résider à saint-quentin est israël Le bouc, qui figure sur une liste des chantres de la chapelle d’henri iii dressée vers 1586 (brooks 2000, p. 490). son monument funéraire et épitaphe, décrits par La Fons, montrent qu’il fit en 1599 une fondation d’oraisons à chanter en polyphonie le jour de Pâques, incluant le legs d’un grand tableau représen-tant la Passion, la résurrection et l’Ascension :
de là [5e pilier du côté droit] tirant à gauche, contre le gros pilier de la croisée devant le Crucifix, se trouve l’épitaphe de Me israël Le boucq, Chanoine, en un grand tableau où est peinte l’histoire de la passion de n.-s., de sa résurrection et ascension, avec cette inscription : in honorem dei suaeque
La c
ollé
gial
e ro
yale
de
sain
t-que
ntin
et l
a m
usiq
ue
224
domûs dilectionem, venerabilis et discretus vir, Magisler israël Le boucq, hujus ecclesiae Canonicus, regiusque Capellanus, imaginem crucifixi et adjunctas depingendas atque historiam hâc tabellâ expressam hic statuendam curavit, necnon preces pietatis plenas sub dies Paschae, horam sextam vespertinam, hâc in ecclesià decantandas instituit et fundavit, anno domini 1599. requiescat in pace (La Fons 1649, t. i, p. 116).
il avait également contribué à la décoration du chœur :
Le Crucifix élevé au milieu de l’Église est très-bien fait avec les figures de la Vierge et de saint Jean, qui sont posées sur une grande poutre revêtue de part et d’autre d’une belle menuiserie de trois pieds de hauteur. en la face qui regarde la nef, il y a 25 figures en bosse, au milieu desquelles sont les pieds de la croix et la figure de saint quentin, qui a, à son côté droit, les douze Apôtres, et à gauche les douze Prophètes. de l’autre face, qui regarde le chœur, sont dépeints, en plate peinture encore les douze Apôtres d’un côté, et saint quentin avec tous ses com-pagnons de l’autre, et tout au milieu, sous le pied de la croix, est dépeint à genoux Me israël Le boucq, Chanoine de cette eglise, qui a fait peindre et dorer toute la croix, le Crucifix et toutes les images, de côté et d’autre, l’an 1587 (Idem, op. cit., p. 75).
Conclusion
L’histoire de la musique à la collégiale royale de saint-quen-tin présente un profond paradoxe. du XiV e au XVie siècle, aucun chapitre du royaume de France ne peut se vanter d’avoir accueilli dans ses rangs autant de musiciens aussi éminents que les cinq grands noms qui lui furent attachés. dans le même temps, aucun nom des musiciens qui assu-raient le quotidien des exécutions musicales n’est connu. Cet état des connaissances résulte directement de l’état de la documentation et de l’historiographie. Alors que les archives ont disparu en 1669, les deux historiens qui écrivirent avant cette date transmettent avant tout une histoire de l’église par ses hommes illustres, malgré des méthodes différentes. Le travail de l’un, Claude hémeré, repose principalement sur l’étude de la composition du chapitre à partir de ses archives. L’autre, quentin de La Fons, témoigne d’un inté-rêt de nature archéologique pour l’édifice de son époque, et notamment pour ses inscriptions, une mémoire de pierre largement dominée par les plus importantes personnalités du chapitre. de ce matériau, il résulte donc d’abord une his-toire de la musique de l’église par ses quelques musiciens illustres.Pour autant, ces cinq figures s’inscrivent dans un modèle institutionnel : celui d’une « collégiale royale ». À bien des égards, l’histoire de la musique à saint-quentin se confond avec l’histoire du mécénat musical de la monarchie française. des étapes claires s’y perçoivent mais de Machaut à Josquin, et encore au-delà, la présence croissante de ces musiciens directement liés aux plus hauts pouvoirs de leur temps est d’une frappante continuité. de ce point de vue, et malgré les lacunes des archives, saint-quentin est de toute évidence l’un des plus hauts lieux de l’histoire de la musique dans le royaume de France.
225
Davi
d Fia
la
BIBLIogRAPhIe
n Frédéric billiet, « témoignages insolites dans les stalles au XVie siècle », in P. Guillot et L. Jambou (éd.), Histoire, humanisme et hymnologie. Mélanges offerts au professeur Édith Weber, Paris, Presses universitaires de Paris-sorbonne, 1997, p. 47-56
n Claudine billot, Les Saintes-Chapelles royales et prin-cières, Paris, Éditions du patrimoine, 1998
n roger bowers, « Guillaume de Machaut and his Canonry of reims, 1338-1377 », Early Music History, 23, 2004, p. 1-48
n Michel brenet, Les musiciens de la Sainte-Chapelle du Palais, Paris, Picard, 1910 (réimpression Genève, Minkoff, 1973)
n Jeanice brooks, Courtly Song in Late Sixteenth-Century France, Chicago, university of Chicago Press, 2000
n Friedhelm burgard, Familia Archiepiscopi : Studien zu den geistlichen Funktionsträgern Erzbischof Balduins von Luxemburg (1307-1354), trier, trierer historische Forschun-gen, 1991
n henry Cardon, « extraits du Journal de Charles de Croix, chanoine de l’église collégiale de saint-quentin (3 février 1645-3 octobre 1685) », Mémoires de la Société acadé-mique des sciences, arts, belles-lettres, agriculture & industrie de Saint-Quentin, 4e série, 12, 1896, p. 259-454 et 13, 1898, p. 66-258.
n Joseph Chmel (éd.), Die Handschriften der K.K. Hof-bibliothek in Wien, Wien, Gerold, 1841, p. 554-655
n Alice V. Clark, Concordare cum Materia : the Tenor in the Fourteenth-Century Motet, Phd dissertation, Princeton university, 1996
n Jean-Luc Collart, « saint-quentin », in bruno desachy et Jean-olivier Guilhot (éd.), Archéologie des villes. Démarches et exemples en Picardie : Abbeville, Amiens, Beauvais, Château-Thierry, Chaumont-en-Vexin, Com-piègne, Crépy-en-Valois, Laon, Noyon, Saint-Quentin, Senlis, Soissons, Vervins, Amiens, 16/1, 1999, p. 67-128
n Louis-Paul Colliette, Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique, civile et militaire de la province du Verman-dois, Cambrai, s. berthoud, 1771-1772, 3 vol.
n nicoles desgranges, « L’évolution de la maîtrise de saint-quentin de 1777 à 1835 », in bernard dompnier (éd.), Maîtrises & chapelles aux XVIIe & XVIIIe siècles : des institutions musicales au service de Dieu, Clermont-Ferrand, Presses universitaires blaise Pascal, 2003, p. 117-140
n Lawrence earp, Guillaume de Machaut : A Guide to Research, new York, Garland, 1995
n david Fallows, Josquin, turnhout, brepols, 2009n Arnold Fayen (éd.), Lettres de Jean XXII (1316-1334),
rome, bretschneider, 1908-1912, 3 vol.n Marcel Gachard, Collection des Voyages des souverains des
Pays-Bas, bruxelles, Académie royale de belgique, 1876, vol. i
n théodore Godefroy (éd.), Le cérémonial français, Paris, s. Cramoisy, 1649
n Charles Gomart, Notes historiques sur la maîtrise de Saint-Quentin et sur les célébrités musicales de cette ville, saint quentin, 1851 (réimpression Genève, Minkoff, 1972 : La Vie musicale dans les provinces françaises, ii)
n ursula Günther, « Zur biographie einiger Komponisten der Ars subtilior », Archiv für Musikwissenschaft, 21, 1964, p. 172-199
n isabelle handy, Musiciens au temps des derniers Valois (1547-1589), Paris, Champion, 2008
n Pierre M. L. héliot, La Basilique de Saint-Quentin et l’architecture du Moyen Âge, Paris, Picard, 1967
n Claude héméré, Tabella chronologica decanorum, custo-dum, canonicorumque regalis ecclesiae S. Quintini, Paris, A. de La Perrière, 1633
n Id., Augusta Viromanduorum vindicata et illustrata duobus libris, quibus antiquitates urbis et ecclesiae Sancti Quintini, Paris, J. bessin, 1643
n Karl Kügle, The Manuscript of Ivrea, Biblioteca capitolare, 115 : Studies in the Transmission and Composition of Ars Nova Polyphony, ottawa, institute of Mediaeval Music, 1997
n quentin de La Fons, Extraits originaux d’un manuscrit de Quentin de La Fons intitulé Histoire Particulière de l’Église de Saint-Quentin, éd. Charles Gomart, saint-quentin, doloy, 1854-1856, 3 vol.
n Xavier de La selle, Le service des âmes à la cour : confes-seurs et aumôniers des rois de France du XIII e au XV e siècle, Paris, École nationale des Chartes, 1995
n daniel Leech-Wilkinson, « Le Voir Dit : a reconstruc-tion and a Guide for Musicians », Plainsong and Medieval Music, 2, 1993, p. 103-140
n François Lesure, Dictionnaire musical des villes de pro-vince, Paris, Klincksieck, 1999
n Lewis Lockwood, « Jean Mouton and Jean Michel : French Music and Musicians in italy, 1505-1520 », Journal of the American Musicological Society, 32, 1979, p. 191-246
n Auguste Longnon (éd.), Pouillés de la province de Reims, Paris, imprimerie nationale, 1907-1908, 2 vol.
n Armand Machabey, Guillaume de Machaut, Paris, richard Massé, 1955, 2 vol.
n Guillaume de Machaut, Le Livre du Voir Dit, éd. Paul imbs et Jacqueline Cerquiglini-toulet, Paris, Le Livre de Poche, 1999
n Paul Merkley, « Josquin desprez in Ferrara », The Journal of Musicology, 18, 2001, p. 554-583
n sauveur-Jérôme Morand, Histoire de la Sainte-Chapelle royale du Palais, Paris, Clousier, 1790
n John nádas, « secular Courts during the Period of the Great schism : documentation in the Archivio
La c
ollé
gial
e ro
yale
de
sain
t-que
ntin
et l
a m
usiq
ue
226
segreto Vaticano », in bianca Maria Antolini, teresa M. Gialdroni et Annunziato Pugliese (éd.), Et facciam dolçi canti : studi in onore di Agostino Ziino in occasione del suo 65° compleanno, Lucca, LiM, 2003, p. 183-204
n Id., « The internationalization of the italian Papal Cha-pels in the early quattrocento », in Franco Piperno, Gabriella biagi ravenni et Andrea Chegai (éd.), Cappelle musicali fra Corte, stato e Chiesa nell’Italia del Rinascimento. Atti del Convegno internazionale. Camaiore, 21-23 ottobre 2005, Firenze, olschki, 2007, p. 247-269
n helmuth osthoff, Josquin Desprez, tutzing, schneider, 1962-1965, 2 vol.
n Félix raugel, « Peintures murales de musique liturgique découvertes à la basilique de saint-quentin », La Revue musicale, mars 1925, p. 230-234
n Id., « notes pour servir à l’histoire musicale de la collégiale de saint-quentin depuis les origines jusqu’en 1679 », in ernst h. Meyer (éd.), Festschrift Heinrich Besseler : zum Sechzigsten Geburtstag, berlin, deutscher Verlag für Musik, 1961, p. 51-58
n Joshua rifkin et alii, « Compère, Loyset », The New Grove Dictionary of Music and Musicians, op. cit., vol. 6, p. 180-184
n Anne W. robertson, Guillaume de Machaut and Reims : Context and Meaning in his Musical Works, Cambridge, Cambridge university Press, 2002
n stanley sadie (éd.), The New Grove Dictionary Online et The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London, Macmillan, 2001
n Andrew tomasello, Music and Ritual at Papal Avignon, 1309-1403, Phd dissertation, Yale university, 1983
n henri trouillet, « Cérémonial du chapitre métropoli-tain d’Avignon au XViie siècle », Mémoires de l’académie du Vaucluse, 1912, p. 277-301
n Ludovic Viallet, Bourgeois, prêtres et cordeliers à Romans (v. 1280-v. 1530), saint-Étienne, Publications de l’université de saint-Étienne, 2001
n rob C. Wegman, « “And Josquin Laughed...” Josquin and the Composer’s Anecdote in the sixteenth Century », The Journal of Musicology, 17, 1999, p. 319-357.
n Craig M. Wright, The Maze and The Warrior : Symbols in Architecture, Theology, and Music, Cambridge, harvard university Press, 2001
n berthold Zeller (éd.), Louis XII et Philippe le Beau : la conquête et la perte de Naples, 1501-1504, extraits de Jean d’Auton, du loyal serviteur, de Claude de Seyssel, de Saint-Gelais, etc., Paris, hachette, 1889
227















































![Vermand/ Saint-Quentin [topographie chrétienne]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631846cf831644824d03d38d/vermand-saint-quentin-topographie-chretienne.jpg)