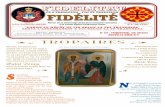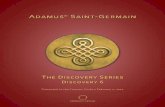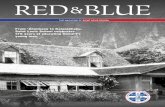Les fortifications de Damas, Entre historiographie et découvertes archéologiques
350 000 ans d'histoire : découvertes archéologiques dans le Saint-Quentinois (exposition tenue à...
-
Upload
culturecommunication-fr -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of 350 000 ans d'histoire : découvertes archéologiques dans le Saint-Quentinois (exposition tenue à...
Un partenariat entre la ville de Saint-Quentin, la Drac de Picardie, et l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap).
Commissariat Jean-Luc Collart, conservateur régional de l’archéologie (Drac Picardie)Christophe Hosdez, archéologue chargé d’études et de recherches (Inrap)Patrick Lemaire, archéologue chargé d’études et de recherches (Inrap)Pomme Legrand, responsable du département Arts plastiques (ville de Saint-Quentin)
Exposition « 350 000 ans d’Histoire Découvertes archéologiques dans le Saint-Quentinois »,
du 16 septembre 2011 au 8 janvier 2012,Espace Saint-Jacques de Saint-Quentin.
Comité scientifique Jean-Luc Collart, conservateur régional de l’archéologie (Drac Picardie)Christophe Hosdez, archéologue chargé d’études et de recherches (Inrap)Patrick Lemaire, archéologue chargé d’études et de recherches (Inrap)
Avec la collaboration des auteurs de l’InrapFrançoise Bostyn (Néolithique)Cyrille Chaidron (céramique époque romaine)Caroline Colas (Néolithique)Thierry Ducrocq (Mésolithique)Muriel Friboulet (céramique protohistorique)Jean-Luc Locht (Paléolithique)Alexia Morel (petit mobilier gallo-romain).
Coordination Guillemette Brutin et Victorien Georges, responsables du service de l’Architecture et du Patrimoine (Ville de Saint-Quentin) et Élisabeth Justome, chargée du développement culturel et de la communication (Inrap)
RelectureJean-Luc Collart (SRA Picardie), Christophe Hosdez (Inrap), Élisabeth Justome (Inrap), Patrick Lemaire (Inrap).
MaquetteFrédéric Pillet et Élodie Danton (ville de Saint-Quentin).
Sauf mention contraire, les illustrations proviennent des fonds de la DRAC Picardie ou de l’Inrap.Remerciements
Que soient remerciées ici toutes les personnes qui par leur concours ont permis la réalisation de cette exposition et du catalogue qui l’accompagne :
Pour leur implication personnelle déterminante nous tenons à remercier tout particulièrement Dominique Bossut, Boris Marié et Alexia Morel.
Les photographes de l’Inrap : Dominique Bossut, Emmanuelle Collado et Stéphane Lancelot.
Rudy Debiak, Sébastien Hébert, Érick Mariette, topographes à l’Inrap.
Pour leur aide et contribution à titre divers :
- Les archéologues de l’Inrap : Ginette Auxiette, Jean-Louis Bernard, Thierry Bouclet, Benoit Clavel, Raphaël Clotuche, Stéphane Gaudefroy, Dominique Gemehl ,Alain Henton, Frédéric Joseph, Véronique Harnay, Karin Libert, Yann Lorin, Boris Marié, Véréna Marié.
- Arnaud Clairand, numismate à la Compagnie Générale de Bourse pour son étude des monnaies de la période médiévale ; Vincent Drost, numismate au cabinet des médailles, pour ses études ; Thierry Galmiche, mission archéologique de l’Aisne, pour le site de Fresnoy-le-Grand ; Daniel Gricourt, cabinet des médailles , pour son étude des monnaies de l’époque romaine ; Vincent Legros, SRA Picardie, pour son étude du mobilier métallique médiéval ;Tarek Oueslati, chargé de recherche au CNRS, pour l’étude de la faune gallo-romaine de Saint-Quentin ; Anthony Petit, pour sa lecture de la dalle funéraire de l’église Saint-Jacques ; Frédéric Pillet, chargé d’études documentaires au Service de l’Architecture et du Patrimoine de Saint-Quentin, pour ses recherches documentaires et iconographiques ; Valérie Burban-Col et Sylvain Rassat du Service régional de l’archéologie de Picardie, pour diverses informations ayant trait à la carte archéologique ; Sébastien Ziegler, UA de Château-Thierry, pour Neuville-Saint-Amand ; Yoann Zotna, directeur du Centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre, pour ses analyses paléographiques et interprétations.
- Pour le prêt d’objets mobiliers : Ghislaine Peiffer, responsable du musée du Vermandois que nous remercions pour sa disponibilité.
- Pour la mise à disposition de sources iconographiques : Alexandre Audebert de la Mission archéologique de l’Aisne pour la photographie de l’Hercule de Vermand ; Gérard Fercoq du Leslay, archéologue au conseil général de la Somme, pour la photographie de Samara ; Bruno de Foucault, Virginie Vergne et Guillaume Lemoine pour la photographie d’Isatis Tinctoria ; Véronique Zech-Matterne, carpologue au MNHN.
L’exposition présente le bilan des découvertes archéologiques réalisées dans le Saint-Quentinois depuis 30 ans et surtout depuis les dix dernières années, avec le développement de l’archéologie préventive, à l’origine d’un renouvellement important de nos connaissances. Le Saint-Quentinois conserve dans son sous-sol les nombreux témoignages des occupations qui s’y sont succédé depuis la première présence humaine attestée vers 350 000 ans avant notre ère.
La recherche archéologique dans le Saint-Quentinois
Des recherches depuis le XVIIe siècleLes savants commencent à s’intéresser à l’archéologie au XVIe siècle. Dans le Saint-Quentinois, il faut attendre le XVIIe siècle pour que les témoignages archéologiques soient évoqués dans le cadre de la polémique sur la localisation d’Augusta Viromanduorum et du premier siège épiscopal du Vermandois. Sous le Second Empire, l’empereur, féru d’histoire et d’archéologie, soutient les sociétés savantes et encourage leurs fouilles, qui ne prennent de l’ampleur dans le Saint-Quentinois qu’après 1870. Jules Pilloy étudie principalement les cimetières romains tardifs et mérovingiens. Ses observations fondées sur une approche rigoureuse, en font un spécialiste reconnu sur le plan international.Théophile Eck, un autre membre de la Société académique de Saint-Quentin, n’est pas moins actif dans les mêmes domaines et enrichit considérablement le musée de Saint-Quentin dont il estle conservateur.La disparition de ces deux savants au tournant du premier conflit mondial, marque le terme de cette activité archéologique intense dans le Saint-Quentinois. En 1941, une loi protège les vestiges archéologiques, mais son application reste limitée. Dans les années 1960, les prospections aériennes réactivent l’intérêt pour les sites archéologiques locaux. Dans les années 1970-1980, l’archéologie de sauvetage, liée aux travaux d’aménagement, se développe, avec une lente mais constante augmentation du nombre d’archéologues professionnels.
Planche du mobilier mérovingien du cimetière de Fontaine-Uterte fouillé en 1878 par Pilloy, publiée en 1879 dans les Mémoires de la Société académique de Saint-Quentin. Excellent dessinateur, Pilloy a illustré de nombreux ouvrages consacrés à l’archéologie de l’Aisne et de la Somme, notamment le célèbre Album Caranda.
L’archéologie préventive : depuis 1985Les années 1990 sont marquées par un formidable bond en avant avec l’archéologie préventive : pour ne pas pénaliser les aménageurs par des arrêts de chantier, les fouilles sont menées préalablement aux travaux d’aménagement. Une procédure en deux étapes se met en place : des sondages ponctuels (appelés « diagnostics ») sont d’abord réalisés sur les terrains susceptibles de receler des vestiges archéologiques. Selon l’intérêt des découvertes, des fouilles préventives sont décidées par le préfet de région. L’objectif d’une fouille préventive n’est pas de conserver en place les vestiges, mais de « sauvegarder par l’étude » les archives du sol avant leur destruction. Tout ce processus a été codifié par la loi sur l’archéologie préventive du 17 janvier 2001 (intégrée depuis au Code du Patrimoine). Une taxe finance les diagnostics, tandis que les fouilles sont à la charge de l’aménageur, sauf pour les particuliers construisant pour eux-mêmes et les logements sociaux. L’exposition et le catalogue permettent de mesurer l’énorme apport scientifique de ces vingt années d’archéologie préventive à la connaissance du passé du Saint-Quentinois.
Vue aérienne d’un diagnostic archéologique sur le Parc des Autoroutes à Saint-Quentin.
Des tranchées de sondage larges de 2 m sont ouvertes à intervalle
régulier (20 m) sur toute l’emprise du projet d’aménagement (soit une ouverture à 10 %) grâce à une pelle
mécanique. Les diagnostics sont réalisés par des opérateurs de statut
public, comme ici l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (Inrap), tandis que pour les fouilles, d’autres opérateurs
agréés peuvent intervenir.© Hubert Flandre, SMER/Conseil général
de la Somme.
Interventions archéologiques dans le Saint-Quentinois de 2000 à 2011.
Les diagnostics en milieu urbain sont des opérations lourdes, comme ici place de la Gare à Saint-Quentin. Cela est dû à la densité des vestiges et à l’épaisseur des dépôts accumulés au fil des siècles qui ont provoqué un exhaussement des sols. Il peut atteindre 5 m d’épaisseur à Saint-Quentin.
0 10 20km
Saint-Quentin
Vermand
Escaut
Oise
SommeOmignon
Bohain
La Préhistoire la plus ancienne est connue dans le département de l’Aisne par la récolte de nombreux bifaces acheuléens associés à des restes osseux lors de l’exploitation de grévières. La plupart du temps, les « belles pièces » acheuléennes et moustériennes sont ramassées hors contexte stratigraphique, ce qui rend impossible leur datation exacte. Les restes fauniques retrouvés témoignent de la présence de grands mammifères, parfois disparus (Mammouth, Rhinocéros laineux,…), adaptés au climat froid qu’a connu le nord de la France durant les périodes glaciaires. Récemment, la région de Saint-Quentin a livré de nombreuses traces d’occupations des chasseurs-cueilleurs nomades de la Préhistoire.
Le Paléolithique inférieur(800 000 – 300 000 ans avant notre ère)
Chronologie des occupations paléolithiques et mésolithiques de la région de Saint-Quentin.
10 000
40 000
130 000
300 000
HOLOCÉNEWEICHSELIENÉÉMIENSAALIENHOLSTEINIEN
Homo-sapiensHomme de Néandertal
Attilly - Bois de la Bocquillière,
Savy, Saint-QuentinSavy
Attilly - Bois d’Holnon, Rouvroy
Attilly - Bois d’Holnon
Attilly - Bois de la BocquillièreVermand
112 000
PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR
PALÉOLITHIQUE INFÉRIEUR
PALÉOLITHIQUE MOYENHomo-érectus
Collecte de la matière première et activités de taille du silex de chasseurs néandertaliens.
Le Paléolithique inférieur (Acheuléen) est surtout connu par la fouille de l’atelier de taille de Vermand, à l’ouest de Saint-Quentin. La petite série de huit bifaces et la soixantaine d’éclats de façonnage découvertes témoignent d’une taille sur place. D’après la typologie des pièces bifaciales, l’âge de cette industrie pourrait avoisiner les 300 000 ans. Elle témoigne de la fréquentation de nos régions par l’Homo Heidelbergensis, qui est une forme évoluée de l’Homo Erectus venu d’Afrique.
Archer mésolithique chassantun chevreuil.
Poste de débitage daté de 55/50 000 ansnotre ère. De nombreux éclats ont puêtre raccordés sur un nucléus de type
Levallois. La méthode des remontages, véritable puzzle en trois dimensions, permet de reconstituer et de comprendre
l’enchaînement des gestes du tailleur préhistorique (Saint-Quentin, Parc des Autoroutes).
Le Paléolithiqueet le Mésolithique
autour de Saint-Quentin
Le Paléolithique moyen(300 000 – 40 000 ans avant notre ère)Le Paléolithique moyen (Moustérien) est documenté par les sites de Savy, d’Attilly et de Saint-Quentin. Sur le premier de ces sites, deux occupations de l’Homme de Néandertal sont attestées, aux alentours de 80 000 et de 55 000 ans. À Attilly et sur le Parc des Autoroutes de Saint-Quentin, les vestiges retrouvés ont aussi un âge de 55 000 ans. Ceux-ci sont essentiellement de grands éclats obtenus selon une technique particulière de préparation du bloc de silex, nommée le débitage Levallois qui permet d’obtenir des éclats réguliers à la morphologie prédéterminée.
Le Paléolithique supérieur (40 000 – 9 500 avant notre ère)La phase ancienne du Paléolithique supérieur correspond à l’arrivée de l’Homme moderne en Europe sous des conditions climatiques rigoureuses. Dans le nord de l’Aisne, elle est reconnue par les sites aurignaciens d’Attilly (Bois d’Holnon) et de Rouvroy. Le Paléolithique final, contemporain de la fin de la dernière glaciation a été identifié à Attilly.
Le Mésolithique (9 500 – 5 000 avant notre ère)Notre réchauffement climatique voit le développement d’une immense forêt où évoluent pendant 4 000 ans les derniers chasseurs-cueilleurs. Cette période, dite Mésolithique, a été découverte à la fin du XIXe siècle dans le Tardenois, au sud de l’Aisne. Pendant longtemps, le terme Tardenoisien a été synonyme de Mésolithique, partout dans l’Ancien Monde. Son originalité repose sur l’abondance de petits silex finement taillés dénommés microlithes. Ces objets sont des armatures de flèches qui démontrent l’emploi massif de l’arc. Dans la région de Saint-Quentin, des sites sont attestés sur des sols sableux, notamment au niveau de la butte d’Holnon / Attilly. Des concentrations de vestiges montrent que les Préhistoriques, par essence nomades, s’y sont arrêtés à plusieurs reprises pour pratiquer la taille du silex afin de façonner des microlithes. S’agit-il de haltes éphémères de chasseurs ou de petits campements occupés plus longtemps par des groupes familiaux ? Pour répondre à cette question essentielle, il faudrait poursuivre les recherches dans la vallée de la Somme où les sites sont susceptibles d’être mieux préservés.
Le Néolithique dans le Saint-Quentinois
La période néolithique (de 5100 à 2000 avant notre ère) correspond à d’importants changements dans les modes de vie des populations qui passent d’un état de chasseurs-cueilleurs à celui d’agriculteurs-éleveurs.
Le Néolithique ancien
Reconstitution d’une maison de type danubien.
Archéosite de Samara : vue intérieure d’une reconstitution de maison de type danubien. La toiture était soutenue par des rangées de trois poteaux (tierces) régulièrement espacés.© Gérard Fercocq du Leslay, Conseil général de la Somme.
Les premiers paysans ont occupé principalement les fonds de vallée à proximité des rivières, mais très vite, ils ont aussi occupé les plateaux. La vocation de ces occupations n’est plus exclusivement domestique comme le montrent les grandes fosses du Néolithique moyen fouillées à Saint-Quentin au Parc des Autoroutes qui ne sont pas situées au sein d’un village et dont la fonction fait l’objet de discussions. Différentes hypothèses sont envisagées comme des fosses destinées au piégeage des animaux chassés ou encore des creusements destinés au rouissage des végétaux.
Les fosses mystérieuses du Parc des Autoroutes
La néolithisation de la région de Saint-Quentin s’inscrit dans le vaste mouvement de colonisation de la France du Nord par des populations venues d’Europe orientale. Cette culture, appelée danubienne, se caractérise par un habitat standardisé composé de grandes maisons sur poteaux, orientées est-ouest et bordées de fosses dans lesquelles le mobilier archéologique piégé permet de dater les occupations. Des fosses de ce type ont été retrouvées à Vermand, confirmant l’occupation de la région saint-quentinoisedès le début de la néolithisation. L’appartenance culturelle des paysans néolithiques est perceptible au travers des objets qu’ils produisent, en particulier la céramique. Celle de Vermand a des décors caractéristiques (boutons sous le bord) de la culture du Villeneuve-Saint-Germain qui s’étend de la Belgique au sud du Bassin parisien.
À partir de 4200 avant notre ère, au Néolithique moyen, les populations entourent leur habitat de palissades et/ou de fossés. À Saint-Quentin, Chemin d’Harly, l’enceinte est composée d’une palissade de poteaux de bois. Elle jouxte un aménagement constitué de deux fossés disposés en «épingle à cheveux », dispositif déjà rencontré dans les vallées de la Seine et de l’Yonne où la vocation funéraire a été avancée. À Saint-Quentin, l’association d’une palissade avec ce double fossé constitue une découverte inédite dont le sens nous échappe encore.
L’enceinte du Néolithique moyen de Saint-Quentin
Le mobilier des sites du Néolithique moyen est plus diversifié qu’à la période précédente. À Saint-Quentin, il renvoie à des entités culturelles différentes. Au Chemin d’Harly, les décors de la céramique (lignes de boutons au repoussé et incisions qui dessinent des triangles et des damiers) et les formes restituables (plat à pain, petit gobelet, puisoir et céramiques carénée) se rapportent aux groupes épi-Rössen, situés notamment en Allemagne. En revanche, sur le site du Parc des Autoroutes, les céramiques avec dégraissant de silex pilé et décor de pastilles au repoussé, évoquent le groupe de Spiere dont le berceau se situe au nord de la France et au sud de la Belgique. Le site de Saint-Quentin est actuellement le témoin le plus méridional de cette culture.
Différentes influences culturelles
Décor de pastilles au repoussé, visible à l’intérieur des céramiques (Saint-Quentin, Parc des Autoroutes).
Le Néolithique se caractérise également par l’existence de réseaux de diffusion de produits finis sur de très longues distances. La présence de haches polies et de grandes lames en provenance de la minière de Spiennes (Belgique, à plus de 80 km vers le nord), mais aussi des minières du Bassin parisien (plus de 60 km vers le sud), témoigne de l’intégration du Saint-Quentinois dans les circuits de distribution particulièrement dynamiques entre 4 000 et 3 000 ans avant notre ère.
Des circuits d’échanges déjà étendus
Vue aérienne la palissade de Saint-Quentin chemin d’Harly.
Saint-Quentin, chemin d’Harly :plan du fossé palissadé néolithique.
0 20 m
Palis
sade
Palis
sade
: Structures néolithiques: Structures gallo-romaines : Structures indéterminées: Chablis et anomalies
Surcreusement en fond de la fosse à environ 2 m de profondeur. Le creusement de cette tranchée étroite à une telle profondeur
constitue une difficulté importante (Saint-Quentin, Parc des Autoroutes).
Une fosse néolithique en
“W”. La fonction de ces fosses est
encore aujourd’hui discutée
(Saint-Quentin, Parc des
Autoroutes).
Vue d’une fosse néolithique de forme cylindrique (Saint-Quentin Parc des Autoroutes).
Palissade
Un village occupéentre 800 et 450avant notre ère
À l’aube du deuxième millénaire, la maîtrise de la métallurgie du bronze puis du fer accélère la mutation de la société amorcée au Néolithique. Elle s’accompagne de profondes transformations : économiques (multiplication des échanges, apparition d’artisanats spécialisés), sociales (évolution des formes de l’habitat) et politiques (hiérarchisation).
Un site majeur, le Parc des Autoroutes
La vue aérienne révèle la zone de conservation (pointillé jaune) dans le fond du vallon. Ce sol ancien se distingue des couches géologiques par une couleur sombre (sol d’occupation).© [email protected]
Permanence de l’organisation spatialeEn plus de 200 ans d’occupation dense, plusieurs dispositions sont restées immuables : les foyers, groupés ou isolés, sont implantés devant les bâtiments et les fosses d’extraction sont rejetées en périphérie de l’occupation. Seules les fosses aux fonctions particulières, peut-être liées au stockage, sont intégrées aux zones bâties. Onze bâtiments de faible emprise au sol sont des greniers à 4 poteaux. L’interprétation est plus délicate pour les 28 constructions sur 6 poteaux, plus grandes : greniers et/ou habitations. Le mobilier recueilli (céramique, accessoire d’artisanat, éléments de parure-bracelets et anneaux) et les rejets alimentaires, indiquent que ce site avait un statut élevé.
Voie romaine
Tête de vallon
Vallée principale
Limite de fouille
Axe du fond de vallon
Paléosol (horizon humifère)
Plan partiel de l’habitat groupé diachronique (-800/-450) fouillé sur l’emprise du Parc des Autoroutes
0 25 m
Fosses (stockage, extraction...)
Trous de poteau
Foyers
Fossés
Modules de bâtiments
N
Fouille minutieuse d’une concentration de foyers formant une aire d’activité domestique ou artisanale proche de l’habitat.
Les sondages profonds ont révélé l’existence d’un horizon humifère ancien (2). Enfouie sous d’épaisses colluvions (1), cette strate brune, ancienne couche de terre végétale, contient les témoins matériels et les vestiges structurels d’un établissement fondé au IXe siècle avant notre ère.
Détail d’un foyer rectangulaire construit à l’aide d’un lit de silex
(base rémanente), recouvert d’une chape d’argile. Il ne subsiste
que des lambeaux d’argile rubéfiée qui composaient
la sole.
Proposition de restitution graphique. Une construction de 16 m2 (vert) avec aménagement d’un pignon triangulaire se substitue à un bâtiment rectangulaire (jaune).
La disparition des matériaux de construction des bâtiments, en bois et terre, rend leur détection difficile. Seuls les trous où étaient plantés les poteaux en bois constituant leur ossature sont repérés. Ici, la disposition dessine un bâtiment de 11 m2 de plan rectangulaire avec pignon triangulaire.
Une quarantaine d’édifices se répartissent inégalement sur les pentes opposées du vallon. Entre ces deux zones bâties, le centre de la dépression est peu occupé : drain naturel des eaux pluviales, il a également pu être utilisé comme bande de circulation. Cet axe a d’ailleurs guidé l’implantation des premières constructions (modules jaunes) créant deux lignes de bâtiments en vis-à-vis. Cette disposition rappelle l’organisation du village-rue. Au fil du temps, l’orientation fixée a été respectée bien que l’alignement soit devenu plus lâche (modules vert clair). Les dernières constructions (modules vert foncé) marquent la fin des « contraintes » d’aménagement.
Un espace très structuré
Protégé par une épaisse colluvion piégée dans un vallon sec, un sol ancien (paléosol) contenait une très forte concentration de vestiges mobiliers et immobiliers issus d’occupations humaines datées de la fin de l’âge du Bronze à la fin du premier âge du Fer. Dans un paysage dominé par un habitat dispersé composé de fermes isolées et peu étendues, le site de Saint-Quentin constitue un exemple d’habitat groupé, rare pour cette période. Ce village se démarque par une organisation spatiale très ordonnée sur plusieurs milliers de mètres carrés.
Plan
Coupe
Coupe d’un trou de poteau en cours de fouille : après décomposition du poteau en bois, le trou est progressivement comblé avec des terres de couleurs différentes.
Vue générale d’une fosse polylobée formée par des extractions successives de limon destiné à la fabrication du torchis, matériau qui recouvre les clayonnages des murs. Après usage, les fosses sont transformées en poubelle d’où leur appellation « fosse-dépotoir ». Les rejets détritiques qui y sont retrouvés (vaisselle, éléments de parure, ossements d’animaux, outils agricoles, etc.) sont de précieux indices pour les archéologues : reflet du mode de vie, de l’activité et du statut social des résidents.
Au début du second âge du Fer, période comprise entre le Ve et Ier siècle avant notre ère,la forme de l’habitat gaulois s’inscrit dans la continuité des périodes protohistoriques précédentes : prépondérance de l’habitat dispersé - petites unités agricoles peu étendues et non ceintes – sur l’habitat groupé de type village. C’est au milieu du IIIe siècle avant notre ère que s’opère un changement notable fort bien perçu par l’archéologie : la généralisation de l’habitat enclos.
Les campagnes au second âge du Fer
L’habitat disperséBien documenté par les fouilles saint-quentinoises, ce type d’habitat ouvert peut être modélisé : une habitation, parfois un bâtiment d’exploitation (remise, atelier) et un ou plusieurs petits greniers aériens, regroupés sur une aire inférieure à 1000 m2. La zone de stockage, constituée de silos enterrés, peut être attenante ou isolée de plusieurs dizaines de mètres du noyau d’occupation. Ces petites fermes mono-familiales semblent être exclusivement tournées vers une agriculture vivrière.
19 m223 m2
6 m2
11,5 m2
9,5 m2
0 10 m
Fosses
Trous de poteau
Foyer
Trous de poteau dessinant des plansde bâtiments
Grenier
GrenierGrenier
Bâtiment d'habitation
N
Point de vue
Cour ?
Bâtiment d'exploitation
Saint-Quentin, Parc des Autoroutes - Plan interprété d’une unité agricole isolée occupée vers 450 avant notre ère. L’habitation, identifiable grâce à la présence d’un foyer, a des dimensions plus importantes et une ossature en bois plus développée que les bâtiments d’exploitation.
Restitution de l’ossature en bois de quatre des cinq édifices révélés par les trous de poteau.
Habitat et champs enclosAu IIIe siècle avant notre ère, le terroir est divisé par des fossés, quelquefois des palissades, qui individualisent des espaces résidentiels, funéraires, agro-pastoraux et les chemins qui les relient. Ces enclos, plutôt curvilignes au départ, tendent à devenir quadrangulaires à la fin de la période gauloise. Les enclos d’habitat, dont la surface - parfois cloisonnée - peut dépasser l’hectare, sont occupés par des bâtiments d’habitation et d’exploitation, juxtaposés à des aires de stockage. Le reste de la surface enclose semble dévolu aux activités agricoles. Ce type d’habitat, étudié à Saint-Quentin, Urvillers, Vermand et Gauchy, est le modèle dominant dans la campagne saint-quentinoise. Ces fermes ont une courte durée d’existence, qui n’excède pas un siècle.
Saint-Quentin, Parc des Autoroutes - Les grands décapages qui permettent
de suivre les fossés de parcellaire sur de longues distances, révèlent
l’organisation du terroir gaulois. Au premier plan, deux fossés encadrent
un chemin menant à un enclos funéraire (tombe au centre de l’enclos), implanté
contre le fossé d’un très vaste enclos agro-pastoral. Pérennes sur plusieurs
siècles, ces limites ont été en partie reprises par le parcellaire gallo-romain.
Saint-Quentin, Bois de La Choque - Coupe transversale montrant la succession de fossés respectant une limite foncière pérenne du Ier siècle avant au Ier siècle de notre ère. À gauche, il s’agit de deux fossés ouverts qui se sont succédés, à droite, d’un fossé d’implantation d’une palissade à poteaux jointifs.
La ferme de VermandCet établissement est un très bel exemple de l’organisation d’une ferme de rang élevé – une résidence aristocratique ? - occupée à la charnière des IVe et IIIe siècles avant notre ère. Haute de plus de 2 m, une palissade à poteaux jointifs ceint un vaste espace ovoïde de près de 1,2 ha. Sa construction a nécessité l’abattage d’au moins 500 arbres, soit 10 ha de forêt environ. L’organisation interne est ordonnée et rigoureuse : secteurs de résidence,d’activité (filage, tissage…), de stockage (aérien et enterré) et probablement, à l’arrière, un secteur d’exploitation (potager, bétail, battage/vannage des céréales…). Construits en bois et torchis, les édifices sont regroupés près de l’entrée nord et s’alignent probablement en bordure d’une cour.L’habitation principale se distingue par une structure très élaborée (3 nefs) développée sur une surface importante (90 m2). Plan interprété
de la ferme de Vermand.
Essai de restitution de la partie nord de l’établissement agricole de Vermand.© Myriam Redouane, SAM Arras.
Entrée nord
Entrée sud
Secteur d'habitat secondaire et d'activité
Secteur d'habitat principal
Secteur de stockage aérien
Trous de poteau
Silos
Fosses
0 25 m
Secteur de stockage enterré et d'activité
Fosse contenant deux squelettes humains
Secteur de stockage enterré et d'activitéCOUR
Zone funéraire Fossé
Fossé
Fossé
Fossé
Palissade à poteaux jointifs
Palissade à poteaux jointifs
Palissadeà claies
Modules de bâtiments
N
Point de vue
Les paysans de l’âge du Fer pratiquaient la polyculture et, dans le cadre d’une économie de subsistance, produisaient l’essentiel afin d’assurer leur autarcie. C’étaient avant tout des agriculteurs dont l’alimentation consistait en ressources végétales, mais ils pratiquaient aussi l’élevage. En effet, le bétail fournissait la viande, le lait, la peau, la laine, mais aussi la force de traction pour le labour et le transport, ainsi que la fumure pour fertiliser les sols cultivés.
ProduireLa récolte des céréales s’effectue avec des faucilles. À partir du IVe siècle avant notre ère, la coupe se fait principalement sous l’épi. La récolte de la paille donne lieu à une
seconde coupe.
La production végétale était avant tout céréalière : les blés à grains vêtus l’emportaient (amidonnier et épeautre), associés à l’orge et l’avoine. Néanmoins, les légumineuses (pois, lentille, ers) fournissaient un précieux complément alimentaire. Dans les fermes protohistoriques saint-quentinoises, le nombre important de structures de stockage témoigne d’une forte production agricole.
de traction pour le labour et le transport, ainsi que la fumure pour fertiliser les sols cultivés.
La production végétale était avant tout céréalière : les blés à grains vêtus l’emportaient (amidonnier et épeautre), associés à l’orge et l’avoine. Néanmoins, les légumineuses (pois, lentille, ers) fournissaient un précieux complément alimentaire. Dans les fermes protohistoriques saint-quentinoises, le nombre important de structures de stockage
Les productions agricolesà l’ âge du Fer
ConserverTrois modes de stockage sont utilisés, aux formes et aux fonctions différentes. Les silos enterrés permettaient une conservation à long terme, entre autres, des céréales destinées aux semailles. Les grains étaient déversés en vrac dans des cavités en forme de « cloche » creusées dans le sol. Une fermeture hermétique et un début de germination supprimaient l’oxygène stoppant ainsi le processus de dégradation des denrées. Les capacités de stockage étaient adaptées aux productions : de 0,50 m3 pour les légumineuses à 8 m3 pour les céréales.
Au sein des fermes, comme celle de Vermand, les silos étaient regroupés dans des aires situées à l’écart des zones de vie. Ce stockage ne nécessitait pas de surveillance et garantissait une qualité nutritive et germinative des denrées durant plusieurs années.
Urvillers - Silo du IIe siècle avant notre ère en cours de fouille. Avec son volume de plus de 8 m3, il est le plus grand des silos découverts dans le Saint-Quentinois. Profond de 3,50 m et d’un diamètre de 4,30 m à la base, il pouvait contenir environ 64 quintaux de blé, soit la production d’une surface d’environ 13 ha avec un semis à la volée.
Reconstitution d’un grenier à 4 poteaux. Les larges pierres
débordantes placées au sommet des poteaux empêchaient l’intrusion
des rongeurs dans le grenier (Asnapio, Villeneuve-d’Ascq).
© Jiel Beaumadier.
10 cm
0
La récolte des céréales La récolte des céréales
Les greniers aériens sont des constructions quadrangulaires dont le plancher surélevé par 4 ou 6 poteaux est destiné à protéger les denrées des animaux et de l’humidité. Les surfaces utiles peuvent atteindre plus de 10 m2. Contrairement au silo, le grenier permettait de répondre aux besoins courants grâce à un accès facile aux produits stockés.Placés dans les greniers ou la maison, les vases de stockage (dolia) permettent une conservation en petites quantités de tous les produits alimentaires, solides et liquides. Ces contenants peuvent également conserver les aliments traités par salaison ou saumurage.
Saint-Quentin - Vase de stockage en céramique du début du IVe siècle avant notre ère.
L’élevageLes restes osseux issus des rejets culinaires quotidiens ou de dépôts exceptionnels liés à des festivités nous renseignent sur la composition des cheptels. Au regard des quelques découvertes saint-quentinoises, il comprend, dans l’ordre d’importance : les ovicaprinés, le porc, le bœuf, le chien et le cheval. La présence de squelettes de fœtus ou de nouveau-nés (agneaux, porcelet et chiot) dans les dépôts atteste de fermes tournées vers l’élevage. Le coq est le seul oiseau de basse-cour représenté dans les rejets domestiques. Le lièvre, la belette et un grand corbeau relèvent de la faune sauvage, de même que le cerf (seulement attesté par un bois de chute).
Vermand - Dépôt en silo d’une quinzaine d’animaux complets ou en partie débités. Le soin apporté dans la mise en place des rejets (les carcasses étant empilées avec ordre le long des parois), montre un acte réfléchi. Il pourrait s’agir d’un rite agraire pratiqué lors d’un banquet ayant pour but d’obtenir la bienveillance des divinités souterraines, garantes de la fertilité et de la fécondité des terres et des bêtes. Le silo aurait été utilisé ici comme un passage symbolique entre le monde des mortels et le monde des divinités.
Détail de crânes de moutons cornus et de porc du dépôt « rituel » consécutifà un abattage important et simultané d’animaux du cheptel. Celui-ci aurait eu lieu au printemps comme le suggère la présence d’agneaux nouveau-nés.
Le paysan de l’âge du Fer développe des savoir-faire lui permettant de vivre en toute autonomie : il construit les installations, fabrique et entretient les objets usuels ainsi que ceux nécessaires au fonctionnement de son exploitation. La production et la transformation des produits issus de l’agriculture, de l’élevage et de la cueillette (viande, lait, laine, céréales, légumineuses, plantes textiles et tinctoriales, fruits, bois…) couvraient l’essentiel de ses besoins alimentaires et vestimentaires. Les excédents pouvaient être échangés afin d’acquérir des produits indispensables relevant d’artisanats spécialisés comme la saunerie.
Transformer
Fond d’une faisselle en céramique attestant une activité fromagère. Les perforations du fond permettaient l’écoulement du petit-lait.
Au sein de la ferme, le paysan effectue la transformation des produits agricoles comme le lait en fromage, les céréales en farine, la laine en tissus. Bien d’autres activités étaient pratiquées mais l’archéologie peine à les identifier faute de traces matérielles dues aux matières périssables employées : vannerie, tannerie, corderie…
Les activités du paysanà l’âge du Fer
MoudreLa mouture est une activité domestique qui répondait aux besoins culinaires quotidiens. Depuis le Néolithique, elle s’effectuait à l’aide d’une meule à va-et-vient, remplacée au IIe siècle avant notre ère par le moulin rotatif formé de deux meules circulaires aux surfaces de contact rendues abrasives par piquetage. Réglable, il permet de décortiquer les céréales à grains vêtus (amidonnier, épeautre, orge) et de réduire en farine les céréales, les légumineuses et les glands.
La meule à va-et-vient tient son nom du mouvement effectué pour broyer ou moudre les denrées. Muni d’un accessoire en pierre
appelé molette, broyon ou rouleau, l’utilisateur exerce une pression, d’avant en arrière, sur les denrées
posées sur la meule fixe et plane.
Un moulin rotatif : la mouture s’effectue par un mouvement rotatif complet ou alternatif de la meule supérieure (le catillus) sur la meule fixe (la meta). Après un premier passage, un tamisage était nécessaire pour débarrasser la farine des fragments d’épiderme du grain (le son).
Filer et tisserDans chaque ferme saint-quentinoise, ces deux activités sont pratiquées comme l’attestent les découvertes d’accessoires de lestage nécessaires au filage, la fusaïole et au tissage, les pesons. Les forces, paire de ciseaux de tonte, sont plus rarement découvertes en contexte d’habitat. La laine de moutons était principalement utilisée et dans une moindre mesure, les plantes textiles comme le lin et le chanvre qui nécessitent un long traitement préalable (le rouissage). Les Gaulois teignaient leurs fils (vert, rouge, jaune, bleu) grâce aux plantes tinctoriales avant de les tisser sur un métier vertical.
Le filage : la fusaïole en terre cuite est un poids conférant au fuseau une plus grande inertie lors de sa rotation. Le mouvement rotatif est donc plus long et plus régulier, assurant un bon filage de la laine.
Reconstitution d’un métier vertical protohistorique.
Les tissus accrochés au métier ont été tissés selon
les techniques et les outils connus des Gaulois.
La maîtrise des modes d’entrecroisement des fils de trame (largeur du tissu) et de chaîne (longueur du tissu), permettait aux Gaulois de tisser des toiles
et des tissus à motifs variés (losanges, chevrons, etc.). Les fils de chaîne étaient tendus par des poids principalement en terre cuite, les pesons.
© Stéphane Gaudefroy / Les Ambiani.La métallurgieLes activités métallurgiques pratiquées dans les fermes saint-quentinoises sont peu documentées. Seul le site de Vermand a livré quelques scories proches des déchets produits lors de la réduction du fer, mais il n’y a aucune trace de forge dans les fermes fouillées. En revanche, la fabrication de petits objets en bronze (voire en métal précieux ?) est attestée par la découverte de creusets et un fragment de moule de torque rejetés dans des silos des fermes de Vermand et de Saint-Quentin.
Détail d’un des trois creusets de bronzier retrouvés dans un silo d’une ferme datée
du IIe siècle avant notre ère. Peu courante,
leur forme tétraédrique permet aux creusets de posséder
trois becs verseurs.
0
5 cm
appelé molette, broyon ou rouleau, appelé molette, broyon ou rouleau, l’utilisateur exerce une pression, l’utilisateur exerce une pression, d’avant en arrière, sur les denrées d’avant en arrière, sur les denrées
posées sur la meule fixe et plane.posées sur la meule fixe et plane.
Les céramiques utilisées sur les sites saint-quentinois proviennent essentiellement de rejets domestiques, mais ces restes ont beaucoup à nous dire sur les choix et les évolutions opérés pendant les cinq derniers siècles avant notre ère. Même si aucun vestige d’ateliers de potiers n’a été découvert, quelques indices stables au cours du temps sont en faveur d’une fabrication locale, notamment l’utilisation constante d’une argile riche en éléments non plastiques : silex, sable, calcaire et chamotte (des particules d’argile cuite).
La céramiquede la Protohistoire
Le façonnageAvant la généralisation du tour rapide au dernier siècle avant notre ère, les vases sont façonnés au colombin ou à la plaque. Ces techniques bien maîtrisées permettent d’obtenir des parois fines et régulières. D’émouvantes traces laissées par les doigts de l’artisan sont encore parfois visibles à l’intérieur des récipients.
Les décorsIls s’appliquent sur la pâte crue grâce à différentes méthodes : doigt (ongle ou pincement), bâtonnet, poinçon, peigne et par impression d’un objet. Le plus courant consiste en une série linéaire et horizontale de dépressions à la liaison entre le col et la panse du vase. Les décors peuvent s’étendre sur toute la surface de la panse en lignes horizontales ou verticales. L’incision est réservée à des motifs géométriques élaborés, spécifiques de la céramique dite «fine». La surface peut être également lissée, lustrée ou enduite.
La cuissonLa cuisson de la céramique s’effectue en meule ouverte, ou chapée par un matériau incombustible ; cette dernière permettant d’atteindre une température plus importante. Ce type de cuisson donne des couleurs de poteries s’échelonnant du rouge-orange (pour celles proche de l’air) à brun-noir (pour celles au cœur du foyer). Au cours du Ier siècle avant notre ère, le four à alandier remplace progressivement la cuisson en meule, assurant une meilleure maîtrise de la température interne.
Les fonctionsAu cours de cette longue période, la céramique suit les évolutions stylistiques régionales et s’adapte sans doute aussi à de nouveaux usages alimentaires. Elle sert également d’autres besoins, comme le stockage des céréales, les préparations laitières, l’élaboration de boissons fermentées et même l’éclairage. Certains dépôts retrouvés sur les parois des céramiques évoquent la fonction des vases tels que les dépôts de carbone (cuisson des aliments) ou de calcaire (eau chauffée). La fin de la période gauloise est marquée par les premières importations d’amphores vinaires méditerranéennes.
Saint-Quentin, Parc des Autoroutes - Vase situliforme
à décor digité (réalisé à l’ongle ?)
sur la panse, fin IVe siècle
avant notre ère.
Zone d'allumageet évent
Cheminée
Saint-Quentin, Parc des Autoroutes - Vases carénés à décor incisé linéaire, IVe-IIIe siècle avant notre ère.
Coupe schématique d’une meule chapée permettant la cuisson de la céramique protohistorique.
Saint-Quentin, barreau RN 29 - Pot globulaire dont le col
a été enduit (matière noire) de poix (tirée de la résine de pin ou de la sève de bouleau), IIe siècle avant notre ère.
Saint-Quentin, Parc des Autoroutes - Cette jatte à bord festonné, dont la panse est décorée de poinçons disposés en lignes verticales, est une lampe à huile, transition VIe-Ve siècle avant notre ère.
Vermand - Détail de dépôts calcaires à l’intérieur d’un pot à cuire.
Ils sont dus à des chauffes
répétées d’eau (début du IIIe siècle
avant notre ère).
Vermand - Vase miniature décoré d’une ligne de digitations (IIIe siècle avant notre ère). La fonction peut être multiple : céramique pour enfant, pot à onguents, creuset pour métal précieux ou test de cuisson.
Saint-Quentin, Parc des Autoroutes - Décors au bâtonnet, au peigne et par incision (chevrons encadrés par deux lignes formant des bandes verticales en zigzag).
Saint-Quentin, Saint-Quentin,
AutoroutesAutoroutesVase situliforme Vase situliforme
à décor digité à décor digité (réalisé à l’ongle(réalisé à l’ongle
sur la panse, sur la panse, fin IVfin IVee
avant notre ère.avant notre ère.
La Protohistoire est marquée par l’apparition des sépultures individuelles, incinération ou inhumation, isolées ou regroupées. Dans le Vermandois, les pratiques funéraires de l’âge du Bronze et du premier âge du Fer sont très peu documentées. En revanche, elles le sont bien pour la période qui va du IVe siècle avant notre ère à la conquête romaine.
Les Gauloiset leurs morts
Vermand - La position des os et l’étude anthropologique ont révélé que le corps de cette femme âgée décédée de mort naturelle, est resté à l’air libre. Des manipulations humaines ont déplacé une partie du membre supérieur gauche sur le flanc droit, le calvarium (crâne) a été prélevé et la mandibule a été placée sur la clavicule gauche. Une boucle de ceinture au niveau de la hanche gauche indique le port d’un vêtement. A quelques centimètres sous ce corps, se trouvait le squelette d’une femme mature qui a subi des traitements analogues.
Saint-Quentin - Ce calvarium prélevé à des fins rituelles (exposition comme trophée ou culte des ancêtres ?), a vraisemblablement perdu son statut particulier et a été rejeté dans une fosse-dépotoir attenante à une habitation gauloise.
Tous les morts ne bénéficiaient pas du même traitement ; certains étaient inhumés dans des structures abandonnées (silo, fosse, fossé), au sein même de l’habitat, comme dans la grande ferme fouillée à Vermand. Dans les années 325-250 avant notre ère, deux femmes ont été inhumées dans un silo, l’une au dessus de l’autre. Des manipulations ont été pratiquées sur les squelettes, comme le révèlent les perturbations anatomiques observées. Le sens de ces pratiques nous échappe : on a proposé d’y voir des rites expiatoires.
Curieuses pratiques
Saint-Quentin – Un chemin bordé par deux fossés (en haut à droite) menait à cet enclos du milieu du IIIe siècle avant notre ère (en « agrafe » car accolé à un fossé parcellaire), qui entourait une grande sépulture (2 x 2m) dont le mobilier (dix céramiques et deux fibules en fer) indique le niveau social élevé du défunt.
Saint-Quentin - Cette sépulture à incinération est caractéristique : dans une fosse carrée, les restes humains (éléments blancs) ont été déposés dans un angle, à côté des céramiques. D’autres vases sont groupés dans l’angle opposé. Les vides suggèrent la disparition de dépôts en matières périssables.
Saint-Quentin – La forme quadrangulaire de l’amas osseux montre qu’il a été placé dans un contenant disparu. La fouille en laboratoire par un anthropologue apporte de nombreuses informations sur le défunt (âge, sexe, taille), la crémation et le traitement postérieur : sélection des restes et organisation du dépôt.
Dès le IVe siècle avant notre ère, l’incinération devient la pratique exclusive, sauf exception. Les restes incinérés sont déposés dans une fosse fréquemment coffrée à l’aide de planches de bois qui maintiennent les parois et la couvrent, à même le sol ou dans un contenant en matériau périssable aujourd’hui disparu (bois, cuir, tissu…). Le dépôt funéraire reflète l’identité et le statut social du défunt et témoigne d’une croyance en une vie après la mort. Il comprend des aliments, solides et liquides, partiellement contenus dans des vases, des accessoires de parure (ceinture, fibules, etc.), des objets personnels ou outils (rasoirs, forces, etc.) et plus rarement, des armes.
La tombe
Lieux et monuments funéraires
Évocation de la partie aérienne d’un cercle funéraire : protégeant la sépulture, un tertre est érigé à l’aide des terres issues du creusement du fossé d’enceinte périphérique. Saint-Quentin - Au IVe siècle avant notre
ère, un cimetière s’est implanté autour du tertre. Les petits enclos entouraient des sépultures privilégiées qui ont été arasées. Ils s’ouvrent en direction du monument.
Saint-Quentin - Fossé d’enceinte d’un cercle de près de 20 m de diamètre ; large de plus de 2,30 m, sa profondeur initiale est estimée à plus de 2 m. Les indices chronologiques associés indiquent que le monument funéraire est antérieur au milieu du VIe siècle avant notre ère.
L’exploration archéologique de dizaines d’hectares, principalement sur le Parc des Autoroutes à Saint-Quentin, a permis la découverte d’espaces funéraires disséminés dans le paysage, à l’écart des habitats contemporains. Ces cimetières multiséculaires ou ces sépultures isolées jouent un rôle dans l’organisation spatiale du terroir. Les plus anciens monuments funéraires découverts dans le Vermandois correspondent à deux cercles établis avant le VIe siècle avant notre ère. L’un d’eux a constitué un point d’ancrage autour duquel d’autres sépultures se sont implantées au IVe siècle.
Cercle funéraire (Ière moitié du VIe siècle avant notre ère)
Petits enclosgaulois
Enclos carré avec sépulture centrale(milieu du IVe siècle avant notre ère)
N
10 m0
La Gaule intérieure conquise au milieu du Ier siècle avant notre ère est réorganisée par Rome dans les deux dernières décennies du siècle. C’est le début d’une période de paix, la pax romana, période longue de plus de deux siècles et demi appelée le Haut-Empire, qui permet au pays de se développer de façon considérable. Vers la fin du IIe siècle, cette prospérité commence à être ébranlée. Les incursions germaniques à partir de 259 marquent le début de temps plus difficiles, appelés Bas-Empire ou Antiquité tardive.
La civitasViromanduorum
La conquêteromaine
Carte de la civitas Viromanduorum. Elle correspond à l’est du Bassin de la Somme, jusqu’à l’Oise. Les sanctuaires, villae et fermes sont plus denses à l’ouest, car la Somme a fait l’objet de prospections aériennes plus nombreuses.
Verse
L’organisation du territoireDurant trente ans, les Romains occupés par la guerre civile, se contentent de lever des impôts et des troupes. Puis Auguste confie à son ami Agrippa le soin d’organiser la Gaule Chevelue. Entre 16 et 13 avant notre ère, elle est divisée en trois provinces : l’espace picard s’inscrit dans l’ouest de la Gaule Belgique. Globalement, les civitates (cités au sens d’unité politique) gallo-romaines correspondent aux peuples belges. Leurs limites ont été conservées par les évêchés, ici celui de Noyon. Toutefois, il a été avancé que la Thiérache appartenait aux Viromandui avant la création de l’évêché de Laon au VIe siècle, mais rien n’est encore venu le démontrer.
Vermand première capitale des ViromanduiDes armes sacrifiées entre le IIIe et la première moitié du IIe siècle avant notre ère ont été recueillies sur le plateau de Marteville, occupé par des sanctuaires gallo-romains. Elles peuvent provenir de sépultures ou d’un lieu de culte. La seconde hypothèse est séduisante, car nombre de sanctuaires gallo-romains ont des antécédents gaulois. Ces lieux de culte occupaient une place prééminente chez les Belges. L’oppidum, forteresse de tradition gauloise, paraît remonter au Ier siècle avant notre ère. C’est le seul attribué aux Viromandui, considéré de ce fait comme leur chef-lieu. Lors de la mise en place des voies romaines, celles d’Amiens à Reims et de Bavay à Beauvais ont été dirigées vers Vermand, ce qui suggère qu’elle était la ville principale au début de la période romaine.
Plan de Vermand dans l’Antiquité. Le transfert de la capitale à Augusta - Saint-Quentin, n’a pas empêché le développement d’une ville importante de structure polynucléaire, où l’occupation est répartie en trois noyaux distincts étendus chacun sur une quinzaine d’hectares : sur la rive droite de la vallée de l’Omignon, à l’intérieur de l’oppidum et au Calvaire et de l’autre côté de la rivière, à la Pâture des Noyers.
L’occupation à l’intérieur de l’oppidum de Vermand était très mal connue jusqu’aux fouilles de la rue des Troupes, fin 1997, qui ont mis au jour un quartier densément occupé du Ier au début du Ve siècle. Toutes les interventions réalisées depuis montrent que le rempart enserre un habitat antique dense et bien conservé.
La Pâture des Noyers à Marteville correspond à un vaste ensemble cultuel organisé autour de nombreux temples (dont quatre sont visibles sur cette vue aérienne) de type gallo-romain, à plan en double carré.
Depuis 121 avant notre ère, les Romains occupent le sud de la Gaule. En 58 avant notre ère, César intervient en Gaule intérieure dite Chevelue. En 57, le général romain évite d’affronter les 300 000 Belges regroupés sur l’Aisne, qui se dispersent. Il soumet successivement les Suessiones (Soissonnais), Bellovaci (Beauvaisis) et Ambiani (Amiénois). Les Nervii (Hainaut), Atrebates (Artois) et Viromandui sont défaits lors d’une sanglante bataille sur les rives de la Sabis. La guerre se poursuit à travers toute la Gaule jusqu’en 51. Les Gaulois en sortent exsangues : un million de morts et un million de captifs réduits en esclavage, pour une population évaluée entre 5 et 8 millions d’habitants.
Les photographies aériennes redressées donnent une image incomplète du quartier du Calvaire qui s’organise autour d’un réseau de rues, autour du carrefour formé par les deux routes antiques qui s’y croisent (le tracé de la voie de Bavay à Beauvais reste à préciser). Plusieurs interventions archéologiques récentes (fond jaune) ont porté sur la limite sud de cet habitat, rue Charles-de-Gaulle.
242400
242600
657800
658000
Collège
Traces d’après les vues aériennes
1969 : fours de potieret nécropole
1976: rejets de potier
Bâtiments
Rue ?
Rue ?
Rue ?
Rue Charles De G
aulle
Rue ?
Bâtiments
2009-2010: Bâtiment
2008: Bâtiment
2008:Bâtiment
Route
Fossé de la voie
Fossés
Vers AmiensRue ?
Rue ?
Rue ?
Vers Bavay
0 100 m 2011
658000
659000
242000
Oppidum
Collège
Ruelle Eleup
le Calvaire
100
C h a m p d e l aTr é s o re r i e
Le s Rempar t s
La Pâture des Noyers
Marteville
75
ZAC des Lavoirs
fermegauloise
Au Dessus de La Maison Lalue
75
siteromain
vers Amiens
vers
Bav
ay
vers St-Quentin
Om
igno
n
Zone humide occupéepar des marais et prairies
Rempart protohistorique Voies et rues antiques
Occupation antique
Nécropoles antiques
Nécropole mérovingiennne
Opérations archéologiques récentes : emprise des parcellesOpérations récentes : emprisedes tranchées
250m0 500m2011
Les voiesromaines
Les routes aménagées par les Romains restent la trace la plus perceptible de leur présence : nombre de ces voies constituent encore d’importants axes routiers. Leur rectitude étonne :leur fonction était d’abord de faciliter la circulation des troupes et des administrateurs afin d’assurer un bon contrôle du pays et leur tracé ne se préoccupe pas de la topographie. L’archéologie révèle que ces routes sont loin de ressembler à l’image que l’on s’en fait : une chaussée pavée. A l’origine, ce ne sont que des chemins de terre bien aplanis. Lors des réfections, ils ont souvent été empierrés, mais de façon sommaire.
Un réseau diversifiéLes déplacements rapides des troupes de César suggèrent qu’il y avait de bons chemins en Gaule avant la conquête. Un premier réseau de grandes routes est aménagé par Agrippa. Après que les capitales de cité aient été fondées, cette trame de voies publiques, les viae publicae, est rapidement densifiée par des axes reliant les chefs-lieux entre eux. Des routes secondaires, mal connues, complétaient ce réseau principal, ainsi que de nombreux chemins ruraux desservant les fermes et les terres agricoles, mis au jour ponctuellement par les fouilles.
La voie du Léman à l’Océan, qui franchissait la Somme à Saint-Quentin, appartient au premier réseau routier mis en place par Agrippa en 39 ou en 16avant notre ère. Plusieurs de ces voies partaient de Lyon, la capitale de la province, mais la voie du Léman à l’Océan venait directement d’Italie et reliait Milan au port de Boulogne.
Un réseau stratégique qui dynamise les échangesLes voies publiques sont jalonnées de relais du cursus publicus, pour le déplacement rapide des agents de l’État, notamment des porteurs de courrier : tous les 10 milles environ (14,8 km), il est possible de changer de monture dans une mutatio, tous les 30 milles (44,3 km) une mansio offre un hébergement et les services d’un charron à même de réparer les véhicules. Rapidement, ces relais publics sont ouverts à tous les voyageurset d’autres, de caractère privé, notamment des auberges ou tavernes(tabernae) se multiplient. Certains donnent naissance à de petites agglomérations.
Des chemins de terre…Les voies fouillées aux alentours de Saint-Quentin révèlent une certaine hétérogénéité. Leur emprise, délimitée par des fossés pour drainer l’eau, oscille entre 12 et 15 m. Au départ, les chaussées sont des chemins de terre, larges d’au moins 3,5 m, mais souvent plus, car ils se déplacent voire se dédoublent. Par endroit, des terrassements ont été réalisés pour adoucir les déclivités : des versants ont été entaillés pour former des cavées. Ultérieurement, certains tronçons ont été empierrés par des apports de craie, silex et grès, dont la surface est légèrement bombée pour faciliter l’écoulement de l’eau. Des traces d’ornières creusées par les roues des véhicules sont presque partout visibles.
extrait des cartes IGN 2508 E, 2509 E, 2608 O et 2609 O, série bleuextrait des cartes IGN 2508 E, 2509 E, 2608 O et 2609 O, série bleuextrait des cartes IGN 2508 E, 2509 E, 2608 O et 2609 O, série bleue ver
s So
isso
ns
ver
s So
isso
ns
ver
s So
isso
ns
ver
s A
rras
ver
s A
rras
ver
s Bav
ay
ver
s Bav
ay
ver
s C
amb
rai
ver
s C
amb
rai
vers Cologne
vers Cologne
ver
s C
olog
ne
ver
s C
olog
ne
vers Reims
vers Reims
vers Beauvais vers Beauvais vers Beauvais
vers Amiens vers Amiens vers Amiens
vers Bavay
vers Bavay
0 4 km
tracé incertaintracé probableemplacement reconnuAugusta Viromanduorum
Le réseau des voies publiques rayonne autour de la ville capitale, Saint-Quentin. Cependant, Vermand constitue un second nœud routier, qui correspond certainement à l’époque où cette agglomération était la capitale. Les voies publiques ont été récemment observées en huit endroits : Gricourt, Pontru, Pontruet (en deux endroits), Vermand, Villeret et par deux fois à Saint-Quentin.
ornières
chemin
Un chemin rural a été fouillé sur plus de 200 m de longueur au Bois de la Chocque à Saint-Quentin. Il est implanté dans une cavée large de 3 m à 5,20 m. Au centre, la chaussée principale, large de 1,70 m, est bordée par des fossés de drainage. Les ornières, bien visibles, permettent d’estimer la largeur des essieux des chariots à environ 1,40 m et celle des roues, à 8 cm. Cette voie s’élargit à plusieurs endroits, sans doute pour permettre à deux véhicules de se croiser. Ce chemin aménagé dans la seconde moitié du Ier siècle avant notre ère est comblé dans le troisième tiers du Ier siècle de notre ère.
À Gricourt, a été observée une portion de la voie publique reliant Saint-Quentin à Arras. Établie à 2 m du chemin actuel dont elle est pratiquement parallèle, elle témoigne d’une pérennité des réseaux viaires depuis l’Antiquité. Large d’environ 6 m, elle ne semble que partiellement empierrée : une couche de silex et grès comblait une dépression.
Le transport routier
Le harnachement Le harnachement du cheval était décoré de multiples pièces en bronze : appliques, pendants et autres phalères. Certaines de ces pièces servaient avant tout à relier les différentes sangles entre-elles ; d’autres devaient protéger les animaux des mauvais esprits comme les clochettes ; on accordait également différentes vertus ou significations à des motifs fortement prisés pour les décorations de harnais (lune, pelte, coquille,…).
Les routes servaient au déplacement des hommes et au transport des marchandises. C’est la principale fonction du cheval (et de ses croisements avec l’âne : bardots et mulets),comme monture, animal de bât ou pour tracter des véhicules. Son harnachement était décoré de multiples pièces en bronze : appliques, pendants et autres phalères.
Les hipposandalesLes hipposandales (soleae) servaient à protéger les sabots, au même titre que le fer à cheval, dans des cas particuliers (animal blessé, terrain difficile…), car elles limitaient l’allure. Les exemplaires découverts sont exclusivement en fer, mais il enexistait en matières végétales. Elles venaient recouvrir les sabots préalablement protégés par une pièce de cuir, le tout maintenu par des lanières.
Schéma de montage d’une roue sur un véhicule antique.Schéma de montage d’une roue Schéma de montage d’une roue sur un véhicule antique.sur un véhicule antique.
Moyeu
Fusée
Clavette
Bandage
Frette d’essieu
Frette du moyeu
Les véhiculesIl existait une large gamme de véhicules pour le transport des personnes, des produits agricoles et des marchandises. Plusieurs pièces de chars ont été mises au jour sur le Parc des Autoroutes. Il s’agit de frettes et cages en fer venant consolider les moyeux en bois qui relient les roues aux caisses des véhicules ou les fusées des essieux. Ces cercles métalliques étaient posés à chaud sur le bois pour assurer une meilleure solidité à l’assemblage. Une goupille pourvue d’une forte tige cylindrique assurait également une grande résistance au châssis.
L’espace ruralantique
Si quelques sites gallo-romains notables, villae et cimetières, des environs de Saint-Quentin ont été fouillés dès le XVIIIe siècle, nos connaissances sur cette période ont été radicalement renouvelées avec le développement de l’archéologie préventive depuis 25 ans. Autour de Saint-Quentin, l’exploration minutieuse de 350 hectares de terres agricoles a permis de dresser un inventaire fiable des formes de l’habitat gallo-romain et de leur rôle dans la structuration de l’espace rural.
Une occupation denseDans les années 1960-1970, les prospections aériennes dans le bassin de la Somme, ont révélé des centaines d’établissements agricoles de grande taille, identifiés à des villae, terme employé par les Romains pour les fermes d’une certaine importance. L’archéologie préventive, parce qu’elle permet des investigations sur de vastes espaces et des territoires jusqu’alors inexplorés, a révélé un semis d’établissements plus petits, montrant une occupation du sol bien plus dense que ce qui était perçu jusqu’alors : sur le Parc des Autoroutes à Saint-Quentin, il y a un site d’habitat pour 45 hectares.
Fouillée dès 1765, la villa du Royaux à Neuville-Saint-Amand apparaît
sur des clichés aériens réalisés dans les années 1970
par Roger Agache.
Un habitat disperséL’habitat rural dominant est caractérisé par une mosaïque d’établissements de tailles variées, qui vont de la maison isolée à la grande villa étendue sur plusieurs hectares. Très majoritairement, ils ont une vocation agricole, mais des activités artisanales sont parfois attestées, comme sur le Parc des Autoroutes où un atelier de production de céramiques a été découvert. Cet habitat dispersé est complété par des sanctuaires, des sites routiers (comme Prémont), quelques rares bourgs généralement implantés sur les routes (Gouy Ronssoy, Epehy et Châtillon-sur-Oise), ainsi que de petites villes comme Vermand.
Un territoire structuréDes chemins, matérialisés par deux fossés latéraux, sillonnent l’espace rural, qui est divisé - hormis les espaces boisés - en parcelles agricoles cultivées ou en prairie. Une partie d’entre-elles sont bordées par des fossés (les autres formes de clôture, par exemple, végétales, n’ont pas laissé de trace). Les clôtures fossoyées de l’époque romaine tendent à être rectilignes, ce qui a été interprété, autrefois, comme un découpage régulier des terres, la centuriation. Les fouilles récentes ont cependant montré que ces limites n’avaient pas la régularité supposée et qu’elles étaient souvent associées à des parcellaires gaulois conservés, par endroits, durant toute la période romaine.
Au Parc des Autoroutes à Saint-Quentin, une décennie de fouilles a permis d’étudier l’évolution de l’habitat gallo-romain sur 180 ha et sur une durée de quatre siècles. Les premières implantations (1, 2, 3 et 4), apparaissent au début du Ier siècle sur d’anciens sites gaulois. Une ferme traverse toute la période, sans jamais montrer de grandes marques de romanité (6). Non loin, une grande ferme préfigure, par son organisation régulière, l’organisation des villae (5). Elle est presque désertée, lorsqu’une villa est fondée à proximité dans les années 70 (7). Et lorsque cette villa est abandonnée à la fin du IIIe siècle, le site de la grande fermeest réoccupé par un établissement agricole ouvert. Le début du Ve siècle marque le terme de cette occupation dense.
Carte de l’occupation gallo-romaine autour de Saint-Quentin.
Réseau viaire antique
Repérage aérien (R. Agache) Villa (grand établissement agricole)
Ferme plus ou moins importante
Habitat ou indice d’habitat
Habitat à vocation artisanale
Chef-lieu de cité
Parc des Autoroutes
(Extrait des cartes IGN 2508 E, 2509 E, 2608 O et 2609 O, série bleue)
N
1 hectare
100
Zone d'extraction (craie, limon...)destinée à la construction
110
110
?
sd 8
2056
2392
2264
2192
2257
4/E-
0 200 m
117.13
117.22
116.33
116.18
116.33
116.29
116.48
116.32
116.53
116.28
1tr
2
4
5
7
8
19piquet voirie
1134
1179
N
E
S
O
Cimetière du milieu IVe s.( 9 inhumations )
Voie romaine Vermand-Saint-Quentin
Voie romaine Beauvais-Saint-Quentin
1 - Petit établissement à vocation agricole et artisanale (production de céramique) occupé entre les années 10/20 et 50 de notre ère
Ferme enclose succédant à un petit habitat (2) du milieu Ier s. délimité par un fossé en agrafe. Ferme occupée de la fin du Ier s. à la seconde moitié du IVe s.
Espace funéraire du milieu du IIIe s. : puits d'extraction reconvertis en sépulture associant des incinérations humaines et des inhumations de chevaux
(milieu IIe siècle)
7 - Villa (exploitation agricole) fondée vers 70 de notre ère et abandonnée à la fin du IIIe siècle. Elle succède à un établissement enclos du début de la période gallo-romaine (3), préfigurant plus modestement l'enclos de la villa (en violet).
7
5
5 - Grande ferme du milieu du Ier s., périclitant à la fin du Ier s., servant de site à un petit habitat secondaire du IIe/IIIe. Déserté, l'emplacement est de nouveau occupé dès la fin du IIIe s. et jusqu'au début du Ve s. par un grand établissement agricole.
Zone d'extraction (craie, limon...)destinée à la construction
66
1
2
3
4
Voie principaleVoie secondaire, chemin de desserte
Fossés délimitant les espaces résidentielsFossés délimitant les espaces agricoles (culture et élevage), forestiers...
L’habitat rural :formes et évolutionDans les campagnes, la romanisation ne s’est pas traduite par un bouleversement radical des terroirs. Face à l’émergence de la villa, type d’établissement agricole longtemps présenté comme emblématique de la romanisation, mais qui résulte plus d’une évolution locale, où l’influence gauloise transparaît dans l’organisation spatiale dispersée, il existe de petites fermes où la tradition gauloise s’est pratiquement perpétuée jusqu’au IIe siècle de notre ère.
La ferme de Bohain-en-VermandoisDurant sa courte existence, de 60-70 au milieu du IIe siècle, la ferme de Bohain présente une organisation spatiale et des modes architecturaux qui évoquent davantage les fermes gauloises que les fermes gallo-romaines évoluant en villa. Ce modeste établissement (quatre fois plus petit que la villa de Saint-Quentin)est l’exemple d’une catégorie d’habitat peu affecté par la romanisation.
Une installation précaire à UrvillersLe site correspond à un habitat très modeste (maison, cave, puits à eau…), occupé brièvement entre 70 et 90/100 de notre ère. Les indices d’un probable travail métallurgique ne permettent pas d’exclure une activité agricole. Ce type d’habitat, qui commence à peine à être documenté par l’archéologie, ne semble pas rare aux deux premiers siècles de notre ère.
L’établissement s’inscrit dans un enclos trapézoïdal de 4 500 m2, divisé en trois secteurs par des fossés. Dans son premier état, seul l’espace central est occupé par des constructions en bois et en terre, comprenant une habitation et des greniers. Dans son second état, l’habitation principale est déplacée et un nouveau bâtiment d’exploitation est construit dans la partie sud de l’enclos.
Installé dans l’angle d’une parcelle agro-pastorale, des fossés discontinus délimitent
un enclos irrégulier de 3 000 m2. La découverte d’une scorie interne
(résidu de la réduction du fer) suggère le travail du fer sur le site.
Le développement spatial de la ferme du dernier quart du Ier siècle (en noir) s’appuie sur l’enclos initial (en vert) du deuxième tiers du Ier siècle. Au fond de l’enclos, l’habitation principale, dotée d’une cave extérieure, domine la cour. Toutes les constructions s’appuient sur des poteaux plantés et leurs élévations étaient probablement en torchis.
À la fin du Ier siècle, un plus grand bâtiment principal est reconstruit sur des fondations en dur, tandis que la majorité des édifices annexes s’appuient toujours sur des poteaux plantés dans le sol. La cour est divisée en deux espaces distincts, une pars urbana résidentielle et une pars rustica entourée des bâtiments d’exploitations, par une clôture interne associée à un bâtiment-tour surmontant une cave. Cette organisation est conservée jusqu’à l’abandon de la villa durant la seconde moitié du IIIe siècle.
Bâtiments d'habitationsecondaire ou d'exploitation,architecture de bois et de terre
Bâtiments d'habitationsecondaire ou d'exploitation,architecture de bois et de terre
Bâtiments d'habitationsecondaire ou d'exploitation,architecture de bois et de terre
Bâtiments totalementarasés (hypothétiques)
Chemin en creux dedésenclavement (vers un autre habitat ?)
Grande ferme préfigurant la villa(dernier quart du Ier siècle)
Enclos primitif de la grande ferme (entre 30 et 70)
Villa, premier état (de la fin du Ier s. au milieu du IIe s.)
Entrée principalede la ferme gallo-romaine(vers la voie romaine)
Entrée principaled'un enclos (habitat ?)
Chemin en creux reliant la villa à la voie romaine
Bâtiment principalde l'exploitation,architecture en pierre
Bâtiment d'habitationsecondaireen bois et en terre
0 50 m
N
La villa de Saint-QuentinCette villa de taille moyenne est l’une des rares intégralement fouillées en Picardie. En deux siècles d’existence et d’évolutions, la permanence de l’organisation spatiale est manifeste. Dans la filiation d’un enclos quadrangulaire de 8000 m2, une nouvelle enceinte rectangulaire, de près de 2 ha, est mise en place dans les années 70 de notre ère. Contrairement à l’enclos primitif, la présence de bâtiments d’exploitation, disposés autour d’une cour centrale vide permet d’identifier une ferme dont l’organisation générale préfigure celle de la villa. À la fin du Ier siècle, l’usage de la pierre dans la construction de certains bâtiments permet de qualifier avec certitude, cette ferme de villa.
Évocation en trois dimensions de la villa du Parc des Autoroutes dans son état le plus documenté.© Boris Marié.
Bâtiment d'habitation
Passage
Entrée principale
Passage
Fossés d'enceinte, fosses et poteaux de l'établissement Fossés de parcellaire antérieurs à l'établissement
50 m
N
Puits
Chemin
Passage
Zone d'activité ?
Cour
Entrée principale
Parcelle agro-
pastorale
Légende
Bâtiment d'habitation
Zone de maraîchage ?
Parcelle agro-pastorale
Bâtiment du premier étatBâtiment du second état
Fosse et poteauZone de piétinement
N
La ferme de Bohain-en-VermandoisLa ferme de Bohain-en-Vermandois siècle, la ferme de Bohain
présente une organisation spatiale et des modes architecturaux qui évoquent villa.
de Saint-Quentin)
État 1 - © Boris Marié.
État 2 - © Boris Marié.
Les productionsagricoles
Les activités agricoles de la période romaine sont documentées par l’étude des vestiges des productions végétales (objets de la carpologie, anthracologie et palynologie) et animales (ostéologie), des outils utilisés et des aménagements en rapport (bâtiments et installations agricoles). Ces différentes approches montrent à la fois une forte continuité avec la période gauloise et l’introduction d’innovations liées à l’influence romaine, qui suggèrent une intensification de la production en vue de dégager davantage d’excédents commercialisables.
La conservation des denrées végétalesAu début de la période romaine, la conservation en silo enterré est abandonnée. Les petits greniers surélevés sont remplacés, rapidement dans les grandes exploitations et plus tard dans les petites, par un grand grenier (parfois deux, dans les grandes villae), à sol surélevé par un plancher afin d’assurer une bonne isolation. Les récoltes sont donc concentrées dans un seul édifice.
L’élevageCette activité a laissé peu de traces archéologiques directes, en dehors des ossements animaux étudiés par l’archéozoologie. Dans le Saint-Quentinois, les restes de faune sont mal conservés, ce qui limite les analyses. Dès le début de la période romaine, la taille des animaux les plus communs - bovins, ovins, porcins et équidés - augmente significativement, en raison d’importations d’animaux et d’innovations zootechniques. L’objectif est d’accroître la production de viande et de disposer d’animaux de travail (bœufs) plus puissants qui permettent de mieux travailler des sols lourds. Les oiseaux de basse-cour, les poissons, coques et huîtres, correspondent à de nouvelles habitudes alimentaires, comme l’abandon de la consommation du cheval et du chien. Une discrète présence du cerf et du lièvre atteste une pratique de la chasse.
Découverte sur la villa de Neuville-Saint-Amand, cette graine de melon ou concombre (taille réelle 6 mm) témoigne de l’introduction de cucurbitacée méditerranéenne dans la culture potagère locale. © Véronique Zech-Matterne, MNHN.
Les productions végétalesSur plusieurs sites, des lots de graines et restes de plantes cultivées, mais aussi adventices et messicoles (« mauvaises herbes »), révèlent la diversification des cultures par l’introduction de plantes exogènes, alternéesà la jachère dont le rythme nous échappe. Le Bassin de la Somme est caractérisé par un maintien des blés vêtus, amidonnier et épeautre, espèces robustes préférées des Gaulois, difficiles à panifier et plutôt consommées sous forme de galettes, semoule et bouillies. Sont aussi cultivés, en moindre quantité, le froment panifiable, les légumineuses (lentilles et les pois) et l’orge vêtue. La pratique de la cueillette est attestée par la découverte des noisettes, des noix et des prunelles sauvages.
Grains d’orge gallo-romaine carbonisés. La carpologie étudie les restes de graines et de fruits conservés par une carbonisation (incendie) ou une minéralisation (excréments fossilisés). © Véronique Zech-Matterne, MNHN.
Blé épeautre, variété rustique toujours cultivée en raison de ses qualités nutritives et gustatives.© Véronique Zech-Matterne, MNHN.
Blé amidonnier, variété rustique
toujours cultivée à titre conservatoire.
© Véronique Zech-Matterne, MNHN.
de Neuville- de Neuville-
Sur plusieurs sites, des lots de graines et restes de plantes cultivées, mais aussi adventices et messicoles (« mauvaises
quantité, le froment panifiable, les légumineuses (lentilles et les pois) et l’orge vêtue. La pratique de la cueillette est attestée par la découverte des noisettes, des noix et des prunelles sauvages.
Saint-Quentin, Parc des Autoroutes - Plan d’un grenier
surélevé à six poteaux de la première moitié du Ier siècle,
de tradition architecturale gauloise. Suite à un incendie,
il s’est effondré : la répartition des restes carpologiques révèle
un rangement des céréales par espèces.
2,5 m0
Grenier sur poteaux :surface planchéiée utile 15 m2
Fosses d'implantation des poteaux
Concentration significative de restesde blé amidonnier
Concentration significative de restesd'orge vêtues
Empreinte des poteaux
N
Archéosite d’Aubechies (Belgique) - Reconstruction d’un grenier à 6 poteaux d’après des données archéologiques et ethnographiques.
Saint-Quentin, Parc des Autoroutes - Plan d’un grand grenier à contreforts du Bas-Empire. Un enclos rectangulaire fossoyé protège le grenier de l’humidité en drainant le sol. Devant, un grand espace vide pourrait correspondre à une aire de traitement des grains sur un sol aménagé (battage/vannage) ou de déchargement avant stockage.
Vue générale du grenier. Malgré des fondations très arasées, quelques ressauts situés le long des fondations
marquent l’emplacement de contreforts.
Fondations restituées 0 5 m
Grenierde 35 m2
Contreforts
Fossés ouverts
Passage
PassagePassagePassageFondations existantes
Aire de traitementou de déchargement ?
N
Différence de stature entre le petit bovin gaulois et le grand bovin gallo-romain.© Gilles Tosello.
Vue générale du grenier. Malgré des Vue générale du grenier. Malgré des fondations très arasées, quelques fondations très arasées, quelques ressauts situés le long des fondations ressauts situés le long des fondations
marquent l’emplacement marquent l’emplacement
Les travaux agricolesChamps, potagers et vergers
Travailler la terreLe coutre présenté est une des pièces métalliques d’un araire en bois ; il sert à découper la terre verticalement lors des travaux des champs. Contrairement à la charrue qui retourne la terre en profondeur et la verse d’un seul côté, l’araire trace un sillon symétrique en surface.La charrue au sens strict demeure inconnue des Romains. Les outils à main comme la serfouette et la bêche sont plus appropriés à la culture potagère ou au jardinage.Les bêches en bois renforcées par une ferrureapparaissent à la période romaine.
Les outils ou instruments agricoles en fer mis au jour ont été exclusivement employés dans les campagnes viromandes. Il est délicat de juger des types d’exploitations et de leur ampleur à partir de ces découvertes, les outils en fer étant fréquemment récupérés pour être recyclés et ceux en bois ayant disparus.
Les végétauxLa fourche au même titre que le râteau restent des outils polyvalents qui ont pu servir à la culture et à l’entretien de lopins de terre mais aussi aux foins ou aux nettoyages de litières d’animaux. Les fourches à trois dents apparaissent au cours de l’Empire. La récolte des céréales est illustrée par une faucille caractérisée par sa lame étroite en arc de cercle. La taille des arbres et arbustes était effectuée à l’aide de couteaux agricoles à lames courbes plus larges, les serpes et serpettes. Le crochet exposé, monté sur un long manche, a pu être utilisé pour attraper des éléments en hauteur (fruits, branches coupées ?). Les lourdes haches, à œillères caractéristiques des productions romaines, étaient destinées à abattre et à débiter les arbres.
AugustaViromanduorum
Les Romains ont imposé le système de la polis : la vie politique, sociale et religieuse d’un territoires’organise autour d’une ville capitale. Le nom de la nouvelle ville, Augusta, a été choisi pourhonorer Auguste, le premier empereur romain, qui régnait à l’époque (de 27 avant notre ère à 14)où la ville fut fondée.
La capitale des ViromanduiLa ville et son territoire sont administrés par un sénat local (curie) composé des décurions, des notables. Deux inscriptions gravées sur des stèles conservent le souvenir de deux éminents magistrats, qui après avoir exercé toutes les magistratures locales, ont été délégués par la cité à l’assemblée des Trois Gaules à Lyon, une sorte de parlement provincial, où ils ont eu de hautes responsabilités. La première a d’ailleurs été découverte à Lyon. Celle trouvée en 1870 dans les fondations de la Basilique, incomplète et aujourd’hui perdue, est datée de la fin du IIe siècle ou du IIIe siècle.
La fondation de la villeMajoritairement, les nouvelles capitales sont fondées à peu de distance d’un oppidum, car leur topographie ne convenait probablement pas à une urbanisation de type gréco-romain : Vermand est délaissée pourSaint-Quentin. Les grandes routes mises en place antérieurement semblent avoir été déterminantes dans le choix du site, ici la voie du Léman à l’Océan, ainsi que la présence d’un cours d’eau, la Somme :la ville a été implantée au point de franchissement du fleuve par la route. Le versant exposé au sud a étépréféré afin de bénéficier d’un meilleur ensoleillement, bien que la déclivité des versants du plateau soitmarquée. Les investigations archéologiques ne permettent pas de déterminer avec certitude le moment précis de cette fondation, qui est probablement intervenue dans les deux décennies précédant notre ère.
L’organisation de la villeL’occupation s’étend sur plus de 40 hectares : les limites de l’agglomération ne sont pas encore établies avec précision. La ville est structurée par un réseau de rues très partiellement reconnu grâce à l’archéologie. Elles sont rectilignes et plus ou moins parallèles. Comme dans toute ville romaine, celles qui sont plutôt axées nord-sud sont appelées cardines (cardo au singulier) et celles qui les recoupent de façon plus ou moins perpendiculaires, plutôt axées est-ouest, sont les decumani (decumanus au singulier). La grille ainsi constituée encadre des îlots quadrangulaires (insulae).
Calque (moitié de sa taille réelle) de la dédicace gravée sur une stèle en calcaire noir trouvée en 1870 dans les fondations de la Basilique, avec à droite, une restitution du texte manquant (partiellement hypothétique), car la pierre (H. 420 mm, L. 370 mm), aujourd’hui perdue, était cassée et l’inscription incomplète. Voici le texte (les parties manquantes sont indiquées par les crochets. Les mots usuelsabrégés sont complétés entre parenthèses) :Num(ini) Aug(usti), d[eo Vol]/kano, civit(ati) Vi[romanduorum], C(aius) Suiccius La[…], sac(erdos) Rom(ae) et Au[g(usti)], praef(ectus) l(egionis) VIII, cu[rator] civitatis Sue[ssionum, in]/quisitor Ga[lliarum, le]/gatus[.Ce qui signifie : « à la divinité impériale, au dieu Vulcain, à la cité des Viromandui, Caius Suiccius La[ ], prêtre de Rome et d’Auguste, préfet de la VIIIe légion, curateur de la cité des Suessiones, inquisiteur des Gaules, délégué… ».Cette dédicace correspond au culte civique rendu à la divinité impériale qui permet aux habitants de l’Empire de démontrer leur loyauté au souverain. Il est habituel d’y associer une divinité locale majeure : ici, Vulcain, le dieu forgeron. Le troisième destinataire est la civitas (c’est-à-dire le peuple) des Viromandui. Le dédicant était un citoyen romain viromandue, probablement un chevalier, qui après avoir exercé toutes les magistratures et prêtrises locales a été délégué à l’assemblée des Gaulesà Lyon, où il a eu des fonctions financières.
Plan d’Augusta, avec les vestiges antiques reconnus. Le tracé des rues est largement hypothétique. Zones funéraires : A : Basilique (à partir du Ve s.) ; B : grande nécropole détruite au XVIIe s. ; C : caveaux funéraires ( ?) signalés au XIXe s. ; D : découverte d’une stèle funéraire au XIXe s.Liste des interventions ayant livré des indices d’occupation romaine : 1 : rue Victor Basch (1980) ; 2 : 33-37 rue Voltaire (1981) ; 3 : Les Oriels (1982) ; 4 : 39, rue Villebois-Mareuil (1984) ; 5 : rue du Wé (1988) ; 6 : Hôtel-Dieu (1989) ; 7 :Place de l’Hôtel de Ville (1990) ; 8 : rue de l’Arquebuse (1991) ; 9 : 14, rue de Lyon (1991) ; 10 : 16, Place Babeuf (2000) ; 11 : 73, rue Émile Zola (2000) ; 12 : ancienne filature Touron, bd Victor Hugo, rues des Faucons et Voltaire (plusieurs diagnostics et fouilles de 2000 à 2009) ; 13 : 81-83 rue Voltaire (2005) ; 14 : 10-12 rue Bisson (2005) ; 15 : 49 rue Émile Zola (2007) ; 16 : école Jumentier (2008) ; 17 : crypte archéologique de la Basilique (2004-2010).
1
2
3
4
56
7
8
9
10
11
1213
14
17
?
B
D
15
C
A
16
2011
Voie : observation ancienne
Voie : observation imprécise
Rue : tracé hypothétique
Routes antiques
Routes : tracé incertain
Voie : tracé probable
Voie au tracé assuré
Zone funéraireZone humide, marais
Sondages et fouilles
Parcelles explorées
Le site d’Augusta
Les ruesd’Augusta
Les recherches archéologiques ont mis au jour plusieurs portions de rues qui montrent un aménagement relativement standardisé et conforme à ce qui est connu dans les villes principales de la Gaule.
Des rues aux façades alignéesLes rues sont larges de 10 à 13 mètres. Les édiles veillent à ce que l’espace public soit respecté : les maisons n’empiètent jamais sur la rue. En revanche, l’aménagement de cet espace diffère légèrement d’une rue à l’autre et peut changer au fil du temps. Cependant, le principe général est partout identique : une chaussée centrale pour la circulation des véhicules est séparée des deux trottoirs latéraux réservés aux piétons par des caniveaux ou petits égouts à coffrage de bois pour l’évacuation des eaux de pluies.
Rue de l’Arquebuse, se croisentun cardo, large de 13 m et un decumanus dont le prolongement a été reconnu en 2007 rue Emile-Zola. Les caniveaux du decumanus présentent la particularitéde ne pas être alignés de part et d’autre du croisement avec le cardo. Au nord, il est classiquement à environ 3 m de la façade de la maison. En revanche, au sud, il longe la façade et il n’y pas de trottoir.
Des trottoirs en partie couvertsLes deux trottoirs latéraux, larges de 0,60 m à plus de 3,50 m sont en terre damée parfois assainie par de la craie. Ils sont protégés des intempéries par des portiques couverts d’une toiture en appentis ou par un étage en encorbellement, appuyés sur des poteaux de bois ou des colonnes de pierre qui reposent sur des bases de pierre espacées de 3 à 5 m.
Rue Emile-Zola, un decumanus, large de 11 m, déjà reconnu en 1991 rue de l’Arquebuse, a été suivi sur presque 56 m de longueur. L’occupation de ce quartier débute avant le milieu du Ier siècle et s’achève dans les années 260-270, mais la voie a été utilisée au moins jusqu’au IVe siècle, comme en témoigne la découverte d’une monnaie. Les vestiges antiques ont dû rester longtemps visibles : les maisons du XIVe sièclese superposent aux constructions antiques et l’espace de la rue ne semble pas bâti.
Rue Emile-Zola - Les trottoirs, au sol de terre, d’argile ou craie damée, étaient protégés par un portique dont les colonnes ou poteaux de bois étaient supportés par des bases de pierre, certaines formées de fûts de colonne retaillés.
La chaussée fouillée rue Emile-Zola a été rechargée sur plus de 1,50 m d’épaisseur au fil du temps. Dans son premier état,la voie est aménagée dans le substrat loessique où les ornières creusées par le passage des roues sont bien lisibles. Ensuite, un remblai de blocs de craie compacté sur une épaisseur de plus de 0,20 m sert d’assise à un lit de silex. Il est surmonté, sur plus de 0,50 m d’épaisseur, par cinq autres recharges de silex alternant avec des remblais de craie ou des niveaux de terre.
Des chaussées de largeur variableElles sont initialement installées directement sur le substrat géologique. Suite à l’exhaussement progressif des sols des habitations contiguës, elles sont rechargées à l’aide de craie et de silex compactés. Au final, leur épaisseur varie de 0,60 m à plus de 1,50 m. Plusieurs niveaux de circulation sont ainsi superposés, matérialisés par de fins niveaux de terre fine. La largeur des voies varie de 4,40 m à presque 8 m. Leur profil bombé facilite l’écoulement des eaux vers les caniveaux latéraux dont les coffrages de bois sont maintenus par des piquets plantés.
La vaste parcelle partiellement fouillée entre les rues Voltaire, des Faucons,
de La Grange et le Boulevard Victor-Hugo, contenait deux cardines et deux decumani. Les observations les plus significatives ont
été faites sur le decumanus central. Au tournant de notre ère, la rue large
de 10,60 m, possédait déjà des portiques, alors que la chaussée était
directement aménagée sur le substrat de craie (photo en haut). Ensuite, elle a été rechargée avec de la craie et du silex
(photo de gauche). Le caniveau, plusieurs fois réaménagé, avait un coffrage de bois
maintenu par des piquets, dont la trace est bien visible sur la photo de droite.
cave
caniveau
caniveau
chaussée
caniveau
chaussée
trottoir
trottoir
: mur: fondation: base de pilier
: restitution de mur: restitution salle antique 0 10 m
hypocaustehypocauste
: mur: fondation: base de pilier
: restitution de mur: restitution salle antique
0 10 m
La constructionromaine
L’influence romaine est particulièrement perceptible au niveau de l’architecture et des modes de construction. Les innovations les plus flagrantes sont l’introduction de la pierre et de la tuile,mais les fouilles archéologiques révèlent une situation plus nuancée. Si l’usage de la pierre est bien une nouveauté, il n’a pas éclipsé l’architecture en bois et terre en usage à la période gauloise, loin s’en faut. D’autre part, son succès a été progressif.
Le bois et la terre restent majoritairesDeux techniques de constructions à ossature de bois sont utilisées à l’époque romaine : des poteaux de bois plantés dans le sol ou assemblés avec une pièce de bois horizontale (sablière basse). Les poteaux plantés se raréfient après le milieu du Ier siècle (avant de faire un retour massif au IVe siècle). Les bâtiments à structure posée sont plus complexes à mettre en œuvre (assemblage à tenons et mortaises ou mi-bois), mais cette technique donne une meilleure longévité à l’édifice. Cette dernière est accrue si la sablière basse est isolée du sol : une grande variété de techniques a été mise en œuvre, allant d’un simple lit de pierres ou solin, éventuellement installé dans une tranchée, à un véritable mur maçonné. Plus ce support est massif, plus longue est la durée de vie de la construction.
Dans cette restitution inspirée par les observations faites à Vermand, rue des Troupes, la sablière basse repose sur de gros blocs de pierre espacés.
La structure de bois est hourdie de torchis (mélange de limon et de paille hachée) enduite sur des lattes de bois maintenues par des pièces verticales,
les colombes. La toiture est couverte de tuiles canal (imbrex) qui couvrent la jonction entre les tuiles plates à rebords latéraux (tegula).
Les hypocaustesLes Romains ont développé un ingénieux système de chauffage par le sol, par hypocauste, utilisé dans les thermes publics et privés, mais aussi pour des pièces de réception ou des chambres dans les riches demeures. L’air réchauffé par un foyer (praefurnium), circule sous le sol « suspendu » (suspensura) par un réseau de petits piliers ou pilettes qui supporte des dalles de terre cuite recouvertes par un béton « au tuileau », c’est-à-dire incluant des fragments de terre cuite concassés lui donnant une coloration rose. Les murs peuvent aussi être chauffés grâce à un système de double cloison créant un vide. Plus souvent, des conduits en terre cuite (tubuli) assurent le tirage en permettant aux fumées de s’évacuer en haut du mur.
L’opus caementiciumLes murs en dur sont majoritairement réalisés en opus caementicium ou béton romain, formé de lits successifs de pierres brutes liées au mortier de chaux et sable, revêtus de deux parements de petits moellons, carrés ou rectangulaires, souvent taillés en pointe vers l’intérieur du mur pour une meilleure cohésion avec le mortier. Ces moellons peuvent avoir un module constant ou être disparates, notamment lorsque le grès, difficile à tailler, est utilisé. L’épaisseur des murs est variable, mais elle est fréquemment de 0,6 m (soit 2 pieds). À Saint-Quentin et dans le Bassin de la Somme, ce mode de construction semble plutôt limité aux soubassements des murs, en raison de l’absence de calcaire remplacé par la craie gélive. Rare jusqu’au milieu du Ier siècle, il est fréquent aux IIe et IIIe siècles.Rue des Patriotes, les fondations sont constituées de blocs de craie compactés dans une tranchée, ce qui est une technique très commune dans le Bassin de la Somme. Rue Emile-Zola, la fondation est formée de moellons de craie grossièrement taillés, liés au mortier de chaux et elle est plus large que le mur, ce qui est habituel.
Hypocauste de la place de l’Hôtel-de-Ville - Contre les murs du bâtiment, un muret a été construit à l’intérieur de l’espace chauffé, pour soutenir les bords de la suspensura qui repose sur des pilettes formées de carreaux en terre cuite. L’emplacement du praefurnium, ainsi que deux canaux d’évacuation des fumées sont visibles sur les photos.
foyer(praefurnium)
pilette
conduits(tubuli)
sol en béton (suspensura)
air chaud
détail d’un remplissage depan de bois par des lattesen bois souple refendu
poteau
bloc
sablière basse ou sole
hourdis de torchis
colombe
couverture de tuiles
fermetriangulée
chevronfaîtière
panne
foyer
01
23m
sablière haute
tegula
umbrex
anté�xe
Scellementde mortier
La maison gallo-romainedans le Saint-QuentinoisLes maisons fouillées dans le Saint-Quentinois ont des plans variés, ce qui est une caractéristique de l’architecture gallo-romaine. Cela va de pair avec leur étendue qui peut aller de quelques dizaines, pour les plus modestes, à quelques centaines de mètres carrés, pour les plus vastes (et au-delà, mais il n’y en a pas encore d’exemple fouillé). C’est aussi un phénomène nouveau :la superficie de la maison et la qualité de son architecture constituent les moyens privilégiés de manifester sa position sociale.
La maison gallo-romaineL’unité d’habitation de base ne comprend qu’une ou deux pièces, dont une avec foyer central (Bohain, Urvillers, Vermand). Plus la taille croît, plus le nombre de salles augmente. Elles sont disposées en longueur, mais peuvent aussi se développer en retour pour encadrer un espace central dégagé (cour ou jardin), comme Place de l’Hôtel-de-Ville à Saint-Quentin. Dans les grandes maisons, un couloir longitudinal ouvert dessert les pièces (villa du Parc des Autoroutes). Cet élément contribue à la monumentalisation de l’édifice. La résidence principale de Bohain est construite selon un plan de tradition gauloise
mais associant des éléments d’architecture romaine dont une cave, une probable galerie de façade ainsi que la toiture en tuiles posée sur une charpente avec ferme triangulée.
Les cavesRares dans l’habitat gaulois, les caves sont très communes à l’époque romaine : toute maison de quelque importance en possède une. Elles servent à la conservation de produits alimentaires. Initialement, ce sont de simples fosses quadrangulaires creusées dans le substrat, avec ou sans coffrage de planches de bois, pourvues ou non d’un escalier (à Bohain, l’accès se faisait au moyen d’une échelle). Dans les habitats plus cossus, les parois sont revêtues d’un parement de moellons, souvent intégré à un solide mur en opus caementicium. Les caves passent de mode au début du IVe siècle.
Place de l’Hôtel-de-Ville à Saint-Quentin, deux des maisons fouillées sont assez complètes. Elles ont en commun un corps de bâtiment parallèle à la rue, complété, pour l’une, par une aileperpendiculaire avec hypocauste et pour l’autre, par deux ailes qui encadrent une petite cour interne où se trouve un puits. La vue en perspective, hypothétique, évoque l’aspect de ce quartier.
Cette cave de la rue des Troupes à Vermand, comblée à la fin du IIIe siècle, était vaste, mais sommairement aménagée. Les parois ne semblent pas avoir été coffrées et l’escalier extérieur était directement taillé dans le substrat limoneux.
Boulevard Victor-Hugo à Saint-Quentin - cette cave comportait deux niches
rectangulaires encastrées dans le mur face à l’accès. Abandonnée dans
la seconde moitié du IIe siècle, son soupirail a été trouvé déposé sur le sol.
La villa de Rouvroy comportait une cave parementée située dans une tour d’angle, en façade de la maison principale. Dans les murs, de gros blocs verticaux (orthostates) servaient à soutenir les poutres du plancher. Les niches de forme semi circulaire avec voûte en cul-de-four ont leur base directement au niveau du sol.
L’évolution du bâtiment principal
de la villa du Parc des Autoroutes permet
de suivre le passage, à la fin du Ier siècle
de notre ère, de la construction
sur poteaux de bois à la résidence
sur fondations. Le plan du bâtiment
avec sa galerie de façade est caractéristique
de cette période. La cave placée dans
un angle de la galerie vers le milieu
du IIe siècle est reconstruite
à l’intérieur d’une des salles principales avant l’abandon
de la villa mi IIIe siècle.
ferme triangulée
plancher
Le confort à la romaineLes murs internes des maisons d’un certain niveau sont revêtus d’enduits peints polychromes, dont les décors sont plus ou moins riches selon les moyens du propriétaire. Des fragments ont été recueillis dans les fouilles récentes mais aucun n’est suffisamment grand pour qu’on puisse en restituer le décor. Les sols sont le plus souvent en terre battue (pas de trace de plancher dans les fouilles récentes). De manière exceptionnelle, ils peuvent être recouverts d’une mosaïque.
Cette mosaïque a été découverte en 1897, rue de l’Abbaye d’Isle, sous la sacristie de la chapelle de l’abbaye d’Isle. Elle mesurait 5,84 m de côté. Le décor géométrique composé de tesselles noires et blanches peut être daté des Ier-IIe siècles.
galeriede
façade ?
fosséd'enceinte
planchermurde
façade
terrain naturel
niveau d'occupation antique supposéniveau d'apparition des vestiges
épaisseur de terrain disparu depuis l'Antiquité
poteau porteur de lapoutre faîtière
toiture constituée detegulae et d'imbrex
cave
trémie échelle
couverture végétale
0 4 m
Superposition des différentes phasesd'évolution du bâtiment principal
cave galeriede
façade
cave
galeriede
façade
cave
galeriede
façade
Phase 1, bâtiment primitif en bois et torchis
Phase 2, première construction en dur
Phase 3b, déplacement de la cave
Phase 3a, réaménagement du bâtiment principal
0 20 m
L’ameublement
Les systèmes de fermeture Les bâtiments, notamment les habitations, étaient fermés par des systèmes de loquets et serrures. D’autre part, les biens personnels étaient mis à l’abri à l’intérieur de meubles, coffres ou coffrets. Les découvertes présentées illustrent différents types de serrure qui se définissent selon le mode d’action de la clef sur le mécanisme d’ouverture. Le système le plus simple met en œuvre une clef se rapprochant d’un simple crochet, en forme de « C ». Il est principalement utilisé à l’époque romaine pour fermer les enclos et les remises. Des clefs plus élaborées, comportent plusieurs dents qui libèrent le pêne de la serrure par retrait et permettent le mouvement de va-et-vient (la translation) à proprement parler. Enfin, le système que nous utilisons de nos jours fonctionnant par un mouvement de rotation est utilisé en Gaule dès le début de l’Empire : la clef comporte un panneton latéral, percé de différentes ouvertures la rendant unique.
Le mobilier de la maison gallo-romaine est apparemment inspiré de celui des Romains. Il est très difficile d’en juger, car l’essentiel était en bois et n’a donc pas laissé de traces. Il n’en subsiste que les pièces de métal, os et ivoire qui servaient à les assemblerou à les décorer (poignées, appliques, ferrures, clous, etc.).
Serrure fonctionnant par retrait et translation. Une fois la clef introduite dans l’ouverture prévue, on la tire vers soi afin que les dents pénètrent dans les gardes, repoussent les lames de ressort et ainsi libèrent le pêne.Vue de profil et schématisa-tion du mouvement.
dentsdent
Serrure fonctionnant par translation simple.La pointe de la clef en «c» s’engage dansle trou du pêne et permetle mouvement de translation par simple basculement de la clef.Vue de profil et schématisa-tion du mouvement.
Serrure fonctionnant par rotation d’aprèsle cadenas de Saint-Quentin, Parc des Autoroutes. La tige forée de la clef pénètre sur la broche. La rotation de la clef soulève le ressort de verrouillage et permet de libérer le pêne. Exemple de panneton avec ses garnitures et schématisation du mouvement.
tige forée
rouet
pertuis
râteau ou dents
bouterolle
broche
Commerce : le témoignage de la céramique
L’étude de la céramique d’époque romaine, mise au jour en grande quantité dans les fouilles, donne de multiples informations, d’abord chronologiques (c’est souvent elle qui apporte les indices les plus précis), mais aussi sur les habitudes alimentaires, le statut social des détenteurs, parfois la nature même de l’occupation et enfin, le commerce.
Les ateliers viromanduesUn four de potier a été récemment fouillé à Saint-Quentin, Parc des Autoroutes, tandis que d’autres ont été observés anciennement à Vermand et au nord de Saint-Quentin. La diffusion de ces productions du nord-est du Vermandois se limite au nord de la cité. Le rayonnement des ateliers du Noyonnais est beaucoup plus large : non seulementla cité, mais aussi l’ouest du département de la Somme, une partie de l’Oise et le sud-est de l’Angleterre, où les vases estampillés du potier Quintus Valérius Véranius sont pléthoriques. Un autre centre de production important a été partiellement fouillé à la frontière sud-est de la cité, autour de Beuvraignes, au sud de Roye.
Le commerce régional La vaisselle de table comprend aussi des plats, gobelets à boire et coupes provenant de la Champagne, du centre de la Gaule et d’ateliers septentrionaux. La vaisselle de cuisine est dominée par les céramiques produites à Saint-Quentin et aux alentours. Au niveau de la céramique à feu, la région d’Arras est bien représentée, ainsi que les plats à cuire à « vernis rouge pompéien » du Cambrésis et les pots à engobe micacé de Bourgogne (Morvan). En ce qui concerne la céramique dévolue au stockage et à la préparation, les provenances extérieures sont diversifiées mais révèlent des liens privilégiés avec la cité voisine des Nerviens (ateliers du Cambrésis et de Bavay-Famars).
Carte montrant la provenance de certains aliments et des céramiquesd’origines lointaines. Entre la fin du Ier siècle avant notre ère
et les deux premières décennies du Ier siècle, la sigillée provient d’Italie ou de Lyon. Ces ateliers sont successivement supplantés par La Graufesenque,
près de Millau, puis Lezoux (Puy-de-Dôme) au IIe siècle et enfin l’Argonne (à la frontière entre Champagne et Lorraine) au IIIe et IVe siècle.
Carte des principales sources d’approvisionnement céramique du Saint-Quentinois par les ateliers du Nord de la Gaule.
Rome
Athènes
Lyon
Trèves
Carthage
AlexandrieJérusalem
Antioche
Byzance/Constantinople
LondresCologne
Aquilée
Thessalonique
Milan
Syracuse
Leptis Magna
Ephèse
Tarragone
Marseille
Pont - Euxin
M e r M é d i t e r r a n é e
Océan
Atlantique
Pise
Arezzo
Campanie
La Graufesenque
Lezoux
Argonne
Bétique
Tarraconaise
Rhodes
Tripolitaine
Champagne
Aude
Morvan
Centre
Cambrésis
1000 km0
Vin
Huile d’olive
Salaisons, sauces de poisson
Fruits
Autre huile
Céram. sigillée
Céram. à parois �nes
Céram. à vernis rouge
Céram. métallescente
Autres céramiques
Saint-Quentin
Somme
Sambr e
Aisne
Escaut
Oise
Oise
Seine
Atrébates
Morins
Ménapes
Ambiens
Bellovaques
Nerviens
Véliocasses
Suessions
Rèmes
Saint-Quentin
500 100km
Production du Beauvaisiscéramiques de table et culinaires
Production de Beuvraignescéramiques de table et culinaires
Production d’Arrascéramiques culinaires
Production du Cambrésis céramiques de table, plats à fouret amphores
Production du Noyonnais céramiques de table, préparation,stockage et amphores
Production du Soissonnais céramiques culinaires et de stockage
Productions champenoisescéramiques de table
Ambiens
Limite supposée de civitas
Nom de peuple
Les importations lointainesLes amphores constituent la catégorie de céramique importée emblématique, en raison des échanges à grande distance dont elles témoignent, avec l’Italie, l’Espagne, l’Afrique du Nord, la Gaule du Sud, etc. Ce sont des contenants pour des produits alimentaires (vin, huile d’olive, garum - sauce à base de poisson très prisée - et diverses conserves). Dédiée au service de la table, la sigillée est une céramique fine de couleur rouge, avec un vernis plus ou moins brillant, soit lisse, soit décorée de motifs moulés en relief et parfois estampillée d’une marque de potier.
Saint-Quentin, Parc des Autoroutes - Four à
un volume et à deux alandiers opposés du milieu du Ier siècle.
Avec une sole de moins d’un mètre de diamètre,
sa capacité de cuisson est très faible et il est difficile
de définir le niveau de cette production : domestique
ou artisanale.
Illustration du fonctionnement du four à un volume de Saint-Quentin.© Boris Marié.
Une économie monétaire
Les monnaies gauloises Des monnaies d’or (statères et subdivisions) sont émises en Gaule intérieure à partir du IIIe siècle avant notre ère, mais elles sont rares et utilisées de façon limitée en raison de leur valeur élevée. Au IIe siècle, apparaissent des deniers d’argent, puis des monnaies en alliage cuivreux, coulées (potins) ou frappées (bronzes). Ces pièces sont imitées des monnaies grecques et romaines, mais chaque peuple les personnalise. Elles constituent un remarquable témoignage sur l’art celtique. L’introduction des deniers, potins et bronzes témoigne d’une monétarisation des échanges, encore limitée, mais réelle. Après la conquête romaine, l’émission de monnaies de bronze se poursuit jusqu’à la fin du Ier siècle avant notre ère, avec une ampleur inconnue jusqu’alors. Elles circulent jusqu’au milieu du Ier siècle.
Par rapport aux périodes antérieures et postérieures, l’époque romaine est caractérisée par un emploi généralisé de la monnaie. Elle est utilisée pour les échanges quotidiens,y compris les plus modestes.
Les monnaies impérialesL’exploit accompli par Rome est d’avoir imposé sa monnaie dans l’ensemble de son vaste Empire, grâce à l’émission d’espèces identiques au niveau du poids et des alliages. Elles avaient ainsi une valeur libératoire universelle qui inspirait confiance aux utilisateurs. 1 aureus (or) valait 25 deniers (denarius, argent) ou 100 sesterces (sestertius, en laiton), 200 dupondius, 400 as (cuivre) et 1600 quadrans (cuivre). Cependant, dès le Haut-Empire, le poids des monnaies d’or et d’argent diminue. Au IIIe siècle, la part d’argent dans les deniers est drastiquement réduite, ce qui les discrédite. Les réformes monétaires consécutives voient l’apparition de nouvelles pièces : en or, solidus (ou sous), semissis ; en argent, antoninien, puis argentus, milliarenses, silique ; en bronze, follis, nummus, etc.
L’avers des monnaies romaines représente généralement l’empereur et parfois les membres de sa famille. Sur cet as découvert à Saint-Quentin, Parc des Autoroutes, il s’agit de Constant, qui a régné entre 320 et 350, avec un diadème perlé sur la tête, le buste drapé et cuirassé. Son nom est mentionné (CONSTANS) ainsi que ses titres : DN pour dominus noster, « notre seigneur », P F AVG pour Pius Felix Augustus, « empereur pieux et heureux ». Le revers qui sert de moyen de propagande et d’information est très varié : divinités, allégories, monuments, célébration d’un événement militaire ou familial, ici le 1100e anniversaire de la fondation de Rome, comme l’indique la légende FEL.TEMP. REPARATIO, « restauration des temps heureux », soit une émission de 348. TRP révèle une frappe de l’atelier de Trèves. Au centre est représenté l’empereur debout à gauche sur un bateau dirigé par une Victoire, tenant une Victoire sur un globe et le labarum (bannière avec le chrisme).
ArtisanatDes productions domestiques
et artisanales
La fabrication du textileD’une manière générale, les Gallo-Romains filaient et tissaient à la campagne comme à la ville. La production de tissus - à partir de la laine et probablement le lin et le chanvre - sont attestées en milieu rural par la découverte d’ustensiles similaires à ceux de la période gauloise. En revanche, les aiguilles et bagues à coudre associées à l’étape finale, la couture, n’ont été découvertes qu’en contexte urbain.
Il est difficile de faire la part des objets manufacturés par un artisan spécialisé de ceux produits dans le cadre domestique. Les paysans gallo-romains tendaient vers l’autarcie en limitant les achats et le recours aux artisans. Leur autonomienécessitait une polyvalence des savoir-faire, des installations spécifiques (forge…) et un outillage adapté (menuisier, charpentier, maçon…). En outre, des activités artisanales pouvaient compléter les revenus tirés de l’agriculture. Néanmoins, certaines productions et transformations relevaient d’établissements ruraux spécialisés ou d’artisans exerçant dans les bourgs et les villes.
Le travail du fer : du minerai à l’objetLe fer est le produit d’une réduction des oxydes de fer contenus dans le minerai par le monoxyde de carbone libéré lors de la combustion du charbon de bois. Cette opération s’opère dans un bas fourneau dès 1000 degrés. Elle fournit un produit brut appelé « éponge de fer », mélange de métal et de déchets qui doit être raffiné, par martelage à chaud pour obtenir une loupe de fer exploitable. Chaque étape produit des rejets spécifiques : scories internes et coulées externes, scorie en calotte, battitures, billes…
Généralement, les deux activités de réduction et de raffinage coexistent sur un même site, mais les découvertes archéologiques sont parfois partielles : à Etreillers, seules les étapes du raffinage et de l’élaboration d’objets sont attestées par la présence de déchets métallurgiques spécifiques et par différents foyers. Au contraire, à Urvillers, des scories internes de fond de four et des scories externes coulées témoignent d’une activité de réduction. À côté de ces sites métallurgiques spécialisés, les établissements agricoles, notamment les villae,possédaient une forge pour l’entretien des outils de fer, les travaux de charronnerie et peut-être de maréchalerie, ainsi que la fabrication d’objets simples (clous, huisseries…).
Apport d'air par une tuyère
Gueulard
Charbon de boisMinerai de fer
1200° C
300° C
Scories internes
Scories couléesexternes
Coagulation du fer métalà l'état solide =formation de l'éponge de fer
Coupe schématique d’un bas fourneau de réduction de fer.
Transformation, préparation et consommation des aliments
L’alimentation des Gallo-Romains est mal documentée. Si les vestiges archéologiques nous renseignent partiellement sur leur régime alimentaire - céréales, légumineuses, légumes, fruits, laitages, espèces animales (viande, poisson, fruits de mer) - ils donnent peu d’informations sur les modes de préparation et encore moins sur l’importance respective de ces différents aliments.
La boulangerieLa farine est obtenue par le broyage des grains entre deux meules en pierre emboîtées, dont l’une est fixe (la meta) et l’autre mobile (le catillus), formant un moulin. Les meules de petite taille, abondantes sur les sites ruraux et urbains, témoignent d’une transformation domestique répondant à des besoins ponctuels. Les boulangers étaient implantés en milieu urbain. Cependant, de grands fours à pain ont été mis au jour dans les villae de Saint-Quentin et de Neuville-Saint-Amand. Leur taille imposante (sole d’environ 1,50 m de diamètre) indique une capacité de production dépassant les besoins domestiques. Ces exemples et d’autres de la Picardie, suggèrent que les villae, en particulier au Bas-Empire, produisaient du pain destiné à la commercialisation.
Coupe schématique d’un moulin à bras gallo-romain à usage domestique. Le moulin gaulois connaît un perfectionnement technique par l’ajout d’une anille, pièce métallique qui permet de régler l’écartement des meules.
La boucherieL’étude des ossements animaux (ostéologie) met en évidence que l’abattage et le débitage du porc et des caprinés sont domestiques, tandis que celui des bovidés est réalisé essentiellement en milieu urbain, par un boucher qui maîtrise un savoir-faire importé de Rome. La découverte d’une activité de boucherie dans la villa du Parc des Autoroutes, soulève dès lors des questions. À Saint-Quentin, boulevard Victor-Hugo, l’examen des ossements composant un vaste dépotoir de boucherie utilisé durant plus de deux siècles nous renseigne sur diverses pratiques. Outre la découpe de la viande, attestée par des traces de couteau et de scie, des prélèvements ont été opérés par des artisans : les cornetiers (corne), tabletiers (os), tanneurs et pelletiers (peau). Des os concassés et bouillis attestent aussi l’extraction du collagène, base de fabrication de la colle.
Sole du four à pain de la villa de Neuville-Saint-Amand. Le dôme de la chambre de cuisson, construite à l’aide de fragments de tuiles recouverts d’argile, a été entièrement détruit après l’abandon de l’établissement.© Sébastien Ziegler, Conseil Général de l’Aisne.
Saint-Quentin, villa du Parc des Autoroutes - Détail d’une côte de bœuf portant des traces de désossage caractéristique d’un travail de boucher.
Saint-Quentin, villa du Parc des Autoroutes - Ce couperet
de boucher sert au désossage et à la découpe d’animaux.
Saint-Quentin, boulevard Victor-Hugo - Omoplate de bœuf perforée par le crochet de suspension du boucher.
Coupe schématique d’un moulin pompéien à usage artisanal.
Ce type de moulin, rare en Gaule, était mû par un homme
ou un équidé (âne ou mulet).
La vaisselle gallo-romaineLes céréales étaient conservées dans de grands vases (dolium) et d’autres denrées, dans des récipients céramiques plus petits. Les amphores montrent la variété des approvisionnements en vin, huile, conserves de poissons et sauce tirée de la macération d’entrailles de poissons (garum), de même que des origines géographiques les plus éloignées (Italie, Espagne, Afrique). Elles témoignent d’une culture culinaire raffinée et d’une variété des ustensiles culinaires : casseroles, marmites, bouilloires, poêlons, plats à cuire, cuillères, couteaux, pelles à feu, etc. Les mortiers servant au broyage des aliments correspondent à l’introduction de recettes méditerranéennes. Ce raffinement est encore démontré par la variété du service de table constitué d’assiettes, plats et bols, coupelles à sauce, gobelets à boire, cruches, bouteilles, couteaux et cuillères. Les fouilles n’en donnent qu’une vision partielle. En effet, le verre, très fragile, ne nous parvient que très rarement ou en fragments, tandis que la vaisselle de bronze et d’étain a été largement récupérée en raison de sa valeur (et a fortiori celle d’argent, réservée aux élites). En revanche, les vases en céramique ont été rejetés en abondance et constituent notre principale source d’information.
Saint-Quentin, Parc des Autoroutes - Passoire en bronze, dont la tôle percée a disparu, qui servait à filtrer le vin parfumé aux épices.
Axe de rotation
Bras de rotation
1 - Meule dormante : la meta
2 - Meule tournante : le catillus3 - Grains de blé
4 - Farine5 - L'anille
2
14
3
5
0 25 cm
0
1
2 m
0
1
2 m
Axe de rotation
Bras de rotation
1 - Meule dormante : la meta2 - Meule tournante : le catillus3 - Grains de blé4 - Farine
1
22
4
3
et pelletiers (peau). Des os concassés et bouillis attestent aussi l’extraction du collagène, base de fabrication de la colle.
Victor-Hugo - Omoplate Victor-Hugo - Omoplate de bœuf perforée par le de bœuf perforée par le crochet crochet de suspension du de suspension du boucher.boucher.
La vaisselle gallo-romaineLa vaisselle gallo-romaine
L’étude des ossements animaux (ostéologie) met en évidence que l’abattage et le débitage du porc et des caprinés sont domestiques, tandis que celui des bovidés est réalisé essentiellement en milieu urbain, par un boucher qui maîtrise un savoir-faire importé de Rome. La découverte d’une activité de boucherie
du Parc des Autoroutes, soulève dès lors des questions. À Saint-Quentin, boulevard Victor-
après l’abandon de l’établissement.après l’abandon de l’établissement.© Sébastien Ziegler, Conseil Général de l’Aisne.© Sébastien Ziegler, Conseil Général de l’Aisne.
villavilla du Parc du Parc des Autoroutes - Ce couperet des Autoroutes - Ce couperet
de boucher sert au désossage de boucher sert au désossage et à la découpe d’animaux.et à la découpe d’animaux.
Les bijouxLa coquetterie des Gallo-Romaines était satisfaite par la production en masse de bracelets, bagues, boucles d’oreilles et autres colliers dans des matériaux variés tels l’or, l’argent, les alliages cuivreux, le verre, le lignite, le jais, les pierres dures et précieuses… Ces bijoux nous livrent de nombreux indices sur les sites fouillés, leur chronologie, le niveau de vie des occupants, les influences et échanges culturels et mêmela religion.
Les fibulesLa fibule, sur le même principe que nos épingles de sûreté, était utilisée pour attacher les vêtements tant par les hommes que par les femmes. Accessoire indispensable du costume, elle est le bijou le plus communément retrouvé lors des fouilles saint-quentinoises. Elle revêt des formes variées allant de la simple agrafe à la broche richement décorée.
Éléments de ceintureLe cingulum, de même usage que notre ceinture, est couramment porté à la taille. Si le cuir ou le tissu qui a servi à le fabriquer n’est pas retrouvé, son usage est révélé par la découverte de ses garnitures en métal : boucles, appliques et ferrets…
Les bijouxet accessoires vestimentaires
Prendre soin de soi
Les bainsLes citadins pouvaient passer de longues heures aux thermes, où ils transpiraient d’abord dans l’étuve, puis prenaient des bains chaud, tiède et froid. On pouvait s’y faire masser, s’adonner au sport dans la palestre, s’y promener ou discuter avec ses amis. C’était un lieu de convivialité privilégié. Les habitants des campagnes n’étaient pas en reste, car nombre de villae possédaient des bains privés.
La toiletteLes riches Romains avaient des esclaves qui se consacraient uniquement à la beauté de leurs maitres (ornatrix). Les femmes accordaient une grande importance à leur chevelure qui pouvait être frisée et teinte, pour réaliser des coiffures d’une grande complexité imitant celles des impératrices, maintenues par de petites épingles en os, bronze ou argent. D’autres objets découverts lors des fouilles, se rapportent à la toilette : peigne en os, miroir, palette destinée à préparer les fards, ustensile permettant de prélever, de broyer et d’appliquer les cosmétiques et vases servant à contenir ces onguents.
La villa du Parc des Autoroutes à Saint-Quentin a livré un strigile en fer (non restaurable), utilisé pour racler la sueur lors du bain, ou l’huile dont les sportifs s’enduisaient le corps lors de leurs exercices (début IIIe s., L. 163 mm).
Les croyances
Les sanctuaires Toute ville antique possédait de nombreux temples mais aucun n’est connu à Augusta. L’inscription relative au culte impérial et au dieu Vulcain découverte en remploi dans les fondations de la Basilique a suscité l’hypothèse que l’église succédait à un temple. C’est peu crédible. En revanche, à Vermand, les prospections aériennes ont mis en évidence sur le plateau voisin de Marteville, un quartier rassemblant plusieurs temples de plan gallo-romain (baptisé fanum par les archéologues).
D’une manière générale, les Romains polythéistes ne sont pas intervenus dans le domaine religieux et les Gallo-Romains sont restés attachés aux croyances ancestrales. Cependant, les dieux celtiques ont largement été assimilés aux divinités romaines.
Cultes et dévotions privéesLes croyances des Viromandues sont donc principalement illustrées par des représentations de divinités. Les figurines en terre cuite, vendues bon marché et très répandues, relèvent clairement des cultes domestiques. Pour beaucoup d’objets utilitaires (manches de couteaux et de clefs), de bijoux (gravures sur les pierres ou verroteries dites intailles qui ornent les bagues), décors de coffret et même pour la petite statuaire en bronze, ces représentations religieuses, très prisées, sont plutôt décoratives.
Vermand, La Pâture des Noyers : le redressement des nombreuses vues aériennes permet de restituer le plan de ce vaste ensemble cultuel organisé autour de nombreux temples, majoritairement des fana. Ces temples ont un plan centré à double carré (rarement circulaire ou polygonal) spécifique, qui se rencontre seulement dans les pays occupés par les Celtes. Cette disposition correspond à une cella centrale, fort haute, renfermant l’image de la divinité honorée, entourée par une galerie périphérique, où déambulaient les fidèles (cf. la restitution en bas, à droite). Ils s’inscrivent dans un enclos sacré ou péribole.
241400
241200
677200
677400
Rue ?
Rue ?
Rue ?
Rue ?
Rue ?
Temple
Temple
Temple
Temple ?
Grand temple
Temple ?
TempleTemple ?
Temple ?
chapelle ?
Rue ?
Rue ?
Vers Saint-Quentin
2010 100 m
5m
Les Gallo-Romainsface à la mort
La crémation est la pratique dominante jusqu’au milieu du IIIe siècle. Elle est ensuite remplacée par l’inhumation. Des objets sont déposés dans la tombe : éléments liés à l’habillementet la parure, accessoires de toilette et personnels, monnaie, lampes et vaisselle en rapport avec un dépôt d’aliments solides et liquides. Ils témoignent d’une croyance en une forme de survie après la mort. Certains attestent une assimilation précoce des rites et concepts romains, telle la monnaie (obole à Charon ou naulum) qui permet de payer la traversée du fleuvedes Enfers, le Styx.
Une riche sépulture à UrvillersElle a été découverte au bord de la voie de Saint-Quentin à Soissons, un type d’emplacement recherchéà l’époque romaine : en ville, les nécropoles se développaient le long des routes, à la sortie des agglomérations et dans les campagnes, des tombeaux isolés, matérialisés par des monuments, jalonnaient les voies. À Urvillers, la superstructure de la tombe a disparu, mais son riche mobilier de la fin du IIe siècle, en partie contenu dans deuxcoffres et comprenant un très rare gobelet en verre noir, indique un statut social élevé du défunt.
Après la crémation du défunt, les restes osseux ont été recueillis dans les cendres du bûcher, puis placés, avec une monnaie (obole à Charon), dans ce gobelet en verre noir faisant office d’urne cinéraire, déposé à l’intérieur du plus grand coffre.
Un cimetière du milieu du IVe siècle à Saint-Quentin
Les neuf inhumations mises au jour sur le Parc des Autoroutes, constituent un espace funéraire ouvert et sans organisation particulière. Les tombes sont axées NO-SE. Les défunts sont inhumés dans un cercueil, sur le dos, habillés et parfois parés de bijoux (collier à lunule et bracelet en argent). Peu abondants, les dépôts funéraires sont concentrés dans deux grands caveaux. L’étude anthropologique a permis de recenser sept adultes, dont au moins deux femmes, un adolescent et un très jeune enfant.
Vue de la sépulture en cours de fouille : les éléments métalliques des deux
coffres en bois aujourd’hui disparus et dont la forme a été déterminée grâce
à un relevé en trois dimensions, sont désignés par les lettres, les céramiques et verreries,
par les chiffres.
Mobiliers funéraires - Déposée à l’extérieur du cercueil, une cruche en étain, objet d’une certaine valeur, relève du service des liquides ou des ablutions (dans ce cas, elles pourraient être rituelles, cette pratique étant connue dans le cadre des funérailles romaines).
L’association, à l’écart du groupe, des sépultures d’une adulte et d’un jeune enfant, suggère une filiation. Au centre de la grande fosse funéraire profonde de 1,60 m, des lignes noires, seules traces visibles des planches en bois disparues, ainsi que des clous en fer, matérialisent le cercueil.
Les trois verreries (2, 6, 7) sont trop dégradées pour
une identification. La cruche en céramique blanche (5) et le gobelet (4) relèvent
du service des liquides ; l’assiette en sigillée (8) et la marmite en terre grise (1) sont liées
aux aliments solides.
La défunte était placée sur le dos ; la position des bracelets et de la monnaie indiquent que les avant-bras étaient croisés sur le bassin, la monnaie étant placée dans la main. L’assiette contenait des vestiges de semelles cloutées.
Les restes du bûcher funérairecomposés d’esquilles osseuses humaines mêlées aux charbons de bois ont été déposés dans une petite fosse ovale et, dans la majorité des cas,
une céramique a été placée dessus. Le tout a été scellé par les ossements de chevaux.
Dépôts funéraires singuliersDes dépôts du IIIe siècle associant une incinération humaine et une inhumation de cheval, ont été effectués à plus de 2 m de profondeur, dans de grandes fosses abandonnées. Ces associations homme/cheval, parfois multiples en un endroit, sont observées dans trois espaces différents. Cette répétition révèle un rituel funéraire précis, jusqu’à présent inconnu dans le Nord de la Gaule.
Trois incinérations ont été en partie perturbées par une inhumation multiple contemporaine. Le statut et les conditions du décès des trois
individus inhumés simultanément, sans mobilier funéraire, dans une fosse trop exiguë, posent question.
Auberonnière
Avant Arrière
0 50 cm
Monnaie
Agrafe
Plaque de serrureet ses clous(M sur la photo)
Second Coffre
Coffreprincipal
Monnaie
0 5 cm
Disposition des différents mobiliers funéraires
Contours pressentis des coffrets
Éléments en fer des coffretsÉlements en bronze
VerrerieCéramique
NN
J
Au IIIe siècle, les difficultés militaires et économiques affaiblissent les empereurs et les usurpations se multiplient. L’armée romaine engagée dans des luttes fratricides ne parvient plus à contenir les Germains qui ravagent la Gaule à plusieurs reprises. La crise économique entraîne aussi des révoltes sociales et un brigandage endémique se développe, les bagaudes. À la fin du siècle, l’ordre est rétabli, mais la Gaule septentrionale ne retrouve pas la prospérité antérieure. Dans cette tourmente, Augusta a été désertée au profit de Vermand qui redevient la capitale locale.
À la fin de l’AntiquitéVermand - Viromandis
redevient le chef-lieu
l’ordre est rétabli, mais la Gaule septentrionale ne retrouve pas la prospérité antérieure. Dans cette
Le chef-lieu est transféré à VermandLa cave fouillée place de l’Hôtel de Ville était comblée de débris d’incendie et les moellons de craie de ses parois étaient rougis par le feu. Le quartier a ensuite été déserté, comme celui de la rue Voltaire, lui aussi détruit par un incendie.
À la fin du IIe siècle, l’économie des villes de la Gaule décline et elles se dépeuplent. Les disettes, dues à une péjoration climatique qui réduit les récoltes, favorisent les pestes qui déciment la population. À partir du milieu du IIIe siècle, les razzias des Germains accentuent les difficultés.La surface des villes se rétracte considérablement, mais à Saint-Quentin, cette régression a une ampleur exceptionnelle. Le nom de Vermand vientde Viromandis et signifie « chez les Viromandui ». À la fin de l’Antiquité,la majorité des chefs-lieux de la Gaule ont adopté un nom formé sur celuidu peuple dont ils étaient la capitale. Ce nom suggère que Vermand était le chef-lieu à cette époque. L’archéologie le confirme : les traces du IVe siècle y abondent, notamment des centaines de tombes fouillées au XIXe siècle.
Une place-forte défendue par des GermainsÀ partir du milieu du IVe siècle, des bandes entières de Germains sont incorporées comme auxiliaires disséminés dans les campagnes dans le cadre d’une mise en défense en profondeur du Nord de la Gaule. Leur présence est révélée par de riches dépôts funéraires, alors que les Gallo-Romains tendent à les abandonner. La Picardie et le Saint-Quentinois en particulier, ont livré un grand nombre de ces tombes. Elles abondent à Vermand ce qui montre le rôle stratégique de cette ville dans le dispositif de défense régional. Il est encore confirmé par le « tombeau du chef militaire », qui a accueilli la dépouille d’un officier de très haut rang.
La sépulture d’un officier germanique de très haut rang décédé vers 400 a été découverte en 1885 dans le cimetière des Remparts de Vermand. Ce « tombeau du chef militaire » avait été pillé et le sarcophage construit en grands blocs de remploi, ne contenait plus que trois boucles (1, 2 et 3) et les restes d’une épée (4) et d’un poignard. Dans le vaste caveau, furent découverts une hache (5), dix javelots ou flèches (6), un bouclier et une lance de parade. Le bouclier rond était bien conservé, puisque les éléments en matière organique (bois et osier, revêtu de cuir) ont pu être observés. Son umbo (protubérance centrale : 7) et le manipule (poignée interne : 8) étaient en fer plaqué d’argent. La forme particulière du fer de lance (9), et les deux crochets à sa base,sont caractéristiques des lances de parade, interprétées comme des symboles de commandement.Elle était décorée d’une virole (10) et de deux appliques en argent doré (11, 12), en taille biseautée et niellés, comme les boucles, qui sont parmi les plus beaux exemples de cette production de luxe. (1 à 4 et 10 à 12 sont grandeur nature, le reste est au quart).Dessins - colorisés - des objets : J. Pilloy.
La christianisation : genèse du cultede saint QuentinEn Gaule, le christianisme est resté marginal jusqu’à son adoption par les empereurs au début du IVe siècle. Son succès a été grandissant, mais limité : l’archéologie révèle une bonne fréquentation des temples païens ruraux au moins jusqu’au début du Ve siècle, malgré l’interdiction du paganisme en 392. Néanmoins, une part importante de la population s’est convertie. C’est dans ce contexte que se développe le culte de saint Quentin, qui aurait été martyrisé à Augusta à la fin du IIIe siècle. La véracité de cet événement n’est pas établie, car les clercs du haut Moyen Âge ont fait preuve d’une grande inventivité. Cependant, les fouilles archéologiques récentes dans la Basilique de Saint-Quentin ont établi qu’une tombe installée vers le milieu du IVe siècle dans un petit bâtiment (ce qui souligne l’importance du défunt), était, au plus tard dès le Ve siècle, un lieu de dévotion chrétienne.
Les tombes de la seconde moitiédu IVe siècle, à Vermand en
particulier, ont livré des objets aux décors chrétiens.
Cependant, la foi chrétiennede leur détenteur n’est pascertaine. Sur cette coupe en verre gravé (diam. 190 mm, échelle 1), qui appartient à une production de luxe dont
ne subsistent que de rares exemples, est représentée
la résurrection de Lazare.Dessin -colorisé - : J. Pilloy.
1 2
3
4
5 6
7
11
8
10
9
12
Les Francs participent au dépeçage de la Gaule romaine et s’y taillent plusieurs petits royaumes. L’un de ces rois, Clovis soutenu par les Gallo-Romains après sa conversion au catholicisme, s’empare progressivement d’une grande partie de la Gaule, qui prend le nom de « royaume des Francs ». Les vallées de l’Aisne et de l’Oise sont appréciées par les souverains mérovingiens (VIe- milieu VIIIe siècle) qui y possèdent de nombreux domaines et palais. Sous les Carolingiens(milieu VIIIe- fin du Xe siècle), la reconquête des terres abandonnées à la fin de l’Antiquité s’intensifie, témoignant d’une probable expansion démographique.
Le hautMoyen Âge
Une nouvelle sociétéDès la fin du Ve siècle, les changements vestimentaires et l’évolution des rites funéraires révèlent la fusion culturelle entre Germains et Gallo-Romains. Aux alentours de Saint-Quentin, les fouilles de cimetières mérovingiens ont été nombreuses au XIXe siècle, mais elles sont rares depuis. Jusqu’à la fin du VIIe siècle, les défunts sont inhumés revêtus de leurs plus beaux habits, d’où la découverte de boucles de ceinturons et bijoux. Des objets personnels sont aussi déposés, notamment des armes pour les hommes, afin d’affirmer leur statut de guerriers.
Carte des pagus veromandensis et
noviomensis. La répartition des
cimetières révèle une préférence pour
les vallées arrosées par les cours d’eau.
Le déplacement du siège épiscopal
du Vermandois à Noyon est
certainement lié à la proximité
de Soissons, l’une des capitales du
royaume lors des partages successoraux
mérovingiens.
Le cimetière de Caulaincourt, utilisé de la fin du Ve à la fin du VIIe siècle, a été fouillé au XIXe siècle. En 1996, la construction d’un gazoduc a permis d’examiner 153 tombes, dont 22 intactes. Les sépultures violées renfermaient encore les squelettes et une partie des dépôts : les anciens fouilleurs, seulement intéressés par les bijoux, ne dégageaient que la partie supérieure des corps. Le mobilier retrouvé atteste une population aisée. Les fosses, creusées dans la craie, étaient réparties en rangées ordonnées. Le corps est déposé, toujours sur le dos, soit en pleine terre, soit dans un cercueil ou un coffrage construit et quelques-uns en sarcophage.
Un habitat méconnuLa période est caractérisée par une rupture radicale dans l’occupation du sol.La quasi-totalité des habitats gallo-romains est désertée. Après des millénaires d’habitat dispersé s’amorce un phénomène de regroupement en hameaux groupant plusieurs fermes. Une deuxième rupture est observée au niveau de la localisation de cet habitat : les plateaux sont largement désertés au profit des vallées, en particulier celles arrosées par un cours d’eau. Enfin, les changements architecturaux constituent une troisième rupture significative. L’architecture sur poteau planté redevient systématique, de même que l’emploi de matériaux périssables pour les élévations (torchis) et les couvertures (chaume, etc.). Les plans des constructions, marqués par une nette influence germanique, diffèrent aussi radicalement de ceux qui étaient rencontrés antérieurement. L’habitat mérovingien reste encore mobile, avec des sites occupés sur une courte durée. La concentration s’accentue sous les Carolingiens, ainsi que la stabilité, pour donner naissance au village groupé autour de son église paroissiale, typique de l’habitat du plein Moyen Âge (XIe – XIIIe siècle), qui s’est perpétué jusqu’à nos jours. Les fouilles sont encore trop peu nombreuses pour bien comprendre les étapes de ce processus fondamental.
En 2006, lors des travaux du contournement de Fresnoy-le-Grand, a été découverte une exploitation agricole mérovingienne datée entre le milieu du VIe et le milieu du VIIe siècle. Caractéristique de l’époque, ce bâtiment semi-enterré (11 m²), est couvert d’une toiture supportée par quatre poteaux corniers. Le long des parois, une cloison en torchis est ancrée dans une étroite tranchée. Des cloisons intérieures ou supports de stockage ont été identifiés. Cette cabane a pu être utilisée comme resserre, atelier, lieu de stockage ou bergerie.
À La Carrière Rouge à Vermand, en 2006, a été fouillée la frange orientale d’un habitat du Xe siècle sur 1300 m2. Le plan montre qu’il est dense, structuré et pérenne : les chevauchements de bâtiments témoignent de leur succession au même endroit. Implanté en bordure d’un marais, le bâti s’oriente parallèlement à l’Omignon, rivière située à 200 m à l’ouest. L’établissement comprend des bâtiments sur poteaux (habitation, exploitation et stockage), ainsi que des structures annexes (fosse, silo, latrines, sépulture de nourrisson…).
N
E
S
O
0 10 m
Augusta devientSaint-Quentin
Saint-Quentin au Xe siècle, localisation des éléments connus.
Augusta, un temps désertée, renaît durant le haut Moyen Âge sous le nom de Saint-Quentin. C’est bien parce que le culte de saint Quentin a joué un rôle majeur dans ce processus : l’église qui abritait ses restes est non seulement devenue la principale du secteur, mais a aussi attiré des pèlerins qui ont dynamisé l’économie locale et contribué par leurs donations à l’enrichissement du clergé desservant l’église et l’abbaye installée dans une île de la Somme. La renommée du martyr a donc créé les conditions d’un nouveau basculement du chef-lieu.
Le développement du culte de saint QuentinLes Francs qui s’installent à la fin du Ve siècle sont majoritairement païens. Suivant l’exemple de leur roi Clovis, ils se convertissent et le royaume franc est officiellement catholique. Cependant, jusqu’au VIIIe siècle,le clergé s’emploie à éradiquer les croyances païennes qui subsistent, en s’appuyant sur le culte des saints locaux. Saint Eloi, le célèbre évêque de Noyon actif dans la première moitié du VIIe siècle, a joué un rôle déterminant dans le développement du culte de saint Quentin, dont le renom s’est répandu bien au-delà du Vermandois.
Découverte au XIXe siècle, la dalle de calcaire noir a été présentée comme marquant l’emplacement de la tombe de Quentin durant l’époque mérovingienne. Les fouilles récentes ont confirmé cette interprétation.Elle recouvrait une fosse sépulcrale signalée dès le IVe siècle par un aménagement de surface et implanté au milieu d’un petit bâtiment. Les agrandissements successifs de cette chapelle funéraire, rapidement transformée en église (la Basilique de Saint-Quentin), sont désormais bien documentés pour le haut Moyen Âge.© Christian Sapin, Centre d’études médiévales.
Place de l’Hôtel de Ville à Saint-Quentin, ont été mises au jour quelques sépultures dispersées, datées du Xe siècle par le radiocarbone, car depuis le VIIIe siècle les tombes sont dépourvues de mobilier. La première est implantée dans un hypocauste antique dont le sol de béton a été percé. Pour la seconde, une simple fosse partiellement comblée a été utilisée (d’où l’inflexion du corps pour l’adapter à l’espace disponible).
La renaissance urbaineAu VIe siècle, l’église de Saint-Quentin est desservie par des prêtres et au moins depuis le VIIe siècle, par des moinesgroupés dans un monastère qui comprend plusieurs églises, dont Notre-Dame-de-Labon. Un bourg se développeautour. Au VIIIe siècle, les Carolingiens s’emparent du riche monastère, remplacent les moines par des chanoineset le confient à des proches, dont des abbés laïques qui sont comtes de Vermandois. Ils résident dans un palais situé dans le bourg désormais appelé Saint-Quentin, qui redevient la capitale locale. Fortifiée en 886, Saint-Quentin est l’une des principales places fortes des puissants et ambitieux comtes, assiégée à plusieurs reprises au Xe siècle.
La topographie de Saint-Quentin durant le haut Moyen ÂgeElle est mal connue. Le bourg né autour du monastère, ravagé par les Normands en 883, est fortifié à partir de 886 par une enceinte de 5 ha. Les chemins qui rayonnent autour reprennent plus ou moins le tracé des rues antiques. Les principaux sont la rue Emile Zolaqui aboutissait à l’une des deux portes de l’enceinte et la rue d’Isle qui menait vers l’abbaye d’Isle. Rue Voltaire, une fosse mérovingienne suggère que des habitats pouvaient exister aux alentours. Le grand cimetière mérovingien de la Croix-Saint-Claude dans le faubourg d’Isle est lié à un second pôle d’habitat, probablement implanté autour du franchissement de la vallée de la Somme et de l’abbaye d’Isle, née autour des emplacements où le corps et la tête de Quentin auraient été retrouvés, lieux importants du pèlerinage. Les comtes de Vermandois avaient un château à l’emplacement de l’abbaye Saint-Prix.
Saint-Quentinde 1080 à 1914
Du XIe au XIVe siècle, Saint-Quentin est une ville prospère. Sa position au cœur d’une riche région agricole, sur des axes de circulation importants, en fait une place commerciale dynamique, ce qui favorise l’écoulement de ses productions artisanales, notamment ses draps de laine. À partir du milieu du XIVe siècle, elle souffre des maux qui accablent la région :la famine, la peste et la guerre. Son économie s’étiole tandis qu’elle se dépeuple. À la fin du XVe siècle, sa position sur la frontière avec l’Empire espagnol accroît les difficultés.Après 1659, les conquêtes de Louis XIV éloignent le péril et la ville retrouve sa prospérité.
L’essor médiéval Du IXe au XIVe siècle, de meilleures conditions climatiques et des progrès techniques accroissent la production agricole permettant une expansion démographique. L’intensification des échanges favorise l’essor des villes, comme centres de production et de consommation. Leur population augmente rapidement à partir du XIe siècle. En outre, Saint-Quentin bénéficie de sa position sur le grand axe commercial animé par les foires de Champagne, qui relie la Flandre à l’Italie, les deux pôles économiques de l’Europe médiévale. Au cœur d’une riche région agricole, ses marchands commercialisent les blés et la pâte tinctoriale bleue tirée de la waide ou guède, vendue très cher dans toute l’Europe du Nord. Ils exportent aussi du vin en direction du nord, car la Picardie correspond à la zone la plus septentrionale de production. La foire annuelle de Saint-Quentin, sans être majeure, est importante. Ces fluxcommerciaux favorisent l’industrie textile : c’est une ville drapante qui diffuse ses draps de laine jusqu’en Italie.Les métiers du cuir y sont aussi développés.
La reconstruction gothique de la Collégiale (actuelle Basilique), qui rivalise par ses dimensions avec les plus grandes cathédrales, témoigne de l’opulence de la ville aux XIIe et XIIIe siècles.© Frédéric Pillet, Ville de Saint-Quentin.La famine, la peste et la guerre
À la fin du XIIIe siècle, une péjoration climatique réduit les récoltes et les disettes se multiplient. Entre 1348 et 1352, la peste bubonique ou « peste noire » décime une population affaiblie et frappe ensuite régulièrement. Les chevauchées anglaises de la guerre de Cent Ans ravagent les campagnes autour de Saint-Quentin. La ville est dépeuplée (de moitié ?) et ruinée : son commerce est entravé par l’insécurité, sa foire s’étiole et ses draps ne trouvent plus de débouchés. Elle doit faire face à d’énormes dépenses pour entretenir ses fortifications. Au XVe siècle, comme les autres « villes de la Somme », elle est disputée au roi de France par le duc de Bourgogne, ce qui lui est plutôt favorable. Le rétablissement de la production agricole et de la sécurité permet une reprise du commerce et de l’industrie textile qui se tourne vers la fabrication de toiles de lin et de chausses.
La waide ou guède (Isatis tinctoria, appelée pastel dans le sud de la France) est une plante cultivée le long de la Somme au Moyen Âge, dont les feuilles broyées donnent une pâte tinctoriale bleue vendue sous forme de boules (coques).
La citadelle assiégéeEntre la fin du XVe siècle et jusqu’au milieu du XVIIe siècle, Saint-Quentin se trouve sur la frontière qui sépare la France de l’empire hispano-flamand. En 1557, la cité tombe aux mains des Espagnols qui la pillent. La ville rendue à la France en 1559 est peu à peu reconstruite. Durant un siècle, les travaux de fortification sont intenses : l’enceinte médiévale est protégée par des ouvragesbastionnés remaniés à plusieurs reprises. Deux quartiers sont rasés pour leur faire place. A la fin du XVIe siècle, des marchands hollandais exilés introduisent le tissage des toiles fines de lin (linon et batiste), qui permet de renouer avec la prospérité. Au milieu du XVIIe siècle, la ville échappe aux sièges, mais subit la famine et la peste (celle de 1636 emporta 3000 habitants, sur peut-être 10 000) qui ravagent la Picardie durant la guerre de Trente Ans.
Le siège et la prise de Saint-Quentin en 1557 ont eu un grand retentissement dans l’Europe entière. Cette vue est tirée d’une vaste peinture ornant l’une des salles du palais de Saint-Laurent-de-l’Escurialbâti par le roi d’EspagnePhilippe II, en commémoration de sa victoire sur les troupes d’Henri II, roi de France, le 10 août (jour de la Saint Laurent) 1557 à Saint-Quentin.© Luc Couvé, Ville de Saint-Quentin.
La prospérité retrouvéeAprès 1659, les conquêtes de Louis XIV éloignent la frontière et Saint-Quentin n’est plus exposée. Au XVIIIe siècle, ses fines toiles de lin sont exportées dans toute l’Europe et aux Amériques. Néanmoins, la plus grande partie de ces toiles étant fabriquées dans les campagnes environnantes, la population urbaine reste modeste, 10 000 habitants sous la Révolution. Au XIXe siècle, le développement des machines à vapeur entraîne une concentration de l’industrie et un afflux considérable d’ouvriers. La population augmente alors très vite, pour atteindre 50 000 habitants en 1914. La ville s’étend très largement hors des fortifications arasées dans les années 1810-1825.
Vue générale de la ville de St-Quentin, dessin de Tavernier de Jonquières. Voyage pittoresque de la France de de Laborde, t. VI, Picardie, paru en 1787. La ville depuis le faubourg Saint-Martin. © Bibliothèque Nationale de France.
Le cadre urbain
Bef
PP
P
P
P
P
P P
PP
P
P
ArGS
PR
Ta
Collège
Mo
H1
H2
H5B4
B3
H3
Ho2
Ho3
Ho4
B1B5H6
H4
H7
Ho1
B2
MP
F1
Source duGronnard
F2
F3F4
F5
P1
P2
P3
T25
P4
P6
P5
T24
T23
T26T27
T28T29T30
T31T32
T33T34
T35T36
T37
T38
T39
T40T41
T42
T43
Pt1
T44
T45
T46
Pt2
T22 T21 T20 T19T18
T17 T16T15
T14T13
T12
T11
T10
T9
T8
T7
T6
T5
T4
T3
T2
T1T47
T48
T49
P7
T50
Sur le Biez Petit Pont
Pêcherie
Vivier du Grand Pont
Grand Pont
Canal
d’Angoulemortier
Faubourg du Vieux-Marché
Pontoile
Gardin de le ville (jardin
de la ville)
Vieux-MarchéVieux-Marché
Entre deux ponts
Marais St-Prix
Marais de la Capelle
Noirmont
Ilots de St-Prix
Ile du Biez
Canal du Biez
Vallée du Roi
Vieux-Marché
Toucquet
Belle Porteou St-Jean
BoulangeriePontoile
Sellerie
Coppekat ouCoppecaire
Beauvoir puisCoppecaire
Castel
Ste-Pécinne
Tannerie ?
Fontaine ou Ste Catherine
Rue Neuve Gréance
Ronde Chapelle
Rue d’IsleRue d’Isle
PR : PrisonMo : MonnaieGS : Grenier à selAr : Artillerie
hôpitauxH1 : Grand HôpitalH2 : ND GréanceH3 : de BuridanH4 : St-NicolasH5 : de Lambais H6 : Charité des P. H7 : Petit Pont
hôtelleriesHo 1 : des En�ésHo 2 : St-AntoineHo 3 : St-JacquesHo 4 : Belle Porte
MP: Maison de la PaixTa : Tour aux archivesBef : Beffroi
la commune
le roi
enceinte
soins, charitéet accueil
béguinage
B1 : de FonsommeB2 : des GrènetiersB3 : des SuzannesB4 : des EsquehériesB5 : d’Etreillers
source dite «fontaine»
F1 : au murF2 : Chapelle rondeF3 : des TurgeonsF4 : ferréeF5 : de l'Ermitage
enseigneGréance
EnceintePortesP1 : Remicourt P2 : Belle PorteP3 : Vieux MarchéP4 : PontoillesP5 : MayeureP6 : d'IsleP7 : Petit PontPoternesPt 1: Ste CatherinePt 2: Petit Pont ToursT1 : à l’EauT3 : de l’AtreT6 : de Ste PécinneT10 : de la MonnaieT12 : RougeT13 : des CouturesT17 : Dame HeuseT23 : Delle de HamT34 : de ConstanceT47 : Tour-Y-ValT48 : MayeureT50 : Mortier
four public
puits public
300m0
Au fur et à mesure de l’afflux de population, la surface de la ville s’est étendue, jusqu’à recouvrir l’assiette de la ville gallo-romaine et à la dépasser largement (110 hectares contre 40 ou 50). L’extension maximale de l’habitat est atteinte lorsque la population culmine au début du XIVe siècle. Le plan de la ville est alors, pour l’essentiel, figé jusqu’au XIXe siècle, en dehors des secteurs affectés par les travaux de fortification, qui ont réduit la surface d’habitat.
L’évolution de la ville À partir du XIe siècle, la croissance de la population se traduit par une extension de l’habitat qui s’accélère aux XIIe et XIIIe siècles. Les interventions archéologiques ne permettent pas encore d’en retracer la progression. Les fondations d’églises paroissiales qui l’accompagnent, fournissent quelques indices : d’environ 5 au XIIe siècle, elles passent à 14 en 1214, puis 15 au milieu du XIIIe siècle. Au XIIe siècle, commence la construction d’une enceinte qui englobe l’essentiel de l’aire urbaine, soit environ 110 hectares, une surface considérable. En outre, il faut y ajouter des faubourgs d’étendue indéterminée. Il y a peu d’éléments pour évaluer la population, mais elle dépasse probablement 12 000 habitants au XIIIe siècle, ce qui correspond à une ville importante. À partir du milieu du XIVe siècle, la diminution de la population s’est traduite par une régression de la surface bâtie. Au milieu de ce siècle, le sud de la ville a été retranché et au XVIIe siècle, deux quartiers ont été rasés.
Au XIIe siècle, l’enceinte s’interrompt au niveau de la Somme et de la vallée à l’ouest. Au XIVe siècle, les périls encourus dans le contexte de la guerre de Cent Ans, conduisent à la fermer le long du grand canal. Le quartier retranché, précédemment appelé « basse ville » prend alors le nom de faubourg d’Isle.
Rues et îlotsLe tracé des nouvelles voies a été certainement en partie influencé par les rues antiques, encore visibles. Cependant, elles ne semblent pas être superposées et leur disposition n’est pas aussi régulière qu’à l’époque romaine. Avant le XIIIe siècle, seules les rues principales sont pavées. L’entretien des voiries n’est pas réalisé ; les déchets s’y accumulent et les porcs errants y trouvent leur pitance. La Grand Place est assainie par des remblais de craie et silex. L’approvisionnement en eau est assuré par des puits collectifs. La densité de l’habitat varie d’un quartier à l’autre : très resserré au cœur de la ville et le long des rues principales, il est plus lâche à sa périphérie et intègre des espaces de jardin. Les zones humides sont en partie occupées par des jardins maraîchers et des prairies.
Les maisonsAu Moyen Âge, les habitations sont majoritairement construites en pan de bois hourdi de torchis, avec un toit de chaume. Elles possèdent presque toutes une cave ouverte vers la rue, aux murs revêtus de blocs de craie ou calcaire plus ou moins rectangulaires et liés à l’argile ou au mortier. Seuls les seigneurs, les établissements religieux et les plus riches bourgeois ont les moyens de faire construire des bâtiments en dur, où les soubassements sont souvent réalisés en grès et les élévations en calcaire, dotées de belles caves de style gothique. À partir du XVIIe siècle, les constructions en matériaux périssables sont progressivement remplacées par des maisons de brique et de pierre avec toit en ardoises ou en tuiles vernissées.
Vue de maisons à pan de bois dans la rue Croix-Belle-Porte et de la Monnaie (actuelle rue du Gouvernement), au niveau du carrefour avec la rue Belle-Porte ou rue Saint-Jean (actuelle rue Raspail), en 1849. À l’angle gauche du carrefour, en face de la maison Monaque, la grande maison de la Croix-de-Fer remontait à 1582. Les caves sont ouvertes sur la rue.© Archives muncipales de Saint-Quentin.
Rue de Lignières, cette cave comblée au XIVe siècle a des murs épais de 0,4 à 0,5 m, en moellons de craie irréguliers liés au mortier jaune. Sa profondeur était supérieure à 1,8 m. La partie inférieure des murs de la maison associée, était construite en grès.
carrières
halles aux laines,au �lé, aux draps et aux cuirs
r. de la Poterie
r. au Charbon
carrières
r. des Machecriers
r. de la Tein
turie
r. du Moulin
Boulangerier. du Chauffour
r. de l’Orfèvrerie
halle as pichonspoissonnerie
Grands maisiauxboucherie
Petits maisiauxboucherie
halle à le cresse
Moulin Becquerel
Moulin du Gronnard Moulin du
Petit Pont
Moulin des Jacobins
Markiet
poids Raoul Belin
poids St-Rémi
poids dele canel
r. Vieille Poissonnerie
Grenier du chapître
Pl. de la cossonerie marché des volailles
Pl. du Vies Markietmarché des bovins
markié as pourciauxmarché des porcs
Pl. au carbonvente du charbon
Foulerie du Grand Pont
Vivier
Pêcherie
r. de la Sellerie
r. des Liniers
Tannerie(enseigne)
r. des Foulons
r. des Corroyeurs
Grenier de l’Hôtel-Dieu
Pl. au lin
fours à chaux
Moulin à eau
Moulin à vent
Activité liéeaux blés
Poids
localisationapproximat.
Activité liéeaux bêtes
Bâtiment lié à l’économie
Marché
Textile
Cuir
estaple du vin
Le croix au blévente des blés
300m0
Sur le Biez
Gardin de le ville (jardin
de la ville)
Ile du Biez
Canal du Biez
Marais St-Prix
Marais de la Capelle
Noirmont
Ilots de St-Prix
Du XIIe au XIVe siècle, Saint-Quentin est une place commerciale active qui exporte ses produits manufacturés (draps de laine, cuirs), la guède et les céréales de ses campagnes ainsi que le vin régional. La ville possède un atelier monétaire actif. Aux XIVe et XVe siècles, la guerre de Cent Ans affaiblit le commerce et la draperie périclite. L’économie se redresse dans la seconde moitié du XVe siècle : l’artisanat textile est désormais dominé par la fabrication de toiles de lin et de chausses. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les toiles fines permettent de renouer avec la prospérité.
Commerceet artisanat
Les activités commercialesLe long des rues principales sont établies des boutiques d’artisans ou de commerçants, ainsi que de multiples estaminets. Une partie de l’activité commerciale se concentre dans des halles et sur des marchés spécialisés. La place du Marché (actuelle place de l’Hôtel de Ville), accueille des marchés, surtout de produits alimentaires, destinés à la consommation locale ou au commerce, ainsi que la foire annuelle.
Commerce et artisanatà Saint-Quentinau Moyen Âge.
Cave de la maison du Froid-Mantel (angle des rues Voltaire et des Canonniers) en 1931. La construction de ces grandes caves, dont quelques-unes subsistent, est certainement liée au commerce du vin. Au XVe siècle, Saint-Quentinest l’un des points de passage obligé où est prélevé l’impôt royal sur l’exportation du vin (étape).© Société Académique de Saint-Quentin.
L’artisanatLe nom de plusieurs rues suggère que les artisans étaient initialement regroupés par activité, ainsi les artisans du cuir dans les rues de la Sellerie et des Corroyeurs (actuelle rue de la Comédie). Au sud de la ville, les foulons et tanneurs se répartissaient le long des cours d’eau, de même que les moulinsà eau. L’archéologie a livré quelques traces de ces activités : un four de potier du XIIIe siècle rue des Faucons, deux fours à brique d’Époque moderne, rues Cordier et de Pontoile, des rejets de tabletiers mêlés à des creusets de bronzier aux Oriels, un moule de bronzier à l’Hôtel-Dieu. Le Moulin Becquerel a été mis au jour lors d’un récent diagnostic place du monument aux morts.
Four à brique du XVIe ou XVIIe siècle, de type « en meule », fouillé rue Cordier,
à l’extérieur de la ville fortifiée. Deux canaux aménagés dans la longueur permettent la circulation de l’air chauffé
depuis les foyers placés à leur extrémité. Les briques mal cuites laissées en place,
sont empilées de chant, légèrement en oblique.
Un boucher place BabeufLa parcelle fouillée place Babeuf était située au sud-est de la place du Vieux Marché, où se tenait le marché aux bestiaux et au sud de la rue des Machekriers (Bouchers). À la fin du Moyen Âge, c’était un espace de jardins et de dépendances ; au XVe siècle, des latrines ont servi de dépotoir à un boucher. Unique pour cette période dans le Nord de la France, il a un grand intérêt pour l’histoire de l’alimentation médiévale. Bovidés, ovicaprinés et porcs représentent près de 97 % des restes, qui sont très variés : autres mammifères (chien, chat, chevreuil, sanglier et lapin), oiseaux (coq domestique, oie, canard colvert, pigeon biset, cygne tuberculé, perdrix grise et pluvier doré), poissons marins (carrelet, turbot, morue et hareng). La présence du poisson dans une boucherie peut paraître surprenante. Mais l’interruption annuelle de la consommation de viande durant quarante jours pour raisons religieuses, a conduit les bouchers à élargir leurs activités.
Ce moulin mentionné au Xe siècle, jouxtait le « Grand Pont » de pierre à trois arches qui franchissait la Somme. En 1384, sont attestés deux moulins implantés de part et d’autre de la Somme, reliés au XIXe siècle pour ne former plus qu’un seul bâtiment, lorsque le pont est abandonné. Ils sont détruits en 1917.
Les crânes de moutons non vendus retrouvés dans le dépotoir de la boucherie présentent
des traces de découpes, témoins du prélèvementde la langue et de la cervelle de l’animal. Les bas
de pattes (métapodes) ont aussi été rejetés. En majorité, ces animaux avaient dépassé cinq ans.
Humérus de chien et de chat avec traces de découpes. Au Moyen Âge, ces animaux n’étaient pas consommés, sauf en cas de disette ou famine.
La viereligieuse
Les cimetières
Jacobins
St-Quentin-en-l’ Isle
St-Prixjusqu’au XV e s.
Cordeliers
Cordelières
St-Prix (XV e s.)
Toussaint
St-Mein & St-Louis
Ste-Pécinne
St-Pierre-au-Canal
St-Thomas
Ste-Catherine
St-RémiSt-André
St-Jacques
St-Jean
Ste-Marguerite
St-MartinSt-Nicaise
ND-de-la-Gréance
St-Éloi
St-Pierre-le-Moïen
Chapelle Ronde
Grand Âtre
St-Q uentin
R6
R5
R7
R3
C7R1
H10
R4
C6
C8
H6
CH
Maisons refuges
localisationapproximat.
Église & chapelle
Bât. conventuels
Egl. paroissiales
Autres églises
Cimetières
Ordres monastiques
Églises et cimetières
Maisons & prieurésC6 : prieuré St Nicolas de PrémontréC7 : Hôtel du TempleC8 : Maison des Hospitaliers de St-Jean-de JérusalemH6 : AugustinesH10: Trinitaires
Maisons-refugesR1 : HomblièresR2 : VermandR3 : FervaquesR4 : Mont-St-MartinR5 : OrignyR6 : St-Q.-en-l’I.R7 : Royaumont
CH : Chapitre de St-Quentin
300m0
: bloc calcaire : grès
: limite de sondage
Légende :
mur second état
nef
mur premier état
route pavée
trottoir
sépulture
accès
route pavée
mur second état
0 2,5 m
cave
tranchée derécupération
rue
de
Lig
niè
res
Légende :
: sépulture
: argile naturelle
: mur
: fosse
: sol
: crâne
: grès
: limite de sondage
0 5 m
La religion est profondément ancrée dans le quotidien du Moyen Âge. L’encadrement de l’Églisese manifeste au travers des églises paroissiales. Leur nombre élevé (quinze) correspond à une forte population. Particularité de Saint-Quentin, le chapitre canonial y exerce une autorité quasi épiscopale et choisit la majorité des curés et chapelains. Le clergé est aussi représenté par des abbayes bénédictines, puis des couvents mendiants, mais aussi par de nombreuses maisons-refuges et hôtels appartenant aux établissements monastiques de la région.
Le réseau paroissialDeux églises paroissiales ont été en partie fouillées. Saint-Jacques, antérieure à 1214, occupait l’angle sud-est de la Grand Place. Pillée et détruite en 1557 par les Espagnols, elle est reconstruite en 1562 dans la rue éponyme (actuel espace Saint-Jacques). L’église Saint-Pierre-au-Canal, attestée dès 1146, devient paroissiale en 1248. Elle disparaît dans la seconde moitié du XVIe siècle, lorsque l’angle sud-est de l’enceinte est retranché de la ville (Coupement) et transformé en une sorte de demi-lune.
Églises, abbayes, couvents et maisons religieuses aux XIVe et XVe siècles.
L’inhumation à l’intérieur des églises est un privilège réservé à quelques-uns. Les notables cherchent aussi à reposer dans les établissements conventuels, mais le chapitre de Saint-Quentin veille à limiter cette pratique. Le paroissien trouve sa place dans les cimetières paroissiaux, mais leur capacité insuffisante a nécessité l’aménagement d’un grand cimetière ou Grand Atre au sud-est de la ville. Une intervention archéologique rue de Lignières a mis au jour un lieu de sépulture non documenté par les archives, dont la limite sud a été appréhendée. Ce cimetière pourrait avoir fonctionné aux XIIIe et XIVe siècles, voire à partir du XIIe siècle.
Les fondations de l’église Saint-Pierre-au-Canal sont formées de gros grès et les murs, épais de 0,75 m, sont parementés de moellons de grès et de craie. Les niveaux de démolition de la seconde moitié du XVIe siècle ont livré des blocs sculptés et moulurés provenant de baies vitrées.
Cette dalle funéraire brûlée par l’incendie qui a ravagé l’église Saint-Jacques en 1557, correspond à la sépulture d’un organiste décédé en 1526.
À l’intérieur de l’église Saint-Jacques, certaines tombes des XVe-XVIe siècles
contenaient des céramiques, utilisées pourbrûler de l’encens lors de la cérémonie funéraire.
Cette partie du cimetière de la rue de Lignières a livré majoritairement des enfants ou des périnataux. Les sépultures sont classiquement axées ouest-est. Les défunts sont enterrés soit en pleine terre, soit dans un coffre en bois ou dans un cercueil, sans objet, ce qui rend la datation difficile. Toutefois, les coffres ou cercueils, dont ne subsistent que les clous, ne réapparaissent qu’au XIIIe siècle.
Les établissements conventuelsLa vie monastique médiévale a été animée par des élans successifs : Bénédictins durant le haut Moyen Âge, implantés en périphérie de la ville, à Saint-Quentin-en-l’Isle et Homblières, réformés au Xe siècle, en même temps qu’est fondée Saint-Prix, la seule abbaye documentée par les fouilles récentes ; Cisterciens, Prémontrés, Templiers et Hospitaliers au XIIe siècle, présents à Saint-Quentin au travers de leurs maisons-refuges ou hôtels ; ordres mendiants au XIIIe siècle, implantés dans les villes où ils déploient des activités apostoliques et charitables : Franciscains (ou Cordeliers), Dominicains (ou Jacobins), Augustines et Trinitaires.
Des vestiges de l’abbaye Saint-Prix ont été observés
en 2004. Implantée vers 986 dans l’ancien château des comtes de Vermandois,
elle est rasée en 1471, car située sur une hauteur
dominant la ville. Ces éléments
architectoniques appartiennent à une cave
de l’Abbaye Saint-Prix probablement antérieure à sa première destruction vers 1358. Les retombées
des nervures indiquent une voûte à croisées d’ogives
et arcs brisés.
Une vaste enceinte est construite à partir de la fin du XIIe siècle, comprenant une courtine, épaisse muraille parementée en grès, flanquée par des tours espacées d’une vingtaine de mètres (portée des armes de jet). Face à la montée en puissance de l’artillerie, le dispositif est complété par des terrasses en remblai (« boulevards ») et des ouvrages avancés. Le siège de 1557 montre le caractère inadapté de ces défenses. Saint-Quentin, place forte à la frontière du Royaume, a alors bénéficié des différentes solutions de bastions expérimentées aux XVIe et XVIIe siècles, antérieures aux systèmes « à la Vauban ».
Le développement des fortifications bastionnéesLa prise de Saint-Quentin en 1557 a montré l’importance stratégique de la ville, sa vulnérabilité, en raison d’une position topographique peu propice et la nécessité d’en améliorer la défense. Dès 1559, les travaux commencent et se poursuivent jusqu’au milieu du XVIIe siècle, avec un rythme particulièrement intense de 1624 à 1642. Les ouvrages bastionnés sont adaptés à l’artillerie : des remblais considérables sont maintenus par d’épais murs maçonnés en pierre, renforcés par des contreforts internes et revêtus sur la face externe par un parement de grès à la base et des briquesen élévation. Ils sont précédés par un large fossé à fond plat, le long duquel court un chemin couvert protégé par un glacis permettant une défense avancée. Des ouvrages détachés, du type demi-lunes renforcent le dispositif. La forme triangulaire adoptée permet d’éviter les angles morts : les ouvrages voisins se protègent mutuellement par des tirs croisés.
Boulevard Victor Hugo, en 2000, l’une des deux poudrières construites à Saint-Quentin dans la seconde moitié du XVIIe siècle, celle de Tour-y-Val, a été partiellement dégagée. Les murs sont extrêmement épais (2 m), profondément fondés (plus de 1,5 m) et construits avec soin (grès sur soubassement de craie pour la fondation). Il était probablement recouvert d’une voute massive (cf. croquis), car il fallait protéger la poudre des engins incendiaires.
conduitd'aération
meurtrières
Les fortifications de Saint-Quentin à l’Époque moderne
P3
P1
P4
P5
CN1
P2
Ba3
CG
CG
DL3
DL6
Ba9T1
T2
T3
PA1
PA2
Lu
TN1
TN2
DL4
Ba4
Ba2
Ba1
DL1
DL2
Ba5
Ba6
Ba7
DL5
Ba8
Po1
CN2
CN2
Ch. de Pér onne et Amiens
Chaussée rom
aine
Le Vivier
Pré St Éloi
PortesP1 : St-JeanP2 : St-MartinP3 : St-NicaiseP4 : 1ère d'IsleP5 : 2e d'Isle
BastionsBa1 : CoulombiéBa2 : LonguevilleBa3 : RichelieuBa4 : St-JeanBa5 : Le RoiBa6 : DauphinBa7 : AnjouBa8 : La ReineBa9 : Pienne
Demi-lunesDL 1 : St-LouisDL 2 : St-MartinDL 3 : CavinDL 4 : St-JeanDL 5 : PradelDL 6 : Coupement
CornesCN1: VaubanCN2: Saint-Martin
TenaillesTN1: RemicourtTN2: Mont-joli
Places d'armesPA1: St-ThomasPA2: St-Martin
Lu : LunetteCG : Corps de garde
ToursT1: Tour-y-ValT2: Ste-CatherineT3: Grosse Tour
PoudrièresPo1 : Tour-y-Val500m0 2011
Interventions archéologiques
Plan des fortifications en 1774
Rue Varlet, en 2006, l’un des ouvrages les plus imposants de Saint-Quentin,
le bastion Saint-Jean a été en partie reconnu. Deux galeries internes aménagées vers 1590,
permettaient de tirer dans le fossé. Trois emplacements de tir comprennent chacun
trois embrasures : celle du centre est droite, tandis que les deux autres sont obliques
de telle sorte qu’elles se rejoignent en une seule ouverture à l’extérieur. Ces postes de
tir sont surmontés par un conduit d’aération qui permettait d’évacuer les épaisses fumées
dégagées par les armes à feu.
Boulevard Léon Blum, en 2001, a été fouillée la pointe sud-est de la corneoccidentale aménagée dans la première moitié du XVIIe siècle. Cet ouvrage, composé de deux bastions saillants, défendait la porte d’Isle. Le mur, large de 4,80 m présente un parement externe épais de 0,70 à 0,80 m qui comprend une maçonnerie en briques revêtue à l’extérieur par un parement de blocs de grès montés en assises régulières. Édifiée sur un terrain gorgé d’eau, la pointe a basculé vers l’avant : pour arrêter ce phénomène, des pieux de chênes ont été battus sur deux rangs pour densifier le sol et l’espace entre les pieux et le mur a été remblayé.
Les cornes de VaubanAprès les victoires de Louis XIV et la conquête des territoires qui constitueront désormais le Nord de la France, Saint-Quentin perd son importance stratégique et les travaux de fortification s’interrompent quasiment. Les cornes de Vauban, construites entre 1671 et 1674, sont le seul ouvrage réalisé sous le contrôle du célèbre architecte. Construites sur la rive gauche du fleuve, elles assuraient la défense du franchissement de la Somme. Constitué de deux bastions saillants reliés par un mur, l’ensemble mesure pratiquement 225 m de long.
Plan des cornes de Vauban. Le diagnostic réalisé place la Gare en 2011 a permis de localiser avec précision l’ouvrage et d’étudier son mode de construction. Les murs de la courtine et des bastions font 3,90 m d’épaisseur avec un parement de briques 0,90 m de large. Des contreforts espacés de 3,20 m à 3,50 m, liés avec le mur, viennent renforcer sa face interne.
corne de Vauban occidentale
emplacementdu mur defortification
orillon
flanc retirécourbe
La corne occidentale est située au niveau de la gare actuelle. Sa face ouest avait une longueur minimale de 80 m tandis que sa face sud mesurait environ 70 m. L’angle oriental était arrondi avec un flanc retiré courbe jusqu’à la courtine : c’est un orillon. : parement ou blocage de briques
: parement de grès: fossé
: blocage de blocs de craie
gare
étangd’Isle
cornes de Vauban
0 75 m
0 10 m
: bloc calcaire
: limite de fouille
: blocage (craie et mortier)
: brique
: parement de grès
: pieux en chêne
: fossé
: �ssure
: remblai de stabilisation







































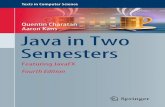

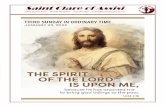

![Vermand/ Saint-Quentin [topographie chrétienne]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631846cf831644824d03d38d/vermand-saint-quentin-topographie-chretienne.jpg)