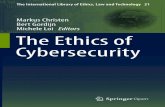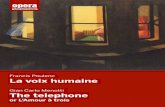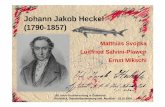Johann Peter Süßmilch: de la loi divine à l’intervention humaine
-
Upload
uni-saarland -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Johann Peter Süßmilch: de la loi divine à l’intervention humaine
Population-F, 66 (3-4), 2011, 699-726
* Universität des Saarlandes, Allemagne.
Correspondance : Justus Nipperdey, Universität des Saarlandes, Lehrstuhl Frühe Neuzeit, Campus Saarbrücken, Historisches Institut, B3 1, 3.05, Post: D - 66041 Saarbrücken,tél : 0049-681-302-3295, courriel : [email protected]
Justus NIPPERDEY*
Johann Peter Süßmilch : de la loi divine à l’intervention humaine
La portée démographique de l’œuvre du théologien allemand Johann Peter Süßmilch, L’Ordre divin, est largement reconnue par les historiens spécialistes de la population. C’est ainsi que l’Ined en a publié en français en 1984 la deuxième édition (1761-1762) avec une présentation de Jacqueline Hecht, avant de publier en 1998 la première édition (1741) du même ouvrage dans une traduction annotée par Jean-Marc Rohrbasser. Justus NIPPERDEY analyse ici l’évolution de la pensée de Süßmilch au cours des vingt années qui séparent les deux éditions de son œuvre majeure, et notamment la transformation de son argumentation. L’analyse de la possibilité d’une intervention humaine modifiant les comportements remplace progressivement la justification de la perfection du monde comme motivation de l’analyse des événements placés au cœur de la démographie : la croissance de la population, le nombre de décès et de naissances, la répartition des naissances selon le sexe et des décès selon l’âge. Après le succès de la première édition, la prise en compte de l’hétérogénéité de la population dans les analyses et le souhait de Süßmilch de jouer un rôle comme conseiller du Prince ont transformé profondément son œuvre, accompagnant ainsi l’éclosion en Europe de l’économie politique dans la deuxième partie du XVIIIe siècle.
Johann Peter Süßmilch est reconnu depuis longtemps comme le contribu-teur allemand le plus important au développement de la démographie et de la statistique. Jacqueline Hecht, qui en a publié une traduction française et ainsi fourni un apport essentiel à l’histoire de la pensée démographique, qualifiait L’Ordre divin de 1741 de « premier traité de démographie de l’histoire » (Hecht, 1980, p. 667). Vingt ans plus tard, le pasteur du Brandebourg publia une seconde édition, si différente de la précédente qu’on peut la présenter comme un autre ouvrage. Tout en maintenant ses thèses démographiques initiales, Süßmilch
J. NIPPERDEY
700
élargissait l’objectif de son enquête démographique au champ des politiques sociales et économiques. De nombreux commentateurs ont signalé les diffé-rences entre ces deux éditions (Arisawa, 1979, p. 23 ; Hecht, 1980, p. 670 ; Rohrbasser, 1996, p. 984 ; Dreitzel, 1986a, p. 43). Mais l’évolution du travail de Süßmilch n’a pas été suffisamment mise en lumière, et moins encore expli-quée dans le contexte des débats de l’époque sur la population. Cet article montre que, dans les vingt années qui ont séparé les deux éditions, Süßmilch a radicalement modifié le projet et les perspectives qu’il s’était donnés en ras-semblant son matériau démographique. La deuxième édition participe mani-festement au discours politique et économique allemand du deuxième tiers du XVIIIe siècle, alors que la précédente n’en laissait entrevoir aucune connaissance ni désir d’y participer. Cette lecture de Süßmilch s’appuie sur l’hypothèse d’une forte séparation entre le discours érudit à propos du développement de la population et les débats sur les politiques de population dans le Saint Empire romain germanique, à la différence de l’Europe occidentale.
Afin de donner un aperçu du développement de la pensée de Süßmilch, il est en premier lieu nécessaire de présenter son objectif, ses sources ainsi que ses rapports aux auteurs précédents et contemporains de la première édition de L’Ordre divin. La deuxième partie analyse la réception de l’œuvre par les caméralistes allemands, et comment ils furent influencés par la méthode et la terminologie de Süßmilch, tout en négligeant son argumentaire central de nature religieuse. Dans la troisième partie, on verra que le théologien lui-même devint partie prenante dans le discours caméraliste des années 1750, et qu’il commença à utiliser son matériau dans des polémiques selon un mode jamais suivi auparavant. Son implication dans les débats politiques de son temps a finalement été à son apogée dans la volumineuse deuxième édition de L’Ordre divin, développée dans la quatrième et dernière partie.
I. L’Ordre divin de 1741 :à la recherche des preuves de la loi divine
Dans sa préface à l’édition de 1741, Süßmilch donne un clair aperçu de ses motivations, ses sources et le but ultime de son ouvrage. Pasteur inconnu, Süßmilch qui n’avait publié aucun texte scientifique devait justifier son entre-prise(1). Il cite comme inspiration première Physico-theology de William Derham, qu’il avait rencontré lors de ses études universitaires à Halle et qui a façonné sa vision du monde. Suivant cet exemple, le pasteur allemand veut montrer l’ordre parfait du monde tel que Dieu l’a créé. Quand Süßmilch explique la fonction et le bénéfice à tirer de son ouvrage, il le fait toujours en se référant à la connaissance de Dieu. Il n’y a qu’une exception : sa dédicace à Frédéric II
(1) Il avait publié précédemment sa thèse sur l’attraction physique des corps. Elsner (2000) fournit une liste complète des publications de Süßmilch et de ses communications à l’Académie royale des sciences de Berlin.
JOHANN PETER SÜßMILCH : DE LA LOI DIVINE À L’INTERVENTION HUMAINE
701
mentionne effectivement l’utilité de ses réflexions pour le souverain. Mais en pratique il ne délivre pas de prescription politique, il fait l’éloge de l’état des affaires en Brandebourg-Prusse (Süßmilch, 1741/1998, dédicace, p. 5-7)(2). Ces quelques phrases visent à flatter le nouveau roi et ne reflètent pas l’orientation principale du texte. Dans celui-ci, l’auteur ne cherche pas à fournir une infor-mation ou des spécifications à visée politique ou économique.
C’est particulièrement clair lorsqu’il parle du mathématicien hollandais Nicolas Struyck (1687-1769). Süßmilch révèle s’être interrogé sur la publication de son propre travail quand il a entendu parler de l’Introduction à la géographie générale que Struyck venait de publier. Outre ses propres données, le Hollandais avait utilisé les matériaux assemblés par les arithméticiens politiques John Graunt (1620-1674) et William Petty (1623-1687), ainsi que l’historien William Maitland (1693-1757). Süßmilch justifie l’usage qu’il fait du même matériau dans son propre ouvrage par la différence de leurs approches respectives. Selon lui, les calculs de Struyck étaient « orienté[s] vers l’utilité politique » qui pouvait être faite du calcul des rentes viagères (Süßmilch, 1741/1998, préface, p. 19). Il recon-naît que « l’utilité politique » que le Hollandais voulait faire du matériau démo-graphique était une entreprise respectable dans un pays où un grand nombre de rentes viagères étaient vendues (Süßmilch, 1741/1998, préface, p. 19-20). Mais ce but était très éloigné de celui que lui-même poursuivait dans son vaste projet. Le pasteur n’était intéressé ni par le calcul de l’espérance de vie pour des produits financiers, ni par des conseils auprès de l’État. Il a participé à une discussion savante entre théologiens et naturalistes à propos de la population maximale sur terre, de sa taille effective dans l’Antiquité et les Temps modernes, de son rythme de croissance et du temps qu’il avait fallu à l’humanité pour doubler après la Chute ou le Déluge (Ducreux, 1977 ; Egerton, 1966).
Il est essentiel de bien distinguer les différents discours sur les questions de population pour rendre compte de la contribution de Süßmilch. L’historiographie des débuts de la pensée démographique a trop souvent recueilli et mis côte à côte l’ensemble des textes qui contiennent le moindre développement sur la population sans égard au contexte discursif (Bonar, 1931 ; Pearson, 1978). En Europe occidentale, il existait un lien entre les débats sur la démographie biblique et mondiale et les discussions économiques et politiques sur l’accrois-sement du nombre d’habitants (Rusnock, 2002). William Petty, par exemple, participait aux deux discours (Rohrbasser, 2002, p. 28). À l’âge des lumières, cette association se renforça, et le développement de la population fut au cœur de nombreux débats idéologiques en France et en Angleterre (Whelan, 1991). Mais ce rapprochement des différents discours ne se produisit pas dans l’Al-lemagne des XVIIe et XVIIIe siècle, où la distinction resta particulièrement nette entre les textes qui s’efforçaient de découvrir des réponses scientifiques
(2) Les traductions des citations extraites de L’Ordre divin proviennent de l’édition française établie par Jean-Marc Rohrbasser (1998) pour l’édition de 1741, et de celle établie par M. Kriegel et révisée par A. Cailar et J. Hecht (1979) pour l’édition de 1761-1762. Les indications de pagination sont celles des traductions françaises indiquées par les références 1741/1998 et 1761-1762/1979 (NdlR).
J. NIPPERDEY
702
d’une part, et les traités politiques et économiques qui édictaient des principes essentiels de politique de population d’autre part. Un discours important sur les politiques de population s’était développé depuis la fin de la guerre de Trente Ans (1618-1648), mais ces textes ne révélaient pas la moindre connaissance des débats savants ayant cours en Europe occidentale(3). Cette segmentation est cruciale pour comprendre la contribution de Süßmilch en 1741. Alors que celui-ci connaissait bien les débats scientifiques sur la population, il ne cite pas un seul texte allemand sur les questions économiques ou la politique de population(4). Süßmilch ayant toujours scrupuleusement fait état de ses sources, il est clair qu’il ne connaissait pas ces textes à l’époque. En fait, il n’avait pas à les connaître ! Au début du XVIIIe siècle, le discours caméraliste sur la popu-lation ne portait que sur la politique économique visant à stimuler la croissance démographique. Ces textes ne contenaient rien de pertinent pour un projet ayant l’ambition de révéler des lois démographiques universelles(5).
En revanche, Süßmilch était manifestement familier du discours érudit sur le développement de la population mondiale. Il mentionne explicitement et cite fréquemment les participants majeurs à ces débats paneuropéens, à commencer par l’humaniste Justus Lipsius (1547-1606), puis le savant hollandais Issac Vossius (1618-1689), les jésuites Jacques Bonfrère (1573-1643), Denis Pétau (1583-1652) et Giovanni Battista Riccioli (1598-1671), le médecin anglais Sir Thomas Browne (1605-1682), et parmi ses contemporains le théologien et physicien William Whiston (1667-1752) et le naturaliste suisse Johann Jacob Scheuchzer (1672-1733)(6). Ces débats se situaient principalement entre théologie et sciences natu-relles (Sieferle, 1990), les rendant particulièrement intéressants pour le pasteur qui souhaitait initialement devenir médecin. Deux questions se rattachaient de loin aux thèmes généraux de la chronologie et de la croissance démographique dans l’Antiquité : l’humanité a-t-elle une tendance naturelle à s’accroître ? La population mondiale est-elle aujourd’hui plus ou moins nombreuse que dans l’Antiquité ? Les chercheurs qui prétendaient à un déclin par rapport à l’époque romaine mettaient en doute l’idée d’une tendance inhérente à la croissance (Whelan, 1991, 41 sq.). D’autres faisaient état d’une disposition générale à la croissance naturelle, balayée périodiquement par de grandes crises de la mor-talité. Dans ce point de vue largement partagé, la peste, la guerre et la famine n’étaient pas des fléaux du monde mais les correctifs nécessaires envoyés par
(3) La rupture n’est pas reconnue, mais en pratique elle se reflète dans la littérature sur la pen-sée démographique en Allemagne. Fuhrmann (2002) ne traite que du discours sur la politique de population, alors que Sieferle (1990) couvre entièrement les débats érudits sur le développement de la population.(4) Voir la liste des ouvrages cités dans la traduction française de Sußmilch J. P. (1741) par Rohr-basser J.-M., 1998, p. xliii-il.(5) La seule fois où il introduisit un argument d’économie politique, il eut recours à une citation de six pages extraite d’un magazine anglais, dans un style qui s’éloignait radicalement de ses habitudes (Süßmilch, 1741/1998, p. 50-53). Il semble juste de supposer que ce passage attira son intérêt princi-palement parce qu’il contenait des calculs numériques sur les pertes humaines causées par les guerres de Louis XIV, le raisonnement économique ne trouvant sa place dans L’Ordre divin que fortuitement.(6) La plupart d’entre eux sont cités dans Süßmilch (1741/1998, préface, p. 16-17).
JOHANN PETER SÜßMILCH : DE LA LOI DIVINE À L’INTERVENTION HUMAINE
703
Dieu pour alléger la pression démographique (Cipolla, 1974). Alors que Süßmilch croyait fermement à la croissance naturelle de l’humanité, il abhorrait l’idée de Dieu tuant délibérément des gens pour rétablir un équilibre. Il voulait montrer à la place que Dieu disposait d’instruments beaucoup moins brutaux pour agir sur le développement de la population. Le point de vue physico-théologique de Süßmilch et sa participation à ces débats savants avaient une conséquence par-ticulière : comme il voyait en toute chose la loi de Dieu, il n’était pas – à l’époque – particulièrement intéressé par les possibilités de régulation des pro-cessus démographiques par l’homme. Une différence très frappante avec son œuvre ultérieure.
Ce point de vue particulier peut encore être illustré par la façon dont il utilisa les travaux de John Graunt et William Petty. À cause de son intérêt pour les deux Anglais et de leur fréquente citation, Süßmilch a été qualifié de disciple de l’arithmétique politique (Dreitzel, 1986a, 31 sq. ; Hecht, 1998, XVI sq.). Ce n’est vrai qu’en partie. Süßmilch louait les méthodes et les résultats des auteurs anglais, mais il n’était pas intéressé au départ par l’usage que les arithméticiens politiques imaginaient de ces chiffres, c’est-à-dire dans le champ de l’économie politique. En particulier, l’aspect économique, si important dans le travail de William Petty, est totalement absent chez Süßmilch. Il utilise les données et les calculs de Petty et commente la méthode, mais pas les conséquences que Petty envisageait au profit de son concept d’arithmétique politique (Petty, 1690, préface)(7). Süßmilch recevait les publications originales de Londres et on peut supposer qu’il avait lu un certain nombre de propositions politiques ou économiques. Mais ces concepts ne trouvèrent pas place dans L’Ordre divin. Ses calculs étaient destinés à montrer l’ordre général et la capacité de ses méthodes statistiques ; ils n’étaient pas là pour contribuer au savoir du gouvernement. Dans son utilisation des méthodes de l’arithmétique politique, Süßmilch essayait de surmonter ce qu’il voyait comme les faiblesses du discours érudit. Malgré l’estime qu’il avait pour les auteurs cités plus haut, leur méthode ne le séduisait pas du tout. Il leur reprochait de trop spéculer, leurs assertions n’étant pas tirées d’observations empiriques (Süßmilch, 1741/1998, préface, p. 20). D’un point de vue épistémologique, il était proche des arithméticiens politiques, mais les questions qu’il cherchait à résoudre n’étaient pas celles de l’économie politique, elles venaient du discours érudit de la théologie et de l’histoire naturelle.
La population figurait en bonne place en Allemagne dans un troisième discours, appelé le Staatenkunde, qui était une forme de statistique descriptive. Professeur à Helmstedt, Hermann Conring (1606-1681) avait introduit la statistique descriptive dans les universités allemandes comme branche de la politique (Horváth, 1979 ; Seifert, 1980 et 1983). Poursuivant une tradition qui avait débuté avec Giovanni Botero (1540-1617) à la fin du XVIe siècle, il examinait
(7) Dans l’abondante littérature sur Petty, voir McCormick (2009). Pour une vue d’ensemble sur le projet de l’arithmétique politique dans le contexte de la politique et de l’économie du XVIIe siècle, voir Slack (2004). Plus spécifiquement, sur le raisonnement démographique de Petty, voir Reungoat (2004).
J. NIPPERDEY
704
les causes de la dépopulation enregistrée en Espagne (Rodríguez, 1985 ; Conring, 1730, p. 69-73). Staatenkunde était délibérément orienté vers la politique ; en fait, il remplissait une fonction propédeutique pour la compréhension de la politique. La taille de la population était traitée exclusivement dans son effet sur les relations de pouvoir ou comme une conséquence de la politique à l’égard de la population. C’était l’exact opposé de la conception qu’avait Süßmilch des études de population et de sa recherche de lois universelles. Süßmilch ne mentionne ni Conring ni d’autres tenants de la même école, mais il tourne en ridicule les arguments de la statistique descriptive en critiquant l’historien italien Gregorio Leti (1630-1701), qui se convertit ultérieurement au calvinisme et devint historiographe de la ville d’Amsterdam ( Jaumann, 2004, p. 405-407)(8).
Selon Süßmilch, Leti avait expliqué le déclin supposé de la population européenne par trois causes : le célibat des prêtres catholiques et l’abolition de la polygamie dans les pays chrétiens, la taxation trop sévère, et le comportement des nobles empêchant le mariage de leurs enfants de crainte de devoir partager la richesse de la famille. La plupart de ces facteurs étaient des arguments cou-rants de la littérature (protestante) du Staatenkunde au XVIIe siècle sur les questions de population. Pour Süßmilch, qui était familier de la statistique, c’étaient des causes mineures qui pouvaient avoir amplifié l’effet de facteurs décisifs comme la peste, la famine et la guerre. À ses yeux, Leti avait « allégué de vraies et de fausses raisons et négligé les principales. » (Süßmilch, 1741/1998, p. 59) Süßmilch réfutait la plupart des démonstrations de Leti en donnant des contre-exemples ou en montrant la faible portée numérique des facteurs allé-gués. Le seul argument accepté par Süßmilch était celui des taxes élevées, qu’il intégrait dans le contexte plus large de l’impact démographique de la pauvreté (Süßmich, 1741/1998, p. 61).
De toute évidence, Süßmilch était très éloigné de la pensée des statisticiens descriptifs. Bien qu’il ait étudié quatre ans à l’université d’Iéna, il ne semble pas avoir été en contact avec Martin Schmeizel (1679-1747), qui y fut professeur et l’un des principaux protagonistes de la statistique descriptive à l’époque. Jürgen Wilke, expert de la vie de Süßmilch et ses contacts intellectuels, a qualifié de « surprenante » cette absence de relation, car il considère que les deux hommes travaillaient dans le même champ. Wilke est également surpris qu’il n’y ait pas eu de lien personnel entre Süßmilch et Gottfried Achenwall (1719-1772), célèbre professeur de Staatenkunde à Göttingen (Wilke, 1994, p. 227)(9). À l’examen de la première édition de L’Ordre divin, il semble tout à fait plausible qu’il n’y ait eu aucun lien personnel ni intellectuel entre Süßmilch et les représentants de la statistique descriptive. Leurs approches méthodolo-
(8) Süßmilch cite Leti, Il ceremoniale historico e politico, Amsterdam, 1685.(9) Une recherche dans les documents personnels d’Achenwall a cependant révélé que celui-ci avait
2003, p. 126-128).
JOHANN PETER SÜßMILCH : DE LA LOI DIVINE À L’INTERVENTION HUMAINE
705
giques différaient et leurs questionnements étaient opposés. Süßmilch suivait les traces des auteurs du XVIIe siècle sur la démographie biblique et mondiale. Tout en critiquant leurs méthodes hasardeuses, il leur reconnaissait le mérite de chercher les règles générales du comportement démographique. Il pouvait se rattacher à leurs interrogations, alors que les préoccupations purement politiques de la statistique descriptive étaient étrangères à son projet.
En fait, L’Ordre divin contenait bien un ensemble d’informations qui pouvaient aisément être utilisées pour démontrer l’impact démographique de circonstances politiques et économiques, mais l’auteur lui-même s’y refusait. Il notait fréquemment des divergences dans les données démographiques des différents pays d’Europe ou les régions du Saint Empire romain. Süßmilch refusait d’en commenter explicitement les raisons possibles. Dans le contexte de son système général de développement de la population, les raisons se devaient d’être sociales ou politiques. Ainsi refusait-il résolument les théories ancestrales sur la forte fertilité de certains peuples. Il rejetait sèchement l’affirmation de Tite-Live selon laquelle les femmes françaises seraient particulièrement fertiles : « cela m’a donné lieu d’examiner particulièrement cette opinion ; mais j’ai trouvé qu’elle était infondée et que la France (…) [n’avait] là-dedans aucun avantage particulier. » (Süßmilch, 1741/1998, p. 26) Il réfutait de même la théorie selon laquelle les peuples du Nord seraient particulièrement féconds, qu’il attribuait à Nicolas Machiavel, Pierre Bayle et bien d’autres auteurs (Süßmilch, 1741/1998, p. 115). Süßmilch insistait au contraire sur l’universalité de la capacité de propagation, n’envisageant que quelques différences entre les zones tempérées et les régions extrêmes de la planète.
Tout en soulignant l’uniformité naturelle de la reproduction humaine, Süßmilch notait des différences entre certaines régions allemandes. Il enre-gistrait seize à dix-sept naissances pour dix décès en Prusse orientale, contre seulement douze à treize en Westphalie, et le pasteur de Berlin situait sa propre région du Brandebourg entre ces deux extrêmes. À ceux qui n’étaient pas familiers des statistiques, il expliquait que ces différences avaient des effets considérables quand elles s’appliquaient « à des grands nombres. » (Süßmilch, 1741/1998, p. 40) L’ auteur notait bien sûr l’intérêt général de ce résultat. « Je sais bien que le lecteur voudra connaître la cause de cette différence, mais je ne puis la lui donner car je ne connais pas la constitution interne des pays. » (Süßmilch, 1741/1998, p. 107) Les familiers de ces régions pourraient en iden-tifier les causes. Eux seuls pourraient concevoir des instruments politiques pour remédier à la situation démographique négative de certains territoires. Le jeune Süßmilch déléguait à d’autres la tâche subalterne des politiques de population, tandis qu’il se réservait celle plus élevée de la recherche sur la loi universelle de la nature. Il ne revint donc pas sur ce sujet dans les trois cents pages suivantes de l’ouvrage.
Pour conclure, tout au long de la première édition de L’Ordre divin, Süßmilch répugna à traduire ses observations en suggestions d’action administrative. Il établit que la mortalité était généralement plus élevée dans les grandes villes,
J. NIPPERDEY
706
mais il détecta aussi des différences considérables entre elles. Il spécula très brièvement sur les causes possibles de la surmortalité urbaine (Süßmilch, 1741/1998, p. 70-71). Les données suggéraient que différents modes d’organi-sation des villes conduisaient à différents taux de mortalité, offrant ainsi un point de départ pour alléger le péril qui en résultait pour la taille de la popu-lation. Toutefois, Süßmilch ne suivit pas cette piste sérieusement. La réduction du taux de mortalité par des mesures politiques ou des moyens administratifs ne faisait pas partie de ses objectifs dans la publication originelle – même s’il revint sur le sujet ultérieurement. Il en va de même pour les variations de la fécondité dont les causes étaient bien plus claires et donc bien davantage sujettes à intervention politique. Süßmilch identifiait l’âge moyen des femmes au mariage comme facteur prépondérant (Süßmilch, 1741/1998, p. 71). Il mentionnait que les femmes suisses avaient soi-disant douze enfants ou plus en moyenne, bien davantage que les Allemandes. Pour Süßmilch, une seule explication était possible : l’âge au mariage devait être nettement plus bas en Suisse. Une fois de plus, Süßmilch s’arrêta là et passa à un autre argument. Il se garda de fran-chir le pas et de suggérer des mesures politiques pour abaisser l’âge au mariage, alors que ceci aurait été la forme la plus efficace de politique de population d’après son propre système. Ses lecteurs caméralistes allemands furent moins timides. Dès que Süßmilch leur eut fourni ces indicateurs, ils commencèrent à s’interroger sur les façons de modifier les moyennes par des interventions politiques. Ils utilisèrent les résultats et le vocabulaire de Süßmilch pour construire un champ d’intervention biopolitique. Dans les vingt ans qui s’écou-lèrent avant la deuxième édition de L’Ordre divin, le discours allemand autant que la perception par Süßmilch du but et de l’orientation de son projet chan-gèrent fondamentalement, sous l’influence des débats environnants.
II. L’influence de Süßmilch sur les caméralistes allemands
L’Ordre divin de 1741 donna aux caméralistes allemands et aux penseurs politiques des outils qu’ils n’avaient pas jusqu’alors. Il introduisit des indica-teurs concernant la fréquence des mariages, leur fécondité, ainsi que la mortalité de la population dans son ensemble et dans différents secteurs. De plus, Süßmilch prouvait que les taux de croissance différaient entre les territoires allemands. Tous ces résultats stimulèrent l’imagination des caméralistes déjà persuadés que la croissance de la population devait être un objectif clé de la politique des princes. Ils n’avaient pas besoin du conseil d’un théologien féru de statistiques pour en être convaincus. En fait, le discours sur la population orienté vers l’accroissement du nombre d’habitants s’était développé à l’écart de toute preuve statistique. Les demandes politiques émanant de ce discours étaient restées plutôt vagues, mises à part celles, universelles, concernant la politique d’immigration. Les auteurs allemands d’économie politique man-quaient d’un vocabulaire clair désignant les processus démographiques. Ainsi, les causes et effets de la croissance de la population n’étaient pas traités
JOHANN PETER SÜßMILCH : DE LA LOI DIVINE À L’INTERVENTION HUMAINE
707
systématiquement, alors qu’on supposait l’existence d’une relation générale entre prospérité économique et procréation. Les auteurs économiques à partir de Joachim Becher (1635-1682) plaçaient la politique d’expansion économique au centre de la politique de population. À leurs yeux, les sujets du prince ne pouvaient pas être forcés à avoir des enfants. Ils étaient des êtres libres et rationnels qui ne désireraient procréer que s’ils en avaient les moyens. Les auteurs concluaient ainsi non par idéologie mais à partir d’un raisonnement pragmatique. Leur théorie n’empruntait ni la forme d’une valorisation de l’au-tonomie individuelle, ni le vocabulaire de la loi naturelle de Samuel Pufendorf. Ils attribuaient aux sujets la liberté du choix de procréer à partir d’une approche factuelle qui présentait les faits comme évidents, ne requérant pas de preuve. Cette interprétation économique de la procréation avait comme conséquence que l’État ou le prince n’était pas en mesure de réguler directement le compor-tement procréateur de ses sujets.
La théorie qui découlait de la politique indirecte de population alimentait le seul ouvrage traitant de la politique de population en Allemagne dans la première moitié du XVIIIe siècle : Der Herrschafften / Städt und Länder Volcks-Besatzung (L’habitation des principautés, des cités et des pays) de Samuel Wagner (Wagner, 1711)(10). Bien qu’il traitât officiellement de questions de population, Wagner s’attachait en fait à la politique économique, reprenant ainsi l’hypothèse sous-jacente des auteurs allemands des cinquante années précédentes. L’ouvrage ne contenait pas d’idées originales sur la population, mais il était important par sa façon de résumer toutes les prescriptions que ses prédécesseurs avaient établies et accumulées pour accroître la population. Fondamentalement, elles ramenaient toutes à la politique économique. Dans la majeure partie de cet ouvrage de démographie, chaque chapitre s’intitulait « Vermehrung des Handels und Wandels durch... », qu’on peut traduire par « Accroissement du commerce et de l’industrie par… » (Wagner, 1711, Register). Wagner introduisit ses chapitres de politique économique par cet argument qui se passe d’explication : pour qu’une masse de gens vive et réside dans un pays, il est nécessaire qu’ils y trouvent nourriture à profusion et même richesse, ne pouvant résulter que d’une politique économique judicieuse (Wagner, 1711, p. 42). La population ne pouvait donc être régulée qu’indirectement par la politique économique – ce qui était la conviction des premiers auteurs camé-ralistes allemands jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. En 1744, Philipp Jacob Döhler soutenait que la meilleure façon de peupler un pays était d’assurer la justice, la sécurité de la propriété et la prospérité économique du territoire. Outre l’idée que la population ne pouvait augmenter que par l’accroissement de l’activité économique, Döhler adhérait aussi à l’idée réciproque des camé-ralistes selon laquelle une population en hausse stimulerait la consommation et la production, et s’auto-entretiendrait ainsi (Döhler, 1744, 10, p. 394-395).
(10) On ne sait rien de Samuel Wagner. Le livre a été publié dans la ville protestante d’Erlangen. L’auteur fait preuve d’une bonne connaissance des événements ayant affecté l’Ansbach-Bayreuth
voisin.
J. NIPPERDEY
708
Contrairement à certaines assertions fréquentes, la promotion du mariage et celle de la santé aux fins d’augmenter la population n’étaient pas des arguments fondamentaux dans les premiers discours caméralistes (voir par exemple Rosen, 1953). C’est dans ce contexte théorique de politique de population indirecte que L’Ordre divin de Süßmilch eut un impact particulièrement fort. Dans son système de développement de la population, il y avait différents points de départ possibles pour une intervention politique, même si l’auteur lui-même ne les avait pas identifiés comme tels. Ses lecteurs caméralistes étaient moins intéressés par la beauté du dessein divin que par ces aperçus spécifiques.
La première édition de L’Ordre divin eut un succès immédiat. L’ auteur fut salué en Allemagne et à l’étranger et, en 1742, un nouveau tirage fut effectué, non autorisé (Hecht, 1998, p. XV). Le processus d’appropriation du vocabulaire et de la pensée démographiques par les auteurs caméralistes prit cependant quelques années. Dans un premier temps, L’Ordre divin fut mentionné et cité principalement dans des travaux qui essayaient de réconcilier la théologie avec les sciences naturelles, respectant ainsi le discours physico-théologique auquel Süßmilch avait souhaité contribuer. Son calcul de la population mondiale fut particulièrement populaire dans ce genre. Il fut cité par le pasteur Joachim Böldicke (1704-1757) en 1746 dans son Versuch einer Theodicee (Essai sur la théodicée), ainsi que dans une entreprise physico-théologique classique, Ichthytheologie publié en 1754 par Gottfried Richter (décédé en 1765), qui prétendait conduire les hommes à l’admiration, la révérence et l’amour de Dieu par l’observation des poissons (Böldicke, 1746, p. 141 ; Richter, 1754, p. 212, 390 et 709). Theodor Christoph Lilienthal (1717-1781), professeur de théologie à Königsberg, utilisa les mêmes arguments dans un ouvrage célèbre sur la révélation de Dieu (Lilienthal, 1760, p. 327). En outre, dès 1744, l’exposé que Süßmilch avait fait des calculs anglais et hollandais de la durée de vie et des rentes viagères fut repris et commenté par le mathématicien Johann Friedrich Unger (Unger, 1744, p. 242-249).
Georg Heinrich Zincke (1692-1767) fut le premier auteur caméraliste à remarquer le travail de Süßmilch et son importance potentielle pour la science émergente de l’administration des États. Engagé pour enseigner le caméralisme (Kameralwissenschaften) à l’université de Leipzig en 1740, Zincke essayait de systématiser ce nouveau sujet d’études. Dans les vingt années suivantes, il devait devenir l’un des écrivains caméralistes les plus prolifiques (Tribe, 1988, p. 54 ; Brückner, 1977, p. 80-91). À partir de 1744, Zincke publia sa propre revue et rendit compte de L’Ordre divin dans le premier numéro. On ne s’éton-nera pas qu’il ait débuté son compte rendu en justifiant l’introduction d’un ouvrage apparemment théologique dans le champ du savoir caméraliste (Zincke, 1744, p. 78-80). Zincke notait que le livre contenait certes une série de réflexions édifiantes sur la providence divine concernant les naissances et les décès, mais qu’il était également porteur d’enseignements importants pour les lecteurs qui s’intéressaient ou se consacraient à l’administration d’une principauté. Comme
JOHANN PETER SÜßMILCH : DE LA LOI DIVINE À L’INTERVENTION HUMAINE
709
il était de première importance pour les administrateurs de faire progresser régulièrement le nombre des sujets, ils se devaient de connaître la taille de la population, sa croissance ou son recul, et son développement en rapport avec les populations des autres États. Des remarques pertinentes sur tous ces sujets se trouvaient dans le livre du pasteur prussien qui était, selon Zincke, le premier Allemand à traiter ces sujets complexes en utilisant les travaux de chercheurs anglais et hollandais.
Le caméraliste de Leipzig ne détaillait aucune politique spécifique qui pourrait résulter du traité démographique. Il se concentrait au contraire sur la connaissance du territoire et de la population, essentielle pour le projet caméraliste, et que les apports de Süßmilch faisaient progresser. En consé-quence, Zincke inséra un chapitre sur les vérités et les règles concernant la taille de la population dans sa monumentale Kameralisten-Bibliothek (biblio-thèque des/pour les caméralistes) qui regroupait tous les ouvrages concernant le caméralisme sur plus de 2 000 pages. Il y inclut L’Ordre divin de Süßmilch et ses principales sources, en particulier les ouvrages de Petty, Graunt, Davenant et Struyck. Il y ajouta quelques traités médicaux plus anciens sur la naissance et les enfants monstrueux sans aucun contenu démographique (Zincke, 1751, p. 480-482). Alors que Zincke avait bien saisi initialement la large portée du concept démographique de Süßmilch pour l’intervention caméraliste, il ne poursuivit pas dans cette voie. Son classement de L’Ordre divin et de ses pré-décesseurs avec de vieux ouvrages médicaux montre qu’il ne s’intéressait pas à l’utilisation directe et pratique qu’on pouvait faire des indicateurs démogra-phiques fournis par Süßmilch. Dans son Anfangsgründe der Cameralwissenschaft (Fondements du caméralisme) de 1755, il ne citait le pasteur que comme l’homme qui avait suggéré l’établissement de listes des naissances et décès (Zincke, 1755, p. 273). Zincke fut donc le premier à introduire Süßmilch dans le discours caméraliste, mais il fallut attendre les années 1750 pour que soit apprécié son impact réel sur le nouveau mode d’argumentation.
En 1753, l’historien et mathématicien Michael Christoph Hanow (1695-1773) publia un guide pour le bon usage de registres permanents des naissances et décès. Professeur au lycée de Dantzig, il avait lui-même recueilli les données de la ville de Dantzig depuis 1601, que Süßmilch allait utiliser dans sa deuxième édition (Süßmilch, 1761-1762/1979, vol. II, p. 433). Les données démographiques, leur composition et leur intérêt étant encore une nouveauté, Hanow rédigea une note introductive pour justifier son entreprise (Hanow, 1753, p. 3-11). Ses objectifs s’écartaient sensiblement de ceux du pasteur berlinois (Hanow, 1753, p. 35 et 37). Hanow s’intéressait à l’usage historiographique et politique des données. En tant qu’historien de Dantzig, il voulait retracer les tendances de l’évolution de la population et l’apport des étrangers. « À partir des registres on peut percevoir l’augmentation ou la diminution des subsistances (Nahrung) dans la ville et donc aussi des habitants. » (Hanow, 1753, p. 5) L’ étonnante causalité – les registres font d’abord apparaître la variation des subsistances et
J. NIPPERDEY
710
seulement indirectement celle de la population – montre que Hanow adhérait à la théorie économique de la population alors en cours en Allemagne. Outre l’intérêt historique, il en soulignait l’utilisation pratique : « Un homme d’État pourra facilement trouver les causes du déclin des habitants et s’efforcera de les éliminer dans la mesure de ses moyens. » (Hanow, 1753, p. 6) Les années suivantes, la publication des registres de naissances et décès commença à se développer dans le champ constamment élargi des revues savantes. Certaines fois, seules les listes étaient publiées ; d’autres fois, des auteurs les commen-taient en détail, leur interprétation se référant toujours aux théories de Süßmilch comme paradigme de leur pensée.
En même temps que Zincke et Hanow introduisaient les concepts de Süßmilch dans le domaine caméraliste, on observe des appels croissants à une action plus directe pour le progrès de la population. Le concept le plus frappant fut celui de l’écrivain de Francfort Johann Michael von Loën (1694-1776), grand-oncle de Goethe. Il publia en 1748 son Entwurf einer Staats-Kunst, Worinn die natürliche Mittel endecket werden, ein Land mächtig, reich, und glücklich zu machen (Essai sur l’habileté politique révélant les instruments pour rendre un État puissant, riche et heureux). Malgré ce long titre, Loën se concentrait sur un seul thème : la croissance de la population. Selon lui, c’est finalement la taille de la population qui est la base essentielle du pouvoir de l’État et du bonheur de son peuple (Loën, 1751, p. 3). Cela n’avait rien d’extraordinaire à l’époque. Mais Loën dépassait ses pairs en transcendant la théorie économique de la population et son mécanisme indirect, et en optant pour une intervention directe de l’État dans l’administration des mariages. Son but était double. Il voulait accroître le nombre des mariages, pensant que c’était le seul moyen d’accroître la population. Il comparait le souci que le prince avait du mariage de ses sujets au soin qu’on a d’une forêt en prévoyant de favoriser les jeunes pousses (Loên, 1751, p. 20). Son second objectif était d’empêcher les mariages biologiquement préjudiciables. D’une façon inconnue alors, Loën tempêtait contre les mariages des infirmes qui ne pouvaient engendrer que des enfants fragiles et handicapés. Ces mariages devaient donc être interdits par des com-missions locales. Ce projet de restreindre l’accès au mariage sur une base biologique eut quelques échos. Johann Albrecht Philippi, qui sera ensuite directeur de la police de Berlin, évoqua les propositions de Loën dans son propre traité sur L’agrandissement d’un État. L’obligation d’un examen médical prénuptial lui apparut « farfelue » (Philippi, 1753, p. 28). Il est à noter que dans ce débat, aucun des auteurs n’utilisait d’arguments statistiques, ni de concepts démographiques comme l’âge moyen au mariage, les taux de natalité ou de mortalité. C’est pourquoi leurs arguments respectifs et en particulier le pro-gramme interventionniste de Loën apparaissaient plutôt vagues. Il en irait autrement quand l’idée de politique directe de population se combinerait au pouvoir argumentatif des données et des idées de Süßmilch sur le développe-ment de la population.
JOHANN PETER SÜßMILCH : DE LA LOI DIVINE À L’INTERVENTION HUMAINE
711
Cette association fut le fait de Johann Heinrich Gottlob von Justi (1717-1771), le plus grand caméraliste allemand du milieu du XVIIIe siècle (Tribe, 1988, p. 55-64 ; Wakefield, 2009, p. 81-110). Dans l’histoire de la démographie, Justi est surtout connu comme l’opposant à Süßmilch dans le débat sur les taux de mortalité des villes et des campagnes (Bonar, 1931, p. 52). On néglige sou-vent le fait qu’en combattant le pasteur berlinois, Justi faisait passer le raison-nement démographique dans le discours caméraliste. Le débat généra un large intérêt ; les démographes se mirent à juste titre du côté de Süßmilch mais Justi y gagna la reconnaissance en tant qu’expert des études de population (voir Bergius, 1767, p. 282). Dans le même temps, l’implication de Süßmilch dans le débat ainsi que ses arguments témoignaient de son intérêt pour le discours économique et politique allemand, tel qu’il l’avait développé dans la décennie précédente. En janvier 1756, Justi publia un bref article sur l’intérêt des listes de décès pour l’établissement de Policey dans sa propre revue à Göttingen. Comme Süßmilch et Hanow avant lui, il déclarait que ces listes permettaient d’observer la bienveillance et la providence divines. Mais Justi ajoutait : « Ce n’est pourtant pas notre intention dans l’immédiat. » (Justi, 1756, p. 1) Suivant la ligne directrice de sa revue, il chercherait seulement le bon usage des registres de naissances et décès pour l’administration publique. Justi identifiait six domaines d’utilité, de portée inégale. Le ravitaillement en cas de guerre ou de famine serait simplifié, le taux de mortinatalité informerait sur la qualité des sages-femmes, la connaissance des causes de décès aiderait les assemblées médicales, et le taux de natalité hors mariage joint au nombre de décès de jeunes hommes causés par les excès de boissons et de fêtes renseignerait sur la santé morale des gens. Mais le principal bénéfice à tirer des listes serait de donner au gouvernement la connaissance de la situation démographique à travers son territoire. Ils indiqueraient également si les disparités régionales étaient dues à des qualités naturelles, à la négligence des administrateurs locaux, ou à « certaines erreurs dans la constitution du gouvernement. » (Justi, 1756, p. 5) La « sagesse du gouvernement » trouverait ensuite les moyens appropriés pour peupler les régions déficitaires.
À l’époque, Justi n’en dit pas davantage sur ces instruments de politique de population. C’est seulement treize ans plus tard qu’il publiera anonymement son fameux (et infâme) Physicalische und Politische Betrachtungen über die Erzeugung des Menschen und Bevölkerung der Länder (Considérations physiques et politiques sur la procréation des hommes et la population des pays) dans lequel il compare la production des hommes à l’élevage des moutons, des bœufs et des chevaux (Justi, 1769, p. 59 sq.). Mais déjà dans les années 1750, il écrivait à propos de l’impact des lois et coutumes matrimoniales sur la taille de la population. Deux hypothèses sous-tendaient tous ses écrits : le bien-être de l’État et des gens dépend de la croissance de la population, et tous les pays d’Europe pourraient au moins quadrupler leur population sans compromettre leur capacité à nourrir tous les habitants (Justi, 1757a). Ces hypothèses avaient déjà cours, mais Justi en renouvela le contenu en les liant à la hausse systéma-
J. NIPPERDEY
712
tique du taux global de nuptialité. Dans son livre sur le mariage, Justi s’en prend à des notions à la fois catholiques et protestantes, en faisant du mariage un simple contrat civil et en aucun cas une affaire spirituelle (Justi, 1757b, p. 34). Il réfutait en outre le concept essentiellement protestant selon lequel l’assistance mutuelle était l’une des fonctions principales du mariage. Pour Justi, la procréation était son seul véritable objet. À ses yeux, les Romains avaient fondé leurs lois matrimoniales sur cette règle, que les chrétiens avaient perdue de vue. En fin de compte, Justi transformait le mariage en un instrument aux mains du gouvernement pour peupler le pays (Justi, 1757b, p. 69). Aussi la promotion du mariage ne devait-elle s’adresser qu’aux couples capables d’avoir des enfants. Les mariages de personnes âgées ou malades ne devaient pas être autorisés, puisqu’ils ne pouvaient conduire à la procréation (Justi, 1757b, p. 83).
Justi n’était pas le premier à prendre ses modèles de politique de popu-lation dans l’Antiquité. La procédure était courante chez les universitaires du XVIIe siècle de traiter les questions de population dans leurs grands com-pendiums latins de politique. Mais cette tradition fut interrompue à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Le modèle romain de lois matrimoniales coercitives ne joua aucun rôle chez les auteurs économiques qui devinrent les principaux protagonistes du discours sur la population. Contraindre les gens à se marier n’aurait pas eu de sens pour eux qui adhéraient totalement à l’idée selon laquelle la taille de la population ne dépend que des conditions économiques. C’est seulement au milieu du XVIIIe siècle que ce courant reprit de la vigueur, alimenté par l’optimisme des Lumières selon lequel il n’y avait pas d’obstacles de court terme à la croissance de la population, et par les nouvelles observations concernant le taux de nuptialité et l’âge moyen au premier mariage. Conjuguant ces deux perceptions, le soutien à la fécondité passait de façon évidente par un encouragement direct du mariage, et non par une promotion indirecte via l’amélioration des conditions de vie qui avait dominé le débat jusqu’alors. Un contributeur anonyme au magazine de Hanovre en 1759 poursuivit cette logique jusqu’à son terme (Anonyme, 1759) : il demanda que l’État paye tous ceux qui décidaient de se marier. L’État se devait de rétribuer tous ceux qui le servaient, écrivait-il. Or se marier et élever des enfants était le plus grand service possible rendu à l’État, il était donc évident que cette activité méritait salaire. L’État n’avait pas légiféré dans ce sens jusqu’à présent car il supposait qu’il y avait déjà assez d’incitations à se marier. Mais l’auteur conclut que l’hypothèse s’avérait fausse si on consi-dérait la taille de la population et la faible fréquence des mariages. Cet essai sur l’obligation pour l’État de rétribuer les couples qui se mariaient illustre le changement de paradigme dans le discours allemand sur la population dans les deux décennies autour de 1750, passant d’une intervention indirecte à une intervention directe sur le mariage et la procréation.
JOHANN PETER SÜßMILCH : DE LA LOI DIVINE À L’INTERVENTION HUMAINE
713
III. La participation de Süßmilch au discours caméraliste
Parallèlement aux changements dans les débats sur la politique de popu-lation, on peut retracer le développement des intérêts propres à Süßmilch à l’égard de questions politiques concrètes. Bien sûr, le théologien ne perdait pas de vue son projet « anthropo-théologique » d’origine, comme il le nommait lui-même (Süßmilch, 1756, p. 4). Le fait de réfléchir à la politique de population ne se substituait pas à ses préoccupations théologiques et statistiques, il ajoutait plutôt une autre dimension à son intérêt pour les questions de population auxquelles il avait été confronté après la publication de la première édition de L’Ordre divin. Son but premier restait l’identification des lois divines déterminant la population et leur meilleur calcul possible. Pour cela, il sollicita l’aide du célèbre mathématicien Leonhard Euler, qui était venu en 1741 à Berlin où il dirigeait la classe de mathématiques à l’Académie des sciences. En 1747, il démontra qu’il était mathématiquement possible que la terre soit peuplée des descendants d’un seul couple. Süßmilch lui ayant demandé de l’aider à calculer les temps de doublement des populations, il construisit ensuite un modèle mathématique rendant compte de l’évolution d’une population donnée (Girlich, 2007). Dans le même temps, Süßmilch continua de recueillir toutes les données statistiques disponibles pour sa deuxième édition.
Son intérêt naissant pour les utilisations politiques de ses résultats devint perceptible à la fin des années 1740, quand il présenta certaines de ses analyses à des réunions de l’Académie des sciences. Certains y virent la possibilité d’une interprétation politique de ses données. Dans une lettre au roi Frédéric II où il offrait ses services de conseiller sur les questions de population, Süßmilch indiquait que Maupertuis, président de l’académie, l’avait encouragé à rédiger un mémoire regroupant celles de ses observations pertinentes d’un point de vue politique (publié par Wilke, 1994, p. 193). Ce projet n’aboutit pas et Maupertuis écrivit une recommandation plutôt distante qui ne laissait pas entendre d’intérêt de sa part pour le sujet. Le roi déclina l’offre en disant en somme au pasteur de rester dans son domaine de compétences et de ne pas s’immiscer dans les affaires politiques (ibid., p. 198). De fait, ce bref échange marqua pour Süßmilch la fin de sa carrière de conseiller politique avant qu’elle ait commencé. Jean-Marc Rohrbasser qualifie le principal chapitre sur la poli-tique de population dans la deuxième édition de L’Ordre divin de « testament politique » d’un homme qui n’a jamais atteint la position de puissant conseiller politique dont il avait rêvé (Rohrbasser, 2001, p. 211). En fait, cette assertion pourrait s’appliquer à toutes les publications de Süßmilch sur le sujet, car c’est seulement après le refus du roi que le pasteur commença à édicter publiquement les lois de la bonne politique de population – prenant ainsi le parfait contrepied de sa démarche dix ans plus tôt.
Ce changement de point de vue fut exposé dans un texte sur la croissance rapide de la ville de Berlin, suscité par une préoccupation forte concernant les
J. NIPPERDEY
714
variations en cours de la population (Süßmilch, 1752)(11). À l’inverse de ses travaux précédents, il y spéculait explicitement sur les causes de certains des faits démographiques découverts, même s’il continuait de dire que « l’examen des causes (…) est en fait un peu éloigné de [s]es propres objectifs » (Süßmilch, 1752, p. 37). Süßmilch ne s’intéressait pas seulement aux causes de la croissance de Berlin, il était encore davantage intrigué par la hausse récente de la mortalité alors même que la ville avait été épargnée par les maladies épidémiques pendant cette période. Le statisticien concluait que l’augmentation de la population pauvre et les conditions sanitaires des quartiers où ils habitaient devaient être responsables de la hausse de la mortalité moyenne. Il faisait du développement de l’industrie textile dans la ville la raison principale de la multiplication des pauvres. Les nouvelles manufactures employaient en masse des travailleurs dont les salaires étaient si bas qu’ils ne pouvaient ni recourir à la médecine ni se reposer quand ils tombaient malades. Süßmilch savait par sa propre expé-rience que les structures traditionnelles d’assistance aux pauvres ne pouvaient pas faire face aussi rapidement au nombre croissant des démunis. En tant que pasteur de St. Petri, il était membre du « Directorat royal des pauvres » qui était responsable de l’approvisionnement des pauvres, des malades et des orphelins de Berlin (Dreitzel, 1986b, p. 371). Pour y faire face, le pasteur demanda que soient étendus l’assistance et les soins médicaux aux pauvres, en recourant à des arguments utilitaires : si « nous » – désignant les classes possédantes et l’État dans son ensemble – voulons tirer bénéfice de l’existence des pauvres, c’est-à-dire du produit de leur travail, « nous » devons nous soucier d’eux. Sans les ouvriers, les manufactures ne tourneraient pas. « Nous » ne devons donc pas les laisser devenir trop pauvres car ils s’affaibliraient et mour-raient même en des temps salubres (Süßmilch, 1752, p. 48).
C’était une nouvelle approche dans le discours politique et économique allemand de l’époque. Alors que le salariat et le niveau des rémunérations étaient des thèmes courants dans les discussions en Angleterre depuis plus d’un siècle (Coats, 1958 ; Dew, 2007), il n’en allait pas de même dans le Saint Empire romain. Le sujet du travail salarié y avait été négligé par le discours économique même s’il était présent, bien qu’à une plus petite échelle qu’en Angleterre. Des débats avaient souvent lieu sur l’assistance aux pauvres et les mesures administratives tant répressives que de soutien, mais ils ne s’étaient jamais concentrés sur un groupe spécifique de salariés de l’industrie comme c’était le cas dans les villes manufacturières anglaises dès le début du XVIIe siècle (Goose, 2006). Ainsi, Süßmilch, s’appuyant sur sa position d’expert en population, introduisit-il le concept de travailleurs pauvres dans le débat alle-mand. Il le fit de façon prudente vers 1750 en se félicitant de la croissance des industries manufacturières à Berlin, alors que ses réflexions sur leurs consé-quences sociales n’occupaient que quelques pages. Pourtant, un de ses analystes considéra qu’au-delà des données statistiques présentées, ses réflexions sur les
(11) Il avait déjà présenté ce texte à l’Académie royale des sciences en 1749.
JOHANN PETER SÜßMILCH : DE LA LOI DIVINE À L’INTERVENTION HUMAINE
715
ouvriers du textile constituaient la partie la plus intéressante du livre (Göttingische Zeitungen, 1752, p. 1051-1053).
Les années suivantes, le style et la force des arguments politiques de Süßmilch changèrent à mesure qu’il leur consacra davantage de place et d’éner-gie. Un bon exemple est sa réponse à l’attaque de Justi en 1756. Dans son texte sur les listes de décès, le caméraliste n’en avait pas seulement détaillé les intérêts possibles, il avait aussi critiqué les conclusions de Süßmilch sur le taux moyen de mortalité, en particulier dans les grandes villes. Le pasteur avait montré que pendant une année normale une personne sur trente mourait, mais que ce taux atteignait un sur vingt-cinq dans les villes, et un sur vingt dans les plus grandes. Justi prétendait au contraire que la mortalité dans son ensemble était d’un sur quarante, et seulement un sur soixante dans les grandes villes (Justi, 1756). De toute évidence, il ne s’agissait pas seulement de statistiques mais aussi d’orientation de la politique économique (Dreitzel, 1986a, 95 sq.). Justi plaidait pour des manufactures à grande échelle qui conduiraient à une croissance des villes comme centres de production. Le propos de Süßmilch selon lequel ces villes consommaient des hommes et dépeuplaient le pays portait atteinte au discours de Justi, car l’effet sur la population était de loin l’argument le plus convaincant dans les polémiques sur l’économie politique. Il répliqua donc en avançant au contraire que les villes se caractérisaient par une mortalité plus faible que les campagnes. Ce que Süßmilch réfuta dans une longue lettre ouverte en utilisant les matériaux qu’il recueillait depuis long-temps pour la nouvelle édition de L’Ordre divin (Süßmilch, 1756). Il ajouta même une autre lettre dans laquelle il commentait l’usage que Justi faisait des registres, alors qu’il n’y avait pas de désaccord entre eux sur ce point. Dans ces textes, le pasteur loue le patriotisme de son opposant et développe ses positions. Au contraire de ce qu’il avait écrit dans L’Ordre divin de 1741, il est maintenant très clair sur les raisons des écarts de fécondité : « la cause de ces différences réside dans la constitution politique des pays. » (Süßmilch, 1756, p. 6) Il répète ses arguments sur le rôle central de l’âge au mariage. Une fécondité générale faible indique un âge au mariage élevé et un taux global de couples mariés faible, et indique donc l’existence d’obstacles au mariage. Süßmilch suggère qu’un âge moyen au mariage tardif n’est pas un mauvais signe en soi ; il est plutôt le fait d’une région suffisamment peuplée. Dans le texte de 1756, il se contente de suggérer que le dépassement de cette limite à la croissance de la population pourrait résulter de l’introduction de cultures exigeant beaucoup de main-d’œuvre, à l’image de ce que faisait la loi agraire romaine en créant de petites fermes (Süßmilch, 1756, p. 46 sq.). Il reviendra largement sur ces problèmes dans la seconde édition de L’Ordre divin en donnant à l’impact humain une place nouvelle et prééminente dans son système.
Deux ans après sa querelle avec Justi, le pasteur revint sur la question sociale qui accompagnait la croissance des industries et des villes. Le cadre était de nouveau sa ville de Berlin qui avait été frappée par une maladie
J. NIPPERDEY
716
épidémique l’année précédente (Süßmilch, 1758). Süßmilch démontre d’abord que 1757 a bien été une année d’épidémie et de forte mortalité, ce qui n’avait pas été nécessairement reconnu car il n’y avait pas eu de maladie massive. Dans une deuxième partie, il détermine les maladies ayant produit la plus forte mortalité dans l’année en analysant les certificats de décès, avant de finalement se pencher sur les causes probables de cette forte mortalité dans la troisième partie. Il est d’avis que ces causes doivent être cherchées dans le domaine économique et social. Contrairement aux autres épidémies, la mort n’a pas frappé indistinctement cette fois tous les quartiers de la ville. Les parties anciennes où habitent les riches n’ont pas été touchées, alors que ce sont les quartiers des tisseurs et des fileurs qui ont le plus souffert. La mort en 1757 tient donc à des facteurs sociaux plutôt que médicaux, ce qui correspond à sa thèse de 1752 sur les conditions de vie des ouvriers du textile et leur impact sur la mortalité. Süßmilch s’efforce de fournir une preuve indéniable à ce qui n’avait été précédemment que général et spéculatif. Il analyse méthodiquement toutes les causes possibles de forte mortalité qui ont été discutées publiquement et en conclut que la première cause fut sans hésitation la disette de cette année (Süßmilch, 1758, p. 50). Les salaires des travailleurs étant fixes, ceux-ci ont perdu tout leur pouvoir d’achat dans la hausse des prix alimentaires. Süßmilch reconnaît que la souffrance des ouvriers du textile est l’inévitable contrepartie de la prospérité des manufactures (Süßmilch, 1758, p. 53). Il n’offre pas de véritable solution au problème en déclarant qu’il est impossible de relever les salaires sans détruire les industries qui font la richesse de la ville. À la place, il fait appel à une nouvelle forme de charité privée, de sorte que la richesse acquise grâce aux manufactures vienne alléger la détresse des ouvriers.
Dans les années 1750, Johann Peter Süßmilch s’engagea de plus en plus dans les débats sur la politique sociale et économique en utilisant comme arguments puissants ses analyses démographiques. Son implication a deux origines. D’une part, son intérêt personnel pour la recherche des causes effec-tives de chacune des particularités démographiques observées. C’est cet intérêt qui l’avait conduit à établir le taux de mortalité des ouvriers du textile et à dénoncer la responsabilité du système des manufactures. D’autre part, la popu-larité croissante de ses premiers résultats et de ses méthodes auprès des auteurs caméralistes le poussait à participer à ce débat, à clarifier ses conclusions et à introduire quelques-unes de ses nouvelles idées, en particulier celles concer-nant les possibilités d’agir sur les processus démographiques. C’est pourquoi l’évolution du discours caméraliste allemand suscitée par les travaux de Süßmilch et son propre glissement vers une approche plus politique eurent lieu au même moment, mouvement peut-être accentué par l’échec de sa tentative d’exercer un pouvoir politique auprès de la cour de Prusse. Cette démarche culmina avec la deuxième édition de L’Ordre divin, dans laquelle l’auteur présenta son propre modèle de développement économique et démographique pour l’État allemand.
JOHANN PETER SÜßMILCH : DE LA LOI DIVINE À L’INTERVENTION HUMAINE
717
IV. La deuxième édition de L’Ordre divin :un manuel pour la politique de population
Dans sa nouvelle édition de 1761-1762, L’Ordre divin est passé de 446 à 1 415 pages en deux volumes. Non seulement la taille a changé, mais aussi le contenu. L’ augmentation du nombre de pages résulte en partie de la collecte de données supplémentaires par Süßmilch. En outre, le livre contient mainte-nant de longues descriptions de politiques de population à proprement parler, qui étaient totalement absentes en 1741. Süßmilch débute le premier volume en déroulant la séquence du développement de la population à travers neuf chapitres (I-IX). Bien qu’il ait considérablement élargi sa base de données et affiné certains de ses arguments, ses concepts fondamentaux demeurent inchangés. La partie démographique est suivie de cinq chapitres (X-XIV) sur le devoir qu’a le prince de peupler son pays et les quatre règles d’or qu’il devrait suivre pour y aboutir. Le second volume contient une discussion de différents sujets et de leurs effets favorables ou défavorables à la croissance de la popu-lation (chapitres XV-XIX), avant que l’auteur revienne à des questions statis-tiques comme la population mondiale ou la proportion d’hommes et de femmes (chapitres XX-XXV). Cette division approximative entre parties démographiques et politiques a pour but de souligner la prééminence nouvelle des politiques de population dans L’Ordre divin, puisqu’il n’y était pas consacré le moindre chapitre spécifique dans la première édition. En réalité, bien sûr, les résultats et les arguments statistiques et politiques sont beaucoup plus étroitement entrelacés que ne le suggère ce découpage. D’une part, les neuf premiers cha-pitres indiquent déjà amplement les implications politiques des divers résultats démographiques, alors que d’autre part, les avis politiques sont encore et encore appuyés sur de nouvelles données provenant de toute l’Europe.
Dans l’introduction, Süßmilch justifie par avance son intérêt nouveau pour la politique de population. Certains, dit-il, l’ont déjà critiqué pour s’être « laissé aller à trop de considérations politiques » (Süßmilch, 1761-1762/1979, vol. II, p. 301) lorsqu’ils ont vu les révisions. Süßmilch répond par une question rhé-torique : aurait-il dû taire des vérités qui émanent de l’observation de l’ordre divin, et est-il déplacé pour un théologien de tirer directement de la parole de Dieu la vraie politique et la sagesse de gouverner ? En reconnaissant que cette focalisation sur les conséquences de sa recherche pour le monde est nouvelle, le pasteur montre bien qu’il est conscient de cette transformation fondamentale dans son œuvre.
L’importance donnée à l’influence anthropogénique sur le développement de la population met au défi le concept même d’ordre divin, puisqu’il s’appuyait sur l’hypothèse d’une loi universelle maintenant toutes les populations du monde sur la même voie. Il y avait là un problème épistémologique, puisque la preuve de l’existence de cette loi se trouvait dans les similitudes entre populations, les différences étant minimisées et considérées comme insignifiantes. Or Süßmilch se concentre maintenant sur ces différences. Il traite le problème de manière
J. NIPPERDEY
718
pragmatique. Dans un monde parfait, déclare-t-il, le taux de nuptialité serait à peu près le même partout. Mais en réalité, il existe de nombreux désordres dans la reproduction, dus aux spécificités des États et des sociétés, qui interfèrent avec l’ordre naturel sans le détruire. Il reste donc possible de discerner l’ordre divin, tout en identifiant les écarts locaux au parcours prescrit (Süssmilch, 1761-1762/1979, vol. II, p. 345 ; 1761-1762, vol. 1, p. 208-210). Parallèlement, cet argument permet de présenter toutes les recommandations aux hommes politiques comme un moyen d’assurer l’indispensable retour vers l’ordre naturel. Les ignorer serait non seulement une folie politique, mais un défi au dessein de Dieu. Aussi, dans les chapitres explicitement consacrés à la politique de population, Süßmilch recourt-il à des argumentations longues et parfois fastidieuses pour prouver qu’un gouvernement devrait toujours accroître sa population en suivant quatre règles générales : (1) lever tous les obstacles qui freineraient ou retarderaient le mariage ; (2) lever tous les obstacles à la fécondité des couples mariés, essentiellement en leur donnant des conditions de vie favorables ; (3) préserver la vie de tous les habitants, essentiellement par des mesures sanitaires ; (4) permettre à tous les habitants de rester au pays et stimuler l’immigration (Süssmilch, 1761-1762/1979, vol. II, p. 402-403). Ce programme politique n’a rien d’exceptionnel en 1761. La plupart des arguments et des propositions de Süßmilch furent universellement acceptés par les économistes politiques dans toute l’Europe. Le point qui distinguait L’Ordre divin des traités caméralistes est toujours l’argument statistique apparu dans les années 1750.
C’est par le biais d’un de ses résultats statistiques que Süßmilch introduisit une de ses idées les plus originales sur la nature de la politique de population, thème qu’il avait déjà abordé dans sa réponse à Justi en 1756. En analysant le développement de ses indicateurs démographiques les plus significatifs, il constata que le taux de nuptialité avait chuté dans toute l’Allemagne depuis le début du siècle. Ce constat aurait désolé tout auteur caméraliste, mais pas Süßmilch qui y vit au contraire que les campagnes allemandes reprenaient leurs forces après les ravages infligés par les guerres du XVIIe siècle. La forte croissance de la population de l’immédiat après-guerre avait ensuite considé-rablement faibli, car le nombre de gens qui pouvaient vivre sur la terre était limité. La faible nuptialité « n’est pas un signe maléfique, mais un signe béné-fique » (Süßmilch, 1761-1762/1979, vol. II, p. 349). Le jeune Süßmilch s’en serait probablement tenu là, considérant qu’il avait suffisamment expliqué un fait démographique, mais il continuait désormais sa recherche pour savoir si c’était effectivement la fin de l’histoire. Même si la population avait fait tout son pos-sible pour avoir des conditions de vie décentes, ne serait-il pas envisageable de créer de nouvelles conditions qui revigoreraient la croissance de la popu-lation (Süßmilch, 1761-1762/1979, vol. II, p. 350) ? Le pasteur répond solen-nellement : si la population avait atteint son maximum dans le « cadre d’une administration et d’une économie de bon père de famille », il revient au prince de réfléchir aux façons de changer le système (Süßmilch, 1761-1762/1979, vol. II, p. 353). Contrairement à la plupart des caméralistes, ce changement de système
JOHANN PETER SÜßMILCH : DE LA LOI DIVINE À L’INTERVENTION HUMAINE
719
ne signifiait pas pour Süßmilch l’expansion des manufactures. Opposé aux grandes villes et aux manufactures, il s’intéressait surtout à la possibilité d’ac-croître les emplois dans le secteur agraire.
Malgré cela, l’auteur montra les bienfaits que pouvaient apporter les usines, c’est-à-dire essentiellement les manufactures textiles proto-industrielles, en calculant le nombre de travailleurs employés, leurs salaires et le gain financier total pour le pays (Süßmilch, 1761-1762, vol. 2, p. 46-53). Il eut recours pour la première fois à la dimension économique de l’arithmétique politique en essayant de calculer des interrelations économiques. À côté de ses bienfaits évidents, l’industrie manufacturière présentait des inconvénients selon Süßmilch. Elle pouvait attirer les travailleurs hors de l’agriculture, y causant une baisse des rendements. Il était aussi préoccupé de la précarité de l’industrie soumise aux cycles économiques internationaux. Une suspension des importations de coton en provenance de Turquie ferait chuter l’industrie et laisserait des milliers de travailleurs affamés et mourants (Süßmilch, 1761-1762/1979, vol. II, p. 470-471). D’un point de vue démographique, les effets potentiellement néfastes de l’industrie étaient aggravés par la localisation fréquente des manufactures dans les grandes villes, où les taux de mortalité étaient élevés. Des princes avisés devraient répartir entre différents lieux les installations qui entraînent une croissance de la population, créant ainsi un réseau de villes bien peuplées à travers le pays plutôt que de développer une énorme capitale (Süßmilch, 1761-1762/1979, vol. II, p. 342).
Contrairement à l’industrie, une intensification de l’agriculture laissait espérer une croissance durable de l’emploi et de la population. À nouveau, Süßmilch développa longuement une idée qu’il avait évoquée en à peine trois phrases quelques années plus tôt. Il consacra cette fois un chapitre entier de quarante pages à ses réflexions sur les mérites démographiques de l’agriculture en général et des lois agraires de Rome en particulier. Alors que les nouvelles sociétés agraires dans le troisième quart du XVIIIe siècle introduisaient de nouvelles techniques et de nouvelles cultures, Süßmilch se concentra sur les réformes structurelles de la société agraire. Il s’attachait à la répartition des terres qu’il jugeait néfaste à la croissance de la population. Plutôt que de créer de grandes propriétés foncières, les terres devraient être réparties entre des petits fermiers qui les cultiveraient plus efficacement. Même le domaine princier devrait être aboli et alloué à des fermiers, comme l’étaient les terrains commu-naux, car seuls ceux qui sont propriétaires de la terre qu’ils exploitent sont susceptibles d’en accroître la productivité. Pour la même raison, tous les droits féodaux devraient être abolis comme autant d’obstacles à une production effi-cace. À partir d‘arguments démographiques, Süßmilch demandait l’abolition du régime de propriété foncière en vigueur dans les États allemands.
Il n’était pas le premier à exprimer ces idées sur les relations entre la popu-lation et le système de propriété foncière. Son principal inspirateur était l’auteur français Ange Goudar (1708-1791), protagoniste essentiel d’un groupe d’agra-riens prédécesseurs des physiocrates (Hasquin, 2008, p. 175 ; Spengler, 1954,
J. NIPPERDEY
720
64 sq.). Süßmilch citait généreusement Les intérêts de la France mal entendus de Goudar (1756). Le pasteur allemand développait l’argument en le renforçant par une information érudite sur les lois agraires à Rome et par ses propres calculs démographiques. Et c’est Süßmilch, en collaboration cette fois avec Justi, qui introduisit le concept de réforme foncière comme condition nécessaire à la croissance de la population dans le discours caméraliste allemand(12). Le raisonnement de Süßmilch allait devenir un argument régulier chez les camé-ralistes quand ceux-ci eurent combiné en un seul courant les deux sources de leur discours académique, les écrits sur la politique économique et sur l’élevage (Garner, 2005, p. 144-146). L’Ökonomische Encyklopädie de Johann Georg Krünitz (1728-1796) présentera cette thèse comme partagée par tous dans son article de 1773 sur les fermes et le système de propriété foncière (Krünitz, 1774). La critique par Süßmilch de l’expansion prématurée des manufactures ne réussit pas à infléchir le discours des caméralistes. Ceux-ci tenaient leurs bienfaits pour indiscutables. À partir de 1760, le progrès de l’agriculture en général et le sujet de la réforme foncière en particulier devinrent le second pilier du raisonnement économique caméraliste. Il serait exagéré d’attribuer ceci à la seule influence de Süßmilch. Il fut néanmoins l’un des penseurs à inscrire le sujet à l’ordre du jour. Il fournit en outre aux tenants de la réforme des arguments quantifiables, qui avaient pris un énorme pouvoir de persuasion au cours de la décennie précédente.
Conclusion
Un examen attentif des différentes éditions de L’Ordre divin révèle à la fois l’évolution des intérêts personnels de Süßmilch et la transformation du discours allemand sur l’économie et la population entre 1740 et les années 1760. Les deux développements furent étroitement liés. Dans sa publication d’origine, la démonstration physico-théologique régnait sans partage et le pasteur ne se souciait pas des implications politiques de ses résultats. Il présenta pourtant involontairement dès 1741 des points de départ à la mise en œuvre d’une poli-tique de population. Malgré quelques recensions immédiates, il fallut une décennie pour que les méthodes et les conclusions de Süßmilch commencent à pénétrer le discours caméraliste. Le texte de Justi sur l’intérêt des listes de décès eut une importance cruciale pour ce développement. Tout en critiquant certaines des thèses centrales de Süßmilch, le caméraliste le plus connu de son temps adopta avec enthousiasme le raisonnement fondé sur des indicateurs de population. L’influence de Süßmilch s’exerça ainsi davantage sur le mode d’ar-gumentation que sur les résultats démographiques proprement dits. Une faute d’impression mineure mais significative dans un livre de 1759 illustre la nou-veauté de cette approche. Il y était dit que Süßmilch avait présenté ses remarques
(12) Justi changea d’avis sur le sujet vers 1760. À partir de cette date, il encouragea le démantèlement
JOHANN PETER SÜßMILCH : DE LA LOI DIVINE À L’INTERVENTION HUMAINE
721
concernant la « moralité » de l’année précédente (Physikalisch-oekonomische Auszüge, 1759, p. 300). Nous ne savons pas si l’omission du ‘t’ était le fait des éditeurs ou des imprimeurs, mais l’épisode montre que la mortalité commençait à peine à devenir un concept majeur auprès de ce public.
Au fur et à mesure que ses méthodes et ses résultats devenaient connus, Süßmilch reprit les questions économiques et politiques qu’il avait largement négligées jusqu’alors. Il fut influencé en cela par divers facteurs. Premièrement, son échec à devenir le conseiller du roi peut avoir stimulé son désir de publier ses idées politiques. Par ailleurs, la réception de son livre par les caméralistes et sa controverse avec Justi aiguisa son intérêt pour les auteurs économiques allemands qu’il avait largement ignorés jusqu’en 1750. Deuxièmement, il conti-nua à suivre les débats économiques internationaux, en particulier français, qui tournaient plus ou moins autour de l’agriculture et de son rôle dans la vie économique d’une nation. Même si Süßmilch n’était pas physiocrate, la valeur qu’il attachait à l’agriculture influençait ses conceptions de la société et de l’économie. Troisièmement, ses charges de pasteur et d’inspecteur de la charité dans une ville en expansion, Berlin, affinèrent sa compréhension du fonction-nement de l’économie proto-industrielle. Enfin, un autre facteur doit être pris en compte : aux yeux de Süßmilch, l’existence d’un ordre divin avait été établie sans laisser place au doute. Les réactions suscitées par son ouvrage dans toute l’Europe et sa base de données constamment enrichie lui confirmaient la per-tinence de ses thèses quantitatives et de sa théorie sous-jacente. Il pouvait donc en venir aux aspects terre-à-terre de la recherche démographique dans sa deuxième édition et s’appuyer sur sa réputation pour promouvoir un type spécifique de politique économique et démographique, à la fois conservatrice et progressiste. Son adoption enthousiaste de l’idée d’une réforme foncière eut un impact réel sur le discours caméraliste. Ainsi, Süßmilch ne se contenta pas de ressentir l’influence des auteurs économiques sur les politiques de popula-tion, il participa à son tour à leurs débats. Il le fit cette fois délibérément, contrairement à ce qui s’était passé en 1741.
J. NIPPERDEY
722
RÉFÉRENCES
ANONYME, 1759, « Der Staat ist zu den jetzigen Zeiten schuldig, denen, die sich verhey-rathen, Besoldungen auszusetzen », Hannoverische Beyträge zum Nutzen und Vergnügen, 1, p. 1409-1446.
ARISAWA H., 1979, « La loi des grands nombres et le calcul des probabilités dans la première édition de l`”Ordre divin“ », in Hecht J. (dir.), Johann Peter Süssmilch (1707-1767) « L’Ordre divin ». Aux origines de la démographie, vol. I, Paris, Ined, p. 23-31.
BERGIUS J. H. L., 1767, Policey- und cameral-magazin, vol. 1, Frankfurt am Main, Andreä.
BÖLDICKE J., 1746, Abermaliger Versuch einer Theodicee, Berlin/Leipzig, Haude und Spener.
BONAR J., 1931, Theories of Population from Raleigh to Arthur Young, New York, Greenberg, 253 p.
BRÜCKNER J., 1977, Staaatswissenschaften, Kameralismus und Naturrecht. Ein Beitrag zur Geschichte der Polititschen Wissenschaft im Deutschland des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts, München, Beck, 323 p.
CIPOLLA C. M., 1974, « The plague and the Pre-Malthus Malthusians », The Journal of European Economic History, 3, p. 277-284.
COATS A. W., 1958, « Changing attitudes to labour in the mid-eighteenth century », Economic History Review, 11(1), p. 35-51.
CONRING H., 1730, « Examen rerum publicarum potiorum totius orbis », in Goebel J. W. (ed.), Hermann Conring Opera, Vol. IV, Braunschweig, Meyer.
DEW B., 2007, « Political economy and the problem of the plebs in eighteenth-century Britain », History Compass, 5(4), p. 1214–1235.
DÖHLER P. J. F., 1744, Gründliche Entdeckung Einer Wohleinzurichtenden und glück-seeligen Republik, Regensburg, Seiffart.
DREITZEL H., 1986a, « J. P. Süßmilchs Beitrag zur politischen Diskussion der deutschen Aufklärung », in Birg H. (ed.), Ursprünge der Demographie in Deutschland. Leben und Werk Johann Peter Süßmilchs (1707-1767), Frankfurt/New York, Campus, p. 29-141.
DREITZEL H., 1986b, « Anmerkungen zur Schrift ‘Gedanken von den epidemischen Kranckheiten...’ », in Birg H. (ed.), Ursprünge der Demographie in Deutschland. Leben und Werk Johann Peter Süßmilchs (1707-1767), Frankfurt /New York, Campus, p. 343-402.
DUCREUX M.-E., 1977, « Les premiers essais d’évaluation de la population mondiale et l’idée de dépopulation au XVIIe siècle », Annales de démographie historique, p. 421-438.
EGERTON F. N., 1966, « The longevity of the patriarchs. A topic in the history of demo-graphy », Journal of the History of Ideas, 27, p. 575-584.
ELSNER E., 2000, « Fakten zu Leben und Werk des Vaters der deutschen Statistik Johann Peter Süßmilch (1707-1767) », Statistische Monatsschrift, 7(12), p. 270-284.
FUHRMANN M., 2002, Volksvermehrung als Staatsaufgabe? Bevölkerungs- und Ehepolitik in der deutschen politischen und ökonomischen Theorie des 18. und 19. Jahrhunderts, Paderborn, Schöningh, 458 p.
JOHANN PETER SÜßMILCH : DE LA LOI DIVINE À L’INTERVENTION HUMAINE
723
GARNER G., 2005, État, économie, territoire en Allemagne. L̀ espace dans le caméralisme et l’économie politique 1740-1820, Paris, EHESS, 436 p.
GIRLICH H.-J., 2007, Süßmilch und Euler – zwei kooperierende Stammväter der Demographie in Deutschland, Leipzig, 16 p., www.math.uni-leipzig.de/preprint/2007/p5-2007.pdf
GOOSE N., 2006, « The rise and decline of philanthropy in early modern Colchester: The unacceptable face of mercantilism? », Social History, 31(4), p. 469-487.
GÖTTINGISCHE ZEITUNG VON GELEHRTEN SACHEN, 1752. HANOW M. C., 1753, Seltenheiten der Natur und Oekonomie, vol. 1, Leipzig, Lankisch.
HASQUIN H., 2008, « L’anticléricalisme économique au XVIIIe siècle à propos du monachisme et de la dîme », in Hasquin H. (dir.), Population, commerce, et religion au siècle des Lumières, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, p. 169-185.
HECHT J., 1980, « Johann Peter Sussmilch (1707-1767). Aux origines de la demographie : L’ «Ordre divin» », Population, 35(3), p. 667-677.
HECHT J., 1998, Préface, in Süßmilch, 1741, L’ordre divin das les changements de l’espèce humaine, démontré par la naissance, la mort et la propagation de celle-ci, traduit par Rohrbasser J.-M., Paris, Ined, p. IX-XXIV.
HORVÁTH R. A., 1979, « Aux sources de la statistique allemande », Annales de démo-graphie historique, p. 157-163.
JAUMANN H., 2004, Handbuch Gelehrtenkultur der Frühen Neuzeit, vol. 1, Berlin/New York, de Gruyter.
JUSTI J. H. G. VON, 1756, « Von dem Nutzen der Todtenregister in denen Policeyanstalten », Göttingische Policey-Amts Nachrichten, 2, p. 1-3, 5-7, 9-11.
JUSTI J. H. G. VON, 1757a, « Von dem grossen Einflusse der Ehegesetze in die Bevölkerung und in die Glückseeligkeit des Staats », Göttingische Policey-Amts Nachrichten, 3, p. 77-91.
JUSTI J. H. G. VON, 1757b, Rechtliche Abhandlung von denen Ehen, Leipzig, Breitkopf.
JUSTI J. H. G. VON, 1761, Abhandlungen von der Vollkommenheit der Landwirthschaft und der höchsten Cultur der Länder, Leipzig, Gaum.
JUSTI J. H. G. VON, 1769, Physicalische und Politische Betrachtungen über die Erzeugung des Menschen und Bevölkerung der Länder, Smirna [i.e. Breslau].
KRÜNITZ, 1774, « Bauern-Güter », Oeconomische Encyclopädie, Vol. 3, p. 768-794.
LILIENTHAL T. C., 1760, Die gute Sache der in der hl. Schrift Alten und Neuen Testaments enthaltenen göttlichen Offenbarungen, Vol. 1, 2e ed., Königsberg, Hartung.
LOËN J. M. VON, 1751, Entwurf einer Staats-Kunst, Worinn die natürliche Mittel endecket werden, ein Land mächtig, reich, und glücklich zu machen, 3e ed., Frankfurt/Leipzig, Fleischer.
MCCORMICK T, 2009, William Petty and the Ambitions of Political Arithmetic, Oxford, Oxford University Press, 347 p.
PEARSON K., 1978, The History of Statistics in the 17th and 18th Centuries against the Changing Background of Intellectual, Scientific and Religious Thought, New York, Macmillan, 744 p.
PETTY W., 1690, Political Arithmetick, London, Clavel.
PHILIPPI J. A., 1753, Die wahren Mittel zur Vergrößerung eines Staats, Berlin, Haude/Spener.
PHYSIKALISCH-OEKONOMISCHE AUSZÜGE, 1759, Vol. 2, Stuttgart, Mezler.
REUNGOAT S., 2004, William Petty : observateur des îles Britanniques, Paris, Ined, 341 p.
RICHTER J. G., 1754, Ichthyotheologie, Leipzig, Lankisch.
J. NIPPERDEY
724
RODRÍGUEZ M. M., 1985, « Giovanni Botero y el sentimiento de despoblación en la España de la primera mitad del Siglo XVII », Revista internacional de sociología, 43, p. 411-427.
ROHRBASSER J.-M., 1996, « Comment un théologien devient « démographe ». Présentation de J.-P. Süßmilch, de ses lecteurs et de sa méthode », Population, 51(4-5), p. 979-1003.
ROHRBASSER J.-M., 2001, « Süßmilch et Frédéric II : Le sceptique et le ministre de la providence, in Damien R. (dir.), L’Expertise. Annales littéraires de l’Université de Franche-Comté, Besançon, Presses universitaires franc-comtoises, p. 197-223.
ROHRBASSER J.-M., 2002, « Qui a peur de l’arithmétique? Les premiers essais de calcul sur les populations dans la seconde moitié du XVIIe siècle », Mathématiques et sciences humaines, 159, p. 7-41.
ROSEN G., 1953, « Cameralism and the concept of medical police”, Bulletin of the History of Medicine, 27, p. 21-42.
RUSNOCK A., 2002, Vital Accounts. Quantifying Health and Population in Eighteenth-Century: England and France, Cambridge, Cambridge University Press, 249 p.
SEIFERT A., 1980, « Staatenkunde – eine neue Disziplin und ihr wissenschaftstheo-retischer Ort », in Rassem M., Stagl J. (eds.), Statistik und Staatsbeschreibung in der Neuzeit. Vornehmlich im 16.-18. Jahrhundert, Paderborn, München, Schöningh, p. 217-244.
SEIFERT A., 1983, « Conring und die Begründung der Staatenkunde », in Stolleis M. (ed.), Hermann Conring (1606-1681). Beiträge zu Leben und Werk, Berlin, Duncker und Humblot, p. 201-216.
SIEFERLE R.-P., 1990, Bevölkerungswachstum und Naturhaushalt. Studien zur Naturtheorie der klassischen Ökonomie, Frankfurt am Main, Suhrkamp.
SLACK P., 2004, « Government and information in seventeenth-century England », Past & Present, 184, p. 33-68.
SPENGLER J. J., 1954, Économie et population. Les doctrines françaises avant 1800 : de Budé à Condorcet, Paris, Ined/Puf, Cahier n° 21, 389 p.
STREIDL P., 2003, Naturrecht, Staatswissenschaften und Politisierung bei Gottfried Achenwall (1719-1772), München, Utz, 315 p.
SÜßMILCH J. P., 1741, Die göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts, aus der Geburt, Tod und Fortplanzung desselben erwiesen, Berlin, Spener, traduit en français par Rohrbasser J.-M., 1998, L’ordre divin dans les changements de l’espèce humaine, démontré par la naissance, la mort et la propagation de celle-ci, Paris, Ined, 358 p .
SÜßMILCH J. P., 1752, « Abhandlung von dem schnellen Wachsthum der Königl. Residentz Berlin, o. O. 1752 », in Süßmilch J. P., 1994, Die königliche Residenz Berlin und die Mark Brandenburg im 18. Jahrhundert. Schriften und Briefe, Berlin, Akademie, Jürgen Wilke, p. 15-48.
SÜßMILCH J. P., 1756, Die Göttliche Ordnung (…) durch einige Beweißthümer bestätiget, Berlin, Haude und Spener.
SÜßMILCH J. P., 1758, Gedancken von den epidemischen Kranckheiten und dem grösseren Sterben des 1757ten Jahren, o. O., Berlin, Haude und Spener.
SÜßMILCH J. P., 1761-1762, Die göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts, aus der Geburt, dem Tode und der Fortplanzung desselben erwiesen, 2 vols., Berlin, Verlag des Buchladens der Realschule, traduit en français par Kriegel M., complété avec des études et commentaires sous la direction de Hecht J., « L’Ordre divin » aux origines de la démographie, 1979 et 1984, 3 volumes, Paris, Ined/PUF, 823 p.
TRIBE K., 1988, Governing Economy. The Reformation of German Economic Discourse 1750-1840, Cambridge, Cambridge University Press.
JOHANN PETER SÜßMILCH : DE LA LOI DIVINE À L’INTERVENTION HUMAINE
725
UNGER J. F, 1744, Beyträge zur Matthesi Forensi, 2. Stück, Göttingen, Vandenhoeck.
WAKEFIELD A., 2009, The Disordered Police State. German Cameralism as Science and Practice, Chicago, University of Chicago Press, 240 p.
WAGNER S., 1711, Der Herrschafften / Städt und Länder Volcks-Besatzung / bequemliche Leben / gute Nahrung und Reichthum, Christian-Erlangen, Schmatz.
WHELAN F. G., 1991, « Population and ideology in the enlightenment », History of Political Thought, 12(1), p. 35-72.
WILKE J., 1994, Johann Peter Süßmilch: Die königliche Residenz Berlin und die Mark Brandenburg im 18. Jahrhundert, Berlin, Akademie Verlag, 488 p.
ZINCKE G. H., 1744, Leipziger Sammlungen von Wirthschafftlichen, Policey- Cammer- und Finantz-Sachen, Vol. 1, Leipzig, Jacobi.
ZINCKE G. H., 1751, Cameralisten-bibliothek, Vol. 1, Leipzig, Jacobi.
ZINCKE G. H., 1755, Anfangsgründe der Cameralwissenschaft, Vol. 1, Leipzig, Jacobi.
J. NIPPERDEY
726
Justus NIPPERDEY ß
La recherche sur les théories démographiques de Johann Peter Süßmilch s’est concentrée sur la seconde version révisée et augmentée de L’Ordre divin de 1761-1762. Les différences avec l’édition originale de 1741 ont été signalées, mais pas systématiquement analysées et expliquées. Cet article dresse un tableau du développement de la pensée de Süßmilch en relation avec l’évolution du discours caméraliste allemand de l’époque. On ne peut comprendre le projet originel de Süßmilch ni son développement ultérieur sans le rapprocher étroitement des discours allemands sur la population et l’économie. Süßmilch influença le discours caméraliste en renouvelant l’argumentation en faveur des politiques de population. Mais ce n’était pas l’objectif du théologien, qui avait délibérément évité toute interprétation politique de ses résultats en 1741. C’est dans les deux décennies suivantes que Süßmilch s’intéressa aux possibilités qu’offrent les instruments politiques de changer les comportements démographiques. À partir des années 1750, il commença à s’engager dans des polémiques qui atteignent leur apogée dans la deuxième édition de L’Ordre divin, ouvrage portant aussi bien sur les lois gouvernant la popu-lation que sur les politiques de population.
Justus NIPPERDEY ß
The research of Johann Peter Süssmilch’s demographic theories has tended to concentrate on the enlarged second edition of his Divine Order of 1761/2. While the differences to the original edition of 1741 have been noticed, they have not been systematically analysed and explained. This article charts the development of Süssmilch’s thought in relation to the changing German cameralist discourse of the time. Both Süssmilch’s original project as its further development cannot be understood without closely correlating it to the German discourses on population and economy. Süssmilch influenced the cameralist discourse by providing a new mode of argument in favour of population politics. However, this had not been the goal of the theologian who had deliberately avoided any political interpretation of his findings in 1741. It was in the following two decades that Süssmilch became interested in the possibilities of changing demographic behaviour by political means. During the 1750s he started to engage in political arguments that peaked in the second edition of the Divine Order that was as much a book on the laws governing population as on population politics.
Justus NIPPERDEY ß
La investigación sobre las teorías demográficas de Johann Peter Sussmilch se ha concentrado esencialmente sobre la segunda edición corregida y aumentada del Orden Divino de 1761-62. Si bien las diferencias con la edición original de 1741 han sido señaladas, ellas no han sido analizadas y explicadas de manera sistemática. Este articulo sigue le desarrollo del pensamiento de Sussmilch poniéndolo en relación con la evolución de las ideas cameralistas en la Alemania de su tiempo. Tanto el proyecto original de Sussmilch como su desarrollo ulterior no pueden ser comprendidos sin ponerlos en relación estrecha con las ideas que circulaban en el dominio de la población y de la economía. Sussmilch influenció el discurso cameralista suministrando un nuevo tipo de argumentos a favor de las políticas de población. Sin embargo, ése no fue el objetivo del teólogo, el cual quiso evitar cualquier interpretación política de sus resultados de 1741. Fue sólo en las dos décadas siguientes que Sussmilch empezó a interesarse a la posibilidad de un cambio del comportamiento demográfico por medios políticos. Durante los años 1750 comenzó a implicarse en las discusiones políticas que culminaron en la segunda edición del Orden Divino, la cual es una obra tanto sobre las leyes de gobierno de una población que sobre las políticas de población.
Mots-clés : Süßmilch, caméralisme, Allemagne, XVIIIe siècle, histoire de la pensée démographique, politique de population.Keywords: Süßmilch, Cameralism, Germany, 18th century, history of demographic thought, population politics.
Traduit par Patrick Festy.