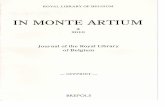L'Opportunisme Cognitif, Approche multidimensionnelle de l'activité humaine - Journée "Jeune...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of L'Opportunisme Cognitif, Approche multidimensionnelle de l'activité humaine - Journée "Jeune...
L’OPPORTUNISME COGNITIFApproche multidimensionnelle de l’activité humaine
Journée « jeunes docteurs » de l’ARCo – Paris 11/01/08
Olivier Penelaud
Perspective de la Psycho-ergonomie Cognitive
Une double approche de l’analyse de l’activité humaine :
Intentionnelle, cognitive, séquentielle, représentationnelle (rep. interne : prédicat/argument…), mentaliste, syntaxique, finalisée logico‐symbolisme ou cognitivisme ;
Situationnelle, distribuée, parallèle, représentationnelle (rep. externe : pattern, carte cognitive…), culturelle, sémantique, « affordée » socioconstructivisme ou cognition située/distribuée.
Implique une confrontation directe avec la complexité naturelle des situations et individus réels (cf. NDM).
Un modèle synthétique de la pratique
Conséquences‐ externes (sur la performance)‐ internes (sur l’individu)
Activité
OpérateurTâche Couplage
ConstructiveProductive
Schéma général pour l’analyse de l’activité (Leplat & Cuny, 1984)
Ergonomie francophone : distinction entre la tâche (i.e. le travail à réaliser) et l’activité (i.e. le travail effectivement mis en œuvre).Cette non correspondance provient de l’intervention d’un opérateur, qui avec ses caractéristiques propres, adapte le travail à réaliser à l’environnement et à la situation vécue.
Sortir des cadres classiques : l’énaction
L’énaction :une théorie inscrite dans une tradition dialectique (p.ex. Hegel : thèse/
antithèse/synthèse, Piaget : assimilation/accommodation/équilibration…) ;la recherche d’un tertium, d’une « voie moyenne », ou encore d’un
entre‐deux inscrit dans une relation dynamique (i.e. processuelle) ;une articulation des opposés complémentaires, dits : mutuellement
exclusifs (i.e. l’un ne peut être ramené à l’autre).
SujetObjet
Objet Sujet
Internalisme
Cognitivisme
Cognitionsituée/distribuée
Externalisme
Objet Sujet
Processualisme
Énactivisme
« Fondement » et limite du paradigme
Posture :L’énaction fonde la co‐émergence – le co‐avènement – de l’organisme et de son monde ou, en d’autres termes, l’émergence de la relation entre les termes immanents de sujet et d’objet, comme nécessaire à l’expression de tout processus de nature cognitive.
Penser l’immanence de cette coprésence, permet de sortir des écueils de l’idéalisme comme du réalisme ; toutefois, s’inscrire dans une perspective à la fois processuelle, complexe et pragmatique, engage de réduire toute prétention d’objectivité au cadre d’une approche à l’objectivité faible et à l’ontologie transitoire (i.e. établie pour l’action).
Faille :Dans une approche processuelle, la recherche de fondements renvoie à l’« absence de fondement » (cf. notion de sunyata).
Sans une certaine fixité des représentations, quid de la planification, des stratégies projectives ? Quid du langage ?
Une dualité intrinsèque
En Physique Quantique :une particule élémentaire manifeste une double caractéristique : elle se comporte à la fois comme une onde (non‐localité, propriétés optiques…), et comme un corpuscule (localité, propriétés cinétiques…) principe de complémentarité de Bohr ;
la mesure (i.e. l’interaction) provoque le « basculement » de la particule (réduction du paquet d’onde) sur l’un des deux états initialement présents (notion de superposition d’états) problème de l’objectivité de l’état observé ;
l’information que l’on peut obtenir sur sa vitesse est inversement proportionnelle à celle que l’on peut obtenir sur sa position ; de plus, plus la durée de la mesure est courte, plus l'incertitude sur l'énergie est grande relations d’incertitude de Heisenberg.
Contradiction du « tiers exclus »
En Science la sélection des théories se fait par l’application des trois principes de la logique classique :
identité : A est A, donne lieu au postulat : « tout ce qui est, est » ;non‐contradiction : A n’est pas non-A : « rien ne peut à la fois être et ne pas être, une proposition ne peut être vraie et fausse en même temps » ;tiers exclus : il n’existe pas de tiers T entre A et non-A : « tout doit ou bien être ou bien ne pas être : une proposition est soit vraie, soit fausse ».
Cette grille est donc insuffisante.
« Le scandale intellectuel provoqué par la mécanique quantique consistedans le fait que les couples de contradictoires qu’elle a mis en évidencesont effectivement mutuellement contradictoires quand ils sont analysés àtravers la grille de lecture de la logique classique » (Nicolescu, 1998, 4. §9).
Dérivation théorético-informationnelle
Toutes les présuppositions ontologiques sont étrangères à la théorie quantique de l’information, qui est en soi, une pure épistémologie. Il n’y‐est question que de descriptions : notion d’objectivité faible (Grinbaum, 2004).
1er Présupposé philosophique : le monde peut être décrit comme une boucle des existences entre le phénomène (i.e. le physique) et lamesure du phénomène (i.e. l’information) ;
l’ensemble de toutes les théories est décrit sous la forme cyclique d’une boucle.
2e Présupposé : chaque description théorique particulière, peut être obtenue à partir d’une opération de coupure sur la boucle.
selon l’endroit où est effectuée la coupure, on change les rôles : ceux qui étaient explanans deviennent explanandum, et l’inverse.
Axiome I : Il existe une quantité maximale de l’information pertinentequi peut être extraite d’un système.Axiome II : Il est toujours possible d’acquérir une nouvelle informationà propos d’un système.
Information quantique & « tiers inclus »
Pour l’approche informationnelle de la MQ, un troisième pôle est considéré.
Cette considération n’est possible que par la transgression du principe du « tiers exclus ».
Il y‐a extension du principe de non‐contradiction(i.e. il y‐a objectivation).
Entre les pôles énergie, matière et information, il y’a en même temps :transformation matérielle (1) et dissipation énergétique (2) ;
émission d’un signal structurel (3) et information de la matière (5)(i.e. actualisation de sa structure) ;
dépense énergétique faible (4) et contrôle de la distribution énergétique (6).
Quantumd’énergie
EnergieMatière
1
2
3 45 6
Information : qbit (bit quantique)
La trialectique : une logique géométrique
Dans la triade du tiers inclus les trois termes (A, non-A & T) coexistent au même moment du temps.
La tension entre contradictoires bâtit une unité plus large qui les inclut : l’état T.Le dynamisme de l’état T, s’exerce à un autre niveau de Réalité, où ce qui apparaît comme désuni (onde ou corpuscule) est en fait uni(quanton), et où ce qui apparaît contradictoire est perçu comme non‐contradictoire.
t
A
non-A
T Codage de l’instant
Plan classique
Plan quantique
Niveaux de réalité
Une épistémologie ternaliste
La trialectique est une heuristique au sein de laquelle, la réalité rationnelle et pragmatique (i.e. construite) est une réalisation projective résultant de la conjugaison d’une intentionnalité subjective appliquée à des conditions objectives cadre d’une ontologie transitoire (i.e. établie pour l’action).
Tout démarrage du processus fait apparaître le temps, c.‐à‐d. : « met en marche » une boucle entre le passé et l’avenir, avec au centre de cette relation,le présent de la conscience et sa réciproque, la conscience du présent.
Projet
SujetObjet
Interne
Externe
Activité
Imaginaire (réflexif)
Réel (sensible)
Réalité (rationnelle & pragmatique)
Présent
Passé
Futur
Un modèle de compatibilité
Projet
SujetObjetProjet
SujetObjet
Projet
SujetObjet
Environnement(écotype)
Organisme (phénotype)
Espèce (génotype)
Avoir (attentionnel)
Etre (intentionnel)
Faire (rationnel)
Altérité(l’autre)
Identité (moi)
Affectivité (l’Humanité)
Triade du Vivant
Triade de l’Activité
Triade de Réciprocité
Conception ternaliste de laPsycho-ergonomie Cognitive
Dans le cadre constructiviste de la trialectique, les deux principales approches de la Psycho‐ergonomie Cognitive se révèlent être complémentaires.Elles peuvent être réunies sous forme d’un objet complexe, dynamique, à plusieurs dimensions, s’enrichissant l’une l’autre.
Projet
SujetObjet
Rationalisme pragmatique
IntentionnalismeSituationnisme
Cognitivisme
Individualisme méthodologique
(analyse de verbalisationsanalyse de la tâche…)
Collectivisme méthodologique
(analyse de l’organisationanalyse de l’activité…)
Cognition située/distribuée
Psycho-ergonomie cognitive
Modélisation & simulation(émission de consignes…)
Modèle d’analyse de l’activité
Conséquences‐ externes (sur la performance)‐ internes (sur l’individu)
Activité
OpérateurTâche Couplage
ConstructiveProductive
Schéma général pour l’analyse de l’activité (Leplat & Cuny, 1984) Activité
OpérateurTâche
Symbolique
Subsymbolique
Pragmatique
CompétencePerformance
Cohérence
Procédures
Routines
Stratégies
Un cas concret : la conduite automobile
Activité
InterneExterne
Situation courante
Situation projetée
Motivations, intentions et modes opératoires
Faire(rationnel)
Planification
Etre (intentionnelle)
Avoir (attentionnelle)
DécisionObservation Conduire
(1) impact du monde et données perçues ;(2) focalisation de l'attention et recherche d'invariances ;(3) implication et évaluation des réactions du monde ;(4) représentation et élaboration ;(5) contrôle et régulation ;(6) expérimentation et apprentissage.
1
2
3 45 6
Finalement : l’opportunisme cognitif…
Le sujet est perçu comme tributaire d’un champ de contraintes qui vientlimiter plus ou moins fortement sa marge de jeu…
…mais il n’est jamais déterminé mécaniquement par ce champ car il disposetoujours d’une capacité d’initiative susceptible de faire émerger de lanouveauté : sa liberté d’action.
Aussi, posant l’opportunisme comme une conduite consistant à tirer lemeilleur parti des circonstances, même si cela doit se faire à l’encontre derègles établies…
…l’opportunisme cognitif se fonde comme devenir psychologique d’unprincipe présent dès lors qu’un système déclare son autonomie, c.‐à‐d. dèslors qu’il se trouve investi d’une pulsion le faisant tendre à perdurer.
Il correspond à la « mise en tension », à la fois inclusive et exclusive, d’uneintention et d’une situation au travers d’un projet d’action…
…il tente de répondre à la question : Mais comment faire ???