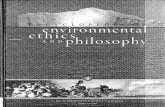« Loi et justice dans les deutérocanoniques du corpus de sagesse (Siracide et Sagesse de Salomon)...
Transcript of « Loi et justice dans les deutérocanoniques du corpus de sagesse (Siracide et Sagesse de Salomon)...
Loi et justice dans les deutérocanoniques du corpus de sagesse
(Siracide et Sagesse de Salomon)
Dans ce qui peut être retenu comme le corpus des livres de
sagesse dans le Canon Catholique des Ecritures, deux livres ne sont
pas dans la Bible hébraïque mais proviennent d‟un élargissement
opérée par la LXX : Siracide et Sagesse de Salomon. Un simple
regard sur le vocabulaire déployé par ces deux textes révèle qu‟ils
utilisent l‟un et l‟autre le vocabulaire relatif à la loi et le vocabulaire
relatif à la justice. Ainsi, ces deux livres, non intégrés au canon
hébraïque et dont le statut dans les communautés juives de ce fait pose
question, offrent paradoxalement un large déploiement de deux
thématiques significatives pour l‟identité d‟Israël, celle de la loi et
celle de la justice, alors même que Qohélet et Job insistent sur la
justice en laissant de côté la référence à la loi. De ce point de vue, ils
offrent un corpus d‟étude sur lequel interroger la corrélation « loi et
justice ».
Le couple de termes proposé n‟est pas classique dans les textes
de l‟Ancien Testament où apparaît davantage celui de « droit et
justice ». Dans la LXX, l‟association krisis ou krima - dikaiosyne (droit et justice) qui traduit mišpāt - s eda qâ, sans être fréquente, se
trouve en effet à plusieurs reprises1. En revanche, les termes « loi » et
« justice » ne sont pas utilisés de manière coordonnée, sauf cas
particuliers comme en Is 51, 7 (s edeq - tôrah traduit par krisis Ŕ
nomos), dans le Ps 119, 42 (s edaqâ Ŕ tôrah traduit par dikaiosyne -
nomos), en Sg 2, 11 (dikaiosyne - nomos). La rareté du binôme
coordonné des deux termes détermine la méthode à suivre, dont le
point de départ est un repérage précis de la terminologie employée.
1 Gn 18, 19 ; Lv 19, 15 ; Dt 33, 21 ; Ps 72, 2 ; 94, 15 ; 106, 3 ; Is 1, 21 ; 5, 7 ; 56, 1 ;
58, 2 où les deux termes apparaissent dans le même verset sans être coordonnés
entre eux ; dans deux stiques parallèles en Ps 106, 3 et dans deux stiques parallèles
et antithétiques en Is 33 , 5 ; 58, 2 ; 59, 14 ; Jr 4, 2 ; 22, 3 ; Ps 99, 4 ; 119, 121 ; 2 S
8, 15 ; 1 R 10, 9 ; 1 Chr 18, 14 ; 2 Chr 9, 8.
VI
A partir d‟un examen attentif du vocabulaire utilisé en Siracide
et dans la sagesse de Salomon, le but de la présente contribution est de
déceler s‟il y a véritablement corrélation des deux thématiques de la
loi et de la justice, et, si tel est le cas, en étudiant le contexte dans
lesquels elle s‟insère d‟en déterminer, pour chacun des livres, la
signification et les enjeux. L‟étude tentera donc une approche littéraire
des textes à partir de l‟analyse de mots répétés et de leur agencement
programmatique. Ce faisant, elle abordera le système de valeur
d‟ordre juridique, moral, politique et théologique de ces textes
lorsqu‟ils traitent la corrélation en question.
Les deutérocanoniques abordés ont été composés, pour ce qui
concerne le Siracide, en milieu juif palestinien, en hébreu avant d‟être
traduit en grec et, pour ce qui concerne la Sagesse de Salomon, en
milieu alexandrin, directement en grec. Entre le deuxième siècle et la
fin du premier siècle, ils ont voulu transmettre un héritage sapientiel et
réaffirmer le patrimoine religieux d‟Israël dans une société confrontée
à la progression de l‟hellénisme, ce dont l‟étude menée donnera un
aperçu.
I. Loi et justice dans le Siracide.
1. Quelques remarques sur le vocabulaire en présence.
1.1 Le vocabulaire de la loi en Siracide.
Dans les fragments hébreux de Ben Sira, le mot tôrâ apparaît
douze fois. Il est rendu neuf fois par nomos, deux fois par elegmos et
une fois par phobos. Une forte concentration du terme se trouve dans
la péricope 32 [35], 14 - 33 [36], 6, avec six occurrences (32, 15. 17.
18. 24 ; 33, 2. 3). Les autres emplois de tôrâ se trouvent en 15, 1 ; 41,
4. 8 ; 42, 2 ; 45, 5 ; 49, 42.
2 I. Lévi, The Hebrew text of the Book of Ecclesiasticus, Leiden, Brill, Semitic Study
Series, 1951; P.C. Beentjes, “The Hebrew Text of Ben Sira 32 [35]:16-33[36]:2”, in:
T. Muraoka (ed.), Sirach, Scrolls and Sages. Proceedings of the Second
International Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls, Ben Sira & the
Mishna held at Leiden University, 15-17 December 1997 (STDJ 32), Leiden, 1999,
pp. 53-67; J. Liesen, “A common background of Ben Sira and the Psalter. The
concept of רהות in Si 32:14-33:3 and the Tôrâ Psalms”, in: A. Passaro, G. Bellia, The
VII
Dans la version grecque, le terme nomos apparaît
fréquemment, avec trente occurrences dont quatre traduisent un autre
substantif que tôrâ ; une majorité d‟emploi du terme n‟a pas toutefois
de correspondant hébreu parce que le texte manque (Prol 1. 8. 14. 24.
35 ; 2, 16 ; 9, 15 ; 17, 11 ; 19, 17. 20. 24 ; 21, 11 ; 23, 23 ; 24, 23 ; 32
[35], 24 ; 33 [36], 2. 3 ; 34 [31], 8 ; 35 [32], 1 ; 38, 34 ; 39, 8 ; 41, 8 ;
42, 2 ; 44, 20 ; 45, 5. 17 ; 46, 14 ; 49, 4)3. D‟autres termes appartenant
au champ sémantique de la loi sont également présents dont entole avec dix-neuf occurrences dont une majorité n‟a pas de correspondant
hébreu (1, 26 ; 2, 15 ; 10, 19 ; 15, 15 ; 23, 27 ; 28, 6. 7 ; 29, 1. 9. 11 ;
32 [35], 2. 7 ; 45, 17) ; quatre utilisations de entole traduisent mis ewâ
(6, 37 ; 35 [32], 23 ; 37, 12 ; 45, 5). Plus rarement se trouvent les
termes prostagma, pour chaque fois un terme hébreu différent (6, 37 ;
39, 16. 18 ; 43, 13), et dikaio ma (4, 17). Le terme krima (17, 12 ; 18,
14 ; 19, 25 ; 20, 4 ; 21, 5 ; 32 [35], 16 ; 38, 22. 33 ; 41, 2. 3 ; 42, 2.
15 ; 43, 10. 13 ; 45, 5. 17 ; 48, 7), d‟usage fréquent, traduit lorsqu‟on
le trouve en hébreu généralement mis pat . Comme en témoignent les
contextes d‟utilisation de ce terme et nos traductions en français, son
usage rapproche la sphère du droit et la sphère de la justice au point
que celles-ci se contaminent, au moins partiellement.
Une des particularités du Siracide est de qualifier le terme loi.
Deux expressions méritent de ce point de vue, semble-t-il, l‟attention :
la loi est loi de vie (nomos zo es ; 17, 11 ; 45, 5) et loi du Très-Haut
(nomos ypsistou ; 9, 15 ; 19, 17 ; 23, 23 ; 38, 34 ; 41, 8 ; 42, 2 ; 44,
20 ; 49, 4). En ce qui concerne cette dernière expression il s‟agit
véritablement d‟une création de Ben Sira, l‟expression ne se trouvant
nulle part ailleurs dans l‟Ancien Testament, même si le titre est utilisé
pour désigner Dieu, particulièrement dans les psaumes. Dans le texte
du Siracide, un petit nombre des références données en grec se
retrouvent en hébreu : tôrâ eleyôn (41, 8 ; 42, 2 ; 44, 20 ; 49, 4) et
masôt eleyôn (44, 20).
Wisdom of Ben Sira. Studies on Tradition, Redaction, and Theology, Berlin – New
York, Walter de Gruyter, 2008, p. 200. 3 Cf. R. Smend, Griechisch Ŕ Syrisch Ŕ Hebräischer Index zur Weisheit des Jesus
Sirach, Berlin, Verlag Von Georg Reimer, 1907.
VIII
Le Siracide indique aussi que la loi a été transmise par Moïse :
(Dieu) lui fit entendre sa voix et l’introduisit dans la nuée. Il lui donna
face à face les commandements (mis ewâ / entole ), la loi de vie (tôrâ
hayîm / nomos zo es) et d’intelligence (tebûnâ / episteme) pour
enseigner à Jacob l’alliance et ses décrets (mis pat / krima) à Israël
(Si 45, 5) ou par Aaron : il lui donna ses commandements (mis ewâ /
entole), pouvoir sur les prescriptions de la loi (mis pat / krima), pour
enseigner à Jacob ses exigences et illuminer Israël par sa loi, pour
enseigner à Jacob ses exigences et illuminer Israël par sa loi (mis pat / nomos) (45, 17). En 24, 23 la loi (nomos) que Moïse a prescrite est
mise en parallèle avec le livre de l‟alliance (biblos diathekes theou
ypsistou). La péricope 17, 11-14 noue plusieurs des termes ou
expressions évoqués ci-dessus : Il leur a accordé en plus le savoir
(episteme), il les a gratifiés de la loi de vie (nomos zo es). Il a conclu
avec eux une alliance (diatheke) éternelle, il leur a montré ses
jugements (krima). Leurs yeux ont vu la magnificence de sa gloire,
leurs oreilles ont entendu la gloire de sa voix. Il leur a dit: "Gardez-
vous de toute injustice", il leur a donné des commandements
(entellomai) à chacun au sujet de son prochain.
1.2 Le vocabulaire de la justice en Siracide.
Les termes de la racine dik- sont assez fréquents dans la
version grecque du Siracide4. Dikaioô est onze fois identifiable (1, 21 ;
7, 5 ; 9, 12 ; 10, 29 ; 13, 22 ; 18, 2. 22 ; 23, 11 ; 26, 29 ; 34 [31], 5 ;
42, 2). Trois emplois rendent s adaq (7, 5 ; 10, 28 [29] ; 42, 2) et deux
naqah (9, 12 ; 31 [34], 5). N‟ont pas d‟équivalent en hébreu parce que
le texte manque : 1, 22 ; 13, 22 ; 18, 2. 22 ; 23, 11 ; 26, 29. Sur cinq
emplois de dikaiosyne, trois n‟ont pas d‟équivalent en hébreu (26, 28 ;
38, 33 ; 45, 26), un cas rend s edeq (16, 20 [22]) et un autre tiqewâ (44,
10). Des sept occurrences de dikaios, trois sont manquantes dans le
texte hébreu (27, 8 ; 35, 5. 6), une rend s edeq (9, 16) et une autre
s addiq (44, 17), les deux restantes rendant d‟autres termes hébreux
(10, 22[23] ; 33, 3 manuscrit B).
4 Cf. R. Smend, ibid.; J.A. Ziesler, The Meaning of Righteousness in Paul. A
Linguistic and Theological Enquiry, Cambridge, Cambridge University Press, 1972.
IX
En travaillant à partir du texte hébreu, on constate que sur cinq
occurrences de s edeq, trois sont rendues par des mots de la racine dik-,
soit dikaiosyne (16, 20 [22]), dikaios (9, 16) et dikaios (33, 17[18]).
Les deux cas restants sont rendus par aletheia (4, 28) et eleemosyne (40, 24). Des huit occurrences de s edaqâ, aucune n‟est rendue par un
mot de la racine dik- : une n‟est pas dans le texte hébreu (51, 30) ; une
est rendue par doxa (44, 13) et les 6 autres sont rendues par
eleemosyne (3, 14. 30 [28] ; 7, 10 ; 12, 3 ; 16, 14 ; 40, 17). Des six cas,
de s addiq, un seulement est rendu par dikaios (44, 17) et les cinq
autres sont traduits par eusebes (11, 15 [17]. 20 [22] ; 12, 2 ; 13, 16
[17] ; 16, 13). Autrement dit, pour rendre les termes hébreux de la
racine s dq, le texte grec utilise non seulement des mots de la racine
dik- (sept occurrences) mais tout autant eleemosyne (sept occurrences)
et eusebes (cinq occurrences). En portant un regard comparatif général
sur le TM et la LXX, il est possible de voir dans cet usage d‟un
vocabulaire grec diversifié une originalité du Siracide. Les mots de la
racine dik-, eleemosyne et eusebes s‟interprètent les uns les autres,
donnant à la notion de justice à la fois la dimension de compassion et
de don, d‟œuvres bonnes, et celle de piété.
Le vocabulaire de l‟injustice est également très présent dans le
Siracide. Dans la version grecque, pour désigner l‟injustice commise
par des hommes adikein apparaît en 4, 9 ; 13, 3 ; 35 [32], 13 ; 36 [33],
9 (manuscrit B). Le substantif adikia est présent en 7, 3. 6 ; 10, 7
(manuscrits A et S). 8 ; 14, 9 ; 17, 20. 26 ; 20, 28 ; 27, 10 ; 35 [32], 3 ;
40, 12 ; 41, 18 pour indiquer généralement ce que le pécheur fait ou ce
que l‟homme doit rejeter. Il est également précisé qu‟aucune injustice
n‟échappe au regard de Dieu (17, 20) et qu‟elle est vouée à disparaître
alors que la bonne foi tiendra éternellement (40, 12). Enfin l‟adjectif
adikos est utilisé en 5, 8 ; 7, 2 ; 10, 7 ; 17, 14 ; 19, 25 ; 27, 10 ; 34
[31], 18 ; 35 [32], 11 ; 40, 13 ; 51, 6 là encore pour nommer l‟injustice
commise ou à rejeter.
En dernière remarque, notons que Siracide utilise des termes
de la racine kri- pour qualifier la manière dont Dieu juge, tendant ainsi
à rapprocher droit et justice : comme l’argile dans la main du potier
qui la façonne selon bon plaisir, ainsi les hommes dans la main de
leur Créateur qui les rétribue selon sa justice (kata ten krisin autou ;
33, 13. Voir également 35, 18. 23). Le terme krima est utilisé
X
également pour désigner les jugements divins, avec en quelques
occurrences une utilisation en parallèle avec loi : il leur accorda
encore la connaissance et les gratifia de la loi de vie : il a conclu avec
eux une alliance éternelle et leur a fait connaître ses jugements (17,
12 ; voir également 45, 6).
2. La corrélation des deux thématiques.
L‟examen du vocabulaire utilisé en Siracide manifeste que le
livre traverse longuement les deux thématiques de la loi et de la
justice, de sorte qu‟il est possible de se demander si conjointement
elles ne constituent pas un thème livrant, au moins en partie, son
système de valeur.
De ce point de vue, le traducteur présente dans le prologue
quelques observations intéressantes. S‟il affirme qu‟il n‟est pas
possible de traduire dans une autre langue, parce qu’il n’y a pas
d’équivalence entre des choses exprimées originairement en hébreu et
leur traduction dans une autre langue (vv. 21-22), néanmoins il lui
paraît nécessaire de le faire pour ce qui concerne l‟instruction de
sagesse de son grand-père. Le projet de son aïeul était d‟aider les
hommes soucieux d‟instruction à apprendre davantage à vivre selon la
loi (dia te s ennomou bio seo s, v. 14). Il paraît nécessaire au petit-fils de
le traduire pour la survie du judaïsme en diaspora, à l’usage de ceux-là
aussi qui, à l’étranger, désirent s’instruire, réformer leurs mœurs, et
vivre conformément à la loi (ennomos bioteuein, vv. 33-34).
Dans la mesure où le vocabulaire de la justice qualifie
généralement l‟homme, nous pourrions imaginer que sa pratique
vérifie une vie menée selon la loi ou conformément à elle. En réalité,
un examen des versets traitant de la question de la justice, que ce soit
avec les mots de la racine dik- ou que ce soit avec l‟utilisation de
eleemosyne et eusebes, amène à constater que la thématique est
massivement abordée dans le contexte de réflexions sur la rétribution
ou sur la justification de l‟homme par Dieu.
XI
Si une unique occurrence affirme que Dieu est juste : Le
Seigneur seul sera proclamé juste (dikaiothesetai ; 18, 2)5, en
revanche, comme nous l‟indiquions, avec les mots de la racine kri- il
est présenté comme le juge qui fait droit aux justes (35, 18) et rétribue
selon sa justice (33, 13). Le soin et la justice que Dieu manifeste
envers les hommes sont l‟expression de sa compassion pour la
faiblesse humaine et de sa volonté de salut. Sa pitié est pour toute
chair (18, 13b). Il a pitié de ceux qui trouvent la discipline (paideiai)
et qui cherchent avec zèle ses jugements (krima) (18, 14). La justice
de Dieu se révèle alors aussi dans le fait qu‟il instruit les hommes, les
corrige et leur donne des préceptes pour qu‟ils puissent vivre selon sa
volonté (cf. 32, 12-14 ; 39, 8)6.
Dans une vaste réflexion sur le mal pensé à l‟intérieur de
l‟œuvre de création divine (15, 11-17, 32)7, Ben Sira répond à des
interlocuteurs fictifs mettant en cause la justice divine ; ils soutiennent
que c‟est Dieu qui fait pécher (15, 11) et interrogent l‟intérêt qu‟il
porte aux actions des hommes, car la rétribution se fait attendre (16,
17-23). L‟auteur répond en affirmant que le mal n‟entre pas dans le
projet créateur de Dieu. En revanche, c’est lui qui au commencement a
fait l’homme, il l’a laissé à son conseil (diaboulion) ou au pouvoir de
son inclination (yes er) selon le texte hébreu du manuscrit A de la
Geniza du Caire8. L‟exercice du choix est ainsi le corollaire de
5 L‟un de ses manuscrits grecs, le 248, ajoute : et il n’y en n’a pas d’autres que lui. Il
gouverne le monde d’un geste et de la main, tout obéit à sa volonté ; car il est le roi
de toutes choses et par sa puissance il sépare les choses sacrées des profanes. 6 Cf. F. V. Reiterer, “The Interpretation of the Wisdom Tradition of the Torah within
Ben Sira”, in: A. Passaro, G. Bellia, The Wisdom of Ben Sira. Studies on Tradition,
Redaction, and Theology, Berlin – New York, Walter de Gruyter, 2008, pp. 209-
231, particulièrement p. 214. 7 Cf. M. Gilbert, « God, Sin and Mercy: Sirach 15, 11-18, 14”, dans: Ben Sira’s
God. Proceeding of the International Ben Sira Conference, Durham – Ushaw
College, 2001, Walter de Gruyter, Berlin – New York, 2002, pp. 118-135; L.
Alonso-Schökel, “The vision of man in Sirach 16:24-17:14”, in: J.G. Gammie, W.A.
Brueggemann, W.L. Humphreys, J.M. Ward (ed.), Israelite Wisdom: a Theological
and Literary essay in Honor of Samuel Terrien, New York, Scholars Press, 1978,
pp. 235-245. 8 Pour les hypothèses discutées à propos de ce verset, voir J. Hadot, Penchant
mauvais et volonté libre dans la Sagesse de Ben Sira (l’Ecclésiastique), Bruxelles,
Presses Universitaires, 1970, pp. 91-103.
XII
l‟inclination dont l‟homme est doté à la création9. Il lui revient alors de
choisir s‟il veut mettre en pratique les commandements (entole) divins, être fidèle à la volonté divine (15, 15-17). Le choix présuppose
une alternative entre le feu qui détruit et l‟eau qui donne vie, qu‟une
reprise de Dt 30, 15-20 reformule et lie au thème de la rétribution :
l‟homme choisit ce qui, éventuellement, lui sera donné, ou la vie ou la
mort. Il lui a cependant été donné tout ce qui est nécessaire au
discernement et à l‟exercice du choix (17, 7). Capable de percevoir la
grandeur des œuvres divines et capable de distinguer le bien et le mal,
il peut choisir en toute connaissance (episteme) et intelligence. La
connaissance (episteme) accordée à l‟homme est encore don de la loi
de vie (nomos zo es ; 17, 11), Ben Sira ne mettant pas d‟intervalle entre
la création et le don de la Torah10. Bien plus, il laisse entendre que la
loi a été donnée à l‟humanité depuis le commencement : le don de la
loi est une intervention divine complétant le travail du Créateur et
ayant une signification universelle. En donnant la loi de vie aux
hommes, Dieu a conclu avec eux une alliance éternelle et leur a fait
connaître ses jugements (krima ; 17, 12). Connaissance du bien et du
mal et connaissance des jugements divins se répondent en écho :
l‟homme est libre de choisir et il peut le faire en toute conscience de la
volonté divine et de ce qui est chemin de vie. Dieu leur dit : “gardez-
vous de tout mal (adikos)”, il leur ordonna des commandements
(entellomai) chacun à l’égard de son prochain (17, 14).
Ainsi en réponse à l‟objection que la rétribution se fait attendre
(les œuvres de la justice, qui les annoncera ? qui les attendra, car
l’alliance est loin ; 16, 22), reliant l‟acte créateur et l‟acte d‟alliance,
le don de la connaissance du bien et du mal et celui de la loi de vie,
Ben Sira répond que l‟homme a reçu de Dieu ce qui est nécessaire à
l‟accomplissement de sa fonction dans le monde et au respect de sa
place envers son créateur et envers son prochain. L‟ordre du monde
étant assuré parce que chaque élément séparé par le Créateur occupe
9 Cf. G. Maier, Mensch und freier Wille, Tübingen, Mohr, pp. 98-115.
10 J.J. Collins, Seers, Sybils and Sages in Hellenistic-Roman Judaism, JSJS 54,
Leiden, Brill, 1997, p. 376; cf. également du même auteur : « Before the Fall : the
earliest Interpretations of Adam and Eve”, in: H. Najman, J. Newman, The Idea of
Biblical Interpretation. Essay in Honor of James L. Kugel, Brill, Leiden-Boston,
2004, pp. 293-308.
XIII
sa place sans prendre celle de l‟autre, conformément à la parole divine
(16, 26-28), l‟homme en accomplissant sa vocation propre et en
gardant la loi divine selon l‟alliance scellée, contribue à assurer le
maintien de l‟ordre cosmique.
L‟interrogation surgissant du constat que la rétribution semble
se faire attendre et Dieu ne pas s‟intéresser aux personnes
individuelles, à leurs actions bonnes ou mauvaises (5, 3-5 ; 15, 11-12 ;
16, 17 ; 23, 18-21…), est en fait une thématique qui parcourt le livre.
Il s‟ensuit quelques exhortations : ne te félicite pas de la réussite des
impies, souviens-toi qu’ici-bas ils ne resteront pas impunis (dikaioo à
l‟aoriste passif ; 9, 12). Sous un autre mode, l‟exhortation est
invitation à fréquenter les hommes justes (dikaios ; 9, 16) et
intelligents et à avoir des entretiens qui portent sur la loi du Très-Haut
(nomos ypsistou ; 9, 15). Elle est appel à faire confiance : n’aie pas
honte de la loi du Très-Haut (nomos ypsistou) ni de l’alliance, du
jugement (krima) qui rend justice (dikaioo ) aux impies (42, 2). La
rétribution ne concerne pas seulement les impies ; elle est aussi
promise aux justes, conformément à leurs actes : voici des hommes de
bien dont les bienfaits (dikaiosyne) n’ont pas été oubliés… Leur
descendance reste fidèle aux commandements (diatheke)… (44, 10.
12). Les appels à pratiquer l‟aumône ou la charité sont présents
(eleemosyne en 3, 14 ; 7, 10), souvent dans des contextes où la
question de la rétribution resurgit (3, 30 [28] ; 12, 3 ; 16, 14 ; 40, 17),
parfois de manière très explicite : il tient compte de tout acte de
charité et chacun est traité selon ses œuvres (16, 14 ; voir 40, 17).
Une invitation semblable à être pieux (eusebes) est formulée en lien
étroit à la question de la rétribution (11, 17. 22 ; 12, 2 ; 16, 13) : il ne
frustre pas la patience de l’homme pieux (16, 13). Bref, comme le
laissait pressentir les emplois fréquents de dikaioo , l‟auteur invite à se
souvenir que celui qui passe de la justice (dikaiosyne ) au péché, le
Seigneur le destine à périr par l’épée (26, 28). Mais le juste qui
persévère dans sa justice sera rétribué en conséquence.
Justice et injustice sont encore mises en lien avec la question
du culte. Ben Sira dénonce le fait que des sacrifices injustes puissent
agréer au Seigneur : sacrifier un bien mal acquis, c’est se moquer ; les
dons des méchants (des « sans lois », anomos) ne sont pas agréables.
Le Très-Haut n’agrée pas les offrandes des impies (asebes) ; ce n’est
XIV
pas pour l’abondance des victimes qu’il pardonne les péchés (34, 18-
19). En revanche, le culte qui plaît à Dieu c‟est d‟observer la loi et de
garder les préceptes de justice et de charité : observer la loi (nomos),
c’est multiplier les offrandes, s’attacher aux préceptes (entole ) c’est
offrir des sacrifices de communion. Se montrer charitable c’est faire
une oblation de farine, faire l’aumône (eleemosyne) c’est offrir un
sacrifice de louange. Ce qui plaît au Seigneur c’est qu’on se détourne
du mal, c’est offrir un sacrifice expiatoire que de fuir l’injustice
(adikia) (35, 1-3). Voilà noués du côté des hommes observance de la
loi et accomplissement de la justice, deux attitudes concrètes,
nommées comme une forme du culte et que le Seigneur rétribuera au
septuple (35, 10). Scruter la loi, en observer les commandements et les
préceptes, accomplir des œuvres de justice, c‟est encore craindre Dieu
(10, 19 ; 32, 14-33, 3)11. Celui qui scrute la loi (nomos) en est
rassasié… Ceux qui craignent le Seigneur sont justifiés, ils font briller
leurs bonnes actions (dikaio ma) comme une lumière… Celui qui a
confiance dans la loi (nomos) observe ses préceptes (entole ), celui qui
met sa confiance dans le Seigneur ne souffre aucun dommage (32, 15.
16. 24). Le parallélisme du dernier verset cité lie étroitement
confiance dans la loi et confiance dans le Seigneur, observance des
préceptes de la loi et assurance d‟être épargné du mal.
Ainsi, pour chercher les chemins de la justice, l‟homme est
invité à scruter la loi et à en mettre en pratique les commandements.
Sans cesser d‟être celle du Sinaï, la loi est identifiée avec ce que Dieu
donne à l‟homme à la création, sous forme de connaissance et de
sagesse, et acquiert ainsi une signification universelle. Elle est pour lui
non seulement un instrument de connaissance et d‟interprétation du
monde, mais encore instruction, chemin de vie lui indiquant les voies
de la justice. L‟homme sage est celui qui accomplit la Loi, c‟est-à-dire
se soumet à l‟instruction divine et y adapte son comportement. Si le
terme loi est polyvalent dans le livre, qu‟il renvoie au Pentateuque
(Prol 9 ; 39, 1. 8) ou bien à l‟entière révélation biblique, à la révélation
dans les actes (histoire d‟Israël) autant que par la parole, à
11
Cf. J. Ramón Busto Saiz, « Sabiduría y Torá en Jesús Ben Sira », EsBi 52 (1994),
pp. 229-239.
XV
l‟instruction divine qui se révèle chemin de vie, voire donc au don de
la connaissance du bien et du mal, les termes préceptes ou
commandements ne se réfèrent jamais à ce qui est typique d‟Israël,
comme la circoncision, le sabbat, la Pâque12… mais manifestent que la
loi est sagesse et est faite pour la justice. Dans la version grecque, du
fait de l‟utilisation de eleemosyne et eusebes à côté de dikaiosyne, pour rendre les termes hébreux de la racine s dq, la justice acquiert à la
fois une dimension théologale et une dimension éthique, et de ce fait
également un caractère universel.
Très clairement la corrélation loi et justice s‟insère dans une
large réflexion sur la question de la rétribution. Dans ce contexte, il est
possible de penser que l‟expression la loi du Très-Haut renvoie à
l‟idée que si la rétribution semble se faire attendre, Dieu n‟est pas
impuissant à punir l‟injustice et à gratifier la justice. En 19, 17 après
avoir exhorté à obéir à la loi du Très-Haut, le manuscrit grec 248
propose un ajout qui pourrait corroborer cette hypothèse : la crainte
du Seigneur est le principe de son indulgence et la sagesse gagne son
affection. La connaissance des commandements du Seigneur c’est la
discipline de vie, ceux qui font ce qui lui plaît récoltent l’arbre
d’immortalité. Ajuster sa vie et sa conduite aux commandements de
Dieu manifestés dans la loi, c‟est craindre Dieu ; observer la loi, c‟est
lui offrir le culte véritable et d‟une certaine manière choisir la vie que
le Très-Haut accorde à ceux qui sont fidèles et justes, qui répondent à
sa révélation en menant une vie dans la justice.
II. Loi et justice dans la Sagesse de Salomon.
1. Quelques remarques sur le vocabulaire en présence.
1.1 Le vocabulaire de la loi en Sagesse de Salomon.
Dans le livre de la Sagesse, le terme nomos revient neuf fois :
2, 11. 12 ; 6, 4. 18 ; 9, 5 ; 14, 16 ; 16, 6 ; 18, 4. 9 (et 10 fois si on le lit
12
Cf. M. Milani, « Rilettura sapienziale della Legge nel recupero dell‟„identità
nazionale‟ di Israele », RSB 15/1 (2003), pp. 109-131.
XVI
en 7, 20 selon les manuscrits A, B, S2)13. Le terme entole est
curieusement peu présent, avec deux occurrences (9, 9 ; 16, 6) ; la
première est au pluriel et la seconde, au singulier, est associée à
nomos : le commandement de la loi. Le substantif prostagma
n‟apparaît pas.
Le mot themis, qui en grec classique est utilisé pour dire la loi
divine ou morale par opposition à nomos qui désigne la loi humaine et
établie par l‟usage, n‟est pas employé dans les textes bibliques à
l‟exception du deuxième livre des Maccabées (2 M 6, 20 et 12, 14) et
on ne le trouve donc pas dans le livre de la Sagesse. En revanche, le
terme dike, dont le sens classique est règle, usage, coutume, et par
extension droit, justice14 y est utilisé (1, 8 ; 11, 20 ; 12, 24 ; 14, 31 ;
18, 11). Un regard sur une concordance révèle que dans le
Pentateuque grec, le mot traduit presque toujours le verbe ou le
substantif de la racine nqm, venger, vengeance, punition (Ex 21, 20 ;
Lv 26, 25 ; Dt 32, 41. 43). En Job (29, 16 ; 33, 13), Proverbes (22, 23),
dans certains textes prophétiques (Am 7, 4 ; Mi 7, 9 ; Os 13, 14 ; Lm
3, 58 ; Ez 25, 12) et dans certains psaumes (Ps 35, 23 ; 43, 1 ; 74, 22),
il traduit généralement le verbe ou le substantif de la racine ryb, entrer
en controverse. Pour une large part, l‟usage de dike dans les textes
bibliques, semble donc proche de l‟acception que révèle son
appartenance à la terminologie judiciaire grecque. Comme dans le
grec classique, dans l‟usage biblique dike équivaut à la contrainte
légale exercée par la justice, à ceci près que celui qui exerce la justice
peut être Dieu. En Sagesse il possède le plus souvent le sens de
châtiment mais en 1, 8 il est question de la justice vengeresse
(elegchousa e dike) qui ne laissera pas échapper l‟impie et en 11, 20
de la dike divine poursuivant les ennemis du peuple de Dieu. Là
encore l‟usage de dike, dans le sens de châtiment, est conforme au
grec classique. La dike, justice vengeresse se chargeant des impies,
13
Pour Luca Mazzinghi le terme nomos se réfère à la loi mosaïque seulement en 2,
12 ; 16, 6 et 18, 4. 9. Une assertion à vérifier (L. Mazzinghi, « La memoria della
Legge nel libro della Sapienza », RSB 16, (2004), pp. 153-176 ; p. 164). 14
En amont de cette notion rationnelle de la dike figure la déesse du même nom :
« Il existe une vierge, Justice (dike ), fille de Zeus, qu‟honorent et vénèrent les dieux,
habitants de l‟Olympe », Hésiode, Les travaux et les jours, 256, trad. P. Brunet,
Paris, Librairie générale française, 1999.
XVII
semble en revanche un écho de l‟usage personnifié du terme, la dike comme hypostase, se chargeant de ceux qui commettent des fautes sur
la terre15.
1.2 Le vocabulaire de la justice en Sagesse de Salomon.
Le terme dikaiosyne revient onze fois sur les dix-neuf chapitres
du livre : 1, 1. 15 ; 2, 11 ; 5, 6. 18 ; 8, 7 (2x) ; 9, 3 ; 12, 16 ; 14, 7 ; 15,
3. Ce mot aurait été forgé dans la langue grecque alors que le
sentiment de justice devenait de plus en plus vif et que l‟idéal de
justice trouvait pour l‟incarner une areté spécifique. Dikaiosyne devint
l‟areté par excellence lorsque la loi écrite fut érigée en critère pour le
bien et pour le mal, le sommet de la perfection humaine, et le résumé
de toutes les vertus. Une fois le nomos (c‟est-à-dire les prescriptions
légales courantes) codifié, l‟idée générale de droiture pris un sens
concret : elle signifia obéissance aux lois de l‟Etat16. Dans le livre de
la Sagesse, au chapitre 2, verset 11, dikaiosyne semble conserver ce
sens d‟obéissance à la loi, avec ceci que le propos des impies (que
notre force soit la loi de la justice) indique qu‟ils refusent l‟obéissance
à la tôrâ et veulent se donner à eux-mêmes leur propre loi. En tant que
tel, leur propos n‟est pas sans rappeler celui tenu par Calliclès dans le
Gorgias de Platon. Celui-ci, en effet, affirme que la nature prouve, en
bonne justice, que celui qui vaut plus doit l‟emporter sur celui qui vaut
moins17. Il défend la loi du plus fort à l‟œuvre dans l‟ordre de la nature
et dénonce l‟institution des lois comme étant artificielle, non fondée
en nature18.
15
Voir Sophocle, Antigone, 538, trad. P. Mazon, Paris, Les belles Lettres, 1997. 16
Cf. W. Jaeger, Paideia. La formation de l’homme grec, Paris, Gallimard, 1964, en
particulier le chapitre VI : La cité Etat et son idéal de justice, pp. 131-148 ; TWNT
IV, 1017. 17
Platon, Gorgias, t. 1, 484a, trad. L. Robin, Œuvres Complètes de Platon, la
Pléiade, Paris, Gallimard. 18
En somme, Calliclès défend la loi du plus fort à l‟œuvre dans l‟ordre de la nature.
En raisonnant ainsi, il reprend le schème antithétique de la physis (nature) et du
nomos (loi), cher aux Sophistes. Les lois définissent, selon eux, un ordre factice,
établi par les hommes. Cet ordre conventionnel et artificiel, distinct de l‟ordre de la
nature, ne peut être placé que sous le signe d‟un pluralisme relativiste. A la loi de la
nature, Calliclès oppose nomos, en jouant sur l‟ambivalence du terme et sur la
diversité de ses acceptions, mêlant le sens de „convention, entente‟ à celui de „loi‟ :
XVIII
Le vocabulaire de l‟injustice traverse également le livre. Le
terme adikia se trouve en 1, 5 et 11, 15 ; le verbe adikein en 14, 29 et
l‟adjectif adikos en 1, 8 ; 3, 19 ; 4, 16 ; 10, 3 ; 12, 12. 23 ; 14, 30. 31 ;
16, 19. 24.
2. La corrélation des deux thématiques.
Le livre de la Sagesse de Salomon s‟ouvre par une adresse à
ceux qui gouvernent ou jugent la terre. L‟exhortation est clairement
délimitée par l‟inclusion du mot-clé dikaiosyne, justice (1, 1. 15). Elle
appelle à aimer la justice, à chercher le Seigneur et à ne pas pactiser
avec l‟impiété, en particulier lorsqu‟elle prend la forme d‟un discours
mensonger qui donne la mort à l‟âme. La mort, fruit de l‟impiété, est
opposée à l‟immortalité qui résulte de la justice : car la justice est
immortelle.
A partir de 1, 16, pour présenter le processus de l‟impiété,
l‟auteur fait parler ceux qui la pratiquent. Mais il avertit le lecteur que
ce discours est le produit de faux calculs (2, 1). Les impies,
prisonniers d‟une conception de la vie marquée par le non-sens parce
que n‟ouvrant sur aucune espérance après la mort et enfermés dans
une logique d‟oppression, en viennent à se donner une loi : Que notre
force soit la loi (nomos) de la justice (dikaiosyne), car ce qui est faible
s’avère inutile (2, 11). Le droit du plus fort devient la loi qui les
conduit. Ils en viennent alors à vouloir mettre à mort le juste, qui
n‟accepte ni leur jugement sur la mort ni leur mode de vie. Tendons
des pièges au juste, puisqu’il nous gêne et qu’il s’oppose à notre
conduite, nous reproche nos fautes contre la loi (nomos) et nous
accuse de fautes contre notre éducation (2, 12). Les impies perçoivent
la vie du juste comme une condamnation insupportable car il défend la
loi mosaïque : elle reste pour lui normative. Une vie menée selon la
loi, dont le fondement ultime est un rapport filial avec Dieu (2, 13),
voilà ce qui oppose le juste aux impies. La seule présence du juste est
en elle-même accusatrice pour les impies. Il est un gêneur pour ceux
la loi positive, contraire à la loi de la nature, n‟est faite que par l‟entente et la
convention des faibles cherchant à garantir leur faiblesse contre la puissance des
forts.
XIX
qui sentent en lui une entrave à leur comportement, un reproche de
faillir à la loi et à leur éducation.
Le parallélisme de l‟expression : nous reproche nos fautes
contre la loi / nous accuse de fautes contre notre éducation, avec la
répétition du terme amarte mata, met en rapport étroit la loi et
l‟éducation. Le parallélisme implique qu‟être éduqué, c‟est l‟être dans
la loi. Y a-t-il des raisons de suspecter que la loi dont il est question ici
ne soit pas la loi mosaïque ?19 Les motifs avancés par les impies
semblent au contraire suggérer qu‟ils sont des Juifs tentés d‟oublier
l‟instruction sapientielle et la tôrâ, la foi des pères, au profit d‟une
conception de la vie, somme toute assez proche de celle de Calliclès.
L‟impiété, qui est tentation d‟entrer dans une dimension de puissance
qui éloigne la pensée de la mort, fait donc de la force la loi de la
justice (2, 11), profanation suprême de la loi (2, 12), chemin qui
conduit à la mort.
Dans les chapitres 3-4, la procédure de disqualification du
discours des impies est mise en œuvre à l‟intérieur du processus
littéraire de quatre diptyques où la bénédiction du juste est mise en
opposition au châtiment des impies. Les quatre diptyques fonctionnent
comme une accusation de l‟attitude débridée, sans loi, des impies,
laquelle porte en elle-même son propre châtiment. Au terme de la
série des diptyques, le chapitre 5 introduit l‟idée d‟un jugement futur.
Il révèle que le juste recevra du Seigneur, une récompense royale (vv.
15-16) tandis que les impies seront consumés dans un ultime et
cosmique embrasement. Le Seigneur s‟armera pour le combat, pour
cuirasse il revêtira la justice (dikaiosyne) et les forces de la création
elles-mêmes se joindront à la bataille contre l‟impiété (vv. 17-23).
L‟auteur transporte ainsi le lecteur du côté de la perspective divine où
19
C‟est l‟avis de J. Collins qui souligne qu‟en 6, 4, l‟hypothétique reproche de ne
pas garder la loi est semblablement mis en parallèle avec des chefs d‟accusation plus
généraux : ne pas juger droitement et ne pas suivre la volonté de Dieu. Il remarque
qu‟il n‟y a dans le livre aucune référence à des lois spécifiquement juives comme la
circoncision, l‟observance du sabbat, ou les lois alimentaires. Il en conclut alors que
la loi mentionnée dans le livre de la Sagesse de Salomon doit être, dans la pratique,
assimilée à la loi naturelle connue de tous (J. J. Collins, Between Athens and
Jerusalem. Jewish Identity in the Hellenistic Diaspora, Grand Rapids, Michigan /
Cambridge, UK, W. B. Eerdemans Publishing Company, 2000, p. 199).
XX
les apparences du pouvoir de l‟injustice et de l‟impuissance de la vertu
sont démontées. Quand l‟impiété se déchaîne, quand la force fait loi,
et que la relation échappe à toute rationalité, aucun discours ne
réussirait plus à convaincre les impies ni les lecteurs qui adhèrent à
leur discours. La scène du jugement sollicite en définitive la foi :
contre toute apparence, la mortalité, la faiblesse et les limites ne
détruisent pas le sens d‟une vie vertueuse. S‟il est, en réalité, difficile
de déduire quelles sont les croyances eschatologiques de l‟auteur du
livre de la Sagesse, il apparaît qu‟il vise essentiellement à favoriser
une juste appréciation de la mort ouvrant au désir de la sagesse et à la
pratique de la justice ; son propos est de défendre l‟idée que
l‟immortalité du juste s‟édifie déjà dans la vie présente et que la mort
est un état actuel et persistant des impies.
Au terme de cette scène du jugement, l‟auteur conclut par une
exhortation qui selon la technique de structuration concentrique
utilisée sur les six premiers chapitres, se déploie en parallèle à
l‟exhortation initiale et porte à son aboutissement le mouvement de
cette première partie du livre. L‟auteur s‟y adresse au lecteur comme à
un roi qui a pour tâche de juger avec droiture et sagesse. S‟il apprend
la sagesse et ne commet pas de fautes (6, 9), il sera reconnu saint et
trouvera une défense (v. 10). Dans ce contexte, le terme nomos
réapparaît (6, 4. 18), d‟abord dans un nouveau parallèle entre
observance de la loi et vie menée selon la volonté de Dieu : si donc,
étant serviteur de son royaume, vous n’avez pas jugé, ni observé la
loi, ni suivi la volonté de Dieu… (v.4). Il est présent également dans
les vv. 17-20 qui se présentent sous forme de sorite20 et dans lesquels
la royauté devient une figure qui dit la proximité avec Dieu,
l‟incorruptibilité obtenue par l‟attention aux lois. Le terme nomos est
20
Un raisonnement grec, où l‟attribut de chaque proposition devient le sujet de la
suivante, jusqu‟à la conclusion qui a pour sujet celui de la première proposition, et
pour attribut celui de l‟avant dernière proposition. Ce qui schématiquement donne :
Commencement de la sagesse… désir (epithymia) très vrai de l’instruction
souci de l‟instruction… amour
amour… observation des lois
attention aux lois… garantie de l’incorruptibilité
incorruptibilité... *près de Dieu*
ainsi le désir (epithumia) de la sagesse… *royauté*.
XXI
ici au pluriel de sorte qu‟il n‟est pas facile d‟en établir d‟emblée la
signification. Faut-il prendre lois dans un sens général ? Faut-il
penser, au contraire, que nous trouvons là le fait inouï d‟un emploi au
pluriel de nomos au sens de loi mosaïque, mais avec l‟acquisition
d‟une couleur politique et nationale21 ? Ce n‟est pas impossible
d‟autant qu‟on retrouve également dans ces versets le thème de
l‟instruction (paideia) : le désir de l‟instruction (epithymia paideias)
est au fond désir de la sagesse (epithumia sophias) ; et le principe et
fondement (arche) de la sagesse est désir de se laisser instruire… Le
mouvement est circulaire parce que peut-être toujours à reprendre.
L‟auteur donne les moyens de s‟y maintenir : l‟amour par
l‟observation de ses lois, l’attention aux lois et le résultat qu‟on
obtient par là : la garantie de l’incorruptibilité (aphtharsia). Dans le
contexte d‟une exhortation à l‟instruction et à la sagesse, où il est
annoncé qu‟une enquête sévère attend les forts (6, 8), une équation
pourrait commencer à se faire jour qui établirait que la tôrâ, la loi
mosaïque, est une instruction qui se révèle proposition de sagesse22. La
loi est subordonnée à la sagesse, instruction qui conduit à
l‟incorruptibilité. Ceux qui n‟auront pas prêté l‟oreille pour se laisser
instruire, qui n‟auront pas respecté la loi, feront l‟expérience du
jugement rigoureux de Dieu (cf. 6, 1-5)23.
21
L. Monsengwo Pasinya, La notion de NOMOS dans le Pentateuque grec, Rome,
Biblical Institute Press, Analecta Biblica, 1973, p. 180. 22
On pourra trouver d‟autres éléments de réflexion dans : F. Foresti, « Il
Deuteronomio : nascita della Torah come proposta di sapienza », in : F. Festorazzi,
F. Foresti, A. Bonora, (et al.), Sapienza e Torah : Atti della XXIX Settimana
biblica, Associazione biblica italiana, EDB, Bologne, 1987, pp. 17-30 ; C.
Brekelmans, « Wisdom Influence in Deuteronomy », in: M. Gilbert (éd.), La
Sagesse de l’Ancien Testament, Leuven, Leuven University Press, 1979, pp. 28-38 ;
G. Braulik, Weisheit, Gottesnähe und Gesetz. Zum Kerygma von Deuteronomium 4,
5-8, in : G. Braulik, Studien zum Pentateuch, Walter Kornfeld zum 60, Geburtstag,
Wien-Freiburg-Basel, 1977, pp. 165-185. 23
Il n‟est pas inintéressant de noter que la Vulgate comporte une addition, une sorte
d‟indication programmant la réception du texte par le lecteur : melior est sapientia
quam vires et vir prudens magis quam fortis, la sagesse est meilleure que la force et
l’homme prudent que le fort. Le discours des impies se donnant la force pour loi a
été contrecarré par l‟auteur, qui maintenant exhorte à choisir pour principe de vie
non la force mais la sagesse.
XXII
Dans la deuxième partie du livre (chapitres 9-10), en 9, 5 le
pluriel de nomos réapparaît en étant curieusement associé au singulier
krisis. Le contexte est celui d‟une prière pour obtenir la sagesse, qui
relit et réactualise la demande de Salomon à Gabaon (1 R 3). Cette
prière, outre le fait de servir de jointure entre la première et troisième
partie du livre, présente l‟intérêt d‟une synthèse construite sur la
tension entre création et salut. Pour gouverner le monde créé par Dieu,
l‟homme doit recevoir la Sagesse par laquelle il a été formé, et pour la
recevoir, il doit la demander. La vocation de l‟homme est rappelée :
dominer les créatures, régir le monde en sainteté et justice
(dikaiosyne), exercer le jugement (krisin krinei) en droiture d‟âme (9,
2-3). Le sage demande la sagesse pour être rendu capable de vivre la
vocation qui lui a été impartie. Il se reconnaît, en effet, faible et de vie
éphémère, peu apte à comprendre la justice et les lois (kriseo s kai
nomon, v. 5). L‟association de krisis et nomos renvoie au champ
sémantique juridique et le second terme possède, de ce fait, un
caractère normatif affirmé. Exercer le jugement en droiture d‟âme est
clairement mis en parallèle avec la souveraine maîtrise confiée à
l‟homme par son créateur et avec la régence sur le monde en sainteté
et justice, c‟est-à-dire dans l‟attitude de celui qui observe la loi divine
et la rectitude intérieure.
Dans la troisième partie du livre (chapitres 11-19), l‟histoire de
l‟exode est réinterprétée en sept diptyques, sept plaies et sept bienfaits,
une septuple série d‟ordalies. Deux autres thématiques viennent
s‟entrecroiser et livrer des clés de compréhension de ce parcours
narratif principal24.
L‟une est un développement sur la justice de Dieu dont la
toute-puissance s‟exerce en miséricorde (11, 15-12, 22). Alors que les
impies, oppresseurs du peuple de Dieu, auraient mérité d‟être
poursuivis par la Justice (dike ), balayés par le souffle de la puissance
divine (11, 20), ils sont châtiés et avertis. Dans la perspective divine,
l‟exercice de la justice est donc miséricorde et attente de conversion.
Etant juste (dikaios), tu régis le monde avec justice (dikaios), et tu
24
S. Ramond, « Causalité divine, causalité humaine dans le livre de la Sagesse »,
dans : A. Pasquier, D. Marguerat, A. Wénin, (éd.), L'intrigue dans le récit biblique,
Peeters, BETL 237, 2010, pp. 201-214.
XXIII
estimes que condamner celui qui ne doit pas être châtié serait
incompatible avec ta puissance. Car ta force est le principe de ta
justice (dikaiosyne) et de dominer sur tout te fait ménager tout (12,
15-16). Le parallélisme de ce verset avec la description de la vocation
humaine en 9, 2-3 (régir le monde en justice et sainteté) manifeste que
cette dernière est délégation de la seigneurie de Dieu sur le monde. La
justice et les lois, que l‟orant se disait peu apte à comprendre, sont
alors peut-être dans l‟organisation du vivre-ensemble humain
l‟expression visible du vouloir de Dieu et la base de la sainteté comme
de la justice.
12, 16 est aussi à mettre en parallèle avec 2, 11 dans la mesure
où dans les deux versets se rencontre le même binôme : force (ischus)
et justice (dikaiosyne). Alors que les impies ambitionnaient que la
force soit la loi de la justice, l‟auteur s‟adresse à Dieu en
confessant que (sa) force est le principe de (sa) justice et que dominer
sur tout (lui) fait ménager tout. Etonnant renversement de perspectives
où la force n‟est pas utilisée pour s‟imposer mais s‟exerce au contraire
en douceur et en modération. La force comme norme de la justice
s‟inscrit, du côté de Dieu, dans un projet complètement opposé à celui
des impies.
L‟autre thématique (chapitres 13-15) dessine un septénaire de
la folie humaine, d‟attitudes liées à l‟ignorance : l‟échec d‟une
analogie, la supplication ridicule adressée à un objet sans vie ou à un
bois fragile, la divinisation d‟une personne morte ou vivante, la
fabrication et le commerce d‟idoles et, pour finir, le culte rendu aux
bêtes les plus odieuses (13,7; 13,19; 14,1; 14,15; 14,20; 15,12; 15,18-
19). Au centre de ce septénaire se trouve donc la mention d‟un culte
rendu aux morts : Affligé par un deuil prématuré, un père a fait
exécuter une image de son enfant enlevé à l’improviste, et à ce qui
n’était plus qu’un cadavre d’homme il rend maintenant des honneurs
comme à un dieu et transmet aux siens des mystères et des rites ; puis,
fortifiée par le temps, cette coutume impie (asebes ethos) fut observée
comme une loi (nomos ; 14, 15-16). Voilà que devient loi une pratique
impie, sur le modèle peut-être de la coutume grecque qui consistait à
associer les défunts aux Muses, à diviniser les fils morts
prématurément pour qu‟ils protègent le cercle familial. Ce culte des
morts, même s‟il a force de loi, est impie ; il est un détournement de
XXIV
l‟instruction qui confère l‟incorruptibilité pour une éducation au
gymnase. Contre cette coutume, l‟auteur rappelle : Savoir qui tu es
conduit à la justice (dikaiosyne) parfaite et reconnaître ta
souveraineté est la racine de l’immortalité (15, 3).
A l‟intérieur du motif principal des sept diptyques, le terme
nomos réapparaît à plusieurs reprises. Nous le trouvons d‟abord lors
de l‟évocation de la troisième antithèse : en punition d‟un culte rendu
à des animaux sans raison et misérables (11, 15), les impies périssent
par des animaux selon ce qu‟ils ont mérité (16, 5. 9), tandis que les
justes sont sauvés, dès lors qu‟ils se tournent vers le signe25 de salut
qui leur rappelle le commandement de la loi (entole nomou ; 16, 6-
7)26. Entolē nomou se réfère probablement à l‟ensemble de la loi
considéré comme instruction pour la vie du peuple, plus que à la loi
entendue comme somme des préceptes singuliers à observer. Ce que
les justes doivent ramener à la mémoire n‟est pas tant un précepte que
boulē theou, la volonté de Dieu (cf. 9, 17) exprimée dans la Loi et
impossible à connaître sans le don de la sagesse. En 16, 11 ce sont les
paroles de Dieu qui sont rappelées aux justes. Pour L. Mazzinghi, le
25
Ou le conseiller (symboulon) de salut selon les manuscrits S et A. Cette variante
lit une allusion à Moïse. Conseiller de salut, il rappellerait le commandement de
Dieu, Sauveur de tous. Dieu, par des tourments éducatifs, avertit les siens et par
l‟intermédiaire de Moïse leur permet un retour de l‟oubli à la mémoire de la loi. 26
En tenant compte de la technique de répétition d‟un mot ou d‟un groupe de mots,
A. Leproux suit le fil tissé entre Sg 6, 4 ; 8, 9 et 16, 6. « En Sg 6, 4, l‟auteur tire la
conclusion de sa première partie. A ceux qui édictent le droit, il est demandé de
prêter l‟oreille. De fait, ils n‟ont pas jugé (ekrinate) droitement, ni respecté la loi
(nomon), ni agi selon le conseil (te n boule n) de Dieu. La portée universelle d‟une
telle proposition est évidente. Il reste cependant important de ne pas la dissocier de
l‟ensemble du livre et en particulier de ce qui est dit de la parole de Dieu. Les juges
de la terre (fiction littéraire qui renvoient aux jeunes juifs appelés un jour à tenir des
responsabilités dans le peuple) sont appelés à étudier (paideuo) les paroles de
Salomon (6, 25) puisque celui-ci a la Sagesse pour conseillère (Sg 8, 9)… En Sg 8,
9, Salomon présente sa décision de prendre la Sagesse comme „conseillère de
biens‟… Celle qui est mère des biens, l‟artisane, l‟épouse, est aussi la conseillère.
Une telle présence aux côté de Salomon justifie les qualités de ce dernier dans
l‟exercice de la justice. En Sg 16, 6, lorsque les justes sont victimes des serpents
sinueux, l‟auteur fait allusion à Moïse, conseiller pour le souvenir de la loi », (A.
Leproux, « Moïse, „conseiller de salut‟ en Sg 16,6 ? Une question de critique
textuelle », RB 111-2 (2004), p. 182).
XXV
rappel de tes paroles, ypomne sis tōn logiōn sou (logion au génitif
pluriel) renvoie à la loi mosaïque car par logia le texte de la LXX,
avec la seule exception de Ps 18, 14 et Is 30, 11, se réfère aux paroles
de la loi de Dieu.
« Il s‟agit d‟un usage typique du judaïsme de langue grecque, dans
lequel la loi est considérée comme expression de la révélation
divine à travers la parole, plus que comme une série de préceptes.
Dans ce cas encore il ne s‟agit pas de se souvenir des préceptes
singuliers mais de rappeler à la mémoire l‟entière révélation de
Dieu. A cet égard, nous devons remarquer qu‟au v. 11, comme au
v. 6, la mémoire de la loi et des paroles de Dieu est liée au salut de
la mort. Même ce qui semblait une punition devient ainsi pour les
Israélites un signe qui rappelle le salut offert par Dieu... »27.
L. Mazzinghi en conclut que la mémoire de la loi et des
paroles de Dieu, de la volonté de Dieu exprimée dans la loi, devient en
réalité aussi mémoire des actions divines, des bienfaits opérés par
Dieu.
Le terme nomos apparaît dans l‟évocation de la cinquième
antithèse : pour avoir voulu retenir captifs les fils de Dieu, porteurs de
l’incorruptible lumière de la loi (18, 4), les sans éducation
(apaideutoi, 17, 1) impies, sans loi (anomoi, 17, 2), sont prisonniers
des ténèbres, dans les entraves d’une longue nuit (17, 2), tandis que
Dieu donne aux siens une colonne flamboyante (18, 3). Ils se sont
égarés au point de croire pouvoir retenir captifs les fils de Dieu,
porteurs de l’incorruptible lumière de la loi (18, 4). Sans conteste, ce
verset se réfère à la loi mosaïque et nous y apprenons que la lumière
de la loi est non seulement donnée au peuple de Dieu, mais à travers
lui au monde entier. La dialectique entre universalisme et
particularisme, visible en ce verset, manifeste que la loi mosaïque est
l‟expression de cette sagesse présente dans le monde depuis les
origines et disponible à chaque homme. Par ailleurs, la technique de
répétition de mots établit un lien entre 17, 1-2 et 2, 12, la troisième et
la première partie du livre. Les impies sans loi, qui ne consentent pas à
entrer dans l‟exigence d‟être éduqués, s‟enfoncent dans l‟injustice. Ils
27
L. Mazzinghi, RSB 16, (2004), p. 158. Je traduis.
XXVI
sont décrits dans les mêmes termes que les impies du chapitre 2 à qui
le juste reprochait leur faute contre la loi et contre leur éducation.
Enfin la sixième antithèse annonce que, pour avoir résolu de
tuer les petits enfants des saints (18, 5), en châtiment, les enfants des
impies périssent (18, 5), tandis qu‟un homme irréprochable arrête
pour les justes la colère et lui barre le chemin des vivants (18, 20-25).
Dans ce contexte, la nuit pascale est interprétée comme
l‟accomplissement d‟une promesse faite aux patriarches. L‟auteur voit
cette pâque comme une célébration d‟alliance où le peuple trouve son
identité dans l‟accueil de l‟alliance de Dieu et l‟engagement au
partage fraternel. Il y est question d‟une loi divine (theiotetos nomon)
que le peuple de Dieu établit : aussi les enfants des bons sacrifiaient-
ils en secret et ils établirent d’un commun accord cette loi divine, que
les saints partageaient biens et périls ; et ils entonnaient déjà le
cantique des pères (18, 9). Pour le même motif d‟avoir voulu tuer les
enfants des saints, les impies périssent d‟une mort étrangère, tandis
que la traversée de la mer est pour les justes un voyage paradoxal
(19,4). C‟est la septième et dernière antithèse, après laquelle le texte
peut conclure : les châtiments s’abattirent sur les pécheurs…, et c’est
en toute justice (dikaio s) qu’ils souffraient pour leurs propres crimes;
car ils avaient montré une haine de l’étranger par trop cruelle (19,
13).
Ainsi, il est clair que dans le livre de la Sagesse les
thématiques de la loi et de la justice sont toutes deux prégnantes. Elles
traversent l‟ensemble du livre en étant fortement corrélées l‟une à
l‟autre. L‟injustice ou impiété est décrite dans les termes de faute
contre l‟éducation et contre la loi, d‟érection de la force comme loi de
la justice ou de coutumes impies comme loi, de méconnaissance de
Dieu et de refus de suivre sa volonté. Elle conduit à la mort. La
justice, à l‟opposé, est consentement à se laisser instruire et
apprentissage de la sagesse, le choix d‟une vie menée dans la
reconnaissance de la souveraineté divine et selon la loi ; elle conduit à
l‟incorruptibilité. Dans la perspective divine, la justice découle d‟une
force qui est à la fois souveraine et maîtrisée ; elle est miséricorde et
attente de conversion. Jusqu‟à un certain point, car ceux qui ne
XXVII
s’étaient pas laissé avertir par une réprimande dérisoire allaient subir
un jugement digne de Dieu (12, 26).
Si l‟idée de justice oriente vers la relation de l‟homme à Dieu
et vers sa capacité à se laisser instruire par la sagesse, la loi est
révélation de la volonté divine, instruction de sagesse qui conduit à
l‟incorruptibilité. L‟auteur a le souci d‟instruire et de proposer la loi
dans un monde marqué par la culture hellénistique. Si le terme nomos,
tout en signifiant la loi de Dieu, acquiert une connotation nationaliste,
le livre de la Sagesse conserve cependant l‟idée que la tôrâ pouvait
constituer pour les Juifs exilés un substitut symbolique au territoire
dont ils étaient dépourvus.
Du parcours opéré, il apparaît que si les termes « loi » et
« justice » ne sont utilisés de manière coordonnée qu‟en une seule
occurrence (Sg 2, 11), leur fréquence et leur contexte d‟utilisation,
l‟usage des mots des mêmes champs sémantiques croisent les deux
thématiques qu‟ils véhiculent. L‟agencement programmatique des
ensembles lexicaux repérés révèle le thème de la loi, voie de la justice.
Cherchant à exprimer le dilemme qui se présentait aux Juifs de la
diaspora, entre assimilation et marginalisation, Siracide et Sagesse de
Salomon réinterprètent la tôrâ en termes de sagesse et son observance
en termes de justice. Ils encouragent à la fidélité à la loi divine, la loi
des pères, en assurant, pour le premier qu‟elle assurera mémoire du
nom et descendance, et, pour le second, immortalité et incorruptibilité,
fruits de la justice.
Il est apparu toutefois que le thème est, dans Siracide, situé à
l‟intérieur d‟une ample discussion sur la question de la rétribution.
C‟est dans une tentative de réponse à la mise en cause de la justice et
de la rétribution divines que le livre encourage à persévérer dans la
fidélité à la loi, gage d‟une vie menée dans la justice. Par le don de la
loi et par le don de la connaissance du bien et du mal, Dieu instruit
l‟humanité et lui donne ce qui est nécessaire au discernement et à
l‟exercice de la liberté. L‟identification du don de la loi de vie et de la
connaissance, la spécification de la justice en œuvres bonnes et piété
(eleemosyne et eusebes) confère au thème un caractère universel. Le
XXVIII
Très-Haut, dans sa justice, rétribuera chacun selon la mesure de son
obéissance à la loi, d‟une vie menée dans la justice.
La Sagesse de Salomon conserve la réflexion sur la rétribution
en lui donnant un autre traitement : à l‟expérience commune, qui ne
voit pas le juste rétribué pour ses œuvres et pour sa fidélité à la loi, il
oppose sa foi dans l‟intervention de Dieu, qui renversera les
apparences. Un système d‟opposition, justice - injustice, déploie le
thème et signale ainsi le choix à faire. Justice et injustice sont
précisées au travers de comportements concrets, dont beaucoup se
jouent au travers du rapport à la loi. Si, dans le cours de l‟histoire, ces
deux attitudes opposées ne semblent pas recevoir une rétribution
concordante, c‟est que l‟exercice de la justice divine est miséricorde et
attente de conversion. Dieu n‟a d‟autre projet que de se révéler, de se
laisser connaître par les hommes, de les entraîner dans la voie de la
justice. Voilà pourquoi, il instruit, corrige… jusqu‟à un certain point.
Ceux qui s‟obstinent, les impies, les sans loi seront exclus de la
providence éternelle. La lutte gigantesque que Dieu mène contre
l‟injustice aura son épilogue dans la victoire eschatologique.
Sophie Ramond
Institut Catholique de Paris