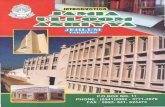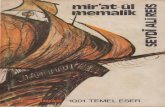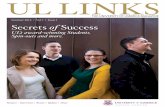innovation et transmission intergenerationnelle - Corpus UL
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of innovation et transmission intergenerationnelle - Corpus UL
CHEDLI BAYA CHATTI
INNOVATION ET TRANSMISSION INTERGENERATIONNELLE DES SAVOIRS PROFESSIONNELS DANS LES ENTREPRISES
ARTISANALES DE MÉTIERS ANCESTRAUX EN TUNISIE
Thèse présentée à la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l'Université Laval
dans le cadre du programme de doctorat en sociologie pour l'obtention du garde Philosophiae doctor (Ph.D)
DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES
UNIVERSITÉ LAVAL QUÉBEC
2012
©Chedli Baya Chatti, 2012
Résumé court
La présente recherche porte sur l'étude des dynamiques de l'innovation et de la
transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels au sein des entreprises
artisanales tunisiennes de métiers ancestraux. À travers l'étude de ces deux dynamiques
dans quatre entreprises appartenant à deux métiers hérités du passé et représentant deux
générations différentes d'entreprises artisanales, cette thèse a pour but de comprendre la
particularité de ces deux dynamiques qui sont considérées comme indispensables à la
survie de cette catégorie spécifique de métiers dans le contexte de la globalisation. En
outre, cette étude a pour objectif d'apporter un éclairage sociologique sur les logiques de
fonctionnement, les structures et les dynamiques internes de ce type d'entreprise qui est
rarement abordé par les recherches sociologiques jusqu'à maintenant. L'étude montre les
liens de dépendance entre, d'une part, l'innovation et la transmission des savoirs et, d'autre
part, entre ces deux dynamiques et les différentes structures et les autres dynamiques de
l'entreprise, notamment l'organisation du travail, la gestion des ressources humaines et les
facteurs socioculturels. De plus, elle montre que la promotion et la conciliation de
l'innovation et de la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels permettent
à l'entreprise artisanale de métier ancestral de s'adapter aux exigences du contexte de la
concurrence accrue par la globalisation tout en conservant les caractéristiques identitaires
de ce genre de métier qui constitue une partie intégrante du patrimoine culturel de la société
locale. Ceci passe inévitablement par l'adaptation des pratiques organisationnelles, des
pratiques managériales et des dynamiques socioculturelles de l'entreprise aux exigences des
dynamiques de l'innovation et de la transmission intergénérationnelle des savoirs
professionnels. De même, il est fondamental que les champs couverts par ces deux
dynamiques favorisent à la fois le changement et la reproduction. Par ailleurs, il est
important d'adapter les objectifs de chacune des deux dynamiques aux objectifs de l'autre.
Tout cela devient sans effet si la culture du métier ne valorise pas les deux dynamiques en
question : l'innovation et la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels.
Résumé Long
Après avoir été marginalisé par les plans de développement économique tout au long des
trois premières décennies de l'indépendance, le secteur des entreprises artisanales de
métiers ancestraux en Tunisie est devenu au cœur des intérêts politiques et économiques du
pays vers la fin du vingtième siècle. Cet intérêt, qui s'est développé parallèlement à
l'inscription de la Tunisie dans la logique de la globalisation par la libéralisation totale de
son économie, s'est concrétisé par le lancement de plusieurs programmes qui participent
d'une stratégie globale visant la transformation de ce secteur en un véritable pôle de
création de richesse et d'emploi et de conservation d'une partie importante de la culture
locale. De ce fait, les responsabilités de cette catégorie spécifique d'entreprise dans le
contexte de la globalisation sont de trois types : une responsabilité économique, une
responsabilité sociale et une responsabilité culturelle. Dans cette thèse, nous avons étudié
les deux dynamiques indispensables à la réussite des entreprises artisanales tunisiennes de
métiers ancestraux dans ses différentes responsabilités : l'innovation et la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels.
En étudiant ces deux dynamiques dans quatre entreprises appartenant à deux corps de
métiers ancestraux, soit deux entreprises associées à un métier en prospérité (la poterie
artisanale) et deux autres faisant partie d'un métier en crise (le tapis du sol), cette recherche
a permis de tirer les constats suivants :
1) L'innovation constitue le chemin à travers lequel l'entreprise artisanale de métier
ancestral peut assumer ses responsabilités économiques et sociales: la création de la
richesse et des emplois.
2) La transmission intergénérationnelle constitue la voie par laquelle cette catégorie
d'entreprise peut accomplir sa responsabilité culturelle, soit la conservation des
caractéristiques identitaires des métiers ancestraux qui constituent une partie intégrante du
patrimoine culturel du pays.
11
3) La conciliation entre l'innovation et la transmission intergénérationnelle des savoirs
professionnels permet aux entreprises de métiers hérités du passé d'assurer leur pérennité
sans perdre leurs caractéristiques identitaires.
4) L'innovation ainsi que la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels
au sein de l'entreprise artisanale de métier ancestral dépendent étroitement de
l'organisation du travail, de la gestion des ressources humaines et des dynamiques
socioculturelles de l'entreprise.
5) La conciliation entre l'innovation et la transmission intergénérationnelle des savoirs
professionnels dépend de facteurs intrinsèques qui leur sont propres, ainsi que de facteurs
extrinsèques qui se rapportent au contexte de la production.
6) La culture du métier influence directement tant l'innovation que la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels au sein de l'entreprise artisanale de métier
ancestral.
Globalement, l'étude a permis de dégager :
1) la particularité de cette catégorie spécifique d'entreprise, à savoir ses dynamiques
organisationnelles, humaines, managériales, sociales et culturelles;
2) la particularité de l'innovation au sein de l'entreprise artisanale tunisienne de métier
ancestral, à savoir ses champs, ses déterminants, ses effets, ses logiques de fonctionnement
et ses dynamiques sociales;
3) la particularité de la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels dans
cette catégorie d'entreprise, à savoir ses champs, ses déterminants, ses effets, ses logiques
de fonctionnement et ses dynamiques sociales;
4) les déterminants de la promotion de l'innovation et de la transmission des savoirs
professionnels, ainsi que ceux de la conciliation entre elles, au sein de l'entreprise
pratiquant un métier appartenant à l'époque préindustrielle.
m
Remerciement
Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur Daniel Mercure, mon directeur de thèse,
de m'avoir ouvert la voie aux études doctorales à l'Université Laval et d'avoir fait de ces
études une expérience constructive et pleine de plaisir. Sa grande disponibilité, ses
encouragements, son assistance, ses contributions, son soutien et ses judicieuses
recommandations m'ont permis de surmonter les difficultés de tous types que j'ai
rencontrés au cours de mes cinq années de thèse et m'ont donné le goût de la recherche. Je
veux remercier également Madame Fathya Barouni Ben Sedrine, ma directrice de Master
en Tunisie, de m'avoir encadré dans mes premiers pas de recherche en sociologie. Je tiens
à remercier aussi tous les professeurs qui m'ont enseigné tout au long de mon cursus
universitaire en sociologie qui a débuté en Tunisie, à la Faculté des lettres et des sciences
humaines de Sfax et à la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, et qui a pris
fin au Canada, à l'Université Laval de Québec.
Je remercie les responsables de l'Office National de l'Artisanat en Tunisie ainsi que les
responsables des délégations régionales de cet office à Monastir et à Kairouan pour les
aides qu'ils m'ont apporté tout au long de l'enquête du terrain relative à cette thèse. Je
tiens aussi à remercier tous les membres des quatre entreprises qui ont bien voulu participer
à cette enquête.
Finalement, je ne voudrais pas passer sous silence le soutien de ma mère, de mes frères, de
mes sœurs, de ma belle aimée, de mes amis et de mes collègues qui m'ont offert
généreusement leur support tout au long de la réalisation de cette thèse.
iv
Je dédie ma thèse : A la mémoire de mon père qui m'as appris la persévérance A ma mère qui m'as appris la patience A mes frères qui m'ont appris la discipline dans le travail A mes sœurs qui m'ont appris le sacrifice A mon âme sœur qui m'a soutenu dans les moments difficiles
Tables des matières Résumé court i Résumé Long ii Liste des tableaux xi Liste des schémas xi Liste des cartes xi Liste des photographies xi Liste des annexes xi
Introduction générale Le retour de l'entreprise artisanale de métier ancestral 3 Les atouts socioéconomiques de l'entreprise artisanale de métier ancestral à l'heure de la globalisation 5 Les atouts culturels de l'entreprise artisanale de métier ancestral à l'heure de la globalisation 7
PREMIÈRE PARTIE : LES CADRES DE LA RECHERCHE
Chapitre 1. Cadre général de la recherche : objet de la recherche
1. La problématique 12 1.1 Les entreprises artisanales tunisiennes de métiers ancestraux face à de nouvelles contraintes 14 1.2 Les responsabilités de l'entreprise artisanale à l'heure de la globalisation 15 1.3 Les entreprises artisanales de métiers ancestraux tunisiennes face à la globalisation : les résultats enregistrés 17 1.4 Les chemins de la réussite 19
2. Les objectifs et les limites de la recherche 22
3. L'approche théorique de la recherche : l'interactionnisme symbolique 24
Chapitre 2. Les entreprises artisanales tunisiennes et le contexte de la globalisation : mise en contexte de la recherche
1. L'artisanat en Tunisie 29 1.1 La Tunisie : aperçu général 29 1.2 Cadre réglementaire et institutionnel des entreprises artisanales tunisiennes 33 1.3 Le secteur des entreprises artisanales de métiers ancestraux en Tunisie : quelques données significatives 40
2. Tunisie et globalisation : nouveaux défis et nouvelles contraintes pour l'entreprise artisanale tunisienne de métier ancestral 43 2.1 La globalisation : un phénomène à facettes multiples 43 2.2 L'intégration de la Tunisie dans la globalisation 48
Chapitre 3. Cadre conceptuel de la recherche : entreprise artisanale de métier ancestral, transmission des savoirs professionnels et innovation
1. L'entreprise artisanale de métier ancestral 54 1.1 Les caractéristiques identitaires de l'entreprise artisanale de métier ancestral 54 1.2 Les spécificités du processus de la production au sein de l'entreprise artisanale de métier ancestral 58
2. La transmission des savoirs professionnels 62 2.1 Les savoirs professionnels: de la qualification à la compétence 62 2.1.1 La qualification professionnelle 63 2.1.2 La compétence professionnelle 65 2.2 La transmission des savoirs professionnels dans les milieux de travail 67 2.2.1 La transmission des savoirs professionnels dans les entreprises : un processus interactif 68 2.2.2 La transmission des savoirs professionnels dans les entreprises : un processus dynamique et complexe 69
3. L'innovation 73 3.1 La notion d'innovation : sens et application dans le monde des entreprises 73 3.1.1 L'innovation : sens et signification 74 3.1.2 La notion d'innovation appliquée au monde des entreprises 75 3.2 L'innovation au sein de l'entreprise : les sources et les déterminants 79 3.2.1 Les sources de l'innovation au sein de l'entreprise 79 3.2.2 Les déterminants de l'innovation dans l'entreprise 81
Chapitre 4. Le cadre opérationnel : la mise en action de la recherche
1. Modèle d'analyse et hypothèses 85 1.1 Le modèle d'analyse et d'observation : les variables 86 1.1.1 Les variables dépendantes 86 1.1.1.1 La première variable dépendante : les dynamiques de la transmission des savoirs professionnels 87 1.1.1.2 La deuxième variable dépendante : les dynamiques de l'innovation 88 1.1.2Les variables indépendantes 90 1.1.2.1 La première variable indépendante : l'organisation du travail 91 1.1.2.2 La deuxième variable indépendante : la gestion des ressources humaines 93 1.1.2.3 La troisième variable indépendante : Les dynamiques socioculturelles 95 1.2 Les hypothèses de la recherche 98 1.2.1 L'hypothèse principale 98 1.2.2 Les hypothèses secondaires 99
vi
2. La stratégie de la recherche 99 2.1 La méthode de la recherche : la méthode qualitative 99 2.2 Les techniques de collecte de données : l'entrevue semi-dirigée et l'observation directe 101
2.3 La technique d'analyse des données : la méthode ancrée 103
3. Le travail du terrain 105 3.1 L'échantillonnage 105 3.2 Les modalités du travail sur terrain 106
PARTIE 2 : PRÉSENTATION ET DESCRIPTION DES RÉSULTATS Innovation et transmission des savoirs professionnels à l'épreuve des
métiers
Chapitre 5. le cas de la poterie artisanale (A)
1. La poterie artisanale de Moknine : la ville et le métier 112 1.1 La ville de Moknine : aperçu général 112 1.2 La poterie de Moknine : aperçu général 113 1.3 La poterie de Moknine aujourd'hui 116
2. L'entreprise Al : l'entreprise domestique 119 2.1 Profil de l'entreprise Al : l'organisation, la gestion des ressources humaines et les dynamiques socioculturelles 119 2.1.1 L'organisation du travail dans l'entreprise Al 120 2.1.2 La gestion des ressources humaines dans l'entreprise Al 122 2.1.3 Les dynamiques socioculturelles de l'entreprise Al 124 2.2 L'entreprise Al et l'innovation 126 2.3 L'entreprise Alet la transmission des savoirs professionnels 129
3. L'entreprise A2 : l'entreprise non domestique 133 3.1 Profil de l'entreprise A2 : l'organisation, la gestion des ressources humaines et les dynamiques socioculturelles 133 3.1.1 L'organisation du travail dans l'entreprise A2 134 3.1.2 La gestion des ressources humaines dans l'entreprise A2 136 3.1.3 Les dynamiques socioculturelles dans l'entreprise A2 139 3.2 L'entreprise A2 et l'innovation 142 3.3 L'entreprise A2 et la transmission des savoirs professionnels 145
Chapitre 6. Le cas du tapis du sol (B)
1. Tapis artisanal du Kairouan : la ville et le métier 151 1.1 La ville de Kairouan 151 1.2 Tapis de Kairouan : aperçu général 153 1.3 Le tapis de Kairouan aujourd'hui 156
vu
2. L'entreprise BI : l'entreprise domestique 158 2.1 Profil de l'entreprise : l'organisation, la gestion des ressources humaines et les dynamiques socioculturelles 158 2.1.1 L'organisation du travail 159 2.1.2 La gestion des ressources humaines 161 2.1.3 Les dynamiques socioculturelles 163 2.2 L'entreprise BI et l'innovation 165 2.3 L'entreprise BI et la transmission des savoirs professionnels 168
3. L'entreprise B2 : l'entreprise non domestique 171 3.1 Profil de l'entreprise B2 : l'organisation, la gestion des ressources humaines et les dynamiques socioculturelles 171 3.1.1 L'organisation du travail dans l'entreprise B2 172 3.1.2 La gestion des ressources humaines dans l'entreprise B2 175 3.1.3 Les dynamiques socioculturelles dans l'entreprise B2 177 3.2 L'entreprise B2 et l'innovation 180 3.3 L'entreprise B2 et la transmission des savoirs professionnels 183
PARTIE 3 : ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS Les dynamiques de l'innovation et de la transmission des savoirs
professionnels à l'épreuve de l'entreprise artisanale de métier ancestral
Chapitre 7. Les dynamiques de l'innovation au sein de l'entreprise artisanale de métier ancestral
1. Les champs de l'innovation au sein de l'entreprise artisanale de métier ancestral 190 1.1 L'innovation de production 191 1.1.1 L'innovation organisationnelle 191 1.1.2 L'innovation de produit 193 1.1.3 L'innovation dans les outils de travail 195 1.2 L'innovation de commercialisation 197 1.2.1 L'innovation de marché 197 1.2.2 L'innovation des moyens de commercialisation 199
2. Les déterminants de l'innovation au sein de l'entreprise artisanale de métier ancestral 203 2.1 Les déterminants relatifs aux caractéristiques intrinsèques des acteurs de l'entreprise203 2.1.1 Le chef de l'entreprise comme déterminant de l'innovation dans l'entreprise artisanale de métier ancestral 204 2.1.2 Les artisans évoluant dans l'entreprise comme déterminant de l'innovation dans l'entreprise artisanale de métier ancestral 206 2.2 Les déterminants en lien avec le contexte de la production 209 2.2.1 Le modèle organisationnel comme déterminant de l'innovation au sein de l'entreprise artisanale de métier ancestral 209
v i 11
2.2.2 La politique managériale comme déterminant de l'innovation dans l'entreprise artisanale de métier ancestral 212 2.2.3 La culture d'entreprise et la culture de métier comme déterminants de l'innovation dans l'entreprise artisanale de métier ancestral 213
3. Les impacts de l'innovation dans un contexte d'entreprise artisanale de métier ancestral 216 3.1 Les impacts de l'innovation sur les individus dans l'entreprise artisanale de métier ancestral 217 3.1.1 Les impacts de l'innovation sur le vécu personnel de l'individu 217 3.1.2 Les impacts de l'innovation sur le vécu professionnel de l'individu 220 3.2 Les impacts de l'innovation sur l'entreprise artisanale de métier ancestral 222 3.2.1 Les impacts de l'innovation sur les activités productives et commerciales de l'entreprise 223 3.1.2.1 Les impacts de l'innovation sur l'activité productive de l'entreprise 223 3.1.2.2 Les impacts de l'innovation sur l'activité commerciale de l'entreprise 225 3.2.2 Les impacts de l'innovation sur les résultats économiques de l'entreprise 226
Chapitre 8. Les dynamiques de la transmission des savoirs professionnels dans un contexte d'entreprise artisanale de métier ancestral
1. Les champs de la transmission des savoirs professionnels dans le contexte de l'entreprise artisanale de métier ancestral 234 1.1 La transmission des savoirs requis par le métier 234 1.1.1 La transmission des savoirs professionnels d'ordre théorique 235 1.1.2 La transmission des savoirs professionnels d'ordre pratique 237 1.2 La transmission des savoirs socialisant à la vie professionnelle et au métier 240 1.2.1 La transmission des normes et des valeurs qui régissent les comportements au sein de l'entreprise 240 1.2.2 La transmission des normes et des valeurs culturelles du métier 242
2.Les déterminants de la transmission des savoirs professionnels dans le contexte de l'entreprise artisanale de métier ancestral 246 2.1 Les déterminants humains de la transmission des savoirs professionnels 246 2.1.1 L'artisan expert comme déterminant dans la transmission des savoirs professionnels 247 2.1.2 Le novice comme déterminant dans la transmission des savoirs professionnels 249 2.1.3 Le collectif de travail comme déterminant la transmission des savoirs professionnels 252 2.2 Les déterminants sociotechniques de la transmission des savoirs professionnels 254 2.2.1 Les déterminants organisationnels de la transmission des savoirs professionnels ....254 2.2.2 Les déterminants managériaux de la transmission des savoirs professionnels 257 2.2.3 Les déterminants sociaux de la transmission des savoirs professionnels 260
3. Les effets de la transmission des savoirs professionnels dans le contexte de l'entreprise artisanale de métier ancestral 263 3.1 Les effets de la transmission des savoirs professionnels sur les individus 264
ix
3.1.1 Les effets de la transmission des savoirs professionnels sur la vie professionnelle du novice 264 3.1.2 Les effets de la transmission des savoirs professionnels sur la vie sociale du novice dans et en dehors de l'entreprise 266 3.2 Les effets de la transmission des savoirs professionnels sur l'entreprise 267 3.2.1 Les effets de la transmission des savoirs professionnels sur la production 268 3.2.2 Les effets de la transmission des savoirs professionnels sur les dynamiques sociales de la production 270
Chapitre 9. Innovation et transmission des savoirs professionnels au sein de l'entreprise artisanale de métier ancestral : la conciliation
1. La conciliation entre les processus de l'innovation et de la transmission des savoirs professionnels : les facteurs intrinsèques aux deux processus 276 1.1 Les facteurs intrinsèques au processus de l'innovation 277 1.1.1 Le type de l'innovation comme facteur de conciliation 277 1.1.2 Les savoirs mobilisés dans l'innovation comme facteur de conciliation 279 1.2 Les facteurs intrinsèques au processus de la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels 281 1.2.1 La socialisation au changement comme facteur de conciliation 281 1.2.2 La formation à l'innovation comme facteur de conciliation 283
2. La conciliation entre les processus de l'innovation et de la transmission des savoirs professionnels : les facteurs extrinsèques aux deux processus 285 2.1 Les facteurs relatifs aux individus 286 2.1.1 Les représentations de l'innovation et de la transmission des savoirs professionnels comme déterminant dans la conciliation 286 2.1.2 La compétence professionnelle des artisans experts comme déterminant dans la conciliation 288 2.2 Les facteurs en lien avec le fonctionnement de l'entreprise 290 2.2.1 L'organisation du travail comme déterminant dans la conciliation 291 2.2.2 La gestion des ressources humaines comme déterminant dans la conciliation 292
CONCLUSION 296
BIBLIOGRAPHIE 304 ANNEXES 329
Liste des tableaux Tableau 1 : Évolution de la création d'emploi dans le secteur de l'artisanat en Tunisie 41 Tableau 2: La composition de la variable des dynamiques de la transmission des savoirs professionnels 88 Tableau 3: La composition de la variable des dynamiques de l'innoyation 90 Tableau 4: La composition de la variable de l'organisation du travail 93 Tableau 5: La composition de la variable de la gestion des ressources humaines 95 Tableau 6: La composition de la variable des dynamiques socioculturelles 97 Tableau 7: Répartition des entreprises étudiées 110 Tableau 8: L'évolution des bénéfices des entreprises Al, A2 et B2 entre 2003 et 2007....228
Liste des schémas Schéma 1 : Les acteurs de l'artisanat en Tunisie 37 Schéma 2: Le modèle d'analyse et d'observation 98 Schéma 3: Les champs de l'innovation dans le contexte d'entreprise artisanale de métier ancestral 202 Schéma 4: Les déterminants de l'innovation dans le contexte d'entreprise artisanale de métier ancestral 216 Schéma 5: Les dimensions affectées par l'innovation dans un contexte d'entreprise artisanale de métier ancestral 231 Schéma 6: Les champs de la transmission des savoirs professionnels dans le contexte de l'entreprise artisanale de métier ancestral 245 Schéma 7: Les déterminants de la transmission des savoirs professionnels dans le contexte de l'entreprise artisanale de métier ancestral 263 Schéma 8: Les dimensions affectées par la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels dans un contexte d'entreprise artisanale de métier ancestral 273 Schéma 9: Les déterminants de la conciliation entre l'innovation et la transmission des savoirs professionnels 295
Liste des cartes Carte 1: Ville de Moknine 112 Carte 2: Gouvemorat de Kairouan 152
Liste des photographies Photographie 1 : Centre ville de Mokenine 113 Photographie 2 : Entrée de la ville de Kairouan 153
Liste des annexes Annexe 1: Conseil National de l'Artisanat 330 Annexe 2: La Fédération Nationale de l'Artisanat 332 Annexe 3: Le conseil des métiers 333 Annexe 4: Centre Technique de Création, d'Innovation et d'Encadrement du Tapis et du Tissage 334 Annexe 5: Les Chambres de Commerce et d'Industrie 335 Annexe 6: Fonds National de Promotion de l'Artisanat et des Petits Métiers (FONAPRAM) 336
xi
Annexe 7: Fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielle (FOPRODI) 337 Annexe 8: Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME) 338 Annexe 9: Guide d'entrevue auprès de personnes agissant au sein des entreprises étudiées
339 Annexe 10: Guide d'entrevue auprès de personnes agissant au sein des institutions étatiques se préoccupant du secteur d'entreprises artisanales 341 Annexe 11: Grille d'observation 343 Annexe 12: Les activités artisanales en Tunisie 345 Annexe 13: Les centres de production artisanale de la poterie en Tunisie 347 Annexe 14: Tour de potier 348 Annexe 15: Les centres de production de tapis artisanal en Tunisie 349 Annexe 16: Métier à tisser 350 Annexe 17: Peigne de tissage 351 Annexe 18: Label de qualité de tapis 352 Annexe 19: Exemples de produits à vocation décorative et horticole 353
Xll
«L'abandon des métiers artisanaux n 'est que le leurre fatal du régime capitaliste» Alfred Sauvy, La tragédie du pouvoir (1979)
Introduction générale :
Depuis la fin du 20e siècle, il est de plus en plus difficile d'appréhender des phénomènes
relatifs au travail, à l'emploi et aux entreprises sans faire le lien avec le phénomène de la
globalisation. La globalisation, considérée le plus souvent comme une nouvelle époque
historique pour l'humanité, s'est concrétisée par la naissance d'un nouveau système-monde
(Wallerstein, 2001). Cette époque se caractérise par l'interdépendance (Sassen, 2009) entre
les nations dans presque tous les aspects de la vie humaine. L'expansion sans précédent de
la mondialisation de l'économie, associée à d'autres facteurs, reste, sans aucun doute, la
locomotive principale du changement ainsi que l'image de marque de l'époque de la
globalisation (Thawaites, 2004). Ainsi, des mutations profondes, voir radicales, ont modifié
les conditions d'existence des humains et des organisations. Ces transformations sont les
résultantes d'un long processus dans lequel s'est mêlé des dynamiques de divers types
depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Lorsqu'on évoque la globalisation revient les idées d'interdépendance accélérée, de rétrécissement du monde (érosion des frontières et des barrières géographiques aux activités socio-économiques), d'action à distance, de compression de l'espace et du temps. Il est question d'intégration globale, de recomposition des relations interrégionales, de conscience de la condition globale, d'intensification de l'interconnectivité. (Abélès, 2008 : 17)
Si ces changements ont eu pour contexte d'apparition le monde occidental, ils ont exercé
progressivement une influence plus au moins planétaire. Le monde du travail et des
entreprises est sensiblement transformé par ces changements (Capron, 2004). Par ses
multiples configurations (économique, culturelle, sociale, politique, etc.), la globalisation a
induit des changements comme elle a entrainé de nouvelles dynamiques dans les différentes
sphères de l'univers du travail et de la production. Depuis que la mondialisation de
l'économie a imposé ses règles de jeu, les entreprises des quatre coins de la planète et de
tous les types sont considérablement appelées à se transformer afin de pouvoir
s'accommoder avec la nouvelle situation caractérisée, entre autres, par le libre échange et
l'hyper compétitivité. Le travail et l'entreprise artisanale dans les pays fortement impliqués
dans le processus de la globalisation n'échapperont pas à ces changements et à ces
nouvelles dynamiques.
Les thèses des théoriciens marxistes, qui soutiennent que le monde serait un jour sous le
contrôle d'un tout petit nombre de grandes entreprises qui domineraient l'économie de la
planète par leurs diverses activités (financières, commerciales et industrielles), semblent
trouver le terrain propice pour se concrétiser dans la nouvelle ère. Or, en ce début du 21e
siècle, la réalité est totalement à l'inverse de ces thèses. Les très petites, les petites et les
moyennes entreprises constituent largement notre environnement le plus immédiat. Cette
réalité englobe les entreprises dites artisanales. Cette situation n'est nullement spécifique à
un seul pays ou une région du monde; elle est commune à plusieurs pays. De ce fait, les
entreprises artisanales ont échappé encore une fois à la disparition. Après avoir surmonté
les menaces de la révolution industrielle et du capitalisme (Jaeger, 1982), ce type
d'entreprise a su encore une fois s'acclimater au nouvel ordre économique mondial imposé
par le processus de la mondialisation de l'économie. En d'autres termes, les entreprises
artisanales, malgré qu'elles ne disposent pas de grandes quantités de capitaux, n'appliquent
pas les principes de l'économie d'échelle et n'emploient pas un nombre très élevé de
salariés comme c'est le cas dans les grandes entreprises; elles continuent à survivre et
même à croître en nombre. Le sort de ce mode de production est devenu une question
d'actualité, surtout dans les pays où celui-ci est considéré comme un véritable appoint pour
leurs économies, sociétés et cultures dans le contexte de la globalisation.
Dans un tel contexte, les intérêts des spécialistes en matière de travail et d'entreprise sont
modifiés. Après avoir privilégié l'étude des grandes entreprises et l'impact de leur
organisation du travail sur la société tout au long du 20e siècle, ces spécialistes
commencent, au début de ce 21e siècle, à manifester un intérêt considérable pour les
entreprises de petites tailles, notamment les entreprises artisanales. Après avoir été
considérée pendant longtemps à la marge de la société du travail, l'entreprise artisanale est
devenue au centre des intérêts des chercheurs, des pouvoirs politiques et des mouvements
sociaux dans les pays où l'artisanat n'a été ni détruit ni absorbé par l'économie capitaliste.
Ce changement de regard sur ce type d'entreprise est dû principalement à :
1) Sa capacité de résoudre les problèmes rencontrés par les grandes entreprises;
2) Sa capacité d'offrir une alternative sociale, économique et culturelle en période de crise
structurant le monde en ce début du nouveau millénaire.
Le retour de l'entreprise artisanale de métier ancestral
Dans un tel contexte de recomposition, l'image de l'entreprise artisanale fait l'objet d'une
communication nouvelle. D'une manière générale, on distingue à l'époque actuelle deux
types d'entreprises artisanales : l'entreprise artisanale de métier ancestral et l'entreprise
artisanale de modernité (Marchesnay, 2003). La différence entre les deux types sera
précisée à une étape ultérieure (Les objectifs et les limites de la thèse). L'entreprise
artisanale de métier ancestral, qui nous intéresse dans la présente recherche, a été pendant
longtemps perçue comme synonymes d'évolution tardive et comme survivance du passé
dans la mesure où elle est héritée de l'époque préindustrielle. Ce type d'entreprises
concerne, en effet, les unités productives qui pratiquent des métiers traditionnels hérité du
passé et qui se caractérisent par la prédominance du travail manuel. À l'heure de la
mondialisation de l'économie, on a cru qu'il serait éliminé définitivement avec la
concentration des capitaux, l'évolution des techniques et l'abolition des frontières
douanières. Aucun de ces phénomènes n'a contribué à la disparition de ces unités de
production. Au moment où on attendait l'éclipsé définitive de l'organisation du travail
artisanale dans l'économie de production en série (Piore et Sabel, 1984) on assiste à un
regain spectaculaire d'intérêt pour l'artisanat.
Historiquement, l'artisanat est défini comme le regroupement d'un ensemble de métiers
véhiculant des capitaux de savoir et de savoir-faire (Zarca, 1988) objectivés dans des
œuvres fabriquées principalement manuellement. Les œuvres artisanales diffèrent des
œuvres industrielles par leurs singularités. Elles sont, donc, loin d'être standardisées et
universelles dans la mesure où l'artisanat fait référence à des réalités différentes selon les
pays et les métiers. Dans les temps modernes, ces métiers sont devenus par excellence un
champ d'intérêt économique, social, politique et scientifique. L'artisan et l'entreprise
artisanale sont de nouveau placés au centre de la vie sociale et économique. Les pouvoirs
politiques et publics de la majorité écrasante des pays du globe prennent, comme jamais
auparavant, au sérieux le sujet de l'artisanat (khalfaoui, 2006). Dans les pays du nord
comme dans les pays du sud, le nombre des entreprises répertoriées dans la catégorie
artisanale ne cesse d'évoluer depuis la fin du 20e siècle (Jaeger, 1982), sans constituer une
catégorie universelle puisque chaque pays à sa propre définition sociale et juridique de
l'artisanat en général et de l'entreprise artisanale en particulier.
Après avoir été négligé pendant longtemps par les études et présenté comme un secteur en
déclin, l'artisanat dans tous ses aspects est devenu par excellence un objet qui attire
l'attention des chercheurs appartenant à diverses disciplines (Polge et Fourcade, 2005;
Marcq, 2007; Boldrini, 2007; etc). Ces études essayent de trouver les explications logiques
de la présence relativement massive et surtout paradoxale de l'artisanat dans les sociétés
contemporaines. Les entreprises artisanales de métiers ancestraux, présumées auparavant
trop archaïques et réputées trop petites pour survivre dans la concurrence, marquent, que ce
soit par leur nombre ou leurs produits, une très forte présence dans ces sociétés qualifiées
d'hypermodernes. Certains métiers ancestraux considérés le plus souvent comme trop
traditionnels pour suivre l'innovation, caractérisant notre époque actuelle, coexistent avec
des métiers nouvellement inventés. L'artisan, accusé jadis d'irrationalité qui ne lui permet
pas d'amplifier son champ d'action, existe toujours et d'une façon plus remarquable dans
les différentes sphères de la vie, sociale, économique, politique et culturelle. Les artisans,
au même titre que les entrepreneurs, sont des agents importants de la croissance et de
l'innovation (Schieb-Bienfait et Journé-Michel, 2005; Jorda, 2006).Tous ces éléments
expliquent l'intérêt majeur accordé à l'univers de l'artisanat dans le contexte de la
globalisation. En effet, la globalisation provoque la recomposition des espaces sans
entraîner la disparition des espaces locaux et régionaux. Elle contribue de certaines
manières à les renforcer (Courlet et Abdelmalki, 1996). Bref, l'artisanat a su répondre à ce
nouveau contexte en préservant des emplois et en créant de nouvelles opportunités
d'emploi tout en apportant aux paniers des consommateurs des produits et des services de
qualité.
Ce contexte semble être un temps de revanche pour l'artisanat qui a subi, tout au long du
siècle précédent, la domination du modèle industriel qui s'est fondé réellement sur les
gravats du modèle artisanal qui a structuré les formes de production dans les sociétés
préindustrielles (Jaeger, 1982; Piore et Sabel, 1984; Zarca, 1986, Caron, 2000; Pinard,
2008). Actuellement, on parle de plus en plus d'une résurrection de l'artisanat et de ses
valeurs. Alors, quelles sont les valeurs qui permettent aux entreprises de l'artisanat de
coexister avec les firmes géantes de l'industrie et de devenir un centre d'intérêt ?
Les atouts socioéconomiques de l'entreprise artisanale de métier ancestral à l'heure de la globalisation
Certes, l'intérêt des différents acteurs ne concerne pas l'artisanat du 19e siècle, il concerne
plutôt l'artisanat qui s'adapte aux exigences du 21e siècle sans altérer son caractère
traditionnel, que ce soit dans la production ou les produits. Certains de ces acteurs voient
dans l'artisanat l'avenir de la société post-industrielle (Boutillier et Fouriner, 2006). Une
société qui tente de trouver de nouveaux modes de production et d'organisation de travail
permettant de surmonter la crise du système industriel de l'époque contemporaine et de
remédier aux anomalies de la globalisation. Les supporteurs de l'artisanat au 21e siècle la
considèrent comme un réservoir d'emploi, un secteur d'activité faiblement capitaliste,
particulièrement attractif pour des travailleurs recherchant l'indépendance, ou plus
simplement un emploi dans une période de crise du salariat (Jaeger, 1982). L'artisanat et les
entreprises artisanales de métiers ancestraux constituent par conséquent des zones
d'emplois à exploiter. Dans le même ordre d'idées, l'artisanat offre l'occasion de valoriser
des savoir-faire occultés et/ou difficiles à gérer par les grandes entreprises de type industriel
(Jorda, 2006). De ce fait, l'artisanat semble être capable de remplir des fonctions sociales et
économiques. En plus de sa capacité de créer de la richesse en produisant des articles non
standardisés et facilement commercialisables (Livio, 2004), les entreprises artisanales de
métiers ancestraux contribuent à la création d'emplois à toutes les catégories y compris à
celles qui ont des difficultés pour accéder au marché du travail, telles que les jeunes, les
femmes, etc. (Boutillier, 2006). La crise et le chômage font donc renaître l'artisanat de ses
cendres. L'artisanat se présente, aussi, comme champ d'activité facilement accessible pour
les chassés et les exclus du système salarial (Kizaba, 2006). Elle se présente, en effet,
comme un canal supplémentaire d'insertion professionnelle à l'époque où cette insertion est
devenue de plus en plus problématique pour plusieurs catégories d'âge et sociale.
La flexibilité, qui est devenue la norme pour les entreprises contemporaines de toutes tailles
(Mercure, 2001), constitue un autre facteur qui permet à l'artisanat de faire un retour en
force (Marchesnay, 2004). Dans un contexte où le modèle du travail qui a dominé au cours
de la deuxième moitié du vingtième siècle commence à être remis en question, l'entreprise
artisanale a l'avantage d'être flexible dans la mesure où elle se caractérise par la visibilité
de son organisation, la simplicité de son organisation du travail et l'échelle réduite de sa
production (Boutillier, 2006, Fournier et Picard, 2009). La petite taille, considérée comme
un handicap pour l'entreprise artisanale dans le contexte de la forte industrialisation, ne
l'est plus à l'heure actuelle. Au contraire, la petitesse est devenue un point fort dans les
temps modernes. La petite taille de l'entreprise artisanale constitue une garantie de
compétitivité (Marchesnay, 2004; Le Roy, 2001). En s'appuyant sur ses compétences
individualisées et sa culture de travail et de production, l'entreprise artisanale est capable de
créer des produits et des œuvres originales caractérisées, entre autres, par leur cohérence en
termes de qualité d'usage, de fonctionnalités techniques et esthétiques tout en respectant les
humains et l'environnement (Jouffroy, 2004). Ces caractéristiques permettent à l'artisanat
d'être concurrentiel dans une ère où ce genre de produits est devenu de plus en plus
demandé.
Les produits de l'artisanat sont testés par l'opinion mondiale comme produits un peu plus chers certes, mais économiquement ils sont trois à quatre fois plus solides et durables que ceux de la production de masse. Les produits faits main sont esthétiques et répondent au gout des consommateurs les plus difficiles. Ils sont conformes à l'hygiène de la santé, à la qualité de la vie et à l'environnement. (Tehami, 2010 :1)
De nos jours, la conscience progressive des consommateurs sur effets néfastes de la
production industrielle et de la mondialisation de l'économie sur les humains et la nature
les a conduits à chercher des produits fabriqués autrement (Dobré et Juan, 2009). Cette
catégorie de consommateurs ne cesse de se développer grâce aux grands efforts des
mouvements sociaux et des organisations qui ont émergés partout dans le monde, en
réaction aux inégalités de tous types et aux problèmes sociaux, écologiques et
environnementaux considérés comme les conséquences de l'industrialisation massive et du
nouvel ordre économique mondial. Ce changement d'attitude, chez les consommateurs,
offre à l'artisanat une raison de plus pour occuper une place sous le soleil dans les sociétés
actuelles et futures. L'entreprise artisanale a une occasion inédite de rayonner là ou la
grande entreprise ne peut pas exercer son emprise (Jorda, 2006). De nos jours, les
consommateurs exigent de plus en plus de produits équitables fabriqués dans de bonnes
conditions de travail tout en respectant l'environnement. Grâce à ses spécificités, le produit
artisanal typique et authentique répond aux nouvelles revendications. Il est un produit
fabriqué, généralement, manuellement (Ba, 2006) dans des petits ateliers faiblement
hiérarchisés (Jaeger, 1982) et caractérisés par des liens de proximité (Le Roux, 2006). De
même, le produit artisanal original est constitué essentiellement de matières premières
naturelles sans ajout ou modification.
Ces quelques caractéristiques intrinsèques des produits artisanaux et de la production
artisanale témoignent de la concordance de l'artisanat, de ses valeurs et de ses modes
opératoires aux nouvelles exigences de consommation. L'entreprise artisanale est donc à la
mode. Elle est socialement responsable (Polge, 2008) dans la mesure où elle participe
activement à la croissance économique en suivant le modèle du développement durable qui
est devenu un des mots de premier ordre au début de ce 21e siècle (Guay, 2004).
Les atouts culturels de l'entreprise artisanale de métier ancestral à l'heure de la globalisation
La mondialisation de l'économie est loin d'être l'unique manifestation du phénomène de la
globalisation. Elle est plutôt un phénomène à multiples facettes (Michelet, 2004). La
mondialisation de la culture demeure une autre manifestation concrète de ce phénomène.
Le développement spectaculaire des technologies de l'information et de la communication
dans le nouveau système-monde a contribué à la diffusion des produits et des valeurs
culturelles (Wallerstein, 2009 ; Vultur, 2002) véhiculant un modèle culturel global
favorisant le succès de ce système.
La globalisation renvoie aussi à l'idée d'une homogénéisation de la culture et du style de vie, un abandon des traditions et des économies locales (...) Les nouvelles formes culturelles qui se généralisent dans le temps pour permettre aux individus d'exploiter rationnellement leur environnement économique. (Nahavandi, 2000 : 18 et 19)
7
L'inégalité partout sur la planète en matière de l'économie et des moyens de
communication ( Landau, 2006) a permis aux pays concepteurs du nouveau système monde
de diffuser leurs modèles culturels partout sur la planète. Étant donné les relations
d'interdépendance dans ce système, les modèles culturels locaux semblent être sous
l'obligation de s'accommoder à la culture globale par la modification, voire le
remplacement de leurs propres valeurs culturelles. Par conséquent, on risque de voir les
cultures locales se dissoudre dans la culture globale qui ne tient pas compte des spécificités
des communautés, des pays et des régions.
Selon les concepteurs du nouvel ordre mondial, tout ce qui est local et national doit céder la
place au transnational dans la mesure où il ne favorise pas l'expansion de cet ordre basé
particulièrement sur l'intégration de toutes les populations dans le nouveau système. Face à
cette situation, plusieurs voix dans le monde, dans les pays du nord comme dans les pays
du sud, s'élèvent pour contester cette hybridation totale et plus précisément l'hybridation
culturelle. Elles revendiquent la nécessité de pérenniser la diversité culturelle à l'échelle
planétaire (Wolton, 2003). La situation se présente encore une fois en faveur de l'artisanat
pour marquer une forte présence dans le nouveau contexte actuel. En tant que partie
intégrante du patrimoine culturel et societal, l'artisanat a constitué pour les sociétés locales,
surtout dans les pays du sud qui sont plus vulnérables aux forces globales (Landau, 2006),
un des premiers remparts de protection de leurs propres cultures. Face à la mondialisation
de la culture, l'artisanat s'est présenté comme un échappatoire permettant aux
communautés locales de préserver leurs cultures, que ce soit en matière de travail ou de
mode de vie. À part sa capacité d'impulser de nouvelles dynamiques économiques (Zaoual,
1998), l'artisanat constitue par excellence une solution afin de maintenir une partie
importante des patrimoines culturels locaux et l'empêche de se dissoudre dans la culture
globale. Dans cette logique, plusieurs métiers ancestraux trouvent leurs raisons d'être dans
le contexte de la globalisation, surtout dans les pays de sud. Ces métiers font référence à
des réalités, des valeurs et des expériences collectives locales. De plus, elles véhiculent,
entre autres, les valeurs culturelles propres à ces sociétés. Les métiers de l'artisanat
contribuent, pareillement, à la production des biens imprégnés de signes et de symboles
culturels permettant aux citoyens de vivre en harmonie avec leurs systèmes
d'appartenances et de références locales. Dans le même ordre d'idées, les métiers
s
ancestraux, dits aussi artisanaux, expriment fortement la reproduction intergénérationnelle
des savoir-faire et des pratiques du travail ancrés dans la culture locale.
En somme, les traits multiples de l'artisanat, décrits ci-dessus, nous conduisent à
comprendre les raisons d'être de l'artisanat dans le contexte de la globalisation. En général,
on peut dire que la réémergence de l'artisanat dans ce contexte est dû principalement à
deux phénomènes : l'augmentation de la conscience des rôles importants que peut jouer
l'artisanat pour remédier aux anomalies sociales, économiques et culturelles de
l'industrialisation massive et de la mondialisation dans toutes ses dimensions d'une part, et
la montée en puissance des questions culturelles et écologiques d'autre part. La
concordance de l'esprit artisanal avec certaines des exigences modernes a contribué à
l'actualisation de l'artisanat. Cette actualisation s'est concrétisée par la présence
progressive des entreprises de type artisanal et des produits artisanaux dans nos sociétés
actuelles. Étant donné leurs caractéristiques et leurs places qui ne cessent d'évoluer dans les
univers de travail et de production, les entreprises de ce type se présentent comme un
phénomène qui mérite l'attention des sociologies appliquées aux mondes du travail.
La présente étude se propose d'examiner le phénomène des entreprises artisanales de
métiers ancestraux dans un contexte qualifié le plus souvent comme étrange pour elles.
L'objectif ici est d'apporter un éclairage théorique ainsi qu'empirique sur les structures et
les dynamiques qui caractérisent ces unités de production supposées d'être absentes dans
l'ère des technologies hypersophistiquées et des modes modernes d'organisation et de
gestion du travail. Pour ce faire, nous avons examiné le secteur de l'artisanat en Tunisie à
travers une problématique spécifique. Cette étude a examiné deux dynamiques qualifiées
comme indispensables pour que l'artisanat et la production artisanale puissent assurer leur
survie et pérenniser leurs caractéristiques identitaires : l'innovation et la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels. Nous avons étudié ces deux dynamiques
dans un ensemble d'unités de production appartenant à deux corps de métiers artisanaux.
Notre souci est de comprendre comment ce type d'entreprise gère ces deux dynamiques,
l'une indépendamment de l'autre, ainsi que la relation entre elles dont l'objectif de
construire des connaissances approfondies sur les unités de production artisanales
tunisiennes de métiers ancestraux dans le contexte de la globalisation.
Trois grandes parties structurent le présent travail. La première partie expose les différents
cadres de la recherche, à savoir le cadre général, le cadre spatio-temporel, le cadre
conceptuel et le cadre méthodologique. La deuxième partie présente et décrit les résultats
empiriques de cette recherche. La dernière partie est consacrée à l'analyse et à
l'interprétation de ces résultats.
10
Chapitre 1. Cadre général de la recherche : objet de la recherche
1. La problématique
La Tunisie est l'un des pays où la question de l'artisanat et de la production artisanale est
devenue de grande actualité ; que ce soit dans les programmes politiques et économiques
ou dans le vécu quotidien de la population. Après avoir été marginalisé pendant les trois
premières décennies de l'indépendance (1960-1980), le secteur de l'artisanat est réintégré,
vers la fin du vingtième siècle, dans le processus économique du pays. Désormais, ce
secteur connaît un intérêt assez important et assez particulier. Afin de réussir cette
réintégration plusieurs mesures ont été entreprises et ne cessent d'être entreprises en faveur
de ce secteur. Dans cette logique, plusieurs programmes ont été lancés. Ces programmes,
visant la promotion des métiers ancestraux et authentiques ancrés dans l'histoire
socioculturelle du pays, s'inscrivent dans une stratégie globale qui a été déclenché en
2002 : la stratégie du développement de l'artisanat à l'horizon de 2016. Des objectifs, sur
les plans économiques, sociaux et culturels, ont été fixés pour cette stratégie. Celle-ci vise
principalement :
1) La promotion et la conservation d'une ressource importante de création de richesse et
d'emplois;
2) La protection d'une partie importante de la culture locale.
Cette stratégie est maintenant à mi-chemin. Après avoir terminé la restructuration des
différentes institutions intervenant dans le secteur de l'artisanat pour qu'elles soient
capables de la faire évoluer, cette stratégie franchit actuellement de nouvelles étapes. Elle
s'occupe maintenant de la question de l'amélioration de la compétitivité des unités
artisanales pratiquant des métiers ancestraux. Cette phase a vu le lancement, en avril 2009,
d'un programme national de mise à niveau de cette catégorie d'unités productives dans le
cadre du perfectionnement du climat des affaires dans le secteur de l'artisanat et l'ancrage
du rôle de l'entreprise artisanale de métier ancestral en tant qu'acteur principal dans la
société tunisienne actuelle. Ce programme a pour but, entre autres, l'amélioration de la
compétitivité de ces entreprises. Le financement de ce programme est totalement étatique.
12
La volonté de promouvoir de nouveau les métiers ancestraux et leurs entreprises s'est
concrétisée par plusieurs autres actions : la création d'un observatoire national de
l'artisanat, la mise en place de plusieurs mécanismes de financement, la multiplication des
compagnes publicitaires encourageant les citoyens à consommer les produits artisanaux
locaux et les incitant à investir dans le secteur de l'artisanat, l'organisation des concours
annuels pour inciter les artisans à l'innovation, l'obligation faite aux grandes surfaces de
consacrer des rayons aux produits artisanaux, etc.
Les efforts déployés à la promotion de l'artisanat concernaient essentiellement les métiers
qui n'ont été ni détruit ni absorbé par l'économie capitaliste introduite en Tunisie par le
colonisateur français depuis le début du 20e siècle. Tout au long de ce siècle, ces métiers
ont survécu, mais d'une manière très timide. Le secteur artisanal traditionnel en Tunisie
s'est juxtaposé au secteur industriel sans réussir à occuper une place assez importante dans
les dynamiques économiques nationales. Il a réussi à exister jusqu'à nos jours pour devenir
un secteur stratégique qui assume des fonctions multiples dans la société. Ce secteur est
actuellement jugé comme stratégique pour l'économie et la société tunisienne puisqu'il
emploie, selon les dernières statistiques de l'Office National de l'Artisanat, 11 % de la
population active et contribue dans une portion de plus de 5% au PIB. Les entreprises
artisanales de métiers ancestraux semblent donc trouver un nouveau souffle pour affronter
la concurrence des grandes et de petites entreprises industrielles. Ceci se confirme de jour
en jour, avec des entreprises qui s'imposent avec force comme des unités productives et
exportatrices.
L'intérêt particulier accordé au secteur des entreprises artisanales s'est développé au
moment même où l'État tunisien favorise la libéralisation totale de son économie suivant en
cela, comme la majorité écrasante des pays du tiers monde, les instructions des organismes
internationaux. Cette libéralisation, qui a eu pour ultime objectif l'insertion de l'économie
tunisienne au nouveau système économique mondial instauré vers la fin du vingtième
siècle, a été concrétisé par la mise en œuvre de plusieurs réformes économiques. Toutes ces
réformes se centraient autour du renforcement des mécanismes de l'économie du marché.
En d'autres termes, il s'agit de faire de la concurrence la méthode de fonctionnement de
l'économie.
13
1.1 Les entreprises artisanales tunisiennes de métiers ancestraux face à de nouvelles contraintes :
Par un tel choix, la Tunisie s'inscrit fortement dans la logique de la globalisation. Cette
logique signifie, entre autres, l'adoption des valeurs et des normes néolibérales à l'échelle
planétaire. L'inscription de la Tunisie à une telle logique est concrétisée par l'adhésion à
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) d'une part, et la ratification de plusieurs
accords de libre échange bilatéraux et multilatéraux d'autre part. Par conséquent, la Tunisie
s'inscrit dans un nouveau contexte économique défini fondamentalement par l'ouverture du
marché local aux entreprises, aux produits et aux capitaux étrangers. En effet, un nouveau
climat de concurrence virulente et d'hyper compétition s'est imposé aux appareils
productifs locaux de tout genre. « Les nouveaux changements que connaît l'environnement
économique, politique et social tunisien placent l'entreprise devant de nouveaux défis »
(Zghal, 2000 : 127). Les entreprises locales devront donc subir les conséquences et les
dynamiques de la mondialisation de l'économie. De toute évidence, les entreprises
artisanales de métiers ancestraux ne sont pas épargnées par ces nouvelles dynamiques. À
vrai dire, leur situation apparaît plus délicate dans la mesure où elles ne disposent pas des
mêmes moyens dont disposent les grandes entreprises industrielles que ce soit sur le plan
organisationnel, technique, financier et technologique.
La réflexion sur l'avenir de ces entreprises dans le contexte de la globalisation, caractérisé
particulièrement par les incertitudes systématiques et pluridimensionnelles, a constitué
donc le point de départ de cette étude. Notre réflexion est partie de la prise de conscience
des nouvelles règles de jeu et des nouvelles contraintes imposées aux entreprises artisanales
de métiers ancestraux dans le contexte actuel. L'avenir de ces unités de production,
devenues stratégiques dans les politiques économiques tunisiennes, devient un enjeu
engageant toutes les parties concernées. Le maintien et le développement des entreprises
artisanales apparaissent alors comme un enjeu fort du développement socioéconomique à
l'heure de la mondialisation des économies.
En réaction aux multiples bouleversements provoqués par la globalisation, surtout dans les
pays économiquement faibles dont la Tunisie fait partie, tout ce qui est local devient une
solution inévitable. Dans l'ère de la globalisation, l'idée d'un rattrapage économique à
14
l'exemple des réussites occidentales devient un simple mirage pour les pays en
développement. Par conséquent, le retour au local et aux stratégies de développement, qui
valorisent les ressources internes de tout type, devient une exigence pour ces pays. Cette
valorisation se présente comme un remède économique aux anomalies de la globalisation
économique qui sont ressenties essentiellement par les pays en question (Zaoual, 1998).
C'est dans cette logique que s'inscrit le retour en force de l'intérêt accordé aux entreprises
artisanales de métiers ancestraux en Tunisie. En misant sur le secteur de l'artisanat, l'État
tunisien exprime son ambition de faire de cette catégorie d'entreprises un acteur qui peut
jouer de multiples rôles dans le contexte actuel. Les rôles de cet acteur, compte tenu des
aspects économiques, sociaux et culturels des métiers ancestraux, consistent à réaliser des
performances économiques et sociales sans renoncer à ces caractéristiques identitaires dans
un contexte de changement structurel de tous les aspects de la vie humaine.
1.2 Les responsabilités de l'entreprise artisanale à l'heure de la globalisation
Réussir une telle mission exige de ce type d'unités de production de relever deux types de
défis en même temps. D'un côté, il leur a été demandé de trouver les moyens adéquats leur
permettant d'assurer leur survivance économique dans un contexte de concurrence très
difficile, marqué par des changements durables. Elles doivent donc adopter leurs structures
humaines et techniques et leurs dynamiques sociales et culturelles afin de pouvoir être
concurrentielles et compétitives sur le marché local. Un marché devenu de plus en plus
inondé par des produits importés, y compris ceux de type artisanal. En améliorant leur
compétitivité, ces entreprises peuvent être une source importante de création de richesse et
d'emplois qui se trouvent fortement affectés par les effets néfastes de la mondialisation de
l'économie. D'un autre côté, elles sont appelées à être prudentes dans le choix de ces
moyens. Ces derniers ne doivent pas altérer le caractère traditionnel et authentique qui
caractérise la forme artisanale de la production et les produits artisanaux. En veillant sur la
conservation des traits identitaires du travail artisanal, les entreprises artisanales de métiers
ancestraux peuvent être un acteur principal de conservation et de promotion de la culture et
du patrimoine local dans le contexte de la globalisation qui annonce la fin de tout ce qui est
local. Admettons alors que les fonctions de l'entreprise artisanale dans ce contexte sont
15
multiples et dépendent l'une de l'autre. En effet, les responsabilités des entreprises
artisanales tunisiennes de métiers ancestraux dans le contexte de la globalisation s'avèrent
de trois types.
1 ) Une responsabilité économique : cette responsabilité consiste à la participation dans la
création de la richesse et à la création de nouvelles occasions pour les capitaux locaux qui
se trouvent fortement affectés par la libéralisation de l'économie.
2) Une responsabilité sociale : cette responsabilité consiste à la participation dans la
conservation des emplois d'une masse énorme de la population active et à la création de
nouvelles occasions d'emplois dans une société où le taux de chômage ne cesse d'évoluer.
Selon les statistiques officielles de 2009, ce taux se situe autour des 14 % et touche plus
que 25 % de la population active en Tunisie1.
3) Une responsabilité culturelle : cette responsabilité consiste à la participation dans la
conservation, par l'application des pratiques traditionnelles du travail et la production des
œuvres dotées d'une charge historique et esthétique qui leur confèrent une valeur culturelle,
d'une partie importante du patrimoine culturel de la société.
Avec une telle perspective, le secteur des entreprises artisanales de métiers ancestraux ne
constitue pas seulement une économie, mais il est en même temps une culture, voire une
civilisation. Il est donc pluridimensionnel. Il revêt une dimension économique, sociale et
aussi une dimension purement culturelle. Compte tenu de ces diverses dimensions, les
entreprises artisanales tunisiennes de métiers ancestraux se trouvent face à une
responsabilité historique envers la société et la culture locale. Elles doivent assurer ses
différentes fonctions au moment où l'économie nationale et la société locale ont besoin de
toutes leurs potentialités. La question qui se pose ici est la suivante : après presque une
quinzaine d'années de l'insertion de la Tunisie dans le nouvel ordre économique mondial,
ces entreprises donnent-elles des signes de leur capacité d'assumer cette lourde
responsabilité ? En d'autres termes, les stratégies mises en œuvre pour promouvoir le
secteur des entreprises artisanales commencent-elles à être payantes ?
1 CIA World Factbook hUp:^\vw\v.indexniundi.com/inaiV?v=74&r=xx&l=rr CIA World Fuctbook - Version du Janvier 1,2009)
16
1.3 Les entreprises artisanales de métiers ancestraux tunisiennes face à la globalisation : les résultats enregistrés
Une étude exploratoire menée à l'été de 2007 a montré que le secteur des entreprises
artisanales de métiers ancestraux a réussi relativement à relever les défis qui lui sont
imposés suite à l'inscription de la Tunisie dans la logique de la globalisation. Les chiffres
enregistrés par le secteur en question témoignent de cette réalité. Ces chiffres montrent :
1) L'évolution continue du nombre des entreprises artisanales de métiers ancestraux; entre
le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2010 ce nombre s'est multiplié de près de 2.5 : il
est passé de 622 à 1455 unités;
2) L'évolution progressive de la part de l'artisanat dans le PIB du pays. L'objectif de
porter la contribution du secteur au PIB à 8% vers l'année 2016 est en voie de se réaliser.
Actuellement la contribution chiffrée s'élève à environ de 6%, mais en réalité nous
estimons qu'elle est plus importante que ça dans la mesure où une partie importante de la
production artisanale s'effectue d'une manière informelle;
3) L'évolution permanente de la part de l'artisanat dans la population active. Au cours de
la période allant de 2006 à 2010 le secteur à contribué à la création d'un peu plus de 48 000
emplois. Ce nombre représente presque 10 fois plus d'emplois crées au cours de la période
allant de 1993 à 2000. Au cours de cette période, seulement 5012 emplois ont été crées
par le secteur;
4) L'évolution considérable des exportations des produits artisanaux. Ces explorations ont
augmenté de plus de 200% au cours de la période allant de 2003 à 2010. Elles sont passées
de 217 948 à 462 100 millions de dinars tunisiens.
Ainsi, l'inscription de la Tunisie dans la logique de la globalisation n'a pas seulement crée
de nouvelles menaces pour les unités productives artisanales de métiers ancestraux, elle
leur a aussi donné l'opportunité de rayonner de nouveau. Ces entreprises ont été, malgré les
nouvelles contraintes qui leur sont imposées, en mesure de remplir leurs différentes
responsabilités. Elles ont pu être créatrices de richesse et d'emplois tout en étant acteur de
conservation de la culture locale. La présence graduelle des produits artisanaux locaux sur
17
le marché local témoignent de cette réalité. D'ailleurs, plusieurs enquêtes menées par
l'Office National de l'Artisanat ces derniers temps ont montré que le consommateur
tunisien commence à apprécier les produits de l'artisanat. Ces produits ne sont pas
représentés comme un folklore; ils sont devenus utiles dans la vie quotidienne de ce
consommateur. D'une part, une telle situation ne peut que confirmer la thèse qui dit que
l'époque de la globalisation offre à l'artisanat un moment de revanche après avoir été
dominé pendant presque deux siècles par le système industriel (Boutllier, 2006 ; Jorda,
2006). D'autre part, elle montre que les actions entreprises dans le cadre des stratégies de
promotion du secteur de l'artisanat commencent à donner leurs fruits.
Certes, les chiffres cités ci-dessus témoignent de l'évolution du secteur des entreprises
artisanales de métiers ancestraux sur tous les niveaux, mais nous estimons que le poids de
ce secteur dans l'économie tunisienne est plus important. L'enquête exploratoire et
l'enquête effective menée dans le cadre de cette étude nous ont conduits à un tel constat. Ce
constat est formulé après avoir remarqué qu'une partie importante de la production
artisanale s'effectue d'une manière informelle. Au-delà de ce constat, les chiffres officiels
nous permettent de déduire que le secteur artisanal a pris plus d'ampleur économique dans
le nouveau contexte sans perdre les linéaments spécifiques du travail artisanal. Ces
linéaments sont traduits principalement dans les produits et les manières de production.
Mais cela ne veut pas dire que tous les domaines des métiers ancestraux, qui constituent le
secteur de l'artisanat en Tunisie, connaissent la même situation. Il y a des domaines qui
sont en pleine prospérité et d'autres en pleine crise. Autrement dit, il ya des entreprises
artisanales de métiers ancestraux qui ont pu assumer leurs responsabilités dans le contexte
de la globalisation et d'autres non. Bref, il y a des entreprises qui connaissent la réussite et
d'autres qui connaissent l'échec. Par entreprise artisanale de métier ancestral réussie, on
désigne l'entreprise qui enregistre des performances économiques et sociales traduites par
la création de la richesse et des emplois tout en assurant la reproduction des principales
caractéristiques identitaires du travail artisanal tant dans la production que dans les
produits. Ceci nous a amené à nous interroger sur les manières par lesquelles les entreprises
artisanales tunisiennes, qui connaissent la réussite, assurent leur pérennité tout en
conservant leurs spécificités.
IX
1.4 Les chemins de la réussite
A l'issue d'un premier travail fondé sur l'étude exploratoire du secteur en question ainsi
que sur une recherche bibliographique, deux principaux chemins ont été déceler permettant
aux entreprises artisanales de métiers ancestraux de réussir leurs différentes responsabilités
dans le contexte de la globalisation, c'est-à-dire à se maintenir et à prospérer sans altérer
leurs caractéristiques identitaires.
D'une part, elles doivent promouvoir la logique de l'innovation afin d'assurer leur
survivance et leur développement. Seulement à travers cette logique, les entreprises de tout
type peuvent relever le défi de la concurrence virulente imposé par le nouvel ordre
économique mondial (Adams et autres 2006; Hsueh et Tu, 2004; Verhees et Meulenberg,
2004). À l'heure de la globalisation de l'économie, l'innovation est devenue une variable
stratégique pour toute entreprise qui désire être compétitive sur le marché.
Innovation may become the basis of all competition in the future. Therefore, organizational theorists and managers alike have long shown more interest in the role of innovation in organizations, primarilydue to the crucial role innovation plays in securing sustained competitive advantage. As organizations attempt to get competitive advantage, they develop and/or adopt new products, processes, techniques, or procedures. (Bakan et Yildiz, 2008 : 177)
À cet égard, l'innovation se présente comme inévitable pour la réussite de l'entreprise
artisanale de métier ancestral dans le contexte actuel. Elle est le chemin à travers lequel ce
type d'entreprises peut assurer ses responsabilités économiques et sociales, notamment la
création de la richesse et des emplois.
D'autre part, les entreprises artisanales sont appelées à incorporer une logique de
transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels relatifs aux métiers ancestraux
afin de conserver leurs caractéristiques identitaires. Seulement à travers la valorisation de
cette transmission, ces entreprises seront capables de reproduire les normes et les valeurs
techniques et socioculturelles du travail artisanal.
La transmission ne se limite pas à un ensemble de connaissances efficaces comme les procédures strictement nécessaires à l'exécution d'une tâche donnée. Toutes les observations des ethnologues corroborent ce que Frnçois Sigaut affirmait dans son rapport au conseil du patrimoine éthologique :
19
L'apprentissage transmet tout un ensemble de savoir efficace, sens et identités. (Chevallier et Chiva, 1991 : 5-6).
De ce point de vue, la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels relatifs à
chaque métier se présente comme la voie idéale permettant de pérenniser et de protéger les
traits de la culture de n'importe quel genre d'activités socioprofessionnelle. En ce sens, la
transmission des savoirs professionnels est le chemin à travers lequel l'entreprise artisanale
peut assurer sa responsabilité culturelle consistant à protéger une partie importante de la
culture locale de la dissolution dans la culture globale.
Les clés de la réussite de l'entreprise artisanale de métiers ancestraux dans ses différentes
responsabilités sont donc tributaires de l'incorporation de deux dynamiques principales :
l'innovation et la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels. Autrement
dit, la vitalité de l'univers des métiers ancestraux dépend largement de sa capacité à innover
sous différentes formes en affirmant conjointement une singularité par rapport à l'univers
industriel.
À propos de l'innovation et de la transmission des savoirs professionnels dans les milieux
du travail, elles sont souvent traitées, l'une indépendamment de l'autre, en tant que
processus multidimensionnels, complexes et dynamiques (Rochet, 2007; Shavinina, 2003;
Lallemand, 2001; Boutte, 2007; Chevallier et Chiva, 1991). Ce processus, dans le deux cas,
implique les différents participants dans le milieu de la production. De même, il nécessite la
mise en œuvre d'un climat organisationnel managériale et social favorable afin d'atteindre
les résultats souhaités de son mise en œuvre (Sigaut, 1991; Bélier, 2002; Le Boterf, 2001;
Gordon, 1989; Alter, 2003). Dans l'ensemble, le processus de l'innovation ainsi que celui
de la transmission des savoirs professionnels partagent plusieurs points de similitudes. Mais
ont-ils les mêmes objectifs et la même nature ?
Relativement au processus de l'innovation en générale et dans le milieu du travail en
particulier, il exprime la volonté d'introduire des nouveautés dans un champ donné dont
l'objectif est de le modifier. Cette modification peut toucher une seule dimension du champ
concerné comme il peut le reconfigurer dans son ensemble. Il peut être décrit, ainsi, comme
un ensemble d'activités visant la transformation d'un état existant. Le sociologue Norbert
Alter qualifie ce processus comme une action de rupture avec le passé. Il écrit à ce propos «
20
Innover amène toujours à s'opposer à l'ordre déjà établi, ordre conçu comme nécessaire.
Cette situation conduit les innovateurs à être à un moment donné des déviants » (Alter,
2003 :76). Le changement est, en effet, le but ultime de tout processus d'innovation.
Au sujet du processus de la transmission des savoirs professionnels dans les entreprises
artisanales de métiers ancestraux, il exprime la volonté de faire perpétuer les normes et les
valeurs d'ordre techniques ainsi que celles d'ordre socioculturelles relatives au métier. Il
peut être décrit, ainsi, comme un ensemble d'activités qui se déroulaient en même temps
que le processus de la production afin de conserver les différents aspects de la production
artisanale. « La transmission ne peut être perçue que comme processus dynamique
entraînant à la fois la ré-création des caractéristiques du processus technique et celles du
groupe social concerné » (Chevallier et Chiva, 1991 : 8). La reproduction est, en effet, la
finalité attendue de tout processus de transmission dans les entreprises artisanales de
métiers ancestraux.
La description rapide des dynamiques de l'innovation et de la transmission des savoirs
professionnels nous permet de constater que ce sont deux processus de nature totalement
antinomiques et qui ont des objectifs diamétralement opposés. L'innovation traduit la
rupture avec ce qui existe alors que la transmission, traduit la reproduction de l'existant.
L'innovation vise le changement partiel ou entier, alors que la transmission favorise la
stabilisation. De ce fait, les entreprises artisanales de métiers ancestraux qui réussissent à
assurer leurs différentes responsabilités dans le contexte de la globalisation sont celles qui
promouvaient les dynamiques de la transmission des savoirs professionnels et l'innovation
d'une part, et qui trouvent les méthodes et les moyens permettant la conciliation entre ces
deux dynamiques de l'autre part. D'où découle la question centrale qui nous a guidés tout
au long de cette recherche : comment les entreprises artisanales tunisiennes de métiers
ancestraux gèrent-elles les dynamiques de la transmission des savoirs professionnels et
celles de l'innovation ainsi que les relations entre elles afin de pouvoir assurer leurs
différentes responsabilités dans le contexte de concurrence accrue par la globalisation?
Autour de cette question se recoupent un ensemble d'interrogations secondaires qui
s'énoncent comme suit :
21
1) Quelles sont les caractéristiques des dynamiques de l'innovation et de la transmission
des savoirs professionnels au sein de l'entreprise artisanale de métier ancestral?
2) Quelle place occupent ces deux dynamiques dans les entreprises artisanales de métiers
ancestraux tunisiennes?
3) Comment ces entreprises promeuvent-elles les dynamiques de l'innovation et de la
transmission des savoirs professionnels?
4) Quelles sont les conditions favorables à la promotion de l'innovation et de la
transmission des savoirs professionnels au sein de cette catégorie d'entreprise?
5) De quoi dépend la réussite des deux dynamiques en question?
6) Comment ces entreprises surmontent-elles les contradictions existantes entre les deux
dynamiques en question?
Ainsi, le fait de poser une telle question centrale permet non seulement d'analyser et
d'étudier les processus de la transmission des savoirs professionnels et d'innovation dans
les unités productives artisanales tunisiennes de métiers ancestraux, mais elle permet aussi
de cerner les traits organisationnels, managériaux et socioculturels de ce type d'entreprises
dans la mesure où ces traits influencent et s'influencent par les deux processus en question.
De plus, elle permet de vérifier la thèse liant la réussite de l'entreprise artisanale de métier
ancestral dans le contexte de la globalisation aux processus de l'innovation et celui de la
transmission des savoirs professionnels. Pour cette raison, deux métiers ancestraux
tunisiens ont fait l'objet de notre investigation. Un premier métier, la poterie artisanale,
représentant les métiers connaissant la prospérité dans le contexte actuel. Un deuxième
métier, le tapis de sol, représentant les métiers connaissant une situation inverse : la crise.
2 Les objectifs et les limites de la recherche
Tel que mentionné précédemment, la transmission des savoirs professionnels et
l'innovation constituent, l'une indépendamment de l'autre, des processus qui influencent et
s'influencent directement par l'organisation du travail, la gestion des ressources humaines
et les dynamiques socioculturelles de l'entreprise. De ce fait, mettre l'accent sur
l'innovation et la transmission des savoirs professionnels dans l'entreprise artisanale de
métier ancestral nécessite inéluctablement de prendre en considération les différentes
structures et dynamiques caractérisant ce type particulier d'entreprises. Il s'agit, en effet,
22
de mettre en relation les processus de la transmission des savoirs professionnels et celui de
l'innovation, qui font l'objet de notre recherche, avec ces structures et ces dynamiques.
Conformément aux exigences de la démarche, la présente étude propose d'étudier et
d'examiner ces deux processus afin d'explorer et d'apporter un éclairage à la fois théorique
et empirique sur l'univers des entreprises artisanales de métiers ancestraux dans le contexte
de la globalisation. Il s'agit donc de parvenir à :
1) Examiner les dynamiques de la transmission des savoirs professionnels dans les
entreprises artisanales tunisiennes de métiers ancestraux;
2) Circonscrire les dynamiques de l'innovation dans ces entreprises;
3) Dégager les modèles de l'entreprise artisanale tunisienne de métier ancestral dans le
contexte de la globalisation.
En proposant de comprendre les caractéristiques spécifiques du processus de l'innovation et
d'éclairer les pratiques de la transmission des savoirs professionnels dans les entreprises
artisanales tunisiennes de métiers ancestraux, cette thèse se donne comme objectif final
d'identifier les réalités humaines, sociales, culturelles, organisationnelles et techniques de
ces deux processus qui reflètent en grande partie l'image de l'entreprise artisanale de métier
ancestral dans le contexte actuel. L'identification de ces réalités et de cette image demeure
une priorité dans le cadre de cette étude afin de déceler les réactions des ces entreprises
face aux nouvelles contraintes induites par le nouvel ordre mondial multidimensionnel. En
d'autres mots, il s'agit de voir dans quelle mesure les logiques de fonctionnement des
appareils productifs artisanaux sont façonnées en grande partie, en réponse aux exigences
de la conjoncture actuelle.
D'une manière générale, dans les sociétés contemporaines, on distingue deux types
d'entreprises artisanales : l'entreprise artisanale de métier et l'entreprise artisanale de
modernité.
L'entreprise artisanale « de métier », dont la mission essentielle est de préserver les conditions d'exécution et les critères de qualité forgés par des générations d'artisans. Pour cette entreprise, la poursuite des intérêts collectifs et catégoriels n'est pas dissociée de ses objectifs propres. L'entreprise artisanale « de modernité » qui recherche, quant à elle, la croissance et le développement. Elle adopte pour cela des modes de managements modernistes, utilisant du
23
marketing management, une plus forte intégration dans la chaîne logistique. (Marchesnay cité par Asquin et Marion, 2005 : 4).
Afin d'éviter tous genre de confusion, il est donc important de préciser que notre recherche
porte uniquement sur les entreprises artisanales de métiers traditionnels. Ce type
d'entreprises concerne les unités productives à l'intérieur desquelles se pratiquent des
métiers ancestraux et authentique qui se caractérisent essentiellement par la prédominance
du travail manuel et la primauté de l'homme sur la machine. Aussi, notre attention porte
seulement sur les entreprises impliquant la participation de plusieurs individus dans la
mesure où il existe des entreprises de ce type composé d'un seul individu qui travaille
isolément. De ce fait, la notion d'entreprise artisanale de métiers ancestraux est utilisée
dans le cadre de cette thèse pour exprimer les unités de production qui englobent les
spécificités citées ci-dessus : l'application d'un métier ancestral et authentique d'une façon
collective.
3 L'approche théorique de la recherche : l'interactionnisme symbolique
Compte tenu de son objectif général, comprendre les dynamiques et les logiques qui
structurent le fonctionnement des entreprises artisanales tunisiennes à travers l'étude des
processus de la transmission des savoirs professionnels et celui de l'innovation, considérés
comme indispensable pour leur survie dans le contexte de la globalisation, notre thèse
s'inscrit dans une démarche d'analyse sociologique de type comprehensive. La démarche
en question s'apparente à la sociologie dite comprehensive qui trouve ses origines dans la
pensée des deux sociologues allemands Max Weber (1864-1920) et Georges Simmel
(1858-1918). En suivant une telle démarche, cela signifie que notre étude retient la
sociologie comprehensive comme support théorique et épistémologique. Cette sociologie,
qui« s'efforce de dégager les significations vécues par les acteurs et de mettre en évidence
les logiques qui sous-tendent leurs actions (Le Breton, 2008 : 3)», s'est développée à
travers des études empiriques qui ont touché plusieurs aspects de la vie sociale. Le résultat
de ces études était l'apparition de plusieurs paradigmes appartenant à cette sociologie.
Chacun de ces paradigmes propose son propre vison du social et son approche particulière
pour appréhender le monde social.
24
Parmi ces1 paradigmes et en fonction de l'objet de notre étude, l'interactionnisme
symbolique peut être distingué des autres paradigmes dans la mesure où il propose une
approche spécifique qui se focalise en priorité sur les interactions entre les individus ayant
l'objectif d'étudier la structure de l'expérience individuelle de la vie sociale et non pas de la
structure de la vie sociale (Goffman, 1974). Ce paradigme considère l'interaction comme le
thème central de toute analyse sociologique (Becker, 1970) qui envisage de déchiffrer les
processus sociaux qui font fonctionner un monde social donné.
Le monde social, selon les partisans de ce paradigme, est en constante construction à
travers les échanges qui se déroulent entre les acteurs qui le composent. En effet, ce monde
est la création propre de ces acteurs. Il est le corollaire de leurs actions et interactions
quotidiennes dans un contexte bien déterminé. Il se présente sous la forme d'un ensemble
de processus d'interactions qui se font et se défont selon les significations et les débats que
les acteurs mettent en mouvement. Il est, donc, un ordre négocié (Strauss, 1978). D'où
découle la grande importance accordée à l'interaction de la part des premiers sociologues
interactionnistes qui représentent la deuxième génération de l'École de Chicago. À part leur
inspiration des idées des sociologues de la première génération de la même école , les
pionniers de l'interactionnisme symbolique ont fondé leur théorie sociologique à travers
plusieurs études empiriques de type microsociologique et en se basant sur la thèse de
George Simmel, l'un des fondateurs de la sociologie comprehensive. Pour Simmel « Il y a
société, au sens large du mot, partout où il y a action réciproque des individus (Simmel,
1996 :165) ». Cette conception de la société et de l'individu montre clairement la centralité
du concept d'interaction dans cette approche.
Cette notion est utilisée pour exprimer l'unité minimale des échanges sociaux et pour
désigner une situation où chaque acteur social agi et se comporte en fonction des autres
acteurs (Durand, 1997 : 248). Ce terme d'interaction est de grande utilité dans le cadre de
notre étude. La recherche bibliographique ainsi que l'enquête exploratoire, ont permis de
La première génération s'attache à étudier les relations interethniques et la délinquance dans les grandes villes aux États-Unis. Celles-ci apparaissent alors comme une sorte de laboratoire social qui permet d'étudier les nombreuses transformations des milieux urbains. Chicago accueille de nombreux immigrants de l'étranger ainsi que du sud des États-Unis. Les représentants de cette première école sont notamment William I. Thomas et Robert E. Park.
25
constater que la compréhension des deux processus objets de notre investigation, la
transmission et l'innovation, passe inéluctablement par l'analyse des actions des acteurs
impliqués. Ces actions ne peuvent pas être analysées si on ne prend pas en considération les
actions réciproques comme nous l'enseigne l'approche interactionniste, car l'action d'un
acteur n'a aucun sens si elle n'est pas confrontée à une autre action. En bref, c'est dans les
interactions que les actions individuelles prennent sens.
D'ailleurs, les deux processus en question, la transmission et l'innovation, sont construits
d'une manière interactive. Ils impliquent la mise en relation permanente de plusieurs
acteurs et occasionnent, donc, des interactions qui contribuent continuellement à leurs
création et recréation. «La transmission ne peut être perçue que comme processus
dynamique, entraînant tout à la fois la ré-création technique et celle du groupe social
concerné » (Chevallier et Chiva, 1991 : 8). La transmission est avant toute une passation,
une relation de soi à l'autre (Burnay et Klein, 2009). Pour l'innovation, c'est la même
logique qui s'applique. « L'innovation ne tient pas seulement à une seule personne, mais
elle dépend d'une foule d'intervenants diversifiés. C'est une longue chaîne
interactive....Est innovatrice une organisation ou un ensemble d'organisations qui
favorisent les interactions, les allers-retours et les négociations en tout genre» (Akrich,
Callon, Latour, 1988 : 5). La centralité de l'interaction dans nos unités d'analyse justifie
notre référence au paradigme de l'interactionnisme symbolique pour aborder les milieux du
travail artisanal de métier ancestral. Dans le cadre de ce paradigme, nous distinguons les
travaux d'Everett Hugues (1897-1983) qui ont porté essentiellement sur les professions et
l'organisation du travail. Donc, son approche sera privilégiée dans le cadre de cette
recherche.
Hugues propose une approche originale pour appréhender le monde du travail ainsi que les
phénomènes qui le traversent. Cette approche fait, en conformité avec le label
interactionniste, de l'interaction comme thème central pour analyser les phénomènes
relatifs à ce monde social spécifique. Comme tout autre monde social, le monde du travail
se fait et se défait constamment à travers les interactions des acteurs collaborant autour
d'une activité spécifique et unie par un étroit tissu de relations. Dans la perspective
interactionniste, le travail est donc une construction sociale négociée (Périlleux, 2009).
26
Pour cette raison Hugues suggère de faire de l'interaction la catégorie principale de toute
étude sociologique qui envisage d'étudier un monde du travail bien particulier ou l'un de
ses composants. Il écrit à ce propos concernant, par exemple, l'organisation du travail :
La division du travail, pour sa part, implique l'interaction ; car elle ne consiste pas dans la simple différence entre le type de travail d'un individu et celui d'un autre, mais dans le fait que différentes tâches sont les parties d'une totalité, et que l'activité de chacun contribue dans une certaine mesure au produit final. Or l'essence des totalités, dans la société comme les domaines biologiques et physiques, c'est l'interaction. Le travail comme interaction est donc le thème central de l'étude sociologique et psychologique du travail (Hugues, 1996 : 61)
En conformité avec cette perspective, les deux unités objet de notre analyse et observation,
la transmission des savoirs professionnels et l'innovation, sont considérées comme les
résultantes des processus sociaux dans lesquelles les acteurs participent activement et non
pas le fait d'une rationalité leur étant imposé. Elles sont donc perçues comme les corollaires
d'une multitude d'interactions et d'échanges entre les acteurs impliqués à l'intérieur. En
concevant les variables en question en termes de processus sociaux nous restons fidèles à
notre objectif général : comprendre les différentes dynamiques et logiques structurant le
fonctionnement des entreprises artisanales tunisiennes de métiers ancestraux. Car une telle
conception amène à s'interroger sur les conditions de leur production et de leur
reproduction et ne pas nous limiter seulement, à leur description. La réponse à une telle
interrogation nécessite, en grande partie, la détermination de la matrice sociale qui fait
fonctionner ces processus au sein des entreprises artisanales : c'est-à-dire les normes et les
valeurs qui régissent les interactions qui les constituent. Ces interactions, selon le
paradigme de référence, ne concernent pas uniquement les échanges verbaux, mais
s'étendent à des signes corporels.
Although an individual can stop talking, he cannot stop communicating through body idiom; he must say either the right thing or the wrong thing. He cannot say no thing. Paradoxically the way in which he can give the least amount of information about him self, although this is still appreciable, is to fit in and act as persons of his kind are excepted to act. (Goffman, 1963: 35).
Ce faisant, il s'agit d'appréhender chacune des entreprises étudiées sous la forme d'un
réseau composé de différents types d'acteurs qui interagissent à travers un tissu de normes
et de valeurs plus ou moins partagées. Ces normes et ces valeurs sont les fruits des jeux
27
d'interactions quotidiennes. Mais cela ne veut pas dire que l'individu en tant qu'acteur
social est entièrement libre dans ses actions. Il est plutôt contraint d'être conforme aux
attentes du monde social dans lequel il évolue. « L'individu attribue du sens à ses actions, à
leurs retentissements, il interprète aussi celle des autres et il agit en conséquence» (Le
Breton, 2008 : 52). De ce fait, les interactions sont loin d'être des processus mécaniques.
Elles impliquent des acteurs socialement situés et se déroulent au sein des circonstances
réelles qui déterminent les cadres de référence des échanges interpersonnels (Strauss,
1992). Elles sont donc subordonnées à des conditions structurelles spécifiques.
En considérant la transmission des savoirs professionnels et l'innovation comme des
processus multidimensionnels, il s'agit d'identifier les normes et les valeurs qui structurent
leur déroulement. Plus exactement les normes et les valeurs qui régissent les interactions
qui les constituent. Ces dernières ne sont que le reflet des circonstances réelles de leur
déroulement. Ces circonstances sont réunies ici dans quatre catégories différentes :
organisationnelle, managériale, sociale et culturelle.
Par la détermination de ces circonstances, il devient possible de comprendre en particulier
les conditions dans lesquelles se déroulent les processus en question et de dégager le
modèle de l'entreprise artisanale de métier ancestral en général. Pour ce faire, il était
important d'observer les acteurs dans leurs interactions quotidiennes dans le travail,
d'étudier leurs expériences vécues dans le travail, surtout celles en relation avec la
transmission et l'innovation et d'analyser les conditions du travail en général. En d'autres
termes, l'étude des interactions de tous types, des expériences individuelles et des situations
concrètes du travail permet de rendre le monde du travail artisanal sociologiquement
intelligible d'une part, et de comprendre comment les acteurs parviennent à concilier entre
l'innovation et la transmission à travers leurs interactions quotidiennes de l'autre part.
2S
Chapitre 2. Les entreprises artisanales tunisiennes et le contexte de la globalisation : mise en contexte de la recherche
Étant donné que notre objet de recherche est l'entreprise artisanale tunisienne dans le
contexte de la globalisation, notre étude empirique prend comme espace d'investigation
l'Artisanat en Tunisie et la globalisation comme conjoncture d'étude. Dans le présent
chapitre, nous focalisons l'attention, en premier lieu, sur la présentation d'un aperçu sur le
secteur de l'artisanat en Tunisie. En second lieu, nous traitons de la question de la
globalisation en générale et de l'intégration de la Tunisie à ce processus en particulier.
1. L'artisanat en Tunisie
Dans le but de mettre en situation notre recherche, notre intérêt concerne ici la présentation
d'une idée sur le secteur de l'artisanat en Tunisie; mais avant d'entamer cette tâche nous
commençons par donner un aperçu général de la Tunisie. Par la suite nous mettons l'accent
sur le cadre réglementaire et institutionnel de l'artisanat en Tunisie. Au final, nous nous
intéressons à l'actualité du secteur.
1.1 La Tunisie : aperçu général
Géographiquement, la Tunisie occupe une position en plein centre de la méditerranée. Elle
se situe en Afrique du Nord, exactement la partie orientale de l'Afrique du Nord. Elle
constitue avec l'Algérie, le Maroc, la Libye et la Mauritanie le grand Maghreb représentant
la partie extrême ouest du monde arabe. La Tunisie est le plus petit pays de l'Afrique
blanche avec une superficie de 162 155 km , soit presque le 1/10 de la province du
Québec : 1 667 441 km2, y compris 40.000 km2 de désert. Il est baigné au nord et à l'est
par la méditerranée sur plus de 1300 km, limitée à l'ouest par l'Algérie et au sud par la
Libye. Plus de 2/3 du pays sont constitués par des plaines. On distingue trois grandes
parties de relief et de climat assez différenciées :
1) Le Haut-tell qui couvre la partie nord du pays, la plus prospère et la plus peuplée en
raison de la fertilité de ses terres et de sa forte humidité ;
2) La Tunisie centrale, région de steppes finissant sur la côte par le sahel;
29
3) La Tunisie méridionale, limitée au nord par la région des chotts, pays des espaces
désertiques et des luxuriantes palmeraies.
Étant donné son positionnement, la Tunisie se trouve sous l'influence de deux types d'air
différent. Elle subit l'influence de l'air frais de la mer méditerranéenne et l'influence de
l'air chaud du désert.
Historiquement, le pays a connu trois appellations : Africa au temps des romains et des
byzantins, Ifriqiya depuis la conquête musulmane et enfin Tunisie dans les temps
modernes. Chacune de ces appellations correspond à une période historique autonome.
Les historiens s'accordent par ailleurs à dire que le pays est habité depuis la préhistoire.
Tout au long de cette histoire très lointaine, la Tunisie connaît la succession de plusieurs
civilisations3 qui ont façonné graduellement la culture et la société tunisienne. Une société
marquée par un héritage très riche faisant du pays un véritable brassage culturel original. «
Le secret de l'originalité tunisienne répond autant à une géographie qu'à une histoire : mille
ans de conquête carthaginoise, quatre siècles romains, un siècle d'occupation vandale, un
interrègne byzantin, la conquête arabe, la résistance berbère, trois siècles d'occupation
turque, trois quarts de siècle de présence française...... (Mestiri, 1995 : 13). Ainsi, la
Tunisie a constitué, grâce à sa position de pont entre l'Afrique et l'Europe et entre
l'occident et l'orient, un territoire qui attire les conquérants depuis la préhistoire. Les
Berbères, les autochtones du pays, voient en 814 AV.JC l'arrivée des colons phéniciens qui
fondèrent la ville de Carthage, devenue très vite une grande puissance côtoyant une autre
grande puissance de la Méditerranée : l'Empire Romain. Après trois guerres4, dites guerres
puniques, l'Empire Romain réussit à détruire Carthage en 146 AV.JC et établi la colonie
romaine d'Afrique. Cette colonisation dure plus que sept siècles jusqu'à la conquête par les
3 La Tunisie a toujours été à la croisée des anciennes civilisations: berbère, punique, romaine, byzantine, arabe, espagnole et turque. Elle a connu toutes les phases de la préhistoire maghrébine, de l'époque de la pierre taillée à celle des pierres polies. Des dolmens et des mégalithes, appartenant au Néolitique ont été trouvés au Cap-Bon (nord est de la Tunisie) et des vestiges du Paléothique dans la région de Gafsa ( sud-ouest de la Tunisie). 4 La première guerre punique (264-241 av. J.-C.) était un conflit essentiellement naval, ayant pour origine des luttes d'influence en Sicile, terre située à mi-chemin entre Rome et Carthage. La deuxième guerre punique (218-202 av. J.-C.) marqua pour Rome le péril le plus grand que la cité ait connu, du moins jusqu'aux invasions barbares qui marquèrent la fin de l'Empire romain d'occident plusieurs siècles plus tard et la troisième Guerre punique (-149 à -146 av. J.-C.) marqua l'emprise de l'empire Romain sur Carthage.
30
vandales5 en 439 AP.JC. Mais très vite Carthage est reprise en 533 par les Byzantins,
Empire Romain de l'orient. Cette fois la domination romaine de Carthage ne dure qu'un
peu plus d'un siècle. En 698, les conquérants arabo-musulmans mettent fin officiellement à
l'époque Romaine en établissant Ifriqya. Dans l'époque Arabo-musulmane, la Tunisie
connaît la prospérité à tous les niveaux. Cette prospérité est favorisée par les dynasties
arabes puis ottomanes qui se sont succédées à la tête du pays jusqu'à l'année 18816. À cette
date, exactement le 12 mai, la Tunisie devient un protectorat français. La colonisation
française du pays perdure jusqu'à la deuxième moitié du vingtième siècle. Après plusieurs
années de lutte marquées par la résistance militaire, l'indépendance du pays donne
naissance à une nouvelle époque historique : la période de souveraineté. Cette
indépendance a été proclamée officiellement le 20 mars 1956.
Ce survol rapide de presque 3000 ans, montre que la Tunisie a constitué un véritable
endroit de croisement des civilisations anciennes qui ont marqué toutes leurs traces sur
cette terre. Des traces qui existent concrètement jusqu'à nos jours et qui continuent à
habiter le vécu du tunisien. Elles se manifestent essentiellement par les métiers artisanaux
pratiqués dans les temps modernes qui témoignent de leurs appartenances à des époques
historiques lointaines. Le secteur artisanal tunisien représente un véritable miroir à travers
lequel on peut effectuer une lecture sociohistorique et culturelle de la société tunisienne.
Dans le produit artisanal tunisien se fondent et se confondent l'habileté manuelle et
l'intelligence. Les matières, les techniques et les formes de ce produit ont été toujours
revues et réactualisées par les artisans de chaque époque. De ce fait, le produit artisanal
tunisien, qui a une présence remarquable dans le vécu quotidien actuel, est imprégné de
5 Les Vandales sont un peuple germanique oriental. Ils conquirent successivement la Gaule, la Galice et la Bétique (en Espagne), l'Afrique du Nord et les îles de la Méditerranée occidentale lors des Grandes invasions, au ve siècle. Ils fondèrent également le « royaume vandale d'Afrique », ou « royaume de Carthage » (439-533).
Chronologiquement dans l'époque Arabo-musulmane la Tunisie a connu les périodes suivantes: 1- La dynastie des Aghlabide fondée vers l'année 800, 2- la dynastie des Fatimides prend la succession en 909, 3-la dynastie des Almohades prend le relais en 1159, 4- en 1236 c'est la dynastie des Hafsides qui prend le pouvoir dans le pays,5- en 1574 la Tunisie est annexée à l'empire Ottomane (L'empire ottoman est un empire multiethnique, qui a existé de 1299 à 1922 (soit 623 ans). Il a laissé la place, entre autres, à la République de Turquie. Fondé par un clan turque oghouze en Anatolie occidentale, l'Empire ottoman s'étendait au faîte de sa puissance sur trois continents : toute l'Anatolie, le haut-plateau arménien, les Balkans, le pourtour de la mer Noire, la Syrie, la Palestine, la Mésopotamie, la péninsule arabique et l'Afrique du Nord (à l'exception du Maroc). , 6- en restant toujours une province de cet empire la Tunisie acquiert en 1705 sous la dynastie des Husseinites
31
valeurs culturelles et d'ajouts civilisationnels. Utilitaire ou décoratif, traditionnel ou
moderne, ce type de produit est considéré en Tunisie en tant que signe d'identité locale et il
représente aussi une source de richesse économique locale.
Ne visitez pas les pays d'orient dans l'espoir d'y trouver la survivance des anciens métiers d'arts, car leurs disparition y est presque complète ; recherchez-les plutôt en Afrique du Nord où ils présentent encore une vitalité étonnante aussi bien au Maroc qu'en Algérie et en Tunisie. (Prosper Ricard cité par Revault, 1967 :5).
Après avoir été marginalisé pendant les trois premières décennies de l'indépendance (1956-
1980), ces métiers sont réintégrés à l'époque actuelle dans le processus économique du
pays pour constituer une source de création d'emploi et de richesse économique d'une part,
et pour renouer avec la culture locale d'autre part. Dans cette perspective l'artisanat en
Tunisie constitue un aspect fondamental du patrimoine culturel pays. Elle véhicule des
valeurs culturelles profondément ancrées dans la mémoire collective de la société
tunisienne.
Sur le plan économique, la Tunisie se caractérise par la faiblesse de ses ressources
naturelles comparativement à ses voisins, surtout l'Algérie et la Libye. En dépit de cette
modestie en ressources naturelles, le pays est considéré comme le premier pays de la région
à être entré dans la catégorie des pays à revenu moyen. Le rapport mondial 2008-2009 du
Forum mondial de Davos sur la compétitivité a classé l'économie tunisienne première au
Maghreb et en Afrique, quatrième dans le monde arabe et 35ème au niveau mondial sur un
total de 134 économies (Porter et Shawb, 2008). L'économie tunisienne, inscrite dans un
processus de réformes et de libéralisation depuis 1986, se distingue des économies des pays
de la région par sa diversification. Le secteur tertiaire (secteur de services) occupe le
premier rang avec un taux de contribution au Produit Intérieur Brut (PIB) qui s'élève en
2007 à 58.5 %. La part importante dans ce taux, revient au secteur du tourisme7 qui
représente un véritable appui pour le secteur de l'artisanat dans le pays. Les touristes
constituent une importante clientèle pour les produits artisanaux tunisiens. En second lieu
7 En 2007 la Tunisie a accueilli 6 761 906 visiteurs étrangers soit une augmentation de 3,2 % par rapport a 2006. Les marches de proximité (Algérie et Libye) atteignent a eux seuls prés de 2,4 millions de visiteurs sur un total de 6,7 millions. Les recettes réalisées sont de l'ordre des 5,3 milliards d'euros (+ 3 %). L'exercice a été marqué par une certaine mutation des flux touristiques en provenance des marches européens
32
vient le secteur secondaire (secteur de l'industrie) avec un taux de contribution de 30 %. En
fin, se classe le secteur primaire (secteur de l'agriculture) avec un taux de contribution de
11,5 %. Le PIB de la Tunisie en 2010 s'élève à 44 290 milliards de dollars (Banque
Mondiale, 2011). Pour le PIB par habitant, il s'élève à 9 400 $ (Statistiques Mondiales,
2011), c'est le PIB par habitant le plus élevé de la région8. Le PIB tunisien a connu une
évolution considérable pendant les deux dernières décennies. Au cours des cinq dernières
années, la moyenne de croissance du PIB est de 5,5 %. Cette croissance a contribué, sans
aucun doute, à l'amélioration des conditions de vie de la population tunisienne qui s'élève
au premier juillet 2011, selon l'Institut National des Statistiques en Tunisie (INS, 2011), à
10 673 300 habitants. Malgré cette constance dans la croissance économique, le pays
enregistre un taux de chômage très élevé qui touche principalement la catégorie des jeunes.
Ce taux s'élève en 2011 à 18,3 % de la population active du pays (INS, 2011). Un peu plus
de 11 % de la population active occupée en 2009 évolue dans le secteur de l'artisanat (INS,
2010). Ce dernier ne cesse de prendre de l'ampleur dans l'économie tunisienne depuis les
deux dernières décennies. Ceci s'est manifesté par la mise en œuvre d'une stratégie
nationale qui visait la réglementation et l'institutionnalisation du secteur afin de le sortir de
l'économie informelle9 d'une part, et d'en paire une source de création d'emploi et de
richesse pour la population dans un contexte de crise économique globale.
1.2 Cadre réglementaire et institutionnel des entreprises artisanales tunisiennes
L'étude des entreprises artisanales tunisiennes nécessite inévitablement de mettre en
évidence la définition de la législation tunisienne des différentes composantes du secteur de
l'artisanat ainsi que de présenter les institutions qui gèrent ce secteur. En ce qui concerne la
législation tunisienne, il est important de noter, au début, que les textes législatifs se
rapportant au secteur de l'artisanat en Tunisie remontent à la fin du 19e siècle1 (Barouni-
Ben Sedrine, 2003). Étant donné que notre étude s'intéresse à l'artisanat dans le contexte
actuel et non pas dans l'histoire, nous nous limitons ici aux textes de l'époque moderne. La
8 La Tunisie se classe avant l'Algérie et le Maroc qui enregistrent, en 2010, consécutivement 7 300$ et 4 800 $ de PIB par habitant. 9 En 1989, une étude entreprise par l'Union Tunisienne de l'industrie, du Commerce et de l'artisanat et réalisée Afif Hendaoui et Belkacem Haddad sur : « Le secteur de l'artisanat : situation et perspectives » notait que « ce secteur est souvent perçu dans le cadre de l'économie informelle ». ' Les premiers textes législatifs du secteur de l'artisanat en Tunisie datent de l'année 1882.
33
loi 106 du 3 décembre 1983 constitue le texte de base en la matière. Cette loi a défini
précisément l'artisanat, l'artisan, et l'entreprise artisanale. Le premier article de cette loi
définit l'artisanat comme suit :
L'artisanat s'entend pour toute activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service, essentiellement manuelles et exercées à titre principal et permanent dans une des branches dont la liste est fixée par arrêté du Ministre du Tourisme et de l'Artisanat.» L'article ajoute que : « Cette activité doit être exercée : Soit directement ou sous sa direction par un artisan tel que défini par l'article 2 de la présente loi. - Soit dans le cadre d'une entreprise artisanale telle que définie à l'article 7 de la présente loi. - Soit dans le cadre d'une entreprise artisanale telle que définie à l'article 7 de la présente loi. » (Article 1, Loi 106, 1983-106).
En ce qui a trait à l'artisan, il est défini par le deuxième et le troisième article de cette loi de
la manière suivante :
Au sens de la présente loi, l'artisan s'entend de tout travailleur autonome exerçant une activité artisanale telle que définie à l'article 1er de la présente loi et justifiant d'une qualification professionnelle, définie suivant les conditions qui sont fixées par décret. (Article 2, Loi 106, 1983 -106). L'artisan peut travailler à domicile ou dans tout autre local, utiliser des outils à main et des machines, avoir enseigne atelier chantier ou magasin acheter les matières premières qu'il transforme en respectant les réglementations spécifiques relatives aux diverses branches d'activités artisanales. (Article 3, Loi 106, 1983 -106).
Pour l'entreprise artisanale, l'article sept de la loi 106-83 la définit de la façon suivante :
Au sens de la présente loi, l'entreprise artisanale s'entend de toute entreprise ayant l'une des formes suivantes : individuelle, société de personnes ou coopérative et présentant les caractéristiques suivantes :
L'exercice d'une activité artisanale telle que définie à l'article 1er de la présente loi ; L'emploi de moins de 10 personnes indépendamment du chef de l'entreprise et des membres de sa famille composée des ascendants, descendants et conjoints lorsque celui-ci a la qualité d'artisan à moins d'une dérogation accordée par le Ministre du Tourisme et de l'Artisanat après avis de la Commission Régionale de l'Artisanat visée à l'article 5 et dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de la présente loi. Une direction assurée par un artisan tel que défini au chapitre II de la présente loi ou par l'association d'un artisan au moins, qui assure la conduite technique de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'entreprise dont le chef n'a pas la qualité d'artisan. Toutefois, aucun artisan ne peut assurer la direction technique de plus d'une entreprise, sauf cas
34
exceptionnels autorisés par le Ministre du Tourisme et de l'Artisanat. (Article 2, Loi 106, 1983-106).
De ces définitions ressort les critères principaux suivants :
1) L'artisanat ne peut concerner que certains actes déterminés : il s'agit de toute activité de
production, de transformation, de réparation ou de prestation de service.
2) La loi exige en premier lieu que l'activité artisanale soit essentiellement manuelle, c'est
le caractère le plus spécifique de l'artisanat. En contrepartie, la loi n'a pas déterminé un
critère objectif en matière d'utilisation des machines. De ce fait, l'artisan peut
théoriquement utiliser outillages, machines simples ou complexes.
3) L'activité artisanale doit être exercée à titre principal et permanent.
En plus de sa délimitation du champ de l'activité et du mode d'exercice de l'activité
artisanale, la loi 106-83 impose aux entreprises l'obligation d'immatriculation dans le
répertoire des entreprises artisanales". De même, elle exige des personnes exerçant une
activité artisanale de détenir une carte professionnelle12 leur donnant le droit au statut
d'artisan. Cette carte représente une sorte de certificat d'identité professionnelle. La gestion
du répertoire des entreprises artisanales, qui regroupe les branches d'activités artisanales
fixées par les ministères de la tutelle13, et la délivrance de la carte professionnelle est confié
à l'Office National de l'Artisanat (ONA) qui est né à l'aube de l'indépendance, en 1959
1 ' Un Répertoire des Entreprises Artisanales a été crée par un arrêté des ministères de la tutelle. La gestion du répertoire en question, qui détermine les branches d'activités artisanales, est confiée à l'ONA. Trois formes d'entreprises artisanales sont admises par la loi tunisienne : la forme individuelle (C'est la forme d'entreprise la plus répandue dans les activités artisanales et des métiers), la forme de société de personnes et la forme coopérative (Cette forme est plutôt courante dans les aspects commerciaux en amont et en aval de l'activité artisanale de production proprement dite). 12
La carte professionnelle, qui constitue une sorte de certificat d'identité professionnelle pour les gens pratiquant une activité de production de type artisanal, est obligatoire (articles 4, 5,6 de la loi 106-83) pour l'artisan, elle constitue un élément de preuve de la qualité d'artisan. La qualification professionnelle peut être démontrée, selon la loi, par l'une des manières suivantes : 1) par l'ancienneté dans l'exercice de la profession, justifiée par l'aminé, par des témoignages. Pour contrer les témoignages de complaisance, le décret de 1985 a instauré le test de qualification professionnelle et les conditions de son administration ont été définies par arrêté du Ministère des affaires sociales. 2) Par un diplôme d'aptitude professionnelle. 3) Par une attestation de fin d'apprentissage délivrée par l'ONA ou le Ministère de la formation professionnelle.
L'artisanat en Tunisie était attaché au début au ministère du Tourisme et maintenant au ministère du commerce.
35
pour accomplir une mission d'encadrement et de développement du secteur. Durant les
trois premières décennies de l'indépendance, l'artisanat n'était pas dans les choix
prioritaires du pays. Cependant, l'ONA a essayé de fournir l'effort nécessaire pour apporter
des contributions appréciables dans la création d'emplois et la sauvegarde du patrimoine
artisanal. Une première restructuration interne de l'ONA a été engagée en 1984. Elle a
permis de séparer les activités de promotion et de production et de commercialisation. Ces
différentes activités font intervenir une panoplie d'acteur dans le secteur d'artisanat en
Tunisie. Ces acteurs peuvent être divisés en deux principales sphères, soit une sphère privée
et une autre publique. Le schéma suivant illustre les principaux acteurs de l'artisanat en
Tunisie.
36
.0. '3!
c •si
-
TJ M -= U !«
u = CT"
IC
y C
: j ■y.
o J 5
>-
U -3 'J
s CJ F U rt
CL, s ■ i - 3 3 u u 3
Z 3
u •— n
u — -o TJ
a S <u — rt W ^ r — M)
S 73 0 d 'C > r -; •o 3
n — 1
o. 3 y.
rt (A 153
— 0
o u
— 3 n
— CX c 0
3 u E
E y .
"C 3
T 3
y
£ E
«a 3 E 1 E
y . "C 3
y E S
o TJ i c 0 3 U -LU - L . LU H U
i — . Tf r i y U
CS
e ~ x
U a c
X u U
w u g > 3
_3
c U
< z
X -J 3 C
<
3 < —-es
> 3
_3
<
M rt
'Si 3
— C
01 c '—' TJ y. T3 "O '—' -1 -y. ,—, ■*-J
01 ■ -
• y ' ^ M S
ed C a -y.
G rt s.
r <
y
u X -J
d o rt
•o TJ
4> U
OJ
S
01 ■ -
• y ' ^ M S <| TJ < U x F, B Ci
Ol
£ s
• m *
B M
"3 c o
o "3 "rt C
cd Z
_y
C O rt
Z c o
tu
■S E
TJ Tec
hn
iqu
e de
emen
t du
Tap
o U u
TJ DQ
'— X)
e. rt i O u
U u -y.
rt o y .
y H rt U
U3 c — i c a y t / j
l M o o u C 0 U X U O — • • • • • T3 • •
VJ
U y.
T3 3 — _. 3 es "J ■ >
c — >. n r j r 0
^0 — rt sC O 2
U ' ; -r es r X r. u — < u
E ~ —. -y.
1) -es .— 3 h f »
u —
< 3 U X CJ
U oc
S 0)
e
c ,—, •2 S o ed e <
•o
TJ
3
q <
ry. U
■a B
X o 3 3
< y = eS B
O l
£ y
TJ
< Z C
U Q
IS O D-, F O
E u y 3 rt 3
LU
TJ 3 vn r, x H cn VS
TJ _ O £ u OJ
- 1 tn B O
U. Z TJ
TJ T J 3
CT
y ' u
c 'A C y M 0 ■ ^
o 3 rt H X —
• 1
U. T 3 3
BÛ 3 • c •
T 3 3
• LU
u
0) 0) 0) ' 01 >• n
01 B Ol
c M vi 3 a c _ O - O» c Ol « n. . ^ u M 01 E
E o
Gu
to
uri
s
'O l JB a.
«3 LÉ
< B E E o
Gu
to
uri
s
'O l JB a.
«3
Depuis la fin des années 1980, le gouvernement ainsi les autres acteurs intervenant dans le
secteur n 'ont pas cessé de donner à celui-ci des impulsions pour son développement. La
création, en 1988, du Ministère de tourisme et de l'artisanat couronnait les initiatives au
profit du secteur. En 1990, il a été décidé de séparer juridiquement les activités de l 'ONA
et de redéfinir sa mission et ses objectifs. Le but était de donner un élan à la promotion des
activités artisanales et principalement aux initiatives privées. Depuis, l'office joue un rôle
important au profit de la promotion du secteur, l 'encadrement, la formation et la mise en
œuvre des choix politiques du pays.
Les missions de l 'ONA, défini par l'État, consiste à:
1 ) sauvegarder le patrimoine artisanal et favoriser son développement ;
2) encadrer et assister les artisans et les entreprises artisanales ;
3) favoriser la promotion des produits du secteur sur les marchés nationaux et étrangers ;
4) contrôler sur le plan technique la qualité de la matière première et du produit fini ;
5) encourager la création et les recherches dans le secteur de l'artisanat ;
6) promouvoir l ' investissement dans le secteur ;
7) mettre en œuvre des programmes de mise à niveau et de recyclage au profit des
entreprises artisanales ;
8) encadrer sur le plan technique les différents programmes intervenants dans le secteur.
L'analyse des documents et des publications de l'Office National de l 'Artisanat en Tunisie,
nous ont permis de déduire que les principales réalisations de cette institution, au cours des
dernières années, ont eu pour ultime objectif la promotion du secteur de l'artisanat afin de
le rendre capable de remplir les responsabilités qui lui sont confiées par l'État : les
responsabilités économiques, sociales et culturelles. Pour ce faire, l 'ONA intervient à
plusieurs niveaux, tels que l 'encadrement des artisans, la formation professionnelle, la
promotion des investissements et les crédits de fond de roulement, le contrôle de la qualité,
la promotion des exportations, le développement et la commercialisation des produits
artisanaux, l 'incitation des artisans à l'innovation et à la création, la promotion de la
consommation des produits artisanaux au sein de la société. Ces différentes réalisations et
interventions ont été couronnées, en 2002, par le lancement d 'une étude stratégique, piloté
3 S
par l'office, pour la promotion du secteur de l'artisanat à l'horizon de 2016. Trois
principaux objectifs ont été fixés par cette étude :
1 Une meilleure connaissance du secteur, de ses performances et de ses préoccupations.
2. L'élaboration d'une stratégie globale de réhabilitation et de développement des activités
artisanales.
3. Le développement de plans d'action pour soutenir cette politique et tracer les objectifs à
réaliser par les différents intervenants.
Les résultats de cette étude ont permis d'identifier les problèmes ainsi que les besoins du
secteur de l'artisanat. En fonction de ces résultats, un plan d'action intégrale a été arrêté. Ce
plan a eu comme première étape de préparer le terrain à la mise en application des
composantes de ce plan. En effet, les différentes institutions intervenantes dans le secteur
ont été restructurées. Après avoir franchi cette étape, les autres composantes du plan sont
actuellement en cours d'application. Ces composantes s'inscrivent dans deux principaux
volets. Pour le premier volet, il comprend des interventions et des mesures qui concernent
le secteur de l'artisanat dans sa totalité. L'élaboration d'un système d'information constitue
la composante principale de ce volet. Il s'agit de faire publier les références et les codes
nationaux se rapportant aux activités du secteur afin de les classifier. Dans ce cadre, un
observatoire national de l'artisanat14 a été créé en 2005 dont le but de mettre en place un
système d'information permanent permettant de prendre les meilleures décisions en faveur
du secteur en question. En ce qui a trait au deuxième volet, ses actions concernent les
différentes branches des activités artisanales. À chacune de ces branches, des mesures et
14 L'Observatoire de l'Artisanat est une structure au sein de l'ONA qui a pour rôle :
• d'observer le secteur de l'artisanat et d'établir son portrait économique; • de collecter l'information existante : études réalisées, événements, ressources, banque de compétences, programmes de soutien et de formation, etc; • d'œuvrer à la mise en réseau des données existantes; • de traiter les données pour en faciliter la diffusion et l'accès; • d'élaborer le tableau de bord du secteur et d'en suivre l'évolution et les tendances à l'aide d'indicateurs économiques; • d'établir des indicateurs de performance pour le secteur; • d'étudier l'incidence des mesures politiques sur le secteur; • de faire connaître le point de vue des artisans et des chefs d'entreprises artisanales aux législateurs, aux médias et à la population; • de mieux contrôler le secteur et d'éclairer ses problèmes;
39
des opérations spécifiques sont mises en application. Les différentes composantes du plan
d'action, qui viennent d'être citées, s'inscrivent dans la même logique de consolider le rôle
de l'artisanat en général et de l'entreprise artisanale en particulier dans le processus de
développement économique et social du pays. Ce rôle ne cesse d'évoluer au cours des
dernières années. Ceci nous conduit à s'interroger sur la réalité du secteur dans le contexte
actuel.
1.3 Le secteur des entreprises artisanales de métiers ancestraux en Tunisie :
quelques données significatives
Au cours des trois premières décennies qui ont succédé à l'indépendance du pays en 1956,
le secteur de l'artisanat a été quasi-totalement marginalisé par les plans de développement
et les stratégies économiques lancées par le jeune État tunisien.
Les politiques de développement entreprises dès l'indépendance ont donné la priorité aux grands projets industriels. Une telle priorité ne s'est pas seulement traduite par des avantages accrus consentis à l'industrie, mais aussi par la mise en veilleuse ou le renoncement au maintien de structures spécifiques à l'artisanat qui avaient pourtant fait leurs preuves, mais que l'on considérait désormais comme surannées. (Charmes et Sanaa, 1985 :5)
D'ailleurs, ce secteur a été considéré pour longtemps comme une partie de l'économie non
structurée du pays. Vers la fin du vingtième siècle, la situation a complètement changé.
L'artisanat devint au centre des intérêts des responsables politiques pour en constituer un
secteur stratégique de part ses dimensions culturelles, sociales et économiques. Ce
changement de regard à l'artisanat s'inscrit dans une approche intégrale visant d'une part
l'exploitation de toutes les ressources nationales disponibles dans le processus du
développement économique et social du pays, et de l'autre part la promotion des
spécificités culturelles nationales tant sur le plan national que sur le plan international. Dès
lors, les mesures prises en faveur de ce secteur ne cessent de se multiplier d'une année à
l'autre. Ces mesures visaient la structuration progressive et la promotion du secteur afin de
le rendre un véritable créateur d'emplois stables à haute valeur ajoutée et d'accroître sa
contribution dans la richesse du pays. Les mesures entreprises se centrent toutes autour du
renforcement de l'encadrement des artisans et de l'impulsion de l'investissement et
l'exportation dans les différentes branches de l'artisanat. Le lancement d'un programme
40
national de mise à niveau des entreprises artisanales en avril 2009 afin d'améliorer leur
compétitivité s'inscrit dans cette logique. Dans la même lignée des mesures, des villages
d'artisans sont aménagés afin que le produit artisanal soit présenté d'une manière plus
agréable et plus attractive à la clientèle. Ces villages regroupent des artisans de divers
métiers artisanaux. L'objectif est d'atteindre 19 villages en 2010. Les différentes mesures
de promotion du secteur de l'artisanat se sont consolidées par la mise en œuvre d'une
stratégie nationale de sensibilisation de la société tout entière à la production artisanale et à
la consommation des produits de l'artisanat. Pour cette raison une journée nationale de
l'artisanat, institué par l'État depuis 1991, est célébrée le 16 mars de chaque année. Ainsi,
l'artisanat est devenu une préoccupation nationale et sociétale.
Les statistiques les plus récentes de l'Office National de l'Artisanat (ONA) explicitent que
le secteur de l'artisanat en Tunisie a connu une évolution considérable au cours de ces
dernières années et que son poids dans l'économie nationale connaît une courbe ascendante
depuis l'année 2006. Cela dit, les stratégies, les plans et les mesures en faveur du secteur en
question commencent à donner des résultats positifs. Actuellement, la liste des activités
artisanales comporte plus de 70 métiers répartis sur 10 groupes dont le tissage, les fibres
végétales et l'argile et la pierre qui constituent nos cas à l'étude. Ces dix groupes emploient
ensemble plus de 350 000 personnes soit 11 % de la population active. Le tableau suivant
montre l'évolution de la création des emplois dans le secteur de l'artisanat de 2006 à 2010.
Tableau 1: Évolution de la création d'emploi dans le secteur de l'artisanat en Tunisie
Désignation 2006 2007 2008 2010
Nombre de projets 6 206 6 930 7 167 8000
Valeur (1000D) 13 967 18 565 19 797 20000 Nombre d'emplois 7 672 9 722 10 236 9500 Source : http://www.onat.nat.tn/
Ces chiffres indiquent que le secteur constitue un véritable pôle d'emplois aujourd'hui,
surtout si l'on sait qu'entre l'année 1993 et l'année 2000 le secteur n'a contribué qu'à la
création de 5102 postes d'emploi. Toujours selon les données divulguées par l'ONA sur
son site Internet, le secteur de l'artisanat en Tunisie contribue pour 5 % dans le PIB et
exporte pour une valeur de 200 millions de dollars. Le nombre des cartes professionnelles
41
attribuées aux artisans jusqu'aux 31 décembre 2009 est 115 160 cartes alors que le nombre
des artisans ayant une carte en 1988 ne dépassait pas les 586 artisans. De ce fait, le nombre
des artisans inscrit et reconnu par l'ONA s'est multiplié par plus de 196 fois. Dans la même
tendance d'évolution, les unités productives enregistrées dans le répertoire des entreprises
artisanales sont passées à 3563 entreprises à la fin de l'année 2009 contre 622 entreprises
seulement à la fin de l'année 2000.
En somme, ces chiffres ne peuvent que témoigner de l'ampleur économique que
commence à connaître le secteur de l'artisanat en Tunisie dans le contexte actuel. De ce
fait, les entreprises artisanales ont su s'adapter au nouveau contexte et, à vrai dire, ont
trouvé dans ce contexte un nouvel élan. Tout en participant aux objectifs de la croissance
économique et à la protection de l'identité locale, l'entreprise artisanale tunisienne de
métier ancestral constitue donc une réponse aux bouleversements provoqués par la
globalisation. Ceci n'était pas dans les pronostics mêmes des plus optimistes lors la mise en
œuvre du pays d'un processus intégral d'ouverture et de libéralisation de son économie
depuis presque un quart de siècle. Avec cette démarche, le devenir des appareils productifs
locaux de tous types se trouvaient plus que jamais face à de nouvelles contraintes. « Les
nouveaux changements que connaît l'environnement économique, politique et social
tunisien placent l'entreprise devant de nouveaux défis » (Zghal, 2000 : 127). Étant donné
leurs caractéristiques, les entreprises de type artisanal sont considérées les plus vulnérables
dans cette situation.
Les données présentées plus haut montrent que les résultats sont à l'encontre des
pronostics. Ce faisant, ce type d'entreprise a su s'adapter à ce nouveau contexte et, à vrai
dire, a trouvé dans ce contexte un nouvel élan. Tout en participant au développement, à la
protection de l'identité et aux objectifs de la croissance économique, l'entreprise artisanale
en Tunisie constitue une réponse à la globalisation qui a modifié profondément les
conditions d'existence des humains et des organisations à l'échelle planétaire.
42
2. Tunisie et globalisation : nouveaux défis et nouvelles contraintes pour l'entreprise artisanale tunisienne de métier ancestral
Au seuil du 21e siècle, le monde connaît une nouvelle vague de changements rapides et
profonds. Ces transformations sont les résultantes d'un long processus multidimensionnel
dans lequel se sont mêlées des dynamiques de divers types depuis la fin de la Deuxième
Guerre Mondiale. Les changements se manifestent dans toutes les dimensions et domaines
de la vie humaine (Beck, 2000; Steger, 2003; Abélès, 2008; Lemarchand, 2009; Sassen,
2009). Les distances entre les pays se réduisent et les différences entre les sociétés ne
cessent de s'atténuer. Le monde est devenu selon l'expression de Marshal McLuHan, « un
village planétaire». Dès lors, on parle d'une nouvelle configuration du monde qui intègre la
majorité écrasante des pays de la planète, tels que la Tunisie qui représente le territoire de
notre recherche. Alors de quoi parle-t-on lorsqu'on dit une nouvelle configuration du
monde ? Et comment la Tunisie s'est elle intégrée dans cette configuration ?
2.1 La globalisation : un phénomène à facettes multiples
Après une division en deux blocs antagonistes, depuis la fin du deuxième conflit mondial,
soit le bloc capitaliste et le bloc socialiste, le monde connaît vers la fin du 20e siècle
l'émergence d'une nouvelle ère historique. Dans la littérature francophone en sciences
sociales traitant de la question, on repère le plus souvent l'usage de deux termes pour
désigner cette ère, à savoir la globalisation et la mondialisation. Si certains voient que le
second n'est que la traduction française du premier qui est d'usage dans la littérature anglo-
saxonne, Guy Rocher (2001) nous offre une distinction originale entre les deux termes.
Selon cet auteur, le terme de globalisation est le plus adéquat pour décrire la nouvelle
époque historique. Car, toujours selon lui, utiliser le terme de mondialisation revient à se
référer à une seule dimension de la réalité contemporaine qui est l'extension des relations et
des échanges internationaux et transnationaux à l'échelle mondiale. Quant au terme de
«globalisation», il fait référence à l'émergence d'une nouvelle configuration du monde dans
laquelle les différents aspects de l'activité humaine, économique politique, sociale et
culturelle, ont été touchés par des changements. «La globalisation ferait référence à
l'émergence d'un système-monde, au-delà des relations internationales, au-delà de la
mondialisation, un fait social total au sens propre du terme, un réfèrent en soi » (Rocher,
43
2001 : 19). D'ailleurs, dans la littérature anglo-saxonne, ce même terme est d'usage afin de
rendre compte des multiples transformations, à l'œuvre depuis la fin du dernier siècle, du
monde. De ce fait, le terme de globalisation permet d'englober les diverses dimensions de
la réalité de la nouvelle époque historique. « Le concept de globalisation présente un apport
précieux, du point de vue théorique, pour rendre compte du monde dans lequel nous vivons
aujourd'hui. Ce qui équivaut à reconnaître la profondeur des mutations qu'ont connues, au
niveau planétaire, l'économie et la société » (Abélès, 2008 : 18). Au-delà des polémiques
autour de la terminologie, les spécialistes en sciences humaines et de la société, toutes
langues confondues, s'accordent sur le fait que la nouvelle ère historique se caractérise par
l'uniformisation du monde sur divers niveaux.
Cette caractéristique est expliquée, par ces sciences, par plusieurs facteurs qui se sont
conjugués pour donner naissance à une nouvelle configuration du monde appelée par
Immanuel Wallerstein (2009) «système-monde ». Pour sa part, Daniel Mercure (2001)
précise que quatre grands moteurs ont été à l'origine des transformations que connaissent
les sociétés contemporaines : 1) la crise économique des années 1975 et la fin des Trente
Glorieuse, 2) l'émergence d'une nouvelle économie dite économie du savoir, 3) la
révolution des technologies du traitement de la communication et de l'information, 4)
l'essor de l'idéologie néolibérale et la quête de la flexibilité chez les grandes entreprises.
De ce fait, la globalisation n'est pas le fruit du hasard, mais elle est la résultante d'un
processus multidimensionnel de changement.
À travers son analyse et sa présentation des dynamiques historiques qui ont contribué à la
constitution de ce système, Wallerstein montre que la variable économique a joué un rôle
principal dans l'édification de ce système. Selon lui, la mise en œuvre de nouvelles règles
et structures économiques, régissant l'économie à l'échelle planétaire, a contribué à la mise
en place du système-monde. Ceci est rendu possible grâce à la révolution des moyens de
communication et de transports qui a contribué à l'abolition des frontières traditionnelles
entre les nations et la réduction des distances qui les séparent d'une part, et la mise en place
des institutions à caractère international, couvrant plusieurs domaines, de l'autre part
(Scholte, 2005). Ces deux éléments ont facilité, entre autres, la circulation des biens, des
services et des capitaux et à l'instauration de l'économie du marché à l'échelle mondiale.
44
Ainsi, la globalisation se caractérise par ce qui est convenu de l'appeler «mondialisation de
l'économie». « Parler de la mondialisation de l'économie, c'est évoquer l'emprise d'un
système économique sur l'espace mondial » (Adda, 2004 : 3). Le système en question n'est
que le système économique néolibéral. Ce dernier a réussi à imposer ses logiques, ses
normes et ses valeurs dans la quasi-majorité des pays de la planète. Ce modèle économique,
instauré par les grandes puissances mondiales et les institutions internationales, s'impose
comme une réalité concrète partout dans le monde pour rompre avec les modèles jadis
existants.
Apparus dans les années 1970-1980, les mots de dérégulation et déréglementation seraient autant synonymes du mot mondialisation. Désormais, ce sont les lois du marché et ses lois seules qui régissent la bonne marche de l'économie mondialisée. Sur le plan doctrinal, la mondialisation marquerait la triomphe du néolibéralisme incarné par Margret Tatcher et Ronald Reagan et auquel, à leur tour, les institutions internationales, à commencer par le Fond Monétaire International (FMI)15, le GATT16 (remplacé en 1995 par l'OMC17), l'OCDE18, le G819 se seraient laissé gagner. Ce sont elles qui imposent la déréglementation, la privatisation [...]. En un mot la mondialisation». (Allemand et Ruano-Borbalan , 2008 : 19)
La logique économique néolibérale s'est concrétisée par la libéralisation des échanges des
produits, des services et des capitaux à l'échelle planétaire, de façon que le monde est
devenu un immense marché sans frontières ni barrières douanières. Charles Albert
Michelet (2004) qualifie la mondialisation de l'économie comme un phénomène complexe
15 Le Fonds Monétaire Internationale est une organisation internationale crée en 1945 dont le but de favoriser la coopération monétaire internationale. Cette organisation regroupe actuellement 186 pays. 16 Le General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), en français Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, fut signé en 1947 pour harmoniser les politiques douanières des parties signataires. Le traité entra en vigueur en janvier 1948. 17 L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) est institutionnalisé en 1995, à la suite des négociations de l'Uruguay Round entamées depuis 1987, a joué un rôle de premier plan dans la construction du système-monde. Cette organisation qui a remplacé les accords du GATT s'est présentée comme le principal régulateur de l'économie mondiale. La suppression des tarifs douaniers est l'une des conditions principales qui permettent à un pays donné d'accéder à cette organisation devenue inévitable. Selon les dernières statistiques Février 2010, l'OMC compte 153 pays membres et 33 pays ayant le statut d'observateur, donc elle englobe la majorité écrasante des pays de la planète. Le but de cette organisation est d'aider, par la réduction d'obstacles au libre-échange, les producteurs, les exportateurs et les importateurs à mener leurs activités. Bref, l'OMC favorise l'économie du marché. 18 L'Organisation de Coopération et de Développement Économique est organisation internationale qui regroupent les pays attachés aux principes de l'économie de marché. 19 Le Groupe des huit regroupe les huit pays parmi les plus puissants économiquement au monde : États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Canada et Russie.
45
qui englobe à la fois trois dimensions : l'échange de bien et de services, les investissements
directs à l'étranger et la circulation des capitaux. Le même auteur détermine trois
configurations de la mondialisation de l'économie :
1) une configuration inter-nationale avec laquelle la mondialisation a pour dimension
dominante les échanges des biens et des services entre les pays;
2) une configuration multinationale où la dimension prédominante est la mobilité de la
production des biens et des services;
3) une configuration globale caractérisée par la prédominance de la dimension financière.
En effet, la mondialisation de l'économie a contribué à l'instauration de nouvelles
dynamiques économiques à l'échelle globale. Elle est aujourd'hui sans précédent dans
l'histoire de l'humanité, tant par son amplitude que par ses caractéristiques. Elle a
transformé le monde en un véritable système d'interdépendance, si un de ses éléments est
affecté le reste des éléments le seront aussi (Beck, 2006). Dans la nouvelle ère, on parle de
plus en plus de l'économie transnationale, mais de moins en moins de l'économie
nationale. En plus de la transnationalisation de l'économie, la mondialisation de l'économie
a été à l'origine de l'émergence du phénomène de la régionalisation. Ce dernier s'est
manifesté principalement par la construction des blocs régionaux sur des bases
économiques. La forte tendance, de la fin du deuxième millénaire et du début du troisième,
est la conclusion des accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux (Siroën, 2004). Le
principal objectif de ces accords est le démantèlement des tarifs douaniers afin de faciliter
et intensifier la circulation des biens, des services et des capitaux.
Par ailleurs, dans l'ère de la globalisation les échanges ne concernent pas uniquement les
échanges de nature économiques, plutôt ces échanges concernent également les idées, les
informations et même les humains.
Globalization is a complex and multilayered concept and social phenomenon. In principal, it does not claim more geographic fact: peoples and places in the world are becoming more extensively and densely connected to each other as a consequence of increasing transnational flows of capital/good, information/ideas, and people. (Kalb, 2000: 1).
De cette façon, la définition du phénomène de la globalisation ne peut pas être réductible à
l'amplification des échanges d'ordre matériels. Elle doit inclure, aussi, la multiplication des
46
échanges de natures immatérielles. Néanmoins, ce deuxième type d'échanges est favorisé
en grande partie par le premier. Car les échanges des biens, des services et des capitaux
provoquent inévitablement l'interaction des individus et des cultures (Short, 2001). En ce
sens, l'ère de la globalisation ne signifie pas uniquement l'émergence de nouvelles
dynamiques économiques. Elle traduit, aussi, l'apparition de nouvelles dynamiques
socioculturelles à l'échelle mondiale. D'ailleurs, dans un tel contexte on parle de plus en
plus de l'émergence d'une culture globalisée qui est en train de prendre sa place
progressivement aux déterminants des cultures nationales. Ces cultures se trouvent plus que
jamais confrontées, grâce au développement des moyens de communication et à
l'interdépendance économique entre les nations, à une culture dite globalisée qui tend à
instaurer des logiques de penser et de savoir-faire universelles. Ce faisant, la globalisation
implique l'uniformisation des références culturelles favorisant l'application et la promotion
des logiques économiques néolibérales. Elle représente, en effet, une reconfiguration des
processus d'identification et de socialisation des individus et modifie ainsi les valeurs de
références de la société.
Does globalization make people around the world more alike or more different? This is the question most frequently raised in discussions on the subject of cultural globalization. A group of commentators we might call pessimistic hyperglobalizes argue in favour of the former. They suggest that we are not moving towards a cultural rainbow that reflects the diversity of the world' existing cultures. Rather, we are witnessing the rise of an increasingly homogenized popular culture underwritten by a western culture industry based in New York, Hollywood, London, and Milan. As evidence for interpretation, these commentators point to Amazonian Indians wearing Nike training Shoes, denizens of the Southern Sahara purchasing Texaco baseball caps, and Palestinian youths proudly displaying their Chicago Bulls sweatshirts in downtown Ramallah. ( Steger, 2003 : 70-71)
Donc, on peut parler d'une mondialisation de la culture qui vient compléter une autre
dimension de la globalisation (Appadurai, 1996). La mondialisation culturelle, comme c'est
le cas pour la mondialisation économique, est soutenue par le pouvoir politique et
économique exercé par les grandes puissances et les organismes internationaux qui assurent
le contrôle de la scène mondiale et qui font référence entièrement à la culture occidentale
(Tomlinson, 1999 ; Nederveen Pieterse, 2003). Par conséquent, c'est le modèle culturel
occidental qui prédomine dans le contexte de la globalisation.
47
Déduisons alors que la globalisation exprime, entre autres, le triomphe d'un modèle
économique et d'un autre culturel purement occidental. Ces deux modèles sont devenus
l'image de marque des sociétés contemporaines. D'ailleurs, ils sont imposés comme une
réalité inévitable pour ces sociétés. Les superpuissances du monde ainsi les institutions
internationales considèrent que le modèle économique néolibéral est le seul chemin qui
puisse mener au développement et à la prospérité économique d'une part, et que le modèle
culturel occidental est l'unique synonyme de la modernité. Vu la position de leadership sur
la scène mondiale de ces superpuissances et de ces institutions, les deux modèles en
question sont partagés par la majorité écrasante des pays de la planète.
Certaines institutions économiques et politiques internationales (OCDE, G8...) promeuvent les postulats de l'idéologie néolibérale et d'autres institutions (FMI, BM, O M C . ) établissent de par le monde les règles libre-échangistes et des politiques budgétaires et monétaires orthodoxes pour susciter l'investissement des entreprises transnationales. Ces institutions sont donc les garantes du projet politique néolibéral. En le diffusant dans les quatre coins de la planète elles légitiment l'ordre globalisé. (Nahavandi, 2000 :39).
Ceci signifie que la quasi-majorité des pays se sont engagés dans le processus d'intégration
mondial. La Tunisie, qui constitue le terrain de notre recherche, est l'un de ces pays qui se
sont engagés profondément dans ce processus. Alors comment s'est concrétisée cette
intégration ?
2.2 L'intégration de la Tunisie dans la globalisation
Abordé l'intégration d'un pays donné dans le processus de la globalisation revient à
s'intéresser principalement à son adhésion à la mondialisation de l'économie dans la
mesure où cette action représente, tel qu'il est mentionné précédemment, le premier contact
avec ce processus. Dans le cas de la Tunisie, ce contact remonte à la deuxième moitié des
années 1980. En 1986, le pays en question met en œuvre une nouvelle politique
économique orientée vers la libéralisation totale de son économie. L'objectif de cette
politique est d'assurer une bonne intégration de l'économie locale dans la mondialisation
de l'économie.
Since the early 1970s, Tunisia's trade policy has rested on three pillars. The first is promoting exports, through generous incentives to attract foreign direct investments (FDI) in the "offshore" sector, incentives to exporting firms, and
48
trade agreements. The second is protecting domestic industries and strictly regulating markets. However, a decisive move toward a market economy started in 1986, and a large number of structural reforms were introduced gradually: liberalizing tariffs and prices, privatizing state enterprises, reducing entry barriers to economic sectors and pre-authorizations, and enacting a new competition law. The third pillar is more recent, and concerns trade facilitation. ( World Bank Country Study, 2009: 16)
En .choisissant une telle orientation, la Tunisie rompt avec les politiques économiques
dirigistes autocentrées appliquées depuis son indépendance en 1956 et caractérisées par le
protectionnisme (Zartman, 1991 ; Krim et Hafsi, 1995). Comme dans la majorité des pays
du tiers monde, la libéralisation de l'économie en Tunisie était une obligation plus qu'un
choix. Face aux situations de déséquilibres macroéconomiques insoutenables enregistrés au
début de la deuxième moitié des années 1980, les choix des décideurs politiques étaient très
limités (Sidi Ahmed, 1993). Le FMI et la BM se sont présentés pour eux comme les seuls
refuges pour surmonter la crise économique totale qui menace l'ordre social et politique20.
Effectivement, le FMI et la BM accordaient à la Tunisie, en 1988, le recours à des fonds
étendus pour une période de trois ans. Par la suite, la période de prêt a été étendue plusieurs
fois d'un an jusqu'en 1992. Le montant accordé par le FMI est de 250 millions de dinars
tunisiens, alors que la BM lui accorde un prêt de 130 millions de dinars tunisiens (Guen,
1988:213).
Il convient de noter que l'octroi de ces prêts était subordonné à l'engagement du pays dans
un Programme d'Ajustement Structurel (PAS) de son économie sous le contrôle des
institutions prêteuses, principalement le Fond Monétaire International. « Avant de signer
La Tunisie connaît en 1986 pour la première fois depuis sont indépendance un taux de croissance négatif. Le déficit budgétaire est de l'ordre de 5%. Ce déficit est le résultant du recul des recettes des exportations d'une part et de l'augmentation des dépenses de l'État de l'autre part. Le taux de la couverture des importations par les exportations n'a cessé de régresser. En 1986, les exportations ne couvrent que 57 % des importations. Le déséquilibre entre les recettes et les dépenses était à l'origine d'un taux d'inflation assez élevé. Le taux d'inflation enregistré en Tunisie en 1986 est de 9 %. Afin de couvrir le déficit de la balance commerciale, le gouvernement tunisien de l'époque recourt à l'endettement externe. En effet, le taux d'endettement connaît une remarquable ascension. En 1986, ce taux a représenté 70% du PIB. La dette extérieure de la Tunisie est passée de prés de 2000 en 1980 à 4470 millions de dinars tunisiens en 1987. L'accumulation de la dette a engendré également une hausse au niveau du service de la dette. À cette époque, le service de la dette en Tunisie absorbe à lui seul 27.3 % des recettes courantes. Ces chiffres ne peuvent que témoigner de la gravité de la crise économique qui a traversé la Tunisie au cours de la décennie 1980. Plusieurs facteurs ont été à l'origine de cette crise, tel que la faiblisse du marché intérieur, la chute du prix du phosphate qui constitué une ressource importante pour l'économie du pays, la série de sécheresse qui a frappé le pays à cette époque, la hausse des taux d'intérêt internationaux, l'expulsion de plus de 30000 emigrants tunisiens de la Libye, etc.
49
cet accord, le débiteur doit s'engager, dans une lettre d'intention approuvée par le FMI,
d'appliquer un programme d'ajustement structurel conçu en étroite collaboration avec les
experts du F.M.I» (Ben Hamouda, 1995 : 128). Le PAS a été amorcé officiellement en
Tunisie en 1987.
Au début, il a eu pour objectif l'allégement de la charge et le remboursement de la dette
extérieure. Les anciens concepts, tels que le secteur public et la nationalisation, sont
dévalorisés au profit de nouveaux instruments d'intervention tels que l'ajustement et la
privatisation. En second lieu, le PAS a visé la libéralisation de l'économie du pays afin de
la préparer à l'insertion au nouvel ordre économique mondial. Pour cette raison plusieurs
mesures ont été imposées par le FMI (King, 2003). Parmi ces mesures, nous citons : la
libéralisation de la plupart des prix, la privatisation des entreprises publiques, la
libéralisation du secteur financier, la législation pour le respect de la concurrence, etc. Avec
l'ensemble de ces mesures, l'économie de la Tunisie connaît pour la première fois depuis
l'indépendance un environnement concurrentiel. Le programme d'ajustement structurel
marque une rupture avec les stratégies de développements dirigistes autocentrées. Il
représente une véritable révolution dans les valeurs et les comportements économiques de
l'État tunisien qui se trouve sous l'obligation d'insérer son économie dans le marché
mondial.
Après la fin de la phase de la restructuration et de stabilisation macroéconomique, effectuée
dans le cadre du programme d'ajustement, la Tunisie met en œuvre une politique de
libéralisation et d'ouverture de son économie, imposée par le FMI, afin de s'insérer dans le
nouvel ordre économique mondial. Cette politique a été couronnée par la signature de
l'accord de l'Uruguay Round en avril 1994 qui donne naissance à l'Organisation Mondiale
du Commerce (OMC) au début de 1995 (GATT, 1994). En effet, la Tunisie entre dans la
globalisation par ses grandes portes. Son marché est devenu accessible à tous les États
membres de l'OMC sans payer des taxes douanières.
En parallèle de son adhésion à l'OMC, le pays en question a cherché activement, comme
la quasi-majorité des pays en voie de développement, à participer à des arrangements
régionaux. En signant l'Accord de Libre Échange (ALE) en juillet 1995, la Tunisie prouve
son attitude d'aller toujours de l'avant vers la libéralisation de son économie. L'ALE
50
regroupe les pays de l'Union Européenne et les pays de la Rive-Sud de la méditerranée
dont la Tunisie fait partie. Le processus de Barcelone a lancé solennellement l'ALE en
1995. Cet accord a visé la création d'une Zone de Libre Échange (ZLE) euro -
méditerranéenne à l'horizon de l'année 2010. «L'économie tunisienne passe par une
période cruciale de transition marquée par deux événements décisifs dans le domaine de la
libéralisation des échanges : la mise en œuvre de l'Accord d'association avec l'Union
Européenne (UE) et le démantèlement de l'Arrangement multifibres (AMF)» (Abbate,
2002 : 9). L'objectif du ZLE est de favoriser la libre circulation des produits, des services,
des capitaux et des moyens de production entre les deux rives du bassin méditerranéen. La
politique d'ouverture économique en Tunisie se traduit aussi par la conclusion de plusieurs
accords et conventions commerciaux bilatéraux, tels que l'accord avec la Chine, les États-
Unis, le Brésil, etc.
Ainsi, par son choix d'entreprendre une politique d'ouverture économique totale, la Tunisie
s'inscrit officiellement dans la mondialisation de l'économie. Une adhésion semble être
porteuse tant d'opportunités que de défis. Afin de profiter des opportunités et de relever les
défis, le pays s'est engagé dans une application des politiques économiques néolibérales
très poussées : le désengagement de l'État de la scène économique, les prix de première
nécessité ne sont plus subventionnés, la privatisation de la majorité des entreprises
publiques, la promotion des investissements étrangers, la libéralisation du commerce
extérieure, la libéralisation du secteur bancaire. L'ensemble de ces réformes a créé sans
aucun doute de nouvelles dynamiques économiques dans les pays d'une part, et a contribué
à la création d'un nouveau contexte pour les appareils productifs de tous genres d'autre part
(Hassan, 2005; Zghal, 2006,). Ces derniers doivent, dorénavant, trouver les moyens
nécessaires leurs permettant d'être concurrentiels sur le marché local devenu sans
protection et sur le marché international devenu plus accessible.
Par ailleurs, l'inscription d'un pays donné dans le processus de la mondialisation de
l'économie traduit également, tel qu'il était mentionné antérieurement, la mise de sa société
et de sa culture locales en contact direct avec les dites société et culture globale. Dans cette
perspective, l'ouverture de l'économie tunisienne sur l'extérieur induit également des
opportunités et des défis pour la culture nationale (Troin et Bisson, 2006). Le grand défi
51
réside dans la capacité de cette culture d'échapper à la dissolution dans la culture globale.
D'ailleurs, ce défi est considéré comme un enjeu majeur pour tous les pays, même ceux
d'appartenance occidentale, afin de préserver la diversité culturelle dans notre monde
actuel.
[...jReferring to the diffusion of Anglo-American value and consumer goods as the Americanization ofthe world, the proponents of this homogenization thesis argue that western norms and lifestyles are overwhelming more vulnerable cultures. Although there have been serious attemps by some countries to resist these forces of cultural imperialism-for example, a ban on satellite dishes in Iran, and the French imposition of tariffs and quotas on imported film and television- the spread of American popular culture seems to be unstoppable. (Steger, 2003 : 71)
La valorisation de l'artisanat, notamment des entreprises artisanales exerçant des métiers en
lien avec l'héritage culturel de la société, en Tunisie, s'inscrit dans cette logique de
tentatives de résister à la globalisation de la culture. Ces dernières sont considérées par les
différents acteurs de la société, essentiellement l'État, comme une des échappatoires
permettant de conserver une partie importante de la culture locale et de créer des
alternatives économiques pour le pays dans le contexte de la globalisation.
Ce faisant, les entreprises artisanales tunisiennes, à la différence de leurs analogues d'autres
types, sont sous la pression d'une contrainte double. D'une part, elles sont appelées à
mobiliser les moyens matériels et immatériels qui leur permettent d'être concurrentielles.
En d'autres mots, les moyens leur permettant d'assurer leur survie dans un contexte de
concurrence virulente. D'autre part, elles sont convoquées à contribuer activement dans la
préservation et le rayonnement de la culture locale dans le contexte de globalisation qui
annonce la fin de tout ce qu'est local. En sens, les entreprises de type artisanales doivent
être polyfonctionnelles. Elles doivent assumer des responsabilités économiques, sociales et
culturelles. La réussite dans ces différentes responsabilités nécessite, comme il a été déjà
mentionné dans la problématique de cette recherche, que ces entreprises intègrent dans leur
logique générale de fonctionnement deux principaux processus, soit celui de la
transmission des savoirs professionnels et celui de l'innovation. Ainsi, le cadre conceptuel
de la présente recherche est constitué de trois catégories principales : l'entreprise artisanale
52
de métier ancestral, la transmission des savoirs professionnels et l'innovation. Dans le
prochain chapitre, les éléments constitutifs de ce cadre conceptuel sont présentés.
53
Chapitre 3. Cadre conceptuel de la recherche : entreprise artisanale de métier ancestral, transmission des savoirs professionnels et innovation
1. L'entreprise artisanale de métier ancestral
Cette thèse se propose d'étudier sociologiquement les processus de la transmission des
savoirs professionnels et de l'innovation dans l'entreprise artisanale du métier traditionnel
dans le contexte de la globalisation. Il s'avère donc indispensable d'élaborer notre cadre
conceptuel en commençant par l'identification théorique de ce mode spécifique de
production peu exploré jusqu'à maintenant par les recherches, surtout sociologiques
(Picard, 2006; Boutillier et Fournier, 2006, 2009). L'objectif ici est de délimiter les
contours ainsi que les principales caractéristiques de ce type d'entreprise. Il s'agit plus
précisément d'identifier les caractéristiques identitaires de son monde spécifique de
production ainsi que les spécificités de son processus de production.
1.1 Les caractéristiques identitaires de l'entreprise artisanale de métier
ancestral
L'entreprise artisanale du métier ancestral qui nous intéresse dans le cadre de cette thèse est
considérée comme un mode spécifique de production, dans la mesure où son champ
d'application concerne des métiers traditionnels qui appartiennent à des époques
historiques antérieures, qui se transmettent d'une génération à une autre et qui visent, à
travers la réalisation, à partir des méthodes de travail héritées du passé, des œuvres
traditionnelles (Loup, 2003). L'identification de ces unités de production, qui ont réussi à
survivre jusqu'à nos jours, s'effectue tout d'abord à travers les métiers pratiqués. Ainsi, le
métier traditionnel constitue la principale caractéristique de ce type d'entreprise (Jaeger,
1982; Zarca 1987; Picard 2006; Allard et al. 2008). Chaque métier confère au groupe qui le
pratique et au cadre de sa pratique une identité spécifique qui les distingue des autres
groupes et des autres cadres. Il représente, de ce fait, un capital incorporé selon lequel
l'entreprise et son effectif pourront être classifies et identifiés. Comme le souligne Zarca :
Le métier constitue un groupe de culture : il se transmet de génération en génération, par apprentissage. Il a sa gestuelle et sa langue qui s'inscrivent dans
54
les corps et assignent un cadre, dont les bords ne sont pas aperçus en tant que tels, à la constitution de l'identité de tout nouvel entrant.il articule différents statuts sans qu'il soit possible de réduire leur rapport au seul rapport salarial. L'action corporative, principalement économique, modèle cependant l'image du métier de manière spécifique. (Zarca, 1988 : 247).
La littérature en matière d'entreprises exerçant des métiers traditionnels renvoie au terme
d'artisanat qui représente une réalité sociologique particulière21. L'artisanat exprime les
activités ancestrales consacrées à la production manuelle d'objets sans la mise en œuvre de
moyens industriels (Ba, 2006). L'entreprise artisanale se caractérise, en effet, par la
prédominance du travail manuel et la primauté de l'homme sur la machine. La machine
dans ce monde spécifique de production n'occupe pas une place centrale. Elle n'est que
l'auxiliaire du travail de l'artisan (Bouvier-Ajam, 1937; Zarca, 1979, 1982, 1986, 1988;
Paccito et Richomme-Huet, 2004). De ce fait, le travail manuel constitue un autre élément
essentiel au travers duquel l'entreprise artisanale de métier ancestral peut être identifiée et
différenciée des autres types d'entreprises; que ce soit celles de type artisanal appliquant de
métier moderne ou celles de type industriel. La prédominance du travail manuel dans les
entreprises artisanales de métier ancestral ne peut que traduire la centralité du facteur
humain dans ce type particulier d'unité productive. Ceci permet de dégager un autre critère
d'étiquetage de ce type d'unité de production. Ce critère correspond aux savoirs et aux
savoir-faire des individus qui le composent. Ces derniers sont généralement décrits comme
des personnes dotées de compétences spécifiques qui leur confèrent le statut d'artisan.
D'une façon générale, on peut dire que l'artisan est celui qui sait travailler la matière en respectant les règles de l'art pour arriver à créer ou à produire une œuvre. Par règles d'art, j'entends des règles qui assurent la cohérence d'une œuvre en termes de qualité d'usage, de fonctionnalité technique et d'esthétiques, mais j'inclus également la déontologie...Quand dit qu'un artisan « a du métier » cela signifie qu'il a de l'expérience et du savoir-faire, mais aussi qu'il sait donner du sens à son ouvrage, comprendre comment les autres vont s'en servir. En ce sens, l'artisan doit être capable d'anticiper, de prévoir, de
21 Les travaux sociologiques, en particulier les travaux de Bernard Zarca qui ont porté sur l'artisanat et les travaux de Reynaud Sainsaulieu, de Claude Dubar et de Michel Lallement en France qui ont étudié la question de l'identité des individus au sein des corporations et des métiers, montrent bien que l'artisanat représente une réalité sociologique particulière. Ceci peut être justifié par plusieurs points, tels que l'importance des relations sociales en son sein, la conscience partagée de ses membres de leur appartenance à une classe sociale spécifique, la primauté de l'homme dans le processus de la production, sa perception comme un groupe social à part.. .etc.
55
savoir où telle ou telle pièce trouvera sa place dans son œuvre. (Jouffroy, 2004:1).
Ainsi, les caractéristiques des artisans se présentent comme un critère permettant de
distinguer l'entreprise artisanale de métier. Bref, l'identité de l'entreprise dite artisanale se
détermine en grande partie, également, par les qualités les comportements de son
personnel. Une entreprise est dite artisanale lorsqu'elle incorpore des individus qui
disposent des caractères spécifiques et des compétences professionnelles relatives à un
métier bien déterminé et qui se comportent en référence aux normes de ce métier ( Robert,
1999). D'ailleurs, le métier est toujours présenté en tant que communauté qui détermine à
ces individus un ensemble de règles et de devoirs qu'il faut respecter lors de l'exercice
professionnel (Tônnies, 1977; Alter, 1996).
La force du métier, et en particulier du métier acquis par apprentissage, est de donner à des êtres des repères sociaux... Cette situation donne lieu à des comportements que les gens du métier connaissent et reconnaîtront. (Casella et Tripier, 1985 : 31).
Donc, le métier régit les conduites dans le travail à travers des normes qu'il incorpore. Mais
ces normes sont loin d'être imposées de l'extérieur. Elles sont plutôt la construction propre
des individus qui la constitue (Strauss, 1992 ; Hugues, 1996). Ce faisant, les conduites au
sein d'une organisation donnée constituent un élément essentiel à travers duquel l'image de
cette organisation peut être construite.
Outre les compétences et les caractéristiques de son personnel, l'entreprise artisanale se
distingue par l'omniprésence de son chef. Ce dernier est en général le propriétaire de
l'entreprise. Il cumule une multitude de tâches au sein de l'entreprise. Son rôle dépasse la
simple direction de son unité de production. Il prend en charge toutes les affaires internes et
externes de l'entreprise. Il gère le processus de la production, les hommes qui travaillent
avec lui, les matériaux ainsi que le matériel mis en œuvre dans la production. De plus, il a
la responsabilité de la commercialisation de la production et de la recherche de nouveaux
marchés pour ses produits (Robert, 1999; Aballéa, 2009). L'identité de l'entreprise
artisanale se détermine, en effet, en grande partie par la polyvalence de son chef (Paccito et
Richomme-Huet, 2004; Merlin-Brogniart, 2009).
56
L'entreprise artisanale fonde son développement sur la polyvalence et les savoir-faire. Le chef de l'entreprise joue ici le rôle du leader capable de structurer et d'anticiper l'activité de l'entreprise. (Khalfaoui, 2006 :141).
De ce fait, le chef artisan et l'entreprise artisanale sont deux entités assimilables dans la
mesure où le chef artisan contrôle et gère tout ce qui se passe au sein de l'entreprise (Polge,
2008). On peut ainsi parler de l'encastrement chef-artisan/ entreprise artisanale.
L'omniprésence du chef artisan dans l'entreprise artisanale est renforcée par la petite taille
de ce type d'entreprise (Merlin-Brogniart, 2009; Deakins et Freel 2009). D'ailleurs, la taille
constitue un autre critère significatif de l'entreprise artisanale. Les multiples travaux qui ont
abordé le monde de la production artisanale et qui appartiennent à diverses disciplines22
aboutissent à une conclusion commune : les unités appartenant à ce monde s'inscrivent
dans la catégorie des petites structures productives. Elles sont définies comme de toutes
petites entreprises (TPE).
La plupart des représentations économiques et politiques de l'artisanat utilisent conjointement et indifféremment les termes de TPE et d'entreprise artisanale » (Pacitto et Richomme-Huet, 2004 :8).
D'une part, ce type d'entreprise se caractérise par le nombre réduit de ses membres qui ne
dépasse pas 20 personnes, voire moins de 10.
Ces entreprises sont souvent appelées artisanales et constituent en France l'artisanat, bien que ce terme n'ait pas la même signification, par exemple au Québec où il désigne celles qui produisent des produits normalement faits main » (Julien et Marchensay , 1988 : 85).
D'autre part, les petites entreprises se singularisent par leurs structures très simples
(Pacitto et Richomme-Huet, 2004). Ce type de structure se caractérise par la proximité
sociale entre les différents membres qui la composent.
La proximité est l'élément central qui non seulement permet de décrire une grande diversité des formes d'entreprises artisanales, mais aussi le principe explicatif qui permet de comprendre en grande partie les comportements des artisans (Torres, 2009 : 363).
22 Zarca, 1986, 1987, 1988; Polge, 2008; Paturel; Richomme-Huet, 2007; Polge et Fourcade, 2005; Schieb-bienfait et et Journé-Michel, 2005; Pacitto et Richomme-Huet, 2004; Schieb-bienfait et et Journé-Michel, 2005; Marchesnay, 2003 ; etc
57
Les relations interpersonnelles dans les entreprises artisanales sont loin d'être des relations
bureaucratiques, elles sont plutôt de type empathique (Ferrier, 2002). En d'autres mots, la
petite taille de l'entreprise artisanale favorise les relations de face à face entre tous les
membres qui la structurent. Donc, les interactions constituent une autre caractéristique
principale de l'entreprise artisanale. Ceci amène à s'interroger sur le processus de la
production et son organisation dans l'entreprise artisanale.
1.2 Les spécificités du processus de la production au sein de l'entreprise
artisanale de métier ancestral
À part sa configuration particulière, l'entreprise artisanale de métier ancestral se distingue
des autres types d'entreprises par le processus de production mis en œuvre. D'ailleurs, ce
processus constitue un autre critère fondamental à travers lequel l'entreprise en question
exprime sa singularité et s'inscrit dans le monde de l'artisanat. Ce mode spécifique de
production, considéré le plus souvent comme un héritage de l'époque préindustrielle, se
qualifie par son procès du travail.
L'on définit l'artisanat par son procès de travail, procès mis en œuvre par un seul individu ou un nombre réduit permettant de ne pas séparer la direction et l'exécution des tâches et fondée sur la qualification et la compétence professionnelle des divers participants . (Jaeger, 1982 : 22).
De cette définition, une première caractéristique du processus de la production au sein de
l'entreprise dite artisanale peut être dégagée : absence d'une séparation entre la conception
et la production. Le travail au sein de l'entreprise artisanale n'est en effet pas divisé entre
ceux qui préparent et planifient les tâches de production et ceux qui exécutent ces tâches
comme c'est le cas des entreprises appliquant un modèle industriel de production. Par
conséquent, la séparation entre le travail qualifié et le travail non qualifié s'annule dans le
contexte artisanal de production.
Afin de différencier l'entreprise artisanale des autres types d'entreprises, Bernard Zarca,
l'un des rares sociologues qui ont été le monde de l'artisanat par l'étude, caractérise ce
genre d'entreprise la présence d'une forme de division du travail qu'il appelle « division
artisanale du travail» (1979). Cette dernière se présente comme le seuil principal qui
58
sépare le modèle artisanal de production de celui industriel23, lequel se démarque par une
division minutieuse du processus de la production. Si dans le modèle industriel le
travailleur effectue une tâche unique dans le processus de la production, dans le modèle
artisanal ce dernier maîtrise le processus tout entier. Ici, le travailleur (l'artisan) prend en
charge la totalité des opérations menant au produit final (Pacitto et Richomme-Huet, 2004).
Une telle spécificité réduit la dépendance des individus au sein du processus de la
production de type artisanal. D'ailleurs, l'autonomie dans le travail est l'un des traits de
l'artisan. « L'indépendance des producteurs nous semble constituer une caractéristique au
moins aussi fondamentale de la réalité artisanale ». (Jaeger, 1982 :22). Mais cela ne veut
pas dire que le processus de production mis en œuvre dans les entreprises artisanales
n'obéit à aucune hiérarchie. Il est plutôt organisé en trois degrés : le maître, le compagnon
et l'apprenti (Marchesnay, 2003 : Gagnon, 2005). Cette hiérarchie demeure l'une des
spécificités des sociétés préindustrielles. De fait, les unités productives contemporaines
appliquant la forme ancestrale de production ont conservé l'organisation hiérarchique
héritée de l'époque féodale.
Comme dans toute autre hiérarchie, la question de la subordination est inévitable. Dans
notre cas, il y a la subordination du compagnon comme de l'apprenti au maître, mais cela
ne traduit en aucun cas ni la séparation entre les trois catégories dans le processus de la
production ni le désengagement du maître des opérations de la production. Au contraire, la
participation du chef d'entreprise (le maître) à la production se présente comme une autre
caractéristique majeure des entreprises artisanales du métier. D'ailleurs, la qualification
d'une entreprise d'artisanale est tributaire de la participation directe ou non de son chef à la
production. « Le qualificatif artisanal ne s'applique pas dès lors que le chef d'entreprise ne
participe plus à l'exécution de la production » (Paturel et Richomme-Huet, 2007 :42). De
23 Le modèle industriel de production se caractérise par une Organisation Scientifique du Travail (OST). Cette méthode de production, dont les principes ont été conçue par F.W. Taylor (1856-1915) et fut poussée à l'extrême par H. Ford (1863- 1947), a été mise en application dans les entreprises à partir du début du 20eme . La caractéristique majeure de cette méthode réside dans sa séparation entre ceux qui programment le travail et ceux qui produisent au sein de l'entreprise. Elle se fonde, donc, sur la séparation entre le travail intellectuel et le travail d'exécution. Le travail intellectuel, selon cette, méthode consiste à planifier et à préparer le travail et à le planifier. Ce type de travail est la responsabilité des agents de méthode qui se trouvent dans les bureaux. Tandis que le travail exécutif est la responsabilité des ouvriers que se trouvent dans les ateliers de production. Ces derniers ne sont appelé qu'exécuté des tâches préconçues par les agents de méthode. Donc, l'ouvrier au sein de l'entreprise de type industrielle n'est pas la pour penser mais pour exécuter seulement.
59
ce fait, l'entreprise artisanale puise son identité spécifique, encore, de l'engagement de son
chef dans le processus de la production.
Le chef d'entreprise artisanale considère toujours qu'il est le dernier garant de la qualité de la production ; il se sent personnellement engagé dans le maintien ou le respect du niveau de qualité souhaité. Il participe de ce fait à la définition du processus de production lui-même, voire à certaines étapes de la production. (Livio, 2004 : 2).
Ainsi, le fonctionnement du processus de la production au sein de l'entreprise artisanale est
centralisé au tour du maître artisan. Si cette position centrale du chef dans le processus de la
production témoigne de l'existence d'une hiérarchie, elle ne traduit pas l'existence d'une
structure complexe au sein de l'entreprise en question. En se référant aux configurations
théoriques des structures organisationnelles établies par Henry Mintzberg (1982) , les
recherches empiriques citées précédemment considèrent que la structure simple est celle
qui convient le mieux à l'entreprise artisanale. Le schéma théorique élaboré à ce type de
structure par Mintzberg, montre l'absence de certains éléments qui peuvent être rencontrés
dans les autres types de structures qui correspondent aux organisations de grande taille. Au-
delà des composantes des différentes structures, Mintzberg (1982) montre que les
organisations passent par des étapes de transitions structurelles. La première étape il
l'appelle «Structure artisanale». Selon lui, cette structure est constituée d'un seul groupe
organisé de façon informelle. La coordination au sein de ce groupe s'effectue par le biais de
la standardisation des qualifications. Dans le même ordre d'idées, l'auteur qualifie la
structure organisationnelle de type artisanal comme une structure de petite taille, peu
élaborée, et dans laquelle la division du travail est imprécise. De ce fait, le processus de la
production au sein de l'entreprise artisanale se caractérise par la simplicité, le nombre
réduit des participants et la quasi-absence de la subordination dans la mesure où tout un
chacun a une connaissance complète du processus de la production tout entier.
Pour résumer ce qui précède, la définition retenue pour l'entreprise artisanale, qui nous
intéresse dans la présente thèse, pourrait être la suivante : l'entreprise artisanale est une
24 Dans son célèbre ouvrage "Structure et dynamique des organisations" publié en 1982, H. Mintzberg définit la structure d'une organisation comme «la somme totale des moyens employés pour diviser le travail entre tâches distinctes pour ensuite assurer la coordination nécessaire entre ces tâches» (p 18). L'auteur distingue cinq types de structures organisationnelles : la structure simple, la bureaucratie mécaniste, la professionnelle, la structure divisionnalisée et l'adhocratie.
60
entreprise de très petite taille dirigée par un chef artisan polyvalent. De plus, elle est
organisée en structure simple. Outre cela, elle pratique un métier traditionnel qui octroie à
ses membres des savoirs-faire liés à des compétences spécifiques et leur prescrit une
division particulière du travail et des normes à respecter lors de l'exécution de leurs tâches
professionnelles.
Au-delà de sa définition spécifique et en se référant à la sociologie de l'entreprise,
l'entreprise artisanale peut être définie d'une manière générale en tant qu'un ensemble de
variables structurelles, sociales et culturelles qui la constituent en mode d'action collective
visant plusieurs finalités et qui sont en interaction avec les environnements externes de
l'entreprise (Piotet et Sainsaulieu 1994 ; Sainsaulieu, 1997 ; Osty, Sainsaulieu et Uhalde,
2007). À partir de cette définition on peut déduire que l'entreprise artisanale, comme tout
autre genre d'entreprise, constitue à la fois un système constitué de plusieurs éléments, une
institution dotée des normes et des valeurs culturelles et une organisation ouverte sur ses
environnements. D'ailleurs, le concept d'entreprise, lorsqu'il est utilisé dans la littérature
sociologique, renvoie à la fois aux notions du système, d'institution et d'organisation. En
d'autres termes, l'entreprise se définit en même temps en tant qu'un système, une
institution et une organisation. De ce fait, il est important de prendre en considération ces
différentes configurations lors de l'étude des deux processus, la transmission des savoirs
professionnels et de l'innovation, qui font l'objet de notre analyse dans la présente thèse.
61
2. La transmission des savoirs professionnels
Tel qu'il a été déjà précisé dans la problématique de cette recherche, la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels de tous types constitue la voix principale à
travers laquelle les entreprises artisanales peuvent conserver leurs linéaments spécifiques.
Cette transmission est indispensable afin que ce type d'entreprises puisse assumer sa
responsabilité culturelle, consistant à protéger une partie importante de la culture locale de
la dissolution dans la culture globale. Avant de l'étudier empiriquement, il s'avère
fondamental de procéder à un travail de conceptualisation de cette catégorie analytique
principale dans notre recherche. À travers une telle entreprise, nous essayons de clarifier et
de comprendre théoriquement ses composantes afin de les rendre opérationnelles au
moment de l'étude empirique. Notre tâche, ici, dépasse la simple définition de la catégorie
en question ainsi que de ses composantes. Il s'agit plutôt de survoler la littérature traitant de
la question tout en mettant en évidence les éléments congruents à notre recherche. Pour ce
faire, nous procédons en deux temps. Dans un premier temps, nous identifions la notion des
savoirs professionnels afin de cerner l'objet de la transmission. Dans un deuxième temps,
nous abordons la question de la transmission des savoirs professionnels, notamment la
transmission dans les milieux de travail qui ont beaucoup travaillé les sociologues des
professions.
2.1 Les savoirs professionnels : de la qualification à la compétence
En tant qu'activité sociale et économique, le travail productif, artisanal ou industriel, exige
une variété de savoir théorique, pratique et social. Ces trois types de savoir forment
ensemble le savoir professionnel. Ce dernier demeure essentiel et inévitable pour que
l'individu accomplisse ses tâches professionnelles afin qu'il soit reconnu et valorisé dans la
communauté du travail à laquelle il appartient. Il est aussi indispensable à la classification
des individus dans des catégories socioprofessionnelles (Santelmann, 2002). Une lecture
chronologique des publications des spécialistes en sciences sociales qui traitent de la
question du travail, particulièrement des sociologues intéressés au monde du travail, montre
une transformation au niveau du vocabulaire intelligible utilisé pour exprimer le savoir
professionnel. Dans un premier temps, ces spécialistes ont adopté le concept de
qualification professionnelle pour désigner lesdits savoirs professionnels. Dans un
62
deuxième temps, ce concept a été remplacé par celui de compétence professionnelle pour
définir la même chose (Jonnaert, 2002). Alors de quoi on parle exactement lorsqu'on dit
savoirs professionnels ?
Afin de répondre à cette question, nous nous pencherons dans la présente section sur les
concepts de « qualification professionnelle » et de « compétence professionnelle ». Nous
préciserons, leurs contextes d'émergence, leurs significations et les différences qui existent
entre eux.
2.1.1 La qualification professionnelle
La notion de qualification professionnelle a occupé une position centrale dans les
recherches portant sur le monde du travail à partir de la deuxième moitié du vingtième
siècle. Elle s'est présentée comme un concept empirique (Campinos et Marry, 1986;
Thomas, 1991) de base pour analyser et étudier les différentes dynamiques des systèmes
productifs industriels et artisanaux. En effet, les réflexions autour de cette notion se sont
développées essentiellement dans un système productif taylorien et dans une organisation
de travail basée sur une rationalisation par une division des tâches et sur l'emploi d'une
importante proportion d'ouvriers non qualifiés (Parlier, 2003). Mais ceci ne veut pas dire
que la question de la qualification professionnelle est propre à un tel système productif et à
une telle organisation du travail.
La question de qualification se pose dès qu'on examine pourquoi une telle personne exécute mieux qu'une autre une activité spécifique, pourquoi une hiérarchie de tâches existe-t-elle au sein des groupes humains et en fonction de quoi celle-ci est établie. (Naville, 1956 : 9).
A partir de cette citation de Pierre Naville, l'un des premiers des sociologues du travail qui
a manifesté un intérêt considérable à la question de la qualification professionnelle, on peut
comprendre que cette dernière est immanente à toute activité humaine collective de
production. Alors qu'est-ce que la qualification ?
Dans son sens étymologique le plus large, le terme de qualification renvoie à la notion de
qualité dérivant de la racine, qualis, quel, qui signifie ce qui est déterminé et précis (Dubois
et al., 2005). La qualité est définie comme l'ensemble des propriétés et des caractéristiques
63
d'une personne ou d'un objet (Fortun et Founder, 2005). Le dictionnaire canadien des
relations du travail définit la qualification professionnelle comme l'ensemble des
connaissances et des capacités acquises par un travailleur au cours de sa formation
professionnelle et de l'exercice de sa profession (Dion, 1986). La qualification est ainsi
présentée comme un attribut de l'individu. Cette idée a constitué pour longtemps un objet
de débat et de controverses entre des spécialistes appartenant à la même ou à différentes
disciplines. Les polémiques se sont manifestées clairement au sein de la sociologie du
travail.
D'ailleurs, le débat autour de la notion de qualification a constitué l'un des débats
constitutifs de la discipline. Il s'est organisé autour de la célèbre opposition entre la
conception substantialiste25 de George Friedman et la conception relativiste26 de Pierre
Naville. Le premier auteur perçoit la qualification comme attribut du poste du travail alors
que le deuxième la considère comme attribut du travailleur (Buscatto, 2006). En d'autres
mots, la notion de qualification est utilisée d'une part pour décrire les capacités et les
connaissances acquises et détenues par un travailleur, c'est-à-dire ses savoirs
professionnels. On parle ici de la qualification de l'individu. D'autre part, la notion est
d'usage lors de la description des capacités et des connaissances requises par un emploi.
Dans ce cas, l'accent est mis sur la qualification d'un poste du travail.
La définition qu'on peut retenir pour désigner la qualification professionnelle d'un individu
se résume comme suit : elle est l'ensemble des savoirs et des habilités professionnelles
acquises par un travailleur pour pratiquer une activité professionnelle prédéterminée. Elle
est donc principalement acquise par la formation initiale. Cette définition montre les limites
de la notion de qualification. Ces limites apparaissent nettement lorsqu'on essaye de
l'appliquer dans des systèmes de travail qui se caractérisent, essentiellement, par la
participation active du travailleur et le changement permanent des situations du travail.
25 La conception de Friedman est dite substantialiste dans la mesure où il lui semble possible de décrire le contenu de la qualification en utilisant des dispositifs formels ou en observant minutieusement l'activité du travail. Pour cet auteur la qualification n'appartient pas à l'homme, elle appartient au poste du travail, central dans la définition de la qualification. 26 La conception de Naville est dite relativiste dans la mesure ou il définit la qualification en tant qu'opération sociale de classement entre individus. Selon cet auteur la qualification dépend de l'homme et non du poste du travail. Donc elle n'est pas une simple estimation technique comme le prétend Friedman.
64
2.1.2 La compétence professionnelle
Vers la fin du vingtième siècle, des changements importants surviennent dans le monde du
travail27. Ces changements, essentiellement de nature qualitative, se sont concrétisés par un
ensemble de transformations affectant à la fois les facteurs de productions ainsi que les
manières par lesquelles sont combinés les uns aux autres. Étant donné leur place centrale
dans tout processus de production, les savoirs professionnels se trouvent à leur tour
affectés. Cet ensemble de changements a incité les chercheurs à réviser certains de leurs
concepts et à en adopter de nouveaux termes appropriés aux nouvelles dynamiques du
travail (Stroobants, 1993). C'est dans le cadre de ces grandes mutations que le concept de
compétence est apparu pour remplacer celui de qualification. Le point partagé entre les
deux concepts, qualification et compétence, c'est que tous les deux sont mobilisés, entre
autres, lors du traitement de la question du savoir professionnel individuel et collectif, que
ce soit dans l'entreprise ou sur le marché d'emploi.
En ce qui à trait à la compétence, elle est définie comme l'ensemble des qualités d'un
travailleur afin de satisfaire aux exigences d'une fonction donnée (Dion, 1986). En d'autres
termes, elle représente les différents savoirs mobilisés et combinés par les individus dans
un contexte productif (Martinet et Silem, 2008). Cela dit que la compétence regroupe
différents types de savoirs. Exactement, le tissu de la compétence se compose de trois types
de savoirs : les savoirs théoriques et procéduraux, le savoir-faire et le savoir-être (Paretti,
2005). Les savoirs, théoriques et procéduraux, sont un ensemble structuré de connaissances,
principalement acquises en formation initiale ou continue (Le Boterf, 2007). Pour sa part, le
savoir-faire exprime les connaissances pratiques et opérationnelles mobilisées lors d'une
activité donnée, une tâche professionnelle par exemple (Fook, Ryan et Hwakins, 2000).
Quant au savoir être, il réfère à une dimension comportementale mobilisée par l'individu
pour mener à bien la mission qui lui a été confiée (Bellier, 2004). En ce sens, la compétence
inclut la capacité à répondre à des exigences complexes et à pouvoir mobiliser et exploiter
2 Les changements sont motivés par une stratégie de modernisation de l'entreprise et de développement de sa compétitivité dans un contexte économique de plus en plus concurrentiel. La modernisation a concerné l'organisation du travail par la mise en œuvre de nouveaux modèles d'organisation qui tendent principalement vers la flexibilité et vers une technisation plus grande du personnel. De plus, de nouvelles pratiques de gestion de ressources humaines ont été introduites. Ces nouvelles pratiques sont centrées atour de la gestion des compétences au sein de l'entreprise.
65
des ressources psychosociales dans un contexte particulier. Elle représente, en effet, un
ensemble intégré d'attitudes et de connaissances qui permet d'accomplir efficacement les
activités d'une profession ou d'une fonction). La compétence professionnelle est donc
l'attribut de l'individu et non pas du poste du travail.
La compétence est la prise d'initiative et de responsabilité de l'individu sur des situations professionnelles auxquelles il est confronté [...]. La compétence est une intelligence pratique des situations qui s'appuie sur les connaissances acquises et les transforme, avec autant de plus de force que de la diversité des situations augmente [...]. La compétence est la faculté de mobiliser les réseaux d'acteurs autour des mêmes situations, à partager des enjeux, à assumer des domaines de coresponsabilité. (Zarifian, 1999 : 70-80).
Pour qu'il y ait compétence, il faut qu'il y ait mis en jeu un répertoire de ressources (connaissances, capacités cognitives, capacités relationnelles...) [...] le professionnel doit savoir sélectionner les éléments nécessaires dans le répertoire, les organiser et les employer pour réaliser une activité professionnelle. (Le Boterf, 2000 : 58-64).
De ces deux définitions proposées par Zarifian et Le Boterf, on peut dégager que la
compétence professionnelle d'un individu est, en effet, loin d'être la simple addition de
savoirs théoriques et procéduraux, savoir-faire et de savoir-être, elle est plutôt une
combinatoire particulière construite de multiples ingrédients. Pour témoigner de sa
compétence face un événement, l'individu doit savoir non seulement sélectionner les
éléments pertinents d'un répertoire de ressources, mais aussi les organiser. La compétence
est donc l'ensemble des ressources mobilisables et mobilisées en situation particulière du
travail. Elle exprime ainsi, l'intégration des savoirs dans l'action. La compétence
professionnelle regroupe, en effet, des éléments hétérogènes, intrinsèques et d'autres
extrinsèques à l'individu. Elle se constate donc lors de sa mise en œuvre en situation
professionnelle à partir de laquelle elle est valable. De ce fait, la compétence est repérée,
évaluée, validée et évoluée au cœur même de l'activité professionnelle. Elle est, en effet, la
combinaison des ressources individuelles et des moyens fournis par l'organisation. C'est
une combinaison concrète mise en œuvre afin de réaliser une activité spécifique ou pour
résoudre un problème particulier (Fook, Ryan et Hwakins, 2000). La compétence
professionnelle est donc centrée sur l'individu et non pas sur le poste ou l'organisation du
travail. Elle est toujours liée à l'activité réelle (l'action). Elle est contextualisée. Elle est
66
toujours une combinatoire et non pas une addition des ressources. Elle représente un
mélange d'éléments liés tout autant à l'individu qu'au contexte.
En somme, les notions de qualification professionnelle et de compétence, malgré les
points de divergence, sont loin d'être totalement opposées. Il serait juste de dire que la
compétence est un supplément (Lichtenberger, 2003). Les principaux éléments distinctifs
entre la qualification et la compétence peuvent être résumés comme suit : la qualification
est irréversible, acquise par la formation initiale et se caractérise par une certaine stabilité
dans le temps, tandis que la compétence est précaire, s'exerce dans un contexte spécifique,
nécessite la formation continue et ne peut pas être dissocié de l'activité professionnelle
(Deprez, 2002). Ce faisant, le milieu de travail est un lieu principal de développement de la
compétence professionnelle (Zarifian, 2009). Cette dernière se présente, comme il a été
indiqué plus haut, sous la forme d'un construit intégrant un ensemble de savoirs acquis et
appris, donc ils sont transmissibles. Étant donné notre objectif, étudier la transmission des
savoirs professionnels dans les milieux du travail, notamment au sein des entreprises
artisanales, la notion de la compétence sera privilégiés dans cette thèse. Mais que nous dit
la littérature sur cette question de transmission ?
2.2 La transmission des savoirs professionnels dans les milieux de travail
Au-delà des polémiques théoriques et conceptuelles qui continuent d'agiter les spécialistes
en sciences sociales interpellés par des questions relatives au monde du travail, le savoir
professionnel d'un individu fait référence aux connaissances, aux habiletés, aux attitudes et
aux aptitudes acquises par cet individu et mobilisées autant que de besoin. En effet,
évoquer le savoir professionnel, notamment la qualification et la compétence
professionnelle, revient à traiter des processus qui font qu'un individu s'en empare. La
transmission est au cœur de ces processus. Étant donné notre problématique de recherche,
nous focalisions l'attention à cette étape sur la question de la transmission des savoirs
professionnels afin de comprendre ses logiques, notamment dans les milieux de travail.
67
2.2.1 La transmission des savoirs professionnels dans les entreprises : un
processus interactif
D'une manière générale, la transmission est définie en tant que processus de
communication (Lohisse, 2007) impliquant au moins deux personnes, celui qui diffuse
l'information et celui qui la reçoit. Ce faisant, la transmission implique des conditions
d'interaction entre celui qui transmet et celui à qui l'on transmet (Chevallier et Chiva,
1991). Si on applique cette formule dans le champ professionnel, la transmission devient la
relation qui relie un « apprenti » à « un maître ». Cette relation est souvent présentée par
les ethnologues et les sociologues du travail comme une relation de compagnonnage
(Boutte, 2007). En citant Lucas, Stroobants confirme cette idée : « L'essentiel du savoir
professionnel, la véritable maîtrise du travail concret se transmettent sur le mode
compagnonnique, par contact et par échange» (Stroobants, 1993 :83). La transmission des
savoirs professionnels doit être comprise alors comme le produit d'une expérience
communicative construite d'une manière interactive.
Replacée dans une problématique des compétences professionnelles, la transmission des savoirs se pose autrement. En effet, ce que l'acteur sait faire n'est pas analysé en tant que savoir, mais en tant que savoir au service de la pratique. Le savoir est alors soumis à l'appréciation d'un professionnel ou d'un groupe de professionnels qui jugent à partir de différents critères, l'usage qui est fait de ces savoirs dans une situation problématique professionnelle. Ainsi, le contenu des savoirs prend-il sens dans un contexte social donné qui lie celui qui sait et ce qui veut apprendre. C'est au cœur de cette interaction sociale que peut émergé la problématique de transmission du savoir. Transmettre ne peut se comprendre hors de l'appréciation de cette interaction entre seniors professionnelles et jeunes, entre grand et petits, entre ceux qui savent et ceux qui souhaitent apprendre. (Jacques-Jovenot, 2007 :158-159).
En présentant la synthèse d'une étude exploratoire effectuée dans une entreprise d'usinage
à la région du Québec, les co-auteurs de l'article «transmission et vieillissement au travail»
ont identifié cinq types d'interactions formatrices de transmission de savoirs professionnels
dans le travail (Lefebvre, 2003 : 71) :
1) Les interactions entre collègues de même cohorte professionnelle et de même âge;
2) Des interactions qui réunissent des travailleurs d'expériences similaires afin d'échanger
des expériences relatives à la production;
68
3) Des interactions avec un collègue proche de la zone de travail, en général d'âge et de
cohortes différentes;
4) Des interactions avec un collègue plus âgé qui est expérimenté dans un domaine
différent;
5) Des interactions avec un collègue plus expérimenté capable d'apporter des réponses
pour dénouer un problème.
La transmission des savoirs ne s'effectue donc pas uniquement en fonction de l'ancienneté
dans le travail; mais la variété des expériences professionnelles contribue aussi à
l'émergence des situations de transmission. Dans tous les cas, la réussite de l'acte de
transmission nécessite une certaine soumission de celui qui reçoit l'information à celui qui
la transmet (Habermas cité par Delbos, 1990). Aussi, elle nécessite que chacun des
protagonistes de l'interaction, occasionnée par la transmission, joue un rôle social à partir
de la position qu'il occupe dans cette interaction (Jacques-Jovenot, 2007). Ceci varie
sensiblement d'une culture de travail à une autre, comme d'un métier à un autre dans la
mesure où chaque métier y développe ses propres rituels et souvent ses formes spécifiques
de transmission de savoirs (Chevallier et Chiva, 1991). Mais la réussite de la transmission
dépend-elle seulement des deux parties de l'interaction de la transmission : le maître et
l'apprenti ?
2.2.2 La transmission des savoirs professionnels dans les entreprises : un
processus dynamique et complexe
La réponse à la question qui précède ne peut être que négative, car le processus de
transmission des compétences est loin d'être résumé comme un simple schéma mécanique;
elle est plutôt un processus dynamique assez complexe contribuant la recréation des savoirs
professionnels et celle du groupe social concerné (Chevallier et Chiva, 1991). En effet, le
processus de transmission des savoirs est par excellence un processus sociotechnique
multidimensionnel (Jacques-Jovenot, 2007). Il nécessite l'engagement efficace des acteurs
participants et l'aménagement d'un climat favorable à la transmission et à l'apprentissage.
« Transmettre un savoir c'est placer quelqu'un dans les meilleures conditions pour qu'il
puisse acquérir lui-même ce savoir, à l'aide de ses propres ressources sensorielles et
69
mentales» (Sigaut, 1991 :42). Donc, le processus de transmission dépend des personnes
ainsi que des conditions du travail. En conformité avec cette réalité, Sandra Bellier
(2002 :27) souligne dans son article «Acquisition et transmission des compétences» que la
transmission des savoirs professionnels dans les contextes productifs dépend autant des
individus que du milieu où elle se déroule. Elle précise que l'opération de la transmission
des savoirs professionnels au sein de l'entreprise est fortement influencée par les
représentations, les attitudes, et les comportements des différents membres de l'entreprise
d'une part, et des différentes composantes non humaines de cette d'entreprise d'autre part.
En ce sens, la transmission des compétences dans le travail dépend de l'environnement du
travail tout entier ainsi que de différents types d'acteurs. «. . . le processus d'apprentissage
et de transmission du savoir s'influence par le contexte dans lequel il se déroule » (Bril,
1991 :15). L'organisation, la gestion des ressources humaines, les systèmes sociaux et la
culture d'entreprises associés à d'autres facteurs seront décisifs dans la réussite ou l'échec
de la reproduction et le développement des compétences dans l'entreprise. Cette
reproduction nécessite de trouver les moyens organisationnels et managériaux pour inciter
les détenteurs de savoir à les perpétuer. Elle exige aussi la recherche des modalités sociales
et culturelles, les plus efficaces, de transmission. Par ailleurs, la transmission des savoirs
professionnels est une opération communicative qui fait intervenir des acteurs appartenant à
différentes catégories hiérarchiques. Cette opération s'effectue d'une manière horizontale et
verticale dans la mesure où le travail est une activité humaine par excellence (Boutte,
2007). La transmission concerne alors tous les acteurs de l'entreprise. Elle dépend, en effet,
du système de relations existant.
La forme artisanale d'organisation du travail est sans doute la forme la plus exemplaire qui
nous permet de repérer de plus près le processus de transmission du savoir dans le travail
dans la mesure où elle est caractérisée par la proximité de ses individus. C'est une
organisation au sein de laquelle se confond le travail et la transmission des connaissances,
de savoir-faire et de savoir être (Boutillier et Fournier, 2006). Les études ethnographiques
et sociologiques dans le domaine ont montré que chaque métier dispose de ses propres
modalités et formes de transmission des savoirs professionnels. Donc, il reste difficile
d'imaginer des processus de transmission identiques (Sigaut, 1991). De plus, ces études ont
70
permis de saisir que la transmission dans le travail ne concerne pas exclusivement les
connaissances nécessaires à l'exécution d'une tâche, mais elle s'accompagne de la
transmission des pratiques culturelles et sociales liées à l'exécution de cette tâche ainsi que
de règles ancrées dans le sens du juste des membres de la communauté du travail (Boltanski
et Thévenot, 1991) .« L'apprentissage d'un métier comporte aussi la transmission d'objets
et symboles qui incorporent la compétence technique elle-même» (Chevallier et Chiva,
1991 :8). En ce sens, les compétences au travail sont le fruit d'un processus d'apprentissage
multidimensionnel, technique, social et culturel qui se fonde en grande partie sur la
transmission d'une culture de travail tout entière.
Le métier, capital de savoirs et de savoir-faire objectif dans des œuvres et des outils, existe aussi à l'état incorporé. Il est transmis par apprentissage, c'est à dire dans une relation d'homme à homme, plus exactement de maître adulte à apprenti enfant ou adolescent. Cette transmission, étale dans le temps, progressive, marquée par des étapes que les compagnonnages ont ritualisées, n'est pas uniquement un transfert d'informations, de procédures d'utilisation d'instruments, de recettes, de techniques, de modes opératoires. Elle est tout à la fois une mise en forme du corps et de l'esprit qui s'opère par identification. (Zarca, 1988 :250)
Les sociologues et les ethnologues, qui ont abordé la question de l'apprentissage dans les
entreprises artisanales et industrielles, mettent en évidence trois figures d'apprentissages,
soit le nourrissage, le coup de pied dans le cul et l'usinage (Chevallier et Chiva, 1991). Le
nourrissage correspond à une imprégnation lente et progressive du métier. Le coup de pied
dans le cul correspond à une version brutale du nourrissage en inculquant à l'apprenti un
rythme, des hiérarchies plutôt que des gestes techniques. L'usinage correspond à un
ensemble de pratiques extrêmement codifiées. Si les deux premières formes représentent un
apprentissage de type informel, la troisième est typiquement formelle. Dans tous les cas, le
processus d'apprentissage dans le travail a comme objectif principal la construction des
compétences professionnelles. La réussite du processus de construction des compétences
professionnelles nécessite de réunir les conditions favorables à la transmission d'une part et
de lever les obstacles qui pourraient s'y opposer (Le Boterf, 2001). Bref, la reproduction
des compétences professionnelles, individuelles et collectives dépend du bon
fonctionnement de l'unité de travail tout entière : l'entreprise.
71
Finalement, la transmission des savoirs professionnels est l'axe central de l'opération de
construction des compétences au sein de l'entreprise. Elle prend la forme d'un processus
complexe et dynamique qui dépend de plusieurs facteurs hétérogènes. Elle peut être
qualifiée comme suit :
1) La transmission dans le travail ne concerne pas uniquement les savoirs, mais elle
s'étend à la transmission des normes, des valeurs, des statuts, des comportements, des
attitudes, des cultures, des identités, etc.
2) Le processus de transmission des compétences professionnelles ne peut pas être
dissocié en aucun cas du processus d'acquisition et d'apprentissage.
3) Le processus de transmission est affecté par une multiplicité de facteurs hétérogènes :
âge des individus, les cadres sociaux de la transmission, les systèmes de valeurs, les
mécanismes de motivation et de valorisation.
4) L'étude du processus de transmission des savoirs professionnels nécessite de toucher
non seulement les personnes, mais aussi le milieu de l'apprentissage ainsi que son
organisation technique, sociale et culturelle.
72
3. L'innovation
Conjointement aux dynamiques de la transmission des savoirs professionnels, les
entreprises artisanales tunisiennes sont appelées, afin de pouvoir surmonter les contraintes
qui leurs sont imposées dans le contexte de la globalisation, de promouvoir un autre type
de dynamique: les dynamiques de l'innovation. On entend ici par «la promotion des
dynamiques de l'innovation» l'instauration d'une culture qui stimule les membres de
l'entreprise à la créativité d'une part, et qui favorise l'introduction des nouveautés sur les
structures et les dynamiques de l'entreprise d'autre part. Les entreprises
artisanales tunisiennes doivent donc s'inscrire dans une logique d'innovation. Cette
inscription demeure l'une des garantes principales pour que ces entreprises puissent assurer
un avantage concurrentiel qui leur permettent de se maintenir et de se développer.
L'innovation est jugée comme l'un des facteurs stratégiques pour la croissance des
entreprises de tous genres dans le contexte de la globalisation. (Mustar et Penan, 2003;
Bellon, 1994, Bakan et Yildiz, 2008). Dans cette ère-ci, la croissance de l'entreprise, autant
dans l'emploi que dans le chiffre d'affaires, dépend étroitement de l'incorporation des
logiques de l'innovation (Freel, 2000; Freel et Robson, 2004). Ainsi, l'innovation constitue
le chemin à travers lequel l'entreprise artisanale peut assumer sa responsabilité d'ordre
économique ainsi que celle d'ordre sociale. D'où découle la centralité de la notion
d'innovation dans notre thèse. À cette étape, nous nous contentons, en nous référant à une
littérature pluridisciplinaire, de la compréhension du sens du terme et des logiques et
dynamiques qui régissent l'action de l'innovation au sein de l'entreprise, tout en prenant en
considération les éléments qui se rapportent à notre objet de recherche.
3.1 La notion d'innovation : sens et application dans le monde des entreprises
L'innovation est aujourd'hui l'un des mots d'ordre le plus couramment entendus dans les
différents domaines de la vie quotidienne dans la mesure où aucun de ces domaines
n'échappe à ce phénomène. Pour les spécialistes des sciences humaines et sociales, cette
notion est indispensable pour comprendre et analyser les dynamiques de changement au
sein des sociétés et des communautés humaines contemporaines ou antérieures (Corneloup,
2009). De quoi s'agit-il donc lorsqu'on parle de l'innovation ? Et, de quoi s'agit-il
lorsqu'on parle de l'innovation dans le monde des entreprises ?
73
3.1.1 L'innovation : sens et signification
En évoquant la notion d'innovation, on se situe dans un champ lexical assez large composé
de plusieurs termes très proches au niveau du sens. Parmi ces termes, on cite : création,
invention, innovation, découverte, progrès, etc. Le plus souvent, il existe une confusion
entre ces différentes notions. Cette confusion est plus nette essentiellement entre la notion
d'innovation et celle d'invention. Si les deux renvoient à l'idée de nouveauté, la distinction
entre elles s'effectue au niveau de la concrétisation de cette nouveauté. L'invention consiste
à engendrer une idée ou une connaissance nouvelle. Autrement dit, inventer c'est apporter
une nouvelle conception d'un objet, d'un produit, d'un procédé, etc. En ce qui a trait à
l'innovation, elle consiste à rendre cette nouvelle conception concrète. Elle est, donc, une
nouveauté qui a effectivement son existence réelle. Au sens étymologique, le terme
inventer (in ver), d'où invention, signifie une action de trouver (Bloch, 2008).
Étymologiquement innover (inno/vare), d'où innovation, signifie une action, le résultat de
cette action est une chose nouvelle (le Petit Robert). L'invention et l'innovation sont, en
effet, deux actions qui se complètent : l'invention est une action de découverte et
l'innovation est une action de concrétisation de cette découverte.
L'innovation est un moteur à deux temps. Il y a l'invention en soi et sa matérialisation ensuite. Il y a l'idée puis sa mise en forme, sa mise en place, sa mise en scène. (Willemarck, 2006 :34).
Mais ceci ne veut pas dire que toute invention peut se transformer en innovation et que
toute innovation est étemelle (Bellon, 2002 ; Alter, 2005). Un nombre très limité des
inventions peut se transformer en innovation et chaque innovation a une durée de vie bien
déterminée. L'innovation dans n'importe quel domaine devient, après une certaine période
de sa concrétisation, obsolète et cède la place à une autre jugée plus efficace. Bref,
l'innovation demeure une constante dans la vie humaine. Elle représente un processus
continu à travers lequel les humains cherchent à améliorer leurs conditions d'existences.
L'innovation exprime donc la volonté d'apporter des changements sur un ou plusieurs
aspects de la vie humaine à travers l'introduction de nouveaux éléments sur une structure
donnée. D'une manière générale, on distingue deux types d'innovation : l'innovation
majeure et l'innovation mineure. L'innovation dite majeure traduit l'introduction d'un
changement radical sur une structure donnée. Ce type d'innovation crée une discontinuité
74
avec le modèle du fonctionnement de cette structure déjà mis en place (Leifer, 2000 ;
Caccomo, 2005). Elle entraîne des changements progressifs et nombreux qui modifient au
complet sa configuration. Elle peut être considérée, donc, comme une innovation de
rupture. L'innovation dite mineure ou dite aussi incrémentale traduit l'introduction des
améliorations régulières (Reynier, 2008) sur une ou plusieurs dimensions d'une structure
afin de l'adapter à son environnement. Ce type d'innovation ne contribue donc pas à un
changement total de la structure. Dans le cas de l'entreprise artisanale, ce type d'innovation
est privilégié.
L'artisan qui souhaite développer son entreprise, sans s'engager dans la croissance. Nous le qualifierons de développement incrémental. Celui-ci consiste à s'orienter vers des améliorations continues de produits, de processus de fabrication, de système de fonctionnement et/ou de prise de décision. (Polge, 2008: 131).
Au-delà de cette distinction, la littérature abondante en matière d'innovation nous montre
que le terme d'innovation est mobilisé par diverses disciplines pour étudier les
changements qui touchent les structures de tous types. D'ailleurs, ce terme est rarement
utilisé tout seul. Il est le plus souvent associé à un autre terme. Les termes qui s'associent
avec notre concept sont très nombreux et concernent presque tous les champs de la vie
humaine. À titre d'exemple, on cite : innovation de produit, innovation sociale, innovation
pédagogique, innovation technologique, innovation organisationnelle, etc. Ceci ne peut que
témoigner de l'omniprésence de l'innovation dans toutes les sphères de la vie humaine ainsi
que de la centralité de ce terme dans les études qui proposent d'étudier les dynamiques de
changement dans une structure donnée. Étant donné notre domaine d'intérêt, de quoi
s'agit-il lorsqu'on parle de l'innovation dans le monde des entreprises ?
3.1.2 La notion d'innovation appliquée au monde des entreprises
Pour les spécialistes des sciences sociales traitant des questions relatives aux mondes du
travail et de la production, la notion d'innovation constitue une catégorie principale
d'analyse. Cette grande importance accordée à cette notion est due au rôle crucial que joue
l'innovation pour la compétitivité et la croissance des entreprises. Elle est mobilisée pour
comprendre l'évolution des structures économiques de divers types.
75
Innovation can and should become a centerplace of the microanalytic littérature, as it is in the economy of reality. It will thereby contribute both to the understanding of the actual economy and to its utility in application (Baumol, 2002: 8).
Pour les économistes, l'innovation exprime la mise sur le marché d'une nouveauté. Elle est
considérée comme la première transaction commerciale impliquant un produit, un procédé,
un système ou un dispositif (Freeman, 1982). L'économiste autrichien Joseph Alois
Schumpeter (1883-1950) est le premier qui propose une définition du concept de
l'innovation dans sa théorie de l'évolution économique. Il relie la croissance économique
en général et des entreprises en particulier à l'innovation. La définition proposée par
Schumpeter montre que l'innovation et l'entreprise sont en intime relation. Selon lui,
l'innovation est l'ensemble des activités consistant à transformer une idée en objet
commercialisé. Pour ce dernier, l'action d'innovation est une action de production. Elle est
la réalisation d'une combinaison nouvelle des facteurs de production : « exécution de
nouvelle combinaison ». Cet auteur énumère cinq cas plausibles d'innovation (Schumpeter,
1935):
1. La fabrication d'un nouveau bien.
2. L'introduction d'une nouvelle méthode de production.
3. L'ouverture d'un nouveau débouché.
4. La conquête d'une nouvelle source de matière première.
5. La réalisation d'une nouvelle organisation
Ainsi, l'innovation dans le monde des entreprises revêt plusieurs formes. Elle traduit
l'introduction d'une ou de plusieurs nouveautés sur une ou plusieurs dimensions de la
production. Les rares recherches qui ont traité de la question de l'innovation au sein des
petites entreprises, notamment les entreprises artisanales (Pacitto et Richomme, 2004 ;
Marchesnay, 2003 ; Loup, 2003), montrent que l'innovation dans ce type d'unité
productive se manifeste à travers trois figures principales :
1. la conception de nouveaux modèles;
2. le lancement de nouveaux produits et services;
3. la mise en œuvre de nouvelles méthodes de production.
76
Dans tous ces cas de figure, l'innovation exprime le changement. D'ailleurs, le sociologue
français Norbert Alter, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'innovation au sein des
entreprises, qualifie l'action de l'innovation comme une action de rupture avec un état
antérieur. Il écrit en ce sens « innover amène toujours à s'opposer à l'ordre établi, ordre
généralement conçu comme nécessaire. Cette situation conduit alors les innovateurs à être à
un moment donné des déviants » (Alter, 2003 :76). En effet, de l'innovation est une action
d'établissement de nouvelles règles et normes au détriment des autres plus anciennes afin
d'engager l'entreprise dans un nouveau sentier de croissance lui permettant d'assurer une
longévité supérieure à celle de ses produits (Blondel, 1990; Bellon, 1994). De ce fait,
l'innovation au sein de l'entreprise est une activité qui regroupe deux actions
diamétralement opposées: une action de destruction des normes de production existantes
d'une part et une action de création de nouvelles normes d'autre part (Carayannis, Gonzalez
et Wetter, 2003). Bref, l'innovation au sein de l'entreprise représente une activité qui
envisage de transformer un ordre donné à travers la modification d'un et ou de plusieurs
éléments à l'intérieur de l'entreprise. Il peut s'agir d'un nouveau mode de production, d'un
nouveau produit, d'une nouvelle méthode d'organiser la production. Elle peut être la
résultante d'une initiative individuelle et ou collective interne comme elle peut résulter de
l'acquisition des éléments externes. Ainsi, l'innovation au sein de l'entreprise peut être
définie comme la production et la mise en pratique de nouvelles idées afin d'améliorer un
des aspects de la production.
Dans les temps modernes, l'innovation est devenue stratégique pour les entreprises de tout
type. Pour survivre, chaque entreprise doit intégrer les logiques de l'innovation.
L'innovation est devenue une des dimensions majeures de l'entreprise, elle irrigue toutes les fonctions de l'entreprise, elle est transversale, c'est une activité dans laquelle l'entreprise est continuellement engagée, de façon explicite ou implicite. (Bellon, 1994 : 7)
Dans sa théorie sur l'évolution économique, Schumpeter accorde un rôle central à
l'entrepreneur dans l'action d'innovation. Selon cet auteur, l'entrepreneur est au cœur de
toute action d'innovation au sein de l'entreprise industrielle soit en apportant une nouvelle
idée ou soit en prenant la décision d'introduire une nouveauté sur le processus de la
production (Schumpeter, 1935). Dans le cadre de l'entreprise artisanale, c'est le chef artisan
77
qui assume ce rôle (Bréchet, Journé Michel et Schieb Bienfait, 2008). Toutefois, les
récents travaux en sociologie de l'innovation et de l'entreprise, tels que les travaux
d'Akrich, Callon, Latour, Alter, Sainsaulieu, etc., montrent clairement que l'innovation ne
s'effectue pas d'une manière brusque ou rapide et ne dépend pas uniquement d'une seule
personne. Elle est plutôt le résultat d'un processus qui se réalise par agglomération de
plusieurs activités et accumulation de nouvelles connaissances et informations qui se
développent au sein de l'entreprise (Lhuillier, 2007).
L'innovation est toujours une histoire, celle d'un processus. Elle permet de transformer une découverte, qu'elle concerne une technique, un produit ou une conception des rapports sociaux, en de nouvelles pratiques » (Alter, 2005 :7).
L'ultime objectif de ce processus est l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise en
introduisant effectivement un et ou plusieurs nouveaux éléments sur une ou plusieurs
dimensions de la structure du travail (Coffey, Siegel et Smith, 2009). Dans cette
perspective, la décision d'introduire des changements ou la proposition d'une nouvelle idée
doivent être comprises comme des inventions et non pas des innovations.
D'un point de vue sociologique, l'innovation au sein de l'entreprise est définie comme un
produit sociotechnique qui résulte d'un processus complexe impliquant tout l'effectif de
travail ainsi que les différentes composantes de l'entreprise (Gordon, 1989 ; Thuderoz,
2005 ; Alter 2005). On ne peut donc pas dissocier les procédures techniques et sociales qui
contribuent à la naissance d'une nouveauté dans l'entreprise (Corneloup, 2009). Ce
processus occasionne des interactions et des dynamiques sociales entre les différents
acteurs de l'entreprise (Akrich, Callon et Latour, 1988 ; Gordon, 1989 ; Alter, 2002), que
ce soit au moment de la prise de décision d'introduire de nouveaux éléments sur la structure
de la production ou de la mise en œuvre de ces éléments. À travers leurs interactions, les
individus participent activement au changement de leur monde du travail et imprègnent ce
monde par leurs propres idées, actions et interactions dans le processus d'innovation. En ce
sens, la structure du travail est en perpétuelle transformation de la part des acteurs qui la
composent. Elle n'est donc jamais stabilisée.
L'étude sociologique du processus de l'innovation au sein de l'entreprise consiste à
comprendre les dynamiques et les logiques sociales qui le structurent ainsi que les facteurs
78
qui l'influencent. En d'autres termes, il s'agit d'explorer les conditions organisationnelles,
managériales, sociales et culturelles de son déroulement. Ces conditions encadrent toutes
les interactions au sein de l'entreprise, notamment les interactions occasionnées par le
processus en question. Dans cette optique, le processus de l'innovation au sein de
l'entreprise peut être conçu comme une création négociée destinée à atteindre un objectif
prédéterminé : l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.
3.2 L'innovation au sein de l'entreprise : les sources et les déterminants
La littérature en matière de l'innovation au sein des entreprises nous informe que la
réalisation d'un tel objectif nécessite de favoriser d'une manière continue un esprit de
création et d'innovation d'une part, d'aménager les conditions perméables et favorables à
l'émergence et à l'introduction des innovations d'autre part. Ceci conduit à s'interroger sur
les origines des innovations et les conditions de leurs apparitions et concrétisations. Il s'agit
ici de préciser les sources possibles ainsi que les déterminants de l'innovation au sein de
l'entreprise.
3.2.1 Les sources de l'innovation au sein de l'entreprise
Concevoir l'innovation au sein de l'entreprise en tant que processus suppose qu'elle
représente une chaîne d'actions successives qui conduisent à la modification partielle et ou
complète des structures et des dynamiques de la production. Ainsi, l'innovation se présente
comme un processus créateur de nouveautés à l'intérieur de la communauté du travail tout
entière. Norbert Alter, qui étudie le phénomène de l'innovation au sein des entreprises
depuis les années 1990, décompose ce processus en trois séquences principales qui se
succèdent : « Dans un premier temps, les directions incitent à l'innovation. Dans un
deuxième temps, elles sont contraintes de laisser faire les innovateurs. Dans un troisième
temps, elles mènent une politique d'institutionnalisation des innovations » (Alter, 2003 :
77). De cette description, on peut dégager que l'innovation à l'intérieur de l'entreprise
repose en grande partie sur la sensibilisation de l'effectif du travail à l'innovation. En ce
sens, elle se présente comme une affaire qui concerne tous les acteurs insérés dedans,
surtout ceux impliqués directement dans l'action productive. Étant donné leur fréquentation
quotidienne de la production et des produits, ces acteurs sont considérés comme l'une des
79
sources principales de nouvelles idées qui déclenchent les dynamiques de l'innovation dans
les unités de production. Il y a plus de deux siècles, Adam Smith a soutenu que les acteurs
de la production représentent une source importante d'innovation pour les entreprises.
A great part ofthe machines made use of in those manufactures in which labour is most subdivided, were originally the inventions of common workmen, who, being each of them employed in some very simple operation, naturally turned their thoughts towards finding out easier and readier methods of performing it. Whoever has been much accustomed to visit such manufactures must frequently have been shown very pretty machines, which were the inventions of such workmen in order to facilitate and quicken their particular part of the work. (Smith, 1839: 5)
Les recherches sociologiques contemporaines, telles que les recherches d'Alter, Akrich,
Callon, Latour, ect, qui ont traité du processus de l'innovation au sein des entreprises
contemporaines de tout type, confirment l'idée de Smith et ajoutent que l'innovation peut
naître dans différents endroits, que ce soit dans une unité de production ou dans n'importe
quelle autre unité au sein de l'entreprise. Elle ne concerne donc pas seulement les acteurs
de la production. À travers leurs enquêtes empiriques, ces auteurs montrent aussi que
l'apparition des inventions n'est pas limitée à un niveau hiérarchique donné. De ce fait, les
prémices du processus de l'innovation peuvent émerger dans n'importe quelle fonction et
chez n'importe quelle catégorie professionnelle dans l'entreprise.
Si la production d'idées d'innovation résulte bien de la spontanéité créatrice (qui existe au niveau des individus, et qui est peut-être nécessairement portée par une collectivité innovante interactive) et si la confrontation de variétés joue bien un rôle de premier plan dans la génération des idées, alors encourager l'innovation doit passer par des structures dans lesquelles, pour un nombre important des acteurs, les relations internes et les relations externes sont nombreuses et variées. Une telle évolution va dans le sens de l'accroissement de la participation de tous les acteurs au processus de l'innovation, et notamment des acteurs qui n'ont pas un niveau hiérarchique important. (Romelaer, 2002 : 95).
Ainsi, la promotion de l'innovation au sein de l'entreprise exige de laisser place aux
initiatives individuelles et de trouver les modalités de reconnaissance sociale permettant
aux acteurs de s'engager dans le processus de l'innovation sans prendre trop de risque. Ce
faisant, l'innovation dans les milieux de production nécessite l'aménagement d'un climat
de travail favorable à la stimulation de la créativité des acteurs d'une part, et à la
80
concrétisation de leurs initiatives innovatrices d'autre part. En ce sens, l'entreprise
innovante est celle qui réussit à intégrer tout son effectif dans une logique de création et
d'invention et qui met en œuvre des structures et des pratiques de travail favorisant le
développement et l'évolution des idées créatrices au sein de l'entreprise tout entière. En
conséquence, le jaillissement et le fonctionnement du processus de l'innovation au sein de
l'entreprise sont tributaires de plusieurs facteurs endogènes hétérogènes. Ce processus
dépend tant que des individus, des structures et des environnements internes.
3.2.2 Les déterminants de l'innovation dans l'entreprise
La littérature en matière de l'innovation au sein des entreprises et des organisations en
général (Alter, Gordan, Romelear, Callon, Akrich, Sainsulieu, Latour, Mohr, Reynaud,
Amabile, Tellis et son équipe., Deschamps.) et dans les entreprises artisanales en particulier
(Schieb-Bienfait, Journé-Michel, Zarca, Picard), nous permet de déduire que la promotion
de l'esprit de l'innovation à l'intérieur d'une entreprise passe par l'existence de plusieurs
facteurs favorables à l'émergence des idées innovatrices et perméables à la concrétisation
de ces idées. Parmi ces facteurs, voici les plus fréquemment cités.
• La présence des compétences particulières. Étant donné que le processus de
l'innovation est dans son début une nouvelle idée et que l'innovation est une transgression
des règles établies, ceci signifie qu'il est important d'avoir dans l'entreprise des individus
qui disposent d'un ensemble de savoirs et qui ont des traits de personnalité spécifique leurs
permettant d'apporter de nouvelle idée d'une part et de déroger les règles déjà établies de
l'autre part. Dans son article « Model of Creativity and Innovation in Organizations »,
Teresa M. Amabile (1988) montre que l'émergence des innovations dans le travail est
tributaire de l'existence d'une certaine personne qui dispose des traits spécifiques. Selon cet
auteur, les traits de personnalités propices à l'innovation sont : la prise de risque, la
créativité, la sociabilité, l'imagination, la diversité des expériences, la flexibilité. De ce fait,
la promotion de l'innovation au sein de l'entreprise dépend aussi des qualités de son
personnel. « Ce qui permet à un processus d'innovation de devenir créateur est ainsi la
capacité à se déférer des croyances initiales : ceci suppose l'existence d'une minorité
critique, capable de transgresser les règles, les normes et les usages établis en matière de
division du travail ainsi que les capacités des directions à entraidé cette minorité »
81
(Moscovici, 1972 : 207). En effet, la promotion de l'innovation au sein d'une communauté
de travail donnée nécessite l'existence des acteurs qui ont le sens de l'innovation et qui
disposent des compétences variées.
• L'octroi d'une marge de liberté aux acteurs dans le travail. Cette marge permet aux
différents acteurs de l'intérieur de s'engager d'une façon permanente dans un sentier de
création et d'invention. Sans cette marge, les acteurs ne peuvent pas mobiliser leurs
imaginations et leurs savoirs-faires lors de l'application de leurs tâches pour apporter des
nouveautés que ce soit sur la structure de la production ou le produit. « Innover, c'est
développer un nouveau produit, un nouveau service ou une nouvelle façon de s'organiser. Il
peut y avoir en partie continuité par rapport à l'état antérieur, mais il ya nécessairement
rupture. En ce sens fondamental, l'innovation c'est l'affranchissement par rapport au
présent, l'innovation c'est la liberté » (Romelear, 2002 : 65). De ce fait, l'accord d'une
autonomie aux différents acteurs dans leurs propres tâches s'avère comme la condition
préalable du processus de l'innovation au sein de l'entreprise. Afin de promouvoir
l'innovation, l'entreprise doit donc donner à son effectif l'occasion de s'investir librement
individuellement et ou collectivement dans des projets novateurs.
• La mise en œuvre de pratiques managériales valorisant l'innovation. Afin de
promouvoir le sens de la création chez son effectif du travail, l'entreprise est contrainte de
stimuler le sens de l'innovation chez eux et de les accompagner jusqu'à la fin dans leurs
projets innovateurs sans calculer dés le début son apport. « Chaque innovation doit être
traitée comme une option qui ne rapporte pas à tous les coûts » (Martinet, 2003 : 40).
L'innovation au sein de l'entreprise dépend aussi de la manière par laquelle sont régies les
ressources humaines. Un système de gestion des conduites dans le travail qui ne contrôle
pas les acteurs dans leurs moindres comportements et qui récompense, matériellement et
immatériellement, l'initiative individuelle de l'autre part se présente comme l'une des
conditions principales favorables à l'innovation (Mohr, 1969, Descarpentries et Korda,
2007). En ce sens, le processus de l'innovation au sein de l'entreprise nécessite
l'application des politiques valorisant l'esprit créatif et permettant de motiver les individus
à se lancer dans un sentier de créativité. En bref, des pratiques qui permettent d'avoir des
comportements innovateurs au sein de l'entreprise.
82
• La présence d'un leadership qualifié. Un leadership qualifié est celui qui est toujours
proche des employés et qui leur donne l'occasion de participer activement à l'amélioration
du contenu et de l'organisation de leurs tâches personnelles et de l'organisation du contenu
du processus de la production en général (Deschamps, 2003). Son rôle consiste à
encourager les individus à proposer de nouvelles idées relatives et à prendre des initiatives.
« on ne peut pas [...] obliger les gens à prendre des initiatives. Un leader peut heureusement
faire beaucoup d'autres choses : sélectionner et promouvoir en priorité des collaborateurs
dotés d'un tempérament proactif, encourager expressément l'initiative, reconnaître le droit
à l'erreur, fixer pour l'action un cadre fait de priorités et de valeurs plutôt que de regèles et
de procédures » (Descarpentries et Korda, 2007 : 189 -190). Dans le cas de l'entreprise
artisanale, le chef artisan peut jouer ses multiples rôles par excellence vu sa position au sein
de l'entreprise. « Dans l'entreprise artisanale, c'est en général le chef d'entreprise qui
impulse le processus de l'innovation, mais celui-ci s'appuie sur les savoir-faire collectifs
des membres de l'organisation». (Schieb-Bienfait et Journé-Michel, 2008 :114). Ainsi, la
promotion de l'innovation à l'intérieur de l'entreprise dépend, également, de la personnalité
du leadership, de sa capacité de stimuler ses employées à la créativité et de sa manière de
gérer et d'animer son équipe de travail.
• L'application d'un modèle organisationnel adéquat. Le modèle adéquat est celui qui
favorise l'apparition des initiatives individuelles ou collectives et qui permet aux individus
de collaborer ensemble pour concrétiser leurs initiatives. Comme le souligne Gordon: « Le
succès d'une innovation individuelle dérives non pas d'actes automnes, mais d'efforts
organisationnels collectifs » (Gordon, 1989 : 108). En ce sens, les modèles organisationnels
de type participatif qui favorisent la coopération et la collaboration entre les différents
acteurs de l'entreprise s'avèrent les plus capables d'offrir un milieu propice à la production
de nouvelles idées au sein de l'entreprise. Analysant les mutations qu'ont connu les
entreprises contemporaines, Norbert Alter remarque que l'organisation du travail dans ces
entreprises s'est fondamentalement transformée pour devenir de plus en plus orientée vers
l'innovation qui devint pour elles une nécessité vitale. Dans les entreprises valorisant
l'innovation « l'organisation du travail se trouve à la fois moins bureaucratique et plus
centrée sur les fonctionnements informels. Elle conduit à un système de relations interactif,
le face-à-face et la négociation en étant les principales caractéristiques » (Alter, 1996 : 42).
S3
Ainsi, il s'avère que certaines modes d'organisation sont plus propices à l'innovation que
d'autres.
• L'existence d'une culture d'entreprise ouverte à l'innovation. Dans un article publié
en 2009 intitulé Radical Innovation Across Nations: The Pre-eminence of Corporate
Culture (Tellis, Jaideep et Chandy , 2009) qui présente les résultats d'une recherche
empirique qui a porté sur près de 800 entreprises réparties dans 17 pays, Gerard Tellis et
son équipe de recherche lient en grande partie l'innovation au sein des entreprises aux
habitudes culturelles internes. La culture d'entreprise, selon ces auteurs, est le facteur de
conduite de l'innovation le plus important au sein des entreprises. Ils remarquent qu'il ya
des cultures d'entreprises propices à l'innovation et d'autre qui peuvent, au contraire,
l'entraver. À l'issue de cette étude, les chercheurs montrent que la culture d'entreprise
favorable à l'innovation est celle orientée vers le changement et l'amélioration. Les auteurs
précisent que ce type de culture est principalement le corollaire de l'existence d'un climat
social de grande confiance au sein de l'entreprise qui se cultive sur le long terme.
En somme, l'innovation au sein de l'entreprise est un processus qui dépend de plusieurs
types de facteurs. Ces facteurs peuvent être regroupés sous deux grandes catégories : des
facteurs relatifs aux caractéristiques intrinsèques des acteurs de l'entreprise et des facteurs
en lien avec le contexte de la production. Ces deux catégories jouent ensemble un rôle
crucial dans l'apparition et la concrétisation des idées créatives : l'innovation. Un
environnement favorable à l'innovation au niveau de l'entreprise se fonde sur un bon climat
de travail, social, humain, culturel, organisationnel, technique, permettant aux différents
acteurs de se mobiliser continuellement dans des démarches innovantes. Afin de
comprendre les logiques et les dynamiques qui structurent le processus de l'innovation au
sein de l'entreprise, il est important, donc, de prendre en considération ces différents
facteurs ainsi que les interactions sociales qui en résultent.
84
Chapitre 4. Le cadre opérationnel : mise en action de la recherche
Après avoir procédé dans les chapitres précédents au traitement de différents éléments
constituant le schéma théorique et conceptuel de l'objet de la recherche, le présent chapitre
est consacré à la mise en action de ces différents éléments. Il s'agit de présenter les
modalités de la mise en application du schéma en question sur le terrain. Dans un premier
temps, le modèle d'analyse et d'observation, constitué des variables à l'étude, ainsi que les
hypothèses issues de ce modèle sont exposés. Dans un deuxième temps, la stratégie de la
recherche est précisée, à savoir le cadre méthodologique de la recherche. Dans un troisième
temps, des éléments relatifs à la phase empirique de la recherche sont présentés, à savoir le
travail de terrain.
1. Modèle d'analyse et hypothèses
Afin d'atteindre les objectifs fixés pour la présente recherche, nous avons adopté un modèle
d'analyse et d'observation centré autour des deux variables principales à l'étude, soit
l'innovation et la transmission des savoirs professionnels. Ce modèle propose
l'opérationnalisation empirique de l'objet de la recherche. À travers ce modèle nous avons
essayé d'appréhender les dynamiques de la transmission des savoirs et de l'innovation au
sein des entreprises artisanales tunisiennes. La construction de ce modèle est le résultat
d'une pré-enquête ainsi qu'une d'une recherche bibliographique. Les éléments constitutifs
de ce modèle représentent les variables à l'étude. Dans l'opérationnalisation des variables
nous nous sommes référés à une littérature multidisciplinaire. Le parti pris de départ était
d'utiliser les concepts et les résultats de recherches antérieures appartenant principalement
à la sociologie de l'entreprise28, notamment celles qui font de l'interactionnisme
symbolique leur support théorique.
28 La sociologie d'entreprise est relativement récente. Elle s'intéresse essentiellement à l'étude des entreprises
industrielles. Cette sociologie s'est développée au sein de deux grands domaines : la sociologie du travail et la sociologie de des organisations (Wieworka, 1987; Maurice, 1990). Elle s'est appuyé, également, dans son approche des mondes de productions sur les acquis de ces deux disciplines ainsi que sur les acquis de plusieurs autres disciplines (Sainsaulieu, Ulhade et Osty, 2007) tel que l'ergonomie du travail, l'ethnographie de l'entreprise, les sciences de gestion, etc. Notre ambition de dégager le modèle de l'entreprise artisanale dans le contexte de la globalisation a exigé un tel choix, surtout si on sait que ce type d'entreprise ne représente pas jusqu'à maintenant un objet privilégié pour les sociologues. Les rares recherches sociologiques qui se sont intéressé à ce type d'entreprise les traites comme étant une forme des entreprises de très petite ou
85
1.1 Le modèle d'analyse et d'observation : les variables
Comme nous l'avons vu plus haut, la transmission des savoirs professionnels et
l'innovation dans les milieux du travail, qui font l'objet principal de notre recherche,
constituent deux processus multidimensionnels qui dépendent étroitement de
l'environnement et du climat du travail régnant au sein de l'entreprise. De ce fait, l'étude
des deux processus en question ainsi que les relations entre eux doit prendre en
considération les différentes dimensions qui les constituent ainsi que les facteurs qui les
influencent. Le modèle d'analyse et d'observation proposé est constitué de deux catégories
de variables : deux variables dépendantes et trois autres indépendantes.
1.1.1 Les variables dépendantes
La recherche bibliographique ainsi que la pré-enquête nous ont permis de constater que les
responsabilités de l'entreprise artisanale tunisienne de métier ancestral dans le contexte de
la globalisation sont multiples. L'assurance de ces différentes responsabilités nécessite
l'incorporation de deux principaux processus ainsi que la conciliation entre eux. D'une
part, le processus la transmission des savoirs professionnels représente l'un des moyens
essentiels permettant à l'entreprise de conserver et de reproduire ses pratiques et sa culture
du travail (Chevalier et Chiva, 1991). Par le biais d'un tel processus l'entreprise artisanale
de métier ancestral sera en mesure d'assurer sa responsabilité culturelle qui consiste à
conserver une partie importante de la culture locale. D'autre part, le processus de
l'innovation constitue l'un des principaux chemins permettant à ce type d'entreprises
d'être concurrentiel sur le marché local (Willemarck, 2006). À travers un tel processus,
l'entreprise artisanale de métier ancestral sera capable d'assurer ses responsabilités
économique et sociale qui consistent à créer de la richesse et des emplois. En ce sens, la
survivance et le développement de l'entreprise artisanale dans le contexte actuel sont
tributaires de la présence de deux dynamiques, soit les dynamiques de la transmission des
savoirs professionnels et les dynamiques de l'innovation. Nous utilisons le terme de
dynamiques dans le cadre de cette recherche afin d'opérationnaliser les deux processus qui
de petite taille et non pas comme une forme spécifique de production ré-émergente. Il s'agit alors d'intégrer, dans un même dessein théorique, la diversité des approches qui permettent de comprendre ce monde particulier du travail dans la situation contemporaine de pressions aléatoires et continues de l'environnement.
86
font l'objet principal de notre étude. Comme il a déjà été mentionné dans le cadre
conceptuel de cette recherche, ces deux processus sont dépendants d'autres variables tant
matériels qu'immatériels. Ainsi, les dynamiques de la transmission des savoirs
professionnels et les dynamiques de l'innovation, sont conçue en tant que variables
dépendantes dans le cadre de notre modèle d'analyse.
1.1.1.1 La première variable dépendante : les dynamiques de la transmission
des savoirs professionnels
S'intéresser à l'étude des dynamiques de la transmission des savoirs professionnels au sein
de l'entreprise artisanale signifie la focalisation de l'attention sur la reproduction
intergénérationnelle des compétences professionnelles dans ce type d'unité de production.
La littérature traitant de la compétence professionnelle nous a conduitt à conclure que
cette dernière est structurée par trois types de savoirs : les savoirs théoriques, le savoir-
faire, et le savoir-être (Labruffe, 2009, Zarifian, 2009). Pour les deux premiers types, ils
renvoient aux connaissances procédurales et pratiques nécessaires à l'exécution d'une tâche
donnée (Bemadou, 1996). En ce qui concerne le troisième type, il réfère à une dimension
comportementale mobilisée par l'individu dans le travail (Bellier, 2004). Cette dimension
exige de l'individu, entre autres, d'incorporer les rituels du travail, les systèmes des valeurs,
les codes sociaux et des modes des représentations du groupe du travail (Labruffe, 2008).
En bref, le savoir être est liée intimement aux normes et aux valeurs sociales et culturelles
du métier et du groupe de travail. Ces normes et ces valeurs constituent un guide de
comportement pour l'individu dans son travail. « Pour qu'il y ait compétence, écrit Le
Boterf, il faut qu'il y ait mis enjeu un répertoire de ressources; connaissances, capacités
cognitives, capacités relationnelles» (Le Boterf, 2000 : 58). En ce sens, la compétence
professionnelle représente un ensemble intégré d'attitudes et de connaissances. La
transmission de ces deux composantes traduit la reproduction des traits tant techniques que
socioculturelles d'un métier donné. Une telle action reste inévitable pour que l'entreprise
artisanale de métier ancestral puisse perpétuer ses caractéristiques identitaires. De ce fait,
mettre l'accent sur la transmission des savoirs professionnels au sein de l'entreprise
artisanale nécessite la prise en considération de ces deux dimensions. D'ailleurs, les
multiples recherches traitant de la question de la transmission des savoirs professionnels
S7
dans l'entreprise ont montré que cette transmission ne concerne pas exclusivement les
connaissances théoriques et pratiques, mais englobe également la transmission des
pratiques sociales et culturelles qui façonnent en grande partie les attitudes des individus
dans le travail (Lave et Wenger, 1999; Rainbird, Fuller et Munro, 2004). Par conséquent la
variable des dynamiques de la transmission des savoirs professionnels, retenue dans le
cadre de cette recherche, est décomposée en deux dimensions principales : les dynamiques
de la transmission des connaissances théoriques et pratiques (savoirs et savoir-faire) et les
dynamiques de la transmission des pratiques socioculturelles (savoir-être). Le tableau
suivant illustre cette variable. Il présente ses deux dimensions ainsi que les champs retenus
pour les observer. Ces champs sont mis en œuvre afin de cerner les logiques tant matérielle
qu'immatérielles qui régissent le processus de la transmission des savoirs professionnels au
sein de l'entreprise artisanale. Tableau 2: La composition de la variable des dynamiques de la transmission des savoirs professionnels
La variable Les dimensions Les champs d'observation
Les dynamiques de la transmission des savoirs
professionnels.
Les dynamiques de la transmission connaissances
professionnelles
• Organisation technique
• Organisation sociale
• Les acteurs
• Les mécanismes
Les dynamiques de la transmission des savoirs
professionnels. Les dynamiques de la
transmission des pratiques socioculturelles
• Organisation technique
• Organisation sociale
• Les acteurs
• Les mécanismes
1.1. ï .2 La deuxième variable dépendante : les dynamiques de l'innovation
Comme nous avons mentionné antérieurement, l'innovation dans l'entreprise traduit toute
action visant la transformation partielle ou complète d'une ou de plusieurs dimensions de
l'entreprise (Sundabo, 2003; Coffey, Siegel et Smith, 2009). Effectivement, elle exprime le
changement d'un ou de plusieurs éléments constitutifs de l'entreprise. La littérature traitant
de la question montre (Alter, 2005; Lhuillier, 2007) que deux actions principales sont à
l'origine de l'innovation (le changement) au sein l'entreprise :
xs
1) Une initiative d'un ou de plusieurs individus évoluant au sein de l'entreprise;
2) L'introduction d'une ou de plusieurs nouveautés développés à l'externe par des
inventaires et des chercheurs.
Ainsi, on peut parler de deux catégories d'innovations en contexte d'entreprise:
1) Des innovations apportées par les individus évoluant au sein de l'entreprise;
2) Des innovations occasionnées par l'acquisition de nouveaux éléments développés à
l'externe.
Dans les deux cas de figures, les différentes composantes de l'entreprise seront impliquées
et ses différentes structures seront touchées (Gordon, 1989; Brodtrick, 1999; Thuderoz,
2005 ; Alter 2005, Callon, 2006). Afin de rendre compte des innovations mises en œuvre
par les unités productives artisanales tunisiennes de métiers ancestraux en vue de s'adapter
aux nouvelles exigences de la globalisation, il était nécessaire de prendre en considération
les deux cas d'innovations lors de l'étude empirique. Avec une telle démarche il advient
possible de :
1) cerner les champs de travail concernés par l'innovation dans les entreprises artisanales
de métiers ancestraux;
2) rendre compte des impacts de l'innovation sur le fonctionnement général de ces
entreprises;
3) préciser les logiques et les mécanismes de l'innovation et de la création au sein des
entreprises objet de l'étude;
4) identifier les principaux déterminants à l'innovation dans ce contexte spécifique de
production.
Dans le but de rendre la catégorie de l'innovation dans l'entreprise opérationnelle, nous
avons porté notre attention sur les différentes dynamiques qui caractérisent les deux cas de
l'innovation. Par conséquent, notre variable à l'étude devient les dynamiques de
l'innovation. Cette variable se scinde en deux dimensions principales, soit les dynamiques
89
relatives aux innovations apportées par les membres de l'entreprise et les dynamiques en
lien avec les innovations occasionnées par la mise en œuvre des nouveautés développées à
l'externe.
À travers ces deux dimensions, nous cherchons d'identifier les changements significatifs
introduits par les entreprises artisanales tunisiennes de métiers artisanaux afin de s'adapter
aux exigences de la globalisation et d'examiner le processus de l'innovation au sein de ces
entreprises. Dans le but de comprendre les dynamiques en question dans les entreprises,
objet de notre étude, nous avons observé un ensemble d'éléments pour chacune de ces deux
dimensions. Le tableau qui suit illustre la variable à l'étude au complet.
Tableau 3: La composition de la variable des dynamiques de l'innovation La variable Les dimensions Les éléments observés
Les dynamiques de l'innovation
Les dynamiques relatives aux innovations apportées
par les membres de l'entreprise
• Les champs concernés par l'innovation
• Les acteurs de l'innovation
• Les champs concernés par l'innovation
• Les objectifs fixés
Les dynamiques de l'innovation
Les dynamiques en lien avec les innovations
occasionnées par la mise en œuvre de nouveautés développées à l'externe
• Les champs concernés par l'innovation
• Les acteurs de l'innovation
• Les champs concernés par l'innovation
• Les objectifs fixés
1.1.2 Les variables indépendantes
Les dynamiques de la transmission des savoirs professionnels, ainsi que celles de
l'innovation au sein des entreprises, dépendent toutes les deux étroitement, comme il a été
déjà montré dans le cadre conceptuel, de l'aménagement d'un climat de travail favorable.
Elles sont tributaires autant des humains que des objets qui les entourent. Afin de
comprendre ces deux dynamiques dans le contexte d'entreprises artisanales de métiers
ancestraux, il devient donc nécessaire de faire l'état des lieux des différentes structures et
dynamiques régnantes dans les entreprises étudiées. Une telle démarche ne permet non
seulement de repérer les conditions matérielles et immatérielles dans lesquelles se déroulent
90
les deux processus en question, mais elle permet également de construire le modèle de
l'entreprise artisanale de métiers ancestraux dans l'époque moderne. De la littérature
traitant des questions de l'innovation et de la transmission des savoirs professionnels au
sein des entreprises de tout type, nous avons retenu trois variables qui nous ont semblé
comme les plus déterminantes que ce soit dans les dynamiques de la transmission des
savoirs professionnels ou les dynamiques de l'innovation. Ces variables sont :
1) l'organisation du travail;
2) la gestion des ressources humaines;
3) les dynamiques socioculturelles.
1.1.2.1 La première variable indépendante : l'organisation du travail La recherche bibliographique a permis de constater que les pratiques organisationnelles des
entreprises jouent un rôle décisif dans le processus de la transmission des savoirs
professionnels ainsi que dans celui de l'innovation. Ainsi, l'organisation du travail est
retenue, dans le cadre de cette recherche, à titre de variable indépendante. La mobilisation
de cette variable vise à savoir dans quelle mesure les différentes dynamiques des deux
processus en question au sein des entreprises artisanales sont influencées et déterminées par
l'organisation du travail mise en œuvre et de voir si la conciliation entre ces deux
processus dépend ou non de cette organisation. Pour ce faire, la variable de l'organisation
du travail est décomposée en deux dimensions : la structure de l'organisation et les unités
organisationnelles.
Derrière la première dimension, nous avons cherché à explorer les modalités d'agencement
des activités dans les entreprises retenues dans notre enquête afin de dégager les liens qui
peuvent exister entre ces modalités et les deux dynamiques qui constituent l'objet central de
notre étude. D'un point de vue organisationnel, on désigne par structure la manière dont
sont organisées ensemble les parties d'un tout (Conso, et Hémici, 2003). « La structure de
l'organisation, écrit Henri Mintzberg, est l'ensemble des moyens formels et semi-formels
que les organisations utilisent pour diviser et coordonner leur travail de façon à créer des
comportements stables» (Mintzberg, 1998 : 18). La structure de l'organisation définit donc
un certain arrangement entre les parties de l'entreprise dans la mesure où cette dernière
représente une organisation et fonctionne selon une organisation donnée.
91
Quant à la deuxième dimension, les unités organisationnelles, elle est mise en œuvre afin
de repérer les dynamiques de la transmission du savoir professionnels et celles de
l'innovation au niveau microscopique. En d'autres termes, cette dimension est mobilisée
avec l'objectif de déterminer les groupes les plus concernées par l'innovation et la
transmission au sein de ces entreprises d'une part, et de rendre compte des caractéristiques
du fonctionnement des unités qui composent les entreprises étudiées d'autre part. En fait,
s'intéresser aux unités organisationnelles, c'est être au plus près des situations concrètes du
travail.
Afin de rendre les deux dimensions de cette variable opérationnelles nous nous sommes
référés à la littérature et aux résultats des recherches antérieures en matière d'organisation
d'entreprise. Ces deux dernières nous offrent une panoplie d'éléments permettant
d'observer et d'identifier les deux composantes de l'organisation du travail que nous avons
retenues. De cette panoplie d'éléments nous avons choisi ceux qui nous ont paru les plus
utiles à l'étude des deux dynamiques qui font l'objet principal de notre recherche d'une
part, et à l'identification des caractéristiques structuro-organisationnels des entreprises
artisanales d'autre part. Le tableau ci-dessous illustre les éléments à travers lesquelles la
variable de l'organisation du travail a été rendu observable, voire opérationnelle.
92
du travail La variable Les dimensions Les éléments
observés Les sous-éléments
observés
L'organisation du travail
La structure de l'organisation
La division du travail
La division des tâches
L'organisation du travail
La structure de l'organisation
La division du travail La division spatiale des
activités
L'organisation du travail
La structure de l'organisation
La hiérarchie La ligne hiérarchique (composition et
longueur)
L'organisation du travail
La structure de l'organisation
Le pouvoir Le système de prise de décisions
(centralisé/décentralisé) L'organisation
du travail
Les unités
organisationnelles
Organisation de l'unité
Mode de répartition des tâches dans l'unité
L'organisation du travail
Les unités
organisationnelles
Organisation de l'unité
Mode de contrôle du travail dans l'unité.
L'organisation du travail
Les unités
organisationnelles
Organisation de l'unité
Mode de coordination entre les membres de
l'unité.
L'organisation du travail
Les unités
organisationnelles
Contenu du travail Le degré de complexité des tâches
L'organisation du travail
Les unités
organisationnelles
Contenu du travail
les compétences exigées pour
l'exécution des tâches
L'organisation du travail
Les unités
organisationnelles
Relations entre unités
La dépendance entre les unités
L'organisation du travail
Les unités
organisationnelles
Relations entre unités
La coordination entre les unités
1.1.2.2 La deuxième variable indépendante: la gestion des ressources humaines
Comme nous l'avons montré lors de la présentation des deux processus qui font l'objet de
notre étude, soit la transmission des savoirs professionnels et l'innovation, le facteur
humain joue un rôle crucial dans ces deux processus. Tout les deux dépendent étroitement
du degré d'engagement individuel et collectif des ressources humaines de l'entreprise dans
les différentes dynamiques qui les caractérisent. De ce fait, l'étude de ces dynamiques
nécessite forcément de focaliser l'attention sur les manières par lesquelles les individus et
les groupes au sein des entreprises à l'étude sont sensibilisés et motivés que ce soit à la
participation active à ces dynamiques ou à l'adoption des attitudes positives vis-à vis ces
93
dernières. Ainsi, la variable de la gestion des ressources humaines se présente en tant que
variable indépendante.
La littérature récente en matière de gestion des ressources humaines fournit une
multiplicité d'analyse décrivant plusieurs dimensions de cette fonction au sein des
entreprises. Pour notre part, nous avons exploré cette fonction dans les entreprises
artisanales tunisiennes de métiers ancestraux à travers les outils mobilisées pour assurer un
meilleur engagement individuel et collectif aux deux processus à l'étude. Deux catégories
peuvent être distinguées, soit les outils de la gestion individuelle et les outils de la gestion
collective. Ces deux catégories d'outils, qui constituent les deux dimensions de notre
variable à l'étude, se présentent comme essentielles pour que les entreprises artisanales
puissent promouvoir les dynamiques de la transmission des savoirs professionnels et les
dynamiques de l'innovation d'une part, et concilier entre les deux dynamiques en question
d'autre part. Le rôle des outils de la gestion individuelle consiste à les sensibiliser les
différents acteurs à ces enjeux. Tandis que le rôle des outils de la gestion collective
consiste à favoriser la coopération et la coordination, qui sont fondamentales dans les deux
processus objet de notre étude, entre les membres de la communauté du travail. Bref, par le
biais de ces deux catégories outils il devient possible de réunir les différents acteurs au sein
de l'entreprise autour des enjeux de la transmission des savoirs professionnels et de
l'innovation. En s'appuyant sur une recherche bibliographique en matière de gestion des
ressources humaines, nous avons pu déceler un ensemble assez large d'éléments permettant
de rationaliser les deux dimensions de la présente variable. Compte tenu du cadre restreint
de la recherche, notre choix s'est limité aux éléments qui ont paru comme les plus
pertinents dans l'étude des deux processus que nous intéresse dans le cadre de cette étude.
Dans l'observation de chacun des ces éléments nous avons centré notre attention sur un
certain nombre de sous-éléments qui les constituent. Le tableau ci-dessous présente la
composition complète de la variable de la gestion des ressources humaines.
94
Tableau 5: La composition de la variable de la gestion des ressources humaines La variable Les dimensions Les éléments
observés Les sous-éléments
observés
La gestion des ressources humaines
Les outils d'une gestion individuelle
La gestion des carrières
La mobilité (verticale/horizontale)
La gestion des ressources humaines
Les outils d'une gestion individuelle
La gestion des compétences
La formation
La gestion des ressources humaines
Les outils d'une gestion individuelle
La gestion des rémunérations
Le système des salaires La gestion des
ressources humaines
Les outils d'une gestion collective
La communication
interne
La circulation des informations
La gestion des ressources humaines
Les outils d'une gestion collective
La communication
interne Les politiques de communication
La gestion des ressources humaines
Les outils d'une gestion collective
Le travail participatif
Les pratiques participatives
La gestion des ressources humaines
Les outils d'une gestion collective
Le travail participatif La gestion des
pratiques participatives
1.1.2.3La troisième variable indépendante : les dynamiques socioculturelles
Les résultats des recherches ainsi que les théories en matière d'innovation et de
transmission des savoirs dans les milieux du travail29 convergent vers une idée, selon
laquelle les processus qui les englobent dépendent des dynamiques socioculturelles de
l'entreprise. Compte tenu de ce constat majeur, ces dynamiques sont identifiées en tant que
variable indépendante dans le cadre de cette recherche. En mettant de l'accent sur les
dynamiques socioculturelles dans les entreprises étudiées, nous avons cherché à voir dans
quelle mesure ces dynamiques sont décisives dans les deux dynamiques analysées dans
cette étude. Pour des raisons méthodologiques, nous avons décomposé cette variable en
deux dimensions : les dynamiques sociales et les dynamiques culturelles. Cette distinction
rend la rationalisation de la variable en question plus facile, même s'il demeure difficile, en
réalité, de dissocier le social du culturel.
L'accent mis sur les dynamiques sociales qui caractérisent les entreprises à l'étude est
justifiée par la nature même des deux processus que nous avons tenté d'examiner dans le
2 À titre d'exemple on cite les recherches effectuées, par le sociologue français Norbert Alter, se rapportant à la question de l'innovation dans l'entreprise et les recherches effectuées, par les sociologues anglaises Helen Rainbird, Alison Fuller et Anne Munro portant sur l'apprentissage et la transmission des savoirs dans les milieux du travail.
95
cadre de cette thèse. Le processus de la transmission des savoirs professionnels ainsi que
celui de l'innovation comporte dans les deux cas une dimension sociale. Ils impliquent
l'ensemble de la collective du travail. De même, ils mettent en relation directe ou indirecte
les différents types d'acteurs appartenant aux diverses catégories hiérarchiques, disposant
des compétences professionnelles diversifiées et ayant des expériences variées au travail.
De ce fait, l'étude des dynamiques sociales demeure une tâche inéluctable afin d'atteindre
les objectifs fixés pour la présente recherche. La focalisation de l'attention sur cette
dimension nous a permis non seulement de découvrir les dynamiques sociales qui régissent
ainsi que celles qui influencent les processus de la transmission des savoirs professionnels
et de l'innovation, mais elle nous a permis également d'identifier les systèmes sociaux
caractérisant les entreprises artisanales tunisiennes de métiers ancestraux dans le contexte
de la globalisation.
Les résultats des recherches antérieurs et la littérature dans la matière, nous indiquent
également que la transmission des savoirs professionnels ainsi que l'innovation, l'une
indépendamment de l'autre, sont influencées directement par les dynamiques culturelles
régnantes au sein des entreprises. De ce fait, la prise en considération de ces dynamiques
s'est avérée inévitable lors de la circonscription des dynamiques régissant les deux
processus qui font l'objet principal de notre enquête empirique. Derrière la mobilisation de
cette dimension, nous avons cherché à interpréter les pratiques culturelles au sein des
entreprises artisanales de métiers ancestraux ainsi que les comportements de ses membres
dans la mesure où ces pratiques et ces comportements sont jugés comme déterminants que
ce soit dans la transmission des savoirs professionnels ou dans l'innovation.
En somme, la variable des dynamiques socioculturelles, par ses deux dimensions, est
mobilisée afin de dégager les liens existant entre elles et les dynamiques des deux
principaux processus à l'étude. De même, elle est mise en œuvre dans le but de rendre
compte des dynamiques sociales et culturelles occasionnées par ces deux processus. Ceci
est rendu possible grâce à l'observation des éléments et les sous-éléments composant ces
dynamiques. Le tableau suivant illustre au complet cette variable.
96
Tableau 6: La composition de la variable des dynamiques socioculturelles La variable Les dimensions Les éléments
observés Les sous-éléments observés
Les dynamiques socioculturelles
Les dynamiques sociales
Le système d'acteur
• Les types d'acteurs
• Les enjeux des acteurs
Les dynamiques socioculturelles
Les dynamiques sociales Le système de
relations • Les relations professionnelles
• Les relations sociales
Les dynamiques socioculturelles
Les dynamiques sociales
Le système de régulation
sociale
• Les logiques
• Les mécanismes
Les dynamiques socioculturelles
Les dynamiques culturelles
La culture de l'entreprise
• Les pratiques de convivialité • La mémoire collective • Les comportements et les attitudes
Les dynamiques socioculturelles
Les dynamiques culturelles
L'identité au travail
• Les représentations sociales de l'innovation et de la transmission
• La socialisation à la transmission et à l'innovation
Les différentes variables présentées ci-dessus constituent le modèle d'analyse et
d'observation qui nous a guidés tout au long de cette recherche. Dans un premier temps, il
nous a aidés à déterminer les hypothèses de la recherche qui nous ont guidés sur le terrain.
Dans un deuxième temps, il était utile lors de la conception de la grille d'observation et de
l'élaboration des axes de l'entretien dans l'enquête empirique. Dans un troisième temps, il
nous a servi de guide lors du dépouillement des données recueillies et de l'analyse de ces
données. La Schéma suivant illustre le modèle d'analyse et d'observation au complet.
97
Schéma 2: Le modèle d'analyse et d'observation
Organisation du travail
r Dynamiques
socioculturelles
1.2 Les hypothèses de la recherche
Afin de couvrir les divers aspects du problème de la recherche, nous avons conçu un corps
d'hypothèses, en référence aux variables à l'étude et à l'observation, qui se construit autour
d'une hypothèse principale autour de laquelle se recoupent un ensemble d'hypothèses
secondaires.
1.2.1 L'hypothèse principale
L'hypothèse conductrice de cette recherche avance que la réussite de l'entreprise artisanale
dans le contexte mondial incertain dépend de sa capacité de bien gérer les relations entre les
processus de l'innovation et de la transmission des savoirs professionnels, cependant que
l'effet de l'innovation et de la transmission sur la réussite de l'entreprise artisanale dépend
des pratiques organisationnelles, des modes de gestion des ressources humaines et des
dynamiques socioculturelles existantes dans l'entreprise. L'analyse de cette hypothèse nous
permet de constater que c'est une hypothèse de type multi-variée. Même si les différentes
98
variables qui la composent sont de nature diverse, elles sont en corrélation et nouent entre
elles de fortes relations d'interdépendance.
1.2.2 Les hypothèses secondaires
Le réseau de relations liant les différentes variables constituant l'hypothèse principale de la
recherche amène à s'intéresser aux liens qui existent entre les différentes variables
séparément. Ces liens partiels conduisent à proposer des hypothèses secondaires. Ces
hypothèses sont :
1) L'institutionnalisation des logiques de l'innovation au sein de l'entreprise artisanale
contribue à l'amélioration de sa compétitivité sur le marché, que ce soit sur le marché local
ou international.
2) L'instauration d'une politique interne, qui tient compte de la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels, des normes et des valeurs du travail
ancestraux, permet de perpétuer les métiers ancestraux.
3) La mise en œuvre d'une organisation de travail favorable, d'une politique de gestion de
ressources humaines développée et d'un climat social et culturel adéquat favorise
l'émergence et l'introduction des innovations dans le travail, facilite la transmission de la
culture du travail et permet de concilier entre le processus d'innovation et celui de la
transmission des savoirs professionnels.
2. La stratégie de la recherche
Après avoir présenté les différentes composantes du modèle d'analyse et d'observation,
nous présentons dans ce qui suit les composantes de la démarche méthodologique. Il s'agit
d'exposer les éléments constitutifs du cadre méthodologique de la recherche : la méthode
de l'étude, les techniques de collecte de données et la méthode d'analyse.
2.1 La méthode de la recherche : la méthode qualitative
Cette étude vise, rappelons-le, le développement d'une compréhension sociologique des
processus de l'innovation et de la transmission intergénérationnelle des savoirs
professionnels au sein des entreprises artisanales de métiers ancestraux. Compte tenu de la
nature interactive de ces deux processus et de leur dépendance tant des facteurs humains
99
que des facteurs matériels, la réalisation de cet objectif nécessite donc de mettre l'accent
sur les interactions interpersonnelles et intergroupes qui les structurent ainsi que sur les
circonstances dans lesquelles elles se produisent. D'une part, ceci passe inévitablement,
comme nous l'enseigne le paradigme de l'interactionnisme symbolique retenu dans le cadre
de cette recherche, par le dégagement du sens que donnent les acteurs impliqués dans ces
deux processus à leurs actions afin de comprendre ces interactions. D'autre part, il est
nécessaire d'étudier ces processus dans leur milieu habituel d'évolution afin de comprendre
les logiques et les mécanismes qui structurent leurs fonctionnements.
Ainsi, la compréhension des processus de l'innovation et de la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels au sein des entreprises artisanales de métiers
ancestraux ne peut se faire qu'à travers l'analyse des propos et des expériences personnelles
et collectives des acteurs impliqués dans ces entreprises ainsi que par le biais de l'analyse
de leur vécu quotidien dans le travail. En termes méthodologiques, cela se traduit par le
questionnement des participants sur les finalités de leurs actions, les significations qu'ils
donnent à leurs comportements et les liens qu'ils entretiennent avec leurs environnements.
Il se traduit également par l'observation de ces actions au moment de leur production. Ceci
dit, les données nécessaires à cette compréhension ont pour principales sources les acteurs
impliqués directement ou indirectement dans les deux processus en question ainsi que les
données générées par leur milieu d'évolution. Autrement dit, les données à la base de cette
compréhension sont fortement ancrées dans la réalité étudiée. Avec une telle orientation
méthodologique, la démarche de cette étude est par excellence une démarche inductive.
Étant donné que l'objectif de cette recherche est la compréhension et non pas l'explication,
le parti pris du départ est de collecter des données purement qualitatives permettant de
comprendre de l'intérieur les deux processus qui ont fait l'objet de notre investigation.
Compte tenu des différents éléments cités ci-dessus, cette recherche s'inscrit donc dans la
tradition des recherches qualitatives. D'ailleurs, cette méthode de recherche est préconisée
par la démarche sociologique de type comprehensive que nous avons adoptés dans cette
thèse.
100
2.2 Les techniques de collecte de données : l'entrevue semi-dirigée et
l'observation directe
Suivant les objectifs de la recherche et les exigences de la méthode adoptée, deux
techniques de collectes de données ont été mise en œuvre. Concrètement, les données à la
base de notre analyse des processus de l'innovation et de la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels au sein des entreprises artisanales
tunisiennes de métiers ancestraux proviennent des entrevues individuelles semi-dirigées et
de l'observation directe des situations concrètes de travail dans les unités étudiées.
Au sujet de la première source de données, nous avons effectué 47 entrevues semi-dirigées
auprès des personnes évoluant dans des entreprises artisanales de métiers ancestraux ainsi
qu'auprès des personnes agissant dans des institutions étatiques se préoccupant de ce
secteur d'entreprises et qui sont considérées comme des experts dans les métiers étudiés. Le
choix d'approcher ces derniers est dû principalement au rôle important que joue ces
institutions dans la promotion de ces entreprises dans le contexte de la globalisation en
Tunisie. Les entrevues effectuées se repartissent comme suit : 41 entrevues auprès des
personnes évoluant au sein des entreprises et 6 entrevues auprès des personnes agissant
dans les institutions encadrant ces entreprises. Dans les deux cas, l'innovation et la
transmission des savoirs professionnels ont constitué les deux principaux axes autour
desquels se recoupent les questions constitutives des entrevues. Néanmoins, les entrevues
diffèrent d'une catégorie de personnes à une autre. Pour les entrevues effectuées auprès des
personnes évoluant au sein des entreprises, elles ont été axées sur la compréhension des
expériences vécues par ces personnes et qui sont en lien direct avec les processus objet de
notre analyse. Pour les entrevues effectuées auprès des personnes agissant dans les
institutions encadrant ces entreprises, elles ont été axées sur la compréhension de l'intérêt
accordée par ces institutions à ces deux processus dans la stratégie, visant à la fois la
conservation des caractéristiques de ces entreprises et leur réinsertion dans les dynamiques
économiques du pays.
En ce qui concerne les thèmes couverts lors des entrevues auprès des personnes agissent au
sein des unités étudiées, ils portaient sur les différents éléments en liaison avec le vécu
101
professionnel du répondant au sein de l'entreprise. Ceci est dû au fait que l'innovation et la
transmission des savoirs professionnels au sein des entreprises artisanales de métiers
ancestraux sont indissociables des expériences professionnelles des individus, L'annexe 9
présente la grille ayant servi de base à ces entrevues. Les questions n'ont pas été
systématiquement posées à toutes les personnes soumises à l'entrevue. Plusieurs facteurs
ont déterminé le déroulement de l'entrevue avec le répondant : son âge, son ancienneté
dans le métier, sa position dans l'entreprise. La grille étant utilisée comme outil de base
pour les entrevues, d'autres sous-questions ont été posées afin d'approfondir un élément qui
est porté à notre connaissance lors du contact avec le répondant.
À l'égard des thèmes couverts lors des entrevues auprès des personnes agissant dans les
institutions qui s'occupent du secteur des entreprises artisanales de métiers ancestraux en
Tunisie, ils portaient sur la réalité actuelle des métiers étudiés ainsi que sur les stratégies
mises en œuvre par ces institutions pour promouvoir cette catégorie d'entreprise,
notamment sur la place qu'occupent les processus de l'innovation et de la transmission des
savoirs professionnels dans ces stratégies. Ceci est expliqué par le rôle important de ces
deux processus dans cette promotion. L'annexe 10 présente le guide de ces entrevues.
Au sujet de la deuxième source de données, des observations directes des situations
concrètes de la production ont été effectuées au sein des unités étudiées. Deux raisons
justifient la mobilisation de cette technique de collecte de données. D'une part, les deux
processus objet de notre investigation sont indissociables de ces situations. Donc, il était
important d'observer les individus dans leurs exercices professionnels. Une telle
observation nous a permis non seulement de dégager les différentes dynamiques relatives à
l'innovation et à la transmission des savoirs professionnels, mais aussi de dégager les
caractéristiques organisationnelles, managériales, sociales et culturelles des entreprises
artisanales de métiers ancestraux. D'autre part, l'objectif de cette étude vise la
compréhension des processus de l'innovation et de la transmission des savoirs
professionnel et non pas l'explication de ces deux phénomènes. Donc, l'observation directe
des participants à ces deux processus demeure une nécessité dans le cadre de cette étude
dans la mesure où cette technique permet la compréhension de l'intérieur des phénomènes à
l'étude (Hughes, 1996).
102
Afin de mener à bien notre observation, une grille a été mise en œuvre pour collecter les
informations nécessaires à la compréhension des processus de l'innovation et de la
transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels. La construction de cette grille
a été faite en référence au modèle d'analyse conçue pour cette étude. Étant donné que les
deux processus étudiés dépendent étroitement des différentes dimensions de l'entreprise,
les thèmes couverts par cette grille ne se limitent pas aux dynamiques relatives à ces deux
processus. Elle contient aussi des thèmes qui se rapportent aux dimensions principales de
l'entreprise qui influencent les deux processus en question. L'annexe 11 présente
l'intégralité de cette grille.
En couvrant des thèmes diversifiés, la grille d'observation nous a permis de collecter une
panoplie d'informations relatives aux processus de l'innovation et de la transmission des
savoirs professionnels ainsi qu'aux unités étudiées. Ceci nous a permis d'élaborer une mini
monographie pour chacun des cas étudiés. Il est à noter que ces mini monographies ne sont
pas élaborées en se basant uniquement sur les informations cueillies via l'observation
directe des situations concrètes du travail. Aussi, les données cueillies auprès des
personnes évoluant au sein des entreprises étudiées ont été mise en œuvre lors de cette
élaboration. Ce faisant, les deux techniques de collecte de données mobilisées dans cette
recherche, l'entrevue semi-dirigée et l'observation directe des situations concrètes du
travail, se complètent entre elles pour fournir les données nécessaires à l'analyse.
2.3 La technique d'analyse des données : la méthode ancrée
En conformité avec la perspective interactionniste comprehensive de cette étude, le principe
de l'induction analytique a été retenu pour analyser les données recueillies. Ce principe, qui
cherche à fournir une compréhension globale du phénomène étudié (Emerson, 1997),
exprime avant tout l'enracinement de cette compréhension dans le terrain. Ce faisant, les
analyses avancées dans cette thèse sont fortement ancrées dans les données issues du travail
empirique. Ceci est rendu possible grâce à la mobilisation de la méthode ancrée lors de
l'étape de l'analyse de données. Cette méthode, qui a été élaborée vers la fin des années
1960 par Bamey Glaser et Anslem Strauss, propose aux chercheurs en sciences sociales,
notamment à ceux qui empruntent le cadre interactionniste et la sociologie comprehensive
103
comme support théorique, une démarche composée de plusieurs étapes afin de découvrir et
de comprendre de l'intérieur les dynamiques et les logiques qui structurent les phénomènes
étudiés. En adoptant une telle démarche, notre recherche se situe ainsi davantage dans une
perspective de découverte que de vérification.
Concrètement, l'analyse de données avec la méthode ancrée exige tout d'abord de
classifier les données collectées (Strauss et Corbin, 2004). La fonction de cette action est
de préciser les unités de base du travail d'analyse. Ces unités sont le résultat de la réduction
des informations obtenues sur le terrain en catégories conceptuelles favorisant l'analyse et
l'interprétation. Autrement-dit, la classification des données consiste à catégoriser les
informations collectées sous des thèmes centraux afin de les utiliser lors de d'analyse. Il
s'agit, donc d'une opération permettant de repérer, d'organiser, d'hiérarchiser et
d'examiner l'ensemble des thèmes évoqués dans les textes d'entrevues et dans les notes
d'observation (Miles et Huberman, 2003). Anslem Strauss et Juliet Corbin précisent, dans
l'ouvrage dédié à la présentation de la méthode ancrée d'analyse de données, que la
réduction de la quantité énorme des informations collectées en un nombre restreint de
catégories analytiques nécessite un travail minutieux de la part du chercheur (Strauss et
Corbin, 2004). En suivant, les prescriptions de Glaser et Strauss, les deux fondateurs de la
méthode ancrée d'analyse de données, nous avons traité les données issues de l'étude
empirique en deux étapes :
1) Lors de la première étape, les catégories centrales et les sous catégories d'analyses
ont été dévoilées à travers une lecture attentive des données recueillies. Il est à noter que
toutes les entrevues et les notes d'observation ont été transcrites. Ceci nous a permis de
déconstruire les données en parties distinctes, de les examiner et de les comparés selon
leurs similitudes et leurs différences. L'ensemble de ces activités a permis de déterminer les
propriétés et les dimensions des catégories d'analyse ainsi que de celles de leurs sous
catégories.
2) Lors de la deuxième étape, les catégories centrales d'analyse ont été mises en rapport
avec leurs sous-catégories. Ceci nous a permis de formuler une compréhension plus
complète et plus précise des processus de l'innovation et de la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels.
104
Ces deux opérations, qui ont eu pour but la réduction des données recueillies en les
synthétisant et les systématisant, ont constitué la phase initiale de l'analyse. À l'issue de
cette phase nous avons élaboré une mini monographie pour chacun des cas étudiés. Ces
mini monographies, qui contiennent le concentré des informations recueillies, ont été donc
à la base de l'analyse finale.
3. Le travail du terrain
Après avoir déterminé les différentes .composantes du modèle d'analyse et d'observation
ainsi que celles du cadre méthodologique (la stratégie de la recherche) mobilisées pour
mettre en œuvre ce modèle, nous présentons la concrétisation de cette stratégie sur le
terrain. Il s'agit à présent d'exposer les bases sur lesquelles ont été sélectionnées les unités
étudiées et le déroulement de l'étude empirique.
3.1 L'échantillonnage
Tel qu'il est expliqué dans la problématique, la population visée par cette étude concerne
les entreprises artisanales tunisiennes qui pratiquent des métiers hérités du passé.
L'échantillon retenu est choisi en suivant une démarche raisonnée. Cette méthode
d'échantillonnage est mobilisée afin d'assurer une certaine représentativité de cette
population dans l'échantillon en question. Néanmoins, cet échantillon est loin d'être
représentatif quantitativement. Il est plutôt un échantillon théorique qui est constitué en
fonction des objectifs et des hypothèses de la recherche. Ce mode d'échantillonnage, qui
est fortement recommandé par les partisans de l'approche interactionniste, est mobilisé afin
de favoriser la compréhension des deux processus objets de l'étude : l'innovation et la
transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels.
La sélection des unités étudiées était basée sur les résultats d'une une pré-enquête
personnelle qui a eu lieu en été 2007. Ces résultats, qui découlent d'une analyse
documentaire ainsi que du contact direct avec le terrain et les différents acteurs intervenant
dans le secteur des entreprises artisanales de métiers ancestraux, nous ont permis de
distinguer 10 domaines de ce type de métier en Tunisie. Ces domaines sont répartis selon
la matière première utilisée dans la fabrication. Chacun de ces domaines regroupe un
105
ensemble d'activités. L'annexe 12 présente ces domaines de métiers ainsi que les activités
qui les regroupent. De la pré-enquête ressort deux principaux constats :
1) Les activités ancestrales en Tunisie connaissent deux situations économiques
distinctes : des activités en pleine prospérité et d'autres en pleine crise.
2) Les activités artisanales en Tunisie sont pratiquées dans deux types différents
d'entreprises : des entreprises domestiques et d'autres non domestiques. Le premier type
symbolise l'ancienne génération des unités productives pratiquant ce genre d'activités alors
que le deuxième type représente une nouvelle génération exerçant ces mêmes activités.
Compte tenu de ces deux constats, l'échantillon à l'étude a été composé de quatre unités:
deux unités appartenant à un métier en prospérité et deux autres à un métier en crise
économique. Le choix de ces unités a été fait en se basant sur les statistiques de l'Office
National de l'Artisanat (ONA), sur les résultats de la pré-enquête et sur les orientations des
responsables agissant dans cet organisme, notamment les responsables des délégations
régionales où l'enquête empirique a eu lieu. Ces derniers nous ont fourni une liste
composée de cinq entreprises considérées comme des références dans la région étudiée.
Pour couvrir les deux types d'entreprises structurant le secteur des métiers ancestraux en
Tunisie, nous avons choisi dans cette liste une entreprise domestique et une autre non
domestique. Dans le cas de l'entreprise non domestique, le critère du choix était
l'ancienneté. Dans le cas de l'entreprise non domestique, le critère du choix était le chiffre
d'affaire. Lors de la sélection, nous avons choisi l'entreprise la plus ancienne et
l'entreprise réalisant le premier chiffre d'affaire dans la région à laquelle appartient le
métier étudié. La répartition en détails de cet échantillon est exposée au début de la partie
qui sera consacrée à la présentation et à la description des résultats de l'enquête empirique.
3.2 Les modalités du travail sur terrain
L'enquête empirique effective relative à cette étude, qui a eu lieu au début de l'année 2009,
s'est étendue sur une période de quatre mois. Ceci dit, la période consacrée à chaque unité
étudiée est d'un mois. Le calendrier suivant décrit le déroulement de cette enquête :
106
Les deux premiers mois : métier A
Mois 1 : entreprise domestique
Mois 2 : entreprise non domestique
Les troisième et quatrième mois : métier B
Mois 3: entreprise domestique
Mois 4 : entreprise non domestique
Le mois passé dans chacune des quarte unités nous a permis d'observer les individus dans
les situations concrètes de production et pendant les temps de pause. De même, il nous a
permis d'interviewer l'ensemble de son effectif à l'exception de l'entreprise 4 vu le nombre
assez élevé de ses membres comparativement aux trois autres entreprises. Dans cette
entreprise 10 entrevues ont été menées. La sélection des participants s'est basée sur un seul
critère : l'ancienneté dans l'entreprise. Les 10 répondants se répartissent comme suit : 5
participants d'une ancienneté de moins d'un an et 5 participants d'une ancienneté de plus
d'un an. Dans les quatre unités étudiées, les interviews ont eu lieu pendant les temps de
pause. La durée moyenne d'une entrevue est d'une heure et demie.
Dans cette première partie, nous avons présenté les différents cadres de la recherche : la
problématique, le cadre spatio-temporel, le cadre conceptuel et théorique et le cadre
méthodologique. Dans la partie suivante, nous présenterons et nous décrierons les résultats
issus de l'enquête empirique.
107
Partie 2 : Présentation et description des résultats
Innovation et transmission des savoirs professionnels à l'épreuve des métiers
Après avoir cerné dans la première partie les différents cadres de la recherche, cette
deuxième partie se consacre à la description et à la présentation des résultats obtenus à
l'issue de l'étude empirique. Compte tenu de l'objectif principal de la recherche, soit la
compréhension des dynamiques d'innovation et celles de la transmission des savoirs
professionnels dans les milieux de travail artisanaux tunisiens de métiers ancestraux, cette
partie expose l'état des lieux de l'innovation et de la transmission des savoirs
professionnels au sein des quatre entreprises qui ont fait l'objet de notre étude.
Précisément, il s'agit de rendre compte :
1) Des innovations qu'ont connues ces entreprises dans le contexte actuel de la
globalisation;
2) De la question de la transmission des savoirs professionnels au sein de ces mêmes
entreprises.
Étant donné que notre recherche a porté sur deux métiers artisanaux ancestraux, la poterie
artisanale (A) et le tapis du sol (B), cette partie est structurée en deux chapitres. Chaque
chapitre débute par la présentation générale du métier qui constitue son objet. Cette
présentation s'appuie sur les données recueillies auprès de l'Office National de l'Artisanat
et de ses délégations régionales, ainsi que sur les données collectées dans les unités
étudiées. Il met l'accent principalement sur la réalité du métier dans la région
d'appartenance de ces unités. Suit la présentation de l'état des lieux de l'innovation et de la
transmission des savoirs professionnels dans ces entreprises. Vu que les entreprises, qui
représentent chaque métier, ne sont pas de même type, soit une de type domestique et une
de type non domestique, les situations dans chacune de ces entreprises sont présentées
séparément. Ce faisant, chacun des deux chapitres, composant la présente partie comprend
trois éléments : des informations générales sur le métier et les résultats de l'enquête dans
chacune des deux entreprises qui ont fait l'objet de notre investigation.
Afin d'éviter les répétitions dans la partie ultérieure, qui sera consacrée à l'analyse et
l'interprétation des résultats, les deux métiers sont désignés dans le texte par les lettres A et
B et les entreprises par les chiffres let 2. Plus précisément, les lettres A et B désignent
successivement les métiers de la poterie artisanale et du tapis de sol, et les chiffres 1 et 2
109
désignent successivement les entreprises de nature domestique et de nature non
domestique. Nos cas à l'étude se répartissent comme suit :
Tableau 7 : Répartition des entreprises étudiées 1 (entreprise domestique) 2 (entreprise non domestique)
A (poterie artisanale) A l A2
B (tapis de sol) B 1 B2
110
Chapitre 5. Le cas de la poterie artisanale (A)
La production artisanale de la poterie constitue un modèle de la réussite de l'artisanat
tunisien dans le contexte de la globalisation. Cette activité, qui remonte à des époques
historiques très lointaines, a pris au cours des deux dernières décennies un nouvel élan.
Après avoir été en voie de disparition pendant les décennies de la crise de l'artisanat en
Tunisie des années 1950 aux années 1980 (Balfet, 1958; Sethom, 1964, Slim et Djait,
1976), elle est devenue l'une des activités productives ancestrales qui font, actuellement, le
printemps de l'artisanat tunisien. La poterie artisanale, qui est répandue sur tout le territoire
tunisien, est inscrite par l'Office National de l'Artisanat (ONA) dans le domaine des
métiers de l'argile et de la pierre. Ce domaine représente l'un des principaux exportateurs
du pays en matière des produits artisanaux. Sa contribution aux exportations, en 2009 est de
30% avec une valeur de 49 532 millions de dinars tunisiens30, soit 33 898 millions de
dollars canadien. La part de la poterie artisanale, selon les responsables de l'ONA, dans ces
exportations est la plus importante. Il est à noter que les statistiques produites par l'ONA
sont présentées par domaine de métiers31 et non pas par métier.
L'artisanat de la poterie est jugé par ces responsables comme un modèle à suivre dans la
mesure où il a réussi à remplir les différentes responsabilités (économiques, sociales et
culturelles) qui sont à la charge des entreprises de métiers artisanaux dans le contexte
actuel. De ce fait, les entreprises de la poterie artisanale semblent être propices pour
comprendre les deux dynamiques qui ont fait l'objet de notre étude : l'innovation et la
transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels. Pour ce faire, nous avons
étudié deux entreprises de la ville de Moknine constituant l'un des principaux pôles de la
poterie artisanale du pays32. L'annexe 13 présente la répartition géographique de ces pôles.
3U Site officiel de l'ONA, http://www.onat.nat.tn/site/fr/article.php?id_article=1002, consulté le 04/06/2010. 31 En Tunisie, les métiers ancestraux sont regroupés, par l'Office National de l'Artisanat, sous des domaines de métiers. Chacun de ses domaines englobe des métiers qui partagent en commun, en général, la matière première utilisée dans la production.
2 En Tunisie, on dénombre dix centres de production artisanale de la poterie. Ces centres produisent plusieurs variétés locales de poterie et forment six écoles indépendantes. Chacune de ces écoles se caractérise par des produits et des techniques de production particulières.
111
1. La poterie artisanale de Moknine : la ville et le métier
1.1 La ville de Moknine : aperçu général
Moknine est située au centre du Sahel oriental de la Tunisie à 180 km de la capitale Tunis.
Elle constitue une commune attachée administrativement au gouvernement de Monastir.
La ville s'étend sur une zone urbaine de 163.9 Km2. Elle comptait, selon le dernier
recensement de la population en Tunisie en 2004, 48 389 habitants33. La carte suivante
localise géographiquement cette ville.
Carte 1: Ville de Moknine
Mahdia ^ V _ ^ _ _ \
Les origines de Moknine remontent à des époques très anciennes. Elle a été habituée
depuis longtemps et elle a connu le passage de plusieurs civilisations. Chronologiquement,
cette ville a connu le passage des Phéniciens, puis des Puniques, puis des Romains enfin
des Arabes musulmans. Selon sa dénomination actuelle qui provient du terme berbère "
Makna" qui signifie colline, les habitants de cette ville sont d'origine berbère. Les
différentes civilisations qui ont passé ont imprégné fortement l'histoire et même le présent
de cette ville. La poterie traditionnelle reste un véritable témoignage de cette réalité. Cette
activité, ancrée dans l'histoire très lointaine cette ville, constitue aujourd'hui l'emblème
33 Institut National de Statistique- Tunisie : http://www.ins.nat.tn/indexfr.php, consulté le 07/06/2010.
112
de Moknine. Elle est le symbole de son identité historique et artistique. Au-delà de sa
dimension symbolique, la poterie artisanale joue, actuellement un rôle important dans
l'économie locale. Elle constitue une source principale de création de richesse et
d'emplois. Pour témoigner de la centralité et de l'importance de cette activité, une
colossale œuvre de poterie artisanale, comme l'indique la prochaine photographie, est
installée au centre de la ville.
Photographie 1 : Centre ville de Mokenine
1.2 La poterie de Moknine : aperçu général
L'artisanat de la poterie à Moknine, comme partout en Tunisie et dans le monde, remonte à
des époques historiques lointaines. Les fouilles archéologiques montrent que la naissance
de cette pratique dans cette ville date depuis la plus haute antiquité. La richesse de la région
en argile34de bonne qualité a constitué le facteur principal qui a favorisé l'instauration de
Moknine parmi les principaux centres de la production de la poterie artisanale dans le pays.
Ce centre potier se distingue par la nature de ses produits et les techniques de la production.
Il représente le premier site potier en terre cuite (Kharraz, 2007). La terre cuite, constituant
34 L'argile, qui constitue la matière première des œuvres de la poterie, existe dans la nature sous forme de roche sédimentaire d'aspect terreux, friable, tendre, à grain très fin. Elle se trouve souvent proche de la surface du sol, et se répartit un peu partout sur le globe, surtout, où est pratiquée l'agriculture à laquelle elle communique le pouvoir de conserver un certain degré d'humidité, et lui fournit de la potasse et de la soude.
113
une des quatre grandes familles des produits en argile35, est un matériau céramique résultant
de la cuisson de l'argile.
En général, on distingue deux types de poterie de la terre cuite : la poterie tendre et la
poterie dure. La différence entre ces deux poteries réside au niveau de la dureté de tesson,
la technique de modulation et la méthode de cuisson. Pour ce qui est de la poterie de la ville
de Moknine, elle appartient à la catégorie de la poterie dure. Les produits de ce type de
poterie se distinguent des produits de la poterie tendre par leur dureté, l'usage d'un tour36
dans leur modélisation et l'usage d'un four dans leur cuisson. Les observations directes
des situations de production et les entretiens avec les artisans potiers montrent que la
fabrication des produits potier passe par trois phases qui font appel à un ensemble de
savoirs et de techniques. L'encadré 1 décrit ces différentes phases.
35 Les quatre grandes familles des produits fabriqués en argile sont : la terre cuite, la faïence, le grès cérame et la porcelaine. 36 Le tour constitue l'outil principal permettant à l'artisan potier de transformer l'argile en œuvre. Dans sa version traditionnelle, le tour est composé d'un support sur lequel est fixé un axe vertical comprenant à chacune de ses deux extrémités un plateau. Sur le plateau du dessus, appelé girelle, l'artisan pose sa motte d'argile pour la transformer en objet. Tandis que le plateau de dessous est utilisé par l'artisan pour faire tourner sa tour. 37 Dans la cuisson de leurs produits, les potiers de Moknine utilisent jusqu'à maintenant le four traditionnel. Comme combustibles de chauffage, ces potiers usent le bois dans un premier temps. Puis il l'alimente par les grignons d'olive pour augmenter sa température. Les différentes matières utilisées dans le chauffage du four, les fagots et les bûches de bois et les grignons, ont pour origine les oliviers qui sont de nombre assez important dans la région du sahel tunisien.
114
Encadré 1 : les phases de la fabrication
Phase 1 : la préparation de la pâte d'argile
Cette phase se déroule en trois étapes. Au début, les blocs d'argile sont exposés dans une cour non couverte afin de les sécher. Dans cette étape, on n'assiste à aucune intervention humaine. Ce sont les effets du soleil et du vent qui sèchent l'argile brute. Ensuite, l'argile est broyée, par des ouvriers spécialisés, afin de le transformer en pâte homogène. Lors de cette étape, l'argile est transformée en petits morceaux, puis elle est plongée dans un bassin d'eau pour la fermenter pendant à peu près deux jours et en fin elle est épurée des différents types de déchets. À la fin de cette première phase, l'opération la plus délicate dans la préparation de la pâte de l'argile aura lieu. Cette opération, appelée pétrissage, consiste à mélanger l'argile, disparaître les bulles d'air et découper l'argile en mottes égales qui seront stockées dans une chambre froide jusqu'à l'utilisation. Lors de cette opération, l'argile est enrichie par un sable très fin pour la dégraisser et par une quantité bien déterminée du sel afin d'avoir des produits de couleur blanche qui représentent l'une des spécificités de la poterie de Moknine.
Phase 2 : le Tournage ou le façonnage
Ayant en main une motte d'argile traitée, l'artisan potier débute officiellement la fabrication de son œuvre. Il commence par placer l'argile sur la partie centrale de son tour. Puis il l'ouvre en forme de couronne. En suite, il procède au façonnage de son œuvre. Dans cette opération, le potier guide la motte d'argile avec ces mains qui les trempent régulièrement dans l'eau et contrôle la rotation du tour afin de donner à l'objet la forme voulue. En terminant son objet, le potier le sépare de la motte d'argile en utilisant un fil. Les objets réalisés sont séchés dans un espace couvert afin de les faire débarrasser de l'humidité et faire évacuer l'eau contenue dans l'argile.
Phase 3 : La cuisson
Cette phase, qui consiste à faire cuire les œuvres en argile, est souvent l'affaire des ouvriers spécialisés. Cette phase se déroule en deux étapes. Dans un premier temps, les ouvriers, qui sont souvent en nombre de deux, stockent les pièces crues sèches dans le four. Lors du remplissage (appelé aussi enfournement) les ouvriers suivent une technique spéciale favorisant la répartition égale de la chaleur et permettant de diminuer la cassure des objets. Dans un deuxième temps, les ouvriers chauffent le four ; c'est ainsi que commence la cuisson. La durée de cette opération varie en fonction de la grandeur des œuvres à cuire.
Au sujet des objets en argile fabriqués dans la ville de Moknine, on peut différencier, selon
l'usage, entre deux catégories principales. La première, regroupe des objets destinés à
l'usage dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, cette ville était renommée pour la
fabrication des vaisselles, des ustensiles de ménage et des contenants nécessaires à la vie
quotidienne de la société locale et de ses environs (Sethom, 1964). Les ouvres, constituant
115
cette catégorie, sont souvent conçues en rapport avec les besoins spécifiques de la société
et les exigences de l'époque historique. Pour ce qui est de la deuxième catégorie d'œuvres
en argile produites à Moknine, elle regroupe les objets destinés à la décoration des jardins
et de l'extérieur des maisons. Ainsi, Moknine constitue aussi un centre potier à vocation
décoratif et horticole (Kharraz 2007). Cette gamme de produits, relativement récente, est
destinée à une clientèle internationale qui ne cesse de croître ces dernières années. Ceci
nous amène à nous interroger sur la réalité actuelle du secteur de la poterie artisanale à
Moknine.
1.3 La poterie de Moknine aujourd'hui
Une recherche récente38, effectuée sous la tutelle de l'ONA, montre que la ville de Moknine
est en train de détrôner la ville de Nabeul, qui représente actuellement le premier centre
potier de la Tunisie, pour devenir en 2020 la première ville tunisienne en poterie (Kharraz,
2007). Si on remonte dans l'histoire, la situation était totalement différente. Comme le
soulignait à l'époque Sethom : « La place de Moknine dans l'artisanat de la poterie en
Tunisie est modeste : Moknine vient très loin derrière Nabeul» (Sethom 1964 : 53). La
prospérité actuelle de cette activité, qui a été considérée dans un temps très proche comme
un simple patrimoine historique qu'il fallait le conserver, est due principalement à
l'évolution considérable des exportations. Selon les statistiques de la délégation régionale
de l'artisanat, 90 % de ces exportations sont destinées au marché européen.
Ainsi, la poterie artisanale de Moknine a bien profité de l'ouverture de l'économie
tunisienne sur l'extérieur. En 2007, la valeur des exportations de cette ville, en matière de
poterie artisanale, s'élève à 2,5 millions de dinars tunisiens39. Cependant, la délégation de
l'artisanat à Monastir estime que la valeur des exportations dépasse largement ce chiffre.
Dans cette estimation les responsables de cette délégation se basent sur deux faits : 1) une
partie importante des exportations ne sont pas déclarées par les artisans potiers et 2) une
La recherche est intitulée « Étude sur les activités artisanales de céramique en Tunisie». Elle a été réalisé, au cours des années 2006 et 2007, par M. Azouz Kharraz, un expert consultant en céramique. Cette recherche, commandée par l'Office National de l'Artisanat, avait pour principal but de délimiter les activités artisanales de la céramique en Tunisie dans les régions communément connues pour être des centres de production artisanale de la céramique. 39 Source : Statistiques de la délégation régionale de l'artisanat à Monastir.
116
autre partie qui ne manque pas aussi d'importance est exportée à travers d'autres ville,
principalement à travers la ville de Nabeul, où le nombre des conteneurs exportés est le
double. Néanmoins, le marché local constitue également une source d'épanouissement que
connaissent, de nos jours, les potiers de Moknine. Ces derniers, en se basant sur un savoir-
faire original et authentique, ont pu développer leurs articles pour qu'ils soient utiles dans
la vie domestique des consommateurs locaux des temps modernes.
La prospérité exceptionnelle du secteur de la poterie artisanale a entraîné une nouvelle
dynamique économique dans la région, surtout après la fermeture de plusieurs entreprises
étrangères de textile employant auparavant une masse importante des jeunes de la région.
Ces derniers ont trouvé dans la poterie artisanale la source alternative pour gagner leur vie.
Certains d'entre eux ont décidé d'apprendre les secrets du métier de leurs ancêtres et
d'autres ont pris l'initiative de mettre en place des projets en lien avec la production de la
poterie artisanale, telle que l'exportation et le transport. Ceci a contribué à une évolution
considérable de la population active dans le secteur de la poterie artisanale. Afin d'appuyer
ce mouvement de retour massif à ce métier traditionnel, qui a connu une dégradation
phénoménale à partir des années 1960 et jusqu'à la fin des années 1980 (Sethom 1969), les
autorités locales ont lancé plusieurs programmes en faveur de l'artisanat de la poterie. Sans
aucun doute, l'aménagement d'une zone d'artisanat dans cette ville reste le projet le plus
intéressant. En créant cette zone, l'état a visé d'éloigner les entreprises de la poterie de la
zone urbaine et de les regrouper dans une seule zone bien équipée permettant leur
expansion. Il est à noter qu'auparavant et même aujourd'hui, ces entreprises sont
éparpillées partout dans la ville.
L'ensemble des mesures entreprises en faveur de l'artisanat de la poterie a contribué
principalement à une augmentation remarquable du nombre d'unités productives. Ces
unités, qui ne dépassaient pas la quarantaine au début des années 2000, en comptent
actuellement plus d'une centaine40. Notre pré-enquête nous a permis de distinguer, comme
dans l'autre secteur étudié, deux types d'entreprise : des entreprises domestiques et
d'autres non-domestiques. De chacun de ces deux types, nous avons étudié une entreprise
dans la ville de Moknine afin de rendre compte des deux dynamiques qui ont fait l'objet
40 Source : Statistiques de la délégation régionale de l'artisanat à Monastir.
117
principal de notre étude ainsi que des caractéristiques de l'entreprise artisanale dans le
contexte actuel.
118
2. L'entreprise Al : l'entreprise domestique
La première entreprise étudiée du secteur de la poterie artisanale est la propriété de la
personne qualifiée comme la référence principale du métier dans la ville de Moknine. Tous
ceux qui ont participé à notre enquête le considèrent comme le symbole du métier dans
cette ville. Ce maître artisan, reconnu par son ancienneté dans le métier et ses efforts dans
le développement et la rénovation de la poterie traditionnelle, est considéré également
comme un témoin des différentes époques qu'a connu la poterie artisanale dans la ville de
Moknine. Il a vécu tous les changements et les événements qui ont marqué ce métier tout
au long du vingtième siècle. Malgré ses 73 ans, dont 68 ans dans le métier, il n'a pas
encore quitté son tour de potier. Il continue jusqu'à nos jours à produire et à diriger un
atelier de production. Cet atelier est considéré comme l'une des entreprises de poterie
artisanale les plus anciennes dans la ville en question.
2.1 Profil de l'entreprise Al : l'organisation, la gestion des ressources
humaines et les dynamiques socioculturelles
Cette entreprise a constitué pour nous un milieu adéquat pour repérer les pratiques et les
dynamiques les plus élémentaires de la production de la poterie artisanale à Moknine en
particulier et en Tunisie en général. Cette entreprise, qui date de plus d'un siècle est demie,
est un héritage familial de trois générations qui s'est transmis de père en fils. Dans son état
actuel, comme l'a indiqué son propriétaire, elle n'a pas perdu beaucoup de ses linéaments
d'origine tant dans l'organisation du travail et la gestion du personnel que dans les
dynamiques socioculturelles du travail. Elle a gardé son statut d'entreprise familiale et son
identité artisanale. Elle est constituée des membres de la famille restreinte du maître
artisan : sa femme, ses fils, ses filles, les belles filles, les gendres et ses petits enfants. Sa
structure est très simple, voir indissociable de la structure de la famille. D'ailleurs,
l'entreprise en question est contiguë à la maison du maître ou plus exactement elle fait
corps avec cette maison. Elle se trouve en plein centre urbain pour constituer à la fois un
milieu de production et d'exposition.
119
L'effectif permanent du travail dans cette entreprise est de neuf personnes auxquelles
s'ajoutent cinq autres dans le cas où la production exige leur participation. Ces derniers, qui
occupent des emplois externes, viennent en aide à leur famille pendant les fins de semaines
et les vacances. Ce faisant, tous les membres de la famille sont impliqués dans la
production. Ceci signifie qu'ils disposent tous des compétences nécessaires pour pratiquer
le métier du potier. Ce sont des compétences que les membres de cette famille ont acquis
depuis leurs jeunes âges.
Mes quatre enfants, relate le maître artisan, ont appris de moi le métier. Seulement deux d'entre eux m'accompagnent d'une façon permanente dans l'entreprise et les deux autres ont poursuivi leurs études pour occuper respectivement les postes d'un professeur au secondaire et un ingénieur dans une entreprise. Ces derniers en cas de besoin ne tardent pas à venir à notre aide pendant leur temps libre.
De ce fait, le métier constitue un élément fédérateur qui réunit tous les membres de la
famille autour d'un projet économique commun. Une telle situation exprime avant tout que
l'économique est au cœur du vécu familial. Ceci amène à s'interroger sur la façon par
laquelle le travail est organisé dans un enchevêtrement si spécifique.
2.1.1 L'organisation du travail dans l'entreprise Al
Les observations directes des situations concrètes de la production dans cette entreprise
conduisent à conclure que l'organisation du travail se caractérise par la simplicité et la
flexibilité. Un tel constat est justifié par les trois points suivants :
1) L'absence d'une division spatiale et formelle du travail : les différentes opérations
relatives au processus de la production, à l'exception de la cuisson, se déroulent dans la
même pièce. De plus, tous les membres de l'entreprise participent aux différentes phases de
ce processus. Ils ont tous les connaissances et les compétences leur permettant de
contribuer à la préparation de l'argile, au tournage et à la cuisson des produits. Pourtant,
l'absence d'une division formelle du travail ne signifie nullement l'absence d'une
organisation et d'une division informelle du processus de la production. L'organisation et la
division des tâches s'effectuent en fonction de la disponibilité des membres de la famille, la
120
nature de la tâche, le genre et les commandes reçues. En général, c'est le maître artisan qui
s'occupe, continuellement, de l'organisation du travail et de l'attribution des tâches.
2) La juxtaposition de la hiérarchie de l'entreprise à celle de la famille : étant donné que la
production dans cette entreprise représente une tâche indissociable des autres tâches
domestiques, il serait donc difficile de parler de catégories hiérarchiques sur des bases
professionnelles dans ce cas. Les membres de l'entreprise sont liés par des liens familiaux
et non par des liens professionnels et chacun d'eux contribue, en fonction de ses
compétences et de ses disponibilités, dans le fonctionnement de l'entreprise. Dans une telle
situation, la logique familiale prévaut sur la logique d'entreprise. De ce fait, la hiérarchie de
l'entreprise n'est que celle de la famille.
3) La centralisation de la prise de décision : le maître artisan dans cette entreprise se
présente comme le point central du pouvoir. Le cumul des statuts, du père et du patron,
légitime fortement son autorité sur les autres membres de l'entreprise. De ce fait, la
légitimité du pouvoir au sein de cette entreprise au sen wébérien, est de type traditionnel.
Ce pouvoir se manifeste principalement lors de la prise des décisions stratégiques relatives
au travail. Néanmoins, la centralisation de la prise de décision ne signifie pas que le style
de direction adopté soit de type autoritaire. Il est plutôt de type paternaliste. Le père
demande d'une façon ponctuelle les avis des membres de sa famille lors de la prise d'une
décision. Cependant, il reste le maître à bord dans l'entreprise.
Les décisions de mon père ne font jamais l'objet de contestation. Son expérience très longue dans le métier lui permet de prendre les décisions les plus efficaces. (Le fils aîné du maître artisan).
Ses expériences et ses connaissances lui permettent d'avoir une bonne vision des choses. D'ailleurs, toutes ses décisions étaient porteuses pour notre entreprise et pour le métier dans la ville de Mokenine. (Le deuxième fils du maître artisan).
On a appris de lui la sagesse, alors comment on peut ne pas approuver ses décisions. D'ailleurs, presque tous les artisans et même les responsables dans la ville viennent pour lui demander conseil. Grace à ses expériences, il est devenu la référence dans la ville. (Le gendre du maître artisan).
121
Ainsi, le maître artisan constitue l'élément capital de la structure de l'organisation de
l'entreprise Al. Dans les faits, toutes les opérations se structurent autour de ce maître. C'est
lui qui organise et gère la production. De même, il s'occupe de la gestion des relations de
l'entreprise avec ses environnements externes, notamment le marché.
À la lumière de ce qui précède, la structure de l'organisation de cette entreprise, en dépit de
sa centralisation autour du chef de l'entreprise, est de type simple. Les principaux éléments
caractérisant ce type de structure, décrit théoriquement par Henry Mintzberg (1982), sont
facilement repérés dans le présent cas : la constitution de l'entreprise d'un seul groupe de
travail organisé d'une façon informelle, l'absence d'unités organisationnelles, la division
imprécise du travail, etc.
2.1.2 La gestion des ressources humaines dans l'entreprise Al
Outre que la simplicité de sa structure organisationnelle, la présente entreprise se
caractérise aussi par la forte importance accordée à la dimension humaine du travail. Un tel
constat est issu de l'analyse des expériences et des parcours professionnels des membres de
cette entreprise. Cette analyse nous montre que cette dimension constitue l'une des priorités
du chef (le maître artisan) de cette unité de production. Malgré qu'il n'ait poursuivi aucune
formation en matière de gestion de personnel et d'entreprise, ce dernier témoigne d'une
forte conscience du rôle important que joue la gestion des effectifs au travail dans la
détermination du sort de l'entreprise.
f...] C'est vrai que mon statut de père me donne une autorité sur tous ceux qui travaillent avec moi, mais ceci ne garantit pas toute seule la réussite de notre entreprise. Pour réussir, chaque membre doit être satisfait et motivé. La satisfaction et la motivation nécessitent que les efforts de chaque individu soient reconnus et que le groupe du travail soit solidaire. (Le chef d'entreprise)
En adoptant une méthode de gestion de ressources humaines de type paternaliste, ce maître
artisan a réussi à faire des membres de sa famille un groupe de travail fortement attaché
aux enjeux de l'entreprise en particulier et du métier en général. Une telle réalisation n'est
que le résultat de l'application inconsciente d'un ensemble de pratiques figurant parmi les
principaux outils de la gestion des ressources humaines dans les temps modernes. Les
principales pratiques repérées dans cette unité sont :
122
1) La gestion des carrières et des rémunérations. En dépit de l'absence des catégories
hiérarchiques, les membres de l'entreprise ont toujours la possibilité d'améliorer leurs
situations financières. De ce fait, on peut parler d'une progression financière qui est
considérée par les théories de la gestion de ressources humaines comme un des principaux
outils de motivation au travail. Deux voies de progression financière peuvent être
distinguées dans cette entreprise, à savoir une progression relative aux changements
biologiques et sociaux et une autre relative aux réalisations professionnelles de l'individu.
Pour la première, elle est à la portée de tous les membres. L'individu bénéficie d'une
augmentation du revenu tout en avançant en l'âge d'une part, et en passant du statut du
célibataire au statut de marié d'autre part. Pour la deuxième voie de mobilité, elle aura lieu
dans le cas où le membre crée un nouveau produit. Une telle réalisation est souvent
originaire des membres les plus expérimentés. Dans ce cas, la part importante des
bénéfices, occasionnés par le nouveau produit, revient à l'innovateur. Avec une telle
méthode de gestion, l'individu peut toujours améliorer son statut dans l'entreprise dans la
mesure où la mobilité financière, notamment celle en lien avec les réalisations
professionnelles, lui apportent plus de reconnaissance au sein du groupe du travail. Ainsi,
à travers cette pratique, on assiste à la combinaison de deux principaux outils de la gestion
des ressources humaines : la gestion des carrières et la gestion des rémunérations.
2) La gestion des compétences. Cette pratique est traduite principalement par la place
importante qu'occupe la formation dans cette entreprise. L'analyse des cursus
professionnels des différents membres montre que le chef d'entreprise accorde un soin
particulier à la question de la formation professionnelle des membres de sa famille. Pour
atteindre le statut d'un artisan, ces membres sont obligés de passer par une longue période
d'apprentissage. Les différentes étapes de cette période d'apprentissage seront présentées
dans la section consacrée à la question de la transmission des savoirs professionnels au sein
de cette entreprise.
D'après ce qui précède, le caractère familial de cette entreprise ne se présente pas comme
un obstacle devant l'application des méthodes plus au moins rationnelle dans la gestion des
ressources humaines. D'ailleurs, ce type d'entreprise reste un modèle dans lequel on peut
repérer la présence naturelle de certains éléments que les autres types d'entreprises
123
s'efforcent pour les mettre en œuvre à travers des pratiques managériales rationalisées et
parfois assez coûteuses. À titre d'exemple, on cite ici les éléments repérés dans la présente
entreprise : la cohésion du groupe, le travail participatif et la circulation facile des
informations au sein de l'entreprise.
2.1.3 Les dynamiques socioculturelles de l'entreprise Al
L'un des constats les plus remarquables de l'enquête effectuée dans cette entreprise réside
dans la polarisation des discours sur la famille, ses enjeux, ses liens et sur plusieurs autres
faits qui se rapportent à son passé, présent et futur. Cette polarisation reflète avant tout
l'indissociation du vécu de la famille de celui de l'entreprise. Il s'agit bien ici d'un
construit dans lequel s'encastre l'économique dans le social. En dépit de sa vocation
économique, cette entreprise est loin d'être considérée en tant qu'un simple espace traversé
par des dynamiques socioculturelles fondées sur des bases purement économiques. En
réalité, ces dynamiques sont déterminées en grande partie par les dynamiques familiales.
Un tel constat est confirmé d'autant plus par l'analyse des interactions qui structurent le
vécu de cette entreprise. Cette analyse montre que ces interactions obéissent à une logique
purement familiale tant dans la structuration que dans la régulation. Cependant, le cadre de
référence de nature familiale est fortement imprégné par les normes et les valeurs
culturelles se rapportent au métier de la poterie artisanale. Ceci peut être expliqué par
l'inhérence de l'histoire de cette famille à ce métier. Sur le plan social, cette entreprise se
caractérise par :
1) Un système social composé de trois types d'acteurs partageant un enjeu commun qui
est la réussite de l'entreprise et la perpétuation du métier. Ces acteurs, qui sont le maître
artisan, l'artisan et l'apprenti, se distinguent l'un de l'autre par le degré de maîtrise du
métier. Toutefois, chacun de ces acteurs a des enjeux individuels qui se centrent tous autour
de la bonne maîtrise et le développement du métier. La réalisation de ces enjeux passe,
selon ces acteurs, par l'approfondissement et le développement des compétences et des
connaissances professionnelles relatives au métier. Avec une telle perspective, les acteurs
inscrivent leurs enjeux individuels dans l'enjeu collectif d'une part, et manifestent une
attitude favorable vis-à-vis l'innovation et la transmission des savoirs professionnels.
124
2) Un système de relation fortement influencé par les liens de consanguinité reliant les
différents membres de l'entreprise. Cette entreprise constitue un espace d'interactions
familiales où les rapports ne sont pas déterminés par des règles organisationnelles et
professionnelles formalisées et rigides. En fait, la structure relationnelle se caractérise par
une grande tolérance et par l'absence des barrières hiérarchiques et des repères formels qui
peuvent réduire la communication entre les membres de l'entreprise.
3) Un système de régulation sociale fondé sur la participation et l'intégration. En dépit de
la centralisation du pouvoir dans cette entreprise, les différents acteurs contribuent
constamment, à travers les négociations et les discussions, à l'actualisation de leur univers
de travail. Dans un tel contexte, les normes de la production ainsi que les règles des
comportements sont une production propre à l'équipe du travail. Une telle situation est
favorisée, sans aucun doute, par les liens affectifs reliant les membres de la présente
entreprise d'une part et par la souplesse du système du contrôle des comportements dans le
travail d'autre part.
L'analyse des dynamiques sociales, décrites ci-haut, montre que le groupe du travail dans
l'entreprise Al se caractérise par sa forte cohésion ainsi que par son fort attachement au
métier. Au sujet de la cohésion du groupe de travail, elle reflète l'existence d'une culture
d'entreprise fondée sur l'esprit d'équipe. Ceci témoigne de la présence d'un système de
normes et de valeurs favorisant l'apparition des comportements et des attitudes favorables à
la coopération et la collaboration dans le travail. Ces faits sont favorisés en grande partie
par les pratiques de convivialité qui rythment le vécu quotidien des membres de cette
famille dans le travail. Ces pratiques constituent en quelque sorte une source de motivation
et d'inspiration pour ces membres d'une part, et les principaux éléments constitutifs de la
mémoire collective de ce groupe de travail d'autre part. Les propos des différents membres
de cette entreprise montrent que les principaux moments de cette mémoire se rattachent à
des événements extra-professionnels ; c'est-à-dire des événements qui ont eu lieu pendant
le travail sans être en relation avec le processus de production. En bref, les événements
d'ordre social et convivial prévalent sur les événements d'ordre professionnels dans cette
entreprise.
125
Néanmoins, l'aspect professionnel demeure de grande importance pour les membres de
cette unité. Cette importance se manifeste par le fort sentiment d'appartenance
qu'expriment ces membres envers leur métier. Pour ces derniers, le métier se présente
comme leur sphère unique d'identification dans le travail. Le passage d'un statut
professionnel à un autre et la reconnaissance dans l'entreprise passe uniquement par la
maîtrise des ficelles du métier. Ainsi, le métier constitue le principal pilier culturel dans
cette entreprise autour duquel gravite un ensemble de motivations, de représentations et de
normes partagées.
En gros, l'entreprise Al se caractérise par une structure organisationnelle très simple, voir
rudimentaire, des pratiques managériales essentielles à la motivation des individus au
travail et des dynamiques socioculturelles façonnées principalement par la famille et le
métier. L'intérêt maintenant est de jeter un coup d'œil sur l'innovation et sur la
transmission des savoirs professionnels en présence de telles circonstances.
2.2 L'entreprise Al et l'innovation
En dépit de la conservation de son mode de fonctionnement typiquement familial depuis
trois générations, la présente entreprise a connu plusieurs innovations au fil des années. Ces
innovations sont, selon le chef de cette unité (le maître artisan), une réaction aux
changements qu'a connu l'environnement de l'entreprise. Pour ce maître artisan,
l'innovation constitue une affaire incontournable dans le contexte actuel. Un contexte qu'il
qualifie comme très difficile pour les métiers ancestraux. Avec une telle vision, ce chef
exprime sa forte conscience de l'importance de l'innovation pour la survie de l'entreprise et
du métier. Cette conscience peut expliquer la présence très forte d'une culture d'innovation
au sein de son unité de production.
Dans le cas de cette entreprise, les deux types d'innovations précisés lors de la présentation
du modèle de l'observation et de l'analyse ont été repérés. Autrement dit, cette entreprise a
connu des innovations intrinsèques résultant des initiatives originaires des acteurs évoluant
au sein de l'entreprise et d'autres occasionnées par l'introduction et la mise en œuvre de
nouveautés développées à l'externe.
126
Au sujet des innovations intrinsèques, elles concernent principalement les produits. Après
avoir été spécialisés uniquement dans la production des ustensiles de ménage pour la
population paysanne et après que la production soit saisonnière, la production dans cette
entreprise a connu une véritable diversification pour s'étendre sur les différentes saisons.
Actuellement, elle produit deux différentes gammes d'articles.
La première gamme concerne toujours les ustensiles de ménage, mais ce type de produits
n'est pas destiné uniquement à la population rurale. En s'engageant dans un processus de
création, les acteurs de cette unité ont pu développer une variété de produits qui satisfait
les besoins de la population urbaine ainsi que celle rurale des temps modernes. Les
principaux moteurs de ce type d'innovations, selon les membres de cette entreprise, sont
les dynamiques internes du secteur de la poterie à Moknine et le retour progressif des
consommateurs aux produits de la poterie artisanale après les avoir délaissés pendant
longtemps au profit des produits en plastique et en aluminium fabriqués industriellement.
À propos du rôle des dynamiques internes du secteur dans l'innovation des produits. Le
fils aîné du chef d'entreprise déclare :
La concurrence entre les potiers de la ville a été à l'origine du développement des produits qui tiennent compte des exigences du consommateur de la vie moderne [...] En tant qu'artisan, il faut se distinguer des autres. Pour cette raison, j'essaye toujours d'apporter des innovations sur mes produits et même de créer de nouveaux produits. De cette façon, je contribue à la distinction de notre entreprise des autres et je peux avoir en même temps une reconnaissance dans le métier.
Pour la deuxième gamme de produits, elle concerne des produits adressés exclusivement
aux marchés extérieurs. Ce type de produits, qui constitue une nouveauté dans l'entreprise
Al, est composé essentiellement des articles de décorations et de jardin. Cette gamme de
produits a constitué le vrai facteur qui a été à l'origine du retour en force de la poterie
artisanale dans cette ville. Pour profiter de cette situation, toutes les entreprises de la région
se sont engagées dans un sentier de création et d'innovation pour attirer plus de clientèle
étrangère. Dans le cas de la présente unité, les innovations en rapport avec cette gamme de
produits touchent les formes et les couleurs. De même, elles se traduisent par l'ajout de
motifs et le traitement des surfaces de ces produits pour les rendre plus élégants.
127
Parallèlement à ces innovations intrinsèques, cette entreprise a connu l'introduction de
plusieurs éléments sur son fonctionnement. Ces innovations sont :
1) L'introduction d'une malaxeuse-boudineuse. Cette machine qui fonctionne
électriquement est utilisée lors de l'étape de pétrissage présenté antérieurement dans la
partie consacrée à la description des phases de la fabrication. Cette étape, qui est la plus
délicate dans la phase de la préparation de la pâte d'argile, était effectuée auparavant
manuellement. Sur les apports de cette machine précise le gendre du maître artisan :
L'introduction de cette machine nous a réduit une charge physique très énorme. De plus, cette machine nous a permis d'avoir une pâte d'argile plus fine et plus facile à modeler lors du tournage. Enfin, avec cette machine on peut préparer une quantité plus grande de pâte en un temps plus court.
2) Le remplacement du tour. Le tour traditionnel qui est commandé par le pied du potier
est troqué par un autre qui fonctionne par l'énergie électrique. Avec ce tour le potier n'a pas
à déployer une force physique pour faire tourner le tour. Ceci ne peut que réduire la fatigue
de l'artisan potier et augmenter sa concentration sur le façonnage des produits. Ainsi, ce
nouveau tour peut être un véritable appoint à la création dans la mesure où il permet à
l'artisan de se concentrer uniquement sur son œuvre.
3) L'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication
pour écouler ses produits. L'entreprise Al a mis en place depuis cinq ans un site internet.
L'objectif de cette action était l'ouverture de l'entreprise sur le marché extérieure. Ce site a
constitué une nécessité pour l'entreprise.
Le site internet, précise le maître artisan, était le portail qui m'a permis de conquérir des marchés étrangers. Sans ces marchés je ne crois pas que mon entreprise peut continuer à survivre. Si je me fie uniquement sur le marché local je ne serais pas capable de faire travailler tous les membres de ma famille. [...] Malgré le retour des consommateurs locaux aux produits artisanaux le marché local ne peut pas absorber les différents gammes de nos produis. Donc, j'étais obligé de trouver le moyen d'exposer ces gammes aux consommateurs étrangers. Louange à dieu (alhamdou lallh), internet a rendu la tâche accessible et facile.
Eu égard à ce qui précède, l'innovation dans ses deux dimensions constitue une dynamique
principale du vécu de cette entreprise. Cependant, la présence de cette dynamique ne
128
signifie en aucun cas la rupture avec les caractéristiques de la production relatives aux
métiers ancestraux. Au contraire, l'innovation a constitué un moyen nécessaire pour
préserver le métier de la disparation dans un contexte devenu de plus en plus difficile pour
les métiers de tout genre.
2.3 L'entreprise A let la transmission des savoirs professionnels
Tel qu'il a été précisé précédemment, la question de la construction des compétences
professionnelles occupe une place importante au sein de cette entreprise. Cette
construction, qui s'inscrit dans un long processus d'apprentissage, s'effectue sur le tas.
Effectivement, tous les membres de cette entreprise, sans aucune exception, n'ont poursuivi
aucune formation professionnelle relative au métier de la poterie en dehors de l'entreprise.
Ils ont appris les ficelles du métier depuis leur jeune âge en accompagnant les membres de
la famille au travail.
L'analyse des différentes expériences d'apprentissage, relaté par les membres de cette
entreprise, et l'observation directe des situations concrètes de l'apprentissage, montrent que
les différents types de savoirs professionnels relatifs au métier sont acquis dans les
interactions quotidiennes qui mettent en relation les membres de l'entreprise. Autrement
dit, l'apprentissage du métier repose en grande partie sur la transmission des normes et des
valeurs techniques et non techniques d'une personne à une autre. En conformité avec cette
réalité, le maître artisan affirme :
Notre métier ne peut pas être enseigné dans l'école ou par une formation professionnelle formelle. Pour l'apprendre, il faut tout d'abord que la personne soit attirée par le métier, mais ceci reste insuffisant. Cette personne si on ne lui transmet pas progressivement et correctement les secrets du métier ne peut jamais développer ses habiletés professionnelles et devenir un artisan de qualité.
Ainsi, la transmission progressive des savoirs professionnels, appelés par le maître artisan
secrets du métier, constitue la voie principale, voire unique, de la construction des
compétences dans cette entreprise. Les membres de cette unité, qui ont actuellement le
129
statut d'artisan41, précisent qu'ils ont reçu les savoirs requis par le métier en accompagnant
les membres de la famille qui les dépassent en âge et en expérience professionnelle. Avant
de monter sur le tour pour produire des articles d'une façon autonome, tout un chacun dans
cette entreprise doit passer par une étape d'apprentissage lors de laquelle il reçoit les
savoirs de base lui permettant d'accéder au métier. Cette période, qui varie d'une personne
à une autre, se déroule en plusieurs étapes. Elle débute par une phase d'initiation au métier.
La totalité des membres de cette entreprise, hormis le maître artisan, ont eu cette initiation
en parallèle à leur formation scolaire primaire. Effectivement, ces membres ont appris les
premiers savoirs relatifs au métier pendant les intercours scolaires journaliers, les fins de
semaines et les vacances scolaires. Dans cette phase d'initiation, l'individu est considéré
comme un apprenti à temps partiel. À ce niveau, il se contente d'observer tout ce qui se
passe dans l'entreprise tout en posant des questions relatives au métier à ses aînés.
Une fois que la formation scolaire prend fin, par échec pour la majorité des membres
permanents de cette entreprise, le membre change de statut. Il devient un apprenti à temps
plein. À ce niveau, il accompagne d'une façon permanente un artisan (son père dans la
majorité des cas). C'est dans cette relation de compagnonnage que commence réellement la
transmission détaillée des savoirs relatifs au métier. Lors de cette phase, l'artisan transmet à
l'apprenti les informations qui se rapportent à la préparation de la pâte d'argile, à sa
conservation, aux tournages et à la cuisson des produits. En d'autres termes, l'apprenti
reçoit lors de cette phase les savoirs théoriques ainsi que le savoir-faire nécessaires pour
pratiquer le métier. Ici, l'apprenti se contente seulement d'observer les gestes de son maître
et d'écouter ses consignes. De ce fait, il ne participe pas à la production pendant
l'apprentissage. Cependant, il reçoit une récompense matérielle d'une façon hebdomadaire.
En moyenne, la durée de cette période est de trois ans et demi. Elle est culminée par le
passage du statut d'apprenti au statut d'artisan producteur.
Au-delà de la transmission des valeurs et des nonnes théoriques et pratiques se rapportant
au métier, le maître transmet à l'apprenti lors de la phase d'apprentissage un ensemble de
normes et de valeurs qui sont en lien avec la culture du métier. L'apprenti acquiert à
41 Par statut d'artisan, on désigne ici une personne qui travaille sur le tour du potier. En d'autres mots, un artisan dans cette entreprise est celui qui produit d'une façon automne des œuvres en argile.
130
l'occasion les manières de se comporter dans le travail en particulier et dans la vie en
général. De même, le maître lui relate des faits historiques qui ont marqué leur entreprise
ainsi que le métier. De ce fait, la transmission concerne également la passation du savoir-
être et la mémoire collective relative à l'entreprise et au métier. Ainsi, la phase de
l'apprentissage constitue par excellence une phase de socialisation au métier.
L'observation directe d'une situation concrète d'apprentissage, mettant en relation le fils
aîné du maître avec son fils, et l'analyse des différentes expériences d'apprentissage,
permettent de constater que l'apprentissage du métier dans l'entreprise Al prend la forme
du nourrissage. En d'autres termes, les différents types des savoirs relatifs au métier sont
transmis d'une manière lente et progressive. Une telle manière de transmission ne peut que
favoriser l'imprégnation douce du métier dans l'esprit de l'apprenti.
Le passage au statut d'artisan autonome exige que l'apprenti ait la maîtrise de l'ensemble
des gestes lui permettant de contrôler le tour et la transformation de la pâte d'argile en
objet. Afin d'évaluer le degré de cette maîtrise, l'artisan met l'apprenti à plusieurs épreuves
d'évaluation. Il lui donne l'occasion, de temps en temps, de monter sur le tour pour voir
l'état de son avancement. Une fois convaincu des prestations du novice, l'artisan formateur
valide le passage de l'apprenti au statut de producteur. En conséquence, il aura son tour
privé et commence à participer directement à la production.
Néanmoins, le processus d'apprentissage ne prend pas fin à ce niveau. Au contraire, c'est à
ce niveau que les savoirs relatifs à l'esthétique des œuvres seront transmis. Ici, c'est le
maître artisan qui s'occupe de la tâche de la transmission. Ce maître effectue un suivi
permanent auprès des membres de sa famille dans la production. Toujours, il les conseille
afin de rendre leurs produits plus élégants. De même, le maître profite de cette occasion
pour transmettre à sa descendance les valeurs et les normes du métier. Ainsi, cette
transmission constitue un moment crucial pour développer les compétences
professionnelles des membres de l'entreprise, pour développer leurs sentiments
d'appartenance et attachement au métier.
Compte tenu de ce qui précède, la transmission des différents types des savoirs
professionnels dans l'entreprise Al, en dépit de l'absence des procédures formelles dans
131
l'apprentissage, obéit à une organisation plus au moins rationnelle qui prend en
considération les capacités cognitives de l'apprenti et qui met en valeur sa progression dans
le processus de l'apprentissage. Ceci ne peut que témoigner de la présence d'une culture de
métier et d'entreprise valorisant et favorisant la transmission intergénérationnelle des
savoirs professionnels.
Tout bien considéré, l'entreprise Al demeure un univers de travail où le métier de la
poterie témoigne de sa capacité de s'accommoder avec les nouvelles circonstances sans
remettre en question ni les principes des métiers ancestraux ni les caractéristiques
identitaires des entreprises de ce genre de métiers. Une telle accommodation est le résultat
de la valorisation de l'innovation et de la transmission intergénérationnelles des différents
savoirs relatifs au métier. Cette valorisation est favorisée, entre autres, par l'organisation
mise en œuvre, la méthode de gestion des ressources poursuivie et les dynamiques
socioculturelles existantes dans l'entreprise. Mais il reste à voir maintenant la situation du
métier dans un contexte différent; c'est-à-dire dans le deuxième cas de figure des
entreprises artisanales en Tunisie; les entreprises à caractère non domestique constituant la
nouvelle génération des entreprises artisanales de métiers ancestraux.
132
3. L'entreprise A2 : l'entreprise non domestique
L'entreprise A2 représente la nouvelle génération des entreprises de la poterie artisanale
dans la ville de Moknine. Cette nouvelle génération témoigne de l'évolution qu'a connu le
secteur en question au cours des deux dernières décennies. Elle est composée de plus d'une
trentaine d'unités de production à ossature métallique constituant ensemble une zone de
métier. Cette zone a été aménagée par la municipalité dans le but d'éloigner les ateliers de
la production du centre-ville. Cette action vise à la fois de faire face aux problèmes
environnementaux, d'aider ces ateliers à se moderniser et d'adapter le métier aux nouvelles
exigences imposées par les changements socioéconomiques qu'a connu le pays vers la fin
du vingtième siècle.
La création d'une zone de métiers à trois kilomètres de la ville a pour objectif principal de réunir les ateliers de production dans un milieu aménagé et équipé d'une infrastructure moderne permettant aux artisans de développer leur activité et d'améliorer la qualité de leur production. Avec un tel projet, on a réussi à joindre l'utile à l'agréable. D'une part, on a diminué le nombre des entreprises localisées en plein centre urbain. Ceci a contribué à l'amélioration de la qualité de vie dans la ville, dans la mesure où les entreprises dégagent une quantité énorme de fumée lors de la phase de la cuisson des produits. D'autre part, on a créé un espace permettant à ce type d'entreprises de se développer. (Un responsable hautement placé dans délégation régionale de l'artisanat).
Ce faisant, l'entreprise A2 constitue un milieu adéquat pour observer le développement
qu'a connu la production de la poterie artisanale dans la ville de Mokenine.
3.1 Profil de l'entreprise A2 : l'organisation, la gestion des ressources
humaines et les dynamiques socioculturelles
L'entreprise A2, créée dans l'année 2000 par un jeune artisan, est considérée par les
responsables de la délégation régionale de l'artisanat comme un modèle de l'évolution de la
poterie artisanale dans la ville de Mokenine. De même, ils la considèrent en tant qu'un
modèle de conservation des techniques traditionnelles de la production et de la culture du
métier en question. Le propriétaire de cette entreprise a appris les ficelles du métier dans la
première entreprise qui a fait l'objet de notre étude (l'entreprise Al). Ce propriétaire est le
133
neveu du maître artisan de l'entreprise Al. Il s'occupe avec son frère de la gestion et de la
direction d'une unité de production composée de 15 personnes.
3.1.1 L'organisation du travail dans l'entreprise A2
À rencontre de l'entreprise Al, l'entreprise A2 se caractérise par la présence d'une
organisation semi-formelle du travail. Toutefois, ceci ne traduit en aucun cas la mise en
œuvre des règlement écrits qui déterminent les rôles de tout un chacun ou qui prescrivent
les tâches au sein de l'entreprise. Le caractère semi-formel de l'organisation du travail est
observé surtout dans l'aménagement du milieu du travail que dans le fonctionnement de
l'entreprise.
En ce qui a trait à l'aménagement du milieu du travail, cette entreprise est divisée en
différents espaces. Chacune des opérations de production se déroule dans une pièce
séparée. Cette division spatiale prend la forme d'une chaîne. Les différentes pièces
constituant l'entreprise viennent l'une après l'autre et ouvrent l'une sur l'autre42. Avec un
tel aménagement spatial du milieu du travail, l'unité A2 peut-être considérée, malgré que
son activité soit typiquement artisanale et ancestrale, comme une entreprise moderne sur le
plan architectural.
Outre la division spatiale du milieu de travail, l'entreprise A2 se distingue de l'entreprise
Al par une division des tâches. Elle est composée de plusieurs unités de production. Les
membres de chacune de ces unités s'occupent d'une phase bien déterminée du processus de
la production. Ce faisant, trois unités de production peuvent être distinguées au sein de
42 Tout d'abord, on trouve une pièce pour stocker les matières premières (l'argile et le sable) dans leur état brut. En suite, une autre pièce de préparation et de traitement de l'argile. Puis, s'instaure une autre pièce dotée d'une chambre froide pour stocker les mottes d'argile prête à l'usage. Après, s'installe la pièce centrale de l'entreprise. Dans cette pièce s'effectue la tâche la plus importante du processus de la production : le façonnage. La salle de façonnage comprend quatre tours qui fonctionnent tous électriquement. Par la suite, on trouve une autre pièce où ils sont placés les produits finaux pour le séchage avant la cuisson. En parallèle à cette pièce, on trouve une passerelle qui mène au four. Par la suite, on trouve une pièce aménagée pour recevoir les produits cuits. A la fin de cette chaîne, s'instaure la pièce la plus grande de l'entreprise. Dans cette pièce sont entreposés les produits finaux avant la commercialisation. En plus de la chaîne des pièces, l'entreprise contient un deuxième étage. Cet étage est composé de deux pièces séparées. La première représente la salle d'exposition dans laquelle sont présentés soigneusement des échantillons de la production de l'entreprise. La deuxième pièce de cet étage est aménagée en tant que bureau qui contient des éléments qu'ont peut les trouvés dans les bureaux de directions des entreprises modernes (Fax, Téléphone, ordinateur, etc.).
134
cette entreprise : l'unité de préparation de l'argile, l'unité de façonnage et l'unité de
cuisson. Une telle organisation de travail ne signifie nullement que les membres d'une unité
donnée sont spécialisés uniquement dans la tâche qui concerne leur unité. Au contraire, ils
disposent aussi des savoirs nécessaires afin d'accomplir les tâches concernant les autres
unités. Tout au long de la période d'observation au sein de cette entreprise nous avons pu
remarquer que les membres se déplacent facilement d'une unité à une autre. Cela dit que les
membres dans cette entreprise maîtrisent l'ensemble des techniques pour fabriquer un
produit dés le début jusqu'à la fin.
En plus de la division de la production en différentes unités, le propriétaire de cette
entreprise partage avec son frère les affaires relatives à la direction. Il s'occupe lui même
des affaires externes (l'approvisionnement des matières premières et la commercialisation
des produits) ainsi que de la gestion humaine au sein de l'entreprise. Pour le frère, il a pour
rôle principal la gestion du processus de la production. Cependant, tous les deux sont des
maîtres artisans. Ils passent une partie importante de la journée sur le tour de fabrication.
Ils sont donc impliqués dans le processus de production. Toujours dans le cadre de la
description des unités organisationnelles composant l'entreprise A2, il est important de
signaler la présence d'une personne disposant d'un diplôme universitaire en Marketing.
Cette personne, qui a été recrutée depuis deux ans, a comme tâche principale la mise en
œuvre d'une stratégie de commercialisation.
En dépit de la présence de plusieurs unités organisationnelles, la hiérarchie au sein de cette
entreprise peut être qualifiée de simple. Toutes les unités de production sont sous la
supervision d'une seule personne : le frère du propriétaire de l'entreprise. De même, il
n'existe aucune relation de subordination ni entre les membres ni entre les unités. De plus,
les membres de ces unités sont en constante coordination. Cette coordination s'effectue
d'une manière directe et sans le passage par aucun intermédiaire. Ceci signifie que la
structure d'organisation dans cette entreprise est de type simple, dans la mesure où la ligne
hiérarchique est très courte et la coordination entre les différentes unités de production est
facile. Un tel constat est justifié d'autant plus par la centralisation du pouvoir de prise de
décision. Mais cela ne veut pas dire que la direction dans cette entreprise est de style
autoritaire. Elle est plutôt de style consultatif. Les deux frères détenant le pouvoir
135
consultent systématiquement les autres membres de l'entreprise lors de la prise d'une
décision qui touche la production directement ou indirectement. À ce propos affirme le
propriétaire:
Avant d'introduire n'importe quel changement au sein de l'entreprise je consulte tous les membres. Leurs avis comptent beaucoup pour moi puisqu'ils seront les principaux concernés par ce changement. De cette façon, je peux éviter les changements qui peuvent nuire au bon déroulement de la production.
Avec un tel style de direction, le chef de l'entreprise A2 s'inscrit dans les modes modernes
de direction. Le style consultatif, qu'il applique dans son unité de production, demeure l'un
des styles de direction les plus appliqués dans les mondes modernes de production (Likert,
1961). De ce fait, cette entreprise appartient, à travers son style de direction, à la catégorie
d'unités productives des temps modernes. Néanmoins, le mode de commandement ne
constitue pas le seul indicateur de l'appartenance d'A2 à cette catégorie d'unités. La
flexibilité et la simplicité de la structure de l'organisation, décrites plus haut, restent aussi
des témoins de sa possession d'autres traits des entreprises modernes. Ces dernières, qui ont
remplacé les univers productifs à organisation taylorienne caractérisés par leurs structures
lourdes et rigides, ont appuyées leur transition organisationnelle par la mise en œuvre des
pratiques managériales modernes. Le but d'une telle application est, entre autres,
l'instauration d'un climat de travail favorable à l'innovation et à la création. Il reste à voir
maintenant si les changements d'ordre organisationnels, qui nous on conduit à qualifier
l'unité A2 comme une entreprise moderne, sont accompagnés par l'application des outils
managériaux caractérisant ce type d'entreprise.
3.1.2 La gestion des ressources humaines dans l'entreprise A2
Quoi qu'on dise, la gestion des ressources humaines constitue un autre élément qui permet
de qualifier l'entreprise A2 comme une entreprise moderne. Un tel constat est renforcé par
l'application des outils de gestion individuelle et collective qui font partie des pratiques
modernes de la gestion des ressources humaines. À l'encontre du chef de l'entreprise Al, le
chef de la présente entreprise a poursuivi une formation spécialisée en matière de gestion et
136
de direction d'entreprise43. Les impacts de cette formation sur le comportement
gestionnaire du chef sont facilement repérables. Ceci se manifeste dans l'intérêt qu'il
accorde à la gestion des individus ainsi qu'au collectif du travail.
En ce qui touche les individus, les questions de la gestion des carrières, des compétences et
des rémunérations sont le centre d'intérêt du chef de l'entreprise A2. L'analyse des
différentes expériences de travail des membres de cette entreprise montre que l'évolution
professionnelle du personnel fait l'objet d'une poursuite continue du chef. A travers cette
poursuite, il témoigne de sa valorisation de la progression professionnelle dans le travail.
Pour cela, il veille sur la planification de l'avancement des individus dans l'entreprise.
Autrement dit, il accorde une grande importance à la question de la mobilité. Cette
mobilité, qui consiste principalement au passage de l'individu d'une catégorie
professionnelle44 à une autre, représente, sans aucun doute, une véritable source de
motivation pour les individus au sein de l'entreprise A2. Ceci les incite à performer et
innover dans le travail d'une part, et à approfondir leurs connaissances professionnelles
d'autre part. Il est important de noter ici que la maîtrise des techniques de production et
l'innovation constituent les voix principales de la mobilité dans l'entreprise en question. À
ce propos affirme le frère du chef de l'entreprise s'occupant de la gestion de la production :
Pour passer d'une catégorie professionnelle à une autre, l'individu doit faire preuve d'une évolution dans l'apprentissage du métier. Cette évolution se concrétise essentiellement par la bonne maîtrise des gestes relatives à l'action de la production. [...] Ces gestes sont nécessaires pour la production des bonnes et mêmes de nouvelles œuvres. En produisant autonomement une nouvelle œuvre, l'individu devient un vrai artisan. L'artisan pour moi c'est un artiste donc il doit être créatif. Dans notre entreprise on accorde une grande importance à cette dimension. C'est pour cette raison on incite notre collectif à la création. En contrepartie toute création sera récompensée soit par le passage d'un statut professionnel à un autre soit par l'augmentation de la rétribution de l'artisan créateur. Même le passage d'un statut professionnel à un autre est accompagné par une augmentation dans le revenu de l'individu. (Le frère du chef de l'entreprise)
43 Dans le cadre de sa stratégie globale de promouvoir les entreprises et le travail artisanal, l'Office National de l'Artisanat en Tunisie organise d'une façon périodique des formations et des rencontres qui s'adressent aux artisans chefs d'entreprises. L'objectif de ces formations et des ces rencontres est de former ces chefs en matière de gestion et de direction des entreprises. 44 Dans cette entreprise nous avons repéré la présence de cinq catégories professionnelles : les ouvriers, les apprentis, les compagnons, les artisans et les maîtres artisans.
137
Dans la même logique de la motivation des individus à l'évolution dans l'apprentissage et
à l'innovation, le chef de l'entreprise a mis en œuvre un système de rémunération axé
principalement sur les performances individuelles. Cette règle concerne principalement les
maîtres artisans et les artisans. Les autres catégories, les ouvriers, les apprentis et les
compagnons, sont payées à la semaine. La rémunération de ces catégories diffère d'une
catégorie à une autre. Un tel système de rémunération ne peut que motiver les individus à
la mobilité dans le travail. Donc, il se présente comme une véritable source d'incitation à la
performance et à l'innovation dans le travail dans la mesure où cette mobilité dépend
étroitement de ces deux facteurs. De même, ce système constitue un facteur incitant les
apprentis à développer leurs compétences professionnelles. Pour réaliser ce
développement, les individus ne sont pas laissés à mêmes. Lors de sa formation, l'apprenti
bénéficie de l'encadrement de tous les maîtres artisans et les artisans qui travaillent dans
l'entreprise tout en profitant d'une grande marge d'erreur dans le travail.
En ce qui regarde le collectif du travail, l'entreprise A2 se caractérise par une facilité et
une organisation au niveau de la communication interne d'une part, et une forte présence
de la culture du travail participative d'autre part. Un tel constat confirme l'application dans
cette entreprise des outils de la gestion des ressources humaines des temps modernes dans
la mesure où la communication interne et le travail participatif constituent l'une des
préoccupations majeures de ce type de gestion. Concrètement dans cette entreprise, les
individus communiquent entre eux facilement sans aucun support ni intermédiaire. Cette
communication orale directe et ouverte est favorisée par la politique de communication
mise en œuvre. Cette dernière se base principalement sur la négligence des catégories
hiérarchiques lors de l'échange des informations d'une part, et sur la prise de l'information
de sa source principale d'autre part. Une telle situation communicationnelle est favorisée
d'autant plus par la culture du travail participatif qui règne dans cette entreprise. Ce type de
travail est favorisé par la division des unités du travail en groupe. Avec une telle logique,
les membres d'un groupe donné sont sous l'obligation de collaborer ensemble pour mener
à bien leurs tâches dans la mesure où la visibilité concerne le travail du groupe en premier
lieu. Pour mener à bien cette pratique organisationnelle, chaque groupe de travail est mis
sous la tutelle d'un maître artisan qui s'occupe entre autres de l'organisation du travail de
son groupe et la formation des membres qui l'accompagnent.
138
Conformément à ce qui précède, la mobilisation des outils modernes de la gestion des
ressources humaines ne se contredit pas avec le caractère de l'entreprise artisanale. Au
contraire, le cas de l'entreprise A2 montre que ces outils sont compatibles avec le modèle
artisanal de la production. De même, elles sont indispensables pour promouvoir
l'innovation et la transmission des savoirs professionnels qui se présentent comme une
nécessité pour ce type d'entreprises dans le contexte de la globalisation.
3.1.3 Les dynamiques socioculturelles dans l'entreprise A2
Les pratiques de gestion des ressources humaines, notamment celles relatives à la gestion
du collectif du travail, témoignent de la forte conscience du chef de l'entreprise A2 de
l'importance de la dimension sociale dans le fonctionnement et la réussite de l'entreprise.
En adoptant des outils favorisant le travail en groupe et facilitant la communication interne,
ce chef vise, comme il l'avait précisé lors de l'entretien effectué avec lui, la promotion
d'un esprit d'équipe dans son entreprise. Les résultats de l'enquête montrent que cette
finalité est bel bien atteinte au sein de cette entreprise.
L'importance des discours sur les valeurs et les coutumes véhiculées par le travail en
équipe reflètent cette réalité. Les termes d'esprit de groupe, de solidarité du groupe,
d'avenir du groupe, etc., sont les termes les plus évoqués par l'ensemble du personnel de
cette entreprise. De même, les situations concrètes de travail montrent la forte présence de
cette culture du travail en équipe. L'entraide, la coopération et le soutien mutuel constituent
les principales caractéristiques de l'entreprise A2. Il s'agit donc d'une communauté qui se
caractérise par son esprit-maison. De ce fait, elle a ses logiques particulières de
fonctionnement social. Ces logiques, structurant les interactions, sont déterminées en
grande partie par la culture d'entreprise issue des rapports sociaux concrets où se déroule
l'apprentissage des repères du collectif du travail. L'un des constats les plus remarquables
de l'enquête effectuée dans la présente unité est la similitude qui existe entre la culture de
cette entreprise et de celle de l'entreprise Al. En effet, le métier joue un rôle important dans
la détermination de la culture de l'entreprise. Ainsi, le groupe du travail et le métier
constituent ensemble, comme dans le cas de l'entreprise Al, les deux principaux piliers des
dynamiques socioculturelles de l'entreprise A2.
139
Pour ce qui est des dynamiques sociales, l'entreprise A2 est marquée par la présence d'un
système d'acteurs constitué de cinq types d'acteurs : le maître artisan, l'artisan, le
compagnon, l'apprenti et l'ouvrier. En dépit de leurs appartenances à divers types
d'acteurs, les membres de cette entreprise partagent un enjeu en commun qui se centre
autour de la réussite de l'entreprise d'une part, et de la perpétuation du métier de la poterie
artisanale d'autre part. Une telle situation témoigne en même temps du fort attachement de
ces membres à leur entreprise et à leur métier. De même, les différents types d'acteurs
manifestent, à travers leurs discours et leurs comportements, une forte conscience de
l'importance de leurs rôles dans le succès de l'entreprise et la pérennité du métier de la
disparition. À cet égard, on cite successivement les propos de trois membres appartenant à
trois catégories distinctes ; un maître artisan, un artisan et un ouvrier :
Chaque membre peut contribuer de sa place au rayonnement de l'entreprise. Si chacun de nous accomplit sa tâche dans les règles de l'art la réussite de l'entreprise et la survie de notre métier seront garanties. De ma part, je dois innover dans les produits afin de se distinguer des autres entreprises et d'adapter les produits aux besoins du consommateur des temps modernes.(Maître artisan)
Le sort de l'entreprise dépend de nous tous. Il est important que chacun fasse son travail correctement pour qu'on puisse assurer la pérennité de la demande sur les produits artisanaux. De cette façon, notre entreprise peut augmenter ses revenus et contribuer à la renaissance de la poterie artisanale dans la ville de Mokenine. (Artisan)
Si on veut que notre entreprise continue à survivre, il est nécessaire que tout le monde participe activement à la réalisation des produits de bonne qualité. Seule la bonne qualité des produits nous permet de conserver nos emplois et d'attirer le consommateur aux produits artisanaux. De mon côté, lors du traitement initial de l'argile j'essaye toujours que la pâte soit bien prête pour produire des articles de haute qualité. (Ouvrier)
Au-delà de ces enjeux communs, les différents types d'acteurs se distinguent l'un de l'autre
par des enjeux personnalisés. Ces enjeux convergent tous vers la réalisation des
performances personnelles permettant aux membres, l'un indépendamment de l'autre,
d'améliorer leurs statuts et leurs situations financières au sein de l'entreprise. En effet, le
projet historique de l'entreprise, qui consiste à faire perpétuer le métier de la poterie
140
artisanale, rejoint celui des destinées individuelles. Ce faisant, les enjeux collectifs et les
enjeux individuels dans le cas de l'entreprise A2 se complètent entre eux pour créer une
ambiance de travail fondée sur la coopération et la collaboration.
Le système de relations régnant au sein de cette entreprise confirme cette idée. Ce système
se caractérise par la richesse des rapports et des interactions dans le travail. L'analyse de
ces derniers montre la présence d'un lien social fort unissant les membres de l'entreprise.
Ce lien, favorisé par les relations d'ordre professionnel, est loin d'être un simple lien
professionnel. Les pratiques quotidiennes et les discours des membres témoignent de la
présence d'un esprit-maison, de la sociabilité très intense au sein de cette unité et de
l'attachement très fort à l'entreprise et à son histoire. De ce fait, l'implication au travail
dans cette entreprise dépasse le cadre professionnel pour devenir une implication affective.
Ce type d'implication est favorisé, sans aucun doute, par le système de régulation sociale se
basant, essentiellement, sur la participation et l'intégration et non pas sur l'exclusion et la
sanction. Ce constat est justifié par deux faits. D'un côté, l'entreprise A 2 se caractérise par
l'absence d'un système fixe de contrôle de comportements. D'autre part, la permanence des
négociations autour des affaires quotidiennes de production authentifie la présence d'un
système de régulation basé sur l'intégration et la participation.
Toutefois, il existe un système de normes et de valeurs nettement remarquable qui guide
les différents acteurs dans leurs comportements et qui influence leurs attitudes. Autrement
dit, il existe une culture d'entreprise qui détermine en grande partie les actions des
différents acteurs. L'analyse de ces actions montre que le métier et le groupe de travail
constituent les principaux cadres de références pour les individus dans cette entreprise.
D'une part, la tradition et les valeurs de métier sont fortement présentes dans le vécu
quotidien des acteurs au sein de l'entreprise. D'autre part, les comportements sont régis par
un système d'entente et de compréhension qui se rapporte à la mémoire collective du
groupe de travail. Au sujet de cette mémoire, elle se caractérise, en dépit du jeune âge de
l'entreprise, par sa richesse. De telle façon, les acteurs font des moments historiques des
cadres de références adéquats pour faire face aux situations du présent. Dans la même
logique, la richesse de la mémoire collective témoigne de l'abondance des pratiques de
141
convivialité. Ces pratiques demeurent sans aucun doute à l'origine de la culture cohesive
caractérisant la présente entreprise.
En raison de ce qui précède, le métier et le groupe de travail constituent ensemble les
principales sources des normes et des valeurs qui régissent le vécu et les dynamiques
sociales des acteurs au sein de cette entreprise. D'ailleurs, ces deux éléments (le métier et le
groupe de travail) représentent les principales sphères d'identification des individus au sein
de cette entreprise. Pour s'identifier, les interviewés, se réfèrent, en premier lieu, à leur
statut dans le groupe du travail et à leur niveau d'apprentissage du métier en second lieu.
Dans l'ensemble, l'entreprise A2 se caractérise par une organisation du travail assez
moderne, par des pratiques de gestion de ressources humaines développées et par des
dynamiques socioculturelles reflétant le fort attachement du groupe du travail au métier.
Ainsi, la modernisation de l'organisation et de la gestion des Hommes dans cette entreprise
s'inscrivent dans une logique de développement et non dans une logique pas de rupture
avec le métier. Il reste maintenant à voir l'état de l'innovation et de la transmission des
savoirs professionnels dans des situations pareilles.
3.2 L'entreprise A2 et l'innovation
En dépit de son appartenance à la nouvelle génération des entreprises de la poterie
artisanale, l'entreprise A2 continue à appliquer les méthodes traditionnelles de production.
Cette conservation, qui confère l'identité artisanale à cette entreprise, se manifeste, entre
autres, dans la primauté du travail de l'homme sur la machine et la structure artisanale de
l'organisation. Néanmoins, la conservation des pratiques ancestrales du métier
s'accompagne par une forte tendance au sein de cette entreprise à l'innovation. Toutefois,
l'entreprise A2 se distingue de l'entreprise Al par l'ampleur de l'innovation. En d'autres
termes, l'innovation dans cette entreprise touchait tous les aspects du travail à l'encontre de
l'entreprise Al où elle ne touchait que certains aspects.
En ce qui concerne les innovations s'inscrivant dans la catégorie d'innovations apportées
par les acteurs de l'entreprise, on distingue dans l'unité A2 deux types d'innovations : des
innovations qui touchaient les produits et d'autres qui touchaient l'organisation et la
142
gestion du travail. Cette distinction est faite en fonction de l'origine de l'innovation. Au
sujet des innovations qui touchaient le produit, elles ont pour origine deux types d'acteurs :
le maître artisan et l'artisan. Il est important de signaler ici que l'entreprise A2 est
spécialisée dans la production des articles de décoration et de jardins. La majorité de cette
production est destinée à l'exportation. Afin de satisfaire les demandes de la clientèle
étrangère, les maîtres artisans et les artisans dans cette entreprise innovent d'une façon
permanente dans les produits. Cette innovation consiste à la création de nouveaux modèles.
Dans leur démarche créative, ces acteurs sont fortement encouragés par le chef
d'entreprise. Ce dernier, malgré ses charges de direction, il participe à son tour dans le
processus de l'innovation par la création de nouveaux modèles et l'encadrement de ses
collaborateurs dans leurs démarches créatives. Ceci témoigne de sa connaissance
approfondie du métier, de son sens d'innovation et de ses qualités de leaderships. Dans le
même ordre d'idées, ces comportements traduisent sa forte conscience de l'importance de
l'innovation pour la survie de l'entreprise et du métier dans le contexte actuel. Cette
conscience ne se manifeste pas uniquement par son encouragement et son implication dans
l'innovation des produits. Elle se manifeste également dans les innovations qu'il a
apportées à l'organisation, à la gestion et aux outils de travail.
Ces innovations n'ont pas uniquement comme source le chef d'entreprise. Elles ont aussi
comme origine le frère qui s'occupe de la gestion et de l'organisation de la production. Au
sujet de ce type d'innovations, il concerne :
1) L'organisation spatiale de l'entreprise. À l'encontre de l'entreprise Al, l'entreprise A2
est divisée en différents espaces séparés. (Voir la partie qui décrit l'organisation dans
l'entreprise A2).
2) La division du travail. Le travail dans cette entreprise est divisé en plusieurs unités de
production. Chacune de ces unités s'occupe d'une opération particulière dans le processus
de la production. (Voir également la partie qui décrit l'organisation dans l'entreprise A2).
3) La mise en place d'un système de rémunération personnalisé. Les membres dans cette
entreprise sont rémunérés seulement en fonction de leurs réalisations professionnelles et
143
sans prendre en considération leur avancement dans l'âge et le changement du statut social
comme il est le cas dans l'entreprise Al.
À ceci s'ajoute l'innovation apportée au four de cuisson. Dans cette entreprise, ce four n'est
pas construit en plein air ni sur la terre comme l'est le cas dans l'entreprise Al. Il est plutôt
creusé dans la terre et se trouve sous l'abri d'un toit. Ceci constitue, selon les propos du
frère du chef de cette entreprise, une innovation dans la ville de Mokenine. Ce dernier qui a
inventé cette nouvelle technique explique les avantages de ce four :
Le fait de placer le four dans une pièce couverte nous a permis de travailler dans toutes les conditions climatiques et de protéger nos produits avant et après la cuisson des effets climatiques indésirables, notamment le vent et la pluie. En creusant le four dans la terre, il est devenu plus facile pour les ouvriers de charger et de décharger les articles. De même, ceci a rendu la cuisson des articles meilleure dans la mesure où la distribution du feu dans ce genre de four est plus équilibrée que dans le four battu sur terre. De plus, cette disposition du four permet à la personne chargée de la cuisson de mieux contrôler l'avancement de cette opération.
En plus des innovations d'origine intrinsèque, l'analyse des situations concrètes du travail
dans l'entreprise A2 et la comparaison des situations avec celles existantes dans
l'entreprise Al montrent l'introduction de plusieurs innovations sur le fonctionnement de
l'entreprise de la poterie artisanale dans la ville de Mokenine. Ces innovations sont :
1) L'introduction de nouveau matériel de production; tel que l'utilisation d'une
malaxeuse-boudineuse dans la préparation de l'argile et le remplacement du tour
traditionnel par un autre électrique.
2) L'utilisation des nouvelles technologies de communication et de l'information : comme
dans le cas de l'entreprise Al, l'entreprise A2 dispose d'un site internet offrant l'option de
vente en ligne. De même, ce site constitue le principal porteur de commandes pour
l'entreprise.
3) L'aménagement d'une salle d'exposition : à l'opposé de l'entreprise Al, cette entreprise comporte une pièce autonome réservée à l'exposition des articles d'une manière harmonieuse.
144
4) La préparation des catalogues : tous les six mois, cette entreprise imprime un catalogue
qui présente les différents articles produits par l'entreprise.
5) L'engagement d'une personne spécialisée en Marketing : cette personne a pour rôle
principal le développement de la stratégie commerciale de l'entreprise.
6) L'engagement d'une diplômée en beaux arts : la tâche de cette personne consiste à
aider les maîtres artisans dans le façonnement des articles se caractérisant par une valeur
esthétique.
Compte tenu de ce qui précède, l'entreprise A2, à l'instar de l'entreprise Al, se caractérise
par la présence très forte d'une culture d'innovation et l'introduction de plusieurs
innovations sur le fonctionnement de l'entreprise. De ce fait, la culture du métier de la
poterie artisanale demeure favorable à la création et à l'innovation. Bref, c'est une culture
qui favorise et encourage les changements lui permettant de s'ajuster aux différents
changements.
3.3 L'entreprise A2 et la transmission des savoirs professionnels
Hormis l'agent de Marketing et la diplômée en beaux arts, le reste des membres de cette
unité n'ont suivi aucune formation professionnelle en dehors de l'entreprise. Ils ont tous
appris le métier dans les contextes concrets du travail. Cette réalité, constituant l'une des
caractéristiques des métiers ancestraux, témoigne une fois de plus de l'importance de la
transmission des savoirs professionnels dans le contexte des entreprises qui les pratiquent.
Dans le cas de cette entreprise, cette question de transmission constitue une des priorités du
chef. Cet intérêt accordé à la transmission des savoirs professionnels se manifeste dans la
manière de l'organisation humaine des groupes de travail. Chacune de ces unités est
composée d'un maître artisan, un artisan, un compagnon et un apprenti. De cette façon, elle
comprend des membres qui n'ont pas le même niveau de connaissance du métier. En
structurant les unités de production de cette manière le chef de cette entreprise vise, selon
ses propos, d'assurer un bon encadrement pour les novices dans le métier et d'assurer la
transmission des différents savoirs relatifs au métier aux nouvelles générations. Il déclare à
ce propos :
145
Pour perpétuer notre métier, il est important que les nouvelles générations apprennent ses ficelles. Cet apprentissage doit être bien planifié et assisté par des maîtres artisans dotés des savoirs approfondis du métier et des expériences professionnelles assez longues. C'est pour cette raison j'ai divisé mon effectif en groupes composés des personnes expérimentées et d'autres qui font leurs premiers pas dans le métier. Ceci permet de développer les compétences au sein l'entreprise. D'ailleurs, c'est la seule et la meilleure façon pour faire assurer la continuité de notre métier qui est notre fierté. Certes en appliquant ce modèle d'apprentissage j'envisage le développement des capacités professionnelles des membres de mon entreprise, mais aussi j'envisage que les anciens du métier transmettent leurs différents savoirs aux nouveaux dans le métier.
Avec une telle perspective, le chef d'entreprise témoigne de sa conscience de l'importance
de la transmission des savoirs professionnels dans la construction des compétences
professionnelles et dans la conservation du métier de la disparition. Aussi, il témoigne de
son attachement au métier de la poterie artisanale. C'est pour cette raison, il veille lui-
même sur le déroulement du processus de la formation des novices. Lors de cette
formation, qui est indissociable de l'activité productive, l'apprenti acquiert les
compétences en situation de travail. En effet, cette formation peut être considérée comme
une formation de type informel. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas organisée ni
structurée. Au contraire, ses objectifs sont bien clairs et sa durée est bien précise. Deux
raisons amènent à la qualifier d'informelle : elle s'effectue en même temps que les
activités quotidiennes de la production et elle ne mène pas à une certification. Elle repose
entièrement sur la transmission directe des différents savoirs professionnels qui se
rapportent au métier d'un ancien à un novice.
Effectivement, l'acquisition des compétences (les différents types de savoir professionnel),
dans l'entreprise A2 se déroule en trois phases qui se succèdent : une phase d'initiation au
métier, une phase d'évaluation et une phase d'intégration.
Lors de la phase d'initiation, l'individu est reconnu en tant qu'un apprenti à temps plein. Il
ne participe pas concrètement à la production. Il se contente de regarder les autres dans leur
travail ainsi d'écouter les discussions relatives à la production qui se déroulaient entre les
anciens dans le métier. Dans cette phase, l'apprenti passe d'une façon successive d'une
unité de production à une autre. Il commence par la première étape du processus de la
146
production, qui est la préparation de l'argile, pour en finir avec la dernière étape ; la
cuisson. Tout au long de ce processus, l'apprenti est supervisé par le maître artisan de
l'unité par laquelle il passe. L'observation effectuée dans cette entreprise montre que
l'apprenti profite des temps de pause pour essayer quelques gestes et tâches de production.
En dépit de sa participation non active dans le processus de la production, l'apprenti reçoit
pendant cette première période de formation une indemnité hebdomadaire de 30 dinars
tunisiens (à peu près 20 dollars canadiens). La durée de cette période est la même pour tous
les membres, elle est de six mois. Au bout de ces six mois, l'apprenti passe à la deuxième
phase d'apprentissage, l'évaluation, sans changer de statut. Il est considéré toujours en tant
qu'apprenti.
Pendant la phase de l'évaluation, l'apprenti refait le tour des différentes unités de
production. Mais cette fois-ci, il participe effectivement dans les tâches relatives à la
production. Ici le maître artisan fournit les informations nécessaires pour exécuter la tâche,
dicte les gestes à faire et corrige les erreurs de l'apprenti tout en informant le chef
d'entreprise de l'état d'avancement de l'apprenti. Lors de cette phase, l'apprenti voit son
indemnité hebdomadaire se doubler. La durée de l'évaluation est aussi de six mois.
Après une année passée dans l'entreprise, l'apprenti change de statut. C'est le chef de
l'entreprise, en collaboration avec son frère et les maîtres artisans, qui décident du sort de
l'apprenti. Deux voies s'ouvrent devant l'apprenti, soit de côtoyer les maîtres artisans dans
la tâche de façonnage ou de côtoyer les membres des unités de la préparation de l'argile et
de la cuisson. Dans le premier cas, l'apprenti devient un compagnon. Cela signifie qu'il fait
la preuve d'un bon apprentissage du métier qui lui permet de devenir un artisan dans la
poterie artisanale. Selon les maîtres artisans, ceci dépend de plusieurs facteurs relatifs à
l'apprenti. Un apprenti qui peut avoir le statut d'un compagnon est celui qui manifeste
qu'il est doué, qu'il a une bonne capacité d'apprentissage, qu'il est habile et qui aime le
métier. Dans le cas inverse, l'apprenti est dirigé vers, soit l'unité de la préparation de
l'argile soit l'unité de cuisson. Il sera considéré comme un ouvrier.
Pour les compagnons ils continuent à apprendre le métier, mais cette fois-ci ils sont
intégrés activement dans le processus de la production. En effet, c'est la troisième phase de
147
l'apprentissage qui se déclenche à ce niveau. Le compagnon profite ici d'un encadrement
plus aigu de la part du maître artisan. Ce dernier lui donne l'occasion de monter de temps
en temps sur le tour de façonnage tout en lui transmettant les astuces lui permettant
d'améliorer la qualité de la production. La durée de cette phase varie d'un compagnon à un
autre. L'analyse des données recueillies montre que la durée de cette période dépend
d'autant plus du maître artisan que du compagnon. Après cette période d'intégration, le
compagnon devient, suite à la décision partagée encore une fois entre le chef d'entreprise,
son frère et le maître artisan qui supervise le compagnon, un artisan qui s'approprie un tour
(l'outil principal de production : Annexe 14). Néanmoins, le processus d'apprentissage ne
s'arrête pas à cette phase. L'artisan continue à être encadré par le chef d'entreprise, son
frère et les maîtres artisans qui évoluent dans l'entreprise. Ces derniers continuent, vu leur
ancienneté dans le métier, à lui transmettre des savoirs professionnels supplémentaires.
L'analyse des différentes phases d'apprentissage montre que l'acquisition de la compétence
professionnelle au sein de cette entreprise s'effectue dans les interactions quotidiennes. Elle
est donc une relation de compagnonnage par excellence qui est structurée par une
transmission systématique des différents savoirs professionnels relatifs au métier de la
poterie artisanale. Cette transmission' ne concerne pas uniquement les savoirs d'ordre
technique et pratique. Elle concerne également la transmission des normes et des valeurs de
l'entreprise et du métier. Bref, elle s'étend à la transmission de la culture de l'entreprise et
du métier. Un tel constat est issu de l'observation des situations concrètes d'apprentissage.
Notre séjour dans cette entreprise nous a permis de constater que l'apprenti, lorsqu'il est
intégré dans une unité donnée, n'est pas considéré comme un simple apprenti par les autres
membres de l'unité. Il est plutôt considéré en tant qu'un enfant qui est à leur charge. Donc,
ils doivent l'éduquer pour bien se comporter dans l'entreprise en particulier et dans la vie
en général. Cela signifie qu'ils lui transmettent un savoir être lui permettant de bien avancer
dans le métier et dans la vie. Autrement dit, ils lui transmettent le système de valeurs qui
régit le métier ainsi que celui qui régi l'entreprise.
À la lumière de ce qui précède, la transmission des différents types de savoirs
professionnels est le vecteur principal de la construction des compétences professionnelles
dans l'entreprise A2. En dépit de son caractère informel, cette transmission est dûment
148
structurée et s'effectue d'une manière progressive. De même, elle prend en considération
les capacités biologiques ainsi que cognitives de l'individu. Ceci confirme, donc, notre
constat dégagé lors de la présentation des états de lieux dans l'entreprise Al : la culture du
métier de la poterie artisanale valorise et favorise la transmission intergénérationnelle des
compétences professionnelles.
En conclusion de ce chapitre, l'innovation et la transmission des savoirs professionnels
occupent une place importante au sein des entreprises de la poterie artisanale. Cette réalité
concerne tant les entreprises appartenant à l'ancienne génération que celle faisant partie de
la nouvelle génération. Ce faisant, le métier de la poterie artisanale est propice à la
coexistence de ces deux phénomènes (l'innovation et la transmission des savoirs
professionnels) qui sont indispensables à leur pérennité et prospérité dans le contexte de la
globalisation. La question qui se pose ici : est-ce que cette réalité concerne tous les métiers
ancestraux. Dans ce qui suit, nous traitons de cette question en mettant l'accent sur deux
autres entreprises pratiquant un autre type de métier ancestral : le tapis de sol.
149
Chapitre 6. Le cas du tapis de sol (B)
Après avoir décrit et présenté dans le chapitre précédent les états des lieux de l'innovation
et de la transmission des savoirs professionnels dans un contexte d'un métier ancestral
connaissant la prospérité, ce chapitre est consacré à la description et la présentation des
états des lieux de ces deux dynamiques dans un contexte d'un métier connaissant une
situation inverse : le déclin. Le métier en question est celui du tapis de sol. Ce métier est
répertorié par l'Office National de l'Artisanat dans le domaine des métiers du tissage45. Ce
dernier représente l'activité artisanale la plus dominante en Tunisie. Il emploie en 2007
73 % de la population artisane du pays46. Au cours des deux dernières décennies, il connaît
un véritable déclin. Les investissements dans les métiers du tissage ont passé de 404 000
milles dinars tunisien en 2003 à seulement 100 milles dinars en 2006. Le nombre d'emploi
crée par ce domaine de métier a connu à son tour l'abaissement. Il est passé de 750
emplois crées en 2003 a 224 seulement en 2007. Le cas du métier du tapis de sol,
constituant le métier le plus notable de l'artisanat de tissage en Tunisie avec 54%47 de la
population artisane du pays, illustre bien cette chute du domaine des métiers de tissage. La
production nationale en mètre carré du tapis de sol est passée de 601 264 m2 en 1988 à 149
093 m2 en 200948. En effet, la production des tapis a régressé de 75 % en 20 ans. La chute
du nombre des pièces produites représente un autre témoin de la régression de la
production artisanale des tapis du sol en Tunisie. Ce nombre est passé de 70 000 pièces en
2006 à seulement 58 000 en 2008. Cette chute est due à la baisse de la demande locale du
tapis tunisien ainsi qu'à la diminution de la demande internationale de ce type de tapis.
D'ailleurs, les exportations du pays en matière de tapis du sol ont connu une baisse
phénoménale. Ces exportations sont passées de 9,5 millions de dinars tunisiens en 1993 à
2,29 millions de dinars en 2009. Ces différents chiffres montrent que l'inscription de la
Tunisie dans les logiques de la globalisation n'était pas avantageuse pour l'artisanat du
45 Ce domaine de métiers est composé de cinq différents métiers : Tapis du sol, Tissage manuel, filature manuelle, teinturerie traditionnelle, tapisserie murale et couverture en laine.
ONA, Les statistiques de l'office National de l'artisanat, Répartition des artisans selon les groupes de métier, Document imprimé.
Centre Technique de Création, d'Innovation et d'Encadrement du Tapis et de Tissage, Etude sur la production des revêtements du sol fait main (tapis et tissage ras), CTCIETT, 2008.
Site Officiel de l'Office National de l'Artisanat, Les chiffres clefs de l'artisanat tunisien, http://www.onat.nat.tn/site/fr/article.php?id_article=1000, consulté le 23/09/2010.
150
tapis de sol comme c'est le cas pour l'artisanat de la poterie artisanale évoqué dans le
chapitre précédent. Avec l'ouverture de l'économie, le tapis tunisien se trouve en
concurrence sur le marché international et même sur le marché local avec des tapis
fabriqués dans les pays asiatiques. Ce type de tapis se distingue des tapis tunisiens,
principalement, par son bas prix.
L'artisanat du tapis de sol n'était pas donc en mesure de réaliser ses responsabilités
économiques et sociales : la création de la richesse et la création des emplois, dans le
contexte actuel. Il ne peut pas, en effet, jouer un rôle dans la conservation d'une partie de
la culture locale dans la mesure où cette situation peut amener les artisans à délaisser ce
métier historique. De ce fait, les entreprises de tapis de sol représentent un milieu adéquat
pour comprendre les dynamiques de l'innovation et celles de la transmission des savoirs
professionnels dans un contexte de crise. Pour ce faire, nous avons étudié deux entreprises
de ce métier, une domestique et une autre non domestique. Ces deux unités sont localisées
dans la ville du Kairouan, qui constitue le premier pôle de la production artisanale du tapis
et le deuxième centre de la production artisanale tous métiers confondus en Tunisie. Ce qui
suit présente, au début, brièvement un aperçu général de la production du tapis de sol à
Kairouan. Ensuite, les états des lieux de l'innovation et de la transmission des savoirs
professionnels au sein des entreprises en question seront présentés successivement.
1. Tapis artisanal de Kairouan : la ville et le métier
1.1 La ville de Kairouan
La ville de Kairouan est située au centre de la Tunisie à 150 km de la capitale Tunis. Elle
est le chef-lieu d'un gouvemorat composé de douze communes. Cette ville s'étend sur une
superficie de 2935 km2. Selon le dernier recensement de la population en Tunisie, qui date
de 2004, la population de la ville de Kairouan comptait 117 903 habitants. La carte suivante
situe le gouvemorat du Kairouan et présente les différentes communes qui le composent.
151
Carte 2: Gouvemorat de Kairouan
La ville de Kairouan, qui est inscrite depuis 1988 par l'UNESCO sur la liste du patrimoine
mondial, est une ville assez jeune. Sa fondation remonte à la période de la conquête
musulmane de l'Afrique du Nord. Elle fut la première ville fondée par les musulmans dans
cette région. Cette ville a été fondée en 670 pour constituer la quatrième ville construite
par les musulmans dans le monde. Kairouan est la première ville sacrée en Afrique du
Nord. Elle est considérée, après la Mecque, la Médine et Jérusalem, en tant que la
quatrième ville sainte en Islam (Smine, 2008). Plusieurs événements historiques ont
marqué son histoire. Le départ de Tarek Ibn Zied49 pour la conquête de l'Espagne reste
sans aucun doute le plus saillant de ces événements. Le résultat de cette conquête fut la
fondation de la civilisation arabo-andalouse qui a rayonné sur le monde méditerranéen plus
de 700 ans, entre 712 et 1492. Depuis sa fondation, la ville de Kairouan a constitué un
véritable centre de savoir dans le monde arabo-musulman. Son université scientifique et
culturelle a eu une influence considérable dans le monde depuis le neuvième siècle. Jadis,
les étudiants venaient de l'Europe et de l'Asie pour suivre des cours dans cette université.
Cette dernière a donné naissance à des savants musulmans reconnus jusqu'à nos jours par
leurs découvertes et leurs apports à la science. De même, cette université a donné naissance
à des écrivains et des poètes romantiques ainsi qu'à des artistes dans divers domaines. En
dehors de son aspect spirituel et scientifique, Kairouan demeure une ville d'art et
d'artisanat. Ce dernier constitue, après l'agriculture, la deuxième source de richesse
Tariq ibn Ziyad ou Tarik Ibn Ziyâd est né au viie siècle, mort à Damas vers 720, est un stratège militaire de l'armée omeyyade probablement d'origine berbère. Il fut un des principaux acteurs de la conquête islamique de la péninsule ibérique.
152
économique de la ville. Elle s'est dotée depuis longtemps d'un artisanat qui lui est
spécifique. La fabrication des tapis de sol reste la plus grande activité artisanale qui fonde
la célébrité de Kairouan. Le grand monument de tapis à l'entrée de la ville témoigne de la
place prépondérante qu'occupe cette activité. La prochaine photographie illustre ce
monument.
Photographie 2 : Entrée de la ville de Kairouan
1.2 Tapis de Kairouan : aperçu général
La fabrication des tapis, qui fait parti des métiers de tissage, constitue l'une des activités les
plus anciennes pratiquées en Tunisie. Le grand historien et sociologue du Maghreb Ibn
Khaldûn50 le précise clairement dans le passage des prolégomènes où il décrit les Berbères ;
les autochtones de la Tunisie. Il écrit à ce propos :
[...] C'est pourquoi ils n'ont que très peu de villes, c'est pourquoi aussi les arts y sont rares et précaires sauf pour le tissage de la laine, le tannage et le traitement du cuir. (Ibn Khaldûn, 1978 : 823).
Ainsi, le tissage du tapis constitue bel et bien une partie intégrante du patrimoine culturel
de la Tunisie. D'ailleurs, les poètes grecs au huitième siècle avant Jésus Christ louangeaient
les tapis de Carthage, la capitale de la Tunisie ancienne. Cette activité est répandue jusqu'à
50 Ibn Khaldûn, de son nom complet Abou Zeid Abd ur-Rahman Bin Mohamad Bin Khaldûn al-Hadrami, né le 27 mai 1332 à Tunis et mort le 17 mars 1406 au Caire. Sa façon d'analyser les changements sociaux et politiques qu'il a observés dans le Maghreb et l'Espagne de son époque lui vaut d'être considéré comme étant à l'avant-garde de la sociologie. Mais Ibn Khaldûn est surtout un historien de premier plan auquel on doit la Muqaddima (traduite par les Prolégomènes et qui est en fait son Introduction à l'histoire universelle) et Le Livre des exemples ou Livre des considérations sur l'histoire des Arabes, des Persans et des Berbères. Ce sont deux ouvrages résolument modernes dans leur méthode, Ibn Khaldûn insistant dès le début sur l'importance des sources, de leur authenticité et de leur vérification à l'aune de critères purement rationnels.
153
nos jours sur tout le territoire tunisien. L'annexe 15 présente une carte des principaux
centres de fabrication artisanale du tapis en Tunisie. La ville de Kairouan constitue le
premier centre du pays dans la matière. En 2007, cette ville a produit a elle seule 20 % de la
production nationale estompée51. D'ailleurs, cette activité représente la spécialité et
l'exclusivité de cette ville. Tous les foyers de Kairouan sont dotés d'un métier à tisser qui
est l'outil de base dans la fabrication des tapis. Il devient donc évident de trouver une
catégorie de tapis en Tunisie qui porte le nom de cette ville : Tapis de Kairouan (Poinssot et
Reveaut, 1957 ; Masmoudi, 1983).
Ce dernier constitue un produit phare qui est fabriqué un peu partout en Tunisie. Le Tapis
de Kairouan comprend plusieurs variantes. La variante la plus célèbre est nommée
«Alloucha». Elle reprend les caractéristiques du tapis traditionnel de la région. Ce type de
tapis est une création purement locale vers le début 19e siècle, il est fait par une famille
kairouanaise en réaction à l'introduction de mauvais éléments qui ont altéré la qualité du
tapis tunisien. Néanmoins, la production du tapis ne date pas seulement de cette époque.
Dés sa fondation, la ville de Kairouan était un centre de production de tapis. Au septième
siècle, la ville était la capitale des Aghlabides52. Elle payait déjà son tribut de souveraineté
au Calife à Bagdad (la capitale de l'empire islamique de l'époque) en tapis (Ibn Khaldûn,
1978). Ceci témoigne de l'ancrage de cette activité dans les traditions ancestrales de cette
ville.
Le tapis de Kairouan (Alloucha) se distingue des autres catégories de tapis par la
technique de réalisation, la matière première utilisée, la forme, les couleurs et les motifs.
Cette catégorie utilise la technique du point noué54 à la main. Elle est fabriquée à la base de
la laine du mouton dans la mesure où l'élevage de ce dernier constitue une autre
51 La direction de la qualité, de la recherche et de l'innovation, Statistiques de la production nationale estompée de tapis et tissage et exportation contrée, Ministère du commerce et de l'artisanat, 2008, p.7. 52 Les Aghlabides sont une dynastie d'émirs issue de la tribu arabe des Banu Tamim originaire du Khorassan. Elle est Première dynastie arabe ayant régné sur l'ifriqiya au nom du calife abbasside, de 800 à 9091, elle compte onze souverains avant d'être évincée avec l'installation des Fatimides.
En Tunisie les tapis et tissages couvrent une gamme de produits qui regroupe les tapis classiques en laine, les tapis classique en soie, les tapis Berbères, les Gitifs, les Margoums , les Clims et les tapisseries. 54 Dans le domaine de fabrication du tapis deux techniques sont distinguées. La première technique, à la quelle appartient le tapis du Kairouan, est la technique du point noué. Les tapis réalisés via cette technique se caractérisent par son épaisseur et son poids ainsi que sa meilleure tenue au sol. La deuxième technique est celle du point tissé. Les tapis réalisés par cette technique se distinguent des tapis à point noué par leur légèreté. Il sont appelé en Tunisie comme en orient Mergoums et Klims et non pas tapis.
154
caractéristique de la ville en question. Le tapis de Kairouan peut avoir plusieurs
dimensions, mais il est toujours dans une composition rectangulaire formé d'un champ
central large où se dispersent des motifs géométriques. Ces motifs véhiculent un aspect
symbolique. Ce tapis incorpore des éléments traditionnels rappelant des coutumes et des
moments historiques de la ville. Il imprégnait de rites et de mœurs régionaux et
traditionnels. De ce fait, le tapis constitue un véritable support de la mémoire collective et
de la culture de la ville. Le tapis emplit donc une double fonction : une fonction pratique et
une autre symbolique. Le champ central du tapis est bordure par des bandes parallèles. En
ce qui à trait à la coloration, le tapis de Kairouan se caractérise par l'utilisation des teintes
naturelles.
Le tapis de Kairouan, qui est un produit fait main dans sa totalité, est réalisé à l'aide de
trois principaux outils : le métier à tisser, le peigne à tisser (khlela) et les ciseaux.
1. Le métier à tisser, constituant l'outil principal dans la fabrication artisanale des tapis, se
présente sous la forme d'un cadre sur lequel le tapis est noué. Il est composé de deux banes
sur le côté, d'une barre près du sol et d'une autre en hauteur. Les deux barres de côté
permettent d'appuyer le métier à tisser contre le mur. La barre d'en haut et celle d'en bas
servent à étendre la chaîne55. Cette chaîne, qui est constituée de fils en coton, est nécessaire
pour la réalisation des nœuds composant le tapis. La préparation de la chaine est une
opération préalable au tissage constituant l'opération principale dans la fabrication du tapis.
De ce fait, on distingue deux phases principales dans la fabrication : la préparation de la
chaine, appelée aussi ourdissage, et le tissage. L'annexe 16 présente une photographie du
métier à tisser.
2. Le peigne, qui est fabriqué en bois et en métal, sert à regrouper et tasser les rangs de
nœuds à la fin de chaque rangée du tapis. L'annexe 17 présente une photographie du
peigne.
3. Les ciseaux servent à couper les velours du tapis une fois qu'une ou plusieurs rangées
sont nouées.
55 La chaîne désigne l'ensemble des fils tendus entre les barres du métier à tisser. Elle sert de support à la trame qui désigne les fils passé entre les fils de la chaîne. La trame, qui constitue les motifs du tapis, reste la seule visible à la fin de l'ouvrage.
155
1.3 Le tapis de Kairouan aujourd'hui
Avec le 1/5 de la production nationale, Kairouan constitue donc le fleuron des tapis faits
main en Tunisie. Cet artisanat emploie, selon les dernières statistiques de la délégation
régionale de l'artisanat en 2010, 25 000 personnes. Cet effectif, qui est composé en quasi-
majorité de femmes, représente 83 % de la population artisane de la ville en question. Plus
de la moitié de ces artisanes détiennent des cartes professionnelles. Le nombre exact des
artisanes qui possèdent ce genre de carte, selon la délégation régionale de l'artisanat, est de
13 715. En dépit du nombre assez élevé des personnes, le nombre d'entreprises enregistrées
reste peu élevé. La ville de Kairouan compte uniquement 11 entreprises de tapis qui sont
enregistrées aux répertoires de l'ONA. Une telle situation signifie que la majorité des
artisanes exercent le métier d'une façon informelle. D'ailleurs, l'enquête dans cette ville
nous a permis de constater qu'une majorité écrasante de la production s'effectue dans un
cadre domestique non organisé.
Dans le cadre de la stratégie nationale visant la promotion de l'artisanat en Tunisie,
plusieurs mesures ont été entreprises en faveur du secteur du tapis en Tunisie en général et
à Kairouan en particulier. Sur le plan national, l'année 2007 voit la création du Centre
Technique de Création, d'Innovation et d'Encadrement du Tapis et de Tissage. Ce centre a
pour missions principales :
1) Encadrer et assister les artisanes pour développer les méthodes de travail, améliorer la
qualité des matières premières et les diversifier;
2) Encourager la création et la rénovation en sauvegardant l'originalité et le patrimoine
national;
3) Développer et la promouvoir des compétences et le savoir-faire artisanal;
4) Fournir l'assistance nécessaire aux artisanes, aux entreprises artisanales et aux
groupements spécialisés dans le domaine pour la modernisation des méthodes de
production et de l'outillage d'une part, et l'amélioration des techniques et la promotion de la
qualité d'autre part.
156
En plus de ce centre national, Kairouan voit récemment la création d'un centre technique
du tapis et du tissage. Ce centre, mis œuvre en avril 2009, vise entre autres la relance de la
production du tapis dans la ville. Selon les statistiques de la délégation régionale de
l'artisanat, la production actuelle des artisanes kairouanaises en surface est d'une moyenne
25000 mètres carré56. Ceci ne représente que le 'A de la production de la ville au début des
années 1990. Le site internet officiel du gouvemorat de Kairouan, www.Kairouan.org,
indique que la production de la ville en surface en 1993 est de 97495 m2. La grande
différence entre ces deux chiffres reste un véritable indicateur de l'état de déclin et de crise
que connaît le secteur de la production du Tapis artisanal à Kairouan. Cette production
continue à chuter à grande vitesse. La production de la ville a baissé de 22% au cours d'une
seule année. Elle est passée de 43 725 m2 en 2008 à 33 714 m2 en 2009 (Zaghouani,
2010). Sans entrer dans la recherche des causes de cette crise, nous avons étudié deux
entreprises de tapis du sol dans la ville en question. Notre objectif était de comprendre les
dynamiques d'innovation et celles de la transmission des savoirs professionnels dans ce
type d'entreprise. Comme dans le cas de la poterie artisanale, les deux unités étudiées ici
appartiennent aux deux grandes catégories structurant le domaine des entreprises artisanales
en Tunisie, soit une entreprise domestique (BI) et une autre non domestique (B2).
54 Barrouhi (A), Retour vers le futur, Jeune Afrique, http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2515p073-074.xml0/industrie-agriculture-cimenterie-irrigationretour-vers-le-futur.html, consulté le 27/09/2010.
157
2. L'entreprise BI : l'entreprise domestique
Tel qu'il a été précisé précédemment, la forme domestique constitue la forme la plus
répandue et la plus ancienne de la production de tapis dans la ville de Kairouan. De ce fait,
il était important de focaliser l'attention sur cette forme de production dans le cadre de cette
étude afin de rendre compte de la production artisanale du tapis dans son état le plus
élémentaire. L'entreprise BI, qui a été le champ de notre étude, reste parmi les rares
entreprises domestiques enregistrées au répertoire de l'ONA. Elle obéit donc au cadre
réglementaire régissant les entreprises artisanales en Tunisie. Bref, elle représente par
excellence une entreprise collective et non pas une unité de production composée d'une
seule artisane travaillant tout seule comme dans la majorité des unités de production à
Kairouan.
2.1 Profil de l'entreprise : l'organisation, la gestion des ressources humaines
et les dynamiques socioculturelles
L'entreprise BI nous a été suggérée par la délégation régionale de l'artisanat de Kairouan
puisqu'elle représente l'entreprise la plus ancienne de la ville. Sa création remonte au début
de la deuxième moitié du vingtième siècle. Elle est actuellement sous la direction de la fille
de Partisane qui l'a créée. Cette fille, âgé de 40 ans et qui n'a jamais eu de formation
scolaire, a appris le métier de sa mère dans cette entreprise. Donc, cette dernière est un
héritage familial qui témoigne de la transmission intergénérationnelle du métier. Selon les
propos de sa propriétaire, l'entreprise BI n'a perdu presque aucune de ces caractéristiques
de départ. Le seul changement réside dans la réduction du nombre des artisanes travaillant
dedans. D'ailleurs, le nombre des métiers à tisser existant dans cette entreprise dépasse
largement le nombre des métiers à tisser en service. Dans l'entreprise BI nous avons repéré
l'existence de dix métiers à tisser, dont six qui sont hors service. Les quatre autres métiers
sont occupés par six femmes d'ancienneté différente au sein de l'entreprise. Il est à noter ici
que le nombre de personnes qui peuvent travailler sur le même métier à tisser est variable.
Il varie, en fonction de la largeur du tapis, entre une et trois personnes.
158
2.1.1 L'organisation du travail
Sur le plan organisationnel, l'entreprise BI est constituée d'une seule unité de production
qui regroupe tous les membres évoluant dedans. Pour autant, il existe une certaine division
de travail. Cette division, qui est faite en fonction des compétences professionnelles des
membres de l'entreprise, concerne uniquement les tâches et non pas l'espace du travail.
Effectivement, cette entreprise se composait d'une seule pièce. Dans cette dernière, faisant
partie de la maison de la propriétaire, se déroulent les deux opérations principales de la
production : l'ourdissage et le tissage. Ces deux opérations constituent deux tâches séparées
dans le processus de la fabrication du tapis. Dans cette pièce s'installe les quatre métiers à
tisser contre le même mur l'un à coté de l'autre et forment ensembles une même ligne sur
laquelle s'associent les artisanes lors de la production. Les différents coins de cette pièce
sont utilisés pour ranger la matière première (la laine) et le produit final (les tapis).
À propos de la tâche d'ourdissage, elle consiste à la préparation de la chaîne sur laquelle
sera tissé le tapis. Cette tâche requiert un ensemble de savoirs et de techniques qui diffèrent
des savoirs et des techniques requis pour le tissage. C'est la chef d'entreprise toute seule
qui prend en charge l'ourdissage dans l'entreprise BI. D'ailleurs, l'analyse des données
recueillies dans cette entreprise montre que deux artisanes des six a, qui travaillant avec
cette chef, disposent des connaissances nécessaires leurs permettant de réaliser la tâche
d'ourdissage. Relativement au tissage, elle se décompose de quatre activités principales qui
font ensemble un cycle répétitif57. Cette tâche est effectuée par tous les membres de cette
entreprise y compris la chef. De ce fait, cette dernière ne se contente pas uniquement de
l'ourdissage, elle participe également dans le tissage. Elle est donc impliquée dans le
processus de la production tout entier. En plus de cette implication, la chef prend en main,
pareillement, la gestion et l'organisation du travail, l'approvisionnement de matière
première et la commercialisation de la production. Ainsi, elle a les traits de l'image des
57 Les activités qui composent la tâche de tissage sont : 1- l'enroulement du fil de la laine autour des deux fils du coton qui constitue la chaine. Cette activité est dite nouage dans la mesure à son issue se façonnent les nœuds qui constituent le tapis 2- L'insertion d'un fil, appelé fil de trame, pour séparer les rangées de nœuds. En générale, chaque deux rangée de nœuds sont séparées par un fil de trame. 3-Le tassage des rangs de nœuds et des fils de la chaîne à la fin de chaque rangée de nœuds du tapis. Le coupage du surplus de la laine une fois une rangée est nouée.
159
chefs d'entreprises artisanales de métiers ancestraux décrite par la littérature traitant de ce
genre d'entreprises.
La place éminente qu'occupe la chef dans cette entreprise est traduite, également, par la
centralisation du pouvoir. Cette centralisation se manifeste clairement lors de la prise des
décisions concernant la production. C'est la chef qui décide, sans consulter aucune des
artisanes qui l'accompagne, le modèle et la taille du tapis à tisser ainsi que toutes les autres
affaires se rapportant au déroulement de la fabrication. Les autres artisanes n'ont qu'a
exécuté la tâche de tissage. En réponse à une question sur leurs rôles dans l'entreprise, les
six artisanes ont répondu presque toutes de la même façon. Les réponses se centrent autour
de la restriction du rôle des artisanes au tissage uniquement et de la monopolisation par la
chef d'entreprise de la prise de décision. Une telle monopolisation signifie la présence
d'une hiérarchie au sein de cette entreprise. Cette hiérarchie peut être qualifiée de très
simple puisqu'elle est composée de deux catégories : la chef d'une part et les artisanes qui
travaillent avec elle d'autre part. Cette hiérarchie n'est pas donc structurée en fonction des
compétences professionnelles, mais en fonction de la disposition des moyens de
productions. Cette logique de distribution du pouvoir au sein de cette entreprise est
confirmée par l'absence des catégories professionnelles distinctes. Cette absence n'exprime
nullement la standardisation des compétences et des expériences professionnelles au sein
de cette unité de production. En revanche, il est facile de distinguer les artisanes qui
évoluent dans l'entreprise BI par leurs anciennetés dans le métier. L'écart entre ces
artisanes est nettement remarquable. Une des artisanes a une ancienneté dans le métier qui
dépasse l'âge de l'ensemble des membres de l'entreprise y compris la chef. En parlant de
son expérience professionnelle et de l'histoire de l'entreprise, cette artisane, âgé de 62 ans,
dit:
Depuis l'âge de douze ans je tisse les tapis [...] C'est ma tente qui m'a appris le métier [...] je me rappelle bien de la naissance de la chef de cette entreprise. Lorsqu'elle est née je travaille déjà avec sa mère dans ce même endroit. On était plus que dix femmes travaillant ensemble ici. (Artisane, 62 ans)
En tenant compte de ce qui précède, l'organisation du travail dans cette entreprise est de
nature très simple. Deux raisons expliquent cette conclusion. D'une part, sa structure
d'organisation est typiquement artisanale (Mintzberg, 1982) puisqu' elle est composée
160
d'un seul groupe organisé d'une façon informelle. Ce caractère informel se traduit, entre
autres, dans l'absence d'un horaire fixe de travail. Les artisanes viennent à l'entreprise
après avoir terminé leurs tâches domestiques. En effet, l'organisation temporelle du travail
n'obéit à aucune réglementation. D'autre part, elle est constituée d'une seule unité
organisationnelle.
2.1.2 La gestion des ressources humaines
Outre la simplicité de son l'organisation, l'entreprise BI se caractérise par une négligence
totale de la gestion de la dimension humaine. À travers ses discours, la chef de cette
entreprise témoigne d'une ignorance totale du rôle important que peut jouer cette dimension
dans le fonctionnement de l'entreprise. C'est pourquoi, aucun des outils de gestion de
ressources humaines, à l'exception de la gestion des rémunérations, n'a été repéré dans la
présente unité de production.
Pour ce qui est de la gestion des individus au sein cette entreprise, il n'existe aucune façon
à travers laquelle les membres peuvent réaliser une mobilité professionnelle ou financière.
Toutes les artisanes travaillant dans BI ont passé par le même parcours pour atteindre le
même point. Cinq des six artisanes ont appris le métier dans la même entreprise. Au début,
elles sont acceptées en tant qu'apprenti. Après une période d'apprentissage assez courte,
elles sont intégrées dans la production à titre d'artisane de tapis. La petite taille de
l'entreprise, l'absence des unités organisationnelles ainsi que l'absence des catégories
hiérarchiques restent sans aucun doute des éléments qui ne favorisent pas la présence d'une
échelle professionnelle sur laquelle les artisanes peuvent évoluer. Dans une telle situation,
il devient évident de ne pas prendre en considération le développement des compétences au
sein de l'entreprise. La seule formation professionnelle que peut avoir une personne
intégrant nouvellement l'entreprisse consiste à apprendre uniquement le tissage. De ce fait,
la formation s'arrête à ce niveau et ne s'étend pas aux autres éléments relatifs au métier de
fabrication du tapis. L'absence d'une formation continue exprime principalement la
négligence de l'un des outils les plus classiques et les plus importants de la gestion des
ressources humaines : la gestion des compétences. Toutefois, un outil important de la
gestion des ressources humaines marque sa présence fortement dans cette entreprise. Cet
161
outil concerne la gestion des rémunérations. La chef applique un système de rémunération
qu'elle a hérité de sa mère. Dans la présente entreprise les artisanes sont payées selon leurs
réalisations professionnelles. Elles sont payées en fonction du nombre de rangées tissées.
Assurément ce système de rémunération peut inciter les artisanes seulement à augmenter
leur rythme de travail et non pas à la création et à l'innovation ni à la recherche des
informations supplémentaires en lien avec le métier.
Relativement au collectif du travail, l'entreprise BI est marquée par une absence étonnante
d'une culture du travail qui valorise le travail collectif constituant, entre autres, l'une des
caractéristiques majeures des métiers hérités du passé. L'analyse des discours des artisanes
se rapportant au collectif du travail et l'observation des situations concrètes de la
production montrent que l'esprit individualiste constitue une caractéristique commune à
l'ensemble des membres de cette entreprise. Cet individualisme peut être expliqué par deux
faits : la visibilité au sein de cette entreprise concerne uniquement le travail de l'individu et
non pas le travail du groupe et les pratiques du travail participatif sont totalement
manquantes dans la présente entreprise. Dans cette perspective, l'entreprise BI ne tient pas
compte des outils s'intéressant de la gestion du collectif du travail demeurant
indispensables à la promotion du travail en équipe ainsi que du travail participatif. En plus
de la carence des pratiques du travail participatif, la communication interne constitue un
autre indicateur de l'omission des outils de la gestion du collectif du travail dans cette
unité. La seule communication d'ordre professionnelle qui peut avoir lieu est de nature
descendante. Le contenu de cette communication est toujours un ordre d'exécution dicté
par la chef à une artisane. Au-delà de cette communication, la chef n'aborde guère des
questions relatives au métier et à l'entreprise avec les artisanes travaillant avec elle. De
même ces dernières (les artisanes) ne communiquent entre elles que pour aborder des sujets
qui touchaient leurs vies conjugales et familiales. De ce fait, il n'existe pas une politique de
communication qui peut regrouper les membres autour des enjeux du métier et de
l'entreprise.
Au terme de ce qui précède, la gestion de ressources humaines est complètement absente
dans l'entreprise BI. Ainsi, la dimension sociale, qui est l'une des préoccupations
principales de ce type de gestion, demeure totalement négligée dans cette entreprise.
162
2.1.3 Les dynamiques socioculturelles
La tentative de comprendre les logiques de fonctionnement social, structurant et régissant
les dynamiques socioculturelles de l'entreprise, a abouti au constat le plus remarquable de
l'enquête réalisée dans l'entreprise BI. Ce constat réside dans le rapport relativement
instrumental au travail que manifestent les artisanes évoluant dans cette unité de
production. Pour appuyer ce constat, on cite successivement les propos de la chef et les
propos d'une artisane âgée de 40 ans et qui travaille depuis 8 ans dans cette entreprise.
Avec le décès de mon mari je me suis trouvée sans ressources pour élever mes quatre enfants. J'ai trouvé la solution dans l'entreprise que j'ai héritée de ma mère. Tous mes proches m'ont encouragé à relancer cette entreprise qui est restée inactive depuis le défunt de ma mère. Pour faire cette reprise, j'ai contacté les artisanes qui ont déjà travaillé avec ma mère. Seulement celles qui se trouvent en difficultés financières ont acceptés de réintégrer l'entreprise. D'ailleurs, l'entreprise constitue pour nous toute une ressource indispensable. Si je trouve une ressource plus meilleur je serais prête de changer d'activité afin d'améliorer les conditions de vie des mes enfants. (Chef d'entreprise)
Je travaille seulement pour avoir un revenu supplémentaire car le salaire de mon mari reste insuffisant pour couvrir les besoins de nos trois enfants. D'ailleurs, si mon mari trouve un emploi plus rentable j'arrêterais immédiatement le travail pour s'occuper plus de mon foyer. (Artisane)
Ainsi, le milieu du travail et l'activité professionnelle représentent des moyens pour
garantir un minimum de revenu et non pas des sphères pour acquérir une identité. De ce
fait, l'entreprise et le métier ne constituent pas un espace d'identification pour les artisanes.
Ce rapport relativement instrumental reflète avant tout un faible attachement au métier ainsi
qu'à l'entreprise. Cependant, il ne faudrait pas voir dans ceci un désintérêt total au groupe
du travail. En dépit de cette désimplication affective au travail, l'entreprise représente pour
ses membres un véritable espace de socialisation. Ce constat tient au fait que le travail
constitue pour les artisanes une sphère où elles peuvent développer des sociabilités. Ceci se
manifeste, essentiellement, dans la richesse des rapports sociaux développés. Mais ces
rapports sont totalement en dehors de l'activité professionnelle. Ainsi, l'individualisme et le
détachement par rapport au travail n'affectent pas obligatoirement les dynamiques sociales
de l'entreprise.
163
L'analyse des différents systèmes structurant ces dynamiques montre que l'entreprise BI se
caractérise par la présence d'un système d'acteur composé uniquement de deux types. Le
premier type concerne la chef faisant un acteur à part. Le deuxième type englobe le reste
des artisanes travaillant avec elle. Cette distinction, qui n'obéit pas, encore une fois, à des
critères professionnels, ne signifie nullement la divergence dans les enjeux de ces deux
acteurs. Au contraire, tous les deux partagent le même enjeu : l'augmentation de la
production dans le but de l'accroissement des revenus. Dans un pareil contexte plusieurs
éléments seraient négligés, notamment la qualité des produits, l'innovation et le
développement des compétences. En dépit du fait que cet enjeu est purement
professionnel, les relations entre ces deux acteurs sont loin d'être considérées comme des
relations professionnelles au sens pur du terme. L'analyse du système de relations,
constituant un autre système déterminant dans les dynamiques sociales de l'entreprise,
montre que les rapports existants dans l'unité BI ne se centrent pas autour des affaires
professionnelles. Ils se centrent plutôt autour des affaires extra-professionnelles et
s'étendent en dehors de l'entreprise.
Cette vocation sociale des relations dans cette entreprise est favorisée par le système de
régulation et d'intégration sociale qui les sous-tendent. Ce système ne prend pas le travail
comme élément d'intégration ou de régulation sociale dans l'entreprise. Les pratiques de
convivialité, marquant une grande richesse et se ne rapportant en aucun cas au processus de
la production, constitue le facteur à travers lequel les différents membres sont intégrés dans
l'entreprise. De même, ces pratiques se présentent comme la seule occasion où ces
membres peuvent déterminer ensemble les normes et les valeurs qui régissent les
comportements et les attitudes au travail. Une analyse dans la mémoire professionnelle
collective de ce groupe restreint montre que les moments qui ont marqué le plus cette
mémoire concernent, principalement, les repères qui doivent être suivis par les artisanes
pendant le travail. De ce fait, les guides de conduites dans cette entreprise sont déterminées
par le groupe de travail. Toutefois, la mise en œuvre de ce guide prend en considération,
fondamentalement, les situations sociales des artisanes non pas les exigences d'ordre
professionnels. Par exemple, l'arrivée d'une artisane à l'entreprise pour une journée de
travail est tributaire des ses engagements familiaux. Dans cette perspective, l'entreprise et
le métier ne déterminent en aucun cas les comportements professionnels dans l'entreprise.
164
C'est le groupe qui remplit cette fonction assez déterminante dans le travail. Bref, le groupe
de travail constitue le pilier unique des dynamiques sociales et culturelles au sein de
l'entreprise BI.
Au total, l'entreprise BI se caractérise par une organisation de travail très rudimentaire, une
absence totale des outils de gestion de ressources humaines et des dynamiques
socioculturelles régies uniquement par le groupe de travail et non pas par le métier. Alors
quel est l'état de l'innovation et de la transmission des savoirs professionnels dans un
contexte pareil?
2.2 L'entreprise BI et l'innovation
Au-delà de ses logiques de fonctionnement organisationnelles, humaines et
socioculturelles, l'entreprise BI se démarque de l'ensemble des quatre entreprises étudiées
par la conservation de ses traits de départ. Concrètement, cette entreprise n'a pas connu ni
le changement de ses produits ni l'introduction d'aucun nouveaux éléments depuis sa
création il y' a plus qu'un demi siècle. Cela veut dire que l'innovation est loin d'être une
préoccupation pour l'ensemble des artisanes évoluant dans cette entreprise y compris la
chef. Ce constat est renforcé par la distance que prennent ces artisanes vis-à-vis de
l'innovation. L'analyse des discours recueillis dans cette entreprise montre que l'ensemble
de l'effectif de travail adopte une attitude défavorable à l'innovation. Elles expliquent leurs
attitudes par le fait que le tapis doit être conforme aux normes de production déterminées
par l'Office National de l'Artisanat (ONA). Ce dernier s'occupe de l'authentification du
tapis à travers l'opération de l'estampillage. Cette opération, qui est indissociable du
processus de la production, est expliquée en détail dans l'encadré 2.
165
Encadré 2 : L'estampillage du tapis en Tunisie
Afin de protéger la spécificité et assurer la qualité du tapis tunisien, l'Office National de l'Artisanat imposait une normalisation de la fabrication des tapis. L'estampillage du tapis est une opération à travers laquelle l'ONA contrôle le respect des artisans de cette normalisation. Il consiste à plomber à l'envers de chaque tapis une étiquette portant les indications sur la qualité, la texture, la mensuration, la maquette, la gamme et la date de fabrication du tapis. L'annexe 18 présente un exemplaire de cette étiquette. Cette dernière, qui constitue un label de qualité, est l'affaire d'un ensemble d'experts de tapis engagé par l'ONA pour cette fin. L'estampillage des tapis prend en considération, outre la qualité des matières premières utilisées, les aspects artistiques et physiques ainsi que les spécifications techniques du produit fini. Le refus ou le rejet du tapis au moment de l'estampillage signifie donc le non respect et le non conformité aux nonnes convenues. Un produit non conforme (refusé par les experts de l'ONA) est celui qui ne respecte pas les spécifications propres à chaque type de texture ou celui qui présente un des défauts suivant : le dégorgement du couleur, le changement de ton très visible dans le fond ou le décor, l'irrégularité très remarquée de la coupe, la déformation apparente sur la totalité de l'ouvrage et la déchirure ou la perforation de l'ouvrage.
L'opération de l'estampillage demeure très déterminante dans la commercialisation du tapis
dans la mesure où les consommateurs la prennent en considération lors de leur choix d'un
tapis. Ainsi, les artisanes doivent estamper leur production afin d'avoir la confiance du
consommateur. Toutefois, la crainte de l'estampillage n'explique pas toute seule cette
distance prise vis-à-vis l'innovation par l'ensemble des artisanes de l'entreprise BI. De
l'analyse des discours de ces dernières ressort un autre facteur expliquant cette distance. Ce
facteur réside dans une double inconscience chez les artisanes : l'inconscience de
l'importance de l'innovation pour la survie du métier et de l'entreprise et l'inconscience de
leur rôle dans le développement du métier de tissage de tapis. La chef d'entreprise comme
les artisanes qui l'accompagnent ne voient pas dans l'innovation une solution à la
décadence que connait le secteur du tapis en Tunisie, notamment à Kairouan. À titre
indicatif des discours qui reflètent ces inconsciences, on cite successivement les propos de
la chef d'entreprise et de deux autres artisanes.
Je ne crois pas que l'acquisition d'un nouveau matériel de production va améliorer la qualité de nos tapis ou augmenter la productivité des artisanes. [...]. On a toujours travaillé avec les mêmes outils, de la même façon et dans les mêmes conditions je ne vois pas pourquoi changé maintenant. [...] Ce qui m'intéresse le plus est de réaliser une production qui serait conforme aux exigences. Donc, je ne suis pas prête à changer les modèles que nous
166
produisons depuis longtemps. D'ailleurs c'est l'ONA qui doit s'occuper de ça. (chef d'entreprise)
Depuis mon entrée dans cette entreprise, il y a 8 ans, on reproduit les mêmes modèles et on n'a jamais eu un refus ou rejet à l'estampillage. Je ne vois pas donc une utilité au changement de nos modèles. [...]Moi en tant qu'artisane je ne peux rien faire pour attirer les consommateurs locaux de nouveau aux tapis tunisiens. Ils (les autorités du pays) ont qu'interdire l'importation des tapis de la Chine et comme ça les tunisiens vont être obligés d'acheter les tapis locaux. (Artisane)
Je tisse des tapis en suivant les modèles qui sont fournis par l'ONA. Je n'ai jamais pensé à faire des modifications sur ces modèles ni lorsque j'ai travaillé auparavant à mon propre compte ni depuis mon recrutement dans cette entreprise il y a 5 ans. (Artisane)
Ainsi, l'absence totale d'une culture d'innovation au sein de l'entreprise BI devient une
évidence. L'absence d'une telle culture s'accompagne par un désintéressement total des
nouvelles dynamiques que connait le métier de tissage de tapis surtout au niveau des outils
de fabrication. Les outils de production dans cette entreprise peuvent être considérés
comme très archaïques comparativement aux outils usés dans l'entreprise B2 qui sera
décrite ultérieurement. De même, la non modernisation des outils de la production associée
aux manières de gestion et d'organisation du travail demeurent un indicateur du
désintéressement total de la chef envers les programmes et les mesures mises en œuvre par
l'état tunisien afin de moderniser et mettre à niveau les entreprises artisanales locales. Une
telle attitude peut être facilement comprise compte tenu de la relation instrumentale au
métier éprouvé par cette chef. Le métier constitue pour elle, comme il a été mentionné
antérieurement, un moyen pour gagner sa vie ni plus ni moins. Cette relation ne présente,
sans aucun doute, aucune motivation au changement, notamment à l'innovation qui exige
avant tout l'implication affective de l'individu au métier.
Conformément à ce qui précède, l'entreprise BI renonce complètement à l'innovation.
Les deux actions menant à l'innovation, précisées lors de l'élaboration du modèle d'analyse
et d'observation, sont totalement absentes. Ici, on ne repère pas ni des initiatives créatrices
internes ni l'introduction ou l'acquisition de nouveaux éléments développés à l'externe.
167
2.3 L'entreprise BI et la transmission des savoirs professionnels
Derrière le problème de la gestion des compétences professionnelles, déjà abordé, se cache
un autre problème beaucoup plus important dans l'entreprise BI. Ce problème réside dans
la construction des compétences professionnelles. Cette construction ne constitue pas une
priorité. L'analyse des différentes expériences d'apprentissage vécues par les membres de
cette entreprise renforce ce constat. Ces membres, qui n'ont jamais fréquenté une école ou
un centre de formation professionnel, ne profitent d'aucun suivi ou programme leurs
permettant de développer leurs connaissances professionnelles.
Concrètement, l'apprentissage du métier dans l'entreprise BI est loin d'être un processus
qui se déroule en plusieurs phases. Elle est plutôt une situation très courte et contingente
par laquelle passe rapidement une nouvelle recrue qui ne possède pas en général de
connaissances antérieures du métier. Le but ultime de la mise en situation de cette recrue
est de lui faire apprendre la technique principale de tissage du tapis : le nouage. Dans cette
situation l'apprentie ne reçoit que des informations utiles à l'exécution de cette tâche. De ce
fait, la transmission des savoirs professionnels dans cette entreprise est une opération Ad
hoc. C'est-à-dire elle aura lieu pour un but bien précis : l'intégration très rapide dans le
processus de la production. D'ailleurs, sur les six artisanes travaillant dans cette entreprise
il n'y a que deux seulement qui maîtrisent la tâche d'ourdissage, décrite plus haut, qui
constitue une phase principale dans la fabrication du tapis. Ceci ne peut que confirmer l'un
des principaux constats de l'enquête dans la présente entreprise : la transmission des savoirs
professionnels reste très restreinte. Le passage suivant illustrant l'expérience d'une jeune
artisane âgée de 18 ans qui a intégré récemment l'entreprise témoigne de cette réalité.
Je travaille dans cette entreprise depuis seulement 6 mois. Avant de commencer le travail ici je n'ai aucune idée sur le tissage de tapis. J'ai passé deux ans, après avoir quitté l'école sans diplôme, dans une entreprise de confiserie installée dans la ville. Maintenant je maîtrise bien la fabrication des tapis. Je peux être toute seule sur un métier à tisser. D'ailleurs, je viens d'installer un chez moi. Le soir je tisse à mon propre compte. [...] Malheureusement, ici on n'a pas eu l'occasion d'apprendre la manière de la préparation de la chaîne à tisser (l'ourdissage). Heureusement, j'ai une voisine qui m'aide à sa préparation. [...]. Le métier entant que tel je l'ai appris au bout d'une semaine. Cette semaine été nécessaire pour moi afin d'apprendre le nouage et le coupage des nœuds. Durant cette semaine, la chef m'a fait asseoir à coté d'une ancienne artisane et
168
elle m'a dit de l'observer dans ses gestes. Elle m'a dit aussi que j'ai qu'une semaine pour apprendre le tissage car elle ne peut pas laisser une place occupée pour longtemps. Donc, j'étais très attentive pour pouvoir garder ce travail. Car comme vous le savez, je suppose, il est difficile de trouver un emploi de nos jours. Même ceux qui ont des diplômes sont en chômage. Être accepté ici c'est déjà pas mal pour moi. [...] Je ne vous cache pas je ne cherche pas à être une artisane de tapis tout au long de ma vie. C'est juste pour avoir un revenu. Je suis en contact permanant avec ma cousine qui travaille à Djerba (une ville touristique tunisienne). Elle me cherche un emploi dans le tourisme. Dés qu'elle me trouve un je quitte ici car je sais bien que ce métier va un jour mourir. Si vous visitez les magasins et les marchés tunisiens vous allez me croire je vous le jure. Ces marchés et ces magasins sont envahis par les tapis chinois à prix très bas. [...]. Durant la semaine d'apprentissage, l'artisane qui s'est occupée de ma formation était elle-même pas satisfaite de sa situation professionnelle. Elle aussi comptait quitter le métier. Elle me parlait tout le temps de ça et des ses problèmes financiers. Presqu'elle m'a rien dit sur le métier. Même la chef d'entreprise m'a rien dit. Juste à la fin de la semaine elle est venue me voir. Elle m'a demandé de faire quelques nœuds et après elle m'a donné l'autorisation pour commencer le tissage. Voilà comment s'est passé mon entrée dans l'entreprise. (Artisane, 18 ans)
L'expérience d'apprentissage de cette artisane ne diffère pas beaucoup des expériences de
ses collègues. Elles ont toutes appris le métier presque de la même manière. Les seules
différences résident dans les endroits et les contextes d'apprentissage. Avec une telle
manière d'apprentissage, la transmission des savoirs professionnels ne concerne qu'une
seule dimension de la compétence professionnelle : le savoir-faire. Elle ne s'étend pas aux
autres composantes de cette compétence : les savoir théoriques et le savoir-être. En
absence de ces deux composantes, la transmission des savoirs professionnels s'inscrit dans
une logique valorisant les enjeux économiques immédiats de l'entreprise et non pas les
enjeux socioculturelles de l'entreprise et du métier. Ceci est expliqué par la négligence
totale des pratiques sociales et des rites qui sont liés à l'histoire de l'entreprise ainsi qu'à
l'histoire du métier dans l'opération de la transmission. Un tel constat peut être renforcé par
le faible attachement des membres de cette entreprise à leur univers de travail (le métier et
l'entreprise). Dans des circonstances pareilles, il advient difficile de mobiliser les membres
de cette entreprise aux enjeux socioculturels et même économiques du métier du tapis de
sol qui continue sa chute libre dans le nouveau contexte.
169
Tout bien considéré, l'entreprise BI demeure un univers de travail où le métier du tapis de
sol témoigne de son incapacité à s'accommoder avec aux nouvelles circonstances. Une
telle situation peut être expliquée d'autant plus par la négligence totale dans cette entreprise
de l'innovation et de la transmission intergénérationnelles des différents savoirs relatifs au
métier. D'ailleurs, l'organisation mise en œuvre, la méthode de gestion des ressources
humaines poursuivies et les dynamiques socioculturelles existantes dans l'entreprise restent
non propice à ces deux dynamiques. Il reste à voir maintenant la situation du métier dans
un contexte différent, soit le deuxième cas de figure des entreprises artisanales en Tunisie :
les entreprises à caractère non domestique qui constituent la nouvelle génération des
entreprises artisanales de métiers ancestraux.
170
3. L'entreprise B2 : l'entreprise non domestique
Comme dans le cas de la poterie artisanale, le métier du tapis de sol connaît à son tour
l'apparition d'une nouvelle génération d'entreprises qui se distingue des entreprises de type
domestique. Cette nouvelle génération se caractérise par le déroulement de l'activité de
production dans un endroit aménagé à cette fin. De surcroît, les entreprises appartenant à
cette nouvelle génération obéissent à des logiques et des dynamiques de fonctionnement
qui font d'elles une catégorie distincte dans la production du tapis de sol. Toutefois, elles
continuent à appliquer les mêmes techniques artisanales dans la fabrication. Ces
entreprises pèsent fortement dans le secteur du tapis de sol en Tunisie. Elles produisent une
partie importante de la production nationale. Ceci est dû principalement à la production de
masse qui caractérise ce genre d'entreprise. À titre indicatif, l'entreprise B2 fabrique plus
que 30 tapis par mois alors que l'entreprise BI, qui appartient à la catégorie des entreprises
domestiques, ne produit pas plus que 3 tapis par mois.
3.1 Profil de l'entreprise B2 : l'organisation, la gestion des ressources
humaines et les dynamiques socioculturelles
L'entreprise B2 fait exception dans le cadre de cette recherche. En dépit de son inscription
dans le répertoire des entreprises artisanales, elle ne se conforme pas à un article important
de la loi réglementant le secteur de ces entreprises en Tunisie du moment qu'elle emploie
38 personnes. Selon la loi, une entreprise artisanale est celle qui exerce une activité
artisanale et qui emploi moins de 10 personnes (voir la section qui aborde le cadre
réglementaire et institutionnel en Tunisie, notamment l'article 7 de la loi 106-83 page 34).
Le choix de cette unité à l'étude a été effectué après l'analyse des données de la pré
enquête. Cette analyse a montré que cette entreprise constitue un environnement adéquat
où on peut observer et étudier le métier du tapis de sol exercé dans des entreprises non
traditionnelles. C'est pour cette raison que le nombre des personnes qui travaillent ne fut
pas pris en considération lors de l'échantillonnage. Au-delà du nombre de son effectif, qui
est totalement féminin, l'entreprise B2 se conforme au critère principal mobilisé lors de
l'échantillonnage : l'exercice d'une activité artisanale ancestrale.
171
3.1.1 L'organisation du travail dans l'entreprise B2
En plus du nombre assez élevé de son personnel, l'entreprise B2 se démarque, aussi, du
reste des entreprises étudiées dans le cadre de cette recherche par son chef. Ce dernier, qui
est un homme de 58 ans, n'a suivi aucune formation relative au métier du tissage artisanal
du tapis de sol. Sans jamais pratiquer ce métier, il a décidé d'investir dans ce domaine à la
période où ce type de produit était fortement demandé surtout par les consommateurs
locaux et les touristes qui visitaient en grand nombre le pays chaque année. En s'appuyant
sur un savoir- faire dans le domaine des affaires et du commerce, ce chef a monté cette
entreprise au début des années 1990. Il a aménagé un méga local pour réunir des artisanes
de la ville dans un milieu de travail qui obéit à une structure organisationnelle assez
formelle et se décompose en différentes unités organisationnelles.
Pour ce qui est de la structure de l'organisation de l'entreprise B2, elle est loin d'être une
structure de type artisanal58. Elle est plutôt une structure assez complexe dans la mesure où
son fonctionnement est déterminé par un règlement formel bien déterminé. Bref,
l'entreprise B2 constitue un exemple où on observe la pratique d'un métier artisanal
ancestral dans un contexte organisationnel non artisanal. Ceci se manifeste dans la division
du travail, la hiérarchie et le système du pouvoir structurant l'organisation de l'activité
productive de cette entreprise.
À propos de la division du travail, l'entreprise B2 se caractérise par une division des tâches
et des activités relatives au processus de la production. La division des tâches se présente
comme suit :
1) La tâche d'ourdissage : cette tâche est effectuée par des artisanes spécialisées dans la
matière.
2) La tâche de tissage : cette tâche est réalisée par des artisanes spécialisées dans le
tissage.
58 La structure artisanale, tel qu'elle est définit par Henri Mintzberg, est constitué d'un seul groupe organisé d'une façon informelle. La coordination au sein de ce groupe s'effectue par le biais de la standardisation des qualifications. Elle est, aussi, une structure de petite taille peu élaboré et dans laquelle la division du travail est imprécise.
172
3) La tâche du contrôle de la production : cette tâche est l'affaire des artisanes qui
détiennent le statut d'une chef de ligne. Dans cette entreprise, il existe trois lignes de
production. Chaque ligne est composée de six métiers à tisser qui sont disposés en trois
rangées parallèles. Chacune de ses rangées est sous le contrôle d'une chef de ligne.
4) La tâche de l'organisation de la production : cette tâche est occupée par des artisanes
qui ont le statut de chef d'unité de production. Dans cette entreprise, on distingue deux
unités de production. Ces deux unités seront présentées ultérieurement.
5) La tâche de l'approvisionnement en matière première et de la commercialisation des
produits finis : cette tâche est l'occupation du chef de l'entreprise.
En plus de cette division des tâches, l'espace du travail dans l'entreprise B2 est divisé. Le
local est composé de cinq pièces séparées. Dans la première s'effectue l'ourdissage. Dans
la deuxième se déroule la tâche de tissage. Pour la troisième et la quatrième, elles sont
aménagées successivement au stockage des matières premières et des produits finis. La
cinquième constitue une salle d'exposition. Ainsi, les tâches sont divisées minutieusement
et les activités sont séparées spatialement. Cette division et cette séparation constituent des
indicateurs de la nature non artisanale de la structure de l'organisation de cette entreprise.
Au sujet de la hiérarchie, l'entreprise B2, à l'encontre des entreprises Al, A2 et BI,
fonctionne selon un organigramme bien déterminé. Cet organigramme se compose de
quatre catégories hiérarchiques : le chef d'entreprise, les chefs d'unités de production, les
chefs de lignes de production et les artisanes. Une telle catégorisation témoigne de la
présence d'une ligne hiérarchique au sein de cette entreprise. En dépit que cette ligne soit
de type très court, ceci n'empêche pas la présence d'un système de pouvoir. Ce système est
typiquement autoritaire. Ceci se manifeste principalement dans la prise des décisions se
rapportant à la production. La prise de décision est totalement monopolisée par la chef de
cette entreprise. Malgré que ce dernier ne dispose d'aucune compétence professionnelle
relative au métier, il prend les décisions relatives à la production seul sans consulter ni les
chefs de lignes de production, qui sont des artisanes expérimentées, ni les artisanes de
tissage ou de l'ourdissage.
On étaient jamais consulté lors de la détermination des modèles de tapis à réaliser. Le chef nous prescrit les modèles. Par la suite, en tant que chef de ligne
173
je transmets le message aux artisanes de production. (Chef de ligne âgée de 43 ans).
Ainsi, la centralisation du pouvoir s'ajoute à la division du travail et à la hiérarchie pour
témoigner ensemble de la nature non artisanale de la structure de l'organisation de
l'entreprise B2. Toutefois, la structure de l'organisation ne constitue pas l'unique indicateur
de l'adoption de cette entreprise d'un modèle organisationnel non artisanal. La présence
des unités organisationnelles constitue un indicateur de plus qui confirme cette réalité.
Relativement aux unités organisationnelles composant la présente entreprise, elles sont de
deux ordres : 1) l'unité d'ourdissage et 2) l'unité de tissage. Pour la première unité, elle est
composée de trois artisanes sous le contrôle d'une chef. Les membres de cette unité
effectuent la même tâche qui est la préparation des chaînes de tissage. Cette tâche, qui est
assez complexe, exige que les artisanes disposent de compétences professionnelles
spécifiques. Il leur est principalement demandé principalement de savoir bien calculer les
fils composant la chaîne. Ce calcul se fait en fonction de la largeur du tapis à tisser et du
nombre des nœuds nécessaires pour finaliser ce dernier. Afin d'éviter les erreurs dans la
préparation de la chaîne, les artisanes évoluant dans cette unité se coordonnent
constamment entre elles. En ce qui à trait à l'unité de tissage, elle est sous la supervision
d'une chef autonome. Elle est composée de plusieurs groupes d'artisanes qui s'occupent de
la tâche du tissage. Les membres d'un groupe ne peuvent pas dépasser trois artisanes. Ces
dernières, travaillant ensemble sur un métier à tisser, sont sous la supervision de la chef de
la ligne à laquelle appartient le groupe. Cette chef contrôle les artisanes afin que les
modèles de tissage soient respectés. De ce fait, les artisanes de tissage doivent maîtriser le
nouage59 et doivent être capables de composer les motifs composant le tapis. Dans cette
unité organisationnelle, la coordination et la dépendance entre les groupes sont totalement
absentes dans la mesure où chaque groupe s'occupe de la réalisation d'un tapis d'une façon
autonome. Toutefois, la coordination et la dépendance entre les deux unités de production
marquent une grande présence. Ceci est dû à la dépendance de la qualité du tissage,
effectué par l'unité 2, de la tâche d'ourdissage qui est l'ouvrage de l'unité 1. La
Le nouage consiste à fixer un brin de laine sur deux fils de la chaîne par un nœud. Sachant qu'un seul tapis est obligatoirement composé de plusieurs dizaine de milliers de nœuds.
174
coordination entre ces deux unités s'effectue via l'interaction directe entre la chef de l'unité
de tissage et la chef de l'unité de l'ourdissage.
Comme nous l'avons dit plus haut, l'organisation du travail dans l'entreprise B2 se
démarque du modèle artisanal d'organisation sous deux principaux aspects soit la structure
d'organisation plus au moins complexe et la présence de plus qu'une unité
organisationnelle au sein de l'entreprise.
3.1.2 La gestion des ressources humaines dans l'entreprise B2
Toutefois, l'application d'un modèle organisationnel assez moderne ne s'accompagne pas
par la mise en œuvre des outils de gestion de ressources humaines modernes dans
l'entreprise B2. Ce constat est justifié par l'absence d'une méthode ou d'une politique qui
veille sur la motivation et la stimulation de l'ensemble du personnel au travail, notamment
à l'innovation et à la transmission des savoirs professionnels. Une telle situation témoigne
avant tout de la négligence totale de la dimension humaine dans cette entreprise. Cette
négligence concerne tant de la gestion des individus que de la gestion du collectif de travail.
En liaison avec la gestion des individus, l'entreprise B2 est loin d'être un lieu du travail qui
peut motiver et stimuler les individus aux enjeux de l'entreprise ainsi qu'à ceux du métier
du tapis de sol. L'analyse des situations professionnelles individuelles des artisanes
évoluant dans cette entreprise montre que la gestion des individus ne figure pas parmi les
préoccupations du chef de cette entreprise. Ce dernier, qui s'occupe tout seul de la gestion
et de la direction des affaires internes et externes, n'accorde aucune importance aux
questions relatives à l'évolution professionnelle des artisanes, au développement de leurs
compétences et à l'adoption d'un système de rémunération qui tient compte des réalisations
personnelles de chacune d'elle. Autrement dit, les outils de gestion des carrières, des
compétences et des salaires sont totalement manquants dans le cas de l'entreprise B2. Les
trois constats suivants traduisent cette réalité :
1) L'absence d'une mobilité professionnelle au sein de cette entreprise. En dépit de la
présence de trois catégories professionnelles distinctes (la catégorie des artisanes de
production, la catégorie des chefs d'unité de production et la catégorie des chefs de lignes
175
de production), les chances de réaliser une mobilité sont très faibles, voir nulles. L'analyse
des discours des artisanes qu'elles ont au-delà de cinq ans au sein de cette entreprise et qui
ont participé dans notre enquête montre qu'aucune d'elles n'a connu une évolution dans la
hiérarchie.
2) L'absence d'un suivi et de l'amélioration des compétences professionnelles. Les
artisanes évoluant dans l'entreprise ne bénéficient d'aucune occasion de formation continue
leur permettant de développer leurs compétences professionnelles individuelles. L'analyse
des expériences professionnelles dans cette entreprise montre que les artisanes sont formées
uniquement au moment de leurs recrutements. Cette formation, qui est d'une durée très
courte, a pour objectif uniquement la formation des artisanes spécialisées en une tâche
particulière et non pas des artisanes polyvalentes qui maîtrisent l'ensemble des techniques
relatives au métier du tissage du tapis.
3) L'absence d'un système de rémunération individualisé. Les artisanes de l'entreprise B2
sont toutes payées à la journée de travail. Le montant de la rétribution journalière, qui varie
d'une catégorie professionnelle à une autre, ne prend pas en considération ni la productivité
de Partisane ni la qualité de son ouvrage ni son ancienneté dans l'entreprise. Une telle
réalité témoigne de la négligence complète des réalisations individuelles des artisanes.
Ainsi, l'analyse des outils modernes de la gestion humaine des individus au travail révèle
une grande pénurie dans ce domaine dans l'entreprise B2. Cette absence ne concerne pas
uniquement cette catégorie d'outils. Elle s'étend, identiquement, aux outils de la gestion
humaine du collectif de travail. L'absence des outils comme la communication interne et le
travail participatif confirme cette réalité. Pour ce qui est de la communication interne, cette
entreprise se caractérise par la faiblesse des interactions et des échanges d'ordre
professionnel entre les membres des différentes catégories professionnelles et même entre
les membres d'une même catégorie. Les informations dans cette unité de production
suivent la ligne hiérarchique. C'est-à-dire que la communication ici est purement verticale
et descendante. Ceci ne peut que témoigner de l'absence d'une politique de communication
qui favorise l'interaction directe et permanente entre les différentes composantes humaines
de l'entreprise. En plus de cette pauvreté communicationnelle, les observations directes des
situations concrètes de la production montrent que les pratiques de travail participatif ne
176
constituent pas une partie du vécu quotidien des artisanes de cette entreprise. Chaque
artisane travaille d'une façon autonome. Une telle situation témoigne de la négligence du
travail participatif ; qui reste parmi les importants outils de la gestion humaine du collectif
de travail.
Aux termes de la description des pratiques managériales, il convient de conclure que
l'entreprise B2 se distingue par la négligence absolue de la dimension humaine dans le
travail. Il reste à voir maintenant l'état des dynamiques socioculturelles dans cette
entreprise en présence de cette négligence.
3.1.3 Les dynamiques socioculturelles dans l'entreprise B2
L'un des constats les plus importants de l'enquête réalisée dans l'entreprise B2 réside dans
l'esprit purement individualiste régnant à l'intérieur. Certes, l'absence des outils de la
gestion collective des humains constitue l'une des causes principales de la présence d'un tel
type d'esprit dans cette entreprise. Néanmoins, cette absence n'explique pas toute seule un
tel état de lieux. L'analyse des discours des artisanes interviewées amène à une explication
plus pertinente. Cette explication se rapporte au rapport qu'entretiennent ces artisanes au
travail. Comme dans le cas de l'entreprise BI, le travail représente, pour les artisanes de
l'entreprise B2, uniquement un moyen de substance (un salaire) ni plus ni moins. De ce
fait, le travail ne constitue pas pour elles une sphère où elles cherchent à développer un lien
social solide, à apprendre et à bâtir un mode de vie commun et à acquérir une identité
spécifique. Ce faisant, la perception de ces artisanes à l'égard du travail est purement
instrumentale puisqu'il est perçu seulement comme un milieu pour faire de l'argent. Cette
perception n'est pas exclusive aux artisanes; mais elle est identique à celle du chef de cette
entreprise. Les propos suivant de ce chef illustrent bien cette réalité.
Mes activités dans le secteur du tourisme m'ont encouragé à investir dans le domaine du tapis de sol. J'ai remarqué que le tapis se vend aux touristes à un prix très élevé alors que son coût de production est très faible. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'investir dans le domaine il y a 20 ans. Maintenant, cette demande a connu une diminution considérable. Le changement de la qualité de touristes qui visitent le pays et l'inondation du marché local par des tapis importés ont été à l'origine de cette diminution. Je suis actuellement à la recherche d'une solution afin de rendre mon local plus rentable. D'ailleurs, j'ai
177
commencé depuis le mois dernier les négociations avec une entreprise étrangère de câblage d'automobile installé dans la ville. Les dirigeants de cette entreprise veulent louer mon local de travail. Je crois que je vais accepter puisque leur offre est intéressante. (Chef d'entreprise)
Ainsi, les membres de l'effectif du travail ne manifestent aucune implication affective
envers le métier et l'entreprise. Autrement dit, le métier et le groupe de travail ne
constituent pas pour eux les valeurs autour desquelles se centrent les dynamiques d'ordre
social ainsi que celles d'ordre culturel qui structurent leur vécu au sein de l'entreprise.
L'observation et l'analyse des différents systèmes régissant ces deux dynamiques
témoignent de cette réalité.
Pour ce qui est des systèmes qui régissent les dynamiques sociales, notamment les systèmes
d'acteurs, de relations et de régulation et d'intégration sociale, ils fonctionnent sur des
bases proprement économiques. Sans aucun doute, l'inscription des membres de
l'entreprise dans une logique de pensée et de représentation qui considère le travail
simplement comme une valeur économique a favorisé une telle logique de fonctionnement.
D'ailleurs, les acteurs agissant dans cette entreprise ne sont différenciés l'un de l'autre que
par le salaire. En plus du chef d'entreprise qui forme un acteur à part vu son appropriation
des moyens de production, le système d'acteurs de l'entreprise B2 se compose de trois
types d'acteurs : les chefs d'unités de production, les chefs de lignes de production et les
artisanes de production. Cette typologie n'indique pas en aucun cas la présence d'un jeu de
pouvoir au sein de l'entreprise ou une divergence au niveau des enjeux de ces acteurs. Au
contraire, ces acteurs partagent un seul enjeu qui est l'amélioration du revenu. En dépit que
cet enjeu soit partagé par les différents acteurs, il est loin d'être un enjeu qui les unit
professionnellement ou socialement. Ce constat est renforcé par l'état du système de
relations constituant l'un des principaux systèmes régissant les dynamiques sociales au sein
de l'entreprise. Ce système est marqué par des relations professionnelles très restreintes et
qui obéissent strictement à la hiérarchie. Dans le même ordre d'idées, les relations sociales
sont aussi faibles et ne s'étendent pas en dehors de l'entreprise. Une telle configuration du
système relationnel exprime un double phénomène. Il y a d'une part, une absence
flagrante d'une culture de coopération dans le travail. Cette absence est due au manque
d'occasions d'échanges et d'interactions entre les différents acteurs autour des questions
178
relatives à la production. Il y a d'autre part, un effritement du corps social de l'entreprise.
Cet effritement demeure le résultat logique de la nature limitée des sociabilités dans cette
dernière. D'ailleurs, ceci se manifeste clairement dans le système de régulation et
d'intégration sociale qui constitue un autre système principal dans le façonnement des
dynamiques sociales de l'entreprise. Les règles régissant les comportements sont loin
d'être une construction propre des acteurs évoluant dans l'entreprise. Ils émanent plutôt de
la direction. De ce fait, la régulation dans cette entreprise, au sens de la théorie développée
par Jean-Daniel Reynaud depuis les années 1970, est une régulation de contrôle et non pas
une régulation autonome qui découle du groupe du travail. De même, l'intégration dans
l'entreprise ne passe pas par des pratiques socialisantes au travail, mais elle est faite à
travers une inculcation des règlements à respecter. Bref, les systèmes d'acteurs, de
relations, d'intégration et de régulation sociales qui structurent les dynamiques sociales
dans l'entreprise B2 ont contribué à la production d'un système social caractérisé par des
interactions s'inscrivant dans le cadre de la recherche de l'efficacité économique et non pas
dans le cadre de la recherche d'une meilleure cohésion sociale du groupe de travail. Ceci ne
peut que limiter l'attachement des membres de ce groupe à l'entreprise en premier lieu et
au métier en second lieu.
D'ailleurs, l'analyse des dynamiques culturelles régnant dans cette entreprise confirme
cette réalité. Ces dynamiques sont fortement marquées par une culture d'entreprise
caractérisée par la présence très forte de l'esprit individuel dans le travail. Cet esprit est
favorisé en grande partie par l'absence quasi-totale des pratiques et des rites de
convivialités. Dans une telle situation, il était difficile de construire une mémoire collective
qui peut servir en tant que cadre de référence pour les comportements et les attitudes dans
le travail. Ces dernières sont loin d'être le résultat d'un apprentissage culturel. Elles sont
plutôt fortement influencées par le cadre réglementaire mis en œuvre au sein de
l'entreprise. Parallèlement à cet esprit individuel, les dynamiques culturelles dans cette
entreprise sont marquées par un système d'identification centré autour des valeurs
économiques, notamment le salaire, et non autour des valeurs qui se rattachent au métier et
à l'entreprise. Cette centralisation d'un double phénomène. Tout d'abord, elle est due aux
représentations des membres de cette unité productive vis-à-vis du métier et de l'entreprise.
Ces dernières ne représentent pour eux que les sphères de réalisation d'un revenu matériel
179
et non pas des sphères de réalisation d'exploits personnels. Dans un contexte pareil, il serait
difficile d'avoir des représentations positives de l'innovation et de la transmission des
savoirs professionnels qui nécessitent, entre autres, l'engagement des membres dans une
voie de recherche de reconnaissance au sein de l'entreprise et non pas dans un sentier qui
mène uniquement à la rétribution matérielle. Ensuite, elle est due à la socialisation dans
cette entreprise. Cette socialisation ne concerne que l'action productive et ne s'étend pas à
d'autres actions, notamment à l'innovation et à la transmission des savoirs professionnels.
En terminant, l'entreprise B2 se caractérise par une structure d'organisation très rigide et
une multiplicité d'unités organisationnelles, une négligence totale des pratiques de gestion
de ressources humaines et des dynamiques socioculturelles qui sont centrées autour des
valeurs économiques et non pas des valeurs et des normes qui font référence au métier et au
groupe du travail. Il est important maintenant de voir la situation de l'innovation et de la
transmission des savoirs professionnels dans des conditions semblables.
3.2 L'entreprise B2 et l'innovation
Comparativement à l'entreprise BI, l'exercice du métier de tapis de sol dans l'entreprise B2
a connu une panoplie de transformations. Néanmoins, ces transformations n'expriment ni
un changement au niveau des techniques de fabrication ni au niveau des produits fabriqués.
Autrement dit, le métier en tant que tel n'a pas connu de mutations. Réellement, les
changements repérés dans cette entreprise touchaient uniquement l'organisation de
l'activité productive, l'outillage de travail et la commercialisation. Ces changements sont
tous des innovations occasionnées par l'introduction de nouveaux éléments externes sur le
fonctionnement de l'entreprise et non pas des innovations résultantes des incitatives
internes. Ces changements font donc partie de la deuxième dimension mobilisée dans cette
recherche pour opérationnaliser la notion d'innovation.
Un tel état des lieux exprime avant tout l'absence d'une culture d'innovation interne dans
cette entreprise. Comme dans le cas de l'entreprise BI, les différents acteurs de l'entreprise
B2 manifestent une prise de distance vis-à-vis à la création. Ceci amène à s'interroger sur
les causes d'une telle attitude. À première vue, le métier apparaît défavorable à
l'innovation. Or la réalité est totalement à l'inverse. Une étude personnelle dans l'histoire
180
du métier montre que la majorité des modèles de tapis tissés de nos jours ont été crée par de
simples artisanes. En effet, l'absence d'une culture d'innovation interne dans cette
entreprise ou dans l'entreprise BI n'a aucun lien avec le métier. En analysant les
représentations des différents acteurs de l'entreprise B2 à l'égard de l'innovation, les causes
de cette absence deviennent plus claires. Ces causes se repartissent en trois catégories :
1) L'inconscience de l'importance de l'innovation pour l'entreprise et les individus. Les
différents sujets interviewés dans cette entreprise manifestent dans leurs discours, sans
aucune exception, un désengagement total du développement du métier et de l'entreprise.
Certes, cette situation demeure logique si on sait que ces sujets ne disposent pas des
compétences nécessaires pour atteindre une telle réalisation. Mais, cela ne veut pas dire que
le problème des compétences constitue la principale explication logique de l'absence d'une
culture d'innovation au sein de cette entreprise. En réalité, c'est dans l'ignorance totale du
rôle de l'innovation dans le développement de l'entreprise et du métier que réside l'une des
principales causes de cette absence. La déclaration suivante du chef de cette entreprise
illustre bien cette réalité :
Je ne crois pas que le problème du secteur de tapis du sol peut être résolu par l'innovation. Ce métier est voué à la disparation. Il faut investir dans d'autres activités pour absorber la masse énorme des artisanes qui travaillent dans ce métier. Je crois que la solution réside d'avantage dans l'encouragement des entreprises étrangères de textile de s'installer dans la ville. Ces entreprises seront la meilleure alternative pour ces artisanes.
2) L'absence d'une politique d'innovation. La distance prise vis-à-vis de l'innovation dans
cette entreprise est due à l'absence d'une stratégie qui vise à inciter et à encourager les
artisanes à la prise des initiatives dans le travail. Une telle carence se manifeste
principalement dans les comportements des artisanes caractérisés par la standardisation et
par leur soumission totale aux règlements du travail. Un tel type de comportement reste,
sans aucun doute, défavorable à l'apparition des initiatives innovantes et créatrices. Car ce
type d'initiative exige, dans la ligne directrice des analyses de Norbert Alter, d'adopter des
comportements déviants qui dérogent certaines règles dans l'entreprise. La déclaration
suivante d'une chef d'une unité de production âgée de 46 ans témoigne de la recherche par
cette dernière de la standardisation et de la soumission des comportements aux règles.
181
Dans leur travail, les artisanes doivent suivre à la lettre les maquettes de tissage. Une erreur peut entraîner la perte de plusieurs journées de travail. C'est pour cette raison je contrôle d'une façon permanente l'ouvrage des artisanes. Toute artisane qui introduit des modifications sur la maquette sera sanctionnée. Déjà, on a viré deux artisanes le mois dernier, car elles ont modifié intentionnellement un motif principal dans le tapis. (Artisane, chef d'unité, 46 ans)
3) La négligence de l'innovation comme sphère d'identification et reconnaissance dans
l'entreprise. Pour l'ensemble des artisanes évoluant dans l'entreprise B2, la création et
l'innovation ne constituent pas une source d'identité ou de reconnaissance dans
l'entreprise. Elle constitue plutôt, comme le montre la déclaration précédente de la chef de
l'unité de production, une source de sanction. Ainsi, l'absence des innovations de la part
des acteurs évoluant dans cette entreprise peut être esquissée brièvement par le désintérêt
total envers la création et l'innovation.
Revenons maintenant à la dimension de l'innovation présente dans cette entreprise : les
innovations occasionnées par l'introduction des éléments externes au fonctionnement de
l'entreprise. Ces innovations ont touché trois dimensions principales. La première grande
transformation qu'a connue le métier du tapis de sol dans cette entreprise, comparativement
à l'entreprise BI, consiste au remplacement du métier à tisser traditionnel par un autre
moderne. Ce dernier se différencie de l'ancien par la matière première utilisée dans sa
fabrication. Il est fabriqué à la base du métal et non pas à la base du bois comme dans le cas
du métier à tisser traditionnel. Également, le nouveau métier en métal se distingue par son
poids plus lourd. Ceci permet, selon les artisanes interviewées dans cette entreprise et qui
ont déjà travaillé sur un métier à tisser en bois, d'avoir plus de perfection au niveau de la
largeur du tapis qui était difficile avec l'ancien outil. Encore, le nouveau métier, se
distingue de l'ancien par ses barres d'en haut et d'en bas. Ces deux dernières ont une forme
cylindrique et non pas carrée. Cette forme est adoptée afin de pouvoir enrouler chaque
partie de tapis tissé. Ceci permet aux tisserandes d'épargner l'effort de surélever les bancs
sur lesquels elles travaillent pour se trouver toujours à la bonne hauteur. En plus de
l'innovation qui a touché l'outil principal du travail, l'entreprise B2 a connu, toujours
comparativement à l'entreprise BI, une innovation d'ordre organisationnel. Cette
innovation concerne la séparation spatiale des deux opérations principales dans la
182
fabrication du tapis de sol : l'ourdissage et le tissage. Cette séparation a entraîné la mise en
œuvre de deux unités de production où évoluent des artisanes exclusivement spécialisées à
la tâche en lien avec l'unité de leur appartenance. Cette transformation nous rappelle bien
l'Organisation Scientifique de Travail proposée au début du 20e siècle par Frederick
Winslow Taylor (1856-1915) pour améliorer la productivité dans les entreprises
industrielles.
À l'innovation d'ordre organisationnel, s'ajoute une autre innovation qui distingue
l'entreprise B2 de l'entreprise BI. Cette innovation concernait la commercialisation directe
des produits finis. C'est-à-dire du producteur au consommateur sans passer par des
intermédiaires. Ceci peut être considéré comme une innovation dans la mesure où la
majorité des entreprises de tapis à Kairouan vendent leurs productions à des commerçants.
Ces derniers jouent donc le rôle du médiateur entre le producteur et le consommateur. Pour
éviter cette médiation, qui diminue le bénéfice du producteur, le chef de cette entreprise a
aménagé une salle d'exposition dans laquelle il vend en détail les tapis. Pour mener à bien
son projet, il a contracté les guides touristiques afin qu'ils lui amènent les groupes de
touristes qui visitent la ville. Si cette méthode permet d'éviter le passage par un
représentant commercial pour commercialiser le tapis, elle fait apparaître un acteur de plus
dans cette commercialisation. Donc, il aura toujours des frais supplémentaires entraînant
l'augmentation de prix des tapis tunisiens. Ce prix reste, selon les études menées par
l'ONA pour faire face à la crise du métier du tapis, l'une des causes principales qui ont
engendré la baisse de la demande sur le tapis tunisien.
À la lumière de ce qui précède, l'innovation est loin d'être une activité importante dans le
vécu des artisanes de l'entreprise B2. Même les innovations externes introduites
n'expriment pas la volonté de conserver et de développer le métier. Elles expriment plutôt
une volonté de modification de l'aspect artisanal du métier.
3.3 L'entreprise B2 et la transmission des savoirs professionnels
Outre l'absence des dynamiques internes d'innovation, l'entreprise B2 partage avec
l'entreprise BI une autre spécificité: le caractère restreint des dynamiques de la
transmission des savoirs professionnels. En dépit du fait que la construction des
183
compétences dans le domaine de tapis de sol en Tunisie demeure une opération qui se
déroule exclusivement sur le tas, cette opération se limite dans la présente entreprise à la
formation des nouvelles recrues aux gestes techniques requis pour exercer le métier.
Autrement dit, la transmission des savoirs professionnels dans l'entreprise B2 ne concerne
pratiquement que les techniques relatives aux deux tâches principales dans le processus de
la fabrication du tapis : l'ourdissage et le tissage. Il s'agit donc d'une formation sur mesure
qui vise l'intégration immédiate des nouvelles recrues dans le processus de la production.
En effet, la transmission des savoirs professionnels dans l'entreprise en question est loin
d'être une expérience permettant de reproduire la culture entière du métier. Cette
expérience ne permet pas à la personne d'acquérir et d'apprendre les différents savoirs en
liaison avec le métier. De même, elle ne lui permet pas de recevoir et d'intérioriser les
normes et les valeurs socioculturelles régissant le métier et valorisant la mémoire
collective construite par les générations antérieures du métier.
Effectivement, on distingue dans l'entreprise B2 deux situations de transmission de savoirs
professionnels. Ces deux situations, qui sont indissociables de l'activité productive, se
déroulent séparément sans constituer un processus continu. C'est-à-dire chacune d'elle
représente un cas d'apprentissage autonome. D'ailleurs, l'état des compétences
professionnelles témoigne de cette ségrégation dans la transmission des savoirs
professionnels. Dans cette entreprise, on différencie deux groupes différents d'artisanes :
des artisanes spécialisées dans l'ourdissage et d'autres dans le tissage. Ce faisant, la
situation de transmission est relative à une tâche particulière et non pas à l'ensemble des
tâches constituant le processus de la production.
Pour la première situation de transmission, elle concerne l'apprentissage des techniques
relatives à la tâche d'ourdissage. Elle met en interaction une nouvelle recrue (une novice
dans le métier) avec les membres de l'unité spécialisée dans cette tâche. L'observation
directe d'une situation concrète d'apprentissage dans l'unité d'ourdissage, qui concerne une
jeune fille de 18 ans qui a été recruté depuis trois semaines, montre que la novice, dès ses
débuts dans cette unité, participe directement à la production. Elle aide les artisanes dans la
préparation de la chaîne à tisser. Néanmoins, cette participation ne dépasse pas
l'accomplissement des opérations qui nécessitent certains efforts physiques. Elle s'occupe,
184
principalement, du déplacement des différentes composantes du métier à tisser. En dépit
qu'elle soit en train de faire ses premiers pas dans le métier, aucune des anciennes artisanes
ne lui explique les techniques permettant de réaliser une chaîne à tisser. Elle est donc
obligée d'apprendre ces techniques par observation. Les propos suivant de cette novice
confirment cette observation :
La semaine prochaine ça sera ma quatrième semaine dans l'entreprise. Je n'ai jamais travaillé auparavant. C'est ma première expérience professionnelle puisque j'étais jusqu'à l'année dernière au lycée [...]. Aussi, je n'ai aucune idée sur le métier du tapis vu que je n'ai aucun membre de famille qui exerce le métier dans la maison comme dans la majorité des foyers à Kairouan. [...] Depuis mon entrée ici j'essaye d'apprendre peu à peu le métier. Malheureusement, je suis affectée dans le groupe qui prépare les chaînes à tisser après une semaine dans l'unité de tissage. Même dans ce groupe personne ne s'occupe de moi. C'est pour cette raison je suis attentivement les artisanes dans leurs gestes et je leur demande souvent des explications afin que je puisse au moins apprendre les techniques de la préparation de la chaîne à tisser. Mais, je ne reçois pas tout le temps des réponses à mes questions. Je comprends bien l'attitude des artisanes. Elles sont obligées d'être rapides dans le travail, car tout retard peut entraîner l'arrêt de la production de plusieurs artisanes de tissages dans la mesure où la chaîne à tisser est indispensable pour le travail du groupe de tissage. (Apprentie)
Ainsi, les novices dans cette unité de production ne bénéficient d'aucun encadrement de la
part des anciennes artisanes. À première vue, les contraintes organisationnelles apparaissent
comme l'unique obstacle devant l'apparition d'un engagement de la part des anciennes
artisanes envers les novices. Si on se fie uniquement à cette explication, la vérité reste
partielle. L'analyse des discours des anciennes artisanes évoluant dans cette unité montre
que ce désengagement de l'encadrement dépend aussi du manque de volonté chez elles
pour transmettre les connaissances aux nouvelles recrues. Les anciennes artisanes
considèrent que la tâche d'apprentissage n'entre pas dans leurs fonctions. Elles disent
toutes qu'elles ne sont payées que pour préparer des chaînes à tisser et non pas afin de
préparer de nouvelles artisanes. Avec une telle attitude, la transmission des savoirs
professionnels devient une opération difficile. C'est pour cette raison que les novices
doivent déployer un effort cognitif énorme pour apprendre les techniques d'ourdissage
seulement par le regard.
185
Pour la deuxième situation de transmission repérée dans cette entreprise, elle concerne
l'apprentissage des techniques relatives au tissage. Cette situation ne diffère pas beaucoup
de la première. Sauf que la novice intégrée dans l'unité du tissage profite d'une période
d'apprentissage. Elle n'est pas donc intégrée directement dans la production effective.
Concrètement, une novice acceptée dans cette unité accompagne un groupe d'artisanes, qui
la dépassent en expérience, pendant une période sur le métier à tisser sans être impliquée
dans la production. Elle se contente d'observer et d'écouter les instructions de ces artisanes.
Ces dernières ne s'occupent pas de l'encadrement et de l'initiation des novices au métier
d'une façon volontaire. Mais, elles sont obligées de le faire dans la mesure où la direction
leur impose de s'occuper de la formation des nouvelles recrues. Durant cette période de
formation, qui ne dépasse pas une semaine, les deux parties constituant la situation de
transmission se trouvent sous la contrainte du temps. Les anciennes artisanes sont
demandées de faire apprendre les techniques aux novices dans les brefs délais et les novices
doivent apprendre très vite ces techniques pour être intégrés rapidement dans le processus
de la production. Les propos suivants de la chef de l'unité du tissage illustrent clairement
cette contrainte :
En parallèle de leur activité de tissage, les anciennes artisanes ont en charge la transmission de leur savoir-faire aux nouvelles. Cette opération ne doit pas durer longtemps sinon le patron ne sera pas satisfait de nous toutes. C'est pour cette raison je veille personnellement sur l'avancement de l'apprentissage des nouvelles artisanes. [...] Si au bout d'une semaine l'apprentie n'était pas capable de travailler d'une façon autonome je me trouvais obligée de la changer par une autre. Mais ceci ne veut pas dire qu'elle sera virée de l'entreprise. Si on a des postes vacantes dans l'unité d'ourdissage, où on a besoin des filles non qualifiées, elle sera affectée dans cette unité. (Artisane, chef d'unité)
Ainsi, les anciennes artisanes n'ont pas assez de temps afin de transmettre aux nouvelles
artisanes des savoirs professionnels autres que les techniques de tissage : le nouage et le
coupage. De ce fait, l'expérience de transmission de savoirs professionnels demeure une
expérience très limitée dans cette entreprise. Elle ne favorise pas la reproduction
intergénérationnelle de la culture du métier dans la mesure où cette reproduction nécessite à
la fois la transmission intergénérationnelle des normes et valeurs théoriques et pratiques
ainsi que celles socioculturelles relatives au métier.
186
En conclusion, les dynamiques de l'innovation et la transmission des savoirs professionnels
au sein des entreprises du tapis de sol diffèrent complètement de celles existantes au sein
des entreprises de la poterie artisanale. Toutefois, cette différence est presque absente entre
les entreprises de l'ancienne et de la nouvelle génération appartenant à un même métier.
Ceci dit, les dynamiques en question sont fortement influencées par le métier. Au-delà de
ce constat général, la description de ces deux dynamiques au sein des quatre unités étudiées
permet d'examiner et de circonscrire ces deux phénomènes (l'innovation et la transmission
des savoirs professionnels) dans un contexte d'entreprises artisanales de métier ancestral.
Ces actions (circonscrire et examiner ces deux phénomènes) ont pour buts de dégager la
particularité l'innovation et de la transmission des savoirs professionnels dans ce type
spécifique d'unités productives d'une part, et de comprendre comment ces unités peuvent à
travers ces deux dynamiques assumer leurs différentes responsabilités dans le contexte
actuel de la globalisation.
187
Partie 3 : Analyse et interprétation des résultats
Les dynamiques de l'innovation et de la transmission des savoirs professionnels à l'épreuve de l'entreprise artisanale de métier ancestral
Après avoir détaillé dans la partie précédente les résultats de l'étude empirique, la présente
partie se consacre à l'examen des dynamiques de l'innovation et de la transmission des
savoirs professionnels au sein de l'entreprise artisanale de métier ancestral. L'objectif de
cet examen est de limiter les champs, les déterminants et les impacts des deux dynamiques
en question qui sont considérées comme indispensables à la survie de cette catégorie
d'entreprise dans le contexte de la globalisation. Une telle démarche permet non seulement
de dégager la particularité de l'innovation et de la transmission des savoirs professionnels
dans cet univers spécifique de production, mais permet également de comprendre comment
les entreprises appartenant à cet univers gèrent ces deux dynamiques ainsi que les relations
entre elles afin de s'acquitter leurs différentes responsabilités dans le contexte de la
globalisation.
Conformément à cette démarche, la présente partie est composée de trois chapitres. Le
premier et le deuxième s'intéressent successivement aux dynamiques de l'innovation et de
la transmission des savoirs professionnels; le troisième met en lumière la question de
conciliation entre ces dynamiques, qui constitue un véritable défi pour les unités
productives de métiers hérités du passé dans le contexte actuel.
189
Chapitre 7. Les dynamiques de l'innovation au sein de l'entreprise artisanale de métier ancestral
L'innovation au sein de l'entreprise, rappelons-le, est une action de mise en pratique de
nouvelles idées au détriment d'autres plus anciennes (Comeloup, 2009). L'objectif d'une
telle action demeure la transformation d'une ou de plusieurs dimensions de travail dans le
but d'adapter l'entreprise aux exigences de ses environnements externes et internes (Rogers
et Kim, 1985). De ce fait, aborder le phénomène de l'innovation au sein des milieux du
travail, notamment les entreprises, revient à mettre l'accent, entre autres, sur les
changements significatifs qui touchaient ces milieux. Étant donné l'objet de notre
recherche, le présent chapitre propose de mettre en lumière les changements importants
qu'ont connus les entreprises artisanales tunisiennes de métiers ancestraux tunisiennes afin
de s'adapter aux exigences de la globalisation. Autrement dit, il s'agit de déceler la
particularité de l'innovation dans un contexte de métier ancestral.
En effet, notre propos ici est de circonscrire les dynamiques de l'innovation dans le cas de
l'entreprise artisanale de métier ancestral. Notre objectif est de comprendre le phénomène
de l'innovation dans ce type d'unités de production. Pour y parvenir, les champs de
l'innovation dans ce milieu particulier de travail sont identifiés en premier lieu. En
deuxième lieu, les déterminants de l'innovation dans ce type spécifique d'entreprise sont
présentés. Enfin, les impacts de l'innovation sur les différentes composantes de ce monde
typique de production sont exposés.
1. Les champs de l'innovation au sein de l'entreprise artisanale de métier
ancestral
Les résultats présentés dans la partie précédente montrent que l'innovation constitue
aujourd'hui une préoccupation relativement généralisée pour les entreprises artisanales
tunisiennes de métiers ancestraux. Pour autant, les champs concernés par l'innovation ainsi
que l'intensité des innovations différèrent d'un univers de métiers à un autre. Aussi, elles
varient d'une entreprise à une autre du même univers de métier. Tel est le constat central
190
qui ressort de l'étude des réactions, des quatre entreprises de l'échantillon, aux nouvelles
contraintes imposées par la globalisation.
Au-delà de ce constat général, les innovations qu'ont connu ces entreprises peuvent être
regroupées dans deux grands registres : la production et la vente. Autrement dit, les
changements significatifs qui ont été repéré touchaient des éléments en lien avec la
fabrication et d'autres relatifs à l'écoulement des produits. Il s'agit donc de deux cas de
figures d'innovation : l'innovation de production et l'innovation de commercialisation.
1.1 L ' innovation de production
Par innovation de production, nous désignons l'ensemble de changements qui ont affecté le
processus de la fabrication. C'est-à-dire les nouveaux éléments qui ont été introduits sur une
ou plusieurs dimensions du procédé de production. En d'autres termes, il s'agit des
modifications apportées à l'exercice du métier. Les résultats de l'étude empirique, présentés
antérieurement, montrent que les deux métiers, qui ont fait l'objet de notre investigation,
ont connu des mutations relatives à leurs façons et manières de production. Cette réalité ne
signifie pas que toutes les entreprises à l'étude ont connu ce genre de transition. Seulement,
trois des quatre cas étudiés confirment cette situation de transition. C'est l'entreprise BI qui
fait exception. Les innovations de ce genre, qui ont été repérés dans les entreprises A1, A2
et B2, concernaient l'organisation du travail, les articles fabriqués et les outils de travail. Ce
faisant, on distingue trois catégories d'innovations relatives au procédé de production dans
les entreprises artisanales de métiers ancestraux : l'innovation organisationnelle,
l'innovation des outils de travail et l'innovation de produits.
1.1.1 L'innovation organisationnelle
L'innovation organisationnelle exprime avant tout la mise en œuvre d'une nouvelle
méthode d'organisation de la production au détriment d'une autre plus ancienne (Alter,
2003). De ce fait, parler de la présence d'innovation organisationnelle au sein des
entreprises de métiers artisanaux signifie, entre autres, que ces dernières ont connu des
changements qui ont touché leurs façons d'organiser l'activité productive. Dans les cas
étudiés, ces changements concernaient les deux dimensions principales de l'organisation
191
de l'activité productive : l'organisation du processus de la production et l'organisation du
lieu de travail. Cette situation est loin d'être commune à tous les cas étudiés. Elle concerne
uniquement les entreprises A2 et B2. Ces deux dernières, appartenant à la nouvelle
génération des entreprises de métiers ancestraux en Tunisie, se distinguaient des
entreprises Al et BI, faisant partie de la forme classique de ce genre d'entreprises, par la
mise en œuvre d'une méthode d'organisation de l'activité productive plus au moins
rationnelle. En d'autres termes, elles se distinguaient par le caractère non artisanal de leur
méthode d'organisation. Ceci se manifeste dans deux dimensions principales en relief avec
cette méthode :
1) La division de l'entreprise en différentes unités organisationnelles : l'entreprise A2
comme l'entreprise B2 comportent plus qu'une unité organisationnelle. Chacune de ces
unités se préoccupe d'une seule tâche ou phase du processus de la production. De ce fait,
elle rompt avec un caractère principal des entreprises artisanales classiques : la composition
de l'entreprise d'une seule unité organisationnelle. D'ailleurs, ce caractère, décrit par la
littérature traitant de l'organisation des entreprises artisanales ancestrales, constitue l'une
des caractéristiques majeures de l'entreprise Al et BI représentant les entreprises
classiques de métiers artisanaux dans notre recherche.
2) La division de l'entreprise en plusieurs espaces : à l'encontre de l'entreprise Al et BI,
le milieu de travail dans les entreprises A2 et B2 est divisé en plusieurs espaces. De telle
sorte que chaque opération du processus de la production se déroule dans une pièce
séparée. Avec une telle division spatiale, ces deux entreprises rompaient avec un autre
caractère principal des entreprises classiques. En général, comme nous l'enseigne la
littérature et nous l'indique les situations des entreprises Al et BI, le type classique prend
la forme d'une seule pièce dans laquelle se déroule toutes les opérations relatives au
processus de production.
Toutefois, l'engagement des entreprises A2 et B2 dans une voie d'innovation
organisationnelle ne signifie guère que ces deux entreprises mettent en œuvre la même
méthode d'organisation. Au contraire, les deux méthodes appliquées sont aux antipodes.
Dans le cas de l'entreprise A2, la méthode d'organisation du travail n'a pas détourné un
principe essentiel des métiers artisanaux hérités des sociétés traditionnelles. En dépit de
192
son inscription dans une logique de rationalisation du processus de la production, la
méthode d'organisation appliquée dans cette entreprise favorise, entre autres, le travail en
équipe, l'autonomie encadrée, l'implication personnelle dans le travail et la flexibilité du
temps de travail. Ces principes, qui demeurent les caractéristiques des entreprises
classiques de métiers artisanaux, sont devenus une innovation dans le monde du travail.
Elles sont appliquées par les entreprises modernes de tous types pour rompre avec la
logique taylorienne d'organisation de travail. Cette logique est la voie qui a été poursuivie
par l'entreprise B2 afin de rationnaliser l'activité productive. Une telle démarche a induit
une division minutieuse et précise des tâches, une réduction de l'autonomie des artisanes et
un esprit individualiste dans le travail. De ce fait, l'innovation organisationnelle dans cette
entreprise a entraîné une dispersion de certaines valeurs principales des métiers ancestraux,
tel que la coopération et la flexibilité dans le travail, l'autonomie de l'artisan, l'implication
affective dans le travail, etc.
Ainsi, l'innovation organisationnelle dans les unités A2 et B2 ne sont pas de même nature.
Si dans le cas de l'entreprise A2 cette innovation a conservé les traits principaux du travail
artisanal dans son état élémentaire, elle a constitué dans le cas de l'entreprise B2 une
véritable destruction de cet état.
1.1.2 L ' innovation de produit
Outre l'organisation du travail, la réalité du terrain montre que le produit constitue un autre
champ d'innovation pour les entreprises artisanales de métiers ancestraux. Certes, cette
situation ne concerne pas toutes les unités qui ont fait l'objet de notre étude. Elle concerne
uniquement les deux entreprises de la poterie artisanale; c'est-à-dire l'entreprise Al et A2.
Tandis que, les deux entreprises de tapis de sol (BI et B2) n'enregistrent pas la présence de
cette catégorie d'innovation liée à la production. En effet, l'innovation de produit
représente une des spécificités du métier de la poterie artisanale. « Par définition,
l'innovation de produit consiste dans la mise au point d'un nouveau produit. Cette
innovation est directement visible par le consommateur» (Caccomo, 2005 : 31).
L'innovation de produit traduit donc le lancement sur le marché d'un nouvel article qui
n'existait pas auparavant.
193
Toutefois, dans le cas des unités Al et A2, appartenant à deux générations différentes
d'entreprises de poterie artisanale, l'innovation de produit n'exprime pas la rupture totale
avec les anciens produits hérités du passé. Elle exprime plutôt l'adaptation de ces produits
aux besoins du consommateur local du temps moderne et aux aspirations de la clientèle
étrangère qui est devenue facilement accessible suite à l'adhésion du pays dans le nouvel
ordre économique mondial. De ce fait, on ne peut pas parlé du lancement de nouveaux
articles. Au contraire, ce sont les anciens articles, considérés jusqu'à une époque très
récentes comme des objets folkloriques sans aucune utilité pour la vie de tous les jours, qui
ont été mis à jour. Ce faisant, l'innovation de produit dans les entreprises de la poterie
artisanale a pour objet le changement de la vision à l'égard des produits artisanaux et non
pas la création de nouveaux produits qui se détachent de l'histoire du métier.
Effectivement, les entreprises Al et A2, comme la majorité des entreprises de la poterie
artisanale de la ville de Mokenine, ont trouvé dans l'innovation de produit le moyen pour
attirer de nouveaux les consommateurs locaux envers leurs produits. De même, elle
constitué un moyen afin d'atteindre une nouvelle clientèle étrangère. D'ailleurs,
l'innovation de produit dans ces entreprises peut être scindée en deux catégories :
l'innovation de produit adressée au marché local et l'innovation de produit adressée aux
marchés étrangers. Avec une telle démarche, ces entreprises ont réussi à la mise en œuvre
de deux gammes différentes de produits. Concernant la première gamme, elle contient des
produits conçus pour satisfaire les besoins spécifiques de la société et les exigences de
l'époque historique. Elle est composée principalement des vaisselles, des ustensiles de
ménage et des contenants nécessaires à la vie quotidienne de la société locale. Pour ce qui
est de la deuxième gamme, elle concerne les produits à vocation décorative et horticole.
Cette gamme de produits est destinée principalement aux marchés extérieurs. L'annexe 19
présente une panoplie de produits appartenant à cette dernière gamme.
Quoiqu'on en dise, l'innovation de produit demeure une affaire qui engage les artisans au
sein de l'entreprise dans la mesure où elle repose principalement sur leurs créativités et
leurs ajouts. Dans cette perceptive, l'instauration d'une dynamique d'innovation de produit
nécessite l'aménagement d'un climat de travail favorable à la création au sein de
l'entreprise. Autrement dit, l'innovation de produit dépend de la réunion de plusieurs
194
conditions. Ces dernières seront détaillées dans la partie qui sera consacrée ultérieurement à
l'analyse des déterminants de l'innovation au sein de l'entreprise artisanale de métier
ancestral.
1.1.3 L'innovation dans les outils de travail
En plus de l'organisation de la production et du produit, les équipements de travail
constituent le troisième champ de l'innovation liée à la production dans les entreprises
artisanales de métiers ancestraux. Si cette réalité concerne les deux métiers étudiés, elle
n'est repérée que dans les entreprises Al, A2 et B2. Autrement dit, seulement l'entreprise
BI, qui représente les entreprises classiques de tapis de sol à Kairouan, n'a pas connu des
changements relatifs aux outils usés dans la production. Ceci signifie qu'elle a conservé, à
l'encontre des trois autres entreprises, les instruments traditionnels de la production.
Cependant, les changements qu'ont connus les entreprises Al, A2 et B2 à ce niveau
n'expriment pas le remplacement au complet des outils traditionnels de production. Ces
derniers continuent à être présents dans ces entreprises, mais dans des versions plus
sophistiquées et développées.
Ainsi, l'innovation dans les outils de travail dans les entreprises en question consiste à
l'introduction des améliorations sur les équipements du travail et non pas à l'introduction
de nouvelles machines au détriment des anciennes. Toutefois, ces entreprises ont connu
l'introduction de nouveaux outils qui n'existaient pas auparavant dans le métier. Les
situations dans les entreprises Al et A2 montrent que le métier de la poterie artisanale, à
l'encontre du métier du tapis de sol, a connu l'entrée d'une nouvelle machine qui n'était pas
mobilisée dans le métier dans son état élémentaire. Cette machine, qui est la malaxeuse-
boudineuse, a été introduite pour réaliser une tâche principale dans le processus de la
production qui était effectué auparavant manuellement : le pétrissage. De ce fait, on
distingue deux catégories d'innovation dans les outils de travail dans les entreprises
artisanales de métiers ancestraux. Ces deux catégories sont :
1) l'introduction des versions modifiées des outils jadis employées dans le métier;
195
2) l'introduction de nouveaux outils ne faisant pas partie des pratiques anciennes du métier.
Compte tenu de ce qui précède, les métiers ancestraux ne se trouvent pas en marge de
l'innovation technologique. Au contraire, ils se présentent à la fois comme des récepteurs
et des moteurs à ce type particulier d'innovation. Mais le plus important, c'est qu'ils
constituent également de véritables milieux d'innovations technologiques. Un tel constat
est justifié, principalement, par le fait que les améliorations qu'ont connu les anciens outils
de production, que ce soit dans le métier de la poterie artisanale ou du tapis de sol, ont eu
pour origine des artisans qui exercent les deux métiers. L'exemple le plus significatif à ce
sujet reste l'entreprise A2. Cette dernière, qui appartient à la nouvelle génération des
entreprises de la poterie artisanale, a connu plusieurs innovations de ce type. Ces
innovations, qui ont pour source unique le frère du chef d'entreprise, touchaient
essentiellement les deux principaux outils de production : le tour et le four de cuisson.
Cette personne, qui est à l'origine un artisan potier, a introduit une modification sur le four.
Cette modification, décrite en détails dans la partie consacrée à la description de
l'innovation dans l'entreprise A2, consiste à l'invention d'une nouvelle technique dans la
construction du four de cuisson. De même, il a rendu le tour ajustable aux tailles des
artisans. Avec ce nouveau tour, les artisans potiers peuvent maintenant régler l'outil
principal de la production en fonction de leurs tailles.
Somme toute, le champ de la production dans les entreprises artisanales tunisiennes de
métiers ancestraux a connu une panoplie d'innovations dans les temps modernes.
Toutefois, ces innovations ne sont pas le fruit d'une invention, mais elles sont plutôt des
nouvelles combinaisons de ressources internes aux métiers. Ces nouvelles combinaisons
expriment avant tout une sorte d'adaptation de ce type spécifique d'unités de production
aux récentes contraintes imposées par la globalisation qui reste, sans aucun doute, l'image
de marque des temps modernes. Néanmoins, l'innovation de production ne constitue pas la
seule réaction de ces entreprises aux nouvelles contraintes. L'innovation de
commercialisation demeure une deuxième réaction qui ne manque pas d'importance.
196
1.2 L'innovation de commercialisation
Par innovation de commercialisation, nous désignons les changements significatifs qui ont
touché les techniques de vente mobilisées par les entreprises tunisiennes de métiers
ancestraux. Précisément, il s'agit des mutations qui sont survenues sur les méthodes de
commercialisation jadis adoptées par ce type d'entreprises. Comme dans le cas de
l'innovation de production, les deux métiers, qui ont fait l'objet de notre étude, partagent
des mutations de ce genre. C'est-à-dire ils ont connu tous les deux une innovation de
commercialisation. Hormis l'entreprise BI, appartenant aux entreprises classiques de tapis
du sol, les entreprises Al, A2 et B2 ont vu leurs méthodes de vente changées. Ce
changement concerne à la fois la destination des produits et les moyens d'approcher la
clientèle. En effet, deux types d'innovations de commercialisation peuvent être distingués
dans le contexte des entreprises de métiers ancestraux : innovation de marché et innovation
des moyens de commercialisation.
1.2.1 L ' innovation de marché
Dans son acception générale, l'innovation de marché est une démarche qui vise
l'augmentation des ventes de l'entreprise. Selon le manuel d'Oslo60, élaboré par
l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), cette
innovation peut être concrétisée par deux actions séparées :
1) L'ouverture de nouveaux marchés pour écouler les produits de l'entreprise;
2) Le positionnement des produits de l'entreprise sur le marché d'une nouvelle façon.
À travers ces deux actions, qui ont été repérés dans les cas étudiés, les métiers de la
poterie artisanale et du tapis de sol ont réussi à la fois à repositionner leurs produits sur le
marché local et à ouvrir de nouveaux débouchés pour leurs produits. Autrement dit, ces
deux métiers ont établi de nouvelles relations avec le marché. Effectivement, leurs
produits ne sont pas adressés uniquement, comme auparavant, aux touristes qui visitaient
le pays. Ils sont destinés également au marché local et étranger. Une telle réalisation
60 Le Manuel d'Oslo, élaboré en 1997 par l'OCDE, présente les principes directeurs proposés pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation et la compréhension du processus de l'innovation.
197
traduit deux phénomènes différents : la réconciliation avec la clientèle locale et la conquête
d'une clientèle étrangère plus large.
En ce qui concerne la réconciliation avec la clientèle locale, elle est exclusive au métier de
la poterie artisanale. Les entreprises Al et A2, représentant ce métier dans notre recherche,
ont pu attirer, grâce à l'innovation de produit, de nouveau les consommateurs locaux à
leurs produits. Ces produits, qui ont été délaissés pour longtemps au profit des produits en
aluminium et surtout en plastique fabriqués industriellement, sont devenus fortement
demandés par les tunisiens. Cette forte demande est expliquée par le fait que les artisans
potiers ont réussi à mettre sur le marché des produits qui peuvent remplacer les produits en
aluminium et en plastique dans la vie quotidienne de la société. Autrement dit, les
entreprises de la poterie artisanale ont mis en œuvre des produits satisfaisant les besoins du
consommateur local moderne. En effet, les produits en argile fabriqués artisanalement
occupent une nouvelle place sur le marché local. Ils ne sont plus considérés comme des
produits de l'antiquité qui non aucune utilité de nos jours. Mais, ils sont devenus
commodes pour l'usage dans la vie quotidienne des individus. Cette situation ne peut
qu'exprimer le nouveau positionnement, qui constitue la première dimension de
l'innovation de marché, de ce type de produit sur le marché local.
Pour ce qui est de la conquête de la clientèle étrangère, elle est partagée par les deux
métiers en question. Exactement, les entreprises Al, A2 et B2, ont profité de l'ouverture de
l'économie tunisienne sur l'extérieur pour diversifier leurs clientèles. Dorénavant, les
produits en argile et les tapis de sol n'ont pas une destination unique qui est le marché
local, notamment les touristes de passage en Tunisie. Ils sont destinés également aux
consommateurs étrangers sur leurs propres territoires. Ceci n'est rendu possible que grâce à
la conception et l'élaboration des produits qui tiennent compte des besoins des ces
consommateurs spécifiques. La prise en considération de ces besoins, a permis à ces
entreprises de produire des articles qui peuvent trouver facilement une place dans la vie
quotidienne des consommateurs étrangers. Une telle situation signifie que les métiers de la
poterie artisanale et du tapis de sol ont réussi à la réalisation du deuxième aspect de
l'innovation de marché : l'ouverture de nouveaux débouchés pour leurs produits.
198
En raison de ce qui précède, les entreprises artisanales tunisiennes de métiers ancestraux
ont réalisé une innovation de marché. Cette innovation les a mis en contact avec un public
plus étendu. Pour mener à bien cette réalisation, il était important d'adopter de nouveaux
moyens de commercialisation permettant de faciliter le contact avec ce public. Ceci nous
conduit à parler d'un deuxième type d'innovation de commercialisation dans le contexte de
cette catégorie d'entreprises : l'innovation des moyens de commercialisation.
1.2.2 L'innovation des moyens de commercialisation
D'une manière générale, les moyens de commercialisation sont les dispositifs mobilisés
par l'entreprise pour faire connaitre leurs produits et pour créer des clients. Autrement dit,
ils sont les outils mis en œuvre pour commercialiser les produits de l'entreprise. Dans le
cas des entreprises étudiées, toujours à l'exception de l'entreprise BI, ces outils ont fait
l'objet d'une transition considérable. Cette transition se manifeste dans l'usage des moyens
de commercialisation qui n'étaient pas utilisés auparavant par ces entreprises. Afin de
rendre compte de cette transition, il est important de faire un petit retour sur les moyens de
commercialisation jadis utilisés par les entreprises de la poterie artisanale à Mokenine et du
tapis de sol au Kairouan. •
En ce qui concerne les entreprises de la poterie artisanale, la commercialisation des
produits s'effectue jusqu'à une époque très récente d'une seule manière. Les artisans
potiers exposent leurs produits dans le souk hebdomadaire de la ville. Lors de cette
exposition, ils vendent leurs produits de deux façons :
1) La vente aux particuliers : cette catégorie de ventes concerne les habitants de Mokenine
et des villages entourant cette ville. Elle est donc une vente en détail où il n'existe aucun
intermédiaire entre l'entreprise et le client.
2) La vente aux marchands : cette catégorie de ventes concerne les commençants qui se
rendaient régulièrement au souk hebdomadaire de la ville pour acheter des grandes
quantités de produits pour les revendre dans les souks des villes éloignées. Elle est donc
une vente en gros dans laquelle le commerçant joue le rôle d'intermédiaire entre
l'entreprise et le client.
199
La situation n'est pas totalement différente pour les entreprises de tapis du sol de Kairouan.
L'exposition des tapis au souk de la ville constitue aussi l'unique moyen de
commercialisation pour ces entreprises. Néanmoins, la commercialisation du tapis demeure
différente sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, l'exposition des tapis ne s'effectue pas
d'une façon hebdomadaire. Elle s'effectue deux fois par semaine. Cette exposition coïncide
souvent avec les jours de l'estampillage organisé par l'ONA pour authentifier les tapis.
Concrètement, les artisans après avoir estampillé leurs tapis passent directement au souk
pour les vendre. La vente ici prend la forme d'une enchère. La procédure est effectuée par
un tiers qui prend en charge la présentation des tapis au public de ce souk. Ce public,
composé général des commerçants, venait de Kairouan et de partout de la Tunisie. Le tapis
est vendu au commerçant offrant le prix le plus élevé. En effet, les entreprises du tapis de
sol n'ont aucun contact direct avec le client. Les tapis passaient donc par un ou de plusieurs
intermédiaires avant d'arriver aux clients
Ainsi, l'exposition des produits au souk constituait auparavant le seul moyen de
commercialisation des produits en argile à Mokenine et des tapis à Kairouan. Dans le
contexte actuel, ce moyen est délaissé complètement par les entreprises Al, A2 et B2. Ces
dernières ont adopté de nouveaux outils presque similaires pour commercialiser leurs
produits. De ce fait, on parle d'innovation de moyens de commercialisation. Cette
innovation concerne la mobilisation de trois nouveaux moyens pour écouler les produits.
Ces moyens sont :
1) Les salles d'exposition : cet outil concerne les entreprises A2 et B2. Ces deux
entreprises exposent leurs produits d'une façon permanente dans une salle bien aménagée et
qui fait partie de l'entreprise, Dans cette salle, ouverte aux marchands comme aux
particuliers, se déroulent les opérations de vente. De ce fait, les entreprises en question
n'ont pas à se déplacer aux souks pour mettre leurs produits en vente. De même, elles n'ont
pas à attendre la tenue hebdomadaire du souk de la ville pour présenter leurs produits à la
vente.
2) Les sites Internet : ce moyen concerne uniquement les entreprises de la poterie
artisanale (Al et A2). ces dernières ont crée des espaces web où elles exposent leurs
différentes gammes de produits. Néanmoins, ces espaces ne sont pas crées pour la simple
200
exposition. Ils sont dotés des outils de ventes en ligne. En effet, les entreprises Al et A2
profitent, encore une fois, des innovations technologiques pour développer leurs activités.
3) Les catalogues de produit : cet instrument concerne uniquement l'entreprise A2. Cette
entreprise prépare continuellement des catalogues où elles présentent ses nouveaux
produits. Ces catalogues, qui sont distribués en Tunisie et à l'étranger, sont préparés par un
spécialiste en marketing qui a été recruté pour développer la politique de commercialisation
de l'entreprise. Une telle action (le recrutement du spécialiste en marketing) représente une
innovation dans la mesure où elle intègre à l'entreprise une personne jadis non existante
dans les entreprises de ce genre. Ainsi, on peut parler d'une innovation d'autre type :
Innovation de personnel. Ce type d'innovation, qui spécifie aussi l'entreprise A2, s'est
concrétisé également par le recrutement d'une diplômée en beaux arts. La fonction de cette
dernière est d'aider les artisans dans la conception des nouveaux produits.
Ainsi, avec l'adoption de ces moyens de commercialisation les entreprises artisanales
tunisiennes de métiers ancestraux consolident l'innovation de marché et rompent
définitivement avec le moyen de vente traditionnel: l'exposition occasionnelle de leurs
produits dans les marchés locaux hebdomadaires. Si cette action de rupture traduit, entre
autres, la capacité de ce type d'entreprises de s'accommoder au nouveau contexte elle
témoigne une fois de plus de l'ouverture des artisans de métiers ancestraux à l'innovation.
Somme toute, l'innovation au sein de l'entreprise artisanale tunisienne de métier ancestral
concerne les deux activités principales de toute unité productive : la production et la
commercialisation. Le schéma ultérieur présente les dimensions relatives à chacune de ces
deux activités qui ont fait l'objet d'innovation dans cette catégorie spécifique d'unité
productive.
201
Schéma 3: Les champs de l'innovation dans le contexte d'entreprise artisanale de métier ancestral
La production :
L'organisation
Le produit
Les outils de
travail
Innovation
La Commercialisation :
■ Le marché
■ Les moyens de
Commercialisation
Ainsi, les innovations dans le monde des entreprises de métier hérité du passé s'étendent
sur plusieurs dimensions. Néanmoins, cette réalité n'englobe pas toutes les entreprises qui
ont fait l'objet de notre étude. Les pratiques de production et de commercialisation qui
constituent les deux principaux champs d'innovation dans les entreprises en question,
n'ont pas fait l'objet de changements dans toutes les unités de l'échantillon. Il y a des
entreprises qui ont connu une transition au niveau d'une ou de plusieurs dimensions,
présentées par le schéma ci-dessus, et d'autres qui ont gardé les logiques traditionnelles de
fonctionnement. En d'autres termes, le phénomène de l'innovation ne concerne pas toutes
les entreprises artisanales tunisiennes de métiers ancestraux. Une telle situation demeure
propice pour comprendre les déterminants de l'innovation dans cette catégorie particulière
d'entreprises.
202
2. Les déterminants de l'innovation au sein de l'entreprise artisanale de
métier ancestral
Le phénomène de l'innovation au sein de l'entreprise, rappelons-le, peut avoir pour origine
deux actions principales (Alter, 2005; Lhuillier, 2007) :
1) L'introduction d'une ou de plusieurs nouveautés développées à l'externe;
2) L'initiative d'une ou de plusieurs personnes évoluant au sein de l'entreprise même.
L'existence de l'une ou de ces deux actions signifie, entre autres, la présence d'une culture
d'innovation à l'intérieur de l'entreprise (Sundabo, 2003; Coffey, Siegel et Smith, 2009).
Toutefois, ces deux actions ne traduisent pas une réalité identique. Pour la première, elle
traduit l'ouverture de l'entreprise sur les innovations externes qui touchent le monde du
travail. Elle est concrétisée par l'acquisition et la mise en œuvre de nouveautés pour
améliorer un ou plusieurs aspects du fonctionnement de l'entreprise. Alors que la
deuxième, elle traduit l'incorporation dans l'entreprise des logiques de la création. Cette
action est concrétisée par l'adhésion des membres de l'entreprise dans un sentier de
créativité.
Compte tenu des résultats de l'enquête empirique, des conditions favorables sont
indispensable à l'existence de ces deux cas de figures au sein de l'entreprise artisanale de
métier ancestral. Autrement dit, la promotion d'une culture d'innovation au sein de cette
catégorie particulière d'entreprises est tributaire d'une panoplie de facteurs. Concrètement,
ces facteurs concernent tant les individus que les conditions dans lesquelles se déroule
l'activité productive. En effet, deux grandes catégories de déterminants de l'innovation
peuvent être distinguées : des déterminants relatifs aux caractéristiques intrinsèques des
acteurs de l'entreprise et d'autre en lien avec le contexte de la production.
2.1 Les déterminants relatifs aux caractéristiques intrinsèques des acteurs de
l'entreprise
L'analyse des situations concrètes dans les entreprises faisant l'objet de notre étude montre
que les deux actions menant à l'innovation dans les entreprises tunisiennes artisanales de
203
métiers ancestraux ont pour principales sources deux types d'acteurs : le chef de
l'entreprise et les artisans évoluant avec lui. Toutefois, la présence de ces deux types
d'acteurs ne signifie pas le déclenchement automatique d'un processus d'innovation dans
l'entreprise. En dépit de leur incorporation de ces deux types d'acteurs, les quatre
entreprises étudiées n'ont pas toutes connue des innovations. De ce fait, les caractéristiques
intrinsèques de ces deux acteurs demeurent décisives dans la promotion ou non d'une
culture d'innovation dans les entreprises artisanales de métiers ancestraux.
2.1.1 Le chef de l'entreprise comme déterminant de l'innovation dans
l'entreprise artisanale de métier ancestral
La promotion de l'innovation au sein de l'entreprise artisanale de métier ancestral dépend
en grande partie, comme le montre la comparaison entre les quatre unités étudiées, des
caractéristiques de son chef. Le rôle de ce dernier est assez important dans les deux actions
menant à l'innovation.
Pour ce qui est de l'introduction des nouveautés développées à l'externe, constituant la
première action occasionnant l'innovation au sein de cette catégorie spécifique d'unités
productives, elle concerne trois unités de notre échantillon : Al, A2 et B2. Elle est
concrétisée, rappelons-le, par les chefs de ces trois unités à travers les actions suivantes :
1) L'acquisition d'un matériel de travail assez sophistiqué pour remplacer les outils jadis
mobilisés;
2) L'instauration des formes d'organisation de travail assez modernes au détriment de la
forme élémentaire de l'organisation du travail;
3) L'utilisation des moyens de commercialisation hyper modernes à la place du seul
moyen traditionnel.
Ces actions montrent que ces chefs constituent des véritables entrepreneurs au plein sens du
terme. Elles témoignent de la présence des deux qualités majeures de l'entrepreneur des
temps moderne. D'une part, ces actions traduisent l'ouverture de ces chefs aux
changements. D'autre part, elles traduisent leur rationalité dans la gestion de leurs
204
entreprises. Ils ont donc les deux caractéristiques fondamentales de l'esprit entrepreneurial
(Ducre, 2005; Basso, 2006; Lowe et Marriott, 2006; Mayoukou et Ratsimbazafy, 2007).
L'absence totale de ces deux caractéristiques chez la chef de l'entreprise BI demeure parmi
les explications logiques de l'absence totale des actions visant le changement. Ainsi,
l'innovation résultant de l'introduction des nouveautés développées à l'externe ne peut être
favorisé qu'en présence d'un chef d'entreprise ayant un esprit entrepreneurial.
Outre que son rôle décisif dans l'action d'introduction d'éléments externes, le chef de
l'entreprise joue un rôle crucial dans la deuxième action menant à l'innovation au sein de
l'entreprise : l'initiative d'une ou de plusieurs personnes évoluant au sein de l'entreprise.
Cette action, qui traduit avant tout la présence d'une logique interne de création, concerne
uniquement les deux entreprises de la poterie artisanale (Al et A2). Tandis que les deux
entreprises de tapis de sol (BI et B2) n'enregistrent pas la présence de cette logique, surtout
l'entreprise B2 où nous repérons la présence de la première action en rapport avec la
culture de l'innovation. De ce fait, l'esprit entrepreneurial demeure tout seul insuffisant
pour encourager et promouvoir une logique de création au sein de l'entreprise (Saint-Pierre
et Mathieu, 2007). Il est important donc que le chef d'entreprise dispose d'autres qualités
pour que les initiatives individuelles occasionnant l'innovation puissent avoir lieu.
Quoi qu'on dise, la promotion de ce type d'initiatives est tributaire de la présence d'un chef
d'entreprise qui se caractérise, en plus de son esprit entrepreneurial, par sa connaissance du
métier, sa valorisation des savoirs individuels et collectifs dans l'entreprise et son
attachement au métier. L'ensemble de ces traits constitue les principales caractéristiques
des chefs des entreprises Al et A2. En réalité, ces traits se manifestent à travers des
comportements concrets de ces chefs dans le travail. Ces comportements sont :
1) L'implication personnelle des deux chefs en question, à l'encontre des chefs des
entreprises BI et B2, dans le processus de la créativité. Leurs connaissances approfondies
du métier leur permet de créer de nouveaux produits. De plus, elles leurs permet de piloter
et d'encadrer les projets créatifs proposés par les membres de leurs entreprises.
2) Le soin particulier accordé, par les chefs des entreprises Al et A2, aux créations
originaires des membres de leurs unités productives. Une telle situation, qui demeure
205
absente dans les entreprises BI et B2, traduit essentiellement la valorisation des savoirs des
individus et du groupe du travail.
3) Le grand intérêt manifesté par les chefs des entreprises Al et A2, contrairement aux
chefs des entreprises BI et B2, envers l'avenir de leur métier. Cet intérêt est concrétisé par
deux faits. D'une part, ils sont eux-mêmes engagés dans un sentier de créativité pour
développer et préserver ce métier de la disparition. D'autre part, ils encouragent
matériellement et immatériellement les membres de leurs entreprises à prendre des
initiatives dans le travail qui peuvent garantir un avenir meilleur à leur métier. Cette
attitude exprime, entre autres, le fort attachement des deux chefs en question à leur métier.
Compte tenu de ce qui précède, la promotion d'une culture d'innovation au sein de
l'entreprise artisanale de métier ancestral dépend en grande partie des qualités de son chef.
En fait, une telle culture se développe en présence d'un chef qui se caractérise par un esprit
entrepreneurial, des connaissances approfondies du métier, un fort sentiment d'attachement
au métier, des qualités d'un leadership qui tient compte des compétences de son groupe de
travail. Toutefois, l'existence de cette culture ne dépend pas uniquement du chef de
l'entreprise mais elle dépend également d'un deuxième type d'acteur : les artisans évoluant
dans l'entreprise.
2.1.2 Les artisans évoluant dans l'entreprise comme déterminant de
l'innovation dans l'entreprise artisanale de métier ancestral
Les artisans évoluant au sein de l'entreprise artisanale de métier ancestral forment un acteur
capital au sein de ce type d'unité productive. À part son rôle dans la production, cet acteur
constitue un pilier principal de l'innovation, notamment dans la deuxième action :
l'initiative d'une ou de plusieurs personnes évoluant au sein de l'entreprise même. La
recherche des causes de la présence de cette action dans certains cas et son absence dans
certains autres confirme cette réalité. Dans les entreprises Al et A2, où on repère
l'existence très forte de cette catégorie d'actions, les artisans évoluant à l'intérieur se
distinguaient de ceux évoluant dans BI et B2 par leur engagement dans une logique de
création interne. L'adhésion des membres des unités Al et A2 dans une telle logique se
manifeste dans leurs initiatives individuelles et collectives ayant pour objectif de mettre en
206
œuvre des produits adéquats aux besoins des consommateurs des temps modernes. Ceci
traduit, sans aucun doute, le fait que des artisans en question disposent de qualités
spécifiques qui les distinguent des artisans évoluant dans les entreprises BI et B2 où ces
réalisations sont entièrement absentes. Concrètement, les différences entre les deux groupes
sont de quatre ordres:
1) Le sens de la création. À l'encontre des artisanes des entreprises BI et B2, les artisans
des entreprises Al et A2 se considèrent comme des gens de métier et non pas des simples
exécutants. D'ailleurs, ils se qualifient eux mêmes en tant qu'artistes. Une telle perception
de soi est révélée par leurs comportements dans le travail. Dans leurs exercices quotidiens,
ils ne se contentent pas de reproduire les modèles préexistants. Ils introduisent
constamment des améliorations sur ces modèles. De même, ils inventent de nouveaux
modèles. Dans l'entreprise Al comme dans l'entreprise A2, la durée de vie d'un produit ne
dépasse pas les trois mois. Une telle situation ne peut qu'exprimer la présence très forte
d'un sens de création chez les artisans évoluant dedans.
2) Les compétences variées. La concrétisation de la logique de création dans ces deux
entreprises est favorisée, aussi, par la maîtrise de leurs artisans du processus entier de la
production ainsi que par leurs connaissances de différentes spécificités des matières
premières mobilisées dans la production. Ces compétences, qui constituent l'un des
principales défaillances des artisanes des entreprises BI et B2, ont permis aux artisans des
entreprises Al et A2 de concrétiser leurs idées créatrices tout en prenant en considération
les contraintes relatives à la production et à la réalisation des produits à base d'argile.
3) La conscience de l'importance du rôle des artisans dans l'évolution du métier et de
l'entreprise. La présence d'une logique de création au sein des entreprises Al et A2 est
rendu possible, également, grâce à la conscience de ses artisans de l'utilité de leurs apports
pour la pérennité de leur métier et la prospérité de l'entreprise. D'ailleurs, ces artisans se
considèrent en tant que les seuls conservateurs de leur métier de la disparition. Une telle
conviction, qui demeure inexistante chez les artisanes des entreprises BI et B2, constitue
un véritable facteur qui les implique dans le développement de leur métier et de leurs
entreprises.
207
4) Le sentiment d'appartenance au métier. La logique de création dans les entreprises Al
et A2 est renforcée, autant, par les représentations de leurs artisans envers le métier. Pour
ces derniers le métier constitue une sphère principale d'identification et non pas un simple
instrument pour réaliser des ressources financières comme il est le cas pour les artisanes des
entreprises BI et B2. D'ailleurs, les membres des entreprises Al et A2 considèrent que le
métier leur a permis d'être reconnu en tant que groupe social autonome qui contribue
activement dans les dynamiques socioéconomiques de la ville d'une part, et qui conserve
l'identité de la société locale d'autre part. Cette représentation ne peut que solidifier le lien
que nouent ces artisans avec le métier de la poterie artisanale. Ce métier représente pour
eux à la fois un groupe de référence et d'appartenance. Une telle relation avec le métier
constitue une autre source de motivation des artisans dans les entreprises Al et A2 à la
création dans la mesure où elle leur permet de garder une bonne image de leur groupe
d'appartenance et de référence.
Ainsi, la présence des initiatives individuelles et collectives, constituant un pilier principal
de l'innovation au sein de l'entreprise artisanale de métier ancestral, traduit l'incorporation
d'une logique interne de création. La promotion de cette logique interne de création repose
beaucoup sur la présence des artisans qui ont des aptitudes individuelles et professionnelles
spécifiques d'une part, et qui sont attachés affectivement à leur entreprise et principalement
à leur métier d'autre part.
En considération de tout ce qui précède, l'innovation se développe dans l'entreprise
artisanale de métier ancestral en raison de deux actions principales : les initiatives internes
et l'introduction des éléments externes. L'émergence de l'une ou de l'autre de ces deux
actions est intimement liée aux qualités personnelles et professionnelles des deux
principaux acteurs : le chef de l'entreprise et les artisans qui l'accompagnent. Toutefois, ces
deux acteurs ne constituent pas les seuls déterminants de l'innovation dans cette catégorie
particulière d'entreprises. Elle dépend, pareillement, des circonstances en lien avec le
contexte de la production.
208
2.2 Les déterminants en lien avec le contexte de la production
En plus des acteurs de l'entreprise, le contexte de la production constitue un autre facteur
conditionnant l'innovation, notamment la promotion d'une logique interne de création. La
comparaison des situations existantes dans les quatre entreprises étudiées montre
clairement que cette logique se développe dans des circonstances organisationnelles,
managériales et culturelles perméables à l'émergence des initiatives individuelles dans le
travail. Autrement dit, la présence de cette logique dans l'entreprise artisanale de métier
ancestral dépend aussi du modèle organisationnel et de la politique de gestion de ressources
humaines appliquées à l'intérieur, ainsi que de la culture de l'entreprise et de celle du
métier.
2.2.1 Le modèle organisationnel comme déterminant de l'innovation au sein
de l'entreprise artisanale de métier ancestral
Les résultats de l'enquête empirique montrent clairement qu'une logique interne de
création, constituant le pilier principal de l'innovation au sein de l'entreprise, se développe
dans un contexte organisationnel qui favorise l'émergence des initiatives individuelles et
collectives dans le travail d'une part, et qui permet de concrétiser ces initiatives d'autre
part. Cette situation correspond aux deux entreprises de la poterie artisanale et non pas aux
deux entreprises du tapis de sol. En d'autres termes, les modèles organisationnels appliqués
dans les entreprises Al et A2 semblent être les plus adéquats à l'émergence d'une logique
de création au sein de l'entreprise. En dépit de leur application de deux modèles
organisationnels relativement différents, ces deux entreprises ont vu, à l'inverse des
entreprises BI et B2, l'apparition des idées créatrices originaires des acteurs qui sont en
contact direct avec la production : les artisans.
La comparaison des modèles organisationnels mis en œuvre dans les quatre entreprises en
question montre que les deux modèles appliqués dans les entreprises Al et A2 partagent
des points similaires qui sont absents dans les modèles mobilisés par les entreprises BI et
B2. En effet, ces points constituent des éléments déterminants de l'instauration de la
logique de création au sein de l'entreprise artisanale de métier ancestral. Concrètement, les
209
entreprises Al et A2 se démarquent des entreprises BI et B2 par leurs structures et leurs
logiques d'organisation de travail.
Au sujet de la structure de l'organisation dans les entreprises Al et A2, elle se caractérise,
comme il a été mentionné dans la partie consacrée à la présentation et à la description des
résultats de l'étude empirique, par sa simplicité. Cette dernière, qui se manifeste tant dans
la division et la hiérarchisation du travail que dans le système de pouvoir régnant dans
l'entreprise, favorise trois conditions importantes à la promotion d'une logique de création
au sein de l'entreprise.
Tout d'abord, elle permet aux artisans évoluant au sein de l'entreprise d'avoir une marge
de liberté assez importante dans le travail. Cette marge demeure d'une grande importance
pour promouvoir l'innovation et surtout la création au sein de l'entreprise dans la mesure
où cette action exprime avant tout la liberté (Romelear, 2002, Alter, 2005). Ensuite, elle
atténue les barrières hiérarchiques dans l'entreprise. Cette atténuation constitue, également,
une condition principale à l'émergence des initiatives individuelles et collectives dans le
travail dans la mesure où les barrières hiérarchiques représentent des véritables entraves à
ce genre d'actions. Enfin, elle implique directement les artisans dans la prise des décisions
relatives aux enjeux de l'entreprise et du métier. Cette implication reste, aussi, une exigence
à la promotion de l'innovation au sein des unités productives dans la mesure où ce
phénomène doit intéresser tout les composantes de l'entreprise (Callon, Akrich et Latour,
2006). La réunion de l'ensemble de ces conditions dans les entreprises Al et A2 explique la
présence très importante des initiatives créatrices dans le travail qui visaient principalement
l'amélioration des produits jadis fabriqués et le lancement de nouveaux produits. En effet,
la structure d'organisation de type simple semble constituer le type de structure adéquat à
l'émergence des initiatives dans le travail. Néanmoins, ce type de structure ne garantit pas
tout seul cette émergence. Les situations dans l'entreprise BI confirment cette réalité. En
dépit de la simplicité de sa structure, cette entreprise est loin d'être un milieu de travail où
on peut repérer des initiatives créatrices. Ceci peut être expliqué par la logique
d'organisation qui favorise le travail de type individualiste et non pas celui de type
participatif.
210
Compte tenu des situations existantes dans les unités Al et A2, ce type de travail constitue
une des conditions organisationnelles perméables à l'apparition et à la concrétisation des
initiatives créatrices dans l'entreprise. La logique du travail participatif dans les deux
entreprises en question se manifeste tant dans les relations entre les différentes unités
organisationnelles composant l'entreprise, que dans les pratiques participatives qui
marquaient une constance dans le vécu quotidien des artisans dans le travail. Cette situation
reste favorable à deux autres conditions requises par la logique de la création dans
l'entreprise.
Tout d'abord, elle favorise la coopération et la collaboration entre les différents acteurs de
l'entreprise. Ces deux actions constituent deux éléments nécessaires pour favoriser la
création parmi les acteurs de l'entreprise dans la mesure où le succès d'une initiative
individuelle dérive d'efforts organisationnels collectifs (Gordon, 1989). Ensuite, elle
permet l'instauration d'un système de relations interactif structuré par le face à face et la
négociation. Un tel système favorise, également, l'apparition des initiatives créatives que
ce soit individuelles ou collectives. L'importance de ce type de système est due
principalement à l'importance de la dimension sociale, notamment des interactions dans
tout processus menant à l'innovation (Bijker, Hugues et Pinch, 1987). Grâce à la présence
des ces conditions organisationnelles supplémentaires, les deux entreprises de la poterie
artisanale ont réussi, à l'encontre des entreprises de tapis du sol, la promotion d'une logique
interne de création qui se base principalement sur les initiatives de leurs membres.
En somme, la présence d'une logique interne de création dépend de la nature de la structure
de l'organisation ainsi que de la logique de la division du travail. Toutefois, la comparaison
des situations existantes dans les deux entreprises de la poterie artisanale, où on repère la
forte présence de cette logique, à celles existantes dans les entreprises de tapis du sol, où
cette logique est totalement absente, montre que l'émergence des initiatives individuelles
et collectives dans le travail est dépendante également d'un autre facteur : la politique des
gestion des ressources humaines.
211
2.2.2 La politique managériale comme déterminant de l'innovation dans
l'entreprise artisanale de métier ancestral
La recherche d'autres explications pertinentes de l'absence totale d'une logique interne de
création au sein des entreprises Blet B2 et de sa forte présence dans les entreprises Al et
A2 conduit à déceler une autre différence entre ces deux blocs d'entreprise. Cette différence
réside dans un.autre déterminant de l'instauration d'une logique interne de création. Ce
déterminant est la politique de gestion des ressources humaines ((Mohr, 1969;
Descarpentries et Korda, 2007). À vrai dire, les entreprises Al et A2 se distinguaient des
entreprises BI et B2 par la mobilisation des outils de gestion des ressources humaines qui
exhortent, reconnaissent et rétribuent les initiatives créatives. Autrement dit, le système de
gestion de conduites dans les deux premières entreprises encourage et valorise l'esprit
créatif, tandis que ce système, dans les entreprises BI et B2, sanctionne ce genre d'esprit.
Comme il a été mentionné antérieurement dans la partie consacrée à la description des états
des lieux dans ces deux entreprises, les artisanes n'entreprennent pas d'initiatives dans le
travail par crainte d'être sanctionnées. La sanction peut aller jusqu'à la révocation par
l'entreprise. À coup sûr, cette situation demeure défavorable au développement d'un esprit
créatif chez les artisanes. À l'inverse, les artisans des entreprises Al et A2 évoluent dans un
contexte managerial totalement aux antipodes. Les outils de la gestion individuelle ainsi
que ceux de la gestion collective dans ces deux entreprises constituent des véritables stimuli
aux initiatives créatives.
Dans ces deux entreprises, la création est à la fois un moyen à travers lequel les artisans
peuvent améliorer leurs revenus et réaliser une mobilité professionnelle au sein de
l'entreprise. De même, elle constitue pour eux une véritable source de reconnaissance dans
le travail et la sphère principale de construction d'une identité professionnelle. En effet, la
création dans les entreprises Al et A2 constitue une véritable source de gratification
matérielle et immatérielle. Concrètement, un artisan entreprenant une initiative créative
dans le travail trouve un soutien de la part du chef d'entreprise. Les chefs de Al et A2
encouragent les artisans qui les accompagnent à faire des ajouts sur les anciens produits et
même les incitent à produire de nouveaux modèles. Aussi, ces chefs contribuent à la
212
concrétisation des apports de leurs artisans. Une telle situation exprime, entre autres, la
présence d'un système de gestion de conduites qui ne contrôle pas les artisans dans leurs
moindres gestes dans le travail. De même, elle traduit l'existence d'un accompagnement
des artisans dans leurs initiatives dès leur émergence jusqu'à leur mise en œuvre sans
calculer à l'avance l'apport de ces initiatives. Dans un cas de réussite, l'initiative est
porteuse pour l'entreprise et l'artisan voit sa situation professionnelle ainsi que financière
s'améliorer. Dans le cas inverse, l'initiative est sans apport pour l'entreprise et la situation
de l'artisan ne subit aucun changement. En effet, les artisans dans les entreprises Al et A2
sont encouragés à exprimer leurs talents créatifs sans craindre d'être sanctionnés. Une telle
situation managériale donne, sans aucun doute, l'autre explication logique de l'engagement
constant des ces artisans dans un courant de créativité.
Ainsi, la forte présence d'une logique interne de création dans les entreprises artisanales de
métiers ancestraux dépend de la nature de la politique de gestion de ressources humaines
mobilisée. Une politique favorisant cette logique est celle qui incite les artisans à la
création, qui les protège dans leurs démarches créatives et qui reconnaît le fruit de leurs
initiatives. Cependant, le succès de cette politique passe par la présence au préalable des
cultures de métier et d'entreprise perméables à l'émergence des initiatives créatives. En
d'autres termes, il est nécessaire que la culture de l'entreprise et celle du métier soient
propices à l'innovation afin que la politique en question puisse réaliser ses objectifs.
2.2.3 La culture d'entreprise et la culture de métier comme déterminants de
l'innovation dans l'entreprise artisanale de métier ancestral
Effectivement, la forte présence d'une culture d'innovation au sein des deux entreprises de
la poterie artisanale est favorisée avant tout par la culture de chacune d'elle ainsi que par la
culture du métier à laquelle elles appartiennent. La confrontation des situations existantes
dans les entreprises Al et A2 à celles existantes dans les entreprises BI et B2 ont été à
l'origine de ce constat.
L'analyse comparative montre que les membres des deux premières entreprises se
distinguaient par leurs habitudes et attitudes favorisant et valorisant le changement dans le
travail, tandis que les membres des deux autres entreprises ne révèlent pas des habitudes et
213
des attitudes semblables. Pour ces derniers le changement dans le travail ne constitue pas
un centre d'intérêt. Il est même perçu comme une affaire qui ne les concerne pas. Une telle
attitude se manifeste, principalement, dans leurs comportements au travail. Les artisanes de
l'entreprise BI comme celles de l'entreprise B2 se contentent de l'exécution des tâches qui
leurs sont dictées sans penser à l'amélioration de certains éléments relatifs à leurs exercices
professionnels. Dans des conditions pareilles, il serait difficile de voir la naissance d'une
culture d'innovation au sein de ces deux entreprises. Car ce type de culture, qui est
essentiellement une production propre des acteurs de l'entreprise (Alter, 2005), nécessite
fondamentalement la présence des habitudes et des attitudes qui n'entravent pas le
changement (Tellis, 2009). En effet, l'innovation et la création dans les entreprises Al et
A2 se sont développées grâce à la présence des habitudes et des attitudes favorables au
changement. En d'autres termes, ces deux unités productives se caractérisaient par des
cultures d'entreprises orientées vers le changement. Ce type de culture demeure, sans
aucun doute, propice à l'innovation et la création dans la mesure où ces deux actions,
rappelons le, traduisent en premier lieu un changement significatif. Alors pourquoi ce type
de culture s'est développé dans les entreprises de la poterie et non pas dans les entreprises
du tapis ?
Certes, plusieurs facteurs ont fait la différence entre les deux blocs d'entreprises.
Néanmoins, un facteur capital a été identifié à l'issue de l'enquête empirique. Ce facteur
concerne la culture du métier à laquelle appartient chaque couple d'entreprise. L'analyse
comparative montre que la présence d'une culture d'entreprise orientée vers le changement
dans les unités Al et A2 est favorisée en grande partie par la culture du métier de la poterie
artisanale. Ce métier a témoigné historiquement, à l'inverse du métier du tapis de sol, de sa
capacité de s'adapter aux transformations qui connaissent ses différents environnements.
Grâce à l'adhésion de ses générations successives à une logique d'amélioration, ce métier a
su chaque fois s'accommoder aux différents aléas externes. Cette réalité exprime
l'ouverture de ce métier au changement et à l'amélioration.
Or, le changement est une valeur partagée par les individus exerçant le métier de la poterie
artisanale. Dans cette perspective, le changement représente un des éléments capitaux
constitutifs de la culture du métier de la poterie artisanale. D'ailleurs, les artisans potiers,
214
comme le montre les résultats de l'étude empirique dans les entreprises Al et A2, sont
socialisés dès leur accès au métier à l'amélioration des différents éléments relatifs à leurs
exercices professionnels. L'innovation et la création constituent, en effet, un apprentissage
culturel pour les membres de ce métier. Dans le cas du métier de tapis de sol ce type
d'apprentissage est totalement absent. Au contraire, ce métier impose à ses membres un
ensemble de contraintes dans la production qui entravent le changement. Concrètement, les
artisanes de BI et B2, comme toutes les artisanes évoluant dans ce métier, doivent
respecter des modèles préconçues pour franchir avec succès une opération délicate en lien
avec le processus de la production : l'estampillage. Dans une situation pareille, la
socialisation se centre uniquement autour du respect des normes de la production. En
effet, la culture du métier est orientée vers la standardisation et non pas vers le
changement, notamment l'innovation. L'amélioration d'un ou de plusieurs dimensions de
la production ne représente donc pas un apprentissage pour les artisanes du tapis.
L'absence d'un tel type d'apprentissage reste une autre explication logique de l'absence
d'une culture d'innovation au sein des deux entreprises du tapis de sol.
À coup sûr, la culture du métier demeure aussi déterminante dans la promotion d'une
logique d'innovation et de création au sein des entreprises artisanales de métiers
ancestraux. À vrai dire, elle est le piédestal de cette logique du moment que la culture
d'entreprise, qui constitue un facteur déterminant dans l'innovation au sein de l'entreprise,
est déterminée en majeure partie par la culture du métier (Denieuil, 2008; Godelier, 2008).
Sans une culture de métier ouverte aux changements et à l'amélioration, il devient difficile,
voir impossible, de promouvoir une culture d'entreprise propice à l'innovation.
À tout prendre, la promotion de l'innovation au sein de l'entreprise artisanale de métier
ancestral dépend de plusieurs conditions. Elle réclame avant tout la présence d'un chef
d'entreprise qui a les qualités d'un leadership qualifié fortement attaché à son métier. Elle
requiert, en même temps, l'incorporation des individus disposant des caractéristiques
particulières leurs permettant de prendre des initiatives dans le travail. Aussi, elle nécessite
la mise en œuvre des modèles organisationnels et managériales perméable à l'émergence et
à la concrétisation de ces initiatives. De plus, elle exige l'existence d'une culture
d'entreprise orientée vers le changement permettant l'application des ces modèles.
215
Également, elle revendique l'appartenance de l'entreprise à une culture de métier favorable
à la construction d'un tel type de culture d'entreprise. Ainsi, les déterminants de
l'innovation dans le contexte d'entreprise artisanale de métier ancestral sont multiples et de
nature hétérogène. Le schéma suivant résume ces déterminants.
Schéma 4: Les déterminants de l'innovation dans le contexte d'entreprise artisanale de métier ancestral
Déterminants humains - Le chef de l'entreprise - Les artisans évoluant dans l'entreprise
Déterminants managériaux - la politique de gestion des ressources humaines
Déterminants organisationnels - La structure de l'organisation - La division du travail
Déterminants culturels - La culture de l'entreprise - La culture du métier
Ainsi, l'action de l'innovation dans les unités productives pratiquants des métiers hérités
du passé dépend du contexte productif tout entier. Toutefois, la relation entre cette action
et ce contexte dépasse la simple relation de dépendance. Elle est aussi une relation de
causalité dans la mesure où toute innovation a des effets directs sur la communauté de sa
mise en œuvre (Alter, 2009). Alors quels sont les impacts de l'innovation dans un contexte
d'entreprise artisanale de métier ancestral ?
3. Les impacts de l'innovation dans un contexte d'entreprise artisanale de
métier ancestral
Évoquer les impacts de l'innovation dans un contexte de production signifie, entre autres,
mesurer les effets tangibles et intangibles, positifs et négatifs de la mise en œuvre de
216
nouveaux éléments dans ce contexte. Il s'agit donc de déterminer les résultats enregistrés à
l'issue de l'introduction d'un ou de plusieurs nouveaux éléments sur une ou plusieurs
dimensions de l'entreprise. Concrètement, les innovations qu'ont connues certaines
entreprises, faisant l'objet de la présente recherche, ont induit la modification de certains
éléments se rapportant au vécu des humains en dehors et dans l'entreprise ainsi que la
modification de certains éléments en lien avec leurs univers de travail. Autrement dit, les
entreprises qui ont connu l'expérience de l'innovation ainsi que leurs membres ont été
influencées par cette expérience. En effet, les impacts de l'innovation concernaient tant les
individus que l'entreprise.
3.1 Les impacts de l'innovation sur les individus dans l'entreprise artisanale
de métier ancestral
Tel qu'il a été précisé antérieurement, seulement les entreprises Al, A2 et B2 ont vécu des
expériences d'innovation. Toutefois, l'ampleur et le contenu de chacune de ces expériences
ne sont pas identiques. En ce sens, les impacts de ces expériences sur les individus varient
d'une entreprise à une autre. Au-delà de cette réalité, les résultats de l'enquête empirique
permettent de distinguer plusieurs impacts possibles de l'innovation sur les individus dans
l'entreprise artisanale de métier ancestral. Ces impacts peuvent être regroupés sous deux
catégories principales : des impacts sur le vécu personnel de l'individu et des impacts sur
son vécu professionnel.
3.1.1 Les impacts de l'innovation sur le vécu personnel de l'individu
Par impacts sur le vécu personnel de l'individu, on entend dire les effets de l'expérience de
l'innovation dans l'entreprise sur la vie personnelle de l'individu, que ce soit dans ou en
dehors du travail. Il s'agit donc des profits ou des pertes personnelles résultant de
l'appartenance des individus à une entreprise incorporant l'expérience de l'innovation.
Dans les cas étudiés incorporant cette expérience, l'innovation était toujours porteuse de
profits pour les individus ; c'est-à-dire qu'elle a été avantageuse pour eux. Plus exactement,
l'innovation a permis aux membres des entreprises Al, A2 et B2 de réaliser des avantages
de type matériel et d'autres de type immatériel.
217
Au sujet des avantages de type matériel, ils concernent principalement les revenus des
individus. Cette situation est exclusive aux membres des deux entreprises de la poterie
artisanale qui ont fait partie de l'échantillon étudié. Pour les membres de l'entreprise Al
comme pour ceux de l'entreprise A2, l'engagement dans une logique interne de création et
d'innovation constitue une source d'augmentation de revenu. Dans ces deux entreprises, la
rétribution varie d'une personne à une autre en fonction des réalisations de tout un chacun.
Par exemple, dans l'entreprise Al, comme il a été déjà mentionné, un artisan qui crée un
nouveau produit ou qui introduit des modifications sur un ancien produit jouit de la plus
grande part des bénéfices réalisés à l'issue de la commercialisation de son ouvrage. La
situation dans l'entreprise A2 n'est pas très différente. Le revenu d'un artisan dans cette
entreprise est fonction aussi de ses réalisations quantitatives et qualitatives dans le travail.
Pour les réalisations qualitatives, qui traduisent l'amélioration d'un ancien produit ou la
création d'un autre nouveau, elles entraînaient systématiquement l'augmentation du revenu
de l'auteur de l'une ou de l'autre des deux actions. Ainsi, l'adhésion à une logique
d'innovation et de création constitue un moyen à travers lequel les membres des
entreprises de métiers ancestraux peuvent améliorer leurs situations matérielles,
notamment leurs situations financières.
Quant aux avantages d'ordre immatériel, ils concernaient principalement la santé de
l'individu au travail. Ces avantages sont dus principalement à l'innovation d'ordre
matériel. C'est-à-dire qu'elles résultaient de l'introduction des nouveautés sur l'outillage
du travail. Cette situation n'est pas unique aux membres des deux entreprises de la poterie
artisanale (Al et A2). Elle concerne également les membres de l'entreprise B2 qui est
spécialisée en tapis de sol. L'introduction de nouveaux outils de travail dans ces trois
entreprises a entraîné à la fois la réduction des efforts physiques et l'amélioration de la
sécurité des individus dans le travail.
Dans le cas des entreprises Al et A2, le remplacement du tour de potier traditionnel par un
autre moderne et la mise en œuvre, pour la première fois, de la malaxeuse-boudineuse, ont
permis aux individus d'épargner d'énormes efforts physiques dans le travail. Dorénavant,
les artisans potiers n'ont plus besoin de déployer des efforts physiques dans les deux tâches
principales de la production : le façonnage et le pétrissage. Pour ce qui est du nouveau
218
tour, il permet d'éliminer un mouvement physique déployé, auparavant, par l'artisan
pendant le façonnage des œuvres en argile. Ce mouvement, qui consiste à commander le
tour par les pieds, nécessite d'énormes efforts physiques. Le nouveau tour permet aux
artisans de délaisser ce mouvement dans la mesure où il fonctionne électriquement. En
conséquence, l'effort physique de l'artisan dans le travail diminue. Ceci ne peut
qu'augmenter sa concentration sur la qualité et l'amélioration de son œuvre, notamment la
création. En ce qui concerne la malaxeuse-boudineuse, elle permet également aux artisans
d'épargner d'énormes efforts physiques lors de la phase de pétrissage puisque c'est la
machine qui les remplace complètement dans cette tâche. Néanmoins, les avantages de
cette machine ne se limitent pas à la réduction de la charge physique des artisans potiers.
Elle a plutôt des effets directs sur leur santé. Elle leur permet, comme nous l'a indiqué le
maître artisan de l'entreprise Al, de minimiser les risques d'être affecté par une maladie
chronique réputée chez les artisans potiers dans leurs vieillesses : le rhumatisme. Avec
cette nouvelle machine, les artisans potiers ne sont pas obligés de passer de longues heures
dans le pétrissage de l'argile avec leurs pieds nus. Ainsi, l'innovation d'ordre matériel
s'avère avantageuse à la santé des artisans. Cette réalité est confirmée d'autant plus dans
l'entreprise B 2 spécialisée en tapis de sol. Dans cette dernière, le remplacement du métier
à tisser traditionnel par un autre moderne a rendu la tâche de tissage plus facile pour les
tisserandes. Le nouveau métier à tisser a permis aux artisanes d'épargner l'effort de
surélever les bancs sur lesquels elles travaillent pour se trouver toujours à la bonne
hauteur. Avec le nouveau métier, elles ne sont pas donc obligées de déployer un effort
physique supplémentaire dans le travail. Car il est équipé de deux barres de forme
cylindrique et non pas carrée comme c'est le cas dans l'ancien.métier à tisser. La nouvelle
forme est adoptée afin de pouvoir enrouler chaque partie de tapis tissé. De cette façon, les
artisanes ne sont pas obligées de s'ajuster continuellement au niveau du tissage.
Compte tenu de ce qui précède l'innovation dans ces deux dimensions, l'innovation
résultant des initiatives des acteurs de l'entreprise et l'innovation occasionnée par
l'introduction des éléments externes, a des impacts positifs sur le vécu personnel des
individus évoluant dans les entreprises de métiers ancestraux. Elle représente un moyen à
travers lequel les travailleurs peuvent améliorer la qualité de leurs vies que ce soit en
dehors ou dans le travail. Certes, une bonne qualité de vie constitue une condition
219
principale à l'engagement des artisans dans les deux processus qui ont fait l'objet central
de cette étude : l'innovation et la transmission de savoirs professionnels. Néanmoins,
l'engagement dans ces processus se manifeste dans le vécu professionnel des individus et
non pas dans leur vécu personnel. Ceci dit, le vécu professionnel des individus se trouve à
son tour influencé par l'innovation. Alors quels sont les impacts de l'innovation sur le vécu
professionnel des individus évoluant dans les entreprises artisanales de métiers
ancestraux ?
3.1.2 Les impacts de l'innovation sur le vécu professionnel de l'individu
Par impacts de l'innovation sur le vécu professionnel de l'individu, on désigne les effets de
l'expérience de l'innovation sur le parcours professionnel des travailleurs au sein de
l'entreprise. Il est donc sujet à des changements d'ordre professionnel qui peuvent être
ressentis par les humains dans une entreprise où l'innovation est présente. La recherche des
impacts de l'innovation sur le vécu professionnel de l'individu signifie, en effet,
l'identification des changements professionnels individuels qui en résultent, de
l'appartenance de l'individu à un milieu de travail incorporant la logique de l'innovation.
Compte tenu des résultats de l'enquête empirique, l'innovation modifie trois dimensions en
lien avec le vécu professionnel de l'individu : le statut professionnel, la productivité et
l'esprit du travail en équipe.
En ce qui a trait au statut professionnel de l'individu au sein de l'entreprise, l'innovation,
notamment l'innovation de produit, constitue une voie à travers laquelle les individus
peuvent réaliser une mobilité professionnelle au sein de l'entreprise. Ce phénomène a été
observé exclusivement dans les deux entreprises de la poterie artisanale. Plusieurs membres
de ces deux entreprises ont réalisé une ascension sur l'échelle professionnelle comme suite
à leur prise d'initiatives créatrices dans le travail. De ce fait, le changement de statut
professionnel, qui constitue une dimension importante du vécu professionnel de l'individu
au sein de l'entreprise, peut résulter de son implication dans la première action
occasionnant l'innovation: l'initiative d'une ou de plusieurs personnes évoluant au sein de
l'entreprise.
220
De même, l'introduction d'une ou de plusieurs nouveautés développées à l'externe, qui
représente la deuxième action occasionnant l'innovation dans l'entreprise, a des effets
directs sur le vécu professionnel de l'individu au sein de l'entreprise. Exactement, elle
affecte les deux autres dimensions relatives à ce vécu et citées ci-dessus : la productivité et
l'esprit du travail en équipe.
Relativement à la productivité, l'innovation, notamment l'innovation des outils de travail, a
contribué à l'augmentation du rendement professionnel des individus que ce soit dans les
entreprises Al et A2 ou dans l'entreprise B2. Dans cette dernière, le remplacement du
métier à tisser traditionnel par un autre moderne a induit l'amélioration de la productivité
des artisanes. Auparavant, une artisane tissait en moyenne 15 rangées par jours. Avec le
nouveau métier à tisser, elle tisse en moyenne 22 rangées. Dans le cas des deux entreprises
de la poterie artisanale (Al et A2), la productivité des artisans a connu, également, une
augmentation considérable comme suite à l'échange du tour traditionnel par un autre
électrique. Dans l'entreprise Al comme dans l'entreprise A2, la rentabilité des artisans a
doublé. À titre d'exemple, la production journalière d'un artisan de vases de décoration est
passée dans l'entreprise Al de 20 vases à 35 vases. Ainsi, l'innovation influence une autre
dimension importante du vécu professionnel de l'individu: sa productivité.
En liaison avec l'esprit du travail en équipe, constituant l'autre dimension du vécu
professionnel de l'individu qui est affecté par l'innovation, celui-ci est influencé
essentiellement par l'innovation organisationnelle. Cette réalité concernait également les
deux entreprises de la poterie artisanale ainsi que l'entreprise du tapis de sol (B2).
Toutefois, l'impact de l'innovation organisationnelle sur cette dimension n'est pas le même
dans les deux cas. Dans le cas des entreprises Al et A2, le modèle organisationnel artisanal
n'était pas totalement changé. Il ajuste été modifié légèrement afin de favoriser et valoriser
le travail en groupe. Ceci a contribué à l'ancrage de l'esprit d'équipe chez les artisans. Les
discours de ces derniers, présentés antérieurement, témoignent de cette réalité. Or, dans le
cas de l'entreprise B2 c'est l'esprit individualiste dans le travail qui règne. Sans aucun
doute, le remplacement du modèle organisationnel artisanal par un autre totalement
rationalisé a été à l'origine de cet esprit. Car le nouveau modèle divise minutieusement les
tâches afin de faciliter le contrôle des rendements individuels dans le travail. Dans une
221
situation pareille, la visibilité ne concerne que le travail de l'individu. Il est donc logique de
trouver des artisanes avec un esprit de travail purement individualiste. Ainsi, l'innovation,
notamment celle d'ordre organisationnel, est déterminante dans l'esprit du travail chez
l'individu évoluant dans une entreprise artisanale de métier ancestral. Elle a, en effet, une
influence directe sur le vécu professionnel de l'individu.
En somme, l'innovation dans l'entreprise artisanale de métier ancestral ne peut pas être
sans effet sur l'expérience vitale de l'individu dans la mesure où elle a des impacts
immédiats sur deux sphères principales de cette expérience : la sphère personnelle et
professionnelle. Elle contribue à la modification de son revenu, influence sa santé,
détermine son statut au travail, agit sur sa productivité et façonne son esprit dans le travail.
Bref, elle est déterminante de son vécu dans et en dehors de l'entreprise. Étant donné que
l'individu est une partie d'un tout qui est l'entreprise, il est évident que celle-ci sera à son
tour influencée par l'innovation. Alors quels sont les impacts de l'innovation sur
l'entreprise artisanale de métier ancestral ?
3.2 Les impacts de l'innovation sur l'entreprise artisanale de métier ancestral
L'action de l'innovation, rappelons-le, consiste en la modification d'un ou de plusieurs
éléments en relation avec l'une des activités de l'entreprise (OCDE, 2010 ; Denervaud et
Chatin, 2009; Uzunidis, 2004) dans le but d'améliorer les résultats économiques de cette
dernière. En effet, s'interroger sur les impacts de l'innovation sur l'entreprise revient,
entre autres, à traiter des apports de l'expérience de l'innovation à ses différentes activités
ainsi qu'à sa rentabilité financière. Les résultats de l'enquête empirique montrent
clairement que cette expérience influence, selon le cas, les deux activités principales de
l'entreprise : la production et la commercialisation. De même, ils montrent que les résultats
économiques de l'entreprise sont déterminés en grande partie par les apports de
l'innovation aux deux activités en question. En effet, deux types d'impacts de l'innovation
sur l'entreprise peuvent être distingués : les impacts sur les activités productives et
commerciales de l'entreprise et les impacts sur ses résultats économiques. Ces deux types
d'impacts sont liés par une relation étroite de cause à effet.
222
3.2.1 Les impacts de l'innovation sur les activités productives et
commerciales de l'entreprise
Évoquer la question des impacts de l'innovation sur les activités productive et
commerciale de l'entreprise traduit avant tout l'identification des ses apports à ces deux
principales activités. Il s'agit, principalement, de cerner les effets de la mise en œuvre
d'une ou de plusieurs nouveautés sur une ou plusieurs dimensions structurant les deux
activités en question.
3.1.2.1 Les impacts de l'innovation sur l'activité productive de l'entreprise
Les impacts de l'innovation sur l'activité productive de l'entreprise résultent
principalement de deux types d'innovations : l'innovation des outils de travail et
l'innovation du produit.
En ce qui concerne les impacts de l'innovation des outils de travail sur l'activité productive
de l'entreprise, ils se manifestent dans deux dimensions principales de cette activité : la
productivité de l'entreprise et la qualité des produits. Tout d'abord, ce type d'innovation a
entraîné une augmentation considérable de la quantité de production dans les entreprises
Al, A2 et B2 où ce type d'innovation a été repéré. L'introduction d'une nouvelle machine
(la malaxeuse- boudineuse) et le remplacement du tour de potier traditionnel par un autre
moderne dans les deux premières entreprises ont contribué, comme il a été déjà mentionné,
à l'augmentation de la productivité des artisans. Le même résultat a été enregistré dans la
troisième entreprise comme suite au remplacement du métier à tisser traditionnel par un
autre moderne. Une telle augmentation ne peut qu'induire l'augmentation automatique de
la productivité de l'entreprise dans la mesure où cette dernière dépend étroitement de la
productivité de ses membres (Schaller, 2001). Ainsi, l'impact de l'innovation du matériel
de travail est ressenti dans la productivité de l'entreprise chez qui les outils constituent
une dimension centrale dans l'activité productive. Ceci s'explique par le fait qu'elle
représente une mesure globale de l'efficience et de l'efficacité de cette activité (Gamsoré,
2006). En effet, la productivité de l'entreprise permet d'évaluer le système productif tout
entier.
223
De plus, l'impact de l'innovation des outils de travail est révélé dans la qualité des
produits. Concrètement, la qualité des produits des entreprises Al, A2 et B2 s'est
améliorée grâce à l'innovation des équipements de production. Dans le cas des entreprises
Al et A2, la mise en œuvre du tour de potier électrique a permis aux artisans de mieux
contrôler l'œuvre en argile pendant son façonnage. Ceci permet, selon les propos des
artisans évoluant dans ces deux unités productives, de rendre meilleure la qualité des
produits. Ces artisans précisent que les déformations de ces produits lors du façonnage sont
devenues moins fréquentes avec le nouveau tour. Dans le cas de l'entreprise B2, le
remplacement du métier à tisser en bois par un nouveau en métal permet, selon les
artisanes interviewées dans cette entreprise et qui ont déjà travaillé sur un métier à tisser en
bois, d'avoir plus de perfection au niveau de la largeur du tapis qui était une affaire
difficile avec l'ancien outil. De ce fait, le nouvel outil rend la qualité des tapis plus
meilleure. Ainsi, l'innovation des outils de travail a également un impact direct sur une
autre dimension importante de l'activité productive de l'entreprise qui est la qualité des
produits (Bachet, 2007). En somme, l'innovation des outils de travail dans les entreprises
artisanales de métiers ancestraux agit tant sur la quantité que la qualité de la production.
Quant aux impacts de l'innovation de produit sur l'activité productive de l'entreprise, ils se
révèlent dans l'un des éléments les plus importants de la production: le produit.
Concrètement, la production dans les deux entreprises de la poterie artisanale est devenue
variée grâce à leurs incorporations de ce type d'innovation. Les entreprises Al et A2 ont
réussi, comme le montrent les résultats de l'enquête empirique, à diversifier leurs gammes
de produits et à élargir ces gammes grâce à l'implication de leurs membres dans une
logique interne de création. Ceci a entraîné la mise à la disposition des consommateurs
locaux ainsi qu'étrangers d'une variété de produits en argile de grande utilité. Ainsi,
l'impact de l'innovation de produit concerne une autre dimension importante de l'activité
productive de l'entreprise. Cette dimension est l'étendue de la gamme de produits.
L'importance de cette dimension dans cette activité est due au fait qu'elle représente le
nombre total de produits différents fabriqués par l'entreprise (Kolter, 2009).
En somme, les impacts des innovations, notamment de l'innovation de matériel et
l'innovation de produit, sur l'activité productive de l'entreprise sont d'ordre quantitatif et
224
qualitatif. Elles contribuent ensemble à l'amélioration de la productivité et de la qualité de
des produits. De même, elles contribuent à la diversification des produits.
3.1.2.2 Les impacts de l'innovation sur l'activité commerciale de l'entreprise
Tel qu'il a été précisé, l'activité commerciale constitue le deuxième champ d'innovation
dans le contexte de l'entreprise artisanale de métier ancestral. Les impacts de l'innovation
subis par cette activité se révèlent dans deux de ses dimensions : la clientèle et les
techniques de vente.
Pour ce qui est de la clientèle, qui est le centre de l'activité commerciale de l'entreprise,
elle a connu des changements considérables dans le cas des deux entreprises de la poterie
artisanale (Al et A2) ainsi que l'entreprise du tapis de sol (B2). Ces changements sont dus
principalement à la réalisation de ces trois entreprises, à l'inverse de l'entreprise BI, d'une
innovation de marché. Cette réalisation, qui est concrétisée par l'ouverture de nouveaux
marchés ou le positionnement d'une nouvelle façon des produits, a permis aux entreprises
Al, A2 et B2 d'élargir leurs champs d'action commerciaux. La clientèle de ces entreprises,
comme il a été déjà mentionné dans la partie consacrée à la description de l'innovation dans
ces entreprises, n'est pas uniquement une clientèle régionale. Elle est devenue, grâce à
l'innovation de marché, une clientèle plus large incorporant aussi bien les consommateurs
nationaux que les consommateurs internationaux. Ainsi, l'innovation de commercialisation,
notamment l'innovation de marché, contribue à la diversification de la clientèle de
l'entreprise artisanale de métier ancestral.
Au sujet des techniques de vente, qui constituent les éléments de base de l'activité
commerciale de l'entreprise, elles ont connu à leur tour d'importants changements. Ces
derniers sont occasionnés essentiellement par le deuxième type d'innovation de
commercialisation. Ce dernier, qui est l'innovation de moyens de commercialisation, a
permis aux entreprises en question de remplacer la méthode de commercialisation
traditionnelle par d'autres méthodes modernes. Avec une telle orientation, ces entreprises
ont réussi à varier leurs techniques de vente d'une part, et d'utiliser des techniques
correspondantes au contexte actuel. Ainsi, l'innovation de moyens de commercialisation
225
contribue à la fois à la diversification et au développement des techniques de ventes de
l'entreprise artisanale de métier ancestral.
En résumé, l'activité commerciale de l'entreprise peut être modifiée en profondeur par un
type bien particulier d'innovation : l'innovation de commercialisation. Cette dernière
entraîne, par ses deux dimensions principales, l'innovation de marché et l'innovation de
moyens de commercialisation, des impacts sur la taille du marché ainsi que sur les
méthodes de vente de l'entreprise.
Tout bien considéré, l'innovation entraîne des impacts irréversibles sur les deux activités
principales de l'entreprise artisanale de métier ancestral : soit l'activité productive et
commerciale. Étant donnée l'importance de ces deux activités dans la détermination des
résultats économique de l'entreprise, l'innovation aura, sans aucun doute, des impacts sur
ces résultats. Alors, quels sont ces impacts?
3.2.2 Les impacts de l'innovation sur les résultats économiques de l'entreprise
Traiter des impacts de l'innovation sur les résultats économiques de l'entreprise traduit
avant tout l'examen de ses conséquences sur sa croissance et sa pérennité. Il s'agit,
principalement, de cerner les impacts de l'innovation sur l'avenir de l'entreprise artisanale
de métier ancestral. Les résultats de l'enquête empirique permettent de distinguer deux cas
de figures. Le premier cas de figure regroupe les deux entreprises de la poterie artisanale
(Al et A2). Le deuxième est exclusif à l'entreprise du tapis de sol (B2).
Dans le premier cas, les bénéfices des entreprises Al et A2 ont connu une augmentation
considérable suite à la mise en œuvre des nouveautés touchant leurs activités productives
et commerciales. Une telle situation exprime que l'innovation a eu des effets directs et
positifs sur les résultats économiques de l'entreprise. Dans le deuxième cas, la situation
est totalement différente. En dépit des innovations qui ont touché les activités productives
et commerciales de l'entreprise B2, les bénéfices de cette dernière ne se sont pas
améliorés. Dans une situation pareille, l'innovation n'a donc pas réalisé son principal
objectif, qui consiste à améliorer les résultats économiques de l'entreprise.
226
Ainsi, l'innovation au sein de l'entreprise artisanale de métier ancestral ne garantit pas
toujours l'augmentation de ses bénéfices. Malgré la présence d'une culture d'innovation
dans les deux cas de figure, les résultats ne sont pas identiques. Autrement dit, la
compétitivité, constituant l'essentiel déterminant des résultats et des performances
économiques de l'entreprise (Barrand, 2010 ; Blondel, 2010; Safarti, 2010; OCDE, 2010),
n'ont pas connu l'amélioration dans les deux cas. En effet, la compétitivité et par
conséquent les résultats économiques de l'entreprise ne sont pas tributaires de l'innovation
tout court. Elles exigent plutôt la présence d'un type particulier d'innovations qui est
l'innovation de produit. Néanmoins, les autres types d'innovation sont d'une grande
importance dans la détermination de la compétitivité de l'entreprise. La comparaison entre
les innovations réalisées par les unités Al et A2 et celles réalisées par l'unité B2 montre
bien cette réalité.
Concrètement, les entreprises Al et A2 se distinguaient par une forte présence de
l'innovation de produit. Ce type d'innovation, qui est totalement absent dans l'entreprise
B2, a permis aux deux entreprises de la poterie artisanale de repositionner leurs produits
sur le marché local, d'élargir leurs gammes de produits, d'actualiser leurs produits en
fonction des besoins des consommateurs modernes, et d'ouvrir de nouveaux débouchés.
L'ensemble de ces réalisations ne peut que renforcer la position concurrentielle de
l'entreprise sur le marché. De ce fait, il ne suffit pas d'innover dans les outils de travail,
l'organisation du travail, le marché et les techniques de ventes, qui constituent des actions
partagées par les entreprises Al, A2 et B2, pour améliorer la compétitivité de l'entreprise.
Il faut également innover dans le produit. En ce sens, l'innovation de produit constitue la
pierre angulaire de la compétitivité et par conséquence de la performance économique de
l'entreprise. Les résultats enregistrés par l'entreprise Al, A2 et B2 confirment ce constat.
En présence de ce type d'innovations avec les autres types, les deux premières ont vu leurs
bénéfices évolués. En présence des autres types d'innovations sans l'innovation de produit,
l'entreprise B2 a vu ses bénéfices chuter. Le tableau suivant illustre bien cette réalité. Il
présente l'évolution des bénéfices enregistrés par les trois entreprises en question au cours
des cinq dernières années qui ont précédé l'enquête. Les bénéfices sont présentés dans ce
tableau sous la forme des pourcentages par rapport à l'année précédente. Il est important de
noter aussi que le choix d'examiner l'évolution des bénéfices des trois entreprises au cours
227
des cinq dernières années est guidé par une simple raison : la majorité des innovations
introduites et mises en œuvre dans ces entreprises remontent au début de cette période.
Tableau 8: L'évo ution des bénéfices des entreprises Al, A2 et B2 entre 2003 et 2007
Année Entreprises Al Entreprises A2 Entreprises B2
2003 Nul (les mêmes bénéfices enregistrés
qu'en 2002)
+ 15% - 11 %
2004 +20 % + 13 % Nul (les mêmes bénéfices
enregistrés en 2003)
2005 + 10% +22 % -7%
2006 +7% + 16% -4%
2007 +25 % +35 % -15%
En effet, l'innovation de produit est d'une grande importance pour l'entreprise artisanale de
métier ancestral. Elle représente l'une des actions principales permettant d'améliorer les
résultats économiques conditionnant la croissance et la pérennité de l'entreprise. Donc,
l'innovation de produit demeure l'un des facteurs décisifs dans la détermination de l'avenir
de ce type particulier d'unités de production dans le contexte de la globalisation. Bref,
l'innovation de produit est l'une des nécessités vitales pour l'entreprise artisanale de métier
ancestral.
Toutefois, si l'innovation de produit est vitale, elle ne suffit pas à tout résoudre si ce type
d'entreprise veut assurer sa continuité et sa croissance dans le contexte actuel. Un bref
retour sur les apports des autres types d'innovations aux individus ainsi qu'aux activités
productives et commerciales confirme bien un tel constat. Les entreprises Al et A2 ont
réussi à stimuler leurs membres à l'innovation de produit grâce aux innovations qui ont
touché leurs organisations et leurs matériels de travail. En plus de la stimulation des
membres des entreprises à l'innovation de produit, l'innovation organisationnelle et
l'innovation de matériel de travail ont contribué également à l'augmentation de la
228
productivité des individus et de l'entreprise. De même, elles ont permis d'améliorer la
qualité des produits. En conséquence, les ventes de ces deux entreprises ont connu une
évolution considérable puisque ces deux types d'innovation associées à l'innovation de
produit ont multiplié la production d'une part, et ont rendu les produits plus compétitifs
d'autre part.
En ce qui concerne les ventes de l'entreprise Al et A2, elles se sont multipliées
respectivement par deux et par trois au cours des cinq dernières années. De ce fait, les
innovations organisationnelles et de matériels du travail se complètent avec l'innovation de
produit, faisant toutes parties de la catégorie de l'innovation de production, pour augmenter
les ventes de l'entreprise constituant à leurs tours un autre indicateur important dans le
calcul des résultats économiques de l'entreprise.
Cependant, les résultats de l'enquête empirique montrent aussi que l'innovation de
commercialisation avec ses deux dimensions, l'innovation de marché et l'innovation des
techniques de vente, a de grandes influences sur les ventes de l'entreprise et par conséquent
sur ses résultats économiques. La réconciliation avec le marché local et la conquête des
marchés étrangers ont été aussi une source de multiplication des ventes pour les entreprises
Al et A2. Au sujet des ventes de ces deux entreprises sur le marché local, elles se sont
développées respectivement de 25 % et 20 % au cours des cinq dernières années. Quant à la
part des marchés étrangers des ventes totales, elle est de 60% pour l'entreprise Al et de
90 % pour l'entreprise A2 en 2007. En 2003, cette part était respectivement de 30 % et de
60 %.
Certes le repositionnement des produits en argile sur le marché local et l'ouverture des
marchés externe constitue une autre explication logique de l'augmentation des ventes des
entreprises Al et A2. Néanmoins, l'innovation de techniques de ventes, qui constituent la
deuxième dimension de l'innovation de commercialisation, représente un autre facteur
explicatif de la montée en force des ventes des deux entreprises en question. À titre
d'exemple, les nouvelles technologies de communication et de l'information, constituant
l'une des innovations de commercialisation mise en œuvre par ces deux entreprises, ont été
aussi à l'origine de cette montée. En 2007, les 3/4 des ventes de l'entreprise Al ont été
effectuées via son site internet. Ainsi, l'innovation de commercialisation demeure
229
également un facteur déterminant dans les ventes de l'entreprise et par conséquent dans ses
résultats économiques.
En effet, les différents types d'innovations agissent ensemble d'une façon directe sur les
résultats économiques de l'entreprise et par conséquent sur son avenir. Effectivement,
l'incorporation de ces différents types d'innovation a permis aux entreprises Al et A2
d'augmenter leurs bénéfices. Cette augmentation a encouragé ces deux entreprises à
accroître leurs champs d'activités. Cet accroissement, qui se manifeste principalement dans
l'agrandissement des deux entreprises en question , a permis la conservation des emplois
des anciens membres de l'entreprise et même le recrutement de nouveaux membres. Dans
les deux autres cas (BI et B2), la situation était à l'inverse. Pour l'entreprise BI, où
l'innovation est totalement absente, elle n'a pas réussi à adapter ses produits aux exigences
du nouveau contexte. Ceci a entraîné une diminution considérable de la production ce qui a
induit une régression dans les résultats économiques. En conséquence, certains membres
de cette entreprise ont perdu leurs emplois. La situation dans l'entreprise B2 n'est pas très
loin de celle de BI. La négligence de l'innovation de produit a contribué à son tour à la
diminution de la production de cette entreprise puisque ses produits ne tiennent pas compte
des besoins des consommateurs modernes. En conséquence, les bénéfices de cette
entreprise ont chuté. Ceci explique très bien, comme il a été mentionné dans la partie
consacrée à cette entreprise, la réduction des métiers à tisser qui sont en service. Cette
réduction signifie la perte de leur emploi pour certaines artisanes.
En somme, l'innovation au sein de l'entreprise artisanale de métier ancestral a des impacts
directs tant sur des dimensions en lien avec les individus que sur d'autres relatives à
l'entreprise. Le schéma suivant assemble ces différentes dimensions.
230
Schéma 5 : Les dimensions affectées par l'innovation dans un contexte d'entreprise artisanale de métier ancestral
L'innovation
Des impacts sur des dimensions en lien avec les
individus > Le revenu > La santé > Le statut > L'esprit dans le travail
Des > impacts sur des dimensions relatives à l'entreprise :
> La qualité des produits > La productivité > La clientèle > Les techniques de vente > Les bénéfices
Compte tenu de ces impacts sur les résultats économiques de l'entreprise, l'innovation
demeure le chemin principal permettant aux unités productives artisanales de métiers
ancestraux d'assumer leurs responsabilités d'ordre économique et d'ordre social dans le
contexte de la globalisation. Les deux entreprises de la poterie artisanale ont réussi à
améliorer leurs performances économiques grâce aux innovations introduites sur leurs
activités productive et commerciale favorisées tant par des facteurs relatifs aux individus
que par des facteurs relatifs aux dynamiques organisationnelles, managériales et culturelles.
Elles ont donc pu être une véritable source de création de la richesse. Cette création leur a
permis de conserver les emplois de leurs membres et même de créer de nouveaux emplois.
Bref, l'innovation permet aux entreprises de métiers ancestraux de performer
économiquement et socialement. Donc, elle constitue la garante principale de leur survie et
par conséquent de la survie des métiers ancestraux. Néanmoins, la survie de ce type de
métier nécessite également, comme le montre la recherche biographique liée à cette thèse,
l'intégration de ces entreprises dans autre dynamique : la dynamique de la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels. Dans le chapitre qui suit, l'accent sera mis
231
sur cette dynamique afin de mieux comprendre son rôle dans la survie des métiers
ancestraux et des entreprises qui les pratiquent.
232
Chapitre 8. Les dynamiques de la transmission des savoirs professionnels dans un contexte d'entreprise artisanale de métier ancestral
La transmission des savoirs professionnels au sein de l'entreprise, rappelons-le, est une
relation de communication construite d'une manière interactive mettant en contact direct
un expert et un novice dans les situations concrètes de la production (Lohisse, 2007;
Boutte, 2007; Jacques-Jovenot 2007; Boutillier et Founder, 2006). L'objectif d'une telle
interaction demeure la formation des individus capables de maitriser les différents types de
techniques relatives à un métier donné et par conséquent assurer la perpétuation des
différents savoirs structurant ces techniques. Le transfert de connaissances professionnelles
est donc par excellence une opération par laquelle la reproduction intergénérationnelle des
savoirs professionnels est assurée (Rainbird, Fuller et Munro, 2004). Le présent chapitre
propose de mettre en lumière les dynamiques de cette opération dans les entreprises
artisanales tunisiennes de métiers ancestraux à qui il est demandé plus que jamais de
reproduire leurs savoirs professionnels afin de conserver leurs spécificités dans le contexte
de la globalisation. Il s'agit, exactement, de voir comment ces entreprises gèrent cette
opération afin de pouvoir perpétuer leurs caractéristiques identitaires qui constituent une
partie importante du patrimoine culturel local.
En effet, l'examen des dynamiques régissant et structurant l'opération de transmission des
savoirs professionnels dans le contexte d'entreprise artisanale de métier ancestral vise à
découvrir la particularité de la formation professionnelle dans des milieux de travail où les
compétences professionnelles se construisent essentiellement par contact et par échanges.
Pour y parvenir, les champs de la transmission sont identifiés dans un premier temps.
Ensuite, les déterminants de l'opération en question sont exposés. Dans un dernier temps,
les effets qui peuvent être occasionnés par cette opération sont présentés.
1. Les champs de la transmission des savoirs professionnels dans le contexte
de l'entreprise artisanale de métier ancestral
L'un des constats les plus remarquables de l'enquête empirique est que l'opération de la
transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels constitue la sphère principale,
voir unique, où les membres des entreprises artisanales de métiers ancestraux peuvent
233
construire leurs compétences professionnelles. L'étude de cette opération dans les quatre
unités objet de notre recherche montre que cette opération est loin d'être identique. Elle est
plutôt variable d'une entreprise à une autre et d'un métier à un autre. Néanmoins, deux
principaux types de savoirs peuvent faire l'objet de cette opération : les savoirs permettant
au novice de pratiquer le métier et les savoirs renforçant son attachement à l'entreprise et
au métier. En effet, le transfert des savoirs professionnels dans le contexte d'entreprise
artisanale de métier ancestral concerne deux champs de savoirs : les savoirs requis par le
métier et les savoirs socialisant à la vie professionnelle et au métier.
1.1 La transmission des savoirs requis par le métier
La transmission de ce type de savoirs constitue, sans aucun doute, une étape incontournable
dans la mesure où elle est indispensable à l'intégration de l'individu dans le processus
productif. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont participé à l'enquête empirique n'ont
suivi aucune formation professionnelle antérieure relative à leurs métiers. Elles ont toutes
acquis les savoirs nécessaires pour leurs exercices professionnels sur le tas. Autrement-dit,
elles ont appris leurs métiers dans le cadre de l'opération de la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels. Toutefois, le contenu de cette phase
d'apprentissage varie d'un métier à un autre.
Dans le cas des deux entreprises de la poterie artisanale (Al et A2), l'apprentissage
concerne les savoirs théoriques en rapport avec le métier ainsi que les savoirs procéduraux
relatifs à ce dernier. Autrement dit, l'expert ne transmet pas uniquement au novice le
savoir- faire, mais aussi des savoirs lui permettant de se construire une idée plus
approfondie des différentes composantes du métier. Dans le cas des deux entreprises de
tapis du sol (BI et B2), la phase d'apprentissage du métier se limite à la transmission des
techniques de production. En d'autres mots, l'apprenti ne reçoit de l'expert que le savoir-
faire. Dans l'ensemble, la transmission des savoirs requis par le métier concerne donc deux
types de savoirs : les savoirs professionnels d'ordre théorique et les savoirs professionnels
d'ordre pratique.
234
1.1.1 La transmission des savoirs professionnels d'ordre théorique
Par savoirs professionnels d'ordre théorique, on entend l'ensemble des connaissances
abstraites relatives à une ou plusieurs composantes du métier. Dans le cas du métier de la
poterie artisanale, où la transmission de ce type de savoirs a été repérée, on distingue trois
catégories divergentes de connaissances de ce genre :
1 ) Les connaissances concernant les diverses matières premières usées dans la production;
2) Les connaissances en lien avec l'ensemble des outils mobilisés dans la production;
3) Les connaissances se rapportant aux différentes phases du processus de la production.
Ces différents types de connaissances constituent ensemble les savoirs professionnels
d'ordre théoriques se rapportant au métier de la poterie artisanale. Cet ensemble de
connaissances est jugé par les artisans comme la pierre angulaire de la compétence
professionnelle de l'artisan potier. L'importance primordiale de ces savoirs se manifeste
principalement dans la place importante qu'occupe dans l'opération de la transmission
intergénérationnelle des compétences professionnelles. La transmission de ces
connaissances constitue donc une opération inévitable dans la formation des jeunes artisans
potiers.
Dans l'entreprise Al comme dans l'entreprise A2, le nouvel arrivant reçoit, tout au long de
la phase obligatoire d'apprentissage, des informations lui permettant à la fois de
comprendre les caractéristiques des outils et des matières premières utilisées dans la
production et de construire des connaissances relatives aux spécificités et aux exigences de
chacune des étapes du processus de la production. La transmission de ces connaissances ne
s'effectue pas indépendamment de la transmission des connaissances d'ordre
opérationnelles. Autrement-dit, l'apprenti acquiert les connaissances d'ordres théorique et
pratique utiles à son exercice professionnel en même temps. La transmission de ces deux
types de connaissance s'effectue d'une manière progressive et lente, qui tient compte des
capacités cognitives de l'apprenti et de son avancement dans l'apprentissage.
235
En effet, le système d'apprentissage professionnel caractérisant le métier de la poterie
artisanale et la majorité des métiers ancestraux obéit à une certaine rationalité dans la
mesure où la transmission des savoirs professionnels prend la forme d'un processus
composé de plusieurs étapes qui doivent être respectées. Une telle logique constitue l'une
des caractéristiques capitales des systèmes d'apprentissage professionnels caractérisant les
sociétés industrielles.
Toutefois, le système d'apprentissage relatif aux métiers hérités des sociétés ancestrales se
distingue de celui se rapportant aux métiers des sociétés industrielles par l'absence d'une
division de la formation professionnelle. Dans ce système, la compétence professionnelle se
construit entièrement dans l'institution du travail. Donc, elle n'est pas construite dans les
institutions de formation professionnelle et les institutions du travail comme il est le cas
dans le système d'apprentissage caractérisant les sociétés industrielles. En général, dans ce
système l'individu acquiert les savoirs théoriques relatifs à son métier de l'institution de
formation professionnelle et les savoirs pratiques relatifs à ce métier de l'institution du
travail. Or, dans le système d'apprentissage professionnel caractérisant les métiers
ancestraux les deux types de savoirs sont acquis dans le même endroit : l'institution du
travail (l'entreprise). Autrement-dit, les connaissances professionnelles d'ordre théorique
s'acquièrent dans le feu de l'action de la production. Ceci dit, la transmission de ce type de
savoirs professionnels est la responsabilité des artisans experts dans le métier et non pas des
formateurs qui ont acquis une formation au sein des institutions de formation
professionnelle. D'ailleurs, cette transmission, ayant pour objectif la formation des
nouvelles générations d'artisans potiers, ne fait pas l'objet d'un programme spécifique
préétabli. Elle s'effectue en même temps où l'apprenti reçoit de son maître les
connaissances opérationnelles lui permettant de pratiquer le métier. De ce fait, les deux
composantes principales de la compétence professionnelle (le savoir théorique et le savoir-
faire) se transmettent simultanément dans des situations concrètes de production. Une telle
logique de transmission des savoirs professionnels permet à l'apprenti d'appliquer et de
tester directement les savoirs reçus. Ainsi, le nouvel arrivant au métier n'aura pas besoin
d'une formation supplémentaires afin d'harmoniser les connaissances professionnels
d'ordre théorique, qui sont généralement dispensées par les institutions de formation
professionnelles, avec les exigences pratiques de la production.
236
1.1.2 La transmission des savoirs professionnels d'ordre pratique
Par savoirs professionnels d'ordre pratique, on désigne l'ensemble des connaissances
opérationnelles relatives à un métier donné. Il s'agit, exactement, du savoir-faire nécessaire
à l'exercice de ce métier. En d'autres termes, le savoir professionnel d'ordre pratique est
la connaissance des techniques permettant la réalisation et l'accomplissement efficace
d'une ou de plusieurs tâches du métier. Étant donné que la totalité des métiers ancestraux se
caractérisent par leurs produits faits main, ce type de connaissances concerne,
principalement, les habilités et les aptitudes manuelles des artisans. De ce fait, la
transmission de ces dernières constitue une opération inévitable afin d'intégrer les novices
au processus productif. D'ailleurs, cette catégorie de connaissances constitue le seul champ
de transmission des savoirs professionnels partagé par les deux métiers qui ont fait l'objet
de notre étude. Dans les deux cas, la transmission des aptitudes et habilités manuelles
s'effectue dans le contexte réel de la production. L'apprenti potier ou l'apprentie tisserande
acquièrent les techniques leur permettant de devenir des artisans producteurs en entrant en
contact direct avec les anciens artisans pendant la production.
Toutefois, l'opération de la transmission de cette catégorie de savoirs professionnels est
loin d'être identique dans les deux métiers objets de notre analyse. Autrement dit,
l'opération de la transmission du savoir-faire constitue un élément permettant la distinction
des métiers artisanaux ancestraux en matière de construction des compétences
professionnelles. La divergence entre les deux métiers réside principalement à deux
niveaux : la durée et l'organisation de cette opération.
Pour ce qui est de la durée de l'opération de la transmission du savoir-faire, les deux
métiers qui ont fait l'objet de notre étude se distinguent largement. Dans le cas des deux
entreprises de la poterie artisanale (Al et A2), cette période est assez longue
comparativement à celle dans les deux entreprises de tapis du sol (BI et B2). Une telle
situation amène à s'interroger sur les raisons rendant cette période assez longue pour
certains métiers et assez courte pour certains autres. Autrement dit, il s'agit d'identifier les
facteurs qui déterminent la durée de la période consacrée à l'acquisition de ce type de
savoirs dans les métiers ancestraux.
237
Dans le cas de la poterie artisanale, le novice reçoit pendant l'apprentissage les différentes
techniques de la fabrication en passant par les différentes tâches constituant le processus de
la production. Une telle logique d'apprentissage a pour objectif de former des artisans
maîtrisant les différentes tâches et non pas de former des personnes qui doivent contribuer
immédiatement dans la production. Ceci explique la durée assez longue de l'opération de
la transmission des savoirs professionnels d'ordre pratiques dans les entreprises de la
poterie artisanale. À l'inverse, dans les entreprises de tapis du sol cette opération est d'une
durée très courte. La novice ici passe par une période d'apprentissage très courte avant
d'être intégrer dans le processus de la production. C'est pour cette raison qu'elle reçoit
uniquement les techniques relatives à la tâche pour laquelle a été recruté.
Il reste à noter que la durée de l'opération de la transmission du savoir-faire ne change pas
d'une catégorie d'entreprise à une autre. Autrement-dit, l'apprentissage des techniques de
production dans les entreprises domestiques et dans celles non domestiques appartenant au
même métier est de même durée. De plus, cette durée ne tient pas compte, comme il a été
montré dans la section consacrée à la description de l'opération de la transmission des
savoirs professionnels dans les quatre entreprises étudiées, de la complexité de la tâche. De
ce point de vue, la durée de l'opération de la transmission des savoirs professionnels
d'ordre pratiques n'est pas déterminée ni par la nature de l'entreprise ni par la nature des
techniques à transmettre. Elle est plutôt fonction de la culture du métier, notamment la
culture du métier en matière de la formation professionnelle.
En rapport avec l'organisation de l'opération de la transmission du savoir-faire, le métier de
la poterie artisanale ainsi que le métier de tapis du sol adoptent tous les deux le modèle de
compagnonnage qui est hérité des sociétés ancestrales préindustrielles. Dans ce modèle, les
novices accompagnent les anciens (les experts) dans le métier pendant le travail afin
d'apprendre le métier. Toutefois, le fonctionnement de ce mode d'organisation de
l'opération de la transmission du savoir-faire diffère profusément dans les deux métiers en
question. Cette différence est due essentiellement à la nature de la relation reliant les deux
parties de l'opération de la transmission des savoirs professionnels : le novice et l'expert.
Dans le cas de la poterie artisanale, la relation entre le novice et l'expert dans le métier est
par excellence une relation d'apprentissage dans la mesure où le novice est considéré en
238
tant qu'apprenti et non pas en tant qu'ouvrier qui doit aider l'expert dans la production.
Avec une telle structuration, le novice acquiert de son maître les connaissances pratiques
requises par le métier sans être obligé de déployer des efforts physiques dans le travail qui
peuvent diminuer sa concentration durant l'apprentissage. De plus, son statut d'apprenti lui
donne le droit de poser des questions à son maître afin d'approfondir ses connaissances et
d'avoir le droit à une marge d'erreur dans le travail pendant l'apprentissage. De même, la
relation d'apprentissage exige du maître de transmettre conformément au novice les
connaissances en question dans la mesure où le résultat de cette relation fait l'objet d'un
suivi au sein de l'entreprise. Ainsi, les mécanismes de fonctionnement de la relation de
compagnonnage dans le métier de la poterie artisanale sont bien précis.
Dans le cas du métier de tapis du sol, ces mécanismes sont plus au moins ambigus dans la
mesure où la relation entre la novice et l'expert est double : une relation d'apprentissage et
une relation de production. Ceci est dû au fait que la novice est considérée à la fois en tant
qu'apprentie et qu'ouvrière qui doit contribuer dans la production. Avec une telle
configuration, l'opération de la transmission des savoir-faire devient secondaire dans la
mesure où la production représente la priorité pour chaque entreprise. Dans une telle
situation, la novice se trouve obligée à la fois de fournir des efforts physiques et cognitifs.
Il lui ait demandé de déployer des efforts physiques puisqu'elle est impliquée dans la
production, et des efforts cognitifs afin d'apprendre le métier si elle veut garder son emploi.
Ainsi, le compagnonnage dans le métier de tapis du sol n'est pas orienté totalement à la
formation professionnelle comme il l'est dans le métier de la poterie artisanale.
Somme toute, la transmission des savoirs professionnels d'ordre théorique et ceux d'ordre
pratique, constituant ensemble à la fois les principaux savoirs requis pour l'exercice d'un
métier donné et les composantes fondamentales de la compétence professionnelles, est une
opération intimement lié aux dynamiques du métier ainsi qu'aux objectifs de l'entreprise.
Son ampleur, ses composantes, sa durée et son organisation expriment la culture du métier
en matière de la formation professionnelle d'une part, et les enjeux des entreprises d'autre
part. Cette réalité concerne aussi bien le deuxième champ de la transmission des savoirs
professionnels au sein des entreprises artisanales de métier ancestraux : la transmission des
savoirs socialisant à la vie professionnelle et au métier.
239
1.2 La transmission des savoirs socialisant à la vie professionnelle et au
métier
L'analyse des données recueilles montrent clairement que l'opération de la transmission
des savoirs professionnels au sein des entreprises artisanales de métiers ancestraux est loin
d'être un simple cadre où le novice acquiert les normes et les valeurs techniques du métier.
Elle constitue, également, un cadre de socialisation pour le novice. Un cadre dans lequel il
reçoit les normes et les valeurs régissant les comportements dans l'entreprise. Aussi, elle
représente un cadre où il construit son identité professionnelle et même sociale. De ce fait,
la transmission des savoirs professionnels concerne aussi les normes et les valeurs
socioculturelles favorisant la construction des identités et la reproduction du métier.
Toutefois, cette réalité ne concerne pas tous les métiers ancestraux. Dans les deux
entreprises de tapis du sol (BI et B2), à l'encontre des deux entreprises de la poterie
artisanale (Al et A2), la relation de compagnonnage n'intègre pas la transmission de cette
catégorie de savoirs professionnels (les normes et les valeurs régissant les comportements
au sein de l'entreprise et les normes et valeurs socioculturelles du métier).
1.2.1 La transmission des normes et des valeurs qui régissent les
comportements au sein de l'entreprise
Les normes et les valeurs régissant les comportements au sein de l'entreprise constituent
par excellence une catégorie importante du savoir professionnel. À travers ces normes et
valeurs, l'individu peut produire des conduites adaptées aux environnements humain et
organisationnel régnants dans l'entreprise. Elles représentent l'ensemble des connaissances
guidant les attitudes, les actions et les réactions de l'individu dans son milieu professionnel.
Il s'agit, exactement, du savoir-être dans l'entreprise. L'enquête du terrain montre que ce
type de savoirs, qui constitue une dimension principale de la compétence professionnel (Le
Boterf, 2001, Labruffe, 2008), s'acquiert aussi dans le cadre de la relation de
compagnonnage. Le savoir- être fait donc à son tour l'objet de transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels dans l'entreprise artisanale de métier
ancestral.
240
Dans le cas des deux entreprises de la poterie artisanale (Al et A2), l'artisan potier joue le
rôle d'un éducateur en plus de son rôle de formateur. Il ne se limite pas à la transmission au
novice des savoirs pratiques et techniques du métier. Il lui transmet également des
connaissances lui permettant d'agir d'une manière acceptable que ce soit dans ou en
dehors de l'entreprise. De ce fait, le novice dans le métier de la poterie artisanale n'est pas
considéré en tant qu'un simple individu en formation professionnelle comme l'est le cas
pour la novice dans les deux entreprises de tapis du sol. Il est plutôt perçu en tant qu'une
personne qui doit apprendre en même temps le métier et le savoir vivre en commun. De ce
fait, les comportements et les attitudes du novice seront fortement influencés par l'artisan
qui le prend en charge lors de la phase d'apprentissage.
La relation entre l'expert et le novice dans le métier de la poterie artisanale est donc une
relation éducative par excellence. Cette réalité, qui est totalement absente dans les deux
entreprises de tapis du sol, concerne les entreprises de la poterie artisanale dans leur forme
traditionnelle (les entreprises domestiques) ainsi que dans leur forme moderne (les
entreprises non domestiques). Ainsi, la culture du métier se présente encore une fois assez
déterminante dans le processus de la transmission des savoirs professionnels.
Comme dans la transmission intergénérationnelle des savoirs théoriques et du savoir-faire
relatifs au métier, l'artisan potier utilise principalement la communication verbale pour
transmettre au novice le savoir-être. Dans cette relation éducative le novice potier apprend
de son maître les habiletés comportementales et relationnelles qui lui sont très utiles dans
l'exercice de son savoir-faire. Le maître transmet, en se référant à son expérience
personnelle, les savoirs contribuant au développement de certaines capacités relationnelles
et sociales chez le novice. Concrètement, le novice potier apprend de son maître les quatre
habilités suivantes :
1) L'habilité de communication;
2) L'habilité de négociation;
3) Le sens relationnel;
4) L'habilité de travailler en groupe.
241
Ainsi, la phase de l'apprentissage constitue pour le novice dans le métier de la poterie
artisanale une occasion pour acquérir des savoirs utiles à sa vie sociale et non pas utiles
uniquement à sa vie professionnelle. Car les habilités ci-dessus demeurent de grande utilité
pour l'individu dans ses différentes expériences sociales. D'ailleurs, la communication, le
sens relationnel, la négociation et le groupe sont les principaux éléments structurants les
interactions sociales. Dans cette perspective, l'opération de transmission des savoirs
professionnels dans les entreprises de la poterie artisanale est aussi une opération de
socialisation, notamment de socialisation à l'interaction qui est la base de toute expérience
sociale de l'individu. De fait, cette opération est loin d'être une opération intégrant
uniquement la transmission des savoirs professionnels d'ordre techniques. Elle intègre aussi
la transmission des savoirs régissant le vécu social de l'individu. Bref, l'opération de la
transmission des savoirs professionnels est structurée d'une dimension technique et d'une
autre sociale. Mais cela ne veut pas dire que cette opération est bidimensionnelle. Elle est
plutôt tridimensionnelle. Elle intègre une troisième dimension : la dimension culturelle.
Autrement-dit, la transmission des savoirs professionnels au sein de l'entreprise artisanale
de métiers ancestraux concerne également des normes et des valeurs d'ordre culturelles.
1.2.2 La transmission des normes et des valeurs culturelles du métier
Parler des normes et valeurs culturelles d'un métier donné renvoie généralement à la
culture intériorisée par les membres exerçant ce métier. Il s'agit, entre autres, du système
de référence identifiant ces membres. L'enquête empirique montre que ce système
s'acquiert à son tour lors de la phase de formation par laquelle passe le novice. De ce fait, la
culture du métier est aussi le fruit d'un apprentissage. C'est un apprentissage culturel qui
s'effectue, comme dans l'apprentissage des normes et valeurs techniques et sociales du
métier, par interaction: le novice acquiert cette culture en entrant en contact avec les aînés
du métier. La culture du métier est donc à son tour un objet de transmission
intergénérationnelle de savoirs professionnels. Cette culture est qualifiée en tant que savoir
professionnel car elle regroupe les connaissances de tous types, accumulées tout au long de
l'histoire du métier, permettant à l'individu de se construire une identité se rapportant au
métier et d'adopter des façons de penser et d'agir en harmonie avec son contexte
professionnel.
242
Dans les entreprises Al et A2, où la transmission de la culture du métier marque une forte
présence, le novice reçoit de son maître ainsi que des anciens du métier avec qui il évolue
des informations se rapportant aux :
1) Faits historiques qui ont marqué l'histoire du métier;
2) Mythes se rapportant au métier;
3) Rites caractérisant le métier;
4) Croyances collectives traversant le corps du métier;
5) Pratiques socioculturelles partagées par les membres du métier.
Ainsi, la phase d'apprentissage dans les entreprises de la poterie artisanale constitue aussi
une occasion pour que les nouvelles générations acquièrent les composantes principales
de la culture du métier. À l'encontre des normes et valeurs sociotechniques du métier,
l'acquisition de ces composantes ne se fait pas uniquement dans le cadre de la relation de
compagnonnage qui réunit un novice et un expert. Elle est plutôt, le fruit de toutes les
interactions qu'entretient le novice avec les anciens de l'entreprise. Autrement-dit, le
novice ne reçoit pas les informations relatives à la culture du métier seulement des maîtres
qui le prennent en charge pendant la phase d'apprentissage. Les anciens membres de la
communauté du travail lui transmettent aussi cette catégorie d'information. Cette
transmission s'effectue généralement pendant les pauses quotidiennes qui réunissent tous
les membres de cette communauté.
Ces réunions, où les membres partagent les repas ou le thé, sont parmi les pratiques
socioculturelles les plus constantes dans les entreprises de la poterie artisanale. Le sujet
central de discussion lors de ce genre de pratique se centre autour des composantes
principales de la culture du métier. Ces discussions représentent pour le novice une
occasion pour enrichir ses connaissances du métier. En observant et en écoutant les anciens
du métier lors de ces réunions, le novice peut valider certaines informations qu'il a reçues
de son maître directement comme il aura l'occasion d'en découvrir de nouvelles lui même.
Souvent, les nouvelles informations font des sujets d'échanges entre le novice et le maître à
243
la reprise du travail. Ces échanges sont, en général, initiés par le novice qui pose des
questions à son maître afin de clarifier un point qui n'était pas clairement abordé dans les
réunions du groupe.
Toutefois, les questionnements du novice ne se limitent pas aux points évoqués dans ces
réunions. Au fil de la période d'apprentissage, l'apprenti se réserve le droit de poser à son
maître des questions relatives à n'importe quel aspect du métier. D'une manière générale,
les questions se rapportant à la culture du métier sont les questions les plus posées. Dans
cette perspective, le novice participe activement à la construction de ses connaissances en
matière de la culture de son métier.
Somme toute, l'opération de la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels
au sein de l'entreprise artisanale de métiers ancestraux s'entend sur plusieurs champs du
savoir. Elle intègre les savoirs théoriques, pratiques, sociaux et culturels se rapportant au
métier. Le schéma suivant résume en détail ces différents champs.
244
Schéma 6: Les champs de la transmission des savoirs professionnels dans le contexte de l'entreprise artisanale de métier ancestral
Savoirs Socialisant au
métier et à la vie professionnelle
Savoir-être +
Normes et valeurs
culturelles du métier
Transmission des savoirs
professionnels
Savoirs requis parle métier
Savoirs théoriques
+ Savoir-faire
La présence ou l'absence d'un de ces champs dépend étroitement de la culture du métier en
matière de la formation professionnelle. Néanmoins, l'existence d'une culture du métier
propice à l'opération de transmission intergénérationnelle de ces différents types de savoirs
est tributaire de la présence de plusieurs facteurs favorisant l'interaction entre les membres
de l'entreprise et l'engagement de ces derniers à cette opération. Alors quels sont les autres
déterminants de l'opération de la transmission intergénérationnelle des savoirs
professionnels au sein des entreprises artisanales de métiers ancestraux?
245
2. Les déterminants de la transmission des savoirs professionnels dans le
contexte de l'entreprise artisanale de métier ancestral
La transmission des savoirs professionnels dans les entreprises, rappelons-le, consiste à
engager les novices ainsi que les experts dans un processus visant la reproduction
intergénérationnelle des normes et des valeurs de tous types (techniques, sociales et
culturelles) se rapportant à un métier donné. L'étude de ce processus dans les quatre
entreprises objet de notre enquête montre que le bon fonctionnement de ce dernier passe par
deux conditions principales. D'une part, il nécessite l'engagement efficace des deux
protagonistes du processus en question. D'autre part, il exige une certaine soumission du
novice à l'expert. Mais cela ne veut pas dire que le fonctionnement et l'ampleur du
processus de la transmission des savoirs professionnels dépend uniquement de ces deux
conditions. La confrontation des situations existantes dans les deux entreprises de la poterie
artisanale (Al, A2) à celles caractérisant les entreprises de tapis du sol (BI, B2), conduit à
constater que le contexte de la production tout entier influence le fonctionnement et
l'ampleur de ce processus. Concrètement, il s'influence tant par les individus que par les
conditions dans lesquelles se déroule l'activité productive. En effet, deux catégories de
déterminants se scindent : les déterminants humains et les sociotechniques.
2.1 Les déterminants humains de la transmission des savoirs professionnels
En tant que processus regroupant des humains dans des situations d'apprentissage, la
transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels est déterminée en grande partie
par les conduites des individus impliqués dans ces situations. L'un des constats les plus
remarquables de l'étude empirique du processus en question dans les entreprises étudiées
réside dans l'implication de l'ensemble de l'effectif du travail dans les situations
d'apprentissage. Pourtant, cette implication n'est pas de la même façon pour les différentes
composantes de cet effectif. On distingue deux types d'implications, soit une implication
directe et une autre indirecte. La première concerne les deux protagonistes de l'opération de
la transmission : le novice (le récepteur) et l'artisan expert (l'émetteur). La deuxième
concerne le reste de l'effectif du travail. Chacune de ces différentes parties est demandée à
246
adopter des comportements et des attitudes spécifiques afin que le processus de la
transmission des savoirs professionnels puisse avoir lieu et réalise ses objectifs.
2.1.1 L'artisan expert comme déterminant dans la transmission des savoirs professionnels
Certes, la détention du savoir professionnel confie a l'artisan expert le statut de l'acteur le
plus déterminant dans le processus de la transmission intergénérationnelle des savoirs
professionnels au sein de l'entreprise artisanale de métier ancestral. D'ailleurs, il constitue
la seule source des savoirs pour les novices dans cette catégorie d'entreprise. De ce fait, le
fonctionnement du processus en question dépend en grande partie de son engagement
efficace. Cet engagement se manifeste dans les attitudes et comportements adoptés par cet
expert lors de ses interactions avec le novice dans les situations d'apprentissage. L'analyse
au plus près de ces situations montre que l'expert artisan qui honore son engagement est
celui qui se caractérise, essentiellement, par un degré assez élevé de tolérance avec le
novice et par la patience. Mais, ces deux traits de personnalité demeurent insuffisants pour
que l'expert artisan mène à bien sa mission. Autrement-dit, l'ampleur et le fonctionnement
de l'opération de la transmission des savoirs professionnels dépendent également d'autres
facteurs en lien avec l'artisan expert. Deux catégories de facteurs peuvent être distingués :
des facteurs en lien avec ses compétences et d'autres en lien avec son rapport au métier et à
l'entreprise.
Pour ce qui est des facteurs en lien avec ces compétences, ils concernent deux types: la
compétence professionnelle (l'ensemble de savoirs relatifs au métier) et le savoir lié à la
communication. Ces deux types de compétences sont d'une grande importance dans
l'opération de la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels. Le niveau
de compétence professionnelle de l'artisan expert joue un rôle assez déterminant dans cette
opération. Dans le cas des entreprises Al et A2, les artisans qui prennent en charge les
novices possèdent assez de connaissances relatives au métier leurs permettant d'inculquer
aux novices les différents savoirs professionnels. De cette façon, les novices n'auront pas
besoin de chercher des informations supplémentaires en dehors de la relation du
compagnonnage les mettant en contact direct avec leurs maîtres formateurs. Ainsi, la
247
transmission concerne ici les différents aspects du métier. La situation dans les deux
entreprises de tapis du sol (B 1 et B2) est totalement différente. Les artisanes transmettent
partiellement, aux novices, un seul type de savoir. Elle leurs inculquent le savoir-faire
relatif à une tâche bien précise et non pas relatif à l'ensemble des tâches englobées par le
métier. Une telle situation est due principalement à leurs manques de connaissances
professionnelles variées. De ce fait, la compétence professionnelle de l'artisan expert
constitue un déterminant principal de l'ampleur du processus de la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels au sein des entreprises artisanales de métier
ancestraux. Néanmoins, la compétence professionnelle ne garantit pas toute seule le bon
fonctionnement de ce processus. L'analyse des expériences d'apprentissage, que ce soit
dans les deux entreprises de la poterie artisanale ou dans les deux entreprises de tapis du
sol, montre que ce bon fonctionnement dépend en grande partie de la capacité de l'expert
de transmettre les savoirs professionnels au novice d'une façon claire et simple. Le bon
fonctionnement du processus en question exige que l'expert artisan maîtrise des habilités
communicationnelles et pédagogiques permettant de faciliter la tâche d'apprentissage au
novice. Ceci dit, la réussite de l'opération de la transmission des savoirs professionnels est
fonction d'habilités à communiquer de l'expert artisan.
En ce qui à trait aux facteurs en lien avec le rapport de l'artisan expert au métier et à
l'entreprise, ils concernent principalement le rapport affectif de ce dernier à son univers de
travail. Il s'agit exactement de son sentiment d'appartenance envers le métier et
l'entreprise. L'étude des situations d'apprentissage dans les quatre entreprises montrent que
le degré d'engagement de l'artisan expert au processus de la transmission des savoirs
professionnels est variable. Cette variation est due principalement à la variation du
sentiment d'appartenance au métier et à l'entreprise d'une personne à une autre. Dans le cas
des deux entreprises de la poterie artisanale (Al et A2), où les individus se caractérisent par
leur fort attachement à leur univers de travail, les artisans experts sont dotés d'une forte
volonté de faire perpétuer et de reproduire les savoirs relatifs à leur métier et d'assurer la
continuité de leurs entreprises. Cette volonté se traduit dans leurs engagements spontanés et
perpétuels dans un processus de transmission intergénérationnelle des différents types de
normes et de valeurs spécifiant leur métier et leurs entreprises. Un tel comportement
exprime avant tout la relation affective très forte qu'entretiennent les artisans potier avec
248
leur monde professionnel. Dans les deux entreprises de tapis du sol (BI et B2), l'absence
de ce type de comportement a rendu l'opération de transmission des savoirs professionnels
une opération contingente qui se déclenche suite à une décision de la direction de
l'entreprise. Ainsi, la relation affective au métier de l'expert artisan constitue par
excellence un autre déterminant de l'opération de la transmission des savoirs professionnels
au sein des entreprises artisanales de métiers ancestraux.
Pour conclure, la transmission des savoirs professionnels au sein des entreprises artisanales
de métiers ancestraux se développe dans un contexte de travail incorporant des artisans
experts caractérisés par leurs :
1 ) Connaissances approfondies du métier;
2) Habilités communicationnelles;
3) Fort sentiment d'appartenance à leur métier et à leur entreprise.
2.1.2 Le novice comme déterminant dans la transmission des savoirs
professionnels
Outre l'expert artisan, le novice constitue à son tour un élément assez déterminant dans
l'opération de la transmission des savoirs professionnels au sein de l'entreprise artisanale
de métier ancestral. D'ailleurs, la présence de ce type d'acteur au sein d'une entreprise
donnée est la condition principale de l'émergence des situations de transmission dans cette
dernière. Au-delà de son rôle inévitable dans le déclenchement de l'opération en question,
le novice contribue à travers ses conduites à la détermination de l'ampleur ainsi qu'au
fonctionnement de cette opération. Exactement, c'est le niveau d'engagement du novice
aux différentes situations d'apprentissage qui pèse dans l'opération en question. L'étude
empirique montre que ce niveau d'engagement est en corrélation directe, entre autres, avec
certains facteurs en lien avec ce novice. Ces facteurs, s'inscrivant dans trois différentes
catégories, influencent donc indirectement le fonctionnement et l'ampleur de l'opération de
la transmission des savoirs professionnels au sein des entreprises artisanales de métier
ancestraux.
249
La première catégorie de facteurs en lien avec le novice concerne essentiellement certaines
de ses caractéristiques intrinsèques. L'analyse des expériences d'apprentissage au sein des
quatre entreprises étudiées conduit à constater que la durée de ces expériences varie d'un
novice à un autre. Dans certains cas, le novice apprend rapidement les techniques de travail
ainsi que les normes et les valeurs relatives au métier. Dans d'autres cas, cette tâche prend
un temps plus long. Autrement dit, la durée de l'opération de la transmission des savoirs
professionnels est variable. Cette variation est due, selon les artisans experts, entre autres,
à deux facteurs en lien directe avec le novice: ses capacités cognitives et son envie
d'apprentissage du métier. Une capacité cognitive assez élevée ou une importante envie
d'apprentissage du métier rendent, sans aucun doute, la tâche de transmission assez facile
pour les artisans experts. Dans une situation pareille, ces artisans peuvent compter sur
l'engagement efficace du novice dans la relation de transmission. Ceci leur permet de lui
transmettre des quantités importantes de savoirs et même de le faire participer dans la
construction de ses propres compétences professionnelles. Dans une situation inverse, la
faible capacité cognitive ou l'absence d'une envie d'apprentissage peuvent entraver
complètement l'opération de la transmission dans la mesure où les réactions et
l'engagement du novice ne sont pas assez motivants pour que l'artisan expert investisse
plus d'efforts dans les interactions avec le novice. Ainsi, la capacité cognitive et l'envie
d'apprentissage du métier du novice jouent un rôle assez déterminant dans l'ampleur et le
fonctionnement du processus de la transmission des savoirs professionnels au sein des
entreprises artisanales de métiers ancestraux.
La deuxième catégorie de facteurs influençant ce processus et se rapportant au novice
concerne les objectifs établis par ce dernier lors de son intégration de l'entreprise. Il s'agit
exactement de la carrière professionnelle envisagée par le novice. L'étude empirique
conduit à distinguer deux catégories de novices. La première est composée des novices
ayant l'ambition d'acquérir des savoirs professionnels leurs permettant de mener une
carrière dans le métier qu'ils ont choisi. La deuxième est composée des novices que se
contentent d'apprendre un minimum de savoirs professionnels leurs permettant d'avoir un
emploi sans penser à une carrière dans le métier. Dans les deux cas, les novices s'engagent
dans l'opération de la transmission des savoirs professionnels, dans la mesure où elle
représente l'unique champ d'acquisition des savoirs dont ils ont besoin pour pratiquer le
250
métier. Toutefois, le niveau d'engagement n'est pas le même pour les deux groupes. Dans
le cas où les novices optent pour la carrière professionnelle, ce niveau est d'une grande
importance. Ceci se manifeste principalement dans leurs comportements pendant la phase
d'apprentissage, notamment dans le cadre de la relation du compagnonnage. Cette
catégorie de novices n'hésite pas à poser des questions à leurs maîtres pour approfondir
leurs connaissances. Une telle attitude, qui est guidée par leurs ambitions de construire une
carrière professionnelle dans le métier, ne peut qu'enrichir les interactions structurant
l'opération de la transmission des savoirs relatifs au métier. Or, dans le cas où les novices
n'ont aucune ambition de vivre une expérience professionnelle de longue durée dans le
métier, ces interactions sont très limitées. Les novices se contentent de l'observation de
leurs maîtres pendant le travail sans essayer de connaître plus sur le métier ou même la
tâche qu'ils veulent apprendre. Une telle situation rend l'opération de la transmission des
savoirs professionnels, une opération très restreinte et la relation entre le novice et son
maître une relation faible en interaction. Ainsi, les ambitions professionnelles des novices
déterminent pareillement le fonctionnement et l'ampleur du processus de la transmission
des savoirs professionnels au sein des entreprises artisanales de métiers ancestraux.
La troisième catégorie de facteurs influençant ce processus et se rapportant au novice
concerne les représentations de ce dernier vis-à vis du métier. Dans les quatre entreprises
étudiées, les novices, manifestant un niveau d'engagement assez élevé à cette opération, ne
considèrent pas le métier en tant qu'un simple moyen permettant de garantir un revenu. Ils
le considèrent aussi comme un moyen pour construire une identité professionnelle et
sociale. Avec une telle représentation, le rapport du novice au métier devient un rapport
affectif et non pas un rapport strictement instrumental. De ce fait, on distingue deux types
de novices sur la base de leurs représentations du métier : ceux qui ont un rapport
instrumental au métier et ceux qui ont un rapport à la fois instrumental et affectif. La
différence entre les deux types de novices est facilement remarquable dans leurs conduites
pendant la relation de compagnonnage. Pour le premier type, l'opération de la transmission
des savoirs professionnels ne constitue pas plus qu'une relation pour acquérir les savoirs
leurs permettant d'être productifs dans les plus brefs délais. C'est pour cette raison qu'ils se
contentent de la quantité assez limitée des savoirs professionnels transmis par les artisans
qui les prennent en charge. Pour le deuxième type, la relation avec ses maîtres constitue
251
une opportunité qu'ils doivent l'exploiter au maximum possible afin d'acquérir les
diverses catégories de connaissances relatives au métier. C'est pour cette raison, qu'ils
s'engagent profondément dans les interactions structurant leurs relations avec leurs maîtres.
De cette façon, la transmission devient une opération riche en interactions et s'étend sur des
champs de savoirs diversifiés. Ainsi, les représentations du novice vis a vis du métier est un
autre déterminant de grande importance dans le fonctionnement et l'ampleur du processus
de la transmission des savoirs professionnels au sein des entreprises artisanales de métiers
ancestraux.
En somme, les caractéristiques intrinsèques, les ambitions professionnelles et les
représentations du métier constituent l'ensemble des facteurs en lien avec le novice qui
affectent directement et profondément le déroulement de l'opération de la transmission des
savoirs dans les milieux de travail hérités des sociétés ancestrales.
2.1.3 Le collectif de travail comme déterminant la transmission des savoirs
professionnels
Étant donné que la transmission des savoirs professionnels au sein des entreprises
artisanales de métiers ancestraux se déroule entièrement dans le contexte réel de la
production, le reste de l'effectif du travail partageant ce contexte avec les deux
protagonistes de cette opération constitue, sans aucun doute, à son tour une partie prenante
du processus qui l'englobe. L'étude de ce processus dans les entreprises Al, A2, BI et B2
montre que les différentes composantes de cet effectif, en dépit de leur détachement de
l'opération de la transmission des savoirs professionnels en tant que telle, sont aussi assez
déterminantes dans le fonctionnement ainsi que dans l'ampleur de ce processus. Mais ceci
ne signifie en aucun cas que ces composantes interviennent dans les interactions qui se
déroulent entre le novice et son maître. Plutôt, elles influencent le contexte dans lequel se
déroulent ces interactions. En d'autres mots, l'effectif du travail agit sur le climat de
l'opération de la transmission. Réellement, ce climat est influencé par les conduites des
composantes de cet effectif au sein de l'entreprise. Dans certains cas, ces conduites
contribuent à la création d'un climat favorable au bon déroulement du processus de la
transmission. Alors que dans d'autres cas, ils ont des effets inverses.
252
Les résultats de l'enquête empirique conduisent à constater que l'établissement d'un climat
favorable à l'opération de la transmission des savoirs professionnels est tributaire, entre
autres, de la présence d'un effectif de travail valorisant cette opération d'une part, et
reconnaissant son importance pour l'entreprise et le métier d'autre part. Autrement dit, un
climat favorable à la transmission des savoirs professionnels dépend de la présence d'un
effectif de travail adoptant une attitude positive vis-à-vis cette opération. La présence d'une
telle attitude garantit, sans aucun doute, l'apparition des conduites dans l'entreprise
facilitant l'exercice du novice et de son maître.
En adoptant ce type de comportements, l'effectif du travail contribue directement à
l'aménagement d'un climat favorable à la transmission des savoirs professionnels. Le
novice et le maître peuvent accomplir leurs actions relatives à cette opération sans être
dérangés par leur entourage. Un climat pareil, les encourage et les motive à donner le
maximum dans leurs interactions structurant l'expérience d'apprentissage qui les réunit.
Donc, ils s'engagent efficacement dans le processus de l'apprentissage. Un engagement
efficace à ce processus contribue à :
1) La diversification des champs de savoirs concernés par la transmission (l'ampleur du
processus);
2) La réduction de la distance entre le maître est son apprenti (le fonctionnement du
processus).
Ainsi, les comportements du collectif de travail constituent un autre déterminant de
l'ampleur et du fonctionnement du processus de la transmission des savoirs professionnels
au sein des entreprises artisanales de métiers ancestraux.
Somme toute, ce processus est intimement dépendant des compétences, des capacités
cognitives, des volontés, des conduites, des attitudes et des représentations des différentes
composantes humaines du contexte de la production. Néanmoins, les caractéristiques
intrinsèques des ces composantes ne sont pas les seuls facteurs influençant le processus en
question. Les dimensions sociotechniques déterminent grandement le processus de la
transmission des savoirs professionnels.
253
2.2 Les déterminants sociotechniques de la transmission des savoirs
professionnels
En tant qu'opération synchronique à l'action productive, la transmission des savoirs
professionnels est déterminée pareillement par des facteurs d'ordre sociotechniques qui
régissent et structurent cette action. L'étude empirique montre clairement que
l'organisation du travail, l'encadrement des participants à cette action et les dynamiques
sociales régnant au sein de l'entreprise constituent des facteurs de grande détermination
dans les dynamiques de l'opération en question. En ce sens, l'ampleur et le fonctionnement
du processus de la transmission des savoirs professionnels dépendent intérieurement de
l'organisation du travail, de la gestion des ressources humaines et du climat social au sein
de l'entreprise.
2.2.1 Les déterminants organisationnels de la transmission des savoirs
professionnels
Outre les facteurs en lien avec les individus, le contexte organisationnel de l'entreprise
demeure un autre facteur qui pèse vigoureusement dans les dynamiques de la transmission
des savoirs professionnels au sein de l'entreprise artisanale de métier ancestral. La
comparaison de ces dynamiques dans les quatre entreprises étudiées montre que le modèle,
du travail participatif constitue le contexte organisationnel le plus propice au processus
englobant les dynamiques en question.
En premier lieu, l'un des principes de ce modèle organisationnel consiste à instaurer la
coopération et la collaboration dans le travail. Ce principe suppose donc que les membres
de l'entreprise soient en contact perpétuel afin de contribuer ensemble au bon
fonctionnement du processus de la production. Une telle logique d'organisation ne peut
qu'entraîner, entre autres, le développement des interactions dans le travail. Un contexte
organisationnel pareil paraît donc être le plus favorable à la transmission des savoirs
professionnels dans la mesure où les interactions constituent le rouage et le fondement
principal de cette opération. D'ailleurs, la faiblesse de l'opération de la transmission des
savoirs professionnels dans le contexte des entreprises BI et B2 peut être expliquée, entre
254
autres, par la quasi-absence des interactions dans le travail. Cette absence est du
principalement à l'individualisation du travail. Dans le cas des entreprises Al et A2, la
forte présence de l'opération en question est favorisée par la richesse des interactions dans
le travail. Cette richesse est due principalement à l'instauration des logiques de coopération
et de collaboration dans le travail. De ce fait, la logique organisationnelle représente un
autre déterminant décisif dans la promotion du processus de la transmission des savoirs
professionnels.
En deuxième lieu, la méthode de division du processus de la production en équipes,
caractérisant le modèle du travail participatif, se présente pour les individus comme la plus
adéquate à la mise en situation de transmission des savoirs professionnels. La comparaison
de l'état des lieux dans les quatre entreprises étudiées montre que seulement avec cette
méthode il sera possible de mettre les individus dans cette situation. Car une telle logique
de division du travail suppose que les équipes du travail soient composées des individus
expérimentés et d'autres moins expérimentés pour les aider. Dans une logique inverse de
division du travail, où le processus de la production est fractionné en tâches et non pas en
équipes, les individus seront attribués selon leurs connaissances professionnelles à des
tâches séparées spatialement. Une logique de division pareille n'entraîne pas donc la mise
en contact des expérimentés avec les novices. De ce fait, les situations de transmission
seront très limitées, voire absentes. La méthode de division du travail constitue donc, par
excellence, un autre facteur assez déterminant dans le processus de la transmission des
savoirs professionnels. C'est elle qui contribue à la présence ou non de ce processus. Ainsi,
un contexte organisationnel propice au processus en question est celui qui permet, entre
autres, de mettre les membres de l'entreprise en situation de transmission.
En troisième lieu, la transmission intergénérationnelle des différentes connaissances
professionnelles est favorisée par un autre principe de base du modèle participatif
d'organisation du travail : le partage des connaissances professionnelles au sein de
l'entreprise. Cette logique de partage amène les expérimentés à s'engager envers les
novices. Ces derniers sont considérés en tant que compagnons et non pas en tant que
simples ouvriers recrutés pour les aider dans la production. Dans le fait d'être perçu en tant
que compagnon, le novice bénéficie, comme l'indiquent les situations dans les deux
255
entreprises de la poterie artisanale (Al et A2), d'un encadrement spécifique de la part de
l'artisan qui le prend en charge. Cet encadrement exige la transmission des normes et des
valeurs techniques, pratiques et socioculturelles relatives au métier d'une part et nécessite
de consacrer un temps à la transmission d'autre part. Or, dans le cas des entreprises du tapis
du sol (BI et B2), la situation est totalement différente. La novice dans ces deux entreprises
ne bénéficie pas de ce type d'encadrement. Ceci peut être expliqué, entre autres, par
l'organisation de travail qui ne donne aucune importance à la question du partage des
connaissances professionnelles dans l'entreprise. D'ailleurs, cette novice est demandée
obligatoirement pour contribuer par des efforts physiques dans le processus de la
production. Elle est donc considérée comme une simple ouvrière et non pas comme une
compagnonne. Ceci ne permet pas de consacrer un temps à la transmission en marge du
temps de la production. De ce fait, le modèle participatif d'organisation du travail contribue
à travers sa valorisation du partage des connaissances à l'instauration de la modalité la plus
efficace à la transmission des savoirs professionnels : le compagnonnage. De même, il
permet d'accorder un temps à la transmission. Les valeurs du contexte organisationnel
constituent donc un autre facteur conditionnant l'opération de transmission. Ces valeurs
déterminent la modalité organisationnelle et le temps accordé à cette opération. Ainsi, un
contexte organisationnel propice à l'opération en question est celui qui permet, entre autres,
d'instaurer une modalité organisationnelle efficace et de laisser un temps nécessaire à son
déroulement.
En quatrième lieu, la conception participative d'organisation du travail contribue également
à la promotion de l'opération de la transmission des savoirs professionnels au sein de
l'entreprise à travers les pratiques qu'elle instaure dans le milieu de la production. Ces
pratiques, qui sont fondamentalement de types participatives, constituent des véritables
opportunités permettant aux novices de diversifier leurs sources de savoirs professionnels
relatifs au métier. Elles permettent aux novices d'entrer en contact direct avec tous les
expérimentés de l'entreprise et non pas seulement avec les maîtres qui les prennent en
charge. La présence de ces pratiques contribue donc à la création de plusieurs occasions de
transmission. D'ailleurs, dans les unités BI et B2, où ce genre de pratiques sont quasi-
absentes, la novice n'arrive pas à construire des idées sur l'ensemble du processus de la
production, force de ne pas pouvoir se réunir avec d'autres experts que ceux qui la prenne
256
en charge pendant l'apprentissage. Une telle situation ne peut que limiter les occasions de
transmission de savoirs professionnels. Or, ces occasions dans les entreprises Al et A2 sont
multiples. Cette multiplicité est principalement le corollaire des pratiques participatives
favorisées par la conception participative d'organisation du travail mise en œuvre par ces
deux unités. Les pratiques occasionnées par le modèle organisationnel constituent donc un
autre déterminant du processus de la transmission des connaissances professionnelles au
sein de l'entreprise artisanale de métier ancestral. Ainsi, un contexte organisationnel
propice à ce processus est celui : qui met en œuvre un modèle organisationnel favorisant
des pratiques permettant la création des occasions de la transmission.
En résumé, l'organisation du travail détermine en grande partie le processus de la
transmission intergénérationnelle des différents types de savoirs relatifs au métier. Elle
influence, à travers ses principes, valeurs, logiques et pratiques, l'existence, le
fonctionnement et l'ampleur de ce processus. Un modèle organisationnel favorable au
processus en question est celui qui instaure un contexte de production favorisant les
interactions dans le travail, mettant les individus en situation de transmission, promouvant
la pratique organisationnelle la plus adéquate à la transmission (le compagnonnage),
laissant le temps à la transmission et créant les occasions de la transmission. Toutefois, ces
conditions restent toutes seules insuffisantes pour engager profondément les individus à
l'opération de la transmission des savoirs professionnels. Il est nécessaire de les consolider
par des pratiques managériales incitant à cet engagement.
2.2.2 Les déterminants managériaux de la transmission des savoirs
professionnels
La comparaison de l'opération de la transmission intergénérationnelle des savoirs
professionnels dans les quatre unités étudiées montre que l'engagement des composantes
humaines de l'entreprise à cette opération diffère d'un contexte managerial à un autre. En
effet, la dimension managériale ressort comme un autre facteur conditionnant cette
opération au sein de l'entreprise artisanale de métier ancestral. Le contexte managerial
favorable à l'opération en question se distingue de celui défavorable par la mise en œuvre
des outils de gestion de ressources humaines incitant et motivant les membres de
257
l'entreprise à s'y engager positivement et activement d'une part, et favorisant cette
opération d'autre part. Ainsi, la promotion du processus de la transmission des
connaissances entre les générations dépend également des outils de la gestion du personnel
mobilisés par l'entreprise. Ceci concerne tant les outils de la gestion collective que ceux de
la gestion individuelle.
Pour ce qui est de la gestion collective, la communication interne et le travail participatif se
présentent comme les deux outils favorisant le plus le processus en question. Étant donné sa
présentation dans la partie consacré aux déterminants organisationnels de la transmission
des savoirs professionnels, l'outil du travail participatif ne sera pas évoqué ici afin d'éviter
les redondances. Concernant la communication interne, elle demeure parmi les conditions
principales à la promotion de ce processus au sein de l'entreprise. C'est elle qui détermine
en grande partie l'ampleur de ce dernier dans la mesure où elle favorise ou non l'échange
des informations entre les membres de l'entreprise. Les résultats de la recherche empirique
montrent que la politique communicationnelle propice à ce processus est celle qui abolit
les barrières hiérarchiques dans ces échanges. Car une situation pareille ouvre largement
les voix de communication entre les novices et les expérimentés appartenant naturellement
à deux différentes catégories hiérarchiques. À partir de la comparaison entre les deux
entreprises adoptant cette politique (Al et A2) et celles la négligeant (BI et B2), deux types
d'avantages peuvent être distingués. D'une part, elle augmente la quantité des informations
transmises des experts aux novices. D'autre part, elle motive les novices à demander plus
d'informations afin d'élargir leurs connaissances professionnelles. Ces deux phénomènes
traduisent, entre autres, l'engagement positif et actif de ces deux types d'acteurs au
processus de la transmission des savoirs professionnels. De même, elles traduisent
l'élargissement des champs de ce processus. Ces réalisations sont consolidées, sans aucun
doute, par le travail participatif constituant à son tour un des outils de la gestion collective.
Ainsi, la transmission des savoirs professionnels est conditionnée également par les outils
de la gestion collective des ressources humaines, notamment la politique de la
communication interne et la politique de gestion du travail participatif au sein de
l'entreprise.
258
En ce qui concerne les outils de la gérance individuelle, la gestion des rémunérations et la
gestion des carrières se présentent comme les deux outils conditionnant le plus l'opération
du transfert des savoirs professionnels entre les générations. Ces deux outils agissent
directement sur la motivation des participants à cette opération. En d'autres termes,
l'engagement de ces derniers à cette opération, surtout le novice et le maître qui le prend en
charge, varie selon les mesures prises par l'entreprise pour les motiver à y adhérer
profondément.
D'un côté, la spécification ou non des novices d'une récompense matérielle de leurs efforts
durant l'apprentissage constitue un déterminant principal de leurs engagements à
l'opération en question. À travers l'application d'un système de rémunération intégrant une
telle récompense, l'entreprise peut garantir l'engagement efficace du novice à l'opération
de la transmission. Dans les entreprises Al et A2, la mise en œuvre d'un système de
rémunération des apprentis construit d'une manière progressive fondée sur l'évaluation des
acquis, a contribué à la motivation des novices à participer positivement et activement dans
l'opération en question. De plus, elle a augmenté la volonté d'apprendre davantage les
savoirs relatifs au métier chez ces novices. Or dans le cas des deux autres entreprises (BI et
B2), en absence d'un tel système les novices ne manifestent pas des comportements pareils.
L'essentiel pour eux est d'apprendre le minimum de savoir-faire afin d'intégrer le plus
rapidement possible le processus de la production pour avoir une rémunération. En effet,
l'opération de la transmission des savoirs professionnels ne peut pas s'élargir sur des
connaissances approfondies du métier.
D'un autre coté, le cadre dans lequel est proposé la tâche de transmission aux artisans
prenant en charge les novices constitue un déterminent capital dans l'opération en question.
Ici on distingue deux cas possibles. Dans le premier cas, repéré dans les entreprises Al et
A2, la transmission est proposée en tant qu'une seconde carrière à ces artisans. De telle
sorte qu'ils trouvent dans l'opération de la transmission une nouvelle expérience
socioprofessionnelle ainsi qu'une reconnaissance et valorisation de leurs compétences et
connaissances acquises tout au long de leurs parcours professionnels. Dans cette
perspective, la transmission devient une source de satisfaction professionnelle et morale
pour les artisans vieillissants. Ceci les incite et les motive à s'investir profondément dans
259
cette opération. Dans le deuxième cas, repéré dans les entreprises BI et B2, la tâche de la
transmission est proposée pour les artisanes vieillissantes comme une tâche contingente
qui ne doit pas en aucun cas affecter le déroulement de l'activité productive. En
conséquence, elle ne représente pas pour eux une activité porteuse. De telle manière
qu'elle devient pour ces artisanes une tâche secondaire qui n'apporte rien à leurs carrières
ni à leurs statuts au sein de l'entreprise. Donc, elles n'auront pas assez de motivation afin
de s'impliquer profondément dans le processus de reproduction intergénérationnelle au sein
de l'entreprise. Ce faisant, l'opération de la transmission sera très limitée et très restreinte.
Elle n'aboutit pas à une reproduction des différents type de savoirs professionnels relatifs
au métier. Ainsi, le processus de la transmission des savoirs professionnels est conditionné
également par les outils de la gérance individuelle, notamment le système de rémunération
et la gestion des carrières.
En résumé, la gestion des ressources humaines de l'entreprise agit, à travers ses outils
s'occupant des individus ainsi que ceux s'occupant du collectif du travail, sur l'ampleur et
le fonctionnement du processus de la transmission des savoirs professionnels au sein de
l'entreprise artisanale de métier ancestral au même titre que le climat social de l'entreprise.
Alors comment ce climat affecte t-il le processus en question?
2.2.3 Les déterminants sociaux de la transmission des savoirs professionnels
Tel qu'il a été mentionné dans la partie consacrée aux déterminants organisationnels de la
transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels, le contexte productif propice à
cette opération est celui qui favorise les interactions sociales entre les différents membres
de l'entreprise. Néanmoins, les déterminants sociaux du processus englobant cette
opération ne sont pas réductibles aux simples interactions. Les différents systèmes sociaux
structurant les dynamiques sociales de l'entreprise conditionnent également le processus en
question. Il s'agit, principalement, des systèmes de relations et d'intégration sociale
existants dans l'entreprise.
Relativement au système de relations, ce processus s'influence principalement par la
nature des rapports structurant ce système. Concrètement, le processus de la transmission
de savoirs professionnels se développe, comme le montre l'étude empirique, dans un
260
système de relations fondé principalement sur des rapports de type communautaire. Car ce
type de rapports permet, entre autres, d'établir des relations très étroites dans l'entreprise.
Avec cette étroitesse dans les relations, l'entreprise devient une communauté de travail
dans laquelle s'enchevêtre le social avec le professionnel. En présence d'un système de
relations ayant ces traits, le lien entre le novice et son maître n'est pas fondé sur des bases
purement professionnelles. Il est plutôt fondé sur des bases socioprofessionnelles. D'une
part, cette situation contribue, sans aucun doute, à l'augmentation de l'engagement du
maître envers le novice qui prend la charge de sa formation professionnelle. Il ne le
considère pas en tant qu'une personne passagère qui doit lui faire apprendre certaines
techniques de travail pour occuper un poste dans l'entreprise. Il le considère plutôt en tant
qu'une personne liée à lui affectivement. Ceci amène le maître à penser sérieusement à la
carrière professionnelle du novice. En conséquence, il lui transmet des savoirs lui
permettant d'avoir un parcours professionnel prospère dans le métier. Ce faisant,
l'opération de la transmission devient plus riche et axée sur la construction d'une
compétence professionnelle et non pas sur la formation d'un agent d'exécution. D'autre
part, la fondation du lien entre le novice et son maître sur des bases socioprofessionnelles
contribue identiquement à l'augmentation de l'engagement du novice dans l'opération de la
transmission. Ce dernier se trouve dans une situation à l'aise lors de l'apprentissage par le
fait de sentir qu'il est accompagné par une personne qui cherche son intérêt et qui veille sur
son avenir, Cette situation ne lui permet pas uniquement d'assimiler facilement les
connaissances qui lui sont transmises. Mais, elle lui donne également le courage de
s'informer davantage sur le métier en posant des questions à son maître. Ce faisant,
l'opération du transfert des connaissances devient de plus en plus riche et intègre
activement le novice. Ainsi, le système de relations demeure un autre facteur conditionnant
l'ampleur et le fonctionnement du processus de la transmission intergénérationnelle des
connaissances professionnelles.
Quant au système d'intégration sociale, il influence ce processus à travers le mode
d'insertion des novices au sein de la communauté du travail. En référence toujours à l'étude
empirique, le système d'intégration sociale propice au processus en question est celui qui
intègre le novice dans le groupe de travail d'une manière progressive. Ce type d'intégration
permet au novice non seulement de se familiariser peu à peu aux dynamiques internes de
261
l'entreprise, mais aussi d'être reconnu par l'ensemble de la communauté du travail en tant
qu'apprenti. L'identité d'apprenti confie au novice plusieurs droits dans l'entreprise.
Principalement, elle lui donne les droits de s'informer sur le métier et de commettre des
erreurs pendant sa période d'apprentissage. Assurément, cette situation contribue à la mise
en œuvre des conditions favorables à la transmission des savoirs professionnels. Elle
permet, entre autres, d'élargir les champs de connaissances transmises et de donner
l'occasion au novice de pratiquer ces dernières durant l'apprentissage sans craindre d'être
sanctionné. En ce sens, l'opération de la transmission devient un véritable champ dans le
quel le novice peut agir comme un acteur et non pas comme un simple récepteur qui se
contente des informations qui lui sont transmises sans pouvoir les exercer en temps réel de
sa formation. De cette façon, le système d'intégration sociale dans l'entreprise constitue un
autre facteur déterminant dans le processus du transfert des connaissances au sein de
l'entreprise au même titre que le système de relations régnant dans l'entreprise.
À tout prendre, l'opération de la transmission intergénérationnelle des savoirs
professionnels au sein des entreprises artisanales des métiers ancestraux est déterminé par
plusieurs facteurs de nature hétérogène. Elle dépend des différentes composantes du
contexte de la production : les humains, les dynamiques organisationnelles et managériales
et les dynamiques sociales. Le schéma suivant présente les différents déterminants de cette
opération.
262
Schéma 7 : Les déterminants de la transmission des savoirs professionnels dans le contexte de l'entreprise artisanale de métier ancestral
Déterminants humains - Le novice - Le maître - Le collectif de travail
Déterminants organisationnels - Le principe d'organisation - Les valeurs organisationnelles - La logique organisationnelle - Les pratiques organisationnelles
La transmission des savoirs professionnels
Déterminants managériaux - L'encadrement individuel
- L'encadrement collectif
Déterminants sociaux
- La structure des interactions
- Le système de relations
- Le système d'intégration sociale
Ainsi, La composition humaine, l'organisation, le management et les dynamiques sociales
du contexte de la production influencent le fonctionnement et l'ampleur du processus
englobant l'opération de la transmission intergénérationnelle des connaissances. Il reste
maintenant à examiner l'influence réciproque. Il s'agit d'identifier les effets de cette
opération sur le contexte en question.
3. Les effets de la transmission des savoirs professionnels dans le contexte
de l'entreprise artisanale de métier ancestral
Identifier les effets de l'opération de la transmission des savoirs professionnels sur le
contexte de la production nécessite principalement la circonscription des apports de la
263
présence de cette opération ainsi que les conséquences de son absence sur ce contexte.
Cette tâche ne peut être faite qu'à travers une comparaison entre des contextes fortement
marqués par cette opération et d'autres caractérisés par sa quasi-absence. Les résultats de
l'enquête empirique fournissent ces deux cas. Concrètement, le premier cas est représenté
par les entreprises Al et A2 et le deuxième cas par les entreprises BI et B2. La
comparaison entre ces deux blocs d'entreprises montre que les effets de la transmission du
transfert intergénérationnel des valeurs et des normes techniques et socioculturelles peuvent
être ressentis au niveau de deux principaux éléments en relation avec le contexte de son
déroulement : le contexte de la production. Il s'agit des individus et de l'entreprise.
3.1 Les effets de la transmission des savoirs professionnels sur les individus
L'opération de la transmission intergénérationnelle des connaissances professionnelles au
sein des entreprises artisanales de métiers ancestraux, rappelons-le, est une activité
purement humaine. Elle s'adresse aux individus et fonctionne par leurs efforts. Ses effets
sont donc ressentis primordialement chez eux. En d'autres termes, la participation des
individus à cette opération ne peut pas être sans traces qui les marquent. En réalité, ce sont
les novices qui seront les plus marqués. L'opération en question concernait, tel qu'il a été
mentionné antérieurement, des savoirs utiles aux novices tant dans l'entreprise que dans la
société. Donc, les effets de la transmission peuvent se manifester dans la vie
professionnelle ainsi que dans la vie sociale du novice dans et en dehors de l'entreprise.
3.1.1 Les effets de la transmission des savoirs professionnels sur la vie
professionnelle du novice
Le transfert intergénérationnel des savoirs professionnels dans les entreprises artisanales de
métiers ancestraux agit, entre autres, comme l'indique les résultats de l'étude empirique,
sur la compétence et le rapport au métier et à l'entreprise du novice. Ces deux dimensions
(la compétence et le rapport au métier et à l'entreprise) demeurent, sans aucun doute, d'une
influence primordiale dans la vie professionnelle de ce dernier.
Premièrement, la transmission entre générations des savoirs relatifs au métier joue un rôle
de premier plan dans la détermination du niveau de la compétence professionnelle. Ce
264
niveau constitue comme le montre l'analyse des parcours de plusieurs personnes
appartenant aux entreprises Al, A2, BI et B2, le facteur le plus décisif dans la vie
professionnelle de n'importe quel individu. D'une part, il détermine sa positon dans
l'entreprise. D'autre part, il conditionne inévitablement son avenir au travail que ce soit
dans l'entreprise où il a appris le métier ou ailleurs. Avec un niveau de compétence élevé et
élargi, le novice peut se positionner dans son milieu de travail en tant qu'acteur se dotant de
plusieurs privilèges et atouts. De même, il peut gérer sa carrière professionnelle selon ses
ambitions et ses conditions. Dans le cas inverse, les réalisations du novice ne peuvent pas
dépasser l'occupation d'un poste sans pouvoir en tirer des avantages exclusifs ni gérer
personnellement son parcours professionnels. L'un ou l'autre de ces deux cas dépend
étroitement de la quantité des connaissances professionnelle acquis par le novice lors de
son implication dans la relation de transmission qui le réunit avec son maître. Ainsi,
l'opération de la transmission a des effets directs sur le statut et la carrière professionnelle
du novice à travers la compétence professionnelle qui lui permet de se construire.
Deuxièmement, le transfert intergénérationnel des savoirs professionnels détermine le
degré d'attachement du novice au métier et à l'entreprise. Ce degré constitue, également,
un facteur assez déterminant dans la vie professionnelle de tous individus. Il influence
principalement son engagement envers son métier et son unité d'appartenance. Un individu
fortement attaché à son métier et à son entreprise se considère en tant qu'acteur qui doit
participer continuellement à leur développement et à leur protection. Ceci l'incite à
performer et à innover dans le travail. Ces réalisations lui permettent d'avoir une
reconnaissance, que ce soit dans l'unité où il évolue ou dans l'univers du métier tout entier.
Cette reconnaissance affecte sa vie professionnelle. Elle lui permet, entre autres, de réaliser
une mobilité professionnelle dans l'entreprise et de devenir une référence dans le métier.
Dans le cas d'un faible attachement au métier et à l'entreprise, l'individu se contente de
l'exécution de sa tâche sans penser à la performance ni à l'innovation dans le travail. Au
contraire, il considère son expérience professionnelle comme passagère qui ne l'engage pas
ni envers le métier ni envers son unité d'évolution. La variation de l'engagement d'un
individu à un autre est fonction également de l'opération de la transmission des savoirs
professionnels. Avoir un engagement positif de la part de l'individu exige de lui transmettre
pendant la période de son apprentissage les savoirs renforçant son attachement au métier à
265
l'entreprise. Ainsi, la vie professionnelle de l'individu s'influence par la nature des savoirs
qui lui sont transmis à son âge de novice dans le métier.
En somme, la quantité et la nature des savoirs transmis par les maîtres contribuent à la
détermination des grands traits des futures vies professionnelles des novices. Toutefois, les
effets de cette transmission ne sont pas réductibles aux expériences en lien avec le métier.
Elle a également des effets sur leurs expériences sociales dans et en dehors du métier.
3.1.2 Les effets de la transmission des savoirs professionnels sur la vie sociale
du novice dans et en dehors de l'entreprise
Tel qu'il a été mentionné antérieurement dans la partie consacrée à la description des
résultats de l'étude empirique, l'opération du transfert intergénérationnel des savoirs
professionnels incorpore, dans certaines entreprises (Al et A2), un processus de
socialisation agissant principalement sur les conduites et l'identité du novice. En effet, elle
sera assez déterminante dans les futures expériences sociales de l'apprenant que ce soit
dans le milieu du travail ou dans la société en générale dans la mesure où ces expériences
seront marquées inéluctablement par ces deux éléments (les conduites sociales et l'identité).
En premier lieu, le processus de socialisation inculque au novice, entre autres, un ensemble
d'habilités sociales lui permettant de savoir communiquer, agir, réagir, négocier et travailler
en équipe. En d'autres termes, l'opération de la transmission fournie au novice un savoir-
être sous la forme d'un ensemble de règles et de normes qu'il doit respecter et suivre pour
réussir son expérience sociale dans le travail. Ces règles et ces normes deviennent, sans
aucun doute, un guide qui l'oriente dans ses interactions, négociations, échanges et
relations avec autrui. En effet, les conduites et les attitudes de l'apprenant dans l'entreprise
seront conditionnées par cette transmission. Étant donné que ce savoir-être est transmis au
novice à un âge très jeune, il est évident qu'il devient une partie prenante de sa
personnalité. Donc, ses comportements et ses attitudes dans la société en générale ne seront
pas différents des siennes au sein de l'entreprise. D'ailleurs, l'étude empirique montre que
le métier peut devenir un véritable groupe social qui peut être distingué, entre autres, par les
manières de se comporter et de s'interagir de ses membres. L'exemple de la poterie
artisanale demeure un témoin de cette réalité. Ainsi, la transmission intergénérationnelle
266
des différentes normes et valeurs sociales structurant le métier influence directement les
différentes expériences sociales du novice à travers les habilitées sociales qui lui a été
permis d'acquérir.
En deuxième lieu, le processus de socialisation permet au novice d'acquérir un ensemble de
normes et de valeurs culturelles afin d'agir en conformité avec la culture de son milieu
d'évolution. En d'autres mots, la phase d'apprentissage permet au novice, entre autres,
d'intérioriser la culture du métier. De ce fait, l'opération de la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels est, aussi, un champ de construction et de
formation identitaire pour le novice. Cette formation influence, sans aucun doute, sa vie
sociale dans la mesure où elle lui inculque les normes et les valeurs à prendre en
considération dans ses actions et ses interactions dans les différents cadres de cette vie.
Bref, l'opération en question offre au novice l'occasion de construire une identité à travers
laquelle il peut se situer dans le milieu du travail et dans la société en générale. En ce sens,
le métier devient pour le novice en même temps un cadre de référence ainsi qu'un cadre
d'appartenance. Ses actions ainsi que ses interactions seront toujours identifiés par lui-
même et reconnues par les autres en référence à la culture du métier qu'il exerce. Ainsi, le
transfert intergénérationnel des connaissances professionnelles agit encore sur la vie sociale
du novice à travers l'identité qui lui permet de se construire.
En résumé, l'opération du transfert intergénérationnelle des connaissances professionnelles
a des effets incontestables sur le novice. D'une part, elle influence, à travers le niveau de
compétence professionnelle et le degré d'attachement à l'entreprise et au métier qui lui
permet d'atteindre, son avenir professionnel. D'autre part, elle affecte, à travers les cadres
de références socioculturelles qui lui permettent de construire sa vie sociale, que ce soit
dans ou en dehors de l'entreprise. Cependant, les effets de cette opération ne se limitent pas
simplement à ces deux sphères de la vie du novice. Elles s'étendent également sur son
cadre d'évolution : l'entreprise.
3.2 Les effets de la transmission des savoirs professionnels sur l'entreprise
L'un des principaux objectifs de l'opération de la transmission intergénérationnelle des
connaissances professionnelles dans les unités artisanales de métiers ancestraux consiste à
267
former de nouvelles générations d'artisans afin de garantir, entre autres, la continuité et la
prospérité économique de l'entreprise. Ce faisant, les effets de l'opération en question
concernaient, également, l'entreprise. Les résultats de l'étude empirique montre que ces
effets peuvent être repérés principalement dans le processus de la production ainsi que
dans les dynamiques sociales structurant ce processus demeurant tous les deux très
déterminants dans les résultats économiques de toute unité productive. En d'autres mots,
l'opération en question agit sur la production ainsi que sur les dynamiques sociales qui la
structurent au sein de l'entreprise.
3.2.1 Les effets de la transmission des savoirs professionnels sur la
production
Tel que précisé précédemment, la transmission des savoirs professionnels détermine en
grande partie la compétence des individus au sein des entreprises artisanales de métiers
ancestraux. Compte tenu de cette réalité, les effets de cette transmission s'étendent
pareillement sur la production dans la mesure où cette dernière dépend grandement de la
compétence professionnelle des membres de l'entreprise. Concrètement, la compétence est
assez déterminante, comme le montre l'étude empirique, sur deux dimensions principales
en relation avec la production : la qualité et l'innovation de produits.
En ce qui concerne la qualité des produits, seulement la haute perfection dans le travail
permet à l'individu de réaliser des produits de bonne qualité. Étant donné que cette
perfection est tributaire principalement de sa compétence professionnelle, il devient évident
donc de parler d'une relation de cause à effets entre l'opération de la transmission
intergénérationnelle des connaissances en lien avec le métier et la qualité des produits.
Cette relation est expliquée par le simple fait que l'individu dans les entreprises objet de
notre étude acquiert les balises de sa compétence professionnelle dans le cadre de cette
opération. Donc, la qualité des produits réalisés par le novice lorsqu'il est intégré
effectivement au processus de la production dépend grandement des savoirs professionnels
qu'il reçoit lors de la phase d'apprentissage. Elle dépend principalement des champs de
savoirs concernés par la transmission. La comparaison de la situation de la qualité des
produits dans les quatre entreprises étudiées témoigne fortement d'une telle réalité.
268
Les entreprises BI et B2 se distinguent des entreprises Al et A2 par la persistance du
problème de la qualité des produits. Ce problème se manifeste principalement lors de
l'estampillage des tapis auprès de la direction régionale de l'ONA. Pour les deux
entreprises en question, plus que la moitié de la production est considérée comme non
conforme aux nonnes de la qualité supérieure. Seulement 30% des produits de l'entreprise
BI sont estompés en qualité supérieure. Dans l'entreprise B2, ce taux est de 45%. Ce taux
en dessous de la moyenne est expliqué, selon les experts de l'ONA, par la méconnaissance
des artisanes de plusieurs éléments en lien avec le tissage, tel que les caractéristiques de la
laine usée, les caractéristiques de la chaine du tissage, etc. Ceci est dû principalement,
comme le montre notre investigation dans ces deux entreprises, au caractère restreint de
l'opération de la transmission. Cette dernière concernait uniquement les savoirs d'ordre
opérationnel sans s'étendre à d'autres types de savoirs se rapportant à la production des
tapis. Dans les entreprises Al et A2 la situation est totalement différente. Le problème de
la qualité n'est pas très aigu. Le faible retour des produits par les importateurs étrangers,
sous prétexte de qualité médiocre demeure un témoin de cette réalité. Pour ces deux
entreprises, le taux de retour des produits exportés est respectivement de 5% et de 8%. Ces
réalisations témoignent, entre autres, de la haute perfection des artisans dans le travail.
Cette haute perfection est due, selon les deux chefs d'entreprises en question, à la
connaissance approfondie de ces artisans des différents éléments liés à la production. Cette
connaissance est le corollaire, comme il a été mentionné dans la partie descriptive des
résultats, de l'étalement de l'opération de la transmission sur plusieurs champs de savoirs
relatifs au métier. Ainsi, les champs de savoirs couverts par le processus du transfert
intergénérationnel des savoirs professionnels ont des effets immédiats sur la qualité des
produits dans les entreprises artisanales de métier ancestraux.
Relativement à l'innovation de produits au sein des cette catégorie d'entreprise, elle
dépend, entre autres, comme il a été indiqué dans la partie consacré aux déterminants de
l'innovation, des compétences professionnelles des artisans. Donc, la relation entre la
transmission des savoirs professionnels et l'innovation de produits est aussi très étroite. Un
contexte productif caractérisé par la mise en œuvre de nouveaux produits et l'amélioration
des produis existants, rappelons-le, est celui qui incorpore des artisans ayant les savoirs
nécessaires leurs permettant ces réalisations. Étant donné que la majorité de ces savoirs
269
s'acquièrent principalement dans la phase d'apprentissage, l'opération de la transmission
demeure donc assez décisive dans l'apparition des innovations de produits dans
l'entreprise. De ce fait, l'opération en question contribue, à travers les savoirs qu'elle met
à la disposition du novice, à la promotion de l'innovation dans l'entreprise dans la mesure
où les artisans d'aujourd'hui ne sont que les novices d'hier. D'ailleurs, l'une des
explications logiques de l'abondance de l'innovation de produits dans les entreprises Al et
A2 est la disposition de leurs artisans à des connaissances qui dépassent la simple exécution
pour s'étendre à d'autres dimensions du métier. Une telle disposition leurs permettent, sans
aucun doute, de stimuler et de concrétiser leurs esprits créatifs. Au contraire, la quasi-
absence de ce type d'innovations dans les entreprises BI et B2 peut être expliquée, entre
autres, par la réduction des connaissances de leurs artisanes à la simple exécution des
tâches. Ainsi, les champs de savoirs couverts par le processus du transfert
intergénérationnel des savoirs professionnels ont, également, des effets sur l'innovation
des produits dans les entreprises artisanales de métier ancestraux.
Pour résumer, l'opération de la transmission des savoirs professionnels agit sur la
production à travers les champs de savoirs qu'elle couvre. Elle agit, principalement, sur la
qualité des produits et l'innovation dans les produits. Donc, elle a des effets directs sur les
résultats économiques de l'entreprise dans la mesure où ces deux dimensions sont d'une
grande détermination dans ces résultats. Cependant, cette opération agit également sur les
dynamiques sociales de la production qui demeurent aussi assez déterminantes dans ces
résultats.
3.2.2 Les effets de la transmission des savoirs professionnels sur les
dynamiques sociales de la production
Effectivement, la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels agit sur ces
dynamiques à travers la fonction de socialisation qu'elle incorpore. L'un des principaux
objectifs de cette fonction, rappelons-le, consiste à ajuster les comportements sociaux du
novice aux exigences du fonctionnement social du processus de la production. Elle est
donc assez déterminante dans le façonnement des dynamiques sociales de la production du
270
moment que ces dernières sont en intime dépendance des comportements sociaux des
membres évoluant dedans.
Concrètement, cette fonction joue un rôle de grande importance dans la socialisation des
novices à la logique sociale qui fait fonctionner le processus de la production. En d'autres
termes, elle leurs permet d'acquérir la façon par laquelle s'articulent les actions
individuelles dans le processus en question. Bref, elle détermine la nature des relations qui
doivent se nouer avec les autres membres de ce processus lorsqu'ils seront dans des
véritables situations de production. Une telle socialisation permet, sans aucun doute,
d'éviter tous genres de dysfonctionnement lors de l'insertion effective d'un novice au
processus de la production. Dans un cas inverse, cette insertion peut engendrer une
perturbation dans le fonctionnement social de ce processus. Dans une telle situation, le
novice lorsqu'il sera mis dans les situations concrètes de production se trouve sans pré
acquis lui permettant de s'intégrer rapidement et facilement dans le groupe de travail. Ceci
l'oblige à effectuer un effort supplémentaire et obligent les autres membres de ce groupe de
modifier leurs actions productives afin de s'ajuster aux actions du nouveau membre. Donc,
toutes les dynamiques sociales structurant ce processus seront perturbées. De ce fait, la
transmission au novice des normes et des valeurs (savoirs) d'ordres sociales régissant le
processus de la production s'avère une tâche incontournable afin de créer une stabilité dans
les dynamiques sociales faisant fonctionner le processus en question. En ce sens, le
transfert des connaissances professionnelles a des effets directs sur la stabilité du processus
de la production. D'ailleurs, dans les entreprises BI et B2, où la socialisation à la logique
sociale du fonctionnement du processus de la production n'est pas pris en considération
dans l'opération de la transmission de savoirs professionnels, l'intégration effective d'une
novice occasionne souvent l'apparition des conflits dans le travail. Ces conflits amènent
dans la majorité des temps la novice à quitter l'entreprise. À part de leur perturbation du
processus de la production, ces conflits mettent l'entreprise souvent devant la nécessité de
recruter de nouveaux membres. Une telle situation est totalement absente au sein des
entreprises Al et A2. La socialisation du novice, dans ces deux entreprises, à la logique
sociale qui fait fonctionner le processus de la production rend son insertion à ce processus
inaperçu. Ceci ne peut que créer une stabilité au niveau des dynamiques sociales de la
production. Ainsi, les effets de la transmission des savoirs professionnels sur les
271
dynamiques sociales du processus de la production concernaient, entre autres, la stabilité
de ces dynamiques. Cette stabilité demeure, comme le montre les états de lieu dans les
unités Al et A2, très bénéfique pour les résultats économiques de l'entreprise. Elle lui
permet de conserver une constance dans la productivité. De même, elle rend son climat
social plus favorable à l'innovation. Ces deux phénomènes se présentent parmi les
conditions nécessaires pour la croissance et la continuité de n'importe quel type
d'entreprise. Ainsi, les résultats économiques de l'entreprise ne sont pas affectés
uniquement par les effets de l'opération de la transmission des savoirs professionnels sur le
processus de la production, mais aussi par les effets de cette opération sur les dynamiques
sociales de ce processus. Bref, les effets de cette opération sur l'entreprise sont donc
incontestables dans la mesure où les résultats en question sont assez déterminants pour le
présent et l'avenir de toute unité productive.
En résumé, les effets de la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels sont
multiples. Ils concernent tant des dimensions en lien avec les individus que relatives à leur
milieu d'évolution. Le Schéma suivant reprend ces dimensions.
272
Schéma 8 : Les dimensions affectées par la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels dans un contexte d'entreprise artisanale de métier ancestral
La transmission intergénérationnelle des savoirs
professionnels
Des en
effets sur des dimensions lien avec les individus :
> La compétence > Le rapport au métier et à l'entreprise > Les conduites > L'identité
Des effets sur des dimensions relatives à l'entreprise :
> La qualité des produits >• L'innovation > Les comportements sociaux dans l'entreprise
En conclusion de ce chapitre, la transmission intergénérationnelle des savoirs
professionnels est assez déterminante dans la perpétuation des métiers ancestraux ainsi que
dans la continuité des entreprises qui les pratiquent. D'une part, elle permet de reproduire
les différents types de savoirs relatifs à ce type de métiers. D'autre part, elle permet à ces
entreprises de développer les compétences professionnelles nécessaires à leurs réussites
économiques. À travers ce double effet, elle détermine les degrés d'engagement et
d'attachement des novices au métier. Autrement-dit, la transmission conditionne la fidélité
des novices à leurs domaines professionnels. Cette fidélité se présente comme l'un des
principaux garants de la reproduction intergénérationnelle des métiers ancestraux
constituant un patrimoine culturel dans n'importe quelle société. Avoir des individus
fortement engagés et attachés nécessite, comme le montre les résultats de l'enquête
empirique, la transmission au novice des différents types de savoirs en lien avec le métier.
Concrètement, il est important que les champs de la transmission concernent les savoirs
d'ordres théoriques et opérationnels afin de permettre au novice de construire une
compétence professionnelle qui peut lui apporter des avantages professionnels et matériels.
273
De même, ces champs doivent s'étendre aux savoirs d'ordres socioculturels afin de lui
permettre de construire une identité personnelle qui est nécessaire à l'augmentation de son
attachement affectif au métier. Ce faisant, la transmission intergénérationnelle des savoirs
professionnels est un processus multidimensionnel qui permet de perpétuer l'ensemble des
caractéristiques identitaires des métiers ancestraux tout en permettant à l'entreprise de
garantir des bons résultats économiques. C'est seulement de cette façon que les entreprises
pratiquantes de cette catégorie de métiers peuvent jouer un rôle culturel dans le contexte de
la globalisation : la conservation d'une partie importante de la culture locale de la
dissolution dans la culture globale. Mais ceci dépend de l'incorporation de l'entreprise des
novices et des maîtres ayant des caractéristiques spécifiques ainsi que de la présence d'une
culture de métier, des conditions organisationnelles, managériales et sociales propices à ce
processus. Autrement-dit, l'entreprise artisanale de métier ancestral peut être un acteur
engagé envers la culture de sa société seulement si le processus de la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels trouve les conditions favorables à son
fonctionnement et à son élargissement aux différents savoirs professionnels se rapportant
au métier.
En conjuguant ce processus avec celui de l'innovation, cette catégorie d'entreprise peut être
aussi, comme il a été mentionné au chapitre précédant, engagée économiquement et
socialement envers cette société par la contribution à la création de la richesse et des
emplois qui se trouvent à leur tour affecté directement par la globalisation. Cumulé ces
différentes fonctions, nécessite certainement la gestion des relations entre les deux
processus en question afin de concilier entre leurs objectifs qui sont d'une nature
divergente. La transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels, rappelons-le,
vise primordialement la reproduction quant à l'innovation elle vise principalement le
changement. Alors comment ce type d'entreprise peut-il concilier ces deux processus afin
de contribuer à la création de la richesse et des emplois sans altérer les caractéristiques
identitaires de leurs métiers?
274
Chapitre 9. Innovation et transmission des savoirs professionnels au sein de l'entreprise artisanale de métier ancestral : la conciliation
Les résultats de l'étude empirique montrent que l'innovation et la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels constituent par excellence les deux chemins
permettant à l'entreprise artisanale tunisienne de métier ancestral d'assumer ses différentes
responsabilités découlant des stratégies visant sa réinsertion dans le processus économique
du pays dans le contexte de la globalisation. La comparaison des états des lieux relatifs aux
quatre unités étudiées indique que l'innovation est le chemin à travers lequel cette
catégorie d'entreprise peut remplir ses fonctions économique et sociale (création de la
richesse et des emplois) fixées par les stratégies en question. Cette comparaison confirme
également que la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels est essentielle
pour que ces unités productives puissent remplir la fonction culturelle (la conservation et la
reproduction d'une partie intégrante de la culture locale) décidée par les mêmes stratégies.
Concrètement, les deux entreprises de la poterie artisanale (Al et A2) ont réussi, à
l'encontre des entreprises de tapis de sol (BI et B2), à remplir ces différentes fonctions.
Ces deux entreprises ont pu générer la richesse et les emplois sans abîmer ou corrompre les
caractéristiques identitaires qui sont fortement ancrées dans la culture de la société locale.
Une telle réalisation traduit avant tout la réussite des entreprises Al et A2 à concilier les
objectifs des processus de l'innovation (le changement) et de la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels (la reproduction). En effet, elles ont pu
réunir deux phénomènes difficilement conciliables : le changement et la reproduction.
Bref, les deux processus en question peuvent donc coexister. Toutefois, cette coexistence
dépend de certaines conditions. Autrement-dit, la conciliation entre les objectifs de
l'innovation et de la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels est
tributaire de la présence de certains facteurs. Ces facteurs se scindent en deux catégories :
des facteurs intrinsèques à chacun de ces deux processus et d'autres qui leurs sont
extrinsèques. Les facteurs intrinsèques, c'est-à-dire propres aux processus en cause, et
extrinsèques, c'est-à-dire leur sont extérieurs tout en jouant un rôle important dans leur
fonctionnement.
275
1. La conciliation entre les processus de l'innovation et de la transmission
des savoirs professionnels : les facteurs intrinsèques aux deux processus
L'intégration des changements significatifs tout en conservant les traits particuliers des
métiers ancestraux au sein des entreprises artisanales est tributaire de la conciliation entre
les objectifs du processus de l'innovation de la transmission intergénérationnelle des
savoirs professionnels. Il s'agit de l'instauration d'une logique d'innovation permettant à
l'entreprise de réussir économiquement. Cette logique ne doit pas se contredire avec la
logique de la reproduction intergénérationnelle du métier qui est véhiculée par le processus
de la transmission des savoirs professionnels. Dans le même ordre d'idées, il s'agit de la
mise en œuvre d'une logique permettant de reproduire les caractéristiques identitaires du
métier. Cette logique ne doit pas constituer un obstacle devant l'intégration des
changements qui sont véhiculés principalement par le processus de l'innovation.
Dans cette perspective, il est fondamental que l'opération de la transmission ainsi que
l'action de l'innovation s'accommodent réciproquement. Autrement-dit, il est important à
l'entreprise de trouver la façon permettant à cette opération et à cette action de coexister si
elles veulent assumer leurs différents engagements envers la société dans le contexte de la
globalisation : la création de la richesse, la création et la conservation des emplois et la
conservation d'une partie importante de la culture locale. Cette façon semble être trouvée
par les entreprises Al et A2 dans la mesure où toutes les deux ont réussi à remplir les
divers engagements en question. Au contraire, l'entreprise B2, en dépit de son
incorporation de l'opération et de l'action en question, n'a pas abouti à cette même
réalisation. La comparaison entre ces deux blocs d'entreprises montre que la réussite du
premier bloc est dû principalement à l'adaptation de l'opération de la transmission
intergénérationnelle des savoirs aux objectifs de l'action de l'innovation et vice-versa. En
effet, chacun des deux processus qui les englobent comporte des facteurs intrinsèques
favorisant l'autre à aboutir à ses objectifs.
276
1.1 Les facteurs intrinsèques au processus de l'innovation
Évoquer les facteurs intrinsèques au processus de l'innovation permettant à celui de la
transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels d'atteindre son objectif de
reproduction des caractéristiques des métiers ancestraux signifie, entre autres, mettre
l'accent sur les éléments qui doivent être pris en considération lors de la mise en œuvre
d'une nouveauté donnée afin de ne pas court-circuiter la logique de reproduction. En
d'autres termes, il s'agit de savoir comment l'entreprise peut éviter que cette nouveauté
induise une rupture avec une ou plusieurs caractéristiques identitaires de son métier.
L'analyse des innovations mises en œuvre au sein des entreprises Al et A2 montre que
ceci dépend du type d'innovation ainsi que des savoirs mobilisés lors de sa conception et
de sa concrétisation. En effet, deux facteurs en lien avec le processus de l'innovation
conditionnent la conciliation entre les objectifs de la transmission intergénérationnelle des
savoirs professionnels et ceux de l'innovation.
1.1.1 Le type de l'innovation comme facteur de conciliation
L'innovation dans le monde des entreprises est une action de changement qui vise la
restructuration d'un ou de plusieurs aspects en lien avec une ou plusieurs activités de
l'entreprise afin d'améliorer, dans la majorité des cas, sa rentabilité économique.
Assurément, cette action, devenue une nécessité vitale pour tous types d'entreprises dans le
contexte de la globalisation caractérisée, entre autres, par l'hyper compétition, n'est
nullement facile d'autant plus qu'elle dépend de plusieurs facteurs parfois de nature
hétérogène. La situation des entreprises artisanales tunisiennes de métiers artisanaux est
plus compliquée dans la mesure où ce type d'unités productives doit être vigilant dans les
changements introduits afin que ces derniers n'entraînent pas la remise en question des
traits identitaires de cette catégorie de métiers. Cette contrainte supplémentaire est le
corollaire de l'engagement de cette variété d'entreprises aux stratégies de l'État qui leur
offrent plusieurs avantages à condition qu'elle conserve leur spécificité que ce soit dans les
produits ou la production. De ce fait, ces entreprises se trouvent face à un vrai dilemme.
D'une part, elles doivent innover pour affronter les défis de la concurrence qui leurs sont
imposées par l'adhésion de la Tunisie au système économique mondial. D'autre part, elles
277
sont sous l'obligation de conserver leurs caractéristiques afin de continuer de jouir des
avantages offerts par l'État.
Les résultats de l'enquête empirique montrent que la conciliation entre les deux partis de
ce dilemme demeure fort possible. C'est-à-dire que l'entreprise peut en même temps
innover et conserver les caractéristiques en question. Donc, elle peut être concurrentielle et
peut continuer de profiter des privilèges qui lui sont octroyés par l'État afin de préserver
une partie importante de la culture locale de la disparition. Mais cette double réalisation
dépend, entre autres, d'une condition principale. Il est important que les innovations mises
en œuvre ne soient pas en rupture avec les caractéristiques identitaires de la production
artisanales et des métiers ancestraux. En d'autres termes, il ne faut pas que les changements
induits par l'innovation transforment en profondeur ces caractéristiques. Ces changements
doivent être donc mineurs et non pas majeurs. Ceci dit, l'entreprise artisanale tunisienne de
métier ancestral doit maîtriser les effets des changements sur ses structures et activités afin
de concilier les différentes exigences de la période historique actuelle.
La maîtrise des effets des changements sur les structures et les activités de l'entreprise reste
tributaire, comme le montre les états de lieu au sein des deux entreprises de la poterie
artisanale (Al et A2), du type d'innovations à mettre en œuvre. En dépit des multiples
innovations qui ont touché tant leurs activités productives que commerciales (voir la partie
consacrée à la description des résultats), ces deux entreprises ont réussi à garder les
spécificités du travail artisanal ancestral. Toutefois, ces innovations leur ont permis
d'améliorer leurs performances économiques et sociales traduites par la création de la
richesse et des emplois. Ceci signifie que ces innovations ont permis à ces deux entreprises
de s'adapter au nouveau contexte sans provoquer une rupture totale avec leurs
caractéristiques identitaires héritées de la culture de leur société. Par conséquent, ces
innovations peuvent être qualifié de type incrémental et non pas de type radical. Car elles
ne changent pas fondamentalement les dynamiques du métier tout en apportant des
améliorations sensibles pour l'entreprise. Autrement-dit, l'innovation dans ces deux
entreprises n'a pas empêché la reproduction intergénérationnelle de ce type de métier. Elle
n'a donc pas contredit l'objectif principal de la transmission intergénérationnelle des
savoirs professionnels au sein de cette catégorie particulière d'entreprises. Dans le cas de
278
l'entreprise B2, où on assiste à la présence aussi des innovations, la situation est totalement
différente. Dans cette entreprise, la volonté d'améliorer la productivité des artisanes a
poussé le chef à innover dans l'organisation du travail. Cette innovation peut être qualifiée
comme radicale dans la mesure où elle a instauré une méthode d'organisation appliquée
dans les entreprises industrielles qui rompt catégoriquement avec celle appliquée dans les
entreprises artisanales. Cette action a entrainé, par conséquent, un changement fondamental
dans les dynamiques du métier. Donc, elle a constitué une barrière devant la reproduction
intergénérationnelle des caractéristiques identitaires du métier. Toutefois, elle n'a pas été à
l'origine d'une amélioration sensible des résultats économiques de l'entreprise. Elle a été
donc à l'inverse de l'objectif principal de la transmission intergénérationnelle des savoirs
professionnelle sans pouvoir aboutir à l'objectif attendu de toute innovation dans
l'entreprise.
Compte tenu de ce qui précède, le type de l'innovation se présente comme un facteur
décisif dans la conciliation entre les objectifs de la transmission intergénérationnelle des
savoirs professionnels au sein des entreprises artisanales de métiers ancestraux. Seulement,
les innovations de type incrémental favorisent cette conciliation. Elles permettent à
l'entreprise de s'adapter à leur environnement actuel sans contredire l'un des principaux
objectifs de la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels consistant à
reproduire les différentes dynamiques caractérisant les métiers ancestraux.
1.1.2 Les savoirs mobilisés dans l'innovation comme facteur de conciliation
L'innovation au sein de l'entreprise artisanale de métier ancestral résulte, rappelons-le, soit
de l'introduction d'une nouveauté développée à l'externe soit de l'émergence d'une
initiative interne. Dans ce dernier cas, l'innovation constitue un moteur à deux temps. Au
début, il y a une idée proposant une nouvelle conception de ce qui existe déjà. Ensuite, il y
a la matérialisation de cette idée. Par conséquent, cet existant se transforme effectivement
partiellement ou intégralement. Dans ses deux temps, l'innovation développée à l'interne se
fait en référence à un ensemble de connaissances et d'expériences. Autrement-dit, l'idée
déclenchant le moteur de l'innovation et la concrétisation de cette idée sont le fruit d'un
travail humain dans lequel l'innovateur mobilise ses savoirs cumulés. De ce fait, les sources
279
de ces savoirs, qui varient d'une personne à une autre et d'un milieu à un autre, vont être
certes de grande détermination dans l'action de l'innovation. Par le fait même, la dimension
concernée par l'innovation au sein de l'entreprise va être, sans aucun doute, façonnée par
les savoirs mobilisés dans les deux phases constituantes de l'action en question. Dans cette
perspective, deux cas sont plausibles. Dans un premier cas, l'innovation développée à
l'interne peut entraîner un changement radical au niveau des dynamiques du métier faute
de la référence de l'innovateur à des savoirs découlant en majorité des sources qui n'ont
aucun lien avec ce métier. Dans un deuxième cas, cette catégorie d'innovations peut être
sans effets sur ces dynamiques à condition que les savoirs mobilisés par l'innovateur soient
ancrés majoritairement dans le métier.
Étant donnée la contrainte de la reproduction intergénérationnelle des caractéristiques
identitaires des métiers ancestraux, les innovations au sein des entreprises artisanales
tunisiennes doivent donc être inscrites dans le deuxième cas. En d'autres mots, les
innovateurs dans cette catégorie d'entreprises doivent se référer inévitablement aux savoirs
découlant de leurs métiers afin d'éviter la modification radicale des dynamiques
caractérisant ces métiers. La privilégisation de cette orientation demeure, sans aucun doute,
parmi les explications logiques de la réussite des entreprises Al et A2 à l'atténuation du
risque de conflit entre les objectifs de l'innovation et ceux de la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels. En dépit de la présence très forte des
innovations internes touchant principalement les produits au sein de ces deux unités, les
caractéristiques identitaires des produits de la poterie artisanale sont resté intact. Une telle
réalisation traduit avant tout l'investissement des innovateurs dans les savoirs relatifs au
métier.
Toutefois, les innovations apportées ont permis à ces produits de se repositionner sur le
marché local et d'envahir le marché international. Ce faisant, le fait de se contenter
principalement dans l'innovation sur les savoirs issus des métiers ancestraux ne se présente
pas comme un obstacle devant l'amélioration de la compétitivité des entreprises artisanales
tunisiennes qui les pratiquent dans le contexte de la globalisation. Au contraire, elle
constitue la façon idéale leur permettant de réussir leurs différentes missions (économique,
sociale et culturelle) du moment qu'elle leur permet d'améliorer leur performance
280
économique tout en reproduisant les caractéristiques identitaires des métiers ancestraux.
Ainsi, la conciliation entre les objectifs du processus de l'innovation et ceux du processus
de la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels dépend également des
savoirs mis en œuvre lors des deux temps structurant l'innovation résultant d'une initiative
interne.
En somme, le type de l'innovation et les savoirs mobilisés dans l'innovation constituent
deux facteurs décisifs dans l'adaptation du processus de l'innovation à celui de la
transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels. Néanmoins, la conciliation
entre les deux processus exige également l'adaptation du premier au deuxième. Alors,
quelles sont les facteurs intrinsèques au processus de la transmission intergénérationnelle
des savoirs professionnels favorisant la conciliation entre les deux processus en question.
1.2 Les facteurs intrinsèques au processus de la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels
Traiter des facteurs intrinsèques au processus de la transmission favorisant celui de
l'innovation signifie, entre autres, mettre l'accent sur les éléments qui doivent être pris en
considération dans cette transmission afin de promouvoir la logique de l'innovation au sein
de l'entreprise. Il s'agit de savoir comment l'entreprise peut éviter que l'opération de la
transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels ne soit pas une simple
reproduction des connaissances qui peut entraver l'innovation. L'analyse de l'opération en
question au sein des quatre unités étudiées permet de dégager deux conditions nécessaires à
cette réalisation. D'une part, Il est important que cette opération incorpore une fonction
socialisatrice permettant de socialiser les novices au changement constituant le résultat
inévitable de toute innovation. D'autre part, il est nécessaire que cette opération incorpore
une fonction de formation à l'innovation afin de fournir aux novices les connaissances
indispensables dans toute démarche innovatrice.
1.2.1 La socialisation au changement comme facteur de conciliation
Parmi les principaux objectifs de la transmission intergénérationnelle des savoirs
professionnels au sein des entreprises artisanales tunisiennes de métiers ancestraux,
281
rappelons-le, il y a celui qui consiste à reproduire les caractéristiques identitaires de cette
variété spécifique de métiers. Un tel objectif, devenu une exigence à ce type d'unité
productive si elles souhaitent remplir leur engagement culturel envers leur société dans le
contexte de la globalisation, paraît en entière contradiction avec le changement constituant
le résultat inévitable d'une autre exigence qui leur a été imposée par le même contexte.
Cette exigence c'est l'innovation. Dans cette perspective, la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels peut entraver le changement dans ces unités
productives. Donc, elle peut être défavorable à l'innovation.
Les résultats de l'enquête empirique montrent que la conciliation entre les deux exigences
demeure une mission possible. C'est-à-dire que l'entreprise artisanale de métier ancestral
peut en même temps reproduire les caractéristiques identitaires de ce type de métier et
introduire les changements nécessaires à son adaptation au nouveau contexte. Donc, elle
peut remplir sa responsabilité culturelle ainsi que ses responsabilités économique et sociale
garanties essentiellement par l'innovation. Toutefois, cette double réalisation dépend, entre
autres, d'une condition principale. Il est important que les membres de l'entreprise adoptent
une attitude favorable vis-à vis du changement. En d'autres termes, il ne faut pas que la
volonté de perpétuer les traits spécifiques du métier se transforme en une source de refus de
tous genres d'innovation. Ceci dit, l'entreprise artisanale tunisienne de métier ancestral doit
maîtriser les effets de l'opération de la transmission des savoirs professionnels sur les
attitudes des novices afin d'éviter l'apparition dans l'avenir des comportements réfutant le
changement dans le travail. Une telle situation constitue, sans aucun doute, le premier
ennemi de l'innovation au sein de l'entreprise.
Comme il a été mentionné dans la partie consacrée à l'analyse des dynamiques de
l'opération de la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels, les attitudes
des individus au travail sont déterminées grandement par la fonction de socialisation
incorporée par cette opération. De ce fait, l'atténuation des comportements réfutant
l'innovation nécessite inévitablement que la fonction en question accorde un intérêt
particulier à la question du changement. En d'autres termes, il est nécessaire de socialiser
les novices à accepter le changement entant qu'une nécessité dans le contexte de la
globalisation afin de favoriser la mise en œuvre des innovations au sein de l'entreprise.
282
Effectivement, La présence d'un tel type de socialisation a permis aux entreprises Al et A2
d'introduire d'une façon continuelle des innovations dans le travail sans que ceci soit à
l'origine de l'apparition d'un dysfonctionnement dans le processus de la production. Toutes
ces innovations ont été acceptées par les membres de ces deux entreprises comme des
atouts pour la survie du métier et l'augmentation de la rentabilité économique de
l'entreprise et non pas comme des menaces à l'identité du métier. Donc, elles sont
considérées en tant qu'éléments qui peuvent améliorer leurs situations professionnelles et
financières personnelles ainsi que la situation du métier de la poterie artisanale dans le
contexte actuel. Or, dans le cas de l'entreprise B2 les innovations introduites, en dépit de
leurs nombres très réduits, sont souvent accueillies par des comportements de refus. Ce
refus se manifeste essentiellement dans le taux énorme des artisanes qui quittent
l'entreprise à chaque fois qu'une innovation est mise en œuvre. Ce taux ne traduit en aucun
cas en une crainte sur les caractéristiques identitaires du métier de tapis du sol. Il exprime
avant tout un manque de conscience chez les artisanes de l'importance du changement pour
la survie de l'entreprise et du métier ainsi que de ses avantages sur leurs vies personnelles.
Une telle situation peut être expliquée principalement par l'absence de la socialisation de
ces artisanes au changement. D'ailleurs, l'opération de la transmission des savoirs
professionnels dans l'entreprise B2 néglige entièrement la fonction de socialisation. Ainsi,
la socialisation au changement constitue un premier facteur relatif à l'opération de la
transmission des savoirs professionnels permettant la conciliation entre ses objectifs et ceux
de l'innovation.
1.2.2 La formation à l'innovation comme facteur de conciliation
L'opération de la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels constitue,
rappelons-le, le chemin idéal à travers lequel les entreprises artisanales tunisiennes de
métiers ancestraux peuvent remplir leur responsabilité culturelle consistant à reproduire les
traits identitaires de ces métiers afin de conserver une partie importante de la culture locale
de la disparition. Dans cette perspective, cette opération possède une sérieuse fonction de
formation à la reproduction. En se limitant à cette fonction, l'opération en question peut
être une véritable menace à la réussite de ces entreprises dans leurs responsabilités
économiques et sociales qui ne sont pas moins importantes de la responsabilité culturelle.
283
Car la concentration uniquement dans cette opération sur la reproduction des traits
identitaires des métiers ancestraux peut être un véritable obstacle devant l'apparition des
innovations internes constituant la condition principale à la réussite de ces unités
productives dans les deux responsabilités en question. Autrement-dit, la transformation de
l'opération de la transmission des savoirs en un simple moyen incitant à la reproduction
peut camoufler le sens de la création, constituant l'un des principaux déterminants de
l'innovation interne, chez les novices. Car cette opération conditionne en grande partie les
actions de ces novices dans le travail lorsqu'ils seront intégrés effectivement au processus
de la production.
Ce faisant, l'entreprise qui veut remplir ses différentes responsabilités doit obligatoirement
agir sur la fonction de l'opération du transfert intergénérationnel des savoirs professionnels
afin qu'elle ne soit pas destinée seulement à la formation des novices à la reproduction. Elle
doit être également orientée vers la formation à l'innovation des novices afin qu'ils soient
capables d'apporter des nouveautés lorsqu'ils seront officiellement intégrés au processus de
la production. Donc, elle doit avoir une double fonction : formation à la reproduction des
caractéristiques identitaires des métiers ancestraux et formation à l'innovation. Cette
dernière exige inévitablement la couverture de l'opération en question des différents
champs de savoirs relatifs au métier afin de mettre à la disposition du novice les
connaissances indispensables à la concrétisation de ses initiatives créatrices.
En incorporant une fonction de formation à l'innovation, l'opération de la transmission
cesse, en effet, d'être défavorable à l'innovation dans l'entreprise, notamment à
l'innovation qui résulte des initiatives internes. Au contraire, elle devient un véritable
moyen à travers lequel l'innovation peut être favorisée. L'incorporation de l'opération de la
transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels dans les entreprises Al et A2
de cette fonction a permis à ces deux entreprises de former des individus fortement dotés
des connaissances indispensable à la concrétisation de leurs sens de création. Ceci se
manifeste dans leurs innovations dans les produits que ce soit par l'ajout des améliorations
sur les anciens modèles ou par la mise en œuvre de nouveaux modèles. Dans le cas des
entreprises B1 et B2 la situation est totalement différente. Les artisanes dans ces unités ne
produisent nullement ce genre d'actions. Ceci est expliqué essentiellement par la restriction
284
de l'opération de la transmission des savoirs professionnels à la reproduction uniquement
d'une partie très limitée des savoirs relatifs à ce métier. Les novices dans ces deux
entreprises ne reçoivent de la part du maître, rappelons-le, que le savoir-faire relatif à une
tâche très particulière. Donc, l'opération en question dans ces deux entreprises s'intéresse
seulement à la formation des novices à la reproduction partielle du métier. De même, elle
ne se contente pas de l'inculcation aux novices des différents savoirs relatifs au métier de
tapis du sol. Donc, elle ne les forme pas à l'innovation. Cette situation demeure, sans aucun
doute, défavorable à l'apparition des innovations au sein de l'entreprise dans la mesure où
les novices ne disposent pas lors de leurs intégration au processus de la production d'assez
de connaissances nécessaires leurs permettant de prendre des initiatives créatrices. Ainsi, la
formation à l'innovation constitue le deuxième facteur relatif à l'opération de la
transmission des savoirs professionnels permettant la conciliation entre ses objectifs et ceux
de l'innovation.
En résumé, la conciliation entre les objectifs de l'action de l'innovation et ceux de
l'opération de la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels au sein de
l'entreprise artisanale de métier ancestral dépend des facteurs intrinsèques à chacune
d'elle. D'une part, il est nécessaire que l'innovation soit mineure et que les savoirs
mobilisés dans sa mise en œuvre soient ancrés dans le métier afin d'éviter la transformation
radicale des dynamiques du métier. D'autre part, il est nécessaire que la transmission ne
soit pas dédiée uniquement à la reproduction. Elle doit être également consacrée à la
socialisation des novices au changement ainsi qu'à leur formation à l'innovation.
Cependant, la conciliation entre les deux dépend pareillement d'autres facteurs extérieurs.
2. La conciliation entre les processus de l'innovation et de la transmission
des savoirs professionnels : les facteurs extrinsèques aux deux processus
En tant que deux processus indissociables de l'activité productive, l'innovation et la
transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels au sein de l'entreprise
artisanale tunisienne de métier ancestral dépendent, tel qu'il a été déjà prouvé
empiriquement, du contexte tout entier de la production. Ce dernier, qui conditionne tant le
fonctionnement que l'ampleur de chacun d'eux, joue également un rôle capital dans la
285
conciliation entre les deux processus en question. Les résultats de l'enquête empirique
montrent que cette conciliation ne peut devenir une réalité concrète que dans un contexte de
production permettant la coexistence en harmonie de ces deux processus. Ces résultats ont
permis de distinguer deux catégories de facteurs en lien avec ce contexte qui sont
déterminants dans cette coexistence : des facteurs relatifs aux individus agissant dans ce
contexte et d'autres se rapportant au fonctionnement de l'entreprise.
2.1 Les facteurs relatifs aux individus
Traiter des facteurs favorisant la conciliation entre les processus de l'innovation et celui de
la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels qui sont en lien avec les
individus revient, entre autres, à dégager les déterminants humains de la coexistence de ces
deux processus. Il s'agit exactement de comprendre comment ces deux processus peuvent
coexister sans rencontrer des problèmes d'ordre humain. Autrement-dit, quelles sont les
conditions humaines propices à la conciliation entre les deux processus en question?61 Les
résultats de l'enquête empirique montrent que les déterminants humains de cette
conciliation sont de deux ordres: les représentations des membres de l'entreprise vis-à vis
de ces deux processus et la compétence professionnelle des artisans experts.
2.1.1 Les représentations de l'innovation et de la transmission des savoirs
professionnels comme déterminant dans la conciliation
L'objectif de la conciliation entre l'innovation et la transmission des savoirs professionnels
au sein de l'entreprise artisanale de métier ancestral est de favoriser la coexistence de deux
projets distincts. D'un coté, il y a un projet visant le changement afin d'adapter cette
catégorie d'entreprise au nouveau contexte. D'autre part, il y a un projet visant la
reproduction des différents types de savoirs professionnels afin de conserver les
caractéristiques identitaires de ce genre de métier. Compte tenu de la place centrale
La réponse à cette interrogation est faite à travers l'identification des points partagés par les membres des unités Al et A2 et non pas à travers la recherche des causes de la réussite de certaines entreprises et de l'échec de certaines autres à la conciliation entre le processus de l'innovation et celui de la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels. Car seulement dans ces deux unités cette conciliation est fortement recherchée. Or, les deux autres entreprises (BI et B2) n'accordent aucun intérêt à ce sujet. D'ailleurs, la présence de ces deux processus, dans ces deux unités, est partielle et très timide.
286
qu'occupent les humains dans les deux projets en question, la réalisation de ces deux
objectifs nécessite avant tout la conviction des membres de l'entreprise sur l'utilité du
changement ainsi que de la reproduction pour l'entreprise et le métier. Autrement-dit, il est
nécessaire que les attitudes et les conduites de ces membres soient favorables à la
coexistence de l'innovation et de la transmission des savoirs professionnels.
Les résultats de l'enquête empirique montrent que les membres des entreprises Al et A2,
où les projets de changement et de reproduction coexistent en harmonie, se distinguent des
membres des entreprises BI et B2, où cette coexistence est absente, par leur forte
conscience de l'importance des actions de l'innovation et de la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels pour la survie de l'entreprise et la
perpétuation du métier. D'ailleurs, ces membres perçoivent ces deux actions comme
incontournables pour repositionner leurs produits sur le marché tout en affirmant leur
distinction des produits fabriqués industriellement. Pour eux, l'innovation ne constitue
aucun danger pour la conservation des caractéristiques identitaires des métiers ancestraux.
Au contraire, ils la considèrent comme un moyen de développement permettant d'actualiser
ces métiers aux exigences du contexte actuel. De même, ils ne considèrent pas la
transmission des savoirs professionnels comme un simple moyen de reproduction. Elle est
plutôt perçue en tant qu'un moyen permettant de construire les compétences nécessaires à
la création et au développement du métier. Ceci dit, les membres de ces deux unités ne
perçoivent pas ces deux actions comme contradictoires. Au contraire, ils les perçoivent
comme complémentaires.
Une telle représentation demeure, sans aucun doute, favorable à l'apparition des
comportements et des attitudes dans le travail permettant aux projets du changement et de
la reproduction de se coexister sans que l'un entrave l'autre. La perception des deux actions
indispensables à ces deux projets comme complémentaires ne motivent pas seulement les
membres de l'entreprise à participer activement dans l'un ou l'autre de ces projets, mais
elle les incite également à contribuer à l'aménagement d'un climat favorable à leur
coexistence. La présence des comportements similaires signifie, entre autres, que le
changement et la reproduction constituent des projets qui engagent les différentes
composantes humaines de l'entreprise. En d'autres termes, les actions d'innovation et de la
287
transmission des savoirs professionnels, qui constituent respectivement les principaux
outils de ces deux projets, deviennent des affaires qui concernent la totalité des membres de
l'entreprise. Elle concerne tant les participants que les non participants dans ces deux
actions. Ceci contribue, sans aucun doute, à l'apparition des attitudes et des comportements
propices à la réussite des deux actions en question à la réalisation de leurs objectifs qui
sont difficilement compatibles. A titre d'exemple de ce type d'attitudes et des
comportements, on cite ceux partagés par les membres des unités A1 et A2 :
1) La reconnaissance des personnes impliquées dans l'un des deux projets, des efforts des
personnes impliquées dans l'autre projet;
2) La collaboration avec les personnes participant à l'une des deux actions même s'ils
font partie seulement de l'autre action.
Ainsi, les représentations des individus à l'égard de l'innovation et de la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels et vis-à-vis de leurs rôles dans la
continuation de l'entreprise et du métier demeurent l'une des conditions principales de la
coexistence des projets du changement et de la reproduction au sein de l'entreprise
artisanale de métier ancestral. Elles constituent donc un facteur déterminant dans la
conciliation entre les processus de l'innovation et de la transmission intergénérationnelle
des savoirs professionnels dans la mesure où cette conciliation nécessite primordialement la
présence des individus qui favorisent la coexistence du changement et de la reproduction.
2.1.2 La compétence professionnelle des artisans experts comme déterminant
dans la conciliation
La perpétuation des caractéristiques identitaires des métiers ancestraux et l'adaptation de ce
type de métier aux exigences du nouveau contexte mondial reposent en premier lieu,
rappelons-le, sur l'engagement efficace des différents membres de l'entreprise dans les
actions de la transmission des savoirs professionnels et de l'innovation. Les résultats de
l'enquête empirique montrent clairement que le poids de ces membres n'est pas le même
dans les deux actions en question. Autrement-dit, il y a des acteurs plus décisifs que les
autres dans le fonctionnement de deux processus qui englobent ces deux actions. Ces
288
.
résultats montrent que l'artisan expert joue le rôle le plus important dans ces deux
processus en comparaison des rôles des autres acteurs qui y participent. D'une part, il
représente la source principale des innovations internes qui constituent l'une des conditions
principales de l'actualisation des métiers ancestraux. D'autre part, il est la seule source
laquelle les novices peuvent acquérir les savoirs professionnels nécessaires à la
reproduction des spécificités de ce type de métier. De ce fait, cet acteur constitue l'élément
central dans les activités de l'innovation et de la transmission intergénérationnelle des
savoirs professionnels. D'ailleurs, la réussite de ces deux activités, l'une indépendamment
de l'autre, dans la réalisation de leurs objectifs, le changement et la reproduction, dépend en
grande partie de l'artisan expert et de son engagement efficace envers l'entreprise et le
métier ainsi qu'envers les novices.
Compte tenu de sa double présence dans les actions de l'innovation et de la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels, l'artisan expert se présente donc parmi les
déterminants humains de la conciliation entre les deux actions en question. En d'autres
termes, la coexistence des projets du changement et de la reproduction au sein de
l'entreprise artisanale de métier ancestral dépend de la capacité de cet acteur de jouer un
double rôle en même temps : le rôle d'innovateur et le rôle du transmetteur des savoirs
professionnels aux nouvelles générations. En plus de ces deux rôles, il lui est aussi
demandé de remplir son rôle de producteur.
Dans cette perspective, l'artisan expert doit accomplir trois tâches à la fois dans la mesure
où ces trois activités, l'innovation, la transmission et la production, sont indissociables dans
cette catégorie spécifique d'entreprise. Dans les entreprises Al et A2, où ces trois activités
coexistent, les tâches d'un artisan expert sont : la production, la formation et la création.
L'accomplissement de ces différentes tâches exige, tel qu'il est précisé antérieurement, que
l'artisan expert détienne des connaissances approfondies du métier. Néanmoins, sa réussite
dans ces différentes tâches ne dépend pas uniquement de ces connaissances
professionnelles. Elle dépend également d'un autre facteur qui le concerne également : sa
capacité déjouer plusieurs fonctions en même temps. Autrement-dit, il est nécessaire qu'il
soit polyvalent.
289
De ce fait, la compétence professionnelle des artisans experts constitue un autre
déterminant assez important dans la conciliation entre les actions de l'innovation et de la
transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels dans les entreprises artisanales
de métiers hérités du passé. D'une part, Cette compétence permet à ce type d'acteur d'être
multifonctionnel. D'autre part, il lui permet d'éviter tout ce qui peut empêcher la
conciliation entre ces deux actions.
En somme, la conciliation entre l'action de l'innovation et de la transmission des savoirs
professionnels au sein de l'entreprise artisanale de métier ancestral exige l'existence de
deux conditions d'ordre humain. D'un côté, elle exige la présence des individus qui ont des
représentations positives à l'égard de ces deux actions. Ces représentations contribuent à
l'apparition des comportements et des attitudes dans le travail favorables à la coexistence
des projets de changement et de la reproduction. Elles préparent donc un terrain propice à la
conciliation entre les deux actions en question. D'un autre côté, elle requiert la présence des
artisans experts ayant des compétences professionnelles assez élevées. Cette compétence
est nécessaire pour que ce type d'acteur puisse remplir plusieurs fonctions en même temps
(production, création et formation) et être capable d'éviter tout ce qui peut mettre en péril la
conciliation en question. Toutefois, l'analyse comparative des données recueillies dans les
unités Al et A2 montre que la conciliation entre l'innovation et la transmission des savoirs
professionnels n'est pas favorisée uniquement par des facteurs de nature humaine, mais
elle favorisée aussi par d'autres facteurs d'autre nature : des facteurs en lien avec le
fonctionnement de l'entreprise.
2.2 Les facteurs en lien avec le fonctionnement de l'entreprise
Se préoccuper des facteurs se rapportant au fonctionnement de l'entreprise intervenant dans
la conciliation entre le processus de l'innovation et celui de la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels revient, entre autres, à dégager les
déterminants techniques de cette conciliation. Il s'agit exactement de comprendre comment
ces deux processus peuvent coexister sans rencontrer des problèmes d'ordre technique qui
peuvent entraver cette coexistence. Autrement-dit, quelles sont les conditions techniques
propices à la conciliation entre les des deux processus en question? Les résultats de
290
l'enquête empirique montrent que les déterminants techniques de cette conciliation sont de
deux ordres: l'organisation du travail et la gestion des ressources humaines.
2.2.1 L'organisation du travail comme déterminant dans la conciliation
Les actions de l'innovation et de la transmission intergénérationnelle des savoirs
professionnels au sein de l'entreprise artisanale de métier ancestral constituent deux
processus qui obéissent à des logiques de fonctionnent totalement différentes. Toutefois, le
fonctionnement et l'ampleur de ces deux processus dépendent étroitement de l'activité
productive. Cette dépendance est expliquée principalement par le fait que ces deux
processus ne sont pas séparés de cette activité ni dans le temps ni dans l'espace.
Compte tenu de cette relation de dépendance, le fonctionnement des deux processus en
question est, sans aucun doute, conditionné par les dynamiques et les logiques structurant
l'activité productive. Les résultats de l'enquête empirique montrent que le fonctionnement
des processus de l'innovation et de la transmission des savoirs professionnels dépend, entre
autres, de deux éléments relatifs à cette activité : la manière par laquelle sont divisées les
tâches du processus englobant l'activité productive et la manière par laquelle est divisé
l'espace dans lequel se déroulent ces différentes tâches.
Dans cette perspective, la promotion des processus de l'innovation et de la transmission des
savoirs professionnels, l'un indépendamment de l'autre, est déterminée également par les
moyens formels et semi-formels mis en œuvre par l'entreprise pour diviser et coordonner
le travail. En ce sens, l'organisation du travail joue un rôle capital dans la promotion de ces
deux processus. Pour promouvoir l'innovation, il est nécessaire que la division des tâches
n'entraîne pas une restriction du rôle de l'individu à la simple exécution. En d'autres
termes, il est nécessaire que cette division ne limite pas le champ d'action des individus
dans le travail. Car cette limitation, telle qu'elle déjà été montrée, se présente comme un
véritable obstacle devant l'émergence des initiatives individuelles et collectives dans le
travail qui constituent le moteur de l'innovation au sein de l'entreprise. Pour promouvoir le
transfert des connaissances professionnelles, il est nécessaire que la division spatiale des
tâches n'entraîne pas l'isolation des individus dans le travail. Autrement-dit, il est
nécessaire que cette division favorise les contacts entre les individus. Car ces contacts sont
291
indispensables pour créer des situations d'échange dans le travail dans la mesure où ces
situations constituent la plateforme de la transmission des savoirs professionnels dans
l'entreprise.
Ainsi, la promotion des processus d'innovation et du transfert intergénérationnel des
connaissances professionnelles au sein de l'entreprise nécessite l'accommodation de
l'organisation du travail aux exigences de chacun de ces deux processus. L'analyse
comparative des données recueillies dans les entreprises Al et A2, où ces deux processus
marquent une forte présence, montrent que l'organisation du travail favorable à la
promotion en même temps de l'innovation et de la transmission des savoirs relatifs au
métier est celle qui se caractérise par deux principaux traits :
1) L'octroi d'une marge de liberté aux individus dans le travail;
2) L'absence d'une séparation entre les individus dans le travail.
Dans cette perspective, l'entreprise qui souhaite réunir les processus de l'innovation et de
la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels est demandée d'agir sur son
organisation du travail afin de l'adapter aux logiques de fonctionnement de ces deux
processus. L'organisation du travail demeure donc un autre facteur assez déterminant dans
la conciliation entre les deux processus en question. Car, cette dernière (la conciliation) ne
peut se transformer en une réalité concrète qu'en présence des conditions favorables
permettant tout d'abord le bon fonctionnement de chacun de ces deux processus. En
d'autres termes, la conciliation entre les deux processus en question nécessite au préalable
l'aménagement d'un terrain organisationnel leur permettant de fonctionner ensemble sans
que l'un élimine l'autre. Cependant, l'organisation du travail ne constitue pas le seul
déterminant d'ordre technique de cette conciliation.
2.2.2 La gestion des ressources humaines comme déterminant dans la
conciliation
Le deuxième déterminant d'ordre technique de la conciliation entre les actions de
l'innovation et de la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels au sein
des unités artisanales de métiers ancestraux qui ressort de l'analyse comparative des
292
données recueillies des entreprise Al et A2 concerne la politique de gestion des ressources
humaines mise en place par l'entreprise. Dans ces deux unités cette conciliation est devenue
une réalité concrète également grâce à la mise en place d'une politique managériale qui
prend en considération les deux actions en question. Cette politique incorpore des outils de
gestion permettant de valoriser à la fois les efforts des participants dans l'action de
l'innovation et de ceux participant dans l'action du transfert entre les générations des
connaissances professionnelles.
Concrètement, la politique managériale mise en œuvre par les entreprises Al et A2 relie la
mobilité professionnelle et le système des rémunérations aux actions de l'innovation et de
la transmission des savoirs professionnels. De telle façon que ces deux actions constituent
des moyens permettant aux individus de réaliser des avantages matériels et immatériels.
Dans ces deux unités, les deux actions en question, l'une indépendamment de l'autre, se
présentent comme des véritables chemins permettant aux individus d'améliorer leurs
revenus ainsi que leurs statuts dans l'entreprise. Les deux actions sont donc porteuses pour
les membres de l'entreprise. Ce faisant, l'adhésion d'un individu à l'une de ces actions
sans participer à l'autre n'entraîne en aucun cas la limitation de ses chances de réaliser des
gains personnels. Certes, une telle politique ne permet pas seulement d'inciter les membres
de l'entreprise à s'engager efficacement, selon leurs statuts, à l'une de ces deux actions,
mais elle permet également d'éviter l'apparition des comportements et des attitudes
individuels et collectifs défavorables à l'action dont ils ne font pas partie. Donc, elle
contribue à la création d'une autre condition principale à la conciliation entre les deux
actions en question : l'atténuation des problèmes qui peuvent entraver la coexistence des
deux processus qui englobent ces deux actions.
Ainsi, la conciliation entre les actions de l'innovation et de la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels au sein de l'entreprise artisanale de métier
ancestral ne dépend pas uniquement du modèle organisationnel mis en œuvre par
l'entreprise, mais aussi du modèle de gestion des ressources humaines. Pour qu'il y ait
conciliation, il est nécessaire que ce modèle mette au même rang les deux actions en
question. En d'autres termes, il ne faut pas qu'une de ces deux actions soit privilégiée sur
l'autre par les outils de la gestion individuelle.
293
À la clôture de ce chapitre, la conciliation entre les actions de l'innovation et la
transmission des savoirs professionnels au sein des entreprises artisanales de métiers
ancestraux nécessite d'agir sur ces deux actions ainsi que sur le contexte de leurs
déroulements. D'une part, elle nécessite l'accommodation de chacune d'elle aux objectifs
de l'autre. Il est nécessaire que l'action de l'innovation n'entraîne pas des transformations
radicales sur le métier et que les savoirs mobilisés dans cette action soient intimement liés
au métier. De même, il est important que l'action de la transmission des savoirs
professionnels contribue à la socialisation des membres de l'entreprise au changement et à
l'innovation. D'autre part, cette conciliation nécessite la présence de conditions humaines
et techniques propices à la coexistence des deux actions en question. Il est nécessaire que
les représentations de ces membres vis-à-vis de ces deux actions soient positives et que les
artisans experts soient dotés de compétences professionnelles approfondies leurs permettant
d'alterner entre les deux actions. De même, il est important que le modèle organisationnel
et la politique managériale mis en œuvre par l'entreprise prennent en considération les deux
actions en question. Bref, la conciliation entre les processus de l'innovation et de la
transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels est .conditionnée par des
facteurs endogènes à chacun d'eux et par d'autres qui leurs sont exogènes. Le schéma
suivant récapitule les facteurs déterminants de cette conciliation.
294
Schéma 9: Les déterminants de la conciliation entre l'innovation et la transmission des savoirs professionnels
Déterminants intrinsèques Déterminants extrinsèques
Facteurs relatifs à l'action d'innovation
- Le type d'innovation - Les types de savoirs mobilisés dans l'innovation
Facteurs relatifs à l'action d'innovation
- Le type d'innovation - Les types de savoirs mobilisés dans l'innovation
Facteurs relatifs aux individus - Les représentations de l'innovation de la transmission des savoirs - La compétence des artisans
Facteurs relatifs aux individus - Les représentations de l'innovation de la transmission des savoirs - La compétence des artisans
/ La conciliation entre les \ ( actions d'innovation et de j
. V la transmission des / / \ \ . savoirs orofessionnels / 1 \ <A ̂ ^ W
Facteurs relatifs à l'action de la transmission
- Les fonctions à la charge de l'opération de la transmission des savoirs
Facteurs relatifs au fonctionnement de l'entreprise
- Le mode d'organisation du travail - Le mode de la GRH
295
Conclusion
Cette étude avait comme point de départ la réflexion sur l'avenir des entreprises artisanales
tunisiennes de métiers ancestraux dans le contexte de la globalisation caractérisée, entre
autres, par la concurrence accrue et la progression d'une culture globalisée au déterminant
des cultures locales. Le retour de ce type spécifique d'unité productive, vers la fin du
vingtième siècle, que ce soit dans les stratégies économiques du pays où dans le vécu
quotidien de la société locale, a été à l'origine de cette réflexion. Les résultats d'une pré
enquête ont permis de constater que les contraintes imposées par ce contexte à ces
entreprises ne diffèrent pas énormément de celles imposées aux entreprises d'autres types.
Cependant, leurs responsabilités sont beaucoup plus complexes que les responsabilités des
autres. L'État tunisien, en réinsérant des unités productives de métiers ancestraux dans le
processus économique du pays avait trois objectifs : la création de la richesse, la création et
la conservation des emplois et la conservation d'une partie intégrante de la culture locale.
Ces unités doivent ainsi assumer plusieurs responsabilités en même temps : une
responsabilité économique, sociale et culturelle. La réussite à ces différentes responsabilités
reste, sans aucun doute, tributaire de l'incorporation de ces entreprises de deux logiques
différentes. D'une part, elles sont obligées d'instaurer une logique de changement afin de
s'adapter aux exigences du nouveau contexte. Cette adaptation est plus que nécessaire pour
qu'elles puissent assurer leur survivance qui garantit, entre autres, la création de la richesse
et des emplois. D'autre part, elles sont obligées d'instaurer une logique de reproduction afin
de perpétuer les caractéristiques identitaires de leur métier dans le contexte de la
globalisation qui se présente comme une menace pour tout ce qui est local. Cette
perpétuation est obligatoire si elles veulent contribuer à la conservation de la culture locale
de la dissolution dans la culture globale. Cette contribution est valorisée par l'état en
attribuant aux entreprises participantes à cette mission des privilèges de différents types.
Donc, les unités productives tunisiennes de métiers héritées du passé sont obligées
d'intégrer deux projets difficilement compatibles : le changement et la reproduction.
La recherche bibliographique, constituant une partie de la pré-enquête, conduit à identifier
deux principales dynamiques permettant à ces unités de production de réaliser ces deux
projets. D'un coté, la dynamique de l'innovation constitue le chemin à travers lequel elles
296
peuvent atteindre le changement. D'un autre coté, la dynamique de la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels constitue le chemin par lequel elles peuvent
assurer la reproduction. La réussite dans ces deux projets exige la promotion de ces
dynamiques, l'une indépendamment de l'autre, au sein de l'entreprise d'une part, et la
conciliation entre elles afin d'atténuer les contradictions qui peuvent empêcher leurs
coexistence d'autre part. De ce fait, une réflexion sur l'avenir des entreprises artisanales
tunisiennes de métiers ancestraux ne peut se faire sans mettre l'accent sur les deux
dynamiques indispensables à leur survie. D'ailleurs, la littérature nous a permis de déduire
que le traitement de ces deux dynamiques permet de comprendre les logiques de
fonctionnement et les structures de cette catégorie spécifique d'entreprise dans la mesure où
ces deux dynamiques prennent la forme des processus qui dépendent étroitement de ces
logiques et de ces structures. Ils dépendent principalement de l'organisation du travail, de la
gestion des ressources humaines et des dynamiques socioculturelles de l'entreprise. Donc,
mettre l'accent sur les dynamiques de l'innovation et de la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels ne permet pas seulement de traiter ces
dynamiques, mais elle permet également d'apporter un éclairage à la fois théorique et
empirique sur le monde des entreprises artisanales de métiers ancestraux dans le contexte
de la globalisation. Pour ce faire, la recherche a tenté de répondre à la question centrale
suivante :
Comment les entreprises artisanales tunisiennes de métiers ancestraux gèrent-elles
les dynamiques de la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels et
celles de l'innovation, ainsi que les relations entre elles afin de pouvoir assurer leurs
différentes responsabilités dans le contexte de concurrence accrue par la
globalisation?
La réponse à cette question a permis à cette recherche d'aboutir à ses principaux objectifs :
l'examen des dynamiques de la transmission des savoirs professionnels dans les entreprises
artisanales tunisiennes de métiers ancestraux, la circonscription des dynamiques de
l'innovation dans ces entreprises et la détermination des modèles de l'entreprise artisanale
tunisienne de métier ancestral dans le contexte de la globalisation. De même, elle a permis
de vérifier la première moitié de l'hypothèse conductrice de cette recherche qui relie la
297
réussite de l'entreprise artisanale tunisienne dans ses différentes responsabilités à sa
capacité de bien gérer les dynamiques de l'innovation et de la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels, ainsi que la relation entre elles.
L'incorporation de l'échantillon étudiée des entreprises qui connaissent la prospérité (les
entreprises de la poterie artisanale) et d'autres qui traversent une crise (les entreprises du
tapis de sol) a permis la confirmation de cette hypothèse.
Concrètement, la présence très forte et la coexistence en harmonie des dynamiques de
l'innovation et de la transmission intergénérationnelle a permis aux deux entreprises de la
poterie artisanale de se repositionner sur le marché local et international, de conserver et de
créer de nouveaux emplois et de préserver les traits identitaires de leurs métiers. Elles ont
donc réussi grâce à ces dynamiques à assumer les fonctions économique, sociale et
culturelle qui sont à leur charge dans le contexte de la globalisation. Or, l'absence totale ou
partielle des deux dynamiques en question dans les deux entreprises du tapis de sol est
accompagnée d'une chute continue dans leurs résultats économiques. Une telle chute se
présente comme une véritable menace à la survie de ce métier qui a été longtemps une
source de richesse économique, un réservoir d'emploi et un symbole culturel du pays. La
recherche des causes de la présence de ces deux dynamiques dans les entreprises de la
poterie artisanale et de leur absence totale ou partielle dans les entreprises du tapis de sol a
permis de vérifier la deuxième moitié de l'hypothèse conductrice de cette étude qui relie
ces deux dynamiques et la conciliation entre elles à l'organisation du travail, à la gestion
des ressources humaines et aux dynamiques socioculturelles de l'entreprise; illustrées, entre
autres, par les représentations de l'innovation et de la transmission des savoirs
professionnels.
Dans les deux entreprises de la poterie artisanale, la mise en œuvre d'un modèle
organisationnel qui tient compte des spécificités des processus de l'innovation et du
transfert intergénérationnel des savoirs professionnels a permis à ces deux processus de
coexister sans que l'un entrave l'autre. Aussi, la mise en œuvre d'une politique managériale
qui motive les membres de l'entreprise à s'engager efficacement demeure un autre facteur
expliquant la forte présence et la coexistence de ces deux processus dans ces deux
entreprises. De même, la présence des dynamiques socioculturelles qui renforcent les
298
sentiments d'appartenance et d'attachement chez les individus à leurs entreprises et à leur
métier constitue un facteur supplémentaire qui a favorisé cette présence et cette
coexistence. Or, dans les deux unités du tapis de sol l'absence totale ou partielle de ces
trois facteurs (modèle organisationnel qui tient compte des processus de l'innovation et de
la transmission intergénérationnelle de savoirs professionnels, politique managériale
incitant à participer à ces deux processus et dynamiques renforçant l'attachement des
individus à leur entreprise et à leur métier) a constitué un véritable obstacle à la promotion
des logiques l'innovation et de la reproduction des savoirs professionnels au sein de ces
deux entreprises.
La comparaison entre les deux entreprises de la poterie artisanale et du tapis de sol nous a
ainsi permis de confirmer les trois hypothèses secondaires découlant de l'hypothèse
générale. En conformité avec ces trois hypothèses, les principaux constats de cette
recherche sont :
1) L'institutionnalisation des logiques de l'innovation au sein de l'entreprise artisanale
contribue à l'amélioration de sa compétitivité sur le marché, que ce soit sur le marché local
ou international. Ceci contribue, sans aucun doute, à l'amélioration des performances
économiques (création de la richesse) qui agit directement sur les performances sociales
(conservation et création de l'emploi) de l'entreprise. Donc, l'innovation est sûrement le
chemin à travers lequelle l'entreprise artisanale tunisienne de métier ancestral peut réussir
sa responsabilité d'ordre économique, ainsi que celle d'ordre sociale.
2) L'instauration d'une politique interne, qui tient compte de la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels, des normes et des valeurs du travail
artisanal, permet de perpétuer les métiers ancestraux. Ceci contribue, sans aucun doute, à la
reproduction d'une partie importante de la culture locale. Donc, la transmission
intergénérationnelle constitue vraiment la voie à travers laquelle les unités productives
artisanales de métiers hérités du passé peuvent assurer leur responsabilité cultuelle dans le
contexte de la globalisation : la conservation d'une partie importante de la culture locale.
3) La mise en œuvre d'une organisation de travail favorable, d'une politique de gestion de
ressources humaines développée et la présence d'un climat social et culturel adéquat
299
favorisent l'émergence et l'introduction des innovations dans le travail, facilitent la
transmission des valeurs et des normes techniques et socioculturelles du métier et
permettent de concilier processus d'innovation et transmission des savoirs professionnels.
Autrement-dit, la promotion de ces deux processus, l'un indépendamment de l'autre, et la
conciliation entre eux, sont conditionnées par des facteurs extrinsèques de nature humaine
et technique. Toutefois, les résultats de l'enquête empirique nous a permis de découvrir que
la conciliation entre les deux processus en question n'est pas conditionnée uniquement par
des facteurs extrinsèques. Elle est conditionnée pareillement par des facteurs intrinsèques à
ces deux processus. D'une part, elle dépend de la nature du changement entraîné par le
processus de l'innovation ainsi que des savoirs mobilisés dans ce processus. D'autre part,
elle dépend des fonctions du processus de la transmission intergénérationnelle des savoirs
professionnels.
Ainsi, la conciliation entre ces deux processus nécessite, tout d'abord, d'agir sur le contexte
de la production toute entier afin de favoriser leur existence. Car le fonctionnement et
l'ampleur de ces deux processus, l'un indépendamment de l'autre, dépendent étroitement
tant des composantes humaines que techniques de ce contexte. Ensuite, cette conciliation
nécessite d'agir sur les deux processus en question afin de favoriser leur coexistence en
harmonie. Car chacun de ces processus a un objectif qui diffère complètement de l'objectif
de l'autre. L'innovation a pour but le changement et la transmission intergénérationnelle
des savoirs professionnels cible la reproduction.
Compte tenu de ce qui précède, la réussite de l'entreprise artisanale de métier ancestral à
assurer sa pérennité sans perdre son identité nécessite la promotion des processus de
l'innovation et de la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels ainsi que
la conciliation entre ces deux processus. La concrétisation de ces deux faits (la promotion
et la conciliation), repose sur les actions suivantes :
1) L'accommodement des logiques de fonctionnement de l'entreprise aux processus de
l'innovation et de la transmission intergénérationnelle de savoirs professionnelles;
2) L'accommodement des structures de l'entreprise aux logiques de fonctionnement de ces deux processus;
300
3) L'accommodement des pratiques de gestion des ressources humaines aux exigences des
deux processus en question;
4) La sensibilisation des membres de l'entreprise de l'utilité de l'innovation et de la
transmission intergénérationnelle;
5) L'accommodement des pratiques socioculturelles de l'entreprise aux dynamiques de
ces deux processus;
6) L'accommodement de chacun de ces deux processus aux objectifs de l'autre processus;
7) La préparation des conditions humaines et techniques propices à la coexistence de ces
deux processus.
Cependant, la présence des processus de l'innovation et de la transmission
intergénérationnelle des savoirs professionnels ne garantit pas toute seule la réussite de
l'entreprise artisanale de métier ancestral dans ses différentes responsabilités dans le
contexte de la globalisation. L'autre élément déterminant dans cette réussite se rapporte
aux champs couverts par ces deux processus. En ce sens, la réussite de cette catégorie
spécifique d'entreprise à l'enregistrement des performances économiques et sociales est
tributaire des dimensions du travail concernées par l'innovation. Dans le même ordre
d'idées, la réussite de ces entreprises à la reproduction des caractéristiques identitaires des
métiers qu'elles pratiquent est tributaire des types de savoirs concernés par la transmission.
Au sujet des performances économiques et sociales, l'innovation dans les produits constitue
le facteur le plus déterminant dans ces performances dans la mesure où ce type
d'innovation contribue à l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise. Cette dernière
augmente les bénéfices de l'entreprise, ce qui entraîne dans la majorité des cas
l'augmentation de ses investissements. Donc, l'innovation dans les produits demeure
décisive dans la réussite de l'entreprise artisanale de métier ancestral dans
l'accomplissement de ses responsabilités économique et sociale : la création de la richesse
et la conservation et la création des emplois. Toutefois, ce type d'innovation ne constitue
pas le seul champ de travail concerné par le processus d'innovation dans les entreprises
étudiées. Les autres champs qui ont fait l'objet d'innovation dans ces entreprises sont :
301
l'organisation du travail, les outils du travail, le marché et les moyens de
commercialisation. Ce faisant, l'innovation dans les unités artisanales tunisiennes de
métiers ancestraux correspondent aux cas d'innovations énumérées par Josef Alois
Schumpeter, le théoricien de l'innovation au sein des entreprises industrielles modernes,
dans son célèbre ouvrage édité en 1935 : Théorie de l'évolution économique.
Au sujet de la reproduction des caractéristiques identitaires des métiers ancestraux, la
transmission des savoirs socialisant au métier constitue le facteur le plus déterminant dans
cette reproduction, dans la mesure où cette catégorie de savoirs concerne les valeurs et les
normes culturelles du métier qui représentent un véritable patrimoine culturel. Donc, la
transmission intergénérationnelle de ces normes et de ces valeurs demeure décisive dans la
réussite de l'entreprise artisanale de métier ancestral dans l'accomplissement de sa
responsabilité culturelle : la conservation d'une partie importante de la culture locale.
Toutefois, cette catégorie de savoirs ne constitue pas le seul champ de savoirs concerné par
le processus de la transmission dans les entreprises étudiées. Les autres champs de savoirs
concernés par ce processus sont : les savoirs théoriques relatifs au métier, le savoir-faire et
les savoir- être. Ce faisant, la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels
au sein des entreprises artisanales de métiers ancestraux concerne les différentes
composantes de la compétence professionnelle dans son sens moderne (Paretti, 2005; Le
Boterf, 2007; Martinet et Silem, 2008).
Ainsi, l'innovation et la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels au sein
de l'entreprise artisanale de métier ancestral constituent des processus multidimensionnels.
Toutefois, ces deux processus ne sont pas identiques dans toutes les entreprises étudiées. En
d'autres termes, les expériences de l'innovation et du transfert entre les générations de
savoirs relatifs au métier varient d'un milieu de travail à un autre. Mais cela ne veut pas
dire que ces expériences n'ont aucune référence commune. L'incorporation de
l'échantillon d'une unité symbolisant la forme classique (l'entreprise domestique) et d'une
autre représentant la forme moderne (l'entreprise non domestiques) pour chacun des deux
métiers étudiés (la poterie artisanale et le tapis du sol) a permis de découvrir un autre
facteur assez déterminant dans les deux processus englobant les deux expériences en
question. Il s'agit de la culture du métier. Concrètement, les dynamiques de l'innovation et
302
de la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels au sein des unités d'un
même métier, en dépit de leur appartenance à deux générations différentes d'entreprises,
obéissent relativement aux mêmes logiques de fonctionnement et occasionnent presque les
mêmes dynamiques socioculturelles au sein de l'entreprise. Bref, chaque métier dispose
d'une culture propre en matière d'innovation et de transmission des connaissances
professionnelles. De fait, cette recherche a aussi permis de mettre en relief l'importance que
revêt la culture du métier lors de l'étude des deux dynamiques analysées dans cette thèse.
Au terme de cette recherche, nous proposons, en se référant aux conclusions tirées,
quelques pistes qui peuvent être poursuivies :
1) En effectuant des recherches analogues dans des entreprises apparentant à d'autres
types de métiers ancestraux en Tunisie, il serait possible de vérifier et de compléter les
résultats obtenus dans le cadre de cette recherche.
2) En effectuant des recherches analogues dans des entreprises exerçant des métiers
modernes en Tunisie, il serait possible de déterminer le rôle que joue la culture de la société
en matière du travail dans les deux dynamiques qui ont fait l'objet de notre investigation :
l'innovation et la transmission des savoirs professionnels.
3) En effectuant des recherches analogues dans des entreprises de métiers ancestraux dans
d'autres pays entretenant des relations différentes avec leurs patrimoines culturels, il serait
possible de déterminer le rôle que joue les représentations du patrimoine culturel dans la
modernisation et la reproduction de cette catégorie spécifique de métiers.
Il reste à la fin à souligner que cette thèse ne porte pas une réflexion définitive sur les
dynamiques de l'innovation et de la transmission intergénérationnelle des savoirs
professionnels dans les entreprises artisanales tunisiennes de métiers ancestraux. Comme
dans toute recherche qualitative, les résultats présentés ne peuvent pas être généralisés. Ils
sont limités dans le temps et dans l'espace. Donc, ils ne constituent qu'une ébauche
permettant de bien comprendre ces deux dynamiques et cette catégorie spécifique
d'entreprise.
303
Bibliographie
Aballéa (F), « Sociologie de l'artisanat», dans Boutillier (S), David (M) et Fournier (C)
dirs., Traité de l'artisanat et de la petite entreprise, Paris, Educaweb, 2009, p.
533-556.
Abbate (F), L'intégration de la Tunisie dans l'économie mondiale : défis et opportunités,
Genève, Nation Unie, 2002, 79 p.
http://www.unctad.org/fr/docs/pocdmml98.fr.pdf
Abélès (M), Anthropologie de la globalisation, Paris, Payot, 2008, 280 p.
Abric (J.-C), Méthodes d'étude des représentations sociales, Ramonville Saint-Agne, Eres,
2003, 295 p.
Abric (J-C), «L'artisan et l'artisanat : analyse du contenu et de la structure d'une
représentation sociale», Bulletin de psychologie, N°366, 1984, p. 861-875.
Abric (J-C), Pratiques sociales et représentations, Paris, PUF, 1994, 251 p.
Adda (J), La mondialisation de l'économie, Paris, La Découverte, 2004, 198 p.
Adams (R., J) et autres, «Innovation Management Measurement: A Review», International
Journal of Management Reviews, n° 1, 2006, p 21-47.
Callon (M), Akrich (M) et Latour (B), Sociologie de la traduction : textes fondateurs, Paris,
Presses de l'École des mines, 2006, 303p.
Akrich (M), Callon (M) et Latour(B), «À quoi tient le succès des innovations? 1 : L'art de
l'intéressement», Gérer et comprendre, Annales des Mines, n° 11, 1988, p. 4-17.
Akrich (M), Callon (M) et Latour(B), «À quoi tient le succès des innovations? 2 : Le choix
des porte-parole», Gérer et comprendre, Annales des Mines, n° 12, 1988, p. 14-
29.
Akrich (M), Callon (M), et Latour (B), Sociologie de la traduction : textes fondateurs,
Paris, Presses de l'École des mines, 2006, 303 p.
Alaluf (M), Le temps du labeur : formation, emploi et qualification en sociologie du
travail, Bruxelles, Éditions de l'université de Bruxelles, 1986, 339 p.
Aldebert (L), Métiers passions pour l'orientation des jeunes vers l'artisanat, Paris, Le
Cherche Midi, 2003, 335p.
Allard (F) et al., La valorisation des spécificités de entreprises artisanale, Annales réseau
Artisanat-Université,2008,8p,
304
infometiers.org/ISM/Media/Files/RAU/articles_scientifiques_v4 : consulté le
08/02/2010.
Allemand (S) et Ruano-Borbalan, La mondialisation, Paris, Le cavalier bleu, 2002, 127 p.
Allouche (J) dir., Encyclopédie des ressources humaines, Paris, Vuibert, 2003, 1890 p.
Alter (N) dir., Les logiques de l'innovation, Paris, La Découverte, 2002, 275 p.
Alter (N), «Innovation et organisation : deux légitimités en concurrence», Sociologie du
travail, n° 4, 1993, p 447-468.
Alter (N), «Innovation organisationnelle entre croyance et raison», dans Mustar (PH) et
Penan (H), Encyclopédie de l'innovation, Paris, Economica, 2003, p 71-88.
Alter (N), «Les innovateurs sont-ils des déviants», Sciences Humaines, n°94, 1999, p 34-
37.
Alter (N), Donner et prendre : la coopération en entreprise, Paris, La Découverte, 2009,
230 p.
Alter (N), « La lassitude de l'acteur de l'innovation», Revue française de sociologie, n° 2,
1993,p 175-197.
Alter (N), L'innovation ordinaire, Paris, PUF, 2005. 284 p.
Alter (N), Sociologie de l'entreprise et de l'innovation, Paris, PUF, 1996,237p.
Alter (N), Sociologie du monde du travail, Paris, Presses universitaires de France, 2006,
356 p.
Amabile (TM), «A Model of Creativity and Innovation in Organizations», Research in
Organizational Behavior, vol. 10, 1988, p 123-167.
Appadurai (A), Modernity At large: Cultural Dimensions Of Globalization, Minneapolis,
University of Minnesota Press, 1996, 229 p.
Argyris (CH), Organization and innovation, Homewood, Irwin, 1965, 274 p.
Argyris (CH), Participation et organisation, traduit par Lingagne (C), Montréal, Dunod,
1974,315 p.
Asquin (A) et Marion (S), La performance comme intention stratégique du développement
d'une activité artisanale, Actes de colloque AIREPME, 2005, 18 p.
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/36/81 /19/PDF/marion pdf.pdf
Astolfi (J-P) dir., Savoirs en action et acteurs de la formation, Mont-Saint-Aignan,
Publications de l'université de Rouen, 2004, 265 p.
305
Ba (A), « Artisans sans frontières», dans Boutillier (S), et Fournier (C) dirs., Artisanat : la
modernité réinventée, Paris, L'Harmattan, 2006, p. 121-152.
Balfet (H), «Poterie artisanale en Tunisie», Cahiers de la Tunisie, vol VI, 1958, p 317-347.
Banque Mondiale, Données : Tunisie, 2011.
http://donnccs.banqucmondialc.org/pavs/tunisic
Bakan (I) and Yildiz (B), «Innovation Strategies and Innovation Problems in Small and
Medium-Sized Enterprises: An Empirical Study», dans Aydogan (N) Innovation
Policies, Business Creation And Economie Development: A Comparative
Approach , New York ; London : Springer, 2008. p. 177-211.
Barbier (J-M) dir., Savoir théorique et savoir d'action, Paris, PUF, 2011, 305 p.
Barouni-Ben Sedrine (F), De la mémoire à l'avenir: la corporation des chouachia de
Tunis mémoire d'un essor et enjeu de développement de l'entreprise aujourd'hui,
Tunis, CPU et ONA, 2003, 570 p.
Barraud (J), Guillemin (M), Kittel (F), La fonction ressources humaines: métiers,
compétences et formation, Paris, Dunod, 2008. 258 p.
Barthélémy (G), Artisanat et développement, Paris, Groupe de recherche et d'échanges
technologiques, 1986, 257 p.
Basso (O), Le manager entrepreneur : entre discours et réalité, diriger en entrepreneur,
Paris, Village mondial, 2006. 234 p.
Baumol (W.J), The free-market innovation machine: analyzing the growth miracle of
capitalism, Princeton : Princeton University Press, 2002, 318 p.
Beck (U), qu 'est ce le cosmopolitisme, Paris, Aubier, 2006, 378 p.
Beck (U), What Is Globalization, Maiden, Polity Press, 2000, 180 p.
Becker, (H.S), Sociological work; method and substance, Chicago, Aldine Pub, 1970,
358p.
Bedarida (F) et Fohlan (C), L'homme et ses métiers : histoire générale du travail, l'ère
des révolutions, Tome 3, Paris, Nouvelle Librairie, 2000, 636 p.
Bellier (S), Acquisition et transmission des compétences, MEDEF, (collection Cahier),
Cahier n° 8 2002, 69p.
http://www.stcphanchaefliger.com/campus/biblio/012/aetdc,pdf
306
Bellier (S), Le savoir-être dans l'entreprise : Utilité en gestion des ressources humaines,
Paris, Vuibert, 2004, 204 p.
Bellon (B), Innover ou disparaître, Paris, Economica, 1994, 211p.
Bellon (B), L'innovation créatrice, Paris, Economica, 2002, 232 p.
Ben Hamouda (H), Tunisie, ajustement et difficulté de l'insertion internationale, Paris,
L'Harmattan, 1995,207 p.
Ben Marzouka (T), Haudeville (B), Ouverture et compétitivité des pays en développement :
actes du colloque international : "La libéralisation, transfert de connaissances et
développement" (2002 : Tunis, Tunisie), Paris , L'Harmattan, 2004,418 p.
Bemadau (A), « Savoir théoriques et savoir pratiques : l'exemple médical», dans Barbier
(J-M) dir., Savoirs théoriques et savoirs d'action, Paris, PUF, 2011.
Bijker ( W.E.), Hughes (T.P) and Pinch (T. J), The Social Construction of Technological
Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology, Cambridge,
MA: MIT Press, 1987, 405 p.
Blanchard (C), La formation professionnelle : un outil vital pour l'avenir de l'entreprise,
Paris, Vuibert, 2005, 474 p.
Bloch (O), Dictionnaire étymologique de la langue française, Paris : Quadrige/PUF, 2008,
682 p.
Blondel (D), Innovation et bien être : une relation équivoque, Paris, Publibook, 2010, 390
P-
Blondel (D), L'innovation, pour le meilleur et pour le pire, Paris, Hatier, 1990, 287 p.
Boldrini (J-C), Journé-Michel (H) et Schieb-Bienfait (N), Trajectoires d'innovations dans
l'entreprise artisanale : une approche évolutionniste fondée sur les ressources et
les compétences, 2007, 31p. http://www.aims2007.uqam.ca/actcs-dc-la-
conlcrcncc/communications/boldrini471/at download/article.pdf
Boldrini (J-C), « L'innovation des entreprises artisanales : les effets de la proximité»,
Revue Française de gestion, n°213, 2011, p. 25-41.
Boltanski (L), Thévenot (L), De la justification : les économies de la grandeur, Paris,
Gallimard, 1991, 485 p.
Bonet (L) et Négrier (E), La fin des cultures nationales? : Les politiques culturelles à
l'épreuve de la diversité, Paris, Découverte, 2008, 230 p.
307
Boudon (R) et al., Dictionnaire de sociologie, Paris, Larousse, 2003, 279 p.
Boutillier (S), « L'entreprise artisanale, entre l'entrepreneur et la grande entreprise», dans
Boutillier (S), et Foumier (C) dirs., Artisanat : la modernité réinventée, Paris,
L'Harmattan, 2006, p. 17-37.
Boutillier (S), et Foumier (C), « Société et artisanat : de la théorie à la réalité», dans
Boutillier (S), et Foumier (C) dirs, Artisanat : la modernité réinventée, Paris,
L'Harmattan, 2006, p. 13-16.
Boutillier (S) et Uzunidis (D), La gouvernance de l'innovation. Marché et organisations,
Paris, L'harmattan, 2007, 248 p.
Boutillier (S), David (M), Foumier (C) dirs., Traité de l'artisanat et de la petite entreprise^
Paris, Éducaweb, 2009, 652 p.
Boutillier (S), et Foumier (C) dirs., Artisanat : la modernité réinventée, Paris, L'Harmattan,
2006,216 p.
Boutillier (S), et Foumier (C), « Une analyse socio-économique de l'entreprise artisanale :
méthodologie, fondements théoriques et enquêtes sur le terrain», LAB.II, 2009, 18
p. http://riifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2009/0I/doc-205.pdf
Bouvier-Ajam (M), La doctrine corporative, Paris, Siery, 1937, 226 p.
Boutte (J-L), Transmission de savoir-faire : réciprocité de la relation éducative Expert-
Novice, Paris, L'Harmattan, 2007, 245 p.
Bouy (B), «La formation professionnelle initiale : les beaux jours de l'expérience»,
Formation Emploi, n°76, 2001, p 35-48.
Brault (J), L'artisan, Montréal : Éditions du Noroît, 2006, 117 p.
Bréchet (J-P), Journée- Miche (H) , Scheib-Bienfait (N) , «Figures de la conception et de
l'innovation dans l'artisanat», Revue internationale P.M.E., Vol. 21, n° 2,
2008, p 43-73.
Bril (B), «Apprentissage et culture», dans Chevalier (D), savoir-faire et pouvoir
transmettre, Paris, Édition de la maison de l'homme, 1991, p 15-21.
Brodtrick (O), « Some Thoughts on Definitions of Innovation », The Innovation
Journal, Volume 4, issue 3, 1999.
Bûcher (J), L'artisanat hier et aujourd'hui, Paris, Les livres nouveaux, 1941, 108p.
308
Burnay (N) et Klein (A), Figures contemporaines de la transmission, Namur, P.U.M, 2009,
499 p.
Bums (T), Stalker (G.M), The Management of Innovation, London, Tavistock Publications,
1961,269 p.
Buscatto (M), «Quand la qualification fait débats», Formation emploi, n° 96, 2006, p 5-10.
Caccomo (J-L), L'épopée de l'innovation, Paris, L'Harmattan, 2005, 146 p.
Capron (M), « Les mutations des stratégies de l'entreprise», Dans Thwaites (J) dir., La
mondialisation : origines, développements et effets, Québec, PUL, 2004, p. 137-
158.
Carayannis (E.G), Gonzalez (E) et Wetter (J), «The Nature and Dynamics of Discontinuous
And Disruptive Innovations From a Learning and Knowledge Managment
Perspective», dans Shavinina (L-V), The International Handbook on Innovation,
Oxford, Pergamon, 2003, p 115-138.
Caron (F) et al., L'homme et ses métiers : histoire générale du travail, le travail au 20e
siècle, Tome 4, Paris, Nouvelle Librairie, 2000, 720 p.
Carré (PH) et Charbonnier (O) dir., Les apprentissages professionnels informels, Paris :
L'Harmattan, 2003, 305 p.
Casella (Ph), Tripier (P), «Dynamique des métiers, contraintes et ressources de la culture de
métier», Économie rurale, n° 169, 1985, p 31-33.
Cavestro (W), Durieux (Ch), Monchatre (S), Travail et reconnaissance des compétences,
Paris, Economica, 2007. 224 p
Chagnollaud (J.P) et Ravenel (B), Le Maghreb face à la mondialisation, Paris,
L'Harmattan, 1997, 152 p.
Charmes (J) et Sanaa (A), La promotion de l'artisanat et des petits métiers en Tunisie : une
politique comprehensive à l'égard du secteur non structuré ?, Tunis, PNUD,
1985,85 p.
Chevallier (D) dir., Savoir faire et pouvoir transmettre : transmission et apprentissage des
savoir-faire et des techniques , Paris, Éditions de la Maison des sciences de
l'homme, 1991,265 p.
Chevallier (D), Chiva (I), «L'introuvable objet de la transmission», dans Chevallier (D)
dir., Savoir faire et pouvoir transmettre : transmission et apprentissage des
309
savoir-faire et des techniques , Paris, Éditions de la Maison des sciences de
l'homme, 1991, p. 1-14.
CTA World Factbook : http://www.indexmundi.coin/map/?v=74&r=xx&l=fr CTA World
Factbook - Version du Janvier 1, 2009)
Cluzel (J), Les pouvoirs publics et l'artisanat, Paris, L.G.D.J, 1982, 212 p.
Coffey (T), Siegel (D), Smith (M), Innovation: myths and mythstakes, Ithaca, Paramount
Market Pub, 2009,251 p.
Conférence européenne de l'artisanat et des petites entreprises (2e : 1994 : Berlin,
Allemagne), L'artisanat et les petites entreprises : clés de la croissance, de
l'emploi et de l'innovation : actes de la Conférence de Berlin, Bruxelles,
commission européenne, 1997, 66 p.
Campinos (M) et Marry (C) « De l'utilisation d'un concept empirique : la qualification.
Quel rapport à la formation ? », dans Tanguy (L) (dir.), L'Introuvable relation
formation/emploi : un état des recherches en France, Paris, La Documentation
Française, 1986, p. 197-232.
Conjard (P), Devin (B) dirs., La professionnalisation: acquérir et transmettre des
compétences, Lyon, ANACT, 2007, 159 p.
Conso (P) et Hémici (F), L'entreprise en 20 leçons : stratégie, gestion, fonctionnement,
Paris, Dunod, 2003, 458 p.
Comeloup (J), «Comment est abordée la question de l'innovation dans les sciences
sociales ?», Revue de géographie alpine, n° 97-1, 2009, p 1-17.
Coronio (G), Commerce et artisanat, Paris, C R U , Centre de recherche d'urbanisme, 1971,
207 p.
Courlet (D), Territoires et régions : les grands oubliés du développement économique,
Paris, L'Harmattan, 2002, 134 p.
Courlet (D) et Abdelmalki (L), Les nouvelles logiques du développement, Paris,
L'Harmattan, 1996,416 p.
D'Iribarne (P), La logique de l'honneur : gestion des entreprises et traditions nationales,
Paris, Seuil, 1989.279 p.
Dardy (C) et Fretigné (C), L'expérience professionnelle et personnelle en questions, Paris,
L'Harmattan, 2007, 263 p.
310
De Witte (s) et al., La compétence : mythe construction ou réalité ?, Paris, L'Harmattan,
1994,230 p.
Deakins (D) et Freel (M), Entrepreneurship and Small Firms, London: McGraw-Hill, 2009,
332 p.
Deauvieau (J), Terrail (J.P) et Bautier (E), Les sociologues, l'école et la transmission des
savoirs, Paris, Dispute, 2007, 329 p.
Descarpentries (J-M) et Korda (Ph), L'entreprise réconciliée : comment libérer son
potentiel économique et humain, Paris, Albin Michel, 2007, 253 p.
Delbos (G) et Jorion (P), La transmission des savoirs, Paris, La Maison des sciences de
l'homme, 1990, 310 p.
Denieuil (P-N), Cultures et société : Itinéraires d'un sociologue, Paris, L'Harmattan, 2008,
289 p.
Denervaud (I), Chatin (O), L'ADN de l'entreprise innovante : Comment accroître les
capacités créatives des entreprises, Paris, Pearson, 2009, 224 p.
Deprez (A), «Compétences et qualifications : mise en perspective et positions d'acteurs», Discussion Papers, n° 208, 2002, 48p. http://www.iwcps.be/repositorv/Piiblication/p discussion papers 02 08/247/dpO 208.pdf
Deschamps (J.PH), «Innovation and Leadership», dans Shavinina (L.V) (dir), The
International Handbook on Innovation, Oxford, Pergamon, 2003, p. 815-830.
Deschamps (J-Ph), Innovation Leaders: How Senior Executives Stimulate, Steer and
Sustain Innovation, Chichester, Hoboken, 2008, 433 p.
(DeSeCo), The defninition and selction of key competencies, 2005, 20 p.
http://www.occd.org/dataoccd/47/61/35070367.pdf
Dion (G), Dictionnaire canadien des relations professionnelles, Québec, les presses de
l'Université Laval, 1986, 993p.
Dobré (M) et Juan (S) dirs., Consommer autrement : la réforme écologique des modes de
vie, Paris, L'Harmattan, 2009, 317 p.
Dosi (G), «Sources, Procedures, And Microeconomic Effects of Innovation», Journal of
Economie Literature, n° 26, 1988, p. 1120-1171.
Dubar (C), «La sociologie du travail face à la qualification et à la compétence», sociologie
du travail, n° 2, 1996, p. 179-193.
311
Dubar (C), La socialisation : construction des identités sociales et professionnelles, Paris,
Armand Colin, 2006, 255 p.
Dubé (A), Mercure (D), Les entreprises et l'emploi. Les nouvelles formes de qualification
du travail, Sainte-Foy, Les éditions du Québec, 1997, 189 p.
Dubois (J) et al., Grand dictionnaire étymologique & historique du français, Paris,
Larousse, 2005, 1254 p
Ducre (H.M), The Entrepreneurial Spirit, Los Angeles, Taylor-Brooke Media., 2005, 172
P-
Durand (J.P) et Weil (R), sociologie contemporaine, Paris, Vigot, 1997, 248 p.
Durand-Prinborgne (C) et al., Dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la
formation, Paris, Retz, 2005, 1160 p.
Dyson (K), Small and Medium Sized Enterprise, New York, MyiLibrary, 2007, 135p.
Emerson (R), «Le travail de terrain après Hughes : Continuités et changements», sociétés
contemporaines, n° 27 , 1997, p. 39-48.
Etienne-Nugue (A), L'artisanat, Paris, Unesco, NANEditions, 2008, 47 p.
Evans (K), Hodkinson (PH) et Unwin (L), Working to Learn: Transforming Learning In
The Workplace, London, Taylor & Francis e-Library, 2004, 246 p.
Faroqhi (S) et Deguilhem (R), Crafts and Craftsmen of The Middle East: Fashioning the
Individual In The Muslim Mediterranean, London, I.B. Tauris, 2005, 380 p.
Farr (J-R), Artisans in Europe 1300-1914, Cambridge, Cambridge University Press, 2000,
304 p.
Ferrier (O), Les très petites entreprises, Bruxelles, De Boeck, 2002, 354 p.
Fook (J), Ryan (M) and Hawkins (L), Professional Expertise: Practice, Theory and
Education for Working in Uncertainty, London, Whiting & Birch, 2000, 284 p.
Fortun (R) et Foumier (P), « La qualité», dans Durand -Prinborgne (C) et al., Dictionnaire
encyclopédique de l'éducation et de la formation, Paris, Retz, 2005, p 879.
Foumier (C) et Picard (Ch), «Caractérisation de l'artisanat et de la petite entreprise», dans
Boutillier (S), David (M) et Foumier (C) dirs., Traité de l'artisanat et de la petite
entreprise, Paris, Educaweb, 2009, p. 17-38.
Francq (B) et Maroy (CH), Formation et socialisation au travail, Bruxelles, De Boeck et
Larcier, 1996,212 p.
312
Freel (M. S), «Do Small Innovating Firms Outperform Non-Innovators? », Small Business
Economics, n° 3, 2000, p.195-210.
Freel, (M. S) et Robson (P. A), «Small Firm Innovation, Growth and Performance », Small
Business Economics, n° 6, 2004, p. 561-575.
Freeman (Ch.), «A quoi tiennent la réussite ou l'échec des innovations dans l'industrie?»,
culture technique, n° 18, 1989, p. 30-39.
Freeman (Ch.), The economics of industrial innovation, Cambridge, Mass.: MIT Press,
1982,250 p.
Gagnon (P.D), L'entreprise : vision globale et mondialisation, Montréal, G. Morin, 2005,
354 p.
Gamsoré (F.L), Productivité et croissance dans les entreprises et les organisations, Paris,
L'harmattan, 2006, 92 p.
Gardi (R), Artisans africains, Paris, Elsevier Sequoia, 1971, 243 p.
Garelli (P) et al, L'homme et ses métiers : histoire générale du travail, préhistoire et
antiquité, Tome 1, Paris, Nouvelle librairie, 2000, 650 p.
GATT, Tunisie / Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, Genève, GATT,
1994.
Glaser (B) et Strauss (A), La découverte de la théorie ancrée ; stratégies pour la recherche
qualitative, Paris, Armand colin, 2010, 409 p.
Godelier (E), «La culture d'entreprise : Notion effective ou Oxymoron ?», dans Sardas (J-
C), Giauque (D) et Guenette (A.-M) dirs., Comprendre et organiser : quels
apports des sciences humaines et sociales, Paris, L'Harmattan, 2008, p. 65-87.
Goffman (E), Behavior in Public Places: Notes on The Social Organization of Gatherings,
Glencoe, The Free Press, 1963, 248 p.
Goffman (E), Les cadres de l'expérience, Paris, Minuit, 1974, 573 p.
Golvin (L), Aspects de l'artisanat en Afrique du Nord, Paris, P.U.F, 1957, 234 p.
Gordon (R), «Les entrepreneurs, l'entreprise et les fondements sociaux de l'innovation»,
Sociologie du travail, n° 1, 1989, p. 107-124.
Coronio (G), Commerce et artisanat, Paris, CRU, Centre de recherche d'urbanisme, 1971,
207 p.
313
Guay (L), « Le développement durable en contexte historique et cognitif», dans Guay (L) et
al., Les enjeux et les défis du développement durable; connaître, décider, agir,
Québec, Presses de l'Université Laval, 2004, p. 1-36. 370 p.
Guay (L) et al., Les enjeux et les défis du développement durable; connaître, décider, agir,
Québec, Presses de l'Université Laval, 2004, 370 p.
Guédez (A), Compagnonnage et apprentissage, Paris, PUF, 1994, 195 p.
Guen (M), Les défis de la Tunisie: une analyse économique, Paris, L'Harmattan, 1988, 254
P-
Hassan (F), Tunisia: understanding successful socioeconomic development, Washington
DC, World Bank, 2005, 100 p.
Haut conseil de la coopération internationale ' avec le soutien de l'Agence française de
développement, La très petite entreprise : promouvoir un acteur essentiel des
économies en développement, Paris, Karthala, 2004, 181p.
Hofstede (G), Cultures and Organizations: Software of The Mind, New York, McGraw-
Hill, 1991,279 p.
Hughes (E.Ch), Le Regard sociologique : essais choisis, Paris, É.H.S.S, 1996, 344 p.
Humbert (R) et Drogou (M-J), Le temps des artisans, Paris, Hier et demain, 1980, 316 p.
Ibn Khaldûn (A), Discours sur l'histoire universelle. Al-Muqaddima, traduction nouvelle,
préface et notes par Monteil (V), Paris : Sindbad, 1978, 1426 p.
INS (Institut National des Statistiques de la Tunisie) : http://www.ins.nat.tn/indexfr.php
consulté le 02 mars 2010.
Jacques-Jouvenot (D) et Shepens (F), «La transmission des savoirs professionnels : enjeux
méthodologique et théorique», dans Burnay (N) et Klein (A) dirs. , Figures
contemporaines de la transmission, Namur, P.U.M, 2009, p. 333-345.
Jacques-Jovenot (D), «La place de l'élu dans la transmission professionnelle», dans Dardy
(C) et Fretigné (C) dirs., L'expérience professionnelle et personnelle en questions,
Paris, L'Harmattan, 2007, p. 155-168.
Jaeger (C). Artisanat et capitalisme : l'envers de la roue de l'histoire, Paris, Payot, 1982,
314 p.
Jaeger (Ch); Pouchol (M); Michèle (S), «L'artisanat en évolution : l'exemple de trois
métiers», Revue d'économie industrielle, n° 1, 1985, p. 58-70.
314
Jaouen (A), «Les stratégies d'alliances des TPE artisanales», Revue internationale P.M.E.,
Vol. 19, n° 3-4, 2006, p. 111-136.
Jasmin (C), Les artisans créateurs, Montréal, Lidec, 1967, 118 p.
Jonnaert (Ph), compétences et socioconstructivisme : un cadre théorique, Bruxelles, De
Boeck, 2002, 97 p.
Joras (M), Le bilan de compétences, Paris, PUF, 2001, 127 p.
Jorda (H), « Les recompositions de l'artisanat : des corporations à la première entreprise de
France» dans Boutillier (S), et Foumier (C) dirs., Artisanat : la modernité
réinventée, Paris, L'Harmattan, 2006, p. 39-53.
Jouffroy (G), «Le sens de l'artisan» Constructifi n°9, 2004,
http://www.constructif.fr/Article_24_36_223/Le_sens_de_l_artisan.html (consulté
le 08/02/2010)
Julien (P.A) et Marchesnay (M), «Les entreprises de l'artisanat», dans Julien (P.A) et
Marchesnay (M), La petite entreprise, Boucherville, G. Vermette, 1988, p. 85-
101.
Julien (P.A) et Marchesnay (M), La petite entreprise, Boucherville, G. Vermette, 1988,
288 p.
Julien (P-A) et Morin (M), Mondialisation de l'économie et PME québécoises, Sainte-Foy,
Presses de l'Université du Québec, 1995, 204 p.
Kalb (D), «Localizing flows. Power, paths, institutions and network», dans Kalb (D) and
Van der Land (M), The Ends of Globalization. Bringing Society Back In, Lanham,
Rowman & Littelfield, 2000, p. 1-32.
Katz (R-L), Skills of an effective administrator, Harvard Business Review, Vol. 51, 1974.
Khalfaoui (Z), «Spécificités de la petite entreprise et effets socio-économiques de son
ancrage territorial, le cas des entreprises à statut artisanal», dans Abedou (A) et
al., De la gouvernance des PME-PMI : regards croisés France-Algérie, Paris,
L'Harmattan, 2006, p. 131-147.
Kharraz (A), Étude sur les activités artisanales de la céramique en Tunisie, Tunis, ONA,
2007, 300 p.
King (S.J), Liberalization Against Democracy: the local politics of economic reform in
Tunisia, Bloomington, Indiana University Press, 2003, 161 p.
315
Kizaba (G), « L'artisanat au monde de l'entrepreneuriat», dans Boutillier (S), et Foumier
(C) dirs., Artisanat : la modernité réinventée, Paris, L'Harmattan, 2006, p. 73-99.
Kolter (Ph), Marketing management, Toronto, Pearson Prentice Hall, 2009, 774 p.
Krim (N) et Hafsi (T), La stratégie nationale de la Tunisie de 1881 à 1991, Montréal,
C.E.A.I, 1995,224 p.
Labruffe (A), Le savoir-être! : un référentiel professionnel d'excellence, La Plaine Saint-
Denis, AFNOR, 2008, 250 p.
Labruffe (A), Les nouveaux outils de l'évaluation des compétences, La Plaine Saint-Denis,
AFNOR, 2009, 318 p.
Labruffe (A), Seniors : talents et compétences dans l'entreprise, Paris, Afnor, 2007, 174 p.
Lallemand (D), Les défis de l'innovation sociale, Paris, ESF, 132 p.
Lallement (M), «L'entreprise est elle une institution?», Revue Française de Socio-
économie, n°l , 2008, p. 67-87.
Laloire (M), (Les) Professions artisanales et leur rôle social, Tournai, Casterman, 1944,
179 p.
Lam, (A), «Organizational Innovation», dans Fagerberg ( J), Mowery (D) et Nelson (R)
dirs., The Oxford Handbook of Innovation, Oxford: Oxford University Press, 2005
p.l 15-147.
Landau (A), La globalisation et les pays en développement : Marginalisation et espoir,
Paris, Harmattan, 2006, 195 p.
Larbi (T), «Relations Europe-Maghreb. La question des investissements directs», Tiers-
Monde, , n°136, 1993, p. 927-935.
Lave (J) et Wenger (E), Communities Of Practice, Cambridge, Cambridge
University Press, 1999,318 p.
Le Breton (D), L'interactionnisme symbolique, Paris, PUF, 2008, 249 p.
Le Boterf (G), Compétence et navigation professionnelle, Paris, Éditions d'Organisation,
2000, 332 p.
Le Boterf (G), Construire les compétences individuelles et collectives, Paris, Éditions
d'organisation, 2001, 217 p.
316
Le Boterf (G), De la compétence : essai sur un attracteur étrange, Paris, Éditions
d'Organisation, 1994. 175p.
Le Boterf (G), Professionnaliser : le modèle de la navigation professionnelle, Paris,
Eyrolles, Éditions d'Organisation, 2007, 142 p.
Le Masson (P), Weil (B) et (A) Hatchuel, Les processus d'innovation, conception
Innovante et croissance des entreprises, Paris, Hermès Lavoisier, 2006, 471 p.
Le Roux (S), « L'artisanat est-il l'avenir du système industriel? vers une théorie de
l'artisanation», dans Boutillier (S), et Foumier (C) dirs., Artisanat : la modernité
réinventée, Paris, L'Harmattan, 2006, p. 55-71.
Le Roy (F), «Agressivité concurrentielle, taille de l'entreprise et performance», Revue
internationale P.M.E., Vol. 14, N° 2, 2001 , p. 67-84.
Lecerf (M), Les petites et moyennes entreprises face à la mondialisation, Paris,
L'Harmattan, 2006, 322 p.
Lefebvre (S) et al., «Transmission et vieillissement au travail», Vie et Vieillissement, 2003,
n°l-2, p. 67-76.
Leifer (R) et al., Radical Innovation: How Mature Companies Can Outsmart Upstarts,
Harvard Business Press, 2000, 280 p.
Lemarchand (Ph), La mondialisation, Neuilly-sur-seine, Atlande, 2009, 200 p.
Levy-Leboyer (C), La gestion des compétences, Paris, Éditions d'organisation, 2001, 165
P-
Ley (H), L'Artisanat entité corporative, Paris, Dunod, 1938, 223 p.
Lhuillier (J-N), «Innover, c'est faire du nouveau. Une voix de définition et d'évaluation de
la nouveauté», dans Boutillier (S) et Uzunidis (D) dirs., La gouvernance de
l'innovation. Marché et organisations, Paris, L'harmattan, 2007, p. 33-53.
Lichtenberger (Y), «Compétence, compétences», dans Allouche (J) dir., Encyclopédie des
ressources humaines, Paris, Vuibert, 2003, p. 203-213.
Lichtenberger (Y), «La compétence comme prise de responsabilité», dans Club CRIN,
Entreprise et Compétence : le sens des évolutions, Paris, Les cahiers du club
CRIN, 1999, p. 69-85.
Likert (R), New Patterns of Management, New York, McGrawHill, (1961,279p.
317
Livio (D), « De l'artisan à l'entreprise artisanale», Constructif, n° 9, 2004.
http://www.constructif.fr/Article 24 36 222/Dc 1 artisan a 1 entreprise artisan
aie.html
Lohisse (J), La communication : de la transmission à la relation, Bruxelles : De Boeck,
2007, 223 p.
Loup (S), «Les petites entreprises de métiers d'art», Revue française de gestion, 2003, n°
144, p. 195-209.
Lowe (R) et Marriott (S), Enterprise: entrepreneurship and innovation: concepts, contexts
and commercialization, Amsterdam, Butterworth-Heinemann, 2006, 444 p.
Marchesnay (M), «Is small so beautiful ?», Revue d'économie industrielle, 1982, n° 1, p.
110-114.
Marchesnay (M), «La petite entreprise : sortir de l'ignorance», Revue française de gestion,
2003, n° 144, p. 107-118.
Marchesnay (M), « L'artisanat dans un monde hypermoderne», Constructif, n°9, 2004.
http://www.constructif.fr/Article 24 36 219/L artisanat dans un monde hyper
modcrne.html
Marcq (J), «L'engagement des salariés dans la TPE, en particulier dans l'artisanat»,
Humanisme & Entreprise, n°284, 2007, p. 3-4.
Martinet (A-CH), «Stratégie et innovation», dans Mustar (PH) et Penan (H) dirs.,
Encyclopédie de l'innovation, Paris, Economica, 2003, p. 27-48.
Martinet (A-CH) et Silem (A), Lexique de gestion, Paris, Dalloz, 2005, 625 p.
Masmoudi (M), Tunisie : l'artisanat créateur, Tunis, CERES-Production, 1983, 95 p.
Mattelart (A), Diversité culturelle et mondialisation, Paris, La Découverte, 2005, 122 p.
Mayoukou (C) et Ratsimbazafy (C) dir., Entrepreneurial et innovation, Paris, L'Harmattan,
2007,413 p.
Mercure (D) (dir.), L'analyse du social : les modes d'explication, Québec, P.U.L, 2005, 320
P-
Mercure (D) (dir.), Une société-monde? : Les dynamiques sociales de la mondialisation,
Québec, P.U.L, 2001,335 p.
Mercure (D) et autres, La signification du travail : nouveau modèle productif et ethos du
travail au Québec, Québec, P.U.L, 2010, 290 p.
318
Mercure (D), «Une société monde?», dans Mercure (D) dir, Les dynamiques sociales de la
mondialisation, Québec, P.U.L et De Boeck Université, 2001, p. 9-16.
Mercure (D),Le travail déraciné. L'impartion flexible dans la dynamique sociale des
entreprises forestières du Québec, Montréal, Boréal, 1996, 232 p.
Merland (L), Kader (M) et Wolski (M), Les métiers de l'artisanat, Paris, L'Etudiant, 1994,
189 p.
Merlin-Brogniart (C) dir., Développement durable et responsabilité sociale des acteurs,
Paris, L'Harmattan, 2009, 231 p.
Mestiri (E), La Tunisie, Paris, Karthala, 1995, 193 p.
Michelet (CH.A), Qu'est-ce que la mondialisation? : Petit traité à l'usage de ceux et celles
qui ne savent pas encore s'il faut être, Paris, La Découverte, 2004, 211p.
Miles (M.B) et Huberman (A.M), Analyse des données qualitatives, traduit par Hlady
Rispal (M), Bruxelles, De Boeck, 2003, 623 p.
Mintzberg (H), Structure et dynamique des organisations, éd des organisations, 12eme
tirage, 1998, Paris, 432p.
Mohr (L. B), «Determinants of Innovation in Organizations», The American Political
Review, vol. 63, 1969, p. 111-126.
Morrisson (Ch), La croissance de l'économie tunisienne en longue période, Paris, OCDE,
1996, 149 p.
Moscovici (S), La société contre nature, Paris, UGE, 1972, 444 p.
Mottis (N) dir., L'art de l'innovation, Paris, L'Harmattan, 2007, 266 p.
Mouro (F) et Wolff (Ph), L'homme et ses métiers: histoire générale du travail, l'âge d'or
de l'artisanat, Tome 2, Paris, Nouvelle librairie, 2000, 617 p.
Musca (G), «La construction de compétences dans l'action», Revue Française de gestion,
n°147, 2007, p. 93-113.
Mustar (PH) et Penan (H) dirs., Encyclopédie de l'innovation, Paris, Economica, 2003,749
P-Naville (P), Essai sur la qualification du travail, Paris, librairie Marcel Rivière, 1956, 148
P-Nahavandi (F), Globalisation et néolibéralisme dans le tiers-monde, Paris-Montréal,
L'harmattan, 2000, 237 p.
319
Nederveen Pieterse (J), Globalization And Culture: Global Melange, Lanham, Rowman &
Littlefield Publishers, 2003, 149 p.
Nowicki (J), Oustinoff (M) et Proulx (S), L'épreuve de la diversité culturelle, Paris, CNRS
Editions, 2008, 262 p.
OCDE, Mesurer l'innovation : Un nouveau regard, Version en ligne, OCDE.org, http://www.occd.Org/documcnt/25/0.3343.fr 41462537 41454856 45215001 1 1 1 1.00&&cn-USS 01DBC.html, consulté le 29/11/2010, 128p.
Oiry (E), «Qualification et compétence deux sœurs jumelle», Revue française de gestion, n°
158, 2005, p. 13-34.
Oiry (E), De la qualification à la compétence, rupture ou continuité ?, Paris, L'Harmattan,
2003,330 p.
ONA, Site officiel, http://www.onat.nat.tn/
Osty (F), Sainsaulieu (R) et Uhalde (M), Les mondes sociaux de l'entreprise, Paris, La
Découverte, 2007, 398 p.
Pacitto, (J-C) et Richomme-Huet (K), A la recherche de l'entreprise artisanale, lème
Congrès International Francophone en Entrepreneurial et PME, 27, 28 et 29,
Montpellier, 2004, 16p. http://web.hec.ca/airepme/images/File/2004/064.pdf,
consulté le 07 février 2010.
Panhuys (H), Zaoual (H) dirs., Diversité des cultures et mondialisation : Au-delà de
l'économisme et du culturalisme, Paris, L'Harmattan, 2000, 214 p.
Paradeise (C) et Lichtenberger (Y), «Compétence, compétences», Sociologie du travail, n°
43, 2001, p. 33-48.
Parlier (M), «Qualification et compétence», dans Abouche (J), Encyclopédie des ressources
humaines, Vuibert, Paris, 2003, p. 216-223.
Peretti (J-M), Dictionnaire des ressources humaines, Paris, Vuibert, 2005, 277 p.
Patruel (R) et Richomme-Huet (K), «Le devenir de l'activité artisanale passe-t-il par
l'activité entrepreneuriale», Revue d'entreprenariat, n° 1, 2007, p. 29-52.
Peretz, (J-C), L'outil et le compagnon, Paris, J.-C. Godefroy, 2004. 127 p.
Périlleux (T), «La transmission au travail», dans Burnay (N) et Klein (A), Figures
contemporaines de la transmission, Namur, P.U.M, 2009, p. 315-331.
Perkins (K), A History Of Modem Tunisia, Cambridge, New York, Cambridge University
Press, 2004, 249 p.
320
Perret (J.F), Apprendre un métier : dans un contexte de mutations technologiques,
Fribourg, Editions Universitaires de Fribourg, 2002, 200 p.
Perspective Monde, Tunisie, 2010, http://pcrspcctivc.ushcrbrookc.ca/bilan/scrvlct/BMTcndanccStatPays?languc=fr& codcPavs=TUN&codcThcme=8&codeThcmc2=l&codcStat=SL.UEM.TOTL.FE. ZS&codcStat2=x, consulté le 02 mars 2010.
Picard (CH), «La représentation identitaire de la TPE artisanale», Revue internationale
P.M.E., Vol. 19, n°3-4, 2006 , p. 13-49.
Picard (CH), Catherine (T-P), «La reprise de l'entreprise artisanale : spécificités au
processus et condition de sa réussite», Revue internationale P.M.E., Vol. 17, n° 2,
2004, p. 93-121.
Pinard (R), La révolution du travail : de l'artisan au manger, Paris, Liber, 2008, 437 p.
Piore (J-M) et Sabel (Ch,F), Les chemins de la prospérité : de la production de masse à la
spécialisation, Paris, Hachette, 1984, 441 p.
Piotet (F) et Sainsaulieu (R), Méthode pour une sociologie de l'entreprise, éd presses de la
fondation nationale des sciences politiques et agences nationales pour
l'amélioration des conditions du travail, Paris, 1994, 377 p.
Poinssot (L) et Revaut (J), Tapis Tunisiens, Paris, Horizons de France, 1957, 91 p.
Polge (M) et Fourcade (C), «Le développement de l'entreprise artisanale comme vecteur
d'innovation», Humanisme et entreprise, n°280, 2006, p. 25-41.
Polge (M) et Fourcade (C), Les TPE artisanale en devenir, Cahier de l'ERFI, Vol. 12, n°3,
2005,15 p.
Polge (M), «Diversité des entreprises artisanales en développement», Revue management et
avenir, n°18, 2008, p. 133-146.
Polge (M), «Le développement incrémental de l'entreprise artisanale : La tradition comme
levier d'innovation?», Gestion 2000, n° 2, 2008, p. 131-145.
Polge (M), «Les stratégies entrepreneuriales de développement. Le cas de l'entreprise
artisanale», Revue française de gestion, n° 185, 2008, p. 125-140.
Porter (M.E) et Shawb (K), Global competiveness report 2008-2009, Genève, World
Economie Forum, 2008, 500 p.
Rainbird (H), Fuller (A) et Munro (A), Workplace learning in context, London-New York,
Routledge, 2004, 314 p.
321
Ramé (L et S), La formation professionnelle par apprentissage : état des lieux et enjeux
sociaux, Paris, L'Harmattan, 1995, 293 p.
Revault (J), Arts traditionnels en Tunisie, Tunis, ONA, 1967, 143 p.
Reynier (A), Progrès technique et innovation, Rosny, Bréal, 2008, 126 p.
Reynaud (J.D), «Le management par compétence : un essai d'analyse», sociologie du
travail, n° 1,2001, p. 7-31.
Ripert (P), Le compagnonnage : histoire, légendes et traditions des compagnons, Paris,
Editions De Vecchi, 2005, 126 p.
Robert (M) et Durand (M), Les artisans et les métiers, Paris, PUF, 1999, 127 p.
Rocher (G), «Mondialisation : un phénomène pluriel», dans Mercure (D) dir., Les
dynamiques sociales de la mondialisation, sous la direction de Daniel Mercure,
Québec, P.U.L et De Boeck Université, 2001, p. 17-31.
Rochet (C), L'innovation est une affaire d'état : gagnants et perdants de la troisième
révolution industrielle, Paris, L'Harmattan, 2007, 418 p.
Rogers (E.M et Kim (J-I), « Diffusion of Innovation in Public Organizations» dans Merritt
(R.L) et Merritt (AJ), Innovation in the Public Sector, London, SAGE
Publications, p.85-108.
Romelaer (P), «Innovation et contraintes de gestion», dans Alter (N), Les logiques de
l'innovation, Paris, La Découverte, 2002, p. 65-104.
Rosende, (M), La compétence contre la qualification, Solidarités, 2001, n°120, p. 128-
129.
http://www.solidaritcs.ch/indcx.php?action=2&id=22&num=120&db version=l
Rossel (P) et al., Demain l'artisanat, Paris, PUF, 1986, 277 p.
Ruano-Borbalan (J-C) et Allemand (S), La mondialisation, Paris, Le Cavalier bleu, 2008,
127 p.
Sainsaulieu (R), L'identité au travail : les effets culturels de l'organisation, Paris, Presses
de la Fondation nationale des sciences politiques, 1985, 460 p.
Sainsaulieu (R), Sociologie de l'organisation et de l'entreprise, Presses FNSP-
Dalloz, Paris, 1997,476p.
322
Saint-Pierre (J) et Mathieu (C), «Le rôle de l'entrepreneur et de l'environnement interne sur
l'innovation de produits dans le PME», dans Mayoukou (C), Ratsimbazaf (C)
dirs., Entrepreneurial et innovation, Paris, L'Harmattan, 2007 p. 61-76.
Salmona (M), Les paysans français : le travail, les métiers, la transmission des savoirs,
Paris, L'Harmattan, 1994. 371 p.
Santelmann (P), Qualification ou compétence : en finir avec la notion d'emplois non
qualifiés, Paris, Laisons, 2002, 244 p.
Santelmann (P), «Production et transmission des savoirs : repères prospectifs», Formation
Emploi, n°76, 2001, p. 197-203.
Sarfati (F), L'entreprise autrement, Paris, L'Harmattan, 2010, 190 p.
Sassen (S), La globalisation : une sociologie, traduit par Pierre Guglielmina, Paris,
Gallimard, 2009, 341 p.
Schaller, La notion de productivité : essai critique, Genève, Droz, 1975, 99 p.
Schein (E.H), Organizational Culture And Leadership, San Francisco, Jossey-Bass, 1985,
358 p.
Schein (E.H), The Corporate Culture Survival Guide: Sense And Nonsense About Culture
Change, San Francisco, Jossey-Bass, 1999, 199 p.
Schieb-bienfait (N) et Journé-Michel (H), «Comment aborder la question de l'innovation
dans l'artisanat ?» Cahier de l'ERFI, Vol.12, 2005, n°3, p. 198-215.
Schieb-Bienfait (N) et Journé-Michel (H), «La face cachée de l'innovation : l'innovation
dans l'entreprise artisanale ou La stratégie du potier revisité», Gestion 2000, n°3,
2008, p. 107-129.
Schmookler (J), Invention And Economie Growth, Cambridge, Harvard University Press,
1966,332 p.
Scholte (J.A), Globalization: a critical introduction, New York, Palgrave Macmillan, 2005,
492 p.
Schumpeter (J. A), Théorie de l'évolution économique : recherches sur le profit, le crédit,
l'intérêt et le cycle de la conjoncture, traduction de Anstett (JJ), Paris : Dalloz,
1935,589 p.
Schumpeter (J.A), Capitalisme, socialisme et démocratie, traduit de l'anglais par Fain (G),
Paris :Payot, 1965,433 p.
323
Sennett (R), The Craftsman, New Haven, Yale University Press, 2008, 326 p.
Sethom (H), «Les artisans potiers de Moknine», Revue Tunisiennes des sciences sociales,
1964, p. 53-70.
Seymour (J), Métiers oubliés, traduit de l'anglais par Guy Letenoux, Paris, Chêne, 1985,
187 p.
Shavinina (LV), «Understanding Innovation: Introduction To Some Important Issues»,
dans Shavinina (L.V) (dir), The international handbook on innovation, Oxford:
Pergamon, 2003, p. 3-14.
Sholte (J.A), Globalization: A Critical Introduction, New York : Palgrave Macmillan,
2005, 492 p.
Short (J.R), Global dimensions: space, place and the contemporary world, London,
Reaktion, 2001, 190p.
Sidi Ahmed (A), «La crise des économies maghrébines : les politiques redistributives en
question», Tiers-Monde, n°135, 1993, p. 565-583.
Sigaut (F), «L'apprentissage par les ethnologues un stéréotype», dans Chevalier (D) dir.,
Savoir-faire et pouvoir transmettre, Paris, Édition de la maison de l'homme,
1991, p. 33-42.
Simard (C), Artisanat québécois, Montréal, Éditions de l'Homme, 1975, 576 p.
Simard (C), Des métiers : de la tradition à la création, Sainte-Foy, Editions GID, 2003,
416 p.
SIMAT, Anticipation de besoin en compétence,
http://observatoire.emploi.wallonie.be/dyn/14/fichiers/anticipa406.pdf„2005, 97
P-Simmel (G), sociologie et épistémologie, P.U.F, Paris, 1981, p 165.
Siroën (J-M), La régionalisation de l'économie mondiale, Paris, La Découverte, 2004, 123
P-
Slim (H) et Djait (H), Histoire de la Tunisie, Tunis, STD, 1976, 410 p.
Slim (H) et al., Histoire générale de la Tunisie, Tunis-Paris, Sud éditions- Maisonneuve et
Larose, 2003, Tome 1, 465 p.
Smine (R)., «L'École de Kairouan», Rue Descartes, n° 61, 2008, p. 16-23.
324
Smith (A) , An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Edinburgh,
T.Nelson, 1839,404 p.
Spurk (Jan), Une critique de la sociologie de l'entreprise : L'hétéronomie productive de
l'entreprise, Paris, L'Harmattan, 1998, 247 p.
Statistiques Mondiales, Tunisie : Statistiques, 2011.
http://www.statistiqucs-mondiales.com/tunisic.htm
Steger (M), Globalization: A Very Short Introduction, Oxford,Oxford University Press,
2003, 147 p.
Steiner (G) et Ladjali (C), Éloge de la transmission : le maître et l'élève, Paris, Albin
Michel, 2003, 141p.
Sternberg (RJ) et Wagner (R.K), Mind in Context: Interactionist Perspectives On Human
Intelligence, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, 245 p.
Strauss (A) et Corbin (J), Les fondements de la recherche qualitative : techniques et
procédures de développement de la théorie enracinée, Fribourg, Academic Press
Fribourg, 2004, 342 p.
Strauss (A), Negotiations: varieties, contexts, processes, and social order, San Francisco,
Jossey-Bass, 1978, 275 p.
Strauss (A.L), La trame de la négociation : sociologie qualitative et interactionnisme,
Paris, L'Harmattan, 1992, 319 p.
Stroobants (M), Savoir-faire et compétence au travail : une sociologie de la fabrication des
aptitudes, Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles, 1993, 383 p.
Sundabo (J), «Innovation And Strategic Refexivity : An Evoltionary Approch Applied To
Services», dans Shavinina (L-V) dir., The International Handbook On Innovation,
Oxford, Pergamon, 2003, p. 97-114.
Tehami (A), Grandeur et décadence de l'artisanat algérien, 2009.
http://www.hoggar.org/index.php?option=comcontent&task=view&id=848&Itc
mid=64,
Tehami (A), L'artisanat, une nouvelle voie de développement économique mondiale en
perspective, Genève, Haggar Institute, 2010, 4 p.
http://www.hoggar.org/index.php?option=com contcnt&task=view&id=906&rte
mid=64
325
Tehami (A), Prochaines assises de l'artisanat : Vers la lutte contre le chômage, la misère
et l'exclusion ?, 2009.
http://www.hoggar.org/index.php?option=com_content&task=view&id=804&Ite
mid=64
Tellis ( G J ) , Jaideep (CP) et Chandy (R), Radical Innovation Across Nations: The Pre
eminence of Corporate Culture, 2009, 22 p.
http://www.csom.umn.cdu/assets/l 14998.pdf
Thomas (G), Creyssel (P), Errecart (M), Rapport du Groupe de travail "Artisanat", Paris,
Documentation française, 1984, Paris, Documentation française, 1984, 143 p.
Thuderoz (CH), Sociologie des entreprises, Paris, La Découverte, 2005, 122 p.
Thwaites (J), « Autour de la mondialisation : éléments d'introduction», dans Thwaites (J)
dir., La mondialisation : origines, développements et effets, Québec, PUL, 2004,
p. 1-13.
Thwaites (J) dir., La mondialisation : origines, développements et effets, Québec, PUL,
2004,918 p.
Tillman (F), «Qu'est ce que une compétence?», Exposant neuf, 2000, n°2, p.p 28-31.
http://www.segec.be/exponeuf/pdl7n2p28.pdf
Thomas (J), Qualification professionnelle : évaluation et évolution, Eyrolles, Paris, 1991, 267 p.
Tomlinson (J), Globalization And Culture, Chicago: University of Chicago Press, 1999,
238 p.
Tônnies (F), Communauté et société : catégorie fondamentale de la sociologie pure, Paris,
Retez, 1977,285 p.
Torres (O), «Comprendre le management de l'entreprise artisanale: le rôle clé de la
proximité et de la sensorialité», dans Boutillier (S), David (M) et Foumier (C)
dirs, Traité de l'artisanat et de la petite entreprise, Paris, Educaweb, 2009, p.
363-368.
Troin (J.F) et Bisson (J) dirs., Le grand Maghreb (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie,
Tunisie) : mondialisation et construction des territoires, Paris, Colin, 2006, 383 p.
326
Uzunidis (D), L'innovation et l'économie contemporaine: espaces cognitifs et territoriaux,
Bruxelles, De Boeck, 2004, 270p.
Verhees(FJ) et Meulenberg (M.T) , «Market Orientation, Innovativeness, Product
Innovation, and Performance in Small Firms», Journal of Small Business
Management, n° 2, 2004, p. 134-154.
Vultur (M), « La mondialisation de la culture. Perspectives comparées entre le Québec et
l'Europe de l'Est », dans Baillargeon (J.P) dir., Transmission de la culture, petites
sociétés et mondialisation, Québec, PUL, 2002, p. 237-246.
Wallerstein (I), Comprendre le monde : introduction à l'analyse des systèmes-monde, Paris,
La Découverte, 2009, 173 p.
Wallerstein (I), «Le système monde en dégradation», dans Mercure (D) dir, Les
dynamiques sociales de la mondialisation, Québec, P.U.L et De Boeck Université,
2001, p. 35-44.
Willemarck (P), Innover pour durer .favoriser Tex-centricité dans l'entreprise, Bruxelles,
De Boeck, 2006, 161 p.
Winterton (J), Delamare-Le Deist (F), Stringfellow (E), Typology Of Knowledge, Skills And
Competences : clarification of the concept and prototype, Luxembourg : Office
for Official Publications ofthe European Communities, 2006, 131 p.
World Bank Country Study, Tunisia's Global Integration A Second Generation of Reforms
to Boost Growth and Employment, Washington, D.C, The world Bank, 146 p.
Wolton (D), L 'autre mondilisation, Paris, Flammarion, 2003, 211 p.
Zaghouani (F), «Le tapis à Kairouan - Une production à la baisse», La presse, Tunis, 2010.
Zaoual (H) dir., La socio-économie des territoires. Expériences et Théories, Paris,
L'Harmattan, 1998,351 p.
Zarca (B), «Identité de métier et identité artisanale», Revue française de sociologie, n° 1,
1988, p. 247-273.
Zarca (B), «Artisanat et trajectoires sociales», Actes de la recherche en sciences sociales,
n°229, 1979, p. 3-26.
Zarca (B), « Comment les artisans se représentent leurs situations sociales», Économie et
Humanisme, n° 246, 1979, p. 19-24.
Zarca (B), «L'artisanat et ses valeurs», Consommation et modes de vie, n° 14, 1986.
327
Zarca (B), «La rationalité économique des artisans», Consommation, n°l, 1982, p. 3-38.
Zarca (B), «Le cheminement professionnel des artisans», Travail et emploi, n°2, 1979, p.
83-88.
Zarca (B), « Travail familial et travail salarial : un modèle de formation du revenu des
artisans», Consommation, n° 4, 1984, p. 1-27.
Zarca (B), Les artisans, gens de métier, gens de parole, Paris, L'Harmattan, 1987, 187p.
Zarca, (B), L'artisanat français : du métier traditionnel au groupe social, Paris,
Economica, 1986, 290 p.
Zarifian (Ph), Objectif compétence, Paris, Liaisons, 1999, 229 p.
Zarifian (Ph), Le travail et la compétence : entre puissance et contrôle, Paris, P.U.F, 2009,
184 p.
Zartman (W), Tunisia: The Political Economy Of Reform, Boulder, Colo, L. Rienner, 1991,
267 p.
Zghal (R), gestion des ressources humaines : les bases de la gestion prévisionnelle et de la
gestion stratégique, Tunis, C.P.U, 2000, 228 p.
Zghal (R), «L'union du Maghreb arabe et la mondialisation», dans Bemier (R) dir., Réalités
nationales et mondialisation, Québec, PUQ, 2006, p. 167-206.
328
Annexe 1: Conseil National de l'Artisanat Création
• Loi n°2005-14 du 16 février 2005 relative à l'organisation du secteur des métiers (art. 18).
• Décret n° 2005-3152 du 6 décembre 2005, fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil national de l'artisanat.
• Décision ministérielle du 13 février 2008
Missions
Le conseil national dc l'artisanat est chargé notamment de :
• Participer à établir les choix nationaux en matière d'artisanat, • Evaluer la contribution du secteur de l'artisanat dans le développement
économique, social et culturel, • Assurer le suivi des principales orientations, d'exécuter les plans et de fixer les
priorités conformément au développement et à la promotion de l'artisanat, • Donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le président du
conseil et se rapportant aux activités artisanales.
Nomination des membres du Conseil Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat sur proposition des ministères et des organismes concernés. Le président du conseil peut faire appel à toute personne compétente pour assister aux travaux du conseil avec voix consultative. Le conseil national de l'artisanat est composé comme suit :
• Le ministre du commerce et de l'artisanat ; président, • Un représentant du Premier ministère : membre, • Un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local : membre, • Un représentant du ministère de l'éducation et de la formation : membre, • Un représentant du ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes
: membre, • Un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale :
membre, • Un représentant du ministère des finances : membre, • Un représentant du ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et
des personnes âgées : membre, • Un représentant du ministère de l'environnement et du développement durable :
membre, • Un représentant du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à
330
l'étranger : membre, Un représentant du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine : membre, Un représentant du ministère du tourisme : membre, Un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie : membre, Un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises : membre, Un représentant de l'office national de l'artisanat : membre, Un représentant de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle : membre, Un représentant du centre de promotion des exportations : membre, Un représentant de l'union nationale de la femme tunisienne : membre, Un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : membre, Un représentant de l'organisation de la défense du consommateur : membre, Un représentant de la fédération nationale de l'artisanat : membre, Un représentant de la fédération tunisienne de l'hôtellerie : membre, Un représentant de la fédération tunisienne des agences de voyages : membre.
Les commissions techniques
Création de trois commissions techniques au sein du Conseil National de l'Artisanat :
• Commission technique de développement des ressources humaines, • Commission technique de la promotion des investissements et de la modernisation, • Commission technique de la qualité et de développement de la compétitivité.
331
Annexe 2: La Fédération Nationale de l'Artisanat Présentation de la Fédération Nationale de l'Artisanat
Représentant le secteur de l'artisanat traditionnel et les métiers d'art en Tunisie, la fédération nationale de l'artisanat regroupe actuellement 13 chambres syndicales nationales représentatives des activités artisanales les plus répandues, ct allant du tissage traditionnel à la taille de la pierre.
La fédération dispose, sur le plan régional, d'un réseau de con-espondants en la personne des membres des bureaux exécutifs chargés de l'artisanat et relevant des unions régionales de l'UTICA, ainsi que d'une base constituée par les 200 chambres régionales.
La Fédération Nationale de l'Artisanat a pour principales missions :
• La représentation des opérateurs du secteur de de l'artisanat et des métiers d'art en Tunisie, qui comptent, selon les estimations officielles, 300.000 artisans exerçant dans une centaine d'activités artisanales répertoriées.
• La défense des intérêts professionnels, économiques et sociaux des artisans • La contribution au développement et à la promotion du secteur artisanal en Tunisie. • L'élaboration et le pilotage des études et autres recherches touchant le secteur • La contribution à la mise à niveau du dispositif de la formation professionnelle
Liste des Chambres syndicales Nationales Relevant de la Fédération Nationale de L'Artisanat
La Chambre Nationale de la Poterie et de la Céramique Artisanale La Chambre Nationale des Artisans -Bijoutiers La Chambre Nationale du Tapis et Tissage Ras La Chambre Nationale du Tissage Traditionnel La Chambre Nationale de L'Habit Traditionnel La Chambre Nationale des Artisans Créateurs La Chambre Nationale des Commerçants d'Artisanat La Chambre Nationale des Commerçants Bijoutiers La Chambre Nationale du Cuivre Artisanal La Chambre Nationale de la Sculpture sur Pierre La Chambre Nationale de la Chachia La Chambre Nationale de la Décoration sur Verre La Chambre Nationale du Bois Artisanal et des Fibres Végétales
332
Annexe 3: Le conseil des métiers Création
Loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du secteur des métiers (Art. 20 et 23)
Missions
Le conseil des métiers veille à la promotion des activités de métiers ainsi qu'à la sauvegarde de l'aspect urbanistique et architectural des souks et de leur spécialisation, et ce, en formulant des propositions de nature à :
• Identifier les souks et les activités qui peuvent y être exercées ; • Elaborer les programmes de formation pour les activités de métiers ; • Inciter l'emploi et l'investissement et promouvoir l'exportation des produits du
secteur ; • Repérer les modèles à déposer auprès de l'Institut National de Normalisation et de
Propriété Industrielle ; • Protéger les activités de l'artisanat menacées de disparition ; • Procéder à des études qui concernent des activités relevant de son domaine de
compétence ;
Le conseil des métiers émet aussi d'une façon générale tout avis sur les questions qui intéressent le secteur et sur tous les autres sujets dont il est saisi par les autorités compétentes. Le conseil des métiers peut s'ériger en conseil de discipline en vue d'examiner les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prises à l'encontre de l'aminé de la profession.
333
Annexe 4:Centre Technique de Création, d'Innovation et d'Encadrement du Tapis et du Tissage Création
• Loi n°2006-60 du 14 Août 2006 relative aux centres techniques de création, d'innovation et d'encadrement dans le secteur artisanal.
• Arrêté du 2007 du Ministère du commerce et de l'artisanat
Missions Les centres techniques de création, d'innovation et d'encadrement dans le secteur artisanal assurent, outre leurs missions spécifiques fixées par leurs statuts, notamment les missions suivantes :
1. Encourager la création et la rénovation en sauvegardant l'originalité et le patrimoine national,
2. Encadrer et assister les artisans pour développer les méthodes de travail, améliorer la qualité des matières premières et les diversifier, agir dans le sens de la maîtrise des coûts, procéder aux travaux de publicité et d'information pour faire connaître les créations, assister les artisans à les exploiter et les commercialiser, ainsi que l'organisation d'ateliers annuels.
3. Inciter à l'utilisation des matières premières naturelles et des techniques permettant la protection de l'environnement et la préservation des ressources naturelles,
4. Accueillir les nouveaux projets et les encadrer durant toutes les étapes de leur création,
5. Fixer des programmes de partenariats avec les institutions d'enseignement supérieur et les centres de formation professionnels dans un cadre contractuel, et ce, pour assurer la veille scientifique et technologique du secteur y compris l'élaboration des études, des recherches et documentations dans le cadre de sa spécialisation en collaboration avec les organes spécialisés,
6. L'inventaire des ressources nationales en matières premières utilisables dans le secteur artisanal,
7. La collecte et l'analyse des informations inhérentes aux activités relevant de ses attributions,
8. Le développement et la promotion des compétences et le savoir-faire artisanal.
334
Annexe 5: Les Chambres de Commerce et d'Industrie Création
Loi n° 2006-75 du 30 novembre 2006, relative aux chambres de commerce et d'industrie (Article4)
Missions Les chambres de commerce et d'industrie contribuent dans leurs circonscriptions
territoriales à la promotion des secteurs du commerce, de l'industrie, des services, de l'artisanat ainsi qu'à la promotion des petits métiers, tels que déterminés par la législation organisant le secteur des métiers.
Les chambres de commerce et d'industrie ont pour mission de :
1. Contribuer à la promotion du secteur privé et à l'impulsion de l'initiative et de l'investissement dans les régions
2. Fournir aux autorités publiques toutes propositions, avis et informations relatifs aux secteurs et activités prévus au paragraphe 1er du présent article et concernant notamment :
3. Contribuer au renforcement des relations de coopération et de partenariat avec l'étranger
4. Assurer la formation et fournir l'information économique 5. Fournir les services destinés à l'entreprise 6. Gérer, le cas échéant, dans leurs circonscriptions un service public dans le cadre de
contrats d'exploitation. 7. Tenir le répertoire des personnes physiques et morales inscrites au registre du
commerce relevant de leurs circonscriptions territoriales.
335
Annexe 6: Fonds National de Promotion de l'Artisanat et des Petits Métiers (FONAPRAM) Pour bénéficier des avantages du FONAPRAM, les intéressés doivent :
• être des artisans ou des entreprises artisanales; • être titulaires du récépissé d'immatriculation; • obtenir une attestation de dépôt de déclaration (Article 2 de la loi 93-120 du
27/12/1993). Conditions relatif au projet :
• d'un coût égal ou inférieur à 50.000 Dinars (fonds de roulement compris). • un projet de création ou d'extension (nouveau projet). • réaliser un schéma de financement comportant au moins 40% de fonds
propres.
Schéma de financement 1) Coût du projet < 10.000 Dinar
* Apport personnel 4% * Dotation FONAPRAM 36% * Crédit bancaire 60%
2) Coût du projet compris entre 10.000 D et 50.000 D
a.Tranche d'investissement < 10.000 Dinars * Apport personnel 4% * Dotation FONAPRAM 36% * Crédit bancaire 60%
b.Tranche d'investissement additionnelle (au-delà de 10.000 D) * Apport personnel 8% * Dotation FONAPRAM 32% * Crédit bancaire 60%
3) Coût du projet compris entre 50.000 D et 100.000 D * Apport personnel 16% * Dotation FONAPRAM 24% * Crédit bancaire 60%
Taux et délais de remboursement : • dotation FONAPRAM
* Durée de remboursement 11 ans * Délai de grâce 7 ans *Taux d'intérêt 0%
• Crédit Bancaire * Durée de remboursement 7 ans * Délai de grâce 1 an ♦Taux d'intérêt 10%
336
Annexe 7: Fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielle (FOPRODI)
• Le FOPRODI est créé en 1974 selon la Loi des Finance pour la gestion de l'année 1974 • Le FOPRODI octroi des crédits allant jusqu'à 5 Million de dinars. • Les crédits FOPRODI sont octroyés aux promoteurs du secteur dc l'Artisanat dans les conditions utilisés dans le secteur de l'Industrie. Le FOPRODI finance les Investissements dans l'industrie, l'artisanat et les petits métiers et les services par le biais des différentes banques. Ce financement est réparti comme suit : 30 % fonds propre et 70 % crédit bancaire. Le fonds propre est réparti comme suit :
• 10 % Dotation propre • 60 % Dotation du Fonds • 10 % Société à capital risque • 20 % Autres associés Les dotations de l'Etat sont remboursées dans un délai de 12 ans avec un taux d'intérêt de 3 %. Dans ce cadre le promoteur bénéficie des avantages suivants :
Prime d'Etude et d'assistance technique : 70 % du coût de l'Etude (Plafonné à 20 MD).
Prime d'Investissement 10% du coût des équipements (Plafonné à 100 MD). Prime de 50 % des Investissements immatériels. Prime de 50 % des Investissements Technologiques (Plafonné à 100 MD). Prise en charge de l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité
sociale au titre des salaires versés aux employés tunisiens durant une période de cinq ans à partir de la date d'entrée en activité effective.
Cadre juridique : Décret n° 2005-165 du 26 Janvier 2005.
337
Annexe 8: Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME)
1. Activités éligibles aux financements de la BFPME : Le champ d'action de la BFPME couvre tous les secteurs de l'économie : • Secteurs nouveaux; • Secteurs classiques Toutefois, la BFPME entend apporter une contribution significative dans le financement de la création et de l'extension des projets innovants (activités relatives aux programmes pilotes d'essaimage et de développement des énergies renouvelables).
2. Limites d'intervention : L'intervention porte sur le financement de : • La création des PME dont le coût d'investissement total est compris entre 100 mille dinars et 5 millions de dinars. • L'extension des PME existantes, à condition qu'elles soient financièrement saines, et que leurs immobilisation nettes, augmentées des nouveaux investissements projetés, se situent entre 80 mille dinars et 4 millions de dinars. • La BFPME intervient exclusivement en cofinancement. • La BFPME finance l'acquisition des biens d'équipement, le génie civil et l'investissement immatériel, à la création et au niveau de l'extension.
3. Modalité d'intervention : • Financement des investissements : réalisé par l'octroi de crédits à MLT et dont le montant Max est fixé à 1 million de dinars par projet. • Financement des capitaux propres : La BFPME peut contribuer au renforcement des fonds propres des entreprises financées : a. Directement, dès la mobilisation par la BFPME d'une ligne dédiée au capital risque. b.Indirectement, en mettant au profit des promoteurs, ses relations avec les différents SICAR de la place.
338
Annexe 9 : Guide d'entrevue auprès de personnes agissant au sein des entreprises étudiées
Informations générales concernant le répondant :
Age- niveau scolaire- ancienneté dans le métier- occupation antérieur- statut dans l'entreprise
Informations relatives au vécu professionnel : La tâche
La rétribution
Les relations au travail
La satisfaction au travail
Les ambitions professionnelles
L'évolution dans l'entreprise
La relation au métier
La relation à l'entreprise
Les représentations vis-à-vis le métier
Informations relatives à la transmission des savoirs professionnels :
• L'accès au métier :
À quel âge?
Pourquoi choisir un tel métier?
Qui a guidé ce choix?
Quelles idées sur le métier avant d'y accéder?
• L'apprentissage du métier:
Avec qui?
La durée?
Quelles sont les étapes?
Comment?
Les savoirs reçus?
Les difficultés rencontrées ?
La relation avec le maître/ le novice?
339
Informations relatives à l'innovation :
• Le développement du métier :
Est-il nécessaire de développer?
Qui doit participer?
Quoi développer?
Comment développer?
• L'innovation dans l'entreprise : L'importance de l'innovation?
Son utilité pour l'entreprise?
Qui doit la faire?
Qui doit participer?
Sa réussite dépend de quoi?
Quelles dimensions innover?
• Les innovations vécues par l'entreprise :
Leurs sources?
Les acteurs de ces innovations?
Les dimensions du travail touchées par ces innovations?
Leurs apports au répondant?
Leurs apports à l'entreprise?
Leurs désavantages?
340
Annexe 10: Guide d'entrevue auprès de personnes agissant au sein des institutions étatiques se préoccupant du secteur d'entreprises artisanales
Informations générales concernant le répondant :
Age, niveau scolaire, poste occupée dans l'institution
Informations généraux relatives au métier et aux entreprises qui l'exercent :
• Le métier : Son histoire
Sa situation actuelle
Sa place dans l'économie nationale
Sa place dans l'économie régionale
Ses horizons
Ses enjeux
Ses défis
Les contraintes
• Les entreprises exerçant le métier : Le nombre
L'évolution
Les atouts
Les difficultés qu'elles rencontrent
Informations relatives aux stratégies visant la promotion et la conservation :
• La promotion des entreprises artisanales de métiers ancestraux :
L'objectif de la promotion de cette catégorie d'entreprises
Les stratégies de l'état pour cette promotion
Le rôle des entreprises dans ces stratégies
La place accordée l'innovation dans ces stratégies
Les apports de l'innovation à ce secteur d'entreprise
Les champs nécessitant l'innovation au sein de l'entreprise
La promotion de l'innovation au sein de l'entreprise
Les contraintes de l'innovation au sein de l'entreprise
341
• La conservation des métiers ancestraux :
L'objectif de la conservation des métiers ancestraux
Les stratégies de l'état pour cette conservation
Le rôle des entreprises dans ces stratégies
La place accordée à la transmission des savoirs professionnels dans ces stratégies
Les apports de la transmission des savoirs professionnels à ce type de métier
Les champs de savoirs professionnels nécessitant la transmission dans l'entreprise
La promotion de la transmission des savoirs professionnels au sein de l'entreprise
Les contraintes de la transmission des savoirs professionnels au sein de l'entreprise
342
Annexe 11: Grille d'observation
Informations générales de l'entreprise :
• Le statut juridique • L'historique • Les produits de l'entreprise • Les marchés de l'entreprise • Les chiffres clés de l'entreprise
Informations relatives au fonctionnement technique, humain, social et culturel de l'entreprise.
L'organisation du travail :
La structure de l'organisation ■ La division du travail ■ La hiérarchie de l'entreprise ■ Le système du pouvoir
Les unités organisationnelles : ■ L'organisation de l'unité ■ Le contenu du travail ■ Les relations inter unitaires
La gestion des ressources humaines :
Les outils de la gestion individuelle ■ La gestion des carrières ■ La gestion des compétences ■ La gestion des rémunérations
Les outils de la gestion collective ■ La communication interne ■ Le travail participatif
Les dynamiques socioculturelles de l'entreprise
Les dynamiques sociales ■ Le système d'acteur ■ Le système de relations ■ Le système d'intégration et de régulation sociale
Les dynamiques culturelles
343
■ La culture d'entreprise
■ L'identité au travail
Informations relatives à l'innovation dans l'entreprise :
L'innovation interne : Les objectifs Les champs concernés de l'innovation
Les sources de l'innovation
Les types de l'innovation
Les acteurs de l'innovation
Les moteurs de l'innovation
Les impacts de l'innovation
Les obstacles face à l'innovation L'innovation externe : Les objectifs
Les champs concernés de l'innovation
Les sources de l'innovation
Les types de l'innovation
Les acteurs de l'innovation
Les moteurs de l'innovation
Les impacts de l'innovation
Les obstacles face à l'innovation
Informations relatives à la transmission des savoirs professionnels dans l'entreprise
Les objectifs de la transmission
Les champs de savoirs concernés par la transmission
Les acteurs de la transmission
La durée de la transmission
Les phases de la transmission
Les moyens de la transmission
L'organisation de la transmission
Les dynamiques occasionnées par la transmission
Les contraintes de la transmission
344
Annexe 12: Les activités artisanales en Tunisie 1/Les métiers du tissage 7/Les métiers des métaux
• Filature manuelle • Teinturerie traditionnelle
Tapis de sol (tapis à points noués, klim, mergoum, grara, ktif...)
• Tapisserie murale • Couverture en laine • Tissage manuel
2/Les métiers de l'habillement
• Fabrication de la chéchia • Confection de vêtements traditionnels • Maille manuelle (dentellerie, tricot, crochet, makhermia...) • Broderie manuelle • Passementerie manuelle • Haute couture • Opération de finition de couture nécessite la qualification professionnelle
3/Les métiers du cuir et de la chaussure
• Fabrication de selles et assimilées • Maroquinerie traditionnelle • Reliure manuelle • Broderie manuelle sur cuir • Fabrication de la balgha et de
chaussures traditionnelles • Tannage traditionnel
4/Les métiers du bois
• Menuiserie traditionnelle • Taille et sculpture sur bois • Tournage traditionnel • Ajourage sur bois • Dorure
• Fabrication d'objets métalliques sculptés, mélangés, ciselés, ajourés, martelés et émaillés
• Ferronnerie d'art • Armurier • Plomberie traditionnelle • Tournage traditionnel des métaux
8/ METIERS DE L'ARGILE ET DE LA PIERRE
• Poterie artisanale • Céramique traditionnelle • Taille et sculpture sur pierres • Fabrication de bibelots en pierre • Taille et sculpture sur plâtre • Fabrication de bibelots en plâtre • Mosaïque • Taille et Sculpture sur marbre • Fabrication de bibelots en marbre ou en poudre de marbre • Brique traditionnelle • Tuile traditionnelle
9/ METIERS DE VERRE
• Fabrication d'objets en pâte de verre • Verre soufflé • Taille et sculpture sur verre
10/DIVERS
• Peinture et décoration sur tous supports • Fabrication de cages traditionnelles • Fabrication d'instruments traditionnels de musique • Calligraphie • Fabrication d'objets en cire • Fabrication de cadres • Fabrication de tamis • Fabrication de parfums • Revêtement et tapisserie de tous genres
345
5/Les métiers des fibres végétales • Fabrication de bat et d'étriers • Fabrication d'articles décoratifs
• Menuiserie traditionnelle • Fabrication de bibelots manuels • Taille et sculpture sur bois • Fabrication artisanale des jouets • Tournage traditionnel • et de poupées • Ajourage sur bois • Fabrication des lampes (lanternes) de tous • Dorure genres
• Fabrication du narguilé (chicha) 6/ METIERS D'ORFEVRERIE * Réparation d'articles artisanaux FT D 'ARCFNTFRÏF * Fabrication d'articles en ambre
Matelassure manuelle • Fabrication de bijoux • Fabrication d'articles en argent • Ciselure des bijoux et d'argenterie • Fabrication d'objets en corail • Ciselage et montage de pierres précieuses
346
Annexe 13: Les centres de production artisanale de la poterie en Tunisie
• Centre Potier
Q Capital du gouverner dt
■ C n U P o t i e r /Capital du gouvemorat
347
Annexe 15: Les centres de production de tapis artisanal en Tunisie TAPIS ET TISSAGES A TRAVERS LA TUNIS IE
Jt:rdo,.rJ;1 gJH
Zo©be ' i ; N a b e u l
• / iV i cnas r i '
M c h d i c
5aur<e : T.-i.-.:i.r.o-i ttMê&en
-
349
Annexe 19: Exemples de produits à vocation décorative et horticole
S.eî 3 2 ~
vcf 3 4 rm Ù.30 cm li:30 tn*/ï>:3î> t m ^
>xm/»:3t> t m- li:40 r m / b î ô 3 cm
iAcf 3 h:30 t m / b : 4 0 c •
9aef 3 7 3t\ ef 38 il\ef 3 0 3 0 r m / b : 3 3 tm Ij:SO t i n / b : 4 0 nu
353
p rm l;:00 cin / t i :30 tm
[ i n / » : 4 0 c m cm '"»:ôC*en
rlAcf 3 5 : 33 tili . li:30 CIII /ÏJ : -IO 4 3 cm lu4e i
. ■ : • - ■ • - • '
Ucf 3 0 h:Si?tu»/Is.SiO cm
354