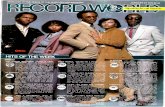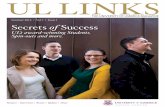médias et groupes de pression dans la - Corpus UL
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of médias et groupes de pression dans la - Corpus UL
SEIMA SOUISSI
MÉDIAS ET GROUPES DE PRESSION DANS LA FORMULATION DES POLITIQUES PUBLIQUES AU
QUÉBEC : LE CAS DE LA MODIFICATION DU PROGRAMME DES PRÊTS ET BOURSES D'ÉTUDES
Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures de l'Université Laval
dans le cadre du programme de maîtrise en communication publique pour l'obtention du grade de maître es arts (M.A)
DÉPARTEMENT D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION FACULTÉ DES LETTRES
UNIVERSITÉ LAVAL QUÉBEC
2007
(O SEIMA SOUISSI, 2007
Remerciements
Mes remerciements les plus sincères s'adressent à toutes les personnes qui m'ont soutenues jusqu'à la concrétisation de ce mémoire.
Je remercie particulièrement mon directeur de recherche, le professeur Charles Moumouni pour ses précieux conseils et ses encouragements jusqu'à l'accomplissement du travail.
Je remercie Mr Alain Lavigne et Mme Collette Brin d'avoir accepté d'être mes examinateurs.
Je voudrais de même remercier les directeurs des programmes de maîtrise et de doctorat en communication publique pour leur confiance et leur soutien.
Je tiens aussi à exprimer ma gratitude à la Mission Universitaire de Tunisie en Amérique du nord pour l'encadrement et l'assistance.
Ensuite, ma profonde reconnaissance s'adresse à mes chers parents qui n'ont cessé de m'encourager et m'ont toujours permis d'être mon propre arbitre dans les choix de ma vie.
Une pensée particulière à ma sœur Mejda, mon frère Douraid et à tous les membres de ma famille.
Merci Mourad pour avoir supporté mes sauts d'humeur, et pour m'avoir consolé toutes les fois où la charge des études et le poids de la distance ont pesé sur mon cœur.
Je voudrais aussi saluer .lihène et Slim qvii m'ont donné l'exemple de patience et d'ambition et ont su me transmettre le goût de la persévérance.
Pour terminer, une pensée affectueuse à mes camarades de parcours Emira, Samar et Asma, qui par leur compagnie ont enrichi l'expérience de ces deux années de ma vie.
Résumé
Ce mémoire traite de la question de la médiatisation des politiques publiques au Québec.
Dans la foulée des nouvelles formes de délibérations démocratiques, les groupes de
pression agissent comme des acteurs primordiaux dans la formulation des politiques
publiques. Animées par le souci de préserver leurs intérêts, ces organisations misent sur
la capacité des médias de masse à joindre et mobiliser l'opinion publique. Dans ce travail,
nous nous interrogeons sur les possibilités d'accès de ces groupes aux médias de masse et
leur adaptation aux règles de fonctionnement de ces institutions ainsi que l'orientation de
la couverture qui leur est donnée par les journaux. A partir de l'étude d'une politique
publique québécoise, celle de la modification du programme des prêts et bourses
d'études, nous avons pu cerner les caractéristiques des activités de protestation menées
par les groupes de pression étudiants et qui ont pu franchir les médias.
Après avoir combiné les techniques d'analyse de contenu de presse et l'entretien semi
dirigé, nous avons relevé que le pseudo-événement constitue l'activité des groupes de
pression la plus citée par les médias. Le spectacle s'est avéré être le principal critère
permettant aux actions promues par ces groupes de franchir les médias de masse. Les
résultats de la recherche prouvent, de même, que les pseudo-événements à caractère
spectaculaire obtiennent une couverture médiatique qui appuie la cause des groupes de
pression et leur permet de transmettre leurs messages au public. Ce constat nous amène à
conclure que le traitement journalistique de l'affaire des prêts et bourses a tenu compte
des dimensions scénique et symbolique des pseudo-événements.
Par ailleurs, le cas étudié confirme l'habileté des groupes de pression à s'adapter aux
exigences de la nouvelle au sens journalistique du terme et la tendance des entreprises de
presse à privilégier l'information spectaculaire et, par conséquent, à accorder plus de
visibilité aux sources qui fournissent ce type d'information au détriment d'autres. Nous
en concluons que ce mécanisme est susceptible de nuire à la vertu de l'expression
plurielle des opinions.
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE I
1- Mise en contexte I
2- Problématique 3
3- Hypothèses 4
Chapitre 1 : LA FORMULATION DES POLITIQUES PUBLIQUES EN DÉMOCRATIE
A- Les formes de délibérations démocratiques 6
1 - La démocratie élitiste 6
2 - La démocratie pluraliste libérale 7
3- La démocratie républicaine X
4- La démocratie complexe 8
5- La démocratie participative 9
6- Le rôle des groupes de pression dans la démocratie 10
B- La formulation des politiques publiques 12
1 - Définition des politiques publiques 12
a- Des problèmes publics vers les solutions 13
b- L'environnement des politiques publiques 14
c- Les acteurs des politiques publiques 15
d- La rationalité dans les décisions publiques 18
2- Le processus des politiques publiques 18
a- L'émergence ou l'identification du problème 19
b- La phase de la formulation 20
c- La phase de la mise en œuvre 21
d- La phase de l'évaluation 22
e- La phase de terminaison des politiques publiques 23
f- Les Limites de l'approche séquentielle 23
3- Le cadre d'analyse ; le cas du Québec 24
Chapitre 2 : LES GROUPES DE PRESSION ET LEURS RELATIONS AVEC LES MÉDIAS
A- Les groupes de pression 28 1 - Définition des groupes de pression 28
2- Les principales caractéristiques des groupes de pression 30
a- Influence des pouvoirs politiques 30
b- Répertoires et ressources des groupes de pression 30
3- Typologie des groupes de pression 31
a- Les groupes de pression avec un statut interne 32
b- Les groupes de pression avec un statut externe 33
c- Les groupes de pression avec un statut ambigu 34
4 - Les groupes de pression au Québec 37
5 - Les stratégies déployées par les groupes de pression 37
a- « La mobilisation de l'action » ou « la mobilisation du consensus » 38
b - Le recours au nombre 39
c- Le recours à la science 40
d- Le recours à la vertu 41
e- Le recours à la rhétorique 42
f- Le recours aux tribunaux 42
g- Le recours aux coalitions 43
B- Rôle et importance des médias pour l'action des groupes de pression 43
1 - Le lobbying indirect ou les campagnes d'opinion publique 43
2- Rôle des médias dans les débats démocratiques 46
C- L'enjeu des relations avec les médias 48
1 - La position des médias dans le processus d'influence 48
2- La dialectique de l'agenda médiatique 49
a- Le modèle de l'agenda-selting 50
b-L'agenda-building 51
c- Les relations publiques à la conquête des médias 52
d- Les contraintes économiques : les médias, institutions lucratives 53
e- Les médias, antidémocratiques ? 56
D- La médiatisation des problèmes publics 57
1- La mise en discours médiatique 57
2- Les stratégies médiatiques des groupes de pression 59
Chapitre 3 : ÉTUDE DE CAS: LA MODIFICATION DU PROGRAMME DES PRÊTS ET BOURSES D'ÉTUDES AU QUÉBEC
A- Les choix méthodologiques 63
1- L'analyse de contenu 65
2- L'entretien semi- dirigé 66
B - Présentation du cas des prêts et bourses d'études 67
1 - Le problème public et le processus de formulation de la décision publique 67
2- Les acteurs de la politique des prêts et bourses d'études 70
3- Présentation des principaux groupes de pression 73
- La Fédération étudiante universitaire du Québec 73
- La Fédération étudiante collégiale du Québec 74
- L'Association pour une solidarité syndicale 75
4- Chronologie de la négociation et des moyens de pression 76
C- Analyse et interprétation des données recueillies 85 1 - Analyse de contenu : corpus et échantillonnage 85
2- Analyse de contenu : grille de traitement des articles de journaux 86
a- Les variétés de la mise en scène médiatique et leurs indices 86
b- L'orientation de la couverture médiatique et ses indices 88
3-Analyse de contenu : traitement des données et interprétation des résultats 90
a- Accès des groupes étudiants aux journaux 90
b- Orientation de la couverture 95
c- La distribution de la parole dans les journaux 102
4- Entretiens semi-dirigés : échantillonnage 104
5- Entretiens semi-dirigés : traitement des données et interprétation des résultats 104
CONCLUSION GÉNÉRALE 109
BIBLOGRAPHIE 112
ANNEXES 119
Avant-propos
Toute personne qui arrive au Québec est attirée par l'effervescence des débats publics et
l'activisme des groupes de pression qui touchent des domaines variés comme ceux des affaires,
de l'environnement, de l'éducation, etc.
Nouvellement arrivée dans la province, les médias, notamment la télévision, étaient pour moi la
première fenêtre sur la société québécoise. C'était en regardant des émissions comme les talk
shows, les télé-journaux, etc, que j 'ai commencé à découvrir la réalité de la société québécoise,
ses préoccupations et son fonctionnement politique.
Les médias au Québec étalent au grand jour le moindre fait de l'activité politique. De plus, ils
vont chercher les répercussions de l'exercice du pouvoir sur la vie des groupes citoyens. Ils
accordent une place importante aux réactions et aux impressions des groupes d'intérêts
concernant tous les détails de la vie publique. En effet, la province est réputée pour avoir
favorisé l'émergence d'une société civile vivante qui contribue à réorganiser la représentation
des intérêts et à établir un contre-pouvoir aux acteurs politiques.
Introduction générale
1- Mise en contexte
La formulation des politiques publiques au Québec est un processus collectif auquel prennent
part les différents acteurs touchés de près ou de loin par les décisions gouvernementales.
Par ailleurs, les débats publics et l'affrontement au grand jour des idées et des intérêts se
transforment fréquemment en bras de fer entre le gouvernement québécois et les groupes de
pression.
Ces derniers sont souvent amenés à investir de grands moyens pour contester les mesures qui
vont à l'encontre de leurs intérêts. Ce qui pourrait conduire le gouvernement à revenir sur ses
décisions afin de garantir une meilleure adéquation entre le pouvoir et les attentes de la
population.
En fait, le cas du Québec n'est pas unique. Les nouvelles tendances politiques, démocratiques
et économiques ont favorisé la mise en place de procédures de dialogue, de négociation et de
concertation entre les acteurs de l'espace public dans les sociétés modernes. Les débats publics
se manifestent partout à travers les pratiques de communication publique. Les médias de masse
occupent une place centrale dans les jeux d'influence, de par leur capacité à constituer et à
mobiliser l'opinion publique.
L'interaction entre les gouvernements, les groupes de pression, les médias et l'opinion publique
nous semble être un phénomène pertinent et fort intéressant à explorer. Il paraît d'abord étrange
qu'un gouvernement démocratiquement élu soit en rivalité avec des groupes d'intérêts dont la
légitimité demeure partielle. Quelles sont les stratégies des groupes qui parviennent à infléchir
les décisions gouvernementales? Que font-ils pour gagner l'estime de l'opinion publique?
Quel est le rôle des médias dans ce contexte ?
l
Dans la réalité des faits, la montée des mouvements sociaux, qui coïncide historiquement avec
la promotion des moyens de communication de masse au rang d'institutions importantes dans
l'espace public, a bouleversé les notions de la vie politique et démocratique.
Le domaine de recherche « communication dans la gestion des affaires publiques » se penche
justement sur l'étude des interactions entre les acteurs de l'espace public construites
fondamentalement autour des médias de masse.
À travers ce mémoire, nous nous intéressons à la relation entre les médias et les groupes de
pression dans la formulation des politiques publiques. En d'autres termes, nous avons
l'intention de savoir comment ces groupes participent au débat public, défendent leurs intérêts
et influencent les décisions publiques en faisant usage des médias.
Le problème tel que posé ici nous place devant la nécessité d'étudier et comprendre
distinctivement d'abord trois concepts ; les groupes de pression, les politiques publiques, et le
fonctionnement des médias. La réalité de chacun de ces éléments doit être prise en
considération pour se faire une idée complète de la dynamique de leur relation.
En effet, la multiplication des enjeux non économiques (écologiques, consuméristes, sociaux
ou éthiques) dans les sociétés modernes a donné naissance au phénomène des groupes
d'intérêts qui ont réussi, avec le temps, à intégrer les sociétés actuelles comme des
composantes inhérentes à leur fonctionnement démocratique. Grâce aux stratégies de
communication et de relations publiques, ces groupes ont beaucoup gagné en termes de
visibilité sociale et de légitimité.
Par ailleurs, au sein des sociétés démocratiques, les médias se sont vu attribuer de nouvelles
fonctions ; ils sont appelés à incarner des arènes de débats publics. Cependant, ces institutions
sont soumises à des contraintes économiques et concurrentielles qui pèsent sur les procédures
de sélection des nouvelles et leur mise en scène.
À partir de cette recherche, nous espérons pouvoir comprendre la dynamique entre ces acteurs
et savoir comment les groupes de pression composent avec les conditions particulières du
système d'information de masse.
,'.
2- Problématique
Le problème de recherche qui sous-tend notre travail s'articule autour de la relation médias-
groupes de pression dans le processus de politiques publiques. Nous nous intéressons à la façon
dont les groupes utilisent les entreprises de presse pour participer au débat public et défendre
leurs intérêts.
Nous partons du postulat que les organisations médiatiques ont un rôle à jouer dans un
environnement démocratique. Elles sont censées être des incitatrices de débats publics et des
scènes d'expression pour les différents courants de pensée. En outre, nous envisageons que ces
institutions évoluent à l'intérieur d'un système complexe marqué non seulement par des
obligations inhérentes au travail journalistique, mais aussi par la confrontation des pouvoirs
économiques et politiques. Ces différentes contraintes ont des répercussions sur le produit
médiatique diffusé au public et ce, tant en ce qui concerne l'ordre du jour établi, qu'à ce qui a
trait au fond et à la forme des messages. L'apport des médias dans les débats publics ne peut
être envisagé sans une réflexion sur l'ensemble des contraintes qui peuvent peser sur la
sélection des nouvelles, leur mise en discours et leur mise en scène médiatique. Conscients de
ces enjeux, les groupes de pression gèrent avec précautions leurs relations avec les médias afin
d'obtenir des couvertures favorables dans la presse et pouvoir joindre l'opinion publique.
À l'égard de cette situation, nous nous proposons, à partir de l'étude d'un exemple de politique
publique, de comprendre d'abord comment ces mouvements réussissent à intégrer l'agenda
médiatique, comment ils arrivent à décrocher l'attention des médias au milieu des flux
d'information qui leur parviennent quotidiennement. Pourquoi parle-t-on de certains groupes,
événements et idées et pas d'autres. Nous espérons pouvoir cerner les techniques de relations
publiques employées par ces groupes pour s'adapter aux exigences du travail journalistique et
au fonctionnement de la machine médiatique en général.
L'attention sera portée, à cette occasion, sur les répertoires d'actions des groupes ayant accédé
à l'agenda médiatique. Nous allons tenter de relever en quoi ces répertoires répondent aux
critères exigés par les médias (émotion, sensationnalisme, spectacle, scandale, faits
imprévisibles, originalité, divertissement, suspense, proximité, rationalité discursive,
combinaison de ces critères...).
)
Nous espérons également pouvoir cerner la nature de la couverture médiatique qu'ils ont
obtenue dans la presse : les groupes ont-ils réussi par le même coup à orienter le discours des
journalistes ? Les actions entreprises par les groupes ont-elles permis juste d'en parler dans les
médias (en toute objectivité), d'en parler d'une façon favorable (en adoptant leurs arguments),
ou encore d'en parler mais avec un ton critique (en dénigrant leur argumentaire) ?
Ensuite, nous allons évaluer la nature de la couverture accordée aux groupes de pression en
fonction des critères qu'ils ont remplis (et qu'on a précisés plus haut). En d'autres termes, il
s'agit dans cette étape de relever la corrélation qui existe entre la nature de la couverture et les
critères qui l'ont rendue possible.
Nous aborderons d'une manière synthétique la question du rôle démocratique des médias en
essayant de savoir à travers cette étude de cas si les médias ont respecté le principe du
pluralisme des opinions, dans le sens où ils ont donné la parole à des groupes différents ayant
des positions différentes. L'objectif ultime étant d'apprécier comment les tensions inhérentes
au fonctionnement des médias et les exigences de l'audience risquent d'influencer le pluralisme
au sein des sociétés démocratiques.
3- Hypothèses
À travers l'étude d'une politique publique québécoise, notre recherche a pour objectif de
vérifier deux hypothèses. Premièrement, nous posons que les groupes de pression impliqués
entreprennent des actions qui répondent aux exigences de la mise en scène médiatique de
façon à pouvoir accéder aux médias et à s'imposer dans leur agenda. Ensuite, nous postulons
que la nature de la couverture médiatique des activités de ces groupes dépend des
caractéristiques de leur mise en scène.
Pour vérifier ces deux hypothèses, deux méthodes d'investigation sont retenues : l'analyse de
contenu d'articles journalistiques et l'entretien semi-dirigé.
Nous avons, par ailleurs, approfondi le cadre théorique de l'enquête afin de bien saisir les
concepts impliqués et les relations entre eux. Nous avons divisé le corps du mémoire en trois
chapitres. Le premier traite des groupes de pression et de la formulation des politiques
publiques en démocratie.
4
En empruntant certaines notions du champ des sciences politiques, nous allons aborder les
formes de délibération démocratiques, puis les différentes étapes du processus de formulation
des politiques publiques.
Le deuxième chapitre sera axé sur la notion de groupes de pression et leurs relations avec les
médias. Nous évoquerons, les atouts et les contraintes liés à la médiatisation des actions des
groupes de pression. Nous allons ensuite nous attarder sur le mode de fonctionnement des
entreprises de presse et l'établissement de l'agenda médiatique. Le dernier thème qui sera
abordé dans ce chapitre a trait à la médiatisation des problèmes publics et aux stratégies
médiatiques des groupes de pression.
Le troisième chapitre sera consacré à l'analyse d'une politique publique québécoise, celle de la
modification du programme des bourses et prêts d'étude et annoncée en 2004. Après la
présentation du problème public et des principaux acteurs qui y sont impliqués, nous
analyserons le contenu des articles de journaux qui ont couvert l'affaire afin de déterminer la
nature et les caractéristiques des activités menées par les groupes contestataires et reprises par
les médias ainsi que la nature de cette couverture. Nous procéderons ensuite au dépouillement
des résultats de cette analyse, combinés avec ceux livrés par les entretiens que nous avons
menés avec des leaders des groupes étudiants.
Ln conclusion, nous aurons l'opportunité de mettre en parallèle les résultats de notre enquête
avec ceux de l'article publié par Jean Charron (1991) et qui étudiait le recours aux pseudo
événements de contestation comme outil stratégique des groupes politiquement et
économiquement faibles.
5
Chapitre 1 : LA FORMULATION DES POLITIQUES PUBLIQUES EN DÉMOCRATIE
A- Les formes de délibérations démocratiques
Le mot démocratie est d'origine grecque. Il est composé de la racine démos, qui signifie peuple,
et Kratos qui signifie gouvernement. «Chez les grecs de l'Antiquité, ce gouvernement du
peuple s'opposait au gouvernement exercé par une seule personne, la monarchie, et au
gouvernement exercé par un petit groupe de nobles, l'aristocratie » (Loriot, 1998 : 33).
La démocratie est un système politique où les citoyens détiennent le pouvoir souverain et
expriment leur volonté essentiellement par le vote. Les principes d'égalité et de liberté, comme
celle d'expression, de pensée, de rassemblement, etc, sont les principaux fondements de la
démocratie. « À la fois, idéal et façon de gouverner, la démocratie propose de confier le
pouvoir politique à la majorité des citoyens, tout en permettant à l'opposition de s'exprimer et
même d'être représentée » (Loriot, 1998 : 76).
Baker (2002) a longuement étudié les systèmes démocratiques en s'intéressant en particulier au
rôle des médias au sein de ces régimes. L'auteur fait la distinction entre quatre formes de
délibérations démocratiques que nous allons présenter ci-dessous.
1- La démocratie élitiste
La première conception de la démocratie est celle qui se fonde sur le principe que « a country
can only be governed sensibly by a vanguard leadership of élites or skilled experts » (Baker,
2002: 130). Les tenants de cette vision de la démocratie affirment que les citoyens ont
l'opportunité de choisir par le suffrage la personne qu'ils jugent apte à les gouverner et ce, à
l'issue d'une compétition libre entre les candidats. Ils admettent que l'implication de la
population en dehors des périodes électorales risque de nuire à la vie politique. La complexité
du monde moderne requiert que la prise de décisions publiques soit conçue comme une activité
à temps plein, par des personnes qualifiées et préparées pour la tâche.
6
Le suffrage universel est un outil démocratique valorisé par les tenants de ce modèle qui le
considèrent comme une source de motivation pour les leaders. En courses électorales, les
candidats sont obligés d'améliorer leurs performances afin de convaincre les électeurs. Leurs
programmes tiennent compte des préoccupations et des attentes d'une large portion de la
population.
Par ailleurs, la démocratie élitiste exige une presse libre et indépendante. Elle joue un rôle
fondamental dans ce système dans la mesure où elle se charge de surveiller l'exercice du
pouvoir et de dénoncer les abus des leaders et la corruption. Baker souligne que « the central
consîitutional rôle of the média results Jrom the unavailability of thèse forces to check abuse hy
government, which can only be controled by the power of public opinion » (Baker, 2002: 134).
2- La démocratie pluraliste libérale
Contrairement à la première, cette forme de démocratie est fondée sur le principe de « self
governing people ». Ce modèle reconnaît que chaque personne a des intérêts particuliers et a sa
propre conception de la vie collective. Ses points de vue sont respectés et partagés par le
groupe auquel elle s'identifie. La société est composée de groupes dont les valeurs et les
intérêts sont souvent conflictuels à l'exemple des travailleurs et des employeurs qui, malgré
leur étroite collaboration, incarnent des intérêts et des valeurs divergentes. Le pluralisme libéral
reconnaît la diversité insoluble et l'égalité absolue entre les individus. Il dénigre l'idée que
certaines formes de vies sont plus valables que d'autres. Les chercheurs en sciences politiques
étudient comment ce système démocratique gère les conflits et réussit à produire une stabilité
relative. Dans ce modèle, à travers les lois et les politiques publiques, la démocratie doit
répondre aux préoccupations de tous ses groupes citoyens et respecter leurs intérêts : « Interesls
are détectable and influence government policy primarily due to interest-group pressure or
représentation» (Baker, 2002: 137). En effet, l'activisme des groupes de pression et leur
mobilisation leur permet de développer un capital politique et pouvoir ainsi prendre part dans
les négociations afin d'influencer les décisions gouvernementales. Selon cette forme de
délibération démocratique, seule la participation équitable des citoyens est susceptible de
protéger leurs intérêts et leurs droits fondamentaux.
/
3- La démocratie républicaine
Bien qu'elle partage le principe de participation, la démocratie républicaine critique le
pluralisme libéral pour son attachement aux intérêts particuliers des individus. Selon cette
approche de la démocratie, l'homme n'est pas forcement individualiste, c'est un être social et
communautaire. Les gens ne cherchent pas seulement à protéger leurs intérêts particuliers,
« they are often molivated by conception of a commun good and by a concern with other 's
welfare » (Baker, 2002 : 138). Les prises de positions et les choix politiques des individus ne
traduisent pas des intérêts personnels isolés, ils émanent généralement des interactions avec les
autres et tiennent compte de la réalité commune.
La notion d'intérêt général se trouve au cœur de la démocratie républicaine. Les négociations et
la participation citoyenne doivent aboutir à l'engagement de tous envers le bien commun. Le
gouvernement est désigné pour garantir l'intérêt général partagé par les citoyens.
Les médias jouent un rôle démocratique central dans l'approche républicaine. «Its design
ought to facilitate the process of deliberating about and choosing values and conceptions ofthe
commongood» (Baker, 2002: 143).
4- La démocratie complexe
La quatrième forme de démocratie reconnaît à la fois le caractère altruiste et égocentrique des
individus. Baker souligne que «people surely needprocesses by which they can clarify both
their individual préférences and their conception of more gênerai common goods» (Baker,
2002: 143). Cette approche emprunte ainsi le principe fondamental du pluralisme libéral et
celui de la démocratie républicaine.
Se voulant une théorie réaliste, la démocratie complexe admet que la participation
démocratique doit se présenter comme une arène où les individus et les groupes échangent pour
prévaloir le bien commun, mais aussi pour mettre en avant leurs valeurs et leurs intérêts
particuliers.
La différence des points de vue et des valeurs est respectée, voire encouragée à l'intérieur de ce
modèle.
8
La société doit être composée de plusieurs groupes qui développent des visions divergentes et
conflictuelles du bien commun. Baker souligne que bien que l'échange et la discussion entre
les groupes ne parviennent pas à résoudre complètement les différences et les conflits, l'ordre
démocratique doit garantir à tous les groupes des chances égales de développer et de vivre leur
différence. La liberté de la presse est envisagée par les tenants de cette approche comme un
outil pour exprimer cette différence et participer à la vie démocratique.
5- La démocratie participative
Il existe d'autres catégorisations de la démocratie. Il y a la démocratie directe, dans laquelle le
peuple exerce directement le pouvoir. C'est la démocratie athénienne ou antique (Mossé, 2000)
de l'époque où les citoyens se réunissaient sur la place publique de la cité et votaient des lois
dont l'administration est ensuite confiée à des fonctionnaires. Il y a la démocratie
représentative ou parlementaire (Manin, 1996) où les citoyens possèdent et contrôlent toujours
le pouvoir politique mais ils en délèguent l'exercice quotidien à des députés. Il y a la
démocratie référendaire : elle reflète une volonté de consulter occasionnellement les citoyens,
par référendum, sur les grandes questions de l'heure. Il y a aussi, la démocratie participative
(Falise, 2003), qui postule l'implication et la participation régulière des citoyens dans les
débats publics et dans les prises de décisions politiques.
Dans la typologie proposée par Baker, mise à part la démocratie élitiste, les trois autres formes
de délibération démocratique sont considérées comme des approches de démocratie
participative puisqu'elles reconnaissent aux citoyens la possibilité de prendre part à la vie
politique en dehors des périodes électorales et d'influer sur les structures et les décisions
gouvernementales.
Au sein de la démocratie participative, la décision publique n'est pas exclusivement l'apanage
du gouvernement et les circuits classiques de représentation des intérêts ne sont plus suffisants.
Des acteurs économiques et sociaux interviennent dans le processus décisionnel pour défendre
des intérêts particuliers issus de la multiplication des enjeux publics ; écologiques,
consuméristes, éthiques, etc. C'est une manière d'enrichir le débat public et d'assurer une
certaine adéquation entre les services publics et les besoins de la population.
9
Dans ce contexte démocratique, la formulation des politiques publiques se dessine comme un
processus collectif impliquant toutes les parties prenantes au débat. Les décisions
gouvernementales sont prises généralement à la suite d'efforts de négociation et de consultation
entre les décideurs et les groupes touchés.
Le paysage politique et démocratique a connu ces dernières années l'émergence de nouvelles
composantes : on parle de société civile, groupes d'intérêts et groupes de pression. L'espace
public se présente alors comme une dynamique entre ces différents acteurs, un lieu commun où
chacun exprime et défend ses propres intérêts en essayant de contrôler cette dynamique en sa
faveur. La marge de manœuvre dont dispose chaque acteur est fonction du modèle
démocratique en place.
L'occasion venue, les acteurs de la société civile s'activent pour exprimer leurs points de vue et
défendre leurs intérêts auprès du gouvernement. Quelle que soit la stratégie qu'ils empruntent,
leurs interventions visent en dernier lieu à toucher les décideurs politiques et à les amener à
prendre les décisions qui leur sont favorables. Cette pratique revient à faire du lobbying direct
et indirect, c'est-à-dire à communiquer par les voies orales, écrites ou médiatiques en vue
d'influencer les décisions d'un titulaire de charge publique. Il s'agit de lobbying direct lorsque
les actions ciblent directement les personnes dans les postes de pouvoir. Si les actions
cherchent plutôt à gagner le soutien de l'opinion publique et mettre ainsi la pression sur les
décideurs, les groupes de pression vont devoir solliciter les médias de masse et faire du
lobbying indirect.
6- Le rôle des groupes de pression dans la démocratie
Les groupes de pression proposent une alternative à la démocratie traditionnelle en,permettant
une participation citoyenne plus élevée. Étant donné que le droit à l'association est un droit
reconnu et fondamental dans toutes les sociétés qui se prétendent démocratiques, les citoyens
désireux de contribuer au processus décisionnel plus souvent qu'au cours des périodes
électorales, s'unissent et forment des groupes d'intérêt autour de différents enjeux sur lesquels
ils désirent être entendus. Ainsi, les groupes latents ou non organisés se mobilisent dès lors que
leurs intérêts sont menacés.
10
Il peut être question d'une cause humanitaire, sociale, ethnique, économique écologique,
consumériste, culturelle, économique, etc. À titre d'exemple, les membres du groupe de
pression peuvent avoir en commun l'objectif de changer un comportement environnemental,
l'abolition du recours à la main-d'œuvre infantile, la préservation d'une espèce d'animaux en
voie de disparition ou la promotion des droits d'une minorité ethnique.
Pour Grossman et Saurugger (2006 : 9), l'activité des groupes de pression s'inscrit dans ce
qu'ils appellent le système de gouvernance multi-nivcaux et qui peut être défini comme « un
processus de coordination d'acteurs, de groupes sociaux et d'institutions en vue d'atteindre
des objectifs définis et discutés collectivement. Selon celte approche, les relations
hiérarchiques ou de subordination entre les acteurs laissent place à un système d'échange
entre acteurs égaux, cherchant une solution commune pour leurs problèmes ».
Considérée comme un indice de santé démocratique, cette contribution aux débats publics est
rendue possible grâce à la communication. Les techniques des relations publiques sont utilisées
pour favoriser le dialogue. La pratique du lobbying constitue l'une de ces techniques
stratégiques ; elle cherche à influencer directement le pouvoir politique.
La nature de l'activité des groupes de pression les appelle à s'ajuster constamment à des jeux
politiques complexes. Ils doivent rester attentifs aux changements survenant dans la
distribution du pouvoir (Mazey et Richardson, 1996). Les niveaux d'action sont complexes et
peuvent être locaux, nationaux et même internationaux. Dans certaines situations, les groupes
de pression cherchent à sensibiliser un public externe, mais qui possède un pouvoir d'influence
considérable sur le gouvernement.
Par ailleurs, les médias de masse font partie intégrante de la définition moderne de la
démocratie. Lieu d'information et de rencontre, cet espace est censé informer et mobiliser
l'ensemble des citoyens et les amener à participer réellement à la vie politique. Il n'est plus
seulement question de droit à l'information aujourd'hui, il s'agit aussi de garantir le droit de
produire sa propre information. Grâce aux médias, les citoyens sont impliqués dans les choix
de société, ils deviennent « des protagonistes dans le processus de communication par
l'interchangeabilité des rôles des émetteurs et de récepteurs.» (Sénécal, 1995 :43). Les médias
constituent donc un outil précieux pour les groupes de pression ; ils leur permettent d'exprimer
leurs positions et de mobiliser l'opinion publique.
Il
Il est judicieux à ce niveau de comprendre comment sont élaborées les politiques publiques à
l'intérieur du contexte démocratique marqué par une implication importante des médias et des
groupes de pression. Nous consacrons donc la section suivante à comprendre cette notion et en
identifier les différentes étapes.
B- La formulation des politiques publiques
Pour le bon fonctionnement de la vie collective, les autorités publiques agissent. Les
municipalités, les ministères et le parlement interviennent de multiples façons. Des mesures
sont prises, des ressources sont allouées et des contraintes sont imposées dans les domaines les
plus variés de la vie des citoyens. L'étude des politiques publiques n'est autre que l'étude de
l'action des autorités publiques au sein de la société. Les sciences politiques et sociales se sont
penchées sur le phénomène et ont tenté de savoir quels sont les acteurs impliqués, quand,
pourquoi et comment ces politiques publiques voient le jour. Les recherches les concernant
sont nombreuses, elles empruntent des approches différentes et ont des motivations variées.
La sociologie des groupes de pression est l'une des approches qui étudient l'action politique.
Elle rejoint nos centres d'intérêts puisqu'elle postule qu'entre les textes de loi et la réalité des
comportements gouvernementaux vient s'insérer un jeu de marchandages, d'influences et de
négociation au cours duquel des intérêts particuliers cherchent à peser sur ce que veut faire
l'autorité publique (Meny etThoenig, 1989 : 10).
I- Définition des politiques publiques
Dans les écrits des sciences politiques, il existe une abondance de définitions qui cernent ce
phénomène et qui l'appréhendent sous différents angles. Vincent Lemieux (2003 : 6) envisage
une politique publique comme étant « un ensemble d'activités par des acteurs politiques, visant
à apporter des solutions à des problèmes ».
En adoptant une approche systémique. Le Moigne (1984) admet qu'une politique publique est
un système d'action, qu'on peut définir par ses environnements, ses finalités, ses activités et ses
structures.
12
Selon l'auteur, une politique publique serait donc faite « d'activités orientées vers la solution
de problèmes publics dans l'environnement et ce par des acteurs politiques dont les relations
sont structurées, le tout évoluant dans le temps » (Lemieux, 2002 :6).
Dans une perspective plus opérationnelle, voici la définition de Knoepfel et Bussman (1998 :
5 9 ) :
C'est un ensemble de décisions de différents niveaux juridiques et d'actions, cohérentes et ciblées vers des objets que les acteurs compétents, prives, corporatistes ou étatiques, prennent ou appliquent dans le but de résoudre un problème social. Une politique publique se compose d'un programme administratif qui fixe les bases juridiques pour les objectifs, les instruments d'intervention et les caractéristiques institutionnelles, organisationnclles, financières et opérationnelles de la mise en œuvre administrative et/ou sociale de la politique publique.
À partir de ces définitions, il apparaît que certains éléments sont inhérents à l'accomplissement
d'une politique publique; la naissance de problèmes dans l'environnement, la présence d'un
certain nombre d'acteurs et la prise de décisions en vue de résoudre ces problèmes. Afin
d'assimiler la notion de politique publique, il est important à ce niveau de s'arrêter sur chacun
de ces éléments.
a- Des problèmes publics vers les solutions
Plusieurs auteurs posent qu'une politique publique a sa source dans une situation où des
problèmes publics sont perçus et soulevés publiquement de façon à entraîner une intervention
des autorités gouvernementales. Mais, que signifie exactement un « problème public » ?
D'après Lemieux (2002:19), « des problèmes sont perçus comme des affaires publiques
lorsqu'ils concernent d'une façon ou d'une autre la distribution des ressources entre les
acteurs d'une même société ou de plus d'une société, qu'il s'agisse de la quantité de ces
ressources ou de leur répartition ». Ces ressources peuvent être liées à des intérêts matériels,
des conditions sociales ou politiques, les conflits peuvent se manifester encore sur un registre
normatif et cognitif. Les acteurs relèvent les écarts qui existent entre une situation donnée et les
normes de la distribution des ressources. Ils définissent la situation comme problématique.
En revanche, le déclenchement de l'action publique n'est pas lié au seuil d'intensité du
problème, il est lié à la perception de celui-ci par la société.
13
Meny et Thoenig (1989 :169) remarquent que les problèmes publics ne produisent pas toujours
les mêmes effets puisque « les représentations des phénomènes, le sens et la signification
donnés aux «faits » varient d'un milieu à l'autre et varient même dans le temps ».
Ainsi, un problème public selon la représentation de Muller (2006 :29) est « un construit social
dont la configuration dépend de multiples facettes de la société et du système politique
concerné ». Dans le même contexte, Kingdon évoque des expressions comme « la tendance
nationale » (national mood), « le climat politique », « le changement dans l'opinion publique »
pour désigner les idées dominantes et prioritaires, les idées dans l'esprit du temps qui font
qu'un problème s'impose comme une affaire publique et incarne une priorité pour
l'intervention gouvernementale (Lemieux, 2002 :37).
Un peu plus loin, nous examinerons comment ces problèmes peuvent apparaître et comment ils
sont soulevés par les acteurs politiques.
Avec la cristallisation du problème public, des idées et des propositions sont développées par
les acteurs concernés afin d'apporter des solutions. Certaines prennent de la valeur, d'autres en
perdent et finissent par être éliminées. Pour qu'elles survivent, elles doivent remplir certaines
conditions. La plus importante est qu'elles puissent rallier les parties prenantes.
b- L'environnement des politiques publiques
L'environnement interne ou externe du système d'action politique est la source des problèmes
publics sur lesquels porte une politique publique. Lemieux précise que l'environnement interne
est fait de sous-systèmes politiques. Il peut s'agir de sous-système législatif, gouvernemental,
administratif ou juridictionnel. L'environnement externe référé à d'autres systèmes que le
système politique, il s'agit de l'environnement économique, social...
Par ailleurs, l'environnement des politiques publiques peut également s'étendre au-delà des
frontières territoriales.
Les politiques publiques peuvent porter sur des situations internes à une collectivité étatique, mais elles peuvent porter également sur des situations qui sont de l'ordre des relations entre les Etats et qui se situent donc dans l'environnement externe de nature extra sociétale, d'un système politique (Lemieux, 2002 :84).
I l
e- Les acteurs des politiques publiques
Les politiques publiques impliquent une multitude d'acteurs qui interagissent dans le but de
protéger leurs intérêts respectifs.
Selon Knoepfel et Bussman (1998 : 60), on désigne par acteur dans le contexte des politiques
publiques, tout groupe de personnes qui, grâce à ses propres ressources et à une répartition
spécifique des compétences, est appelé à être ou est en situation d'exercer une influence sur les
processus décisionnels. Il est à souligner que d'une politique à l'autre, le tour de table des
acteurs varie. Cependant, l'autorité gouvernementale demeure l'acteur central d'une politique
publique (Meny et Thoenig, 1989).
Kingdon, cité par Lemieux (2002), fait la distinction entre les acteurs qui sont à l'intérieur de
l'appareil gouvernemental et ceux qui sont à l'extérieur. À cet égard, Muller (2006) considère
que les politiques publiques ont despubliùs, c'est-à-dire des individus, groupes ou organisations
dont la situation est alTectée par la politique publique. Certains sont passifs alors que d'autres
s'organisent pour influer sur l'élaboration ou la mise en œuvre des programmes politiques. Ils
se mobilisent socialement et politiquement sous formes de partis, associations, mouvements
sociaux, groupes de pression, etc.
Dans les faits, les acteurs internes et externes à l'appareil gouvernemental agissent en
interdépendance. Kingdon précise qu'il est concrètement difficile de tracer la frontière entre les
deux catégories. Les autorités composent avec des groupes d'intéressés et des organismes
impliqués dans la formulation et la mise en œuvre des décisions (Howlett et Ramesh, 2003 :
16). De surcroît, des représentants de groupes interviennent dans des organismes consultatifs de
toute sorte, et des lobbyistcs sont en contact fréquent avec des responsables et des agents
gouvernementaux dans le but de fléchir la décision politique dans le sens qui s'accorde avec
leurs propres intérêts.
Parallèlement, les médias peuvent jouer un rôle important pour la poursuite de cet objectif
(Lemieux, 2002 : 23).
is
Le schéma du « milieu décisionnel central » développé par C. Grémion et repris par Muller
(2006 : 41) permet d'identifier les acteurs qui interviennent dans la décision des politiques
publiques1.
Selon ce modèle, les quatre cercles de la décision publique sont composés d'un noyau dur
d'acteurs relativement permanents et d'acteurs qui interviennent plus ponctuellement. Le
premier cercle est celui par lequel transitent toutes les décisions importantes. Suivant le régime
politique, il est composé du premier ministre, du président de la république, du chancelier, etc.
Le second cercle est composé des administrations sectorielles qui interviennent lorsque leur
domaine est concerné.
Le troisième cercle est celui des acteurs extérieurs à l'État : syndicats, organisations,
associations, entreprises publiques ou privées.
Le dernier cercle regroupe l'ensemble des organes politiques (parlement, congrès, chambre des
communes...) et juridictionnels (conseil constitutionnel, conseil d'État, cour suprême...) ; leur
rôle peut parfois être limité comme il peut être décisif selon la situation.
Les ajustements entre tous ces acteurs s'opèrent autour de relations de pouvoir qui se tissent
entre eux et l'accès aux cercles de la décision représente une ressource politique fondamentale
dont dépendra la capacité de chaque acteur à influencer les politiques publiques.
Voir graphique à la page suivante.
16
Figure 1 : Le schéma du « milieu décisionnel central », C. Grémion, dans Muller (2006 : 41)
I- Premier ministre, Président de la république, Chancelier, etc.
4- Organes politiques (parlement, chambre des communes, etc.) et juridictionnels (conseil constitutionnel, cour suprême, etc.)
2- Les administrations sectorielles
3- Les acteurs extérieurs à l'État : Syndicats, organisations, associations, entreprises publiques ou privées, etc.
17
d- La rationalité dans les décisions publiques
Pour comprendre les politiques publiques il faudrait s'interroger notamment sur la présence ou
l'absence de rationalité dans la prise de décision gouvernementale.
D'après Thomas Dye (2005: 15), « a policy is ralional when the différence belween the values
it achieves and the values it sacrifices is positive [...] Rationalism involves the calculât ion of
ail social, political and économie values ».
À ce sujet, Bernier et Lachapelle (1998) affirment qu'en raison de l'entrelacs des enjeux et des
interventions, les décideurs gouvernementaux s'appuient sur différents modèles, présumés
rationnels, pour simplifier la réalité politique et pouvoir prendre les bonnes décisions :
Pour élaborer ses politiques une organisation aussi complexe que l'État moderne doit tenir compte d'intérêts multiples de logiques contradictoires, d'impératifs légaux administratifs, politiques...difficilement conciliâmes. Ceux qui choisissent ne peuvent guère considérer toutes les variables enjeu. Ils tranchent en envisageant les variables qui sont les plus importantes à leurs yeux (Tremblay, 1998: 15).
Le fait que plusieurs acteurs prennent part dans l'élaboration des politiques publiques semble
rendre la décision rationnelle plus difficile. Les décideurs sont souvent pris entre des logiques et
des points de vue opposés. Les groupes de pression sont ici appelés à faire valoir leurs logiques
auprès des décideurs et faire preuve de cette rationalité recherchée.
Pour récapituler, soulignons que les politiques publiques émergent suite à l'apparition d'un
problème public. Plusieurs acteurs impliqués interviennent dans le débat afin de proposer des
solutions pour résoudre le problème. La multiplication des enjeux et la confrontation des intérêts
privés rendent la décision gouvernementale plus délicate et compliquée.
2- Le processus des politiques publiques
Afin de simplifier l'étude du phénomène, plusieurs auteurs ont développé des modèles qui
décrivent le processus des politiques publiques. La majorité des auteurs ont procédé avec la
même logique, les variations résident généralement dans le nombre des séquences établies d'un
modèle à l'autre. L'avantage de cette division séquentielle est de briser la complexité de l'objet,
en le décomposant en éléments empiriques fins, sans pour autant perdre de vue l'ensemble.
18
Cette démarche est susceptible de permettre d'approcher l'analyse des politiques publiques,
stade par stade, ou en considérant son évolution d'un stade à l'autre (I lowlett et Ramesh 2003 :
13).
Nous allons nous référer principalement au modèle de Charles O. Jones, repris par Muller
(2006: 23). Il propose une grille d'analyse des politiques publiques sous la forme de cinq
séquences d'action plus au moins ordonnées, à savoir les phases de l'émergence, de la
formulation, de la mise en œuvre, de l'évaluation et finalement la phase de la terminaison du
programme.
a- L'émergence ou l'identification du problème
D'une façon globale, « à cette phase sont associés des processus de perception du problème,
de définition, d'agrégation des différents événements ou problèmes, d'organisation de
structures, de représentation des intérêts et de définition de l'agenda » (Muller, 2006 : 24).
En effet, le stade de l'émergence d'une politique publique s'accomplit par l'intégration du
problème à l'ordre du jour d'une instance gouvernementale. Le problème est reconnu comme
un enjeu de controverses publiques ; il fait désormais partie de l'agenda politique. Cette notion
d'agenda renvoie, selon Padioleau (1982), à «l'ensemble des problèmes perçus comme
appelant un débat public, voire l'intervention (active) des autorités publiques légitimes »
(Meny et Thoenig, 1989: 151). La transformation d'un problème en objet d'intervention
publique est toujours le produit d'un travail spécifique réalisé par les acteurs concernés. C'est
chaque fois, selon Muller, le produit contingent du champ de forces qui va se construire autour
du problème. L'action des groupes d'intéressés avec celle des médias auprès de l'opinion
publique contribue considérablement à inscrire l'affaire dans l'ordre du jour gouvernemental.
À cet égard, Lemieux souligne que la bonne place accordée par le public à un problème ou à
une cause particulière est une condition nécessaire pour que le problème « décolle » et soit mis
à l'ordre du jour public, puis gouvernemental. Les médias constituent le lieu de cristallisation
des problèmes publics puisque c'est à partir du moment où un problème devient médiatisé
qu'on peut reconnaître qu'il s'agit d'un problème public qui nécessite une réaction de la part du
gouvernement. Les médias agissent comme des caisses de résonance, ils attirent l'attention du
public et incitent les gens à prendre position.
I1)
Ainsi donc, l'activisme et le dynamisme des groupes de pression reliés à cette cause sont des
conditions nécessaires à la cristallisation des problèmes comme affaires d'ordre public.
Cité aussi par Muller (2006: 31), Pierre Favre a distingué quatre modes d'émergence de
problèmes. L'émergence progressive et par canaux multiples à partir d'une situation jugée
injuste. L'émergence instantanée dans les situations de catastrophes par exemples. L'activation
automatique lorsque un dossier est activé sans qu'il y ait de revendication des populations
concernées. Le quatrième modèle correspond à l'émergence captée quand une institution
extérieure au champ politique s'approprie le problème.
Concrètement, les problèmes peuvent apparaître à titre d'exemple à cause de la publicisation
d'indicateurs ou d'informations produits généralement par les administrations; études
spécialisées, statistiques sur divers secteurs d'activité, ou également à la suite d'une crise ou
d'un désastre.
Les groupes d'intéressés, notamment les groupes de pression, exploitent ces événements pour
qu'ils apparaissent comme des problèmes publics.
b- La phase de la formulation
Selon l'approche séquentielle de l'analyse des politiques publiques de Jones (Muller, 2006), la
seconde étape est celle du traitement proprement dit du problème. Elle associe des processus de
formulation par la définition des méthodes et des solutions pour résoudre le problème.
Cette séquence est divisée en deux étapes chez certains auteurs. D'abord l'étape de la
proposition d'idées et de solutions ; ensuite vient celle du choix de la solution appropriée et son
adoption (Howlett et Ramesh, 2003). Encore faut-il que le problème demeure à l'ordre du jour
du gouvernement pour que la formulation d'une politique conduise à son adoption.
La phase de formulation doit s'achever par l'adoption des mesures de régulation. Ce peut être
le fait d'un parlement, d'un conseil des ministres, ou d'une autre instance autorisée, dont les
instances administratives (Lemieux, 2002 : 83).
Dans son ouvrage sur l'étude des politiques publiques (2002 : 90), Lemieux a analysé trois
situations de politiques publiques en mettant l'accent sur la phase de formulation.
20
Son étude a révélé que les acteurs politiques ont tendance à prendre leurs décisions en fonction
de leurs préférences et intérêts personnels plutôt qu'en fonction d'une définition précise du
problème. La formulation n'est pas l'occasion de raffiner les définitions du problème. C'est
plutôt l'occasion de formuler des solutions organisationnelles remarquablement couplées avec
les priorités politiques.
Les groupes de pression sont fortement présents à cette étape du processus. Ils avancent des
propositions, présentent des idées mais c'est aux acteurs gouvernementaux que revient le
pouvoir d'adopter les politiques publiques. Toutefois, c'est à cette étape qu'ils se montrent les
plus actifs. Ils mettent en avant leurs talents de communicateurs et leurs atouts relationnels et
informationnels afin d'orienter la direction des décisions publiques.
c- La phase de la mise en œuvre
Cette étape marque le passage de la préparation des plans et des programmes vers leur mise en
application. La mise en œuvre ou implementation désigne la phase pendant laquelle des actes et
des effets sont générés à partir d'un cadre normatif d'intentions, de textes ou de discours :
Implementation involves ail of the activities designed to carry out the policics enacted by the législative branch. Thèse activities include the création of new organization or the assignment of new responsibilities to existing organizations. Thèse organisations must translate laws in operational rules and régulations. They must hire personnel, draw up contracts, spend money and perform tasks (Dye, 2005: 52).
Pendant longtemps, les spécialistes et les chercheurs en la matière ont considéré cette étape du
processus comme évidente dans le sens où il suffit que les décisions soient prises pour que les
solutions soient simplement appliquées et que le problème soit par conséquent résolu. En
revanche, nombreuses études sur la mise en œuvre des politiques publiques ont montré que ces
politiques, une fois adoptées, n'étaient pas appliquées automatiquement à leurs publics, mais
qu'il y avait, au contraire, du «jeu» de la mise en œuvre, pour reprendre l'expression de
Baradach (Lemieux, 2002 : 97). Cette phase aboutit souvent à des re-formulations ou des
« réémergences » des problèmes. Voici ce que déclare Lemieux à ce sujet :
La réinformation par rétrovision sur les effets des programmes existants est une voie susceptible de faire surgir des problèmes, que cette réinformation vienne de statistiques officielles, de plaintes de la part des administrés [...]
21
La rein formation par rétrovision peut révéler que la mise en œuvre n'est pas conforme aux objectifs officiels, qu'elle coûte plus cher que prévu qu'elle a des conséquences inattendues, etc. (Lemieux, 2002 : 35).
Par ailleurs, il y a toujours eu une séparation nette entre la conception d'une politique par les
acteurs du sommet de la machine politique et leur exécution par d'autres acteurs qui se situent
au bas de la hiérarchie.
Les décisions politiques ne se souciaient pas suffisamment des répercussions sur les publics
touchés. Dans cette perspective top-clown, la mise en œuvre est une séquence linéaire
descendant d'un centre vers une périphérie. Après que cette méthode a démontré ses limites, on
a commencé à s'intéresser à une approche bottom-up qui met plus l'accent sur ceux qui sont
directement affectés par les actions des politiques et ceux qui prennent en charge leur
application (Howlelt et Ramesh, 2003 : 186).
d- La phase de l'évaluation
La quatrième séquence selon le modèle de Jones correspond à l'évaluation du programme,
«une phase préterminale de mise en perspectives des résultats de la politique. Elle englobe la
spécification de critères de jugements, la mesure de données, leur analyse et la formulation de
recommandations » (Muller, 2006 : 24). Evaluer une politique publique consiste à apprécier les
effets attribuables à une action gouvernementale. La démarche s'appuie sur des méthodes
scientifiques pour la mesure de l'efficacité et des effets prévus ou non des politiques publiques.
Elle peut être exercée sur l'une des séquences, souvent la mise en œuvre, ou encore sur
l'ensemble des séquences. Selon Knoepfel et Bussman (1998), les évaluations renseignent sur
réflectivité, l'efficacité ou l'efficience de l'activité étatique, elles sont réalisées avec un
objectif politique ou administratif concret, comme initier une mesure, légitimer une décision,
améliorer la mise en œuvre, bref elles doivent préparer les fondements d'une décision pendante
ou légitimer les mesures déjà adoptées.
Mcny et Thoenig (1989 : 289) ont identifié quatre attitudes d'évaluation. L'attitude descriptive
qui cherche à établir un simple inventaire des effets. L'attitude clinique qui consiste non
seulement à enregistrer des résultats mais aussi à les expliquer, les comparer avec les objectifs
affichés par la politique. L'attitude normative lorsque l'évaluateur n'adopte pas les objectifs
des décideurs, il leur substitue d'autres valeurs qu'il aura choisies lui-même.
22
L'attitude expérimentale s'attache à découvrir s'il existe des relations stables de causalité entre
un contenu donné d'une politique publique et un ensemble donné d'effets sur le terrain.
Un courant de recherche en sciences sociales sur les politiques publiques étudie la possibilité
qu'il y ait des organismes qui assument le rôle d'évaluateurs dans les systèmes politique: la
presse, des corps de contrôle au sein du secteur public, des groupes de pression, etc. Ces
derniers peuvent utiliser l'évaluation des politiques publiques comme arme de négociation afin
de fonder leur argumentaire contre la démarche étatique (Meny et Thoenig, 1989).
e- La phase de terminaison des politiques publiques
La fin d'une politique publique renvoie à l'arrêt de l'activité ou du programme de résolution.
Une activité prend généralement fin parce que l'autorité publique lui a placé une limite dans le
temps. Cette dernière étape du processus consiste donc à clôturer l'action. Elle suppose la
résolution du problème. Cependant, l'évaluation révèle souvent la nécessité d'ajuster cette
action ou mettre en place une nouvelle action (Muller, 2006). La phase de terminaison prend
moins d'importance que le reste du processus. Elle est absente des schémas séquentiels de
nombreux auteurs.
Pour Jones, étant donné que les problèmes politiques ne sont jamais définitivement résolus
cette étape correspond la plupart du temps à une réorientation ou à la mise en place d'un
nouveau programme avec des moyens et des objectifs différents (Jones, dans Muller, 2006 : 25).
Après avoir pris connaissance des différentes phases du processus de formulation des politiques
publiques, il apparaît que l'organisation de la représentation des intérêts s'effectue dès la phase
de l'émergence. Les groupes saisissent souvent les enjeux dès leur jaillissement afin de
multiplier les chances d'atteindre leurs objectifs. Ils sont parfois à l'origine de la publicisation
du problème en question à l'instar du modèle de l'émergence captée. Leur intervention est donc
à surveiller tout le long du processus.
f- Les Limites de l'approche séquentielle
En revanche, les processus de politiques publiques n'ont pas le caractère linéaire qu'on leur
prête parfois, de façon simplificatrice. Ces processus sont plutôt « tourbillonnaires », selon
l'expression de Monnier (Lemieux, 2002).
23
L'ordre des étapes peut être inversé ou perturbé ; certaines étapes peuvent être omises
volontairement ou involontairement, d'autres sont parfois difllciles à identifier. A ce propos,
Lemieux ajoute que les politiques publiques se déroulent en différents processus récurrents
parce que les tentatives de régulation sont constamment alimentées par l'information nouvelle
qui entraîne de nouvelles interventions sur les affaires publiques (Lemieux, 2002 : 19).
Muller, de son côté, soutient l'idée «qu'on a souvent avantage à concevoir une politique
publique non pas comme une série de séquences successives, mais comme un ensemble de
séquences parallèles interagissant les unes par rapport aux autres et se modifiant
continuellement » (Muller, 2006 :27).
À cet égard, il est conseillé de ne pas appliquer le modèle séquentiel de manière systématique,
comme le reconnaissent d'ailleurs les promoteurs de ce type d'approches, à commencer par
Joncs lui-même. Quant à Muller, il semble plutôt soutenir la représentation des politiques
publiques comme un flux continu de décisions et de procédures dont il faut essayer de
retrouver le sens. Cependant, l'auteur avoue que ce genre de schéma séquentiel vaut plus par
les questions qu'il conduit à poser que par les réponses qu'il peut apporter. Il permet de
s'interroger sur l'action des différents acteurs en présence contribue à construire différemment
la structure séquentielle d'une politique publique, et sur les acteurs qui pèsent le plus sur les
décisions d'une séquence à l'autre (Muller, 2006 :25).
C'est justement dans cette logique que nous abordons les politiques publiques dans notre
recherche. Notre intention est de focaliser sur l'action des groupes de pression et celle des
médias dans le jeu d'influence afin de pouvoir cerner les modalités d'intervention de ces
dernières à l'intérieur du processus des politiques publiques au Québec.
2- Le cadre d'analyse : le cas du Québec
Puisque nous allons étudier le cas d'une politique publique québécoise, il est judicieux de
s'attarder sur le cadre structurel qui conditionne la formulation et la mise en œuvre des
décisions publiques. Il s'agit du système politique en place au Québec.
Au Québec, le système politique se base sur un régime parlementaire. C'est le Parlement qui
détient le pouvoir législatif. Il est formé de l'Assemblée nationale et du lieutenant-gouverneur
du Québec.
24
Ce dernier a aujourd'hui une fonction plus symbolique que réelle. L'Assemblée nationale du
Québec ou la Chambre des élus détient le pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif est dans les
mains du gouvernement.
« Au Québec, le gouvernement et l'Assemblée nationale constituent un ensemble indissociable
[...], ils doivent travailler en étroite relation collaboration et l'accord de l'un est sans cesse
requis pour que l'autre puisse exécuter ses tâches» (Loriot, 1998: 389). Le Conseil des
ministres, ou Conseil exécutif, est le corps responsable des prises de décision dans le
gouvernement. Il se compose du Premier ministre, des ministres titulaires de ministères, des
ministres d'État et des ministres délégués2. Il érige l'action gouvernementale et l'administration
publique, veille à l'application de la loi, des règlements et des politiques.
Les hauts fonctionnaires interviennent en amont et en aval des décisions gouvernementales, ils
sont chargés de préparer puis d'appliquer les lois et les règlements. Dans les faits, « ils ne sont
pas que les simples exécutants des plus hautes autorités politiques : ils congédient les
demandes et ratissent les besoins de la société » (Loriot, 1998 : 394). Ils étudient les futures
décisions ministérielles et prévoient les conséquences de chacun des choix du gouvernement et
en évaluent les dimensions financières et budgétaires.
Les décisions publiques peuvent prendre la forme d'un arrêté3, d'un décret4 ou d'une loi.
Loriot (1998) distingue quatre étapes dans le cheminement des lois au Québec:
- La cueillette et la sélection des demandes
À l'origine, un projet de loi représente une réponse à des demandes ou à des besoins de la
collectivité qui émanent soit des particuliers, soit des associations ou des entreprises. Loriot
précise qu'aussitôt ces besoins sont manifestés, ils sont pris en charge par l'un des quatre
médiateurs suivants : les médias, les groupes de pression, les partis politiques et la fonction
publique. Certains problèmes sont tout à coup lancés sur la place publique et se transforment en
enjeux politiques. Les commissions d'enquête et les sondages d'opinion peuvent être à
l'origine de la révélation publique de ces problèmes.
" Site du premier ministre < htlp://www.premier-ministre.gouv.qe.ca/equipe/eonseil-des-ministres.shtml> Décision exécutoire de certaines autorités administratives (Bibliorom Larousse).
4 Décret : Acte à portée réglementaire ou individuelle pris par le président de la République ou par le Premier ministre (Bibliorom Larousse).
25
Les programmes des partis politiques peuvent aussi proposer des enjeux à l'ordre du jour
politique. De même, les fonctionnaires publiques reçoivent quotidiennement des requêtes et des
lobbyistes qui leur proposent de trouver des solutions à des problèmes particuliers.
La décision ministérielle
Ces enjeux publics nécessitent une réponse du gouvernement sous la forme de décision
ministérielle. À ce moment, le conseil des ministres dispose de quatre options ; il peut décider
d'ignorer le problème, de faire enquête, de présenter un projet de loi, ou de signer un arrêté en
conseil (décret). La dernière option concerne d'une façon générale les simples modalités
administratives et les nominations.
La légitimation par l'Assemblée nationale
Il s'agit de faire adopter le projet de loi (ou encore la décision retenue par les ministres à
l'étape précédente) par l'Assemblée nationale. « La discussion et les votes permettent aux
députés, mais aussi aux groupes de pression de l'extérieur de s'exprimer [...]. Certains projets
sont adoptés en quelques jours, mais d'autres exigent plusieurs mois de travail des députés et
d'intenses efforts de mobilisation extra-parlementaire » (Loriot, 1998 .401).
L'administration des lois
Une fois qu'une loi est entrée en vigueur, les ministres concernés doivent préparer les règles
qui précisent sa mise en pratique. L'administration proprement dite des lois est confiée aux
fonctionnaires.
Revenons à la troisième étape pour examiner de près le cheminement d'un projet de loi au
Québec depuis sa présentation jusqu'à sa sanction à l'Assemblée nationale. Cette démarche
complétera notre compréhension du processus de la prise des décisions publiques au sein de la
province.
Loriot indique qu'il faut tout d'abord distinguer les projets de lois privés qui relatent des
intérêts particuliers ou locaux et les projets de lois publics qui s'appliquent à toute la
population ou à une partie importante de celle-ci. 11 faut aussi distinguer les projets de lois
financières des autres. « Seul un ministre peut présenter un projet de loi public comportant des
incidences financières, dans la mesure où cette proposition législative engage les deniers de
l'État» (Loriot, 1998:421).
26
L'adoption d'un projet de loi peut se résumer en quatre étapes essentielles. La première est
l'étape de la présentation où un ministre (ou un député) propose un projet de loi public. C'est
lui qui se charge de piloter le projet jusqu'à son adoption. À cette étape il se contente de lui
attribuer un titre et de présenter quelques explications résumant son contenu. L'Assemblée se
prononce sans débat sur la motion proposant qu'elle se saisisse du projet de loi.
En second lieu, l'Assemblée peut choisir d'acheminer le projet de loi en commission
permanente pour qu'il y fasse l'objet d'une consultation générale ou particulière. À cette
occasion, les mérites et les conséquences de la nouvelle décision seront discutées publiquement,
les personnes et les groupes concernés pourront faire part de leurs commentaires et de leurs
suggestions aux législateurs. « Cette stratégie permet d'obtenir dès le départ l'heure juste de la
part des citoyens et des groupes de pression affectés par la nouvelle mesure » (Loriot, 1998 :
425).
Ensuite, l'Assemblée nationale entreprend un débat sur la pertinence du projet de loi, puis vote
sur son principe. Une fois que la motion est agréée, le projet de loi va ou retourne, selon le cas,
en commission permanente. Il fait alors l'objet d'une étude détaillée article par article. Tous les
membres de la commission parlementaire peuvent proposer des amendements mais sans
toucher au principe adopté dans l'étape précédente. À l'issue de cette étape un rapport est
déposé. Il doit être adopté par l'Assemblée nationale. Toutefois, encore ici de nouveaux
amendements pourront venir modiller le projet de loi. Finalement, à l'étape de la sanction, le
lieutenant-gouverneur signe la copie officielle du projet de loi adopté qui aura ainsi force de loi.
Loriot souligne qu'au Québec la démocratie commande que les grandes décisions politiques
soient prises de façon transparente et débattues publiquement avant leur application. La
participation des citoyens est favorisée dans les différents niveaux de la décision politique. Les
groupes de pression incarnent l'un des moyens de l'expression sociale. L'auteur classe ces
institutions parmi les pouvoirs contrôleurs du tandem politique gouvernement-Assemblée
nationale.
Après avoir pris connaissance des différentes étapes pour l'adoption des lois québécoises, dans
les prochaines pages nous allons nous consacrer à l'étude des groupes de pression ; nous allons
commencer par les définir ensuite, nous allons identifier leurs caractéristiques ainsi que leurs
stratégies d'intervention dans ce processus de formulation des politiques publiques.
T!
Chapitre 2 : LES GROUPES DE PRESSION ET LEURS RELATIONS AVEC LES MÉDIAS
A- Les groupes de pression
1- Définition des groupes de pression
Le concept de groupes de pression émerge des sciences politiques et particulièrement du champ
des affaires publiques. Toutefois, de part sa complexité, il constitue un objet d'étude pour
plusieurs disciplines et champs de recherche, en l'occurrence la sociologie des organisations, la
politologie ainsi que les sciences de la communication qui se préoccupent des répertoires
d'action mis en oeuvre par ces groupes.
Maisonneuve note que les groupes de pression ont connu une croissance fulgurante au cours
des années 1960-1970, en raison notamment d'une prise de conscience de la diversité des
enjeux touchant les citoyens (Maisonneuve, 2004 : 225).
Plusieurs auteurs ont tenté de définir les groupes de pression. Grant (1995) estime qu'« un
groupe de pression est une organisation qui désire influencer la formulation et la mise en place
d'une politique publique ». Il réduit ainsi la définition de ces organisations en leur objectif
d'introduire des changements sur les politiques publiques.
Plus exhaustive et marquée par une perspective de relations publiques, la définition donnée par
Grunig et Dozier et reprise par Maisonneuve (2004), considère qu'un groupe de pression est un
public activiste, composé d'individus regroupés dans le but d'exercer une influence sur un
autre groupe ou sur plusieurs groupes par le biais de l'action, qu'elle se manifeste par
l'enseignement, le compromis, la persuasion, les tactiques de pression ou la force.
En se référant à cette définition, Maisonneuve conclut qu'un groupe de pression est « une entité
organisée, formée de membres actifs et ayant des objectifs clairs. Ces membres doivent être
mobilisés face à l'atteinte d'objectifs touchant certaines politiques gouvernementales » (2004 :
226).
>K
Ainsi, ces deux définitions mettent l'accent sur le caractère activiste des groupes. Elles font
d'abord allusion à la structure ou à la composition des groupes, aux ressources humaines, aux
objectifs poursuivis par les groupes de pression ainsi qu'à leur champ d'intervention. Nous
développerons ultérieurement chacun de ces aspects.
Par ailleurs, il est important de souligner que dans les écrits qui se penchent sur ce phénomène,
plusieurs termes sont utilisés pour désigner ce genre d'organisations comme « société civile »
ou « mouvements sociaux ». Un amalgame existe entre les expressions « groupes d'intérêt » et
« groupes de pression » qui sont parfois employées comme des synonymes.
Pour Offerlé (1994 : 21) par exemple, le terme groupe d'intérêt est d'apposition récente dans la
littérature sociologique française. Il tend à supplanter le vocable ancien de «groupe de
pression ». Selon l'auteur, la fonction première des groupes d'intérêt est de « faire pression sur
les détenteurs de positions de pouvoir bureaucratico-politique en accédant à la position d'acteur
pertinent reconnu [...] dans la définition des politiques publiques en général ou de certaines
politiques sectorielles » (Offerlé, 1994: 26). Cette définition des groupes d'intérêt leur attribue
les mêmes caractéristiques que ce-que nous venons de voir pour les groupes de pression ce qui
signifie que pour certains les deux termes désignent la même chose.
À ce propos, Grossman et Saurugger (2006 : I I) précisent que le choix de l'un ou l'autre des
deux termes présente des aspects sociologiquement et idéologiquement très diversifiés et
hétérogènes.
Par conséquent, nous concluons que les groupes de pression sont forcement des groupes
d'intérêt, dans la mesure où ils ont des intérêts à préserver. Ils se distinguent essentiellement
parce que leur action est orientée vers le pouvoir politique qu'ils visent à inlluencer dans le
sens favorable à leurs intérêts. Loriot (1998: 160) souligne que « les groupes d'intérêt se
transforment temporairement en groupes de pression lorsqu 'ils désirent influencer les pouvoirs
publics ».
20
2- Les principales caractéristiques des groupes de pression
Les définitions des groupes de pression tournent autour de trois éléments principaux à savoir
l'idée de se mettre en groupe pour défendre un intérêt ou une cause, l'influence exercée sur le
pouvoir politique et les moyens et ressources disponibles pour atteindre ses objectifs.
a- Influence des pouvoirs politiques
Les groupes de pression articulent leurs demandes politiques de la société. Leurs différentes
interventions visent le changement, l'amélioration ou le maintien d'une politique
gouvernementale, d'une loi ou d'un règlement ayant rapport avec la cause défendue, que celle-
ci soit humanitaire, sociale, économique, politique ou culturelle.
Selon certains auteurs, les groupes de pression ne sont pas des organisations politiques même
s'ils participent à des systèmes d'actions où ils sont en rapport direct et indirect avec des
organisations politiques. Vincent Lemieux classe ces organisations parmi la catégorie des
intéressés. Cette catégorie regroupe les acteurs dans le public dont les intérêts sont touchés par
les politiques ; ils sont amenés à participer aux différentes étapes de la formulation des
politiques publiques (Lemieux, 1991 : 20-25).
Les relations entre groupes de pression et gouvernements tiennent à la nature du système
politique en place. Selon le cas, ils peuvent être en relations de compétition, de consultation, de
concertation ou encore de cooptation, selon Hayward (1996 : I I). Un groupe de pression peut
s'opposer au gouvernement, il peut tenter de s'organiser non plus seulement pour influencer le
pouvoir mais pour participer à sa conquête et à son exercice. Ce groupe tente de se muer en un
parti en entrant complètement dans l'arène politico-électorale, comme les mouvements
écologistes ou les partis socialistes travaillistes en tant qu'expression politique des intérêts de la
classe ouvrière et de ses syndicats (Grossman et Sauruggcr, 2006 : 12).
b- Répertoires et ressources des groupes de pression
Les groupes de pression recourent à divers répertoires d'action. Ln fonction de la situation
présente, ils peuvent opter pour la négociation et la consultation, le recours à l'expertise, la
protestation ou parfois même le recours au pouvoir judiciaire.
50
L'expression « répertoire d'action » renvoie aux travaux de Charles Tilly (1984 et 1986) ; elle
désigne « les moyens établis que certains groupes utilisent afin d'avancer ou de défendre leurs
intérêts». Ollitrault (1999, p 156) remarque que le choix du terme répertoire, avec ses
connotations musicales, vise à souligner que les mouvements sociaux agissent toujours en
emprunt, invention et réinvention des standards d'action.
Les professionnels des relations publiques sont fortement sollicités par ces groupes afin
d'entretenir des relations avec les représentants gouvernementaux, de concevoir les plans
d'action et d'organiser des événements publics. Dans la plupart des cas, les médias constituent
un outil indispensable à leur activité ; ils permettent de joindre des milliers de personnes et
procurent une reconnaissance sociale et une visibilité publique. D'ailleurs, le répertoire
d'action des groupes de pression peut être divisé en deux grandes catégories : les campagnes
d'influence dans les couloirs du pouvoir politique (les techniques du lobbying direct) et les
campagnes d'opinion publique auprès de la population désignée par lobbying indirect. Dans le
second chapitre de ce mémoire, l'attention sera portée exclusivement sur les campagnes
d'opinion publique et les relations entre médias et groupes de pression.
Par ailleurs, selon Grossman et Saurugger, la capacité d'agir et le pouvoir de ces acteurs sont
conditionnés par les trois formes de ressources : les ressources financières, sociales et
sociétales.
Les facteurs caractérisant les ressources sociales sont le mode d'organisation du groupe, la nature de ses élites, le degré d'institutionnalisation du groupe au sein de l'appareil politico-administratif, le savoir faire et l'expertise mobilisable... Les ressources sociétales concernent largement la perception du groupe au sein de la société (Grossman et Saurugger, 2006 :14).
3- Typologie des groupes de pression
Nombreux auteurs ont dressé des typologies des groupes de pression. Grant (1989: 11)
propose de faire la distinction entre les groupes de pression qui défendent une cause (cause
groups) et les groupes de pression qui représentent les intérêts d'une section de la communauté
(sectional groups) comme les groupes d'ouvriers ou ceux des patrons.
M
Il indique que les valeurs défendues par cette deuxième catégorie de groupes ne peuvent pas
toucher l'ensemble de la population ; ils sont spécifiques à un profil particulier de personnes.
Tandis que, les « cause groups » défendent des valeurs qui peuvent concerner l'ensemble de la
population selon les convictions des uns et des autres. Ce qui fait que leurs revendications sont
plus facilement susceptibles de devenir des sujets de débat public.
Une autre classification établie par Granl et Aberdeen Research Group divise les groupes de
pression en trois sections et ce, en fonction de la distance qu'ils maintiennent par rapport au
gouvernement.
L'auteur fait la distinction entre les groupes de pression avec un statut externe à l'appareil
gouvernemental, les groupes avec un statut interne et les groupes de pression avec un statut
ambigu (Maisonneuve, 2004 : 228)5.
a- Les groupes de pression avec un statut interne
Les groupes de pression appartenant à cette catégorie tentent de se rapprocher le plus possible
de l'appareil gouvernemental et du processus décisionnel afin de pouvoir agir directement sur
l'orientation d'une politique.
Ils sont consultés régulièrement par les instances responsables de la rédaction et la révision des
politiques publiques puisqu'ils disposent de données et d'études privilégiées concernant leur
champ d'activité.
C'est le statut le plus convoité par les groupes de pression en quête d'influence, mais il
demeure conditionnel de la reconnaissance gouvernementale. Le gouvernement doit
reconnaître officiellement ces groupes comme une source d'information indispensable pour la
rédaction d'une politique. À cette fin, « les groupes doivent démontrer un certain degré de
politique, c'est-à-dire la capacité de parler le langage politique », selon l'expression de Grant,
1995 (Maisonneuve, 2004 : 230). Les groupes de pression avec un statut interne se subdivisent
en trois niveaux, en fonction du degré d'influence exercé sur le pouvoir politique ainsi que de
leur positionnement dans le processus décisionnel.
Voir le tableau page 36
32
Les groupes qui ont une influence permanente et qui collaborent étroitement avec le processus
décisionnel sont dits les groupes de pression avec un statut interne captif. Les groupes de
pression à influence soutenue et qui sont fréquemment consultés par les pouvoirs politiques
sont désignés par les groupes de pression avec un statut interne rapproché. La troisième sous
catégorie est celle des groupes de pression avec un statut interne éloigné. Ces groupes sont
caractérisés par une influence variable, un positionnement en périphérie du processus
décisionnel, et une consultation sur base contextuelle et sporadique (Maisonneuve, 2004 : 230).
Les groupes de pression avec un statut interne sont plus susceptibles de faire usage des
techniques de lobbying direct ce qui correspond à l'ensemble des outils utilisés dans les
contacts engagés et développés directement avec les personnalités politiques que l'on souhaite
inlluencer. Ils demeurent inconnus du public et reposent en grande partie sur la communication
personnelle. Les groupes de pression avec un statut interne tentent d'obtenir des rencontres
avec des hauts fonctionnaires, participent aux commissions parlementaires et aux tables de
concertations, participent à une multitude d'événements à haute fréquentation politique,
commandent et rédigent des rapports de synthèse destinés au centre du pouvoir politique
(Maisonneuve, 2004 : 239).
h- Les groupes de pression avec un statut externe
Les groupes de pression appartenant à cette catégorie font plutôt usage des techniques de
lobbying indirect. Us tentent d'influencer l'opinion publique par l'intermédiaire des médias et
des relations publiques, d'une manière générale, dans le but de faire pression sur le
gouvernement. Plusieurs stratégies de sensibilisation sont déployées, l'objectif étant de
démontrer au gouvernement que la cause défendue est appuyée par l'opinion publique.
Pour ainsi faire, cette catégorie de groupes de pression doit porter une attention particulière aux
médias en entretenant de bons contacts au sein des organismes de presse. L'activité prisée par
cette catégorie de groupes consiste à organiser des événements fortement médiatisés afin
d'attirer l'attention du public vers l'enjeu soulevé et mettre la pression sur les acteurs politiques.
Le recours à ce genre d'événements fait en sorte qu'il n'est pas nécessaire que la majorité de la
population appuie une décision pour qu'elle soit prise ; le battage médiatique joue un rôle
important dans l'orientation des décisions gouvernementales.
33
D'après Maisonneuve (2004 : 232), les groupes de pression ayant un statut externe se
subdivisent en trois sous-groupes. Le premier sous-groupe possède une influence minime sur le
processus décisionnel ; il est rarement consulté par les pouvoirs politiques. Toutefois, il est
caractérisé par une grande visibilité médiatique avec une action à haut contenu visuel. Il s'agit
des groupes de pression avec un statut externe idéologique. Le deuxième sous groupe est celui
des groupes de pression avec un statut externe obligatoire ; ils ont de l'influence sur des enjeux
précis, ils ont peu de culture politique. La troisième sous catégorie se rapproche du profil des
groupes de pression avec un statut interne, ils ont une culture politique et participent à des
enjeux de taille et répétitifs. Il s'agit des groupes de pression avec un statut externe potentiel.
c- Les groupes de pression avec un statut ambigu
Les groupes affiliés à cette troisième catégorie ont un statut ambigu parce qu'ils sont
considérés à la fois comme des groupes de pression avec un statut interne et des groupes de
pression avec un statut externe. Us utilisent leur ambivalence pour mettre en œuvre, lorsque
cela est approprié, les stratégies de relations publiques permettant de faire avancer leur cause.
Maisonneuve cite les syndicats comme les groupes les plus représentatifs de cette catégorie. A
l'instar des groupes à statut interne, ils connaissent les rouages des différents paliers du
gouvernement et de la haute fonction publique, maîtrisent le langage technocratique et sont
régulièrement consultés par les gouvernements. Cependant, ils ont souvent recours à des
stratégies de relations publiques empruntées des groupes de pression à statut externe.
Appartenir à un statut ou un autre dépend du rôle accordé aux groupes par le gouvernement en
place et l'administration publique, la pertinence de leur prise de décision, leur connaissance des
enjeux et leur facilité de s'exprimer dans un langage politisé. Pour certains auteurs comme
Grant, les groupes en quête d'un statut particulier doivent poursuivre des stratégies appropriées
auprès du gouvernement. Toutefois, Maisonneuve affirme que c'est la nature des demandes du
système politique en place qui détermine les statuts des groupes de pression et que ces derniers
n'ont pas vraiment le choix.
D'autres auteurs tel que Walker (1991) estiment plutôt que l'obtention d'un statut particulier
dépend des ressources dont dispose le groupe :
M
Un groupe ayant accès à d'importantes ressources financières possède une plus grande marge de manœuvre pour commander des recherches, engager des firmes de lobby ou de relations publiques ou embaucher du personnel spécialisé dans l'une ou l'autre de ces professions, des éléments clés dans l'obtention d'un statut interne (Maisonneuve: 233).
Maisonneuve souligne aussi que le statut n'est pas définitif: certaines bévues ou maladresses
peuvent parfois faire perdre le statut d'un groupe. Ce dernier doit respecter les règles du
processus de consultation en s'assurant de donner une information précise, bien documentée et
sans exagération sur laquelle les décideurs peuvent s'appuyer en toute confiance.
Le modèle développé par Grant présente une façon lucide de cerner les différences de rôles et
de poids entre les groupes de pression à l'intérieur du processus décisionnel. Plusieurs auteurs
s'accordent pour dire qu'un groupe n'est pas classable dans une seule catégorie, et qu'il n'y a
pas une seule ligne typologique envisageable.
Par ailleurs, Offerlé (1994) remarque que « le souci de maîtriser la bonne définition et le bon
classement est une caractéristiques récurrente chez les groupes de pression ». Pour s'en
apercevoir, l'auteur précise qu'il suffit d'interroger des représentants des groupes ou
d'examiner leurs plaquettes officielles pour retrouver les expressions de dénégation comme
« nous ne sommes pas », les expressions de positionnement comme « nous ne sommes que » ou
d'affirmation comme « nous sommes ».
Aujourd'hui qu'ils représentent un des acteurs de chaque paysage politique, la présence des
groupes de pression diffère d'un pays à l'autre, d'un système politique et social à l'autre.
Grossman et Sauruggcr (2004) soulignent que la volonté et la capacité de prendre en charge des
responsabilités dans le processus politique sont différentes aussi selon les pays.
55
Figure 2 : Tableau récapitulatif de la typologie des groupes de pression de Maisonneuve (
Groupes de pression avec un statut interne
Groupes de pression avec un statut externe
Groupes de pression avec un statut ambigu
Distance au pouvoir Rapprochés du processus
décisionnel parce qu'ils
reconnus officiellement par le
gouvernement comme source
indispensable pour la formulation des
politiques publiques
Éloignés du processus
décisionnels
Considérés comme des groupes de
pression avec un statut interne et externe à la fois.
Ils ont une grande culture politique
Formes Trois sous-groupes
1- Statut interne captif:
Inllucnce permanente
2- Statut interne rapproché : Souvent
consultés 3-Statut interne
éloigné : Inllucnce variable
Trois sous-groupes 1 - Statut externe
idéologique : peu d'influence sur le
processus décisionnel, actions
fortement médiatisées
2- Statut externe obligatoire :
influence sur des enjeux précis, peu
de culture politique 3- Statut externe
potentiel : Culture politique
importante et participation et des enjeux de taille et
répétitifs
Exemple : Les syndicats
Techniques de lobbying
Techniques de lobbying direct : Communication
personnelle, rédaction de
rapports destinés au centre du pouvoir
Techniques de lobbying indirect,
recours aux médias et à l'opinion
publique
Techniques de lobbying direct et
indirect
4-Les groupes de pression au Québec
Dans son ouvrage La démocratie au Québec : origine, structure et dynamique, Loriot s'est
prêté à l'exercice d'identifier les principaux groupes de pression. L'auteur précise qu'il s'agit
d'une enquête complexe, étant donné que « les pressions exercées sur le gouvernement ne sont
pas toujours de nature transparente. Elles échappent souvent au regard du public /.../» (Loriot,
1998: 162).
L'auteur a posé deux critères pour dresser une liste sélective des groupes de pression
québécois : d'abord, le taux de réussite des groupes en comparant leurs demandes auprès du
gouvernement avec les réponses de ce dernier ; ensuite, les ressources politiques des groupes,
c'est-à-dire les atouts dont ils disposent et qui leur accordent du pouvoir.
Loriot conclut qu'au Québec, le groupe de pression le plus puissant est sans contredit le milieu
des affaires. « // obtient le plus souvent ce qu 'il demande aux gouvernants parce qu 'il dispose
de trois ressources politiques jugées essentielles par le parti au pouvoir : l'argent, la création
d'emploi et le contrôle des médias» (Loriot, 1998 : 162). Au deuxième rang, on trouve les
centrales syndicales, qui bénéficient d'un poids électoral et d'une capacité de mobilisations
considérables. Lnsuite, les agriculteurs qui possèdent une valeur stratégique dans l'économie.
Suivis de la minorité linguistique, c'est-à-dire les anglophones et les allophones qui ont
tendance à former un bloc monolithique lors des scrutins. Puis les autochtones, grâce à leur
place stratégique sur le territoire. Les grandes villes et les communautés urbaines, comme la
ville de Montréal, obtiennent beaucoup de « retombées » des autorités provinciales et fédérales
grâce à leur poids électoral. Au septième rang, Loriot classe les corporations professionnelles et
les diplômés d'université qui ont d'importantes ressources relationnelles, des ressources de
compétence et d'expertise.
5- Les stratégies déployées par les groupes de pression
L'activité des groupes de pression puise largement dans les techniques des relations publiques,
qui se définissent comme « la tentative de gagner le soutien du public pour une activité, une
cause, un mouvement, ou une institution, en se servant de l'information de la persuasion ou de
la constitution d'un terrain d'entente » (Bernays, 1965).
VI
Ils ont développé une panoplie de stratégies d'intervention. Leurs campagnes sont mises au
point par un personnel qualifié en relations publiques et par des experts dans les médias.
De nombreux auteurs dont Grunig et I lunt (1984) constatent que c'est en raison de leurs talents
de rclationnistes que les groupes de pression s'imposent comme de redoutables acteurs sur la
scène politique. Leurs choix stratégiques sont étudiés en fonction de la place conjoncturelle
qu'ils occupent dans le champ de la représentation.
Un groupe doit d'abord identifier le type de concurrents auxquels il fait face, l'orientation de la
politique gouvernementale, les valeurs et les intérêts considérés comme défendables et
légitimes par les leaders d'opinion ainsi que les ressources dont il dispose pour pouvoir agir de
façon appropriée (Offerlé, 1994 : 108). Il se fixe des objectifs précis et autant que possible
réalisables et mesurables, comme le prévoit tout programme de relations publiques
(Maisonneuve, 2004).
Qu'elle se manifeste par la voie médiatique ou hors médiatique, l'action des groupes de
pression est soutenue par des choix stratégiques, qui demeurent toujours tributaires de ses
ressources et du rapport de ses forces à celles de ses partenaires et adversaires dans l'espace
public.
Plusieurs auteurs ont tenté de classer la multitude d'aspects stratégiques qui appuient ces
répertoires d'action. Nous avons retenu cinq éléments stratégiques susceptibles d'être derrière
les répertoires d'action développés par les groupes de pression.
a- « La mobilisation de I'action » ou « la mobilisation du consensus »
Les actions de relations publiques des groupes de pression varient en fonction des objectifs à
court ou à long terme recherchés derrière chaque campagne. Klandermans et Omegema (1987)
font la distinction entre deux démarches d'intervention : « La mobilisation du consensus » et la
« mobilisation de l'action ».
« La mobilisation du consensus» s'emploie à éduquer un public et le sensibiliser afin de le
rallier à une revendication. Ollitrault associe cette première démarche à un registre de
communication puisqu'elle vise à tenir « éveillée » une opinion qui, sans être mobilisée
continuellement, constitue une sorte de stock et de soutien diffus et constant.
(8
Certains supports comme les documentaires ou les programmes éducatifs sont justement des
moyens fiables pour sensibiliser le public et attirer des sympathisants. Cette stratégie est
privilégiée chez les mouvements écologistes (Ollitrault, 1999 : 174).
Le capital de sympathie constitué de façon latente dans l'opinion publique pourra être mobilisé
ou mis en scène au moment opportun par d'autres formes de communication que l'auteur
associe à un registre de « mobilisation ». La stratégie de « mobilisation de l'action» telle que
désignée par Klandermans et Omcgema vise cette fois à déclencher des actions ponctuelles, des
mobilisations sur un thème ou un enjeu et ce, suite à une situation de crise ou en réaction à une
décision. Cela peut se produire notamment sur un mode « pro-actif » dans les situations où le
groupe décide d'introduire sur l'agenda politique certains intérêts jusque-là inconnus ou
négligés. La mobilisation de l'opinion publique peut revêtir de nombreuses formes.
Il ne suffit plus de sensibiliser l'opinion publique à un problème, il est nécessaire de recueillir des preuves d'anxiété générale qui devient par la mise en scène un soutien à l'action de ces groupes. [...] L'opinion non plus favorable, mais mobilisée, peut être construite sur divers sites, les manifestations de rue avec retransmission dans les médias, le recueil de signatures dans les lieux de réunion ou de soutien, sur les sites Internet via le courrier électronique (Ollitrault, 1999 :175).
b- Le recours au nombre
Dans certains cas, les groupes composent leur répertoire d'action de façon à faire parler le
nombre ou encore « jouer l'effet de masse », selon l'expression de Clamen (2000).
Offerlé souligne que le nombre apparaît d'une part comme un facteur de représentativité
puisqu'il informe sur l'effectif qui partage les soucis du groupe et d'autre part comme un
facteur de légitimité puisqu'il exprime la capacité de nuisance matérielle ou symbolique d'un
groupe par rapport aux autres. Les groupes font parler le nombre pour se constituer comme
groupe, pour exister comme groupe, pour provoquer un débat et y intervenir (Offerlé, 1994:
I 13).
II existe de nombreuses façons de faire usage du nombre. Un groupe peut inviter ses adhérents
et sympathisants à écrire, téléphoner ou télégraphier un destinataire, il peut les appeler aussi à
joindre leurs noms aux listes de signatures attachées à un texte.
V)
De même, l'organisation de manifestations de protestation peut avoir l'impact d'impressionner
par le nombre. Bn mobilisant une masse pour occuper un espace public et parfois bloquer des
artères et des rues, on crée un événement spectaculaire qui donne le moyen d'avoir une large
visibilité médiatique et par conséquent, un écho immédiat auprès de la population. Certains
groupes choisissent de nouer des alliances et chercher des alliés parmi les acteurs de la scène
publique. À ce propos, Clamen (2000 : 78) note :
L'influence est un jeu à partenaires multiples [...] Il est rare de réussir son influence en restant seul. Des alliés sont nécessaires pour accroître la crédibilité ; accroître la représentativité en parlant au nom d'un intérêt plus collectif, donc plus facile à assimiler à l'intérêt général et triompher dans certaines procédures de décisions qui se fondent sur des votes à la majorité.
Par ailleurs, les opinions sondées puis diffusées dans les médias constituent une autre façon
d'afficher le nombre et de le faire parler.
Conscientes de cet enjeu, certaines organisations privées créent leurs propres coalitions et
mouvements publics qui visent à défendre leurs intérêts notamment lorsqu'elles font l'objet
d'accusations et d'attaques de la part d'autres mouvements. Ces groupes «privés» vont
chercher à rassembler et mobiliser les parties qui partagent les intérêts de l'entreprise, ce qui va
permettre de contrebalancer la pression et d'imposer un point de vue différent dans le débat
public. Très souvent, ces coalitions sont construites avec l'aide des agences de relations
publiques. Les conditions de leur naissance et leur rattachement aux multinationales sont
généralement ignorés par le grand public6.
c- Le recours à la science
Afin d'attirer l'attention du public et pouvoir le convaincre de ses points de vue, les groupes
sont parfois invités à faire preuve d'expertise et d'une bonne maîtrise de la problématique
qu'ils abordent.
Le lobbying exige alors un travail de documentation permanent, il suppose aussi un travail
méthodologique de recherche et d'argumentation souvent technique pour déclencher des
phénomènes d'opinion favorable.
6 Notes de cours « Communication et affaires publiques », Moumouni (2006).
40
Pour étayer leurs thèses, les groupes produisent des discours qui se veulent de plus en plus
scientifiques plutôt qu'idéologiques. Ils n'hésitent pas à recourir à des avis techniques ou puiser
leur argumentation dans des études scientifiques et des rapports d'experts. En fonction des
circonstances, les groupes de pression commanditent des études, des rapports ou des dossiers
auprès des personnes ou des organismes reconnus dans le monde scientifique. La production et
l'utilisation de l'expertise sont présentées comme des réponses rationnelles à des problèmes
précis (Grossman et Saurugger, 2006).
Dans la plupart des cas, le soutien d'un expert est susceptible de donner un écho positif auprès
du public et de favoriser le processus d'influence ; encore faut-il respecter certaines conditions
dans le choix de ces personnes, tel que la compétence dans la discipline en question et
l'indépendance, dans la mesure où la position de l'expert doit incarner la vérité dans le sens
scientifique du terme (Clamen, 2000 : 119).
La stratégie de faire valoir le point de vue scientifique pour appuyer ses propres positions peut
aussi se manifester dans l'organisation des colloques et des rencontres scientifiques.
D'après Offerlé (1994), un colloque est une forme de mobilisation scientifique qui, inventé
dans les années 50 a beaucoup servi à la construction de mouvements sociaux comme les
mouvements des jeunes, des femmes, les mouvements anti-nucléaires ou les mouvements
écologiques. « Organiser un colloque et remplir une salle, c'est une manière pour un groupe de
pression de montrer sa capacité à intéresser un public techniquement compétent sur la question
et tenter d'imposer un thème comme digne d'intérêt » (Offerlé, 1994, pi24).
d- Le recours à la vertu
La vertu est un autre ressort sur lequel les groupes de pression peuvent tenter d'agir et qu'ils
peuvent conjuguer avec les autres stratégies déjà vues. Dans certaines situations, les groupes
vont intervenir en appelant à l'obligation morale. Ils utilisent les techniques de
« scandalisation » afin d'alerter l'opinion et culpabiliser les responsables. Selon les
expressions d'Offerlé, scandaliser c'est affirmer qu'un seuil a été franchi et que ceci n'est pas
tolérable, c'est énoncer qu'il y a scandale en le décrivant, le montrant, le photographiant ou le
télévisant. « Dévoiler le sang qui coule, les enfants qui meurent la nature détruite [...] En
appeler à l'obligation morale, au devoir de solidarité au respect de l'homme [...] » (Offerlé,
1994: 126).
Il
Cependant, Offerlé constate que le monde social est un cimetière de groupes et de causes
latentes non réalisés. Beaucoup de scandales sont morts-nés faute d'avoir été construits comme
scandaleux. Il faudrait élargir le répertoire d'action pour permettre au scandale de produire
l'effet escompté ; faire des conférences de presse, acheter des pages de publicité dans les
journaux ou encore lancer des campagnes d'affichage.
e- Le recours à la rhétorique
Il est important pour les groupes de pression de bien gérer leur argumentaire. Peu importe
qu'ils optent pour un répertoire d'action médiatique ou hors médiatique, ils sont appelés à
formuler leurs messages de façon à garantir leur compréhension et leur assimilation par le
public cible.
Un argumentaire peut poursuivre plusieurs fonctions. Il permet d'abord d'exposer la thèse
défendue, de refléter une certaine image du destinateur, de nouer une relation de partenariat
avec les décideurs et de contrer les arguments adverses. A travers l'argumentation, les groupes
de pression déterminent aussi le terrain de débat et mettent en exergue les facettes du dossier
qui leur sont plus favorables.
Pour Clamen (2000 : 102), un argumentaire est à la fois un acte tactique, par le choix du terrain,
et une communication. Il doit permettre au groupe d'inspirer confiance par sa représentativité
et son sérieux. Il doit informer en apportant des éléments factuels qui éclairent la thèse et
l'appuient, séduire en donnant envie d'en savoir plus sur la position défendue. Il doit
notamment convaincre par la logique du raisonnement. Cependant, de rationnel le débat
devient vite passionnel, voire dramatisé, remarque l'auteur.
f- Le recours aux tribunaux
En cas de véritables crises, les lobbyistes ont le choix entre plusieurs degrés dans l'escalade qui
peut arriver jusqu'au recours aux tribunaux. « Ouvrir un contentieux peut être un moyen
d'influence et de forte pression. Cela peut permettre non seulement défaire respecter ses droits,
mais aussi d'obtenir un changement des règles » (Clamen, 2000). Toutefois l'auteur souligne
que cette technique est à manipuler avec précaution et qu'avant de s'y lancer il faut
juridiquement être sûr de ses atouts.
42
De façon générale, résument Grossman et Saurugger (2006), les groupes d'intérêt
s'intéressent de très près au fonctionnement de la justice. D'abord, parce que les
tribunaux rendent des décisions qui apparaissent comme synonymes de défense de
l'intérêt général contre certains intérêts spécifiques, ensuite, parce qu'ils peuvent
intervenir pour influence la formulation des lois et des législations.
g- Le recours aux coalitions
Dans certaines situations, les groupes de pression, dont les enjeux et les revendications
convergent, décident de mettre en commun leurs efforts et leurs moyens de façon à obtenir des
responsables politiques des décisions conformes à leurs intérêts. Ils se regroupent sous forme
de coalitions.
Une coalition de groupes de pression est crée parce qu'elle est jugée plus efficace pour arriver
aux buts fixés. Chaque membre autonome est persuadé qu'en étant regroupé avec d'autres
acteurs, il peut obtenir plus d'avantages que s'il se retrouvait hors de la coalition. Les membres
sont conscients qu'ils sont libres d'y adhérer, et par conséquent, libres de la quitter. La
coalition est aussi appelée à disparaître à plus ou moins long terme après avoir permis
d'avancer la cause de ses membre ou si elle est jugée inefficace. Cette stratégie d'action
collective est fondée sur la mise en commun de ressources variées : des ressources d'expertise,
humaines, financières et matérielle (Boulanger, 1999 : 92). Ce qui la rend susceptible de
renforcer la légitimité de la cause et d'augmenter le pouvoir des groupes de pression sur la
scène publique.
Ainsi se résument les principales stratégies d'intervention des groupes de pression. Dans les
pages suivantes, nous abordons la question de la médiatisation des problèmes publics en
mettant l'accent sur les relations entre les groupes de pression et les entreprises médiatiques.
B- Rôle et importance des médias pour l'action des groupes de pression
1- Le lobbying indirect ou les campagnes d'opinion publique
L'appui de l'opinion publique peut constituer le moyen le plus efficace pour un groupe de
pression si nous partons du principe que le parti au pouvoir a besoin lui aussi de l'appui de
l'opinion publique.
43
Les techniques de lobbying indirect permettent de conquérir l'espace public et de faire
délibérément du public un témoin ou même un acteur dans le jeu d'influence. «Le groupe
d'intérêt compte alors sur la contribution de l'opinion pour focaliser l'attention des décideurs,
créer une attente à laquelle ils doivent répondre» (Clamen, 2000 : 140).
Il s'agit de concevoir des activités de relations publiques en vue de démontrer au gouvernement
la popularité et la légitimité des positions défendues auprès de l'opinion publique. Le travail de
communication se fait en deux temps. Les groupes vont chercher d'abord à fabriquer des
opinions favorables ; en second lieu, ils vont essayer de prouver aux décideurs politiques qu'ils
bénéficient d'un grand capital de sympathie parmi la population. « Si on parvient à sensibiliser
la population et à recueillir sa sympathie, on recueille un appui qui peut assurer la victoire »
souligne Loriot (1998 : 171).
Ln effet, l'appui de l'opinion publique vient peser dans les rapports de pouvoir. À ce propos
Benjamin Constant déclare : « // est utile en général de rectifier les opinions, quelque
métaphysiques et abstraites qu 'elles nous semblent, parce que c 'est dans les opinions que les
intérêts cherchent des armes » (Delacroix, 2004).
Dans les faits, recourir au lobbying indirect, c'est tenter le plus possible d'attirer les médias qui
deviennent un relais dans le processus d'influence. Les messages diffusés doivent avoir un
écho dans la presse pour capter l'attention du public et pouvoir l'influencer de manière
favorable à la cause défendue auprès du gouvernement.
Tel que nous l'avons antérieurement précisé, ce sont les groupes de pression avec un statut
externe qui adoptent le plus cette stratégie d'intervention, étant donné qu'ils sont plus ou moins
exclus du processus décisionnel et sont à la recherche de visibilité.
Tout dépend de l'objectif poursuivi, les groupes de pression peuvent puiser dans un répertoire
d'actions médiatiques, qui va de la pétition aux campagnes de protestation, en passant par les
communiqués et les conférences de presse, les campagnes de sensibilisation, les spots
publicitaires et le publi-reportages, les sondages, les exposés de presse, les pseudo événements ,
etc.
7 Les actions de pseudo-événements nous semblent très importantes à l'égard de notre étude, c'est pourquoi nous reviendrons plus tard sur ce concept.
44
Le répertoire médiatique tend à se complexifier en suivant les nouveautés techniques en la
matière, comme le récent engouement pour Internet qui permet de signer les pétitions par voie
de courrier électronique, d'intervenir sur les forums et les blogs et d'avoir son propre espace
médiatique sous forme de sites Web ou autres (Ollitrault, 1999 : 181).
Les manifestations font partie des actions organisées par les groupes dans le cadre des
campagnes d'opinion publique. Dans les démocraties, le droit de protester publiquement est
sacré, il offre aux individus l'opportunité de manifester bruyamment leurs revendications. Cette
stratégie offre au groupe un certain nombre d'avantages. Spectaculaire, elle permet d'attirer
l'attention des médias, elle permet aux membres du groupe et aux personnes touchées par le
problème de s'exprimer publiquement et permet enfin de démontrer au gouvernement la force
de mobilisation du groupe et la popularité de ses revendications.
La force et la légitimité des répertoires d'actions se construisent à partir de la capacité du
groupe de conjuguer ces différentes approches, de la manière qui convient le plus au contexte
d'intervention, et sa capacité d'imposer de nouveaux enjeux et d'introduire de nouveaux
problèmes au débat public.
Ceci étant, les groupes de pression accordent beaucoup d'importance aux relations avec les
médias. Ces derniers permettent de joindre des milliers de personnes par la diffusion massive
d'informations. Ils constituent un moyen de reconnaissance sociale et de visibilité.
Ils procurent aux groupes de pression une plateforme pour réagir aux événements ainsi qu'une
source d'information qui peut les renseigner parfois même sur le moment opportun de
déclencher leurs actions de relations publiques.
Par ailleurs, ce sont les médias qui mettent à l'ordre du jour les sujets soulevés par les groupes
de pression et attirent ainsi l'attention de la sphère politique (McCombs, 1977). Des sondages
auprès des groupes de pression ont révélé que ces derniers classent les médias au premier rang
des institutions de par leur force de persuasion auprès de la population et leur capacité
d'influencer les politiques publiques (Simpson, 1999 : 69). Dans ce contexte, Clamen (2000)
affirme que :
45
La presse a des audiences considérables chez les décideurs politiques. Sur les sujets sensibles au grand public, l'opinion transmise par la presse a du poids [...] Pour influencer, mieux vaut ne pas avoir les médias contre soi. Il vaut réagir. La politique de l'autruche serait un leurre : la décision publique ne peut échapper aux exigences d'information.
Le rôle des médias est certes incontestable dans le processus d'influence ; néanmoins, les
auteurs relèvent certaines situations où il serait préférable de ne pas les impliquer. C'est par
exemple lorsque l'enjeu est trop technique ou quand l'affaire s'approche du dénouement
(Clamen, 2000).
Clamen conclut que gérer les relations avec les médias ne s'improvise pas, cela demande des
talents particuliers. Les groupes de pression sont appelés à entretenir de bonnes relations avec
les journalistes et à connaître, notamment, le fonctionnement des organisations médiatiques
pour adapter leurs messages de façon à répondre aux critères de l'événement journalistique.
Neveu ( 1999) ajoute à ce propos :
Tout comme une partie des dirigeants de mouvements sociaux disposent d'une forte maîtrise réflexive des logiques du champ médiatique, une part des journalistes analyse avec beaucoup de lucidité les stratégies médiatiques des protestataires [...] Les journalistes de leur côté sont devenus experts à démontrer les coups médiatiques.
Les médias sont plus que de simples relais dans le jeu d'influence, ils se transforment dans
certains contextes en acteurs à part entière de l'espace public.
Les politiques publiques sont fortement affectées par leurs propres modalités de sélectionner,
rapporter et mettre en scène les informations diffusées à la population. C'est pourquoi les
groupes sont censés être conscients des rouages de ces institutions et bien comprendre leur
réalité pour s'en servir.
2- Rôle des médias dans les débats démocratiques
Les médias de masse font partie intégrante des régimes démocratiques. Ln se fiant à la logique
habermassienne, « média are increasingly becoming the dominant institutions of the public
sphère », affirment Axford et I luggins (2001).
46
McChesney (2000 : 82) pose l'existence d'un système médiatique efficace comme un critère
essentiel au bon fonctionnement de la démocratie puisque toutes les idées doivent disposer
d'un espace d'expression médiatique. Lieu d'information et de rencontre, cet espace est censé
informer et mobiliser l'ensemble des citoyens et les amener à participer réellement à la vie
politique. Les médias sont des institutions qui évoluent, elles s'adaptent à l'environnement
social, économique et politique. Rappelons qu'au niveau de la recherche sur les médias, on est
passé par trois étapes ; à chacune correspond une perception particulière du rôle de ces
institutions dans la société. Ils étaient d'abord envisagés comme un outil de propagande
(Lasswell, 1927; Bernays, 1928 ; Lippmann, 1922), ensuite comme étant des gatekeepers
(White, 1950) et plus récemment comme des acteurs de la société civile.
En effet, de nos jours, pour les enjeux publics importants, les médias peuvent concrétiser un
forum de débat et de discussion à partir duquel différentes opinions, émanant d'une multitude
d'acteurs sont exposées et négociées. Aujourd'hui, il n'est plus seulement question de droit à
l'information, il s'agit aussi de garantir le droit de produire sa propre information qui engage
une participation des usagers aux réseaux de communication. Grâce à la participation, les
citoyens sont impliqués dans.les choix de société, ils deviennent « des protagonistes dans le
processus de communication par l'interchangeabilité des rôles des émetteurs et de récepteurs.
Cette logique nouvelle de la communication appelle une nouvelle façon d'envisager la
démocratie et les rapports sociaux » (Sénécal, 1995 :43).
Les professionnels des médias et les journalistes doivent par conséquent envisager leur rôle
comme des initiateurs du débat public à l'intérieur de la société civile. Ils doivent s'adresser à
leurs publics comme des citoyens et non pas seulement comme une masse qu'ils se chargent
d'informer.
Cette conception des médias correspond au modèle de public journalism, pour reprendre la
désignation de Graber, McQuail et Norris. Ce modèle journalistique cherche « to rcawaken
joumalists to their large démocratie function of helping make démocratie public discourse
possible» (Graber, McQuail et Norris 1998: 133). Il met le citoyen en avant de la scène
médiatique et pourquoi pas impliquer les groupes et les individus dans la définition de l'agenda
médiatique.
47
C- L'enjeu des relations avec les médias
À partir de ce qui précède, il est évident que les affaires publiques sont négociées et débattues
entre les acteurs de la société civile par l'intermédiaire des médias. Les décisions publiques et
le fonctionnement de la vie politique en général dépendent amplement de ce qui se produit dans
l'arène médiatique et du jeu d'influence qui s'y opère. L'action des médias influence
l'évolution des rapports de force dans la société, notamment pour leurs effets présumés sur
l'opinion publique. «La façon dont les événements qui rythment l'histoire des jours y sont
présentés conduit en partie à façonner ou orienter l'opinion publique », soulignent Gabszewicz
et Sonnac (2006 : 3). Plus loin, les auteurs expliquent que la diversité des médias reflète la
diversité des opinions du public et que ces opinions, à leur tour, se forgent à la consommation
des médias.
Cependant, les études sur les médias ont démontré que ces derniers sont soumis à des
contraintes internes et externes qui conditionnement leur fonctionnement. Les médias n'offrent
pas toujours un espace d'expression libre à toutes les idées et les opinions. Dans la couverture
des affaires publiques, ils ont mille et une raisons pour privilégier certains points de vue au
détriment d'autres.
Par conséquent, les questions relatives à la structure des médias, leur contrôle et leur
financement revêtent une importance politique particulière à l'intérieur des sociétés
démocratiques, comme l'ont souligné Chomsky et McChesncy (2000 : 82).
1- La position des médias dans le processus d'influence
Dans le contexte politique, certains envisagent les médias comme un relais entre gouvernants et
gouvernés. D'autres les perçoivent comme une scène commune pour les négociations entre les
différents acteurs impliqués dans les politiques publiques. Il est évident que dans un cas comme
dans l'autre, l'agenda médiatique peut nous renseigner sur les principales préoccupations de la
scène publique.
48
Nous avons eu l'opportunité de souligner le rôle des médias dans la phase d'émergence des
politiques publiques et nous avons démontré qu'il suffit que les médias focalisent sur un sujet
pour réussir à attirer l'attention du public et pour en donner l'envergure d'une affaire publique.
Encore faut-il pouvoir attirer l'attention des médias !
Les autorités ainsi que le reste des acteurs engagés dans une cause publique, notamment les
groupes de pression planifient leurs communications afin de contrôler l'agenda médiatique et
pouvoir ainsi influencer l'opinion publique. Les médias deviennent alors non seulement des
relais mais aussi des cibles.
Un autre point de vue envisage les institutions médiatiques comme l'un des acteurs de l'espace
public. À vrai dire, il y a différentes façons de concevoir le métier de journalisme et ce, en
fonction de son degré d'ouverture aux autres champs de la communication à savoir la publicité
et les relations publiques (Bernier et al, 2005).
L'approche autoréférentielle considère le journalisme comme une structure autonome, régi par
des règles particulières et obéissant à sa propre logique de fonctionnement. Le journaliste
détient le pouvoir et les moyens d'orienter son activité et son propre destin. « Toute influence
de son environnement est décrite comme une 'contamination', une 'anomalie', un 'corps
étranger' » (Moumouni, 2006).
D'autres théories prouvent la possibilité d'une influence réciproque entre l'agenda des médias,
l'agenda du public et l'agenda des acteurs économiques et politiques. Dans cette perspective,
les trois champs de la communication publique (information, publicité et relations publiques)
s'entremêlent et parfois se confondent. On assiste alors à un véritable brouillage des frontières
entre les contenus médiatique. Le publi-reportage est l'une des formes qui témoigne de ce
brouillage (Moumouni, 2006).
2- La dialectique de l'agenda médiatique
La théorie de l'agenda-setting s'est intéressée à la question relative au pouvoir des médias de
soumettre des sujets aux débats publics. Elle a montré à quel point il y a une concordance entre
l'agenda du public et celle des médias.
T)
En revanche, la question qui nous préoccupe ici est celle de savoir les critères de sélection des
informations à diffuser au grand public et comment se fait le choix du ton et le cadrage pour
couvrir chaque événement. Il est donc nécessaire de connaître la mécanique de production de
l'information et d'identifier ceux qui la contrôlent réellement.
a- Le modèle de l'agenda-setting
La théorie de l'agenda-selting repose sur le principe que « the news media's coverage of issues
influences the public perceived importance of issues » (Wanta, 1997:1). Un agenda est défini
par Maigret comme étant une hiérarchie de priorités, une liste d'enjeux classés par importance
croissante. McCombs et Shaw (1972) étaient les premiers à exploiter ce concept en comparant
l'agenda des médias avec celui du public. La corrélation des agendas statistiquement vérifiée
amène les auteurs à conclure que les médias opèrent une influence par effet de structure dans le
sens où ils ne disent pas ce qu'il faut penser mais «à quoi il faut penser » pour reprendre la
formule de Cohen (Maigret, 2004 : 198).
Wanta admet qu'il s'agit d'une forme d'apprentissage social où les individus prennent
conscience de l'importance des faits sociaux à partir de la qualité de la couverture médiatique
accordée à ces derniers. En revanche, le modèle de l'agenda setting n'intègre pas l'existence
d'autres agendas que ceux des médias et des citoyens, comme celui des hommes politiques à
titre d'exemple. Il postule l'autonomie des médias dans l'établissement de leur propre agenda.
D'une façon tout à fait indépendante, les médias font le tri et de cadrage des faits émanant des
sources. « Prinl and hroadeast journalists, editors and média owners can be the chief
gatekeepers who détermine which political message will be publicized through news média
channels and how they should be framed » (Graber, McQuail et Norris, 1998 : 2).
La production des nouvelles provoque souvent des conflits dans les salles de rédaction. Celles-
ci peuvent porter sur le cadrage ou framing des nouvelles, dans le sens de la structuration du
sens et de la signification des messages. Ils peuvent aussi porter sur l'importance relative des
acteurs et des événements, la priorité à leur accorder dans les contenus d'information, et par
conséquent, sur l'allocation des ressources matérielles et humaines pour les couvrir.
50
L'agenda setting noue avec rapproche autoréférentielle du journalisme (Moumouni, 2006)
selon laquelle les médias seraient plutôt imperméables et les relations publiques auront des
difficultés à les aliéner.
Les partis politiques, le gouvernement, les organes institutionnels, les forces économiques et sociales, les groupes de pression agissent continûment sur des thèmes renouvelés. Ils proposent des solutions aux questions du moment, polémiques entre eux, diffusent des milliers de communiqués. Dans cet amas de thèmes et de positions les médias jouent en permanence, en direction du public, un rôle de tri, de sélection et de hiérarchisation (Cayrol, 1997 : 18).
Cette perception de la fonction des journalistes rejoint le modèle de Trustée journalism selon
la typologie de Schudson. Dans ce modèle, « journalist's should provide news according to
what they helieve citizens should know. The projessional journalist 's quest for truth and
fairness », souligne l'auteur (Graber, McQuail et Norris, 1998 : 136).
Ainsi, les médias joueraient un rôle essentiel dans le choix des thèmes autour desquels doit
tourner le débat de la société politique. C'est à travers leur consommation que les citoyens se
font des idées des enjeux du moment et repèrent les points chauds du débat politique. « Les
médias créent ainsi une réalité qui leur est propre, issue de la représentation et des
préoccupations des journalistes. Le public n 'a accès à cette réalité que par leur intermédiaire
et finit par la considérer comme étant LA réalité » (Chabaud, 2002 : 55).
b- L'agenda-building
Le modèle de l'agenda setting demeure partiel puisqu'il ne tient pas compte de l'interaction des
médias avec leur environnement, selon les critiques qui lui ont été adressées. En effet, la
multiplicité des facteurs susceptibles d'affecter l'activité des médias vient mettre des bémols à
cette approche. Ce constat a provoqué une série de travaux qui se sont penchés sur les relations
entre les médias et leurs sources, particulièrement les décideurs politiques. La question centrale
étant de savoir qui détermine l'agenda des médias. Les chercheurs s'accordent à dire que « les
nouvelles ne sont pas sélectionnées mais construites, et que cette construction est l'oeuvre
conjointe des journalistes et des sources » (Charron, 1995).
Le modèle de Y agenda building désigne ce processus collectif pour l'élaboration de l'ordre du
jour médiatique. Il prouve la possibilité d'une influence réciproque entre l'agenda des médias,
l'agenda des sources économiques et politiques ainsi que celui du public, incarné par les
51
groupes et les mouvements sociaux. Le modèle de l'agenda building explique que les centres
d'intérêts et les débats prioritaires de chacun des acteurs de la société sont susceptibles
d'affecter ou d'être affectés par les autres acteurs. L'agenda building est asymétrique mèdia-
centrique lorsque la décision finale de diffuser ou non un fait revient au média. Il s'agit d'un
agenda building source cenlrique lorsque cette dernière s'impose de manière accomplie.
Plus extrême, la notion d'agenda following nous montre que sous certaines contraintes, les
médias peuvent se transformer en simples courroies de l'information. C'est par exemple dans
un contexte où la source monopolise l'information, ou que la liberté de la presse se trouve
opprimée ou bien grâce à la capacité de certaines sources de manipuler les médias par les
techniques de relations publiques.
À titre d'exemple, les résultats d'une étude sur l'actualité à Radio Canada et TVA effectuée en
1982 démontrent que dans 67% des cas, les déclencheurs de la nouvelle sont des opinions et
des réflexions d'hommes politiques (Sénécal, 1995 :220). Il advient que les médias soient bien
investis des pouvoirs politiques et que leur agenda soit largement dicté par l'agenda politique.
c- Les relations publiques à la conquête des médias
Certes, le contenu des médias dépend en large mesure des relations qu'entretiennent les
entreprises de presse avec leurs sources d'information. À l'aide des relations publiques, les
sources tentent de tisser des liens privilégiés avec les journalistes, l'objectif étant d'obtenir du
temps d'antenne, des articles, bref, de susciter une couverture favorable dans la presse sans que
la population n'en ait conscience. En effet, la gigantesque industrie des relations publiques que
connaît le monde actuel est responsable de l'interpénétration croissante de la notion
A'information avec celles de communication ou encore de publicité. À ce propos, Cayrol
explique que :
Les émetteurs d'informations : autorités politiques, administratives, économiques, culturelles sociales, comprennent mieux le fonctionnement et les besoins des entreprises médiatiques, se sont progressivement dotés de services de communication performants. Ceux-ci savent de mieux en mieux gérer leurs relations avec les médias, traiter les informations d'une manière susceptible de les intéresser, créer l'événement ou organiser le silence en fonction de leurs objectifs (Cayrol, 1997: 101).
s Moumouni(2006), noies du cours Communication el affaires publiques. L'étude a été effectuée par l'ICEA (Institut canadien d'éducation des adultes). Voir Lina Trudel dans « La
critique des médias et ceux qui la l'ont : de l'autocritique au contrôle social », Université Laval. L'ICEA fait partie de ces groupes de pression qui ont réclamé un accès large aux médias pour tous les usagers.
52
Lavigne (2005) admet que les relationnistes peuvent déployer deux stratégies pour influencer
les messages journalistiques. 11 s'agit de relations de presse proactives lorsque les relationnistes
prennent les devants vis-à-vis des médias ; et de relations de presse réactives lorsque ce sont les
journalistes qui prennent les devants pour la cueillette d'informations.
Les techniques des relations de presse sont abondantes ; elles varient du communiqué et de la
conférence de presse classiques aux techniques novatrices tels que la formation du porte-parole
et la salle de presse virtuelle, sans oublier l'orchestration d'événements médiatiques ou pseudo
événements.
Nous assistons à l'ère des «relations publiques généralisées» selon l'expression de Miège
(1997). Selon l'auteur, les médias sont perçus comme des activeurs de changements sociaux et
culturels. Alors, animés par la volonté de défendre leurs intérêts, les entreprises, les institutions
de la société civile et l'État s'emparent des moyens de communication et mettent en œuvre des
stratégies pour prendre part aux médias.
Néanmoins, Miège constate que l'accès aux moyens de communication modernes demeure
inégal et favorise l'expression de certains acteurs et groupes sociaux. La réalité économique et
commerciale des entreprises médiatiques favorise la domination des grands groupes qui
disposent des ressources pour y investir.
Par conséquent, le système d'information se retrouve mis en doute, notamment la capacité des
médias à résister aux relations du pouvoir et de l'argent, et à produire une information
indépendante au lieu de transmettre les mises en scène orchestrées par les groupes influents.
d- Les contraintes économiques; les médias, institutions lucratives
Les médias étant des entreprises lucratives, ils doivent quotidiennement gérer des enjeux
économiques et commerciaux qui ne sont pas sans répercussions sur le contenu et la forme de
leur production. Pour réfléchir l'accès des sources aux médias, il faut tenir compte de la réalité
commerciale des institutions médiatiques. Nous allons découvrir dans ce qui suit, comment
l'agenda médiatique peut être expliqué seulement à partir d'une logique commerciale et
financière.
53
C'est d'ailleurs l'objet du champ de recherche de l'économie des médias, qui étudie « comment
les motivations des agents économiques, en particulier les consommateurs et les propriétaires
des médias sont à la source de la production du contenu médiatique » (Gabszewicz et Sonnac,
2006 : 6).
« La logique commerciale qui s'impose aux médias est forcément celle de la conquête du
plus large public possible », précise Cayrol (1997 : 81). Leur préoccupation première demeure
la satisfaction de leurs clients-consommateurs-récepteurs. En effet, depuis qu'on a commencé à
accorder des licences pour les médias privés, on a transformé radicalement l'espace médiatique
en y introduisant les règles du marché ; celles de la concurrence et de la rentabilité.
L'information doit être diffusée rapidement pour ne pas perdre de sa valeur, mais aussi pour
aller plus vite que la concurrence.
L'histoire des médias a connu des vagues successives de concentration entre groupes de
communication et groupes industriels. En évoquant ce phénomène, Chabaud (2002 : 39)
explique que « aussi bien verticale qu'horizontale, la concentration joue un râle fondamental
dans la lutte contre la concurrence. Par les opérations de fusions, d'absorptions, une
entreprise de presse peut renforcer son empire sur un système d'information ».
En termes de choix des sujets prioritaires d'information, les média appartenant à des
conglomérats vont privilégier l'intérêt commun de la grande famille10. Ces géants médiatiques
ont une influence démesurée sur le contenu de l'information et sur l'ensemble de la culture,
selon Chomsky et McChesney (2000 : 9). Concrètement, Sénécal (1995) explique les méfaits
potentiels de ce phénomène sur la qualité de l'information diffusée au public :
Cette concentration a entre autres conséquences, celle de centraliser la production et d'entraîner un appauvrissement et une homogénéisation des sources d'information [...] Les propriétaires des médias sont de la sorte moins sensibles à la diversité et à la qualité de leurs produits qu'aux intérêts financiers et à la place concurrentielle qu'ils détiennent (Sénécal 1995 :36).
"' Voir François Deniers (2005), « I ,a eonvergence comme nouvelle pratique journalistique », dans Marc-François Bernier et al., Pratiques novatrices en communication publique : journalisme, relations publiques et publicité, Québec, Les presses de l'Université Laval, p. 77-101.
54
En revanche, Gabszewicz et Sonnac (2006: 81) démontrent que «paradoxalement plus de
concurrence conduit a une diminution de la diversité offerte » . La multiplication des médias
accessibles et l'abondance de leurs messages camouflent l'absence de diversité de contenu,
dans la mesure où chaque média va tenter d'offrir ce qui répond à la demande majoritaire.
Une chose est certaine, la rentabilité du produit médiatique est assurée par son audience, celte
dernière détermine les tarifs des écrans publicitaires et permet à l'entreprise de presse de
renforcer son positionnement sur le marché. L'assise commerciale aboutit à une hégémonie
mercantiliste de l'espace médiatique qui s'étend à l'échelle mondiale. Elle est responsable du
fait que, dans plusieurs pays, le journalisme ne reflète plus que les intérêts partisans des
propriétaires et des annonceurs, plutôt que les intérêts variés qui existent dans la communauté
(Chomsky et McChesney, 2000 : 94).
D'après Schudson, « the markel model of journalism », est l'approche journalistique qui
correspond à la logique de maximiser les profits de l'entreprise médiatique en élargissant au
maximum son audience. « In this model, journalists should please audiences or al least those
audiences thaï advertisers find attractive. Consumers demand is the ultimate arbiter of the
newsproduct (Graber, McQuail et Norris, 1998: 135) ».
Dans le même ordre d'idées, Demers (2000) propose l'expression «journalisme fonctionnel »
par analogie à la démocratie fonctionnelle. Pour cette conception du journalisme, il y a une
tendance vers la neutralisation de l'éditorial, notamment dans les médias de masse généralisés,
et ce afin de viser la totalité du public et d'en exclure aucune catégorie. L'agenda médiatique
est déterminé par le « marché / public » et la ligne éditoriale sert d'outil de marketing et de
proximité idéologique, politique et culturelle. D'où l'accent sur l'information ludique et
pratique. Ceci implique que la souveraineté du public n'est ici qu'une illusion de démocratie.
Le public est envisagé comme un client-consommateur qui va permettre à l'entreprise de
presse d'écouler ses productions et de réaliser des gains et non pas comme un citoyen valorisé
pour ses opinions et ses idées. Plusieurs observateurs admettent que cet état d'esprit a des
effets négatifs sur la manière dont s'exerce la vie politique en démocratie.
" Gabszewicz cl Sonnac (2006 : 81) expliquent ce paradoxe en reprenant un exemple pertinent développé par Steiner. Ils démontrent qu'un conglomérat garanti plus la diversité du contenu dans le sens où il a la possibilité de combler tous les goûts. Par contre, des entreprises médiatiques à propriétaires différents vont chercher à combler le goût de la majorité.
55
Pour McChesney, la nécessité que le contenu médiatique épouse les besoins commerciaux est
devenue une partie implicite de l'idéologie du métier journalistique. Après de longues années
de journalisme d'opinion, aujourd'hui il s'est rendu nécessaire de promouvoir le «journalisme
professionnel » fondé sur la doctrine principale « de l'objectivité ». Dans les écoles de
journalisme, les diplômés sont censés acquérir un système de valeurs neutre de sorte que la
couverture des affaires publiques soit impartiale. «La mission du journalisme professionnel
consistait donc, du moins superficiellement, à faire passer les médias capitalistes, financés par
la publicité, pour une source d'information objective aux yeux de nombreux citoyens »
(Chomsky et McChesney, 2000 : 94).
e- Les médias, antidémocratiques ?
Il est clair que les médias ont une importance fondamentale dans la vie moderne, mais qu'ils
fonctionnent sous certaines contraintes qui les font dévier de leur rôle principal d'informer
objectivement, de permettre un débat public et de garantir l'expression d'une opinion plurielle.
Le journalisme ne peut se passer d'appui et de financements institutionnels, il reflète les choix
conscients des rédacteurs en chefs et des reporters qui sont animés par des facteurs
idéologiques ou mercantiles particuliers.
En suivant la logique de l'audience, les médias manquent souvent de rendre compte des
problèmes sociaux qui dominent de façon permanente la société. Les médias vont éviter de
traiter les sujets difficiles ou tabous, ceux qui se rapportent à des mouvements, groupes ou
personnalités jugées « minoritaires ». La tendance est d'aller simplement à la recherche de ce
qu'on pense être l'attente majoritaire, créatrice d'audience, du « grand public » (Cayrol, 1997).
Isabelle Gusse (2006) conclut que « cette logique commerciale, en diminuant la diversité des
voix et en altérant la teneur des débats politiques et sociaux, contribue à dévitaliser l'espace
public ». Ln reprenant le raisonnement de Habermas (1988), l'auteur souligne que les médias
ne peuvent plus servir à stimuler, dans l'espace public, des discussions, des raisonnements et
des passages à l'action citoyenne sur les affaires publiques politiques, économiques et
culturelles.
Nous en concluons que le fait de s'intéresser à la couverture médiatique des problèmes publics
suppose une prise en considération des logiques de concurrence et de quête d'audience propres
au champ de la presse.
56
C- La médiatisation des problèmes publics
Nous allons aborder dans cette section deux sous thèmes ; le premier se rapporte à la façon de
transformer un fait en discours médiatique, aux caractéristiques de la nouvelle journaliste et les
facteurs qui interviennent dans sa construction. Le deuxième sous-thème traite des moyens que
déploient les groupes de pression pour s'adapter au mode de fonctionnement médiatique.
1- La mise en discours médiatique
Tous les événements qui ont lieu dans l'environnement ne sont pas automatiquement repris par
les médias. La nouvelle au sens journalistique du terme doit répondre à un certain nombre de
critères pour accrocher le public. D'ailleurs, comme l'affirme Lsquenazi (2002 : 46), les faits
journalistiques sont «des faits seconds, ou plus exactement des rapports de faits». Le
journaliste est perçu comme un technicien, ou encore un artiste qui travaille sur une matière
première : les faits. Il les recherche, les trie et les traite pour les rendre assimilables et attrayants
(Charticr, 2003 : 45).
Pour Charaudeau (1999), la mise en discours médiatique d'un fait requiert trois étapes
successives : la thématisation, le traitement discursif de l'événement et la mise en scène.
L'activité de thématisation consiste à sélectionner l'événement médiatique en fonction de son
potentiel d'actualité, de socialisation et à'imprévisibilité. L'actualité concerne la temporalité
ainsi que la proximité spatiale de l'événement. La socialisation désigne le potentiel qu'aurait
l'événement de toucher la vie des hommes et son organisation collective. L'imprévisibilité
« correspond au caractère inattendu de l'événement dans la mesure où celui-ci viendrait
perturber la tranquillité des systèmes d'attente du sujet consommateur d'information »
(C 'haraudeau, 1999).
Le traitement discursif de l'événement se trouve pris dans la contradiction de respecter la
crédibilité journalistique et de répondre en même temps aux exigences de la captation, en
produisant le plus d'effets dramatisants possible. Quant à la mise en scène, elle dépend de la
particularité de chaque support médiatique. Elle se base sur une composition de la voix, des
sons, de la musique et du bruit dans le cas de la radio, ou encore sur l'image en relation avec la
parole pour la télévision. Et finalement, sur une aire scripturale, faite de mots, de graphiques,
de dessins pour ce qui est de la presse écrite.
57
Fin tenant compte de la réalité des médias, largement exposée ci-haut, plusieurs auteurs se sont
penchés sur les caractéristiques des contenus médiatiques diffusés dans la foulée des enjeux
commerciaux. Ceux-ci ressemblent davantage à des stimuli émotionnels qu'à de l'information.
« Mus qu'ils sont par la logique du profit et la recherche d'audience, les médias s'occupent
plus de nous émouvoir et de nous divertir que de nous informer», écrit Cayrol (1997 : 7). La
course au scoop est devenue obsédante, et la tendance est de privilégier ou bien les événements
à caractère ludique et divertissant, sinon les scandales, les outrages, les catastrophes...
Nombreuses études ont révélé que les journalistes dans la presse écrite, et plus encore dans la
TV et la radio, se préoccupent surtout de rechercher la nouvelle-choc et le sensationnel. Avec
Graber, McQuail et Norris (1998 : 221), on parle de l'information spectacle qui est conçue
avec un style narratif mettant en exergue l'aspect dramatique et émotionnel des faits. Les
médias sont de même constamment à la recherche de l'insolite et de l'événement inhabituel qui
suscitent la curiosité et attirent l'œil et l'oreille : « c'est un ingrédient pour les voyeurs, les
curieux, les amateurs de statistique » (Chartier, 2003 : 47).
La couverture des faits politiques n'a pas échappé à toutes ces pratiques. Les discours, formes
et contenus des messages politiques, se sont progressivement adaptés à la loi médiatique,
notamment à la toute-puissante télévision. En se fiant aux analyses des spécialistes dans les
médias, la télévision est le médium le plus concerné par les effets émotionnels et spectaculaires
puisqu'elle permet des possibilités visuelles et auditives empruntées des techniques
cinématographiques. En môme temps, c'est le médium qui bénéficie de la plus grande
légitimité et pouvoir auprès du public. À cet égard, Roland cite par Cayrol (1997 : 25) précise
que « dès l'instant qu 'il est destiné à être véhiculé par le télévision le discours (politique) doit
prendre en compte les règles propres à la télévision. Or la spécificité, le principe propre à la
télévision c 'est évidemment le spectacle ».
Pour expliquer cette notion de spcctacularisation ou encore de théâtralisation, Chabaud donne
l'exemple suivant :
Un conflit social suivi de manifestations est beaucoup plus télégénique si ce sont des routiers qui bloquent les axes de circulation vers la capitale (parce que les images d'hélicoptère font une belle illustration du problème des usagers de la route), alors qu'une revendication des sages-femmes ne justifie que quelques plans d'entrée d'hôpital ou de salle d'accouchement moins spectaculaires (Chabaud, 2002 : 75).
58
Ces exigences de spectacularisation et de sensationnalisme conditionnent le travail des
journalistes dès la phase de la sélection des nouvelles. D'après Gingras (2006), contrairement à
ce qu'on proclame dans les médias, les critères de la nouveauté, du conflit et de la pertinence
ne sont pas suffisants pour identifier la nouvelle journalistique. Deux critères principaux
semblent plus pertinents pour établir la valeur d'une nouvelle : leur caractère spectaculaire et
leur provenance d'une source crédible.
Les médias constituent le théâtre moderne dont l'éclairage est assuré par tous les événements hauts en couleur, surprenants, scabreux, qui titillent ou qui font rire. Une catastrophe naturelle, un scandale financier, un événement insolite, une découverte bizarre trouveront leur place dans les médias (Gingras, 2006 : 63).
lin second lieu, les médias ont tendance à privilégier les sources crédibles et ayant une
notoriété importante. Ils collaborent fortement avec les personnalités et les institutions
politiques ou celles qui ont un accès avantagé au pouvoir. «L'accent sur la célébrité des
sources restreint forcément le nombre de personnes jugées intéressantes médiatiquement »,
remarque Gingras (2006 : 64).
2- Les stratégies médiatiques des groupes de pression
Conscients du mode de fonctionnement des organes de presse, les groupes de pression ont
développé, avec l'expérience, certaines stratégies pour conquérir l'espace médiatique.
L'une de ces techniques consiste à produire des messages dans un format approprié à l'usage
médiatique. Certaines sources parviennent à une bonne visibilité médiatique en choisissant de
produire, par elles-mêmes, des messages écrits ou audiovisuels qui ont le mérite d'être tous
prêtes à la diffusion.
Les groupes recrutent des journalistes, des scénaristes et des réalisateurs pour produire des
discours el des images distrayantes, attirantes ou dramatiques, susceptibles d'intéresser les
médias et leur audience. Les journalistes ne peuvent que saluer l'initiative des personnes qui
font le travail à leur place.
59
Citée par Gingras (2006 :64), la journaliste Lesley Stahl du réseau CBS déclare à ce sujet
«qu'aujourd'hui nul n'est à l'abri de la tentation d'utiliser ces images flamboyantes et
divertissantes déjà produites, toutes prêtes à être utilisées ».
D'après Gingras, cette technique commence à s'imposer comme un critère supplémentaire pour
déterminer la valeur d'une nouvelle journalistique dans les salles de rédaction puisqu'il n'est
pas rare de trouver un communiqué ou un documentaire repris intégralement dans les médias.
De même, les communicateurs et les relationnistes commandités par les groupes de pression
sont de plus en plus habiles à monter des événements prêts à l'emploi pour les médias. Ce sont
des événements « that are staged to stimulate média reporting. The timing and location of the
event, logistics and the présentation can be designed according to the formats, the sélection
criteria, and the logistics of news reporting» (Graber, McQuail et Norris, 1998 : 75). On les
appelle aussi les pseudo-événements. Pour nombreux groupes de pression, notamment ceux qui
disposent de peu de ressources politiques et économiques, ils présentent une solution
incontournable pour pouvoir bénéficier de temps d'antenne.
Selon la définition de Charron (1991), les pseudo-événements de contestation sont « des
actions qui présentent un écart par rapport au déroulement habituel ou « normal » des choses
et qui sont littéralement mises en scène à l'intention des médias d'information ». Ils sont
organisés comme réponse aux problèmes d'accès aux grands médias parce qu'ils permettent de
produire une rupture brutale et spectaculaire dans le flux quotidien et routinier des événements
et créer un message qui sera saisi comme une nouvelle au sens journalistique du terme.
Naturellement, la capacité d'une affaire, d'un événement d'un groupe d'intégrer l'agenda
médiatique est tributaire de sa capacité de répondre aux impératifs de la mise en scène de
l'information.
En effet, certains groupes « oeuvrent en jouant de formes théâtralisées, expressives parfois
émotionnelles de prise de parole pour propulser vers les médias des enjeux sociaux portés par
des vies et de groupes dont le statut est dominé, illégitime ou minoritaire est souvent vecteur
d'invisibilité sociale » (Neveu, 1999).
60
Par ailleurs, Neveu insiste sur l'idée qu ' i l ne s'agit pas seulement de réussir à avoir un temps
d'antenne, il faudrait s'assurer de pouvoir orienter le cadrage de l'événement en imposant aux
journalistes ses propres schèmes interprétatifs. Ce double objectif est possible à condition de
connaître les logiques internes de la presse et de savoir manipuler les techniques de la mise en
discours médiatique.
Pour Chomsky et McChesney les groupes de pression ont un rôle important à jouer dans les
sociétés actuelles. En plus de la défense des intérêts qu' i ls incarnent, les groupes doivent
oeuvrer à rétablir l 'équilibre dans l'espace médiatique.
Quelle que soit la priorité de mobilisation d'un groupe progressiste, la seconde devrait être les médias et les communications, car tant que les médias demeureront entre les mains de compagnies, réussir à introduire partout des changements sociaux sera extrêmement dif f ici le, sinon impossible (Chomsky et McChesney, 2000 : 196).
Justement, le système d' information marqué par le primat des intérêts économiques, a suscité
les critiques de nombreux usagers qui réclament la pluralité et la diversité des voix transmises
par les médias. Cette prise de conscience rejoint la défense et l'application des droits
démocratiques comme ceux des droits à l ' information et des droits à la communication. Ce
mouvement a débouché sur la mise en place de médias autonomes, dit « alternatifs ». Le but
étant de posséder formellement des moyens d'expression et d' information, ce qui traduit la
prise en charge par les groupes eux-mêmes de leurs problèmes et de leur gestion (Sénécal,
1995 : 215).
En guise de conclusion, admettons que quelle que soient leurs conditions réelles, les médias
fonctionnent à l'intérieur d'un champ de forces et figurent aujourd'hui au centre du système
politique. Ils ont contribué à changer les styles et les pratiques en communication politique. Ils
ont contribué à l'émergence de l'industrie des relations publiques qui offre des solutions
stratégiques aux différents acteurs de la scène publique pour communiquer leurs messages et
utiliser les médias afin d'atteindre leurs objectifs politiques.
12 D'après Lina Trudel citée par Sénécal (1995 : 221) le terme usagers inclul les individus qui ont des problèmes quand à leur droit d'être informés, à leur droit à une information complète et diversifiée, mais c'est aussi les organismes sociaux et syndicaux qui sont mal servis par les média.
61
Ainsi, nous arrivons au troisième chapitre de notre étude, et qui est consacré à l'étude de cas de
l'affaire des prêts et bourses d'études qui a eu lieu en 2004. Nous allons tenter d'analyser les
événements de cette affaire publique québécoise à la lumière du cadre théorique ici développé.
Cette analyse va tenter de répondre à deux questions centrales : comment, et avec quels moyens,
ont agi les groupes de pression pour pouvoir accéder aux médias ? Quel type de couverture leur
a été réservé par les journalistes ? L'exemple de cette politique publique nous donnera un
aperçu sur la dynamique entre le champ journalistique et celui des relations publiques au
Québec.
62
Chapitre 3
ÉTUDE DE CAS : LA MODIFICATION DU PROGRAMME DES PRÊTS ET
BOURSES D'ÉTUDES AU QUÉBEC
A- Les choix méthodologiques
Le problème de recherche qui anime notre étude pose la question de savoir quels sont les
techniques de relations publiques employées par les groupes de pression pour parvenir à
intégrer l'agenda médiatique, et quelle couverture cela leur permet-il d'obtenir. L'approche
méthodologique retenue pour résoudre notre problématique est l'étude de cas. C'est « une
approche de recherche empirique qui consiste à enquêter sur un phénomène, un événement, un
groupe ou un ensemble d'individus, sélectionné de façon non aléatoire afin d'en tirer une
description précise et une interprétation qui dépasse ses bornes » (Roy, 2003 : 166). Mucchielli
(1996) précise qu'elle consiste à rapporter une situation prise dans son contexte, et à l'analyser
pour voir comment se manifestent et évoluent les phénomènes auxquels le chercheur
s'intéresse.
Comme l'indique son nom, l'étude de cas s'intéresse à une unité particulière quelconque. Llle
cherche à recueillir un grand nombre d'informations et d'observations, afin d'étudier la
situation en profondeur, d'en préciser les détails et d'expliquer ses particularités.
D'après Yin (2003), elle est fortement utile dans les recherches en sciences sociales lorsqu'il
s'agit de répondre aux questions « comment » et « pourquoi », lorsque les chercheurs ont peu
de contrôle sur les événements étudiés, et lorsque l'attention est dirigée vers des phénomènes
contemporains dans un contexte de vie réelle (Mucchielli, 1996 : 77).
Pour ce qui est de notre recherche, nous allons nous étudier une affaire publique québécoise,
celle de la modification du programme des prêts et bourses universitaires qui a été annoncée
par le gouvernement de Jean Charest en avril 2004, et dont les péripéties se sont déroulées au
retour des classes à la session d'automne 2004.
63
L'étude de cas est particulièrement appropriée à l'étude des affaires publiques, étant donné la
complexité de ce phénomène et la multiplicité des acteurs qui y sont impliqués13. D'ailleurs,
Mucchielli (1996 : 77) reconnaît qu'elle fournit « une situation où l'on peut observer le jeu
d'un grand nombre de facteurs interagissant ensemble et permet d'appréhender la complexité
des situations sociales et d'explorer leur richesse ».
Dans le même ordre d'idées, Gauthier indique qu'en sciences politiques, on peut mener une
étude de cas sur une crise particulière ou une décision politique. Il ajoute que « l'étude de la
prise de décision replace les décisions dans leur contexte institutionnel, et analyse le jeu des
acteurs apparents et non apparents. L 'étude du jeu des groupes de pression est un bon exemple
à cet égard... » (Gauthier, 2003 : 162).
Néanmoins, de nombreuses critiques ont été formulées à l'égard de cette technique en lui
reprochant un manque de rigueur et une incapacité à fournir des résultats généralisables. Selon
les critiques, cette technique repose sur des informations partielles qui ne représentent pas toute
la réalité du cas réel ; elle se penche sur des cas qui ne sont pas représentatifs de l'ensemble
(Roy, 2003 : 166).
Par souci d'exhaustivité et de fiabilité, l'étude de cas fait appel à plusieurs méthodes de
recherches en même temps, dans le sens où les informations émanent de plusieurs sources et
sont recueillies par différents types d'instruments. Yin (2003 : 97) propose la méthode de
triangulation qu'il définit comme étant «a use of multiple sources of évidence ». Les plus
importantes sources selon l'auteur, sont les documents, les archives, les articles de presse, les
entretiens, l'observation directe, l'observation participante, les artefacts. Yin précise que
l'étude de cas « can be based on any mix of quantitaive and qualitative évidence » (Yin, 2003 :
15).
La triangulation des données permet au chercheur d'obtenir des formes d'expressions variées et
de combler ainsi les biais et les lacunes inhérents à chaque méthode. «Elle place l'objet
d'étude sous le feu d'éclairages différents dans l'espoir de lui donner tout son relief» (Hamel,
dans Roy, 2003 : 177).
Voir section « Les acteurs des politiques publiques » ; chapitre 1, page 15
M
Pour notre étude, nous avons opté pour la combinaison de deux méthodes de cueillette de
données, en l'occurrence l'analyse de contenu d'articles journalistiques qui couvrent l'affaire
de la modification du programme des prêts et bourses, et l'entretien semi-dirigé avec les
leaders des groupes de pression qui ont mené les actions de protestation estudiantine.
1- L'analyse de contenu
L'analyse de contenu porte sur des messages aussi variés que des œuvres littéraires, des articles
de journaux des documents officiels, des programmes audiovisuels, des déclarations politiques,
etc. Elle a pour objectif de connaître la vie sociale à partir de la dimension symbolique des
comportements humains : « elle procède de traces mortes, de documents, de toutes sortes, pour
observer des processus vivants : la pensée humaine dans sa dimension sociale » (Roy, 2003 :
358).
L'analyse de contenu a un très large champ d'application comme l'examen des logiques de
fonctionnement des organisations grâce aux documents qu'elles produisent et l'analyse des
processus de diffusion et de socialisation (journaux, publicités, manuels scolaires, etc.). Etant
donné que notre problématique s'intéresse à la médiatisation des mouvements sociaux et des
affaires publiques québécoises, nous estimons que l'analyse de contenu est la méthode
appropriée pour évaluer cette couverture.
L'analyse de contenu peut s'appliquer en faisant appel à deux catégories de méthodes : les
méthodes quantitatives et les méthodes qualitatives. Selon Quivy et Campenhoudt (2006 : 202),
ces dernières ont pour objet de révéler la présence ou l'absence d'une caractéristique ou la
manière dont les éléments du discours sont articulés les uns par rapport aux autres, tandis que
les premières s'intéressent à la fréquence d'apparition de certaines caractéristiques de contenu
ou la corrélation entre elles.
Quivy et Campenhoudt (2006 : 202) distinguent trois grandes catégories de méthodes d'analyse
de contenu selon que l'on examine la forme du discours, ses éléments ou les relations entre ses
éléments ; ce sont : les analyses thématiques, les analyses formelles et les analyses structurelles.
Les analyses thématiques sont celles qui conviennent le mieux à notre étude. Elles tentent de
« mettre en évidence les représentations sociales ou les jugements des locuteurs à partir d'un
examen de certains éléments constitutifs du discours » (2006 : 202).
65
Il existe deux méthodes pour effectuer une analyse thématique : l'analyse catégorielle qui
consiste à calculer et à comparer les fréquences de certaines caractéristiques préalablement
regroupées en catégories significatives, et l'analyse de l'évaluation qui porte sur les jugements
formulés par les locuteurs, l'attention est focalisée sur la fréquence des différents jugements,
leurs directions (positifs ou négatifs) et leur intensité.
Nous estimons que l'analyse thématique, avec ses deux variantes, est susceptible de nous
permettre d'analyser les articles de presse dans l'objectif d'identifier les composantes
inhérentes à la nouvelle journalistique mises en œuvre pour couvrir les activités des groupes de
pression, et d'autre part pour nous renseigner sur les jugements des journalistes concernant la
cause défendue par les groupes de pression.
2- L'entretien semi- dirigé
L'entretien est la deuxième technique de cueillette d'information à la quelle nous avons fait
appel pour cette recherche. Llle est définie comme « une interaction entre des personnes qui
s'engagent volontairement dans pareille relation afin de partager un savoir d'expertise, et ce
pour mieux dégager conjointement la compréhension d'un phénomène d'intérêt pour les
personnes en présence » (Savoie-Zajc, 2003 : 295).
D'après Quivy et Campenhoudt (2006 : 175), l'entretien semi-dirigé est utile pour l'analyse du
sens que les acteurs donnent à leurs pratiques, leurs représentations sociales, etc. Elle peut
servir de même pour l'analyse d'un problème précis, de ses données, de ses enjeux, ou encore
pour la reconstitution de processus d'action, d'expérience ou d'événements du passé.
Pour toutes ces raisons, il nous semble parfaitement approprié de recourir à cette technique
d'investigation en interrogeant les leaders du jeu d'influence dans l'affaire de la modification
du programme des prêts et bourses. Ceci nous permettra de nous renseigner sur les détails de
leur action, leurs intentions et leurs façons de faire ainsi que leurs perceptions de la situation
dans laquelle ils se sont trouvés.
66
Grâce à l'entretien semi-dirigé, le chercheur entre en contact direct et personnel avec un
interlocuteur dans le but d'obtenir des données de recherche. Les interlocuteurs se trouvent
alors dans une situation de communication particulière dans la mesure où les thèmes sont
prédéfinis et organisés selon une certaine structure. Le chercheur doit orienter la discussion de
façon à amener son interlocuteur à décrire, avec détails, son expérience, son savoir ou son
expertise.
La situation de l'entrevue permet de révéler ce que l'autre pense, et qui ne peut être observé : des sentiments, des pensées, des intentions, des motifs, des craintes, des espoirs ; elle rend aussi possible l'identification des liens entre des comportements antérieurs et le présent et elle peut révéler des expériences de vies peu accessibles (Savoie-Zajc, 2003 : 299).
Ainsi, chaque technique permet d'assouvir des interrogations précises et donne à voir les
événements de cette affaire d'un angle différent. C'est en croisant les informations issues de
chacune d'entre elles que nous allons savoir comment se dessine la relation entre les groupes
de pression et les médias dans ce genre de débats publics. Plus tard, sera développé le plan de
cette enquête. Nous allons dresser minutieusement la grille qui a servi à l'analyse de contenu
des articles journalistiques. Nous allons préciser de même les thèmes et les questions qui seront
abordés lors des entrevues.
B - Présentation de l'affaire des prêts et bourses d'études
1- Le problème public et le processus de formulation de la décision publique
Le problème a émergé quand les Québécois ont appris, à la suite de l'annonce du budget
provincial en mars 2004, que le gouvernement Charest avait décidé de convertir 103 millions
de dollars de bourses d'études en prêts. Cette décision venait pallier le problème du sous-
financement chronique dont souffre le réseau universitaire au Québec. Le gouvernement
Charest propose une autre solution pour augmenter la contribution des étudiants dans le
financement des services universitaires depuis qu'il a promis, dans sa campagne électorale, de
maintenir le gel des frais de scolarité pendant toute la durée de son mandat. La question du
sous-financement des universités est récurrente dans le débat public au Québec. Elle constitue
un enjeu de controverses publiques et figure dans l'agenda politique depuis déjà quelques
années.
67
Alors que les universités ne cessent de réclamer plus d'argent pour assurer la qualité de
l'enseignement et des diplômes accordés, les étudiants, eux, demeurent fermés à toute
éventualité de hausser les droits de scolarité.
Cette fois encore, dès l'annonce de la modification du programme des prêts et bourses, les
groupes étudiants ont manifesté leur mécontentement et ont mobilisé de grands moyens de
pression pour dissuader le gouvernement. La proposition de couper 103 millions de dollars de
bourses et de les convertir en prêts d'études est reçue par ces groupes non seulement comme un
moyen d'alourdir l'endettement des étudiants, mais aussi comme une menace pour
l'accessibilité des jeunes aux études post-secondaires.
En se référant aux modes d'émergence des problèmes publics établis par Favre (Muller, 2006 :
3 1 ) H , nous constatons que cette affaire s'est déclenchée selon le mode de l'activation
automatique, puisque le dossier a été activé spontanément par le gouvernement Charest sans
qu'il y ait de revendication de la population concernée.
Tel que nous l'avons vu avec Lemieux (2002)15, un problème public est perçu comme tel à
partir du moment où les acteurs sociaux relèvent un écart entre une situation donnée et les
normes de la distribution des ressources. Dans l'affaire de la modification des prêts et bourses
d'étude, les groupes étudiants ont dénoncé la décision gouvernementale et l'on considérée
comme un moyen détourné d'aller chercher de l'argent dans les poches des étudiants, un
principe qu'il ont maintes fois rejeté en s'opposant au dégel des frais de scolarité. Les plus
radicaux des groupes étudiants vont jusqu'à réclamer la gratuité de la scolarité dans les
universités du Québec. Le premier ministre Jean Charest et son ministre de l'Éducation de
l'époque, Pierre Reid, se sont montrés fermes et ont rejeté l'idée de renoncer à cette réforme et
de céder aux demandes des étudiants. Ils estiment que comparés au reste du Canada, les jeunes
Québécois sont ceux qui payent le moins cher pour les droits de scolarité et sont les moins
endettés.
D'emblée, la situation devient problématique, et le gouvernement Charest devient la cible de
toutes les critiques et d'un grand mouvement de protestation impliquant 250 000 étudiants
affiliés à plusieurs dizaines d'associations.
14 Voir chapitre 1, page 20 du mémoire. 15 Voir chapitre I page 19 du mémoire.
68
Le bras de fer s'est poursuivi pendant presque une année au cours de laquelle les groupes ont
mis en œuvre une panoplie de moyens de pression allant jusqu'à l'organisation d'une grève
générale illimitée à partir de février 2005.
Force est de constater que si cette affaire a pris tant de dynamique et d'ampleur dans l'espace
public québécois, c'est essentiellement grâce à l'activisme des associations étudiantes qui ont
défendu leurs intérêts avec acharnement. Malgré les divergences idéologiques qui les
distinguent, cette cause a pu fédérer quasiment tous les groupements étudiants de la province.
Ce qui a donné naissance à plusieurs coalitions et à des interventions communes. Les actions de
lobbying ont évolué en crescendo, appelant le ministre de l'Éducation à réinvestir le montant
retranché des bourses dès la session suivante.
L'activisme du mouvement étudiant a obligé le gouvernement Charest à réagir. Après avoir
essayé de justifier cette mesure et de convaincre ses interlocuteurs de la pertinence de sa
décision, le gouvernement a amorcé un jeu de négociation avec les groupes de pression qui a
duré presque une année. Ceci correspond à la phase de la formulation de la politique publique
au cours de laquelle les intervenants proposent des idées et des solutions pour résoudre le
problème jusqu'à aboutir à celles qui rallient toutes les parties prenantes.
Afin d'apaiser le conflit, le ministre de l'Éducation Pierre Reid a proposé, entre autres mesures,
un programme de remboursement proportionnel au revenu (RPR) qui vise à tenir compte du
revenu touché par le nouveau diplômé pour définir les modalités du remboursement de sa dette.
Malgré sa réticence et sous la forte pression des groupes étudiants, le gouvernement à répondu
à leurs revendications et les deux partis ont fini par trouver un consensus. Dès septembre 2005,
70 millions de dollars seront réinvestis en bourses. Le gouvernement québécois, avec l'aide du
gouvernement fédéral, s'est engagé à remettre le reste des 103 millions de dollars sur les quatre
années suivantes.
69
2- Les acteurs de la politique des prêts et bourses d'études
Comme dans toute politique publique, les acteurs de l'affaire des prêts et bourses sont ceux qui
se trouvent dans une situation d'exercer une influence sur les processus décisionnels. Ils
peuvent être regroupés en différentes catégories. II y a principalement les acteurs internes et les
acteurs externes à l'appareil gouvernemental16.
Les membres du gouvernement sont évidemment les acteurs centraux de ce débat. À l'époque,
Jean Charest, chef du parti libéral, était premier ministre du Québec depuis qu'il a remporté les
élections en avril 2003. Pierre Reid était le ministre de l'Éducation, il a occupé cette fonction
depuis son élection en 2003 comme député du Parti libéral du Québec dans la circonscription
d'Orford.
Le 18 février 2005, en pleine crise avec les mouvements étudiants, il a était remplacé par Jean-
Marc Fournier qui a été élu député de la circonscription de Châteauguay pour la première fois
aux élections générales de 1994.
Cette catégorie d'acteurs correspond au premier cercle du schéma du « milieu décisionnel
central » développé par Grémion (Muller, 2006 : 41)17. C'est le cercle d'acteurs relativement
permanents par lesquels transitent toutes les décisions importantes.
La Commission jeunesse du parti libéral, qu'on peut considérer comme un groupe de pression à
statut interne rapproché18, a joué un rôle inédit à l'intérieur du processus d'influence. Malgré le
fait qu'elle soit affiliée au parti politique au pouvoir, le Parti libéral, l'organisation s'est
opposée à un moment donné de la chronologie à la décision de Jean Charest et du ministre de
l'Éducation. Sa position a apporté un soutien considérable au mouvement étudiant contestataire
et a renforcé la légitimité des revendications. Toutefois cet appui n'a pas duré longtemps ; les
jeunes libéraux sont rapidement parvenus à une conciliation avec leur parti et ont fini par
atténuer leurs demandes et se rallier au discours gouvernemental.
16 Voir section « Les acteurs des politiques publiques », chapitre I page 15 17
Voir le schéma du «milieu décisionnel central » (C. Grémion, dans Muller, 2006), chapitre 1 page 17 du mémoire 18 Voir chapitre 2 : tableau sur la typologie des groupes de pression, page 36
70
Par ailleurs, les publics des politiques publiques, pour reprendre l'expression de Muller (2006),
sont les individus, groupes ou organisations dont la situation est affectée par la politique
publique.
Dans l'affaire des prêts et bourses, les étudiants constituent le premier public concerné par la
décision gouvernementale. Les associations, groupes et mouvements étudiants de la province
de Québec ont fait preuve d'une grande capacité de mobilisation et de négociation tout au long
de cette affaire. L'organisation de la représentation des intérêts dans cette affaire est marquée
par un grand mouvement de rapprochement entre les groupes étudiants qui appartiennent à des
établissements éducatifs de niveaux différents et implantés dans différentes régions du Québec.
Les principaux groupes qui ont mené le mouvement de contestation contre la réforme du
régime des prêts et bourses d'études sont :
- La Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) principal coordinateur du
mouvement protestataire.
- La Fédération étudiante collégiale de Québec (FECQ).
- L'Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ).
Ces groupes de pression sont des acteurs extérieurs à l'État, ils correspondent au troisième
cercle du schéma du « milieu décisionnel central » de Grémion.
Le parti de l'opposition officielle, le Parti québécois (PQ), et l'Action démocratique du Québec
(ADQ), qui ont contribué à ce débat sur l'aide financière aux étudiants, appartiennent aussi à ce
cercle d'acteurs non gouvernementaux.
Le deuxième cercle du schéma de Grémion regroupe les administrations et les organismes
sectoriels qui appartiennent au domaine en question, tel que le Conseil permanent de la
jeunesse, le Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études (CCAFE) et la
Fondation canadienne des bourses d'études du Millénaire, qui ont joué un rôle important dans
le processus d'influence.
Les députés de l'Assemblée nationale du Québec appartiennent au dernier cercle du milieu
décisionnel qui regroupe l'ensemble des organes politiques et juridictionnels (parlement,
congrès, conseil d'État, cour suprême...), comme le précise le schéma de Grémion.
71
L'affaire de la modification des prêts et bourses d'études a donné lieu à une dynamique entre
l'ensemble de ces acteurs. Chacun d'entre eux a essayé de défendre ses points de vue. Tous ont
tenté d'imposer leurs logiques et d'influencer le cours des choses de façon à préserver leurs
propres intérêts. Les médias ont joué un rôle crucial dans le processus d'influence ; ils ont été
impliqués dès la phase de l'émergence du problème.
Le graphique suivant représente le schéma du « milieu décisionnel central » (C. Grémion, dans
Millier, 2006) appliqué à la politique publique des prêts et bourses d'études.
4- Les députés de l'Assemblée nationale du Québec.
1- Le Premier ministre du Québec et les ministres de l'Éducation successifs : Pierre Reid et Jean-Marc Fournier 2- Le Conseil permanent
de la jeunesse, le Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études, la Fondation canadienne des bourses d'études du millénaire.
3- Les groupes de pression : FEUQ, FECQ, ASSÉ et la Commission jeunesse du parti libéral.
Les partis politiques : le PQ et l'ADQ
Figure 3 : Schéma du « milieu décisionnel central » (C. Grémion, dans Muller, 2006) appliqué à la
politique publique des prêts et bourses d'études.
72
3- Présentation des principaux groupes de pression
La Fédération étudiante universitaire du Québec (La FEUQ)
Établie en 1989 à la suite du dégel des frais de scolarité, la Fédération étudiante universitaire
du Québec regroupe 17 associations membres et plus de 140 000 étudiants membres de tous les
cycles d'études et de toutes les régions du Québec.
La mission de la FEUQ est de favoriser le cheminement académique des étudiants
universitaires du Québec en travaillant à des dossiers susceptibles d'améliorer la qualité de
l'enseignement et l'encadrement qui leur sont dispensés ainsi que la qualité de la vie
estudiantine d'une manière générale.
Son principal mandat consiste à défendre les droits et les intérêts académiques, sociaux,
culturels et économiques des étudiants, notamment auprès du gouvernement, des intervenants
du domaine de l'éducation et des intervenants de la société civile.
Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, la FEUQ a mené nombreuses batailles et en a gagné
plusieurs. A titre d'exemple, en 1994, la Fédération gagne le gel des frais de scolarité qui est
reconduit en 1998 puis en 2003, et qui est toujours en vigueur. En 1999, à la suite d'un manque
flagrant de places disponibles pour les étudiants stagiaires, la FEUQ obtient un investissement
de 33 millions de dollars sur deux ans afin de créer 22 000 places de stages supplémentaires par
année.
En février 2000, lors du Sommet du Québec et de la Jeunesse, le premier ministre consent,
grâce aux pressions de la Fédération, à un réinvestissement de I milliard de dollars en
éducation sur trois ans, dont 600 millions de dollars réservés aux universités.
La FEUQ réalise un gain important pour les étudiants internationaux. Après l'obtention du
droit pour les étudiants internationaux de travailler sur le campus de l'université qu'ils
fréquentent, la FEUQ parvient, en 2004, à leur garantir celui de travailler hors campus partout
au Canada pour toute la durée de leurs éludes.
19 Voir le site de la fédération étudiante universitaire du Québee « hllp://www.feuq.i|e.ea/ », consulté le 7/06/2007
73
À l'égard de ces réalisations, la FEUQ peut être considérée comme un groupe de pression à
statut externe potentiel ; clic a participé à des enjeux de taille et répétitifs et elle semble avoir
une culture politique importante.
En Tannée universitaire 2004-2005, Pier-André Bouchard St-Amant était le président de la
FEUQ, François Vincent était le vice-président et François Dumontier occupait la fonction
d'attaché de presse. Farouk Karim était attaché politique et directeur de campagne dans
l'affaire des bourses et prêts.
La Fédération étudiante collégiale du Québec (La F ECO)
La FECQ est fondée en mars 1990. Elle représente des étudiantes et des étudiants du secteur
collégial autant des programmes pré-universitaires que techniques, et cela dans une dizaine de
régions du Québec. Elle regroupe, en 2007, 22 associations étudiantes collégiales rassemblant
plus de 60 000 membres.
La FECQ se définit comme étant un groupe de pression visant essentiellement le gouvernement
et les différents acteurs de la société dans des domaines tels que l'éducation, l'environnement
et la jeunesse. l'Ile participe à différentes tables sectorielles et nationales du ministère de
l'Éducation.
Sa principale base de revendication est la qualité de l'enseignement et l'accessibilité
universelle de tous les paliers de l'éducation. La FBCQ produit des recherches et des
argumentaires sur différents dossiers. Llle promeut, protège, développe et défend les intérêts,
les droits et les préoccupations des étudiantes et étudiants des collèges du Québec. La FECQ
peut être aussi considérée comme un groupe de pression à statut externe potentiel.
Julie Bouchard était la présidente de la Fédération étudiante collégiale de Québec pendant
l'année scolaire 2004-2005 ; le vice président était Jonathan Plamondon et Amélie Côté était la
coordinatrice aux relations et communications.
Voir le silc de la Fédération étudiante collégiale du Québec « http://www.leeq.org », consulté le 07/06/2007
74
L 'Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ)
L'Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSE) est une organisation de type
syndical qui regroupe, à l'échelle du Québec, neuf associations étudiantes, à la fois collégiales
et universitaires représentant 20 000 étudiants.
L'activité de l'ASSÉ repose sur les fondements du syndicalisme étudiant qui stipule que
l'étudiant est un jeune travailleur intellectuel. Elle perçoit l'éducation comme un droit
fondamental ; chaque membre de la société a le droit à une éducation gratuite publique,
accessible, laïque et de qualité, libre de toute forme de discrimination.
En matière de frais de scolarité, PASSÉ va jusqu'à admettre que « la seule politique
progressiste c 'est sans équivoque la gratuité scolaire à tous les niveaux pour tous et toutes » '.
L'ASSIS lutte, entre autres, pour garantir un régime d'aide financière adéquat ayant pour but
d'éliminer l'endettement étudiant, garantir la satisfaction des besoins fondamentaux et pour
assurer un réseau d'éducation public libre de toute ingérence de l'entreprise privée. Elle lutte
contre toute forme de mondialisation qui entérine la prédominance du profit sur le bien-être de
la population.
L'ASSÉ s'est appropriée une stratégie de syndicalisme étudiant de combat qui vise à établir un
contre-pouvoir avec les gouvernements. Elle considère qu'un rapport de force permet une
négociation d'égal à égal dans les dossiers et les enjeux qui concernent la population étudiante,
chose indispensable lorsque des décisions sont prises à l'encontre des intérêts des étudiantes.
Elle travaille alors massivement à l'information et à la mobilisation massive du mouvement
étudiant québécois.
Lors des événements ayant marqué l'affaire des prêts et bourses, PASSE a pris conscience de
la nécessité de travailler de concert avec d'autres associations pour élargir son pouvoir d'action.
Au mois d'avril 2005, 18 associations indépendantes ont rejoint ce mouvement syndical pour
former la Coalition de PASSE élargie : CASSÉE. La raison d'être de cette coalition étant le
lancement de la grève générale illimitée pour protester contre la transformation de 103 millions
de dollars de bourses en prêts.
21 Site de PASSIF : « hltp://www.asse-solidante.qe.ea/spip.php?ai'tielel7&lang:=fr », consulté le 07/06/2007.
75
À cette époque, Xavier Lafrance occupait la fonction de secrétaire général de l'ASSÉ. Jérôme
Charaoui était délégué de la CASSÉE et Éric Martin et Héloise Moysan-Lapointe ses porte-
parole.
Bien qu'ils aient tous revendiqué le réinvestissement des 103 millions de dollars au régime des
bourses d'études et qu'ils aient déployé d'importantes ressources pour s'exprimer et défendre
les intérêts de leurs membres, ces groupes n'ont pas forcément les mêmes orientations
idéologiques et les mêmes approches de négociation. Nous avons constaté qu'à plusieurs
occasions, il y a eu des confrontations et des divergences stratégiques entre les trois groupes.
Ces groupes de pression représentent les intérêts d'une section particulière de la communauté,
celle des étudiants ; il s'agit alors d'un « sectional group », selon la typologie de Grant (1989 :
11) . Relativement à leur proximité par rapport au gouvernement, la EEUQ, la FECQ et l'ASSE
correspondent plutôt au profil des groupes de pression avec un statut externe potentiel d'après la
classification de Maisonneuve (2004 : 232). En effet, à l'instar des groupes de pression avec un
statut externe, ces groupes ont privilégié l'organisation d'événements destinés à la médiatisation
et visant à attirer l'attention du public vers les enjeux de la réforme du programme des prêts et
bourses. En même temps, ces groupes se rapprochent beaucoup du profil des groupes de
pression avec un statut interne ; ils ont une culture politique et participent à des enjeux de taille
et répétitifs ; ce qui fait d'eux des groupes de pression avec un statut externe potentiel.
Quant à la CASSÉE, rappelons-le, elle constitue une coalition circonstancielle. Elle a vu le jour
à l'occasion du déclenchement de l'affaire des prêts et bourses et sa principale mission est de
mener la grève générale illimitée.
4- Chronologie de la négociation et des moyens de pression
Après plusieurs mois de négociation et de pression, les groupes étudiants ont obtenu gain de
cause et sont parvenus à infléchir, bien que partiellement, la décision du gouvernement Charest.
Comment ont-ils réussi à le faire ? Quelles sont les stratégies de communication et de relations
publiques qu'ils ont mises en œuvre tout au long du processus? Quels sont des facteurs
externes qui sont intervenus dans le jeu d'influence et de négociation ?
Voir la typologie des groupes de pression à la page 36 du mémoire
'/<>
Nous allons nous intéresser, non seulement aux trois principaux groupes déjà identifiés mais
aussi aux autres associations étudiantes membres de ces groupes et qui ont fait preuve de
dynamisme, de manière individuelle, à l'occasion du dossier des prêts et bourses d'études.
Pour tracer la chronologie du mouvement de protestation dans cette affaire, nous nous sommes
basée essentiellement sur les articles de journaux qui ont couvert cette affaire dès son
émergence jusqu'à son dénouement presque une année après.
Nous avons également consulté quelques articles publiés dans le Web et dans des sites à
vocations différentes : des sites d'actualité, des sites organisationnels et autres. Revenons à la
phase d'émergence de la politique publique, et examinons l'évolution des événements, sans
courir le risque d'une redondance.
Rappelons que l'affaire s'est déclenchée au printemps 2004. Au mois de mars, lors du dépôt du
budget 2004-2005 du gouvernement du Québec, le ministre des Finances, Yves Séguin,
annonce d'importants changements au système de l'aide financière aux études du ministère de
l'Éducation. Le gouvernement décide de retrancher 103 millions de dollars dans le montant
accordé aux bourses et introduit une importante augmentation du plafond des prêts. Les jeunes
québécois ont reçu cette nouvelle avec désillusion. D'emblée, les groupes étudiants, Fédération
étudiante universitaire du Québec (FEUQ) en tête, commencent à s'organiser pour exprimer
leur désaccord à l'endroit du gouvernement Charest et l'inciter à revenir sur sa décision.
De même, pour marquer son désenchantement, le Conseil permanent de la jeunesse (CPJ), un
organisme du gouvernement du Québec, a adressé à Jean Charest une lettre de huit pages visant
à l'inciter à abandonner cette réforme et lui rappeler les engagements qu'il avait pris à l'endroit
de la jeunesse.
Les actions de protestation commencent dès le 9 avril 2004 lorsque la FEUQ interrompt la
conférence de presse du ministre de l'Éducation à Québec par une manifestation. Le 14 avril, la
FECQ et l'ASSÉ font une journée de grève générale d'une journée, partout au Québec. Pendant
la soirée, la FECQ et la FEUQ ont organisé une marche sur la colline parlementaire à Québec
et dans les rues de Montréal.
77
Au mois de juin, le Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études (CCAFE),
organisme gouvernemental responsable de conseiller le ministre en matière d'accès aux études,
a dénoncé la réforme de l'aide financière. De même, le rapport déposé par la Commission de
l'éducation, à la suite de la Commission parlementaire sur la qualité, l'accessibilité et le
financement des universités soutient qu'il faut mettre davantage d'argent dans le régime d'aide
financière. En août 2004, les groupes étudiants obtiennent le soutien de la Commission
Jeunesse du Parti libéral du Québec qui s'est positionné contre les compressions dans les prêts
et bourses. De même, le Parti québécois et l'ADQ se sont exprimés en défaveur de la décision
gouvernementale, lors du congrès de la FEUQ qui s'est déroulé en août 2004.
Ces prises de positions qui émanent d'organismes gouvernementaux et politiques n'ont pour
effet que de renforcer la légitimité de la cause des étudiants et les encourager à poursuivre leur
combat. Cependant, le 1er septembre 2004, les modifications du régime de l'aide financière aux
étudiants sont entrées en vigueur.
Dès le début de la session d'automne, des groupes de jeunes se sont rassemblés au sein de
Concertation jeunesse afin d'interpeller le Premier ministre. Ce regroupement réunit la FECQ,
la FEUQ, soit les fédérations étudiantes collégiale et universitaire et bien d'autres organismes
déjeunes comme Force jeunesse. Les membres de Concertation jeunesse veulent rencontrer le
Premier ministre Jean Charest et lui faire part de leurs demandes, notamment en ce qui
concerne l'aide financière aux étudiants.
Quelques jours après, la FEUQ et la FECQ ont organisé un événement assez original : il s'agit
de journées de marathon téléphonique qui vise les députés libéraux et le cabinet du Premier
ministre. Les numéros de téléphones sont mis à la disposition des étudiants.
Pendant toute la journée, ils ont engorgé les lignes téléphoniques et ont exprimé leur
mécontentement aux députés et aux membres du gouvernement. Cette stratégie de lobbying
direct a eu un écho important dans les médias.
En octobre, la FECQ et la FEUQ participent au Forum des générations et demandent au
gouvernement de réintégrer les sommes coupées dans les prêts et bourses. Mais le
gouvernement Charest ignore leur revendication. Les deux fédérations claquent la porte du
Forum des générations. Ils appellent à une grande manifestation pour le 10 novembre 2004 à
Montréal et à Québec.
78
Jusque-là, la FHUQ et la FECQ sont les groupes les plus actifs. L'association pour une
solidarité syndicale (ASSÉ) a marqué sa véritable entrée dans le jeu d'influence avec
l'organisation d'une manifestation à la clôture du Forum des générations.
Quelques jours après, la FEUQ augmente la pression sur le gouvernement Charest : elle dévoile
un avis juridique qui démontre qu'avec cette réforme du programme des prêts et bourses, le
gouvernement viole l'entente avec la Fondation canadienne des bourses d'étude du Millénaire.
Il se prive ainsi de 70 millions de dollars. Entre temps, I 'ASSÉ entame sa campagne de grève
générale illimitée.
Le 10 novembre, 12 000 étudiants ont répondu à l'appel de la FECQ et de la FEUQ et ont
manifeste dans les rues de Québec et de Montréal.
Suite à cette grande manifestation, la FEUQ a poursuivi la campagne d'opinion publique. Les
résultats d'un sondage Léger-Marketing qu'elle a commandé et qui ont été diffusés le 19
novembre 2004 démontrent que 75% des Québécois appuient la cause étudiante.
Les étudiants ont gagné du terrain parce qu'ils ont su renforcer la légitimité et la popularité de
leur cause en recueillant l'appui de plusieurs acteurs de l'espace public québécois. Les
événements évoluaient en leur faveur, jusqu'au moment où la Commission jeunesse du parti
libéral du Québec, qui a antérieurement exprimé son désaccord à l'égard de la décision du
gouvernement Charest, a laissé tomber les étudiants en acceptant, lors du congrès du Parti
libéral, un amendement du ministre de l'Education qui vide de son sens leur proposition initiale.
Cette attitude a été dénoncée par le reste des groupes étudiants qui se sont sentis trahis par les
jeunes libéraux.
Vers la fin du mois d'octobre, en s'inspirant de l'Halloween, la FAECUM ( la Fédération des
associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal) a organisé une marche funèbre
devant la maison de Jean Charest. Un autre pseudo événement est organisé, cette fois-ci, par la
CADEUL (la Confédération des associations d'étudiants et étudiantes de l'Université Laval) ; la
confédération a offert une crèche vivante au ministre de l'Éducation Pierre Reid à l'occasion de
Noël.
79
Au retour des classes au mois de janvier, les groupes étudiants semblent être, plus que jamais,
mobilisés et décidés à accentuer les moyens de pression afin d'obliger le gouvernement à
revenir sur sa décision.
Pour tenter de calmer les esprits, le ministre de l'Éducation Pierre Reid lance l'idée d'instaurer
un régime de remboursement des prêts d'études proportionnel au revenu (RPR). C'est une
procédure fondée sur les capacités financières de l'ex-étudiant ; elle devrait faciliter le
remboursement des prêts selon les capacités de payer de chacun (Montmarquette, 2006 : 1).
Cette proposition a été rejetée par les étudiants qui l'ont jugée comme un simulacre de
réconciliation qui ne corrige en rien la problématique de l'endettement étudiant.
Après cet événement, le mécontentement des étudiants envers la politique en matière
d'éducation menée par le gouvernement Charest atteint son apogée.
La CADEUL demande la destitution du ministre Pierre Reid. L'association représentant les
étudiants du premier cycle de l'Université Laval a adopté lors de son caucus une motion
demandant à M. Jean Charest de procéder dans les plus brefs délais à un remaniement
ministériel.
Entre-temps, l'ensemble des groupes étudiants (universitaires et collégiaux) commence à
discuter d'opportunités de grève générale. Le 17 janvier, les associations étudiantes du premier,
deuxième et troisième cycle de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) organisent une
journée de grève pour contester la modification du régime des bourses et prêts.
Le 31 janvier 2005, l'ASSÉ lance sa coalition élargie (CASSÉE) pour la grève générale
illimitée.
En février 2005, les étudiants entreprennent une série d'actions insolites et parfois
provocatrices. En référence aux 103 millions de dollars coupés du régime des bourses, des
étudiants de cégeps relâchent 103 souris dans certains bureaux de députés à Montréal et dans le
bureau de circonscription du premier ministre Jean Charest à Sherbrooke. Ce geste traduit le
refus des étudiants d'incarner les rats de laboratoire sur lesquels le gouvernement teste ses
réformes. Bien que les organisateurs de cette action demeurent anonymes, tous les journaux ont
repris la nouvelle.
80
De même, le jour de la Saint-Valentin, trois étudiantes ont porté 103 roses au ministre de
l'Éducation Pierre Reid dans l'espoir de « l'attendrir» afin qu'il annule les compressions des
103 millions dollars dans le régime des prêts et bourses. Une action du même genre a eu lieu au
mois de mars. Le 15 février, des étudiants ont porté 103 balles de foin dans le bureau de la
ministre Françoise Gauthier. À Montréal, 103 étudiants se sont faits entarter par une mascotte à
l'effigie de Jean Charest devant les bureaux du Premier ministre. L'action portait comme
message l'idée que les compressions touchent des « cibles faciles », les étudiants les plus
pauvres. De part leur originalité et leur imprévisibilité, ces actions peuvent être classées comme
des pseudo-événements.
Le gouvernement semble toujours ignorer les demandes des étudiants, mais ces derniers ne
laissent pas tomber le dossier. Une manifestation violente a perturbé le caucus du Parti libéral
du Québec. Les étudiants ont été contrés par les forces de l'ordre qui voulaient les empêcher
d'accéder au Château Montebello dans la région d'Outaouais. Conséquence, la manifestation
tourne à l'émeute avec une dizaine de blessés de part et d'autre et l'arrestation de quelques
étudiants.
En pleine crise entre le gouvernement et les groupes de pression étudiants, le 18 février, suite à
un remaniement ministériel, Jean-Marc Fournier est nommé ministre de l'Education à la place
de Pierre Reid. Le départ de ce dernier est accueilli avec enthousiasme par les étudiants qui
s'attendent à une prise de mesures favorables dans le dossier de l'endettement étudiant.
Par ailleurs, le ministre des Fnances, Yves Séguin, s'est prononcé sur le dossier en promettant
aux étudiants de réinvestir dans le régime des prêts et bourses dès le budget suivant.
Néanmoins, certains groupes continuent à mettre en œuvre leur plan d'action : le jeudi 22
février, 25 000 étudiants affiliés aux associations de la CASSÉE entrent en grève.
De son côté la FEUQ estime que la grève est prématurée à cette étape. Elle opte pour le
dialogue et la négociation avec le nouveau ministre de l'Education. À peine quelques jours
après sa nomination, Jean-Marc Fournier rencontre les représentants de la FECQ et de la FEUQ.
Il se déclare sensible au problème de l'endettement étudiant et promet de réviser le dossier. Les
deux groupes ne baisseront pas les bras tant qu'il n'y pas de résolution concrète du problème.
Même s'ils n'ont pas lancé d'appel officiel à la grève, les associations étudiantes locales
continuent de tenir des référendums de grèves. En parallèle, les deux fédérations étudiantes
lancent une campagne publicitaire à la télévision.
Kl
Les grévistes de la CASSÉE privilégient les manifestations sur le terrain et annoncent une
grande mobilisation dans les jours qui suivent. Ils entament des démarches pour rencontrer le
nouveau ministre afin d'obtenir un engagement clair du gouvernement avant le budget.
Le Syndicat des professeurs des universités du Québec, le Syndicat des professeurs de
l'Université de Montréal ainsi que le Syndicat des chargés et chargées de cours de l'Université
Laval (SCCUL) ont exprimé leur soutien à la cause des étudiants, renforçant ainsi la légitimité
de leurs demandes.
Au début du mois de mars, en votant majoritairement en faveur d'une motion qui reconnaît que
leur gouvernement a eu tort d'agir de la sorte dans l'affaire des prêts et bourses, l'Assemblée
nationale demande au nouveau ministre de l'Éducation de corriger la décision de transformer
103 millions $ de bourses en prêts, en tenant compte de ses effets sur l'endettement des
étudiants.
Par ailleurs, la première rencontre entre le ministre Fournier et le comité de négociation de la
CASSÉE s'est soldée par un échec. La coalition est accusée par le ministre d'avoir chapeauté la
manifestation dans ses bureaux de Châteauguay, ce qui a forcé l'intervention d'une escouade
tactique de la Sûreté du Québec.
À partir de cet événement, chaque jour qui passe amène son lot de mandats de grève et d'appuis
supplémentaires aux étudiants qui protestent contre la transformation de 103 millions $ de
bourses en prêts. Selon les décomptes de la FEUQ, le mouvement a atteint quelque 85 000
grévistes cégépiens et universitaires.
Le 15 mars 2005, Jean-Marc Fournier présente sa première offre aux étudiants en leur
proposant de réinvestir, en compensation des 103 millions de dollars, 29 millions $ l'année
suivante et 90 millions $ sur une durée de cinq ans. La proposition est rejetée par les étudiants
et le ministre refuse de leur redonner plus de 42 millions $ à la rentrée suivante. Les résultats
d'un sondage TVA- Léger Marketing indiquent que la majorité des Québécois appuie le
compromis proposé par le ministre de l'Éducation. Cependant, des dizaines de milliers de
grévistes sont descendus dans les rues de Montréal et de Québec pour exprimer leur colère.
Les manifestations et la grève se poursuivent tout au long du mois de mars et le nombre de
grévistes a atteint presque 200 000 étudiants.
X2
La FEUQ présente au gouvernement une contre-proposition pour lui démontrer comment
trouver les 62 millions $ qui manquent pour arriver aux 103 millions $ à réinvestir dans le
régime des bourses et prêts.
Le 29 mars 2005, les négociations reprennent entre le gouvernement et les étudiants alors que
la grève étudiante entre dans sa cinquième semaine. Le dénouement de la crise commence à se
dessiner dès le début du mois d'avril ; les fédérations étudiantes et le gouvernement sont
parvenus à une entente de principe. Le gouvernement annonce la distribution de 482 millions
de dollars en bourses supplémentaires sur cinq ans de la façon suivante : 70 millions de dollars
la première année et 103 millions les quatre autres années.
Cette augmentation de fond est rendue possible grâce aux accords que le ministre Fournier a pu
conclure avec les autorités fédérales. Le ministère a obtenu d'abord une aide de 40 millions de
dollars suite à une entente avec la Fondation des bourses du Millénaire du gouvernement
fédéral.
Il a ensuite obtenu une deuxième aide de 100 millions de dollars pour les cinq prochaines
années à l'issue des discussions avec le gouvernement fédéral dans le cadre du Programme
canadien de prêts aux étudiants23.
Après deux jours de discussions en congrès général, la CASSÉE rejette officiellement cette
entente de principe. Après six semaines et demie de grève, les étudiants reprennent leurs cours.
F̂n fin de compte, les groupes contestataires qualifient de « bon gain » l'entente avec Québec,
mais refusent de parler de victoire puisque le réinvestissement des 103 millions $ ne s'est pas
fait dès la session suivante, comme ils l'ont longuement revendiqué, mais plutôt sur les quatre
années suivantes.
Cette politique publique a provoqué l'une des plus importantes mobilisations étudiantes dans
l'histoire du Québec. Le bras de fer entre le gouvernement libéral et les groupes de pression de
la communauté étudiante a duré presque une année. Les négociations étaient intéressantes dans
la mesure où, ces groupes ont eu recours à un répertoire d'action riche et ont réussi à rallier
l'opinion publique ainsi que plusieurs autres acteurs de l'espace public.
23 Voir annexe 7 : Déclaration du ministre de l'Éducation, des loisirs et des sports à l'occasion du dévoilement de l'entente de principe avec les leaders étudiants.
83
Les étudiants ont multiplié les moyens de pression et ont eu recours tantôt aux techniques de
lobbying direct, tantôt aux techniques de lobbying indirect. Comme il y a eu des rencontres et
des discussions avec des membres du gouvernement, il y a eu des actions de communication
événementielle, des pseudo-événements et de la communication publicitaire.
Nous constatons qu'il y a eu dans certains cas des actions de lobbying totalement imaginées et
montées par les groupes de pression, tandis que dans d'autres situations, les étudiants ont
profité de la tenue de certains événements d'actualité pour intervenir et faire entendre leur voix.
Nous estimons que la FEUQ a réalisé un bon coup médiatique après avoir commandé et publié
un sondage d'opinion qui témoigne de la popularité de ses revendications auprès de l'opinion
publique québécoise.
Il apparaît aussi que tout au long de cette affaire, les positions prises par ces trois groupes
illustrent la force politique de ces organismes et leur capacité à négocier avec le gouvernement
dans des conditions d'égal à égal, comme dans le cas où la FEUQ a suggéré au gouvernement
d'effectuer un remaniement ministériel pour destituer le ministre Pierre Reid. L'ensemble des
activités entreprises par les groupes étudiants en question témoigne de leurs capacités
financières, organisationnelles, logistiques et créatives, ce qui fait d'eux des groupes de
pression redoutables sur la scène publique québécoise.
Certes, les médias ont joué un rôle significatif dans l'affaire. Ils ont considérablement contribué
à la promotion de la cause et l'ont imposée comme un sujet de débat public.
Dans un article publié le 30 avril 2005 au journal Le Devoir, les deux fédérations étudiantes
ainsi que la CASSEE ont déclaré avoir joué la carte des médias et ont fait d'eux une cible
prioritaire dans leur stratégie de protestation.
Dans l'étape suivante du travail, nous allons approfondir l'analyse du traitement médiatique de
la politique publique des prêts et bourses d'études en focalisant sur la question de l'accès des
groupes de pression à la scène médiatique et l'orientation de la couverture réalisée par les
journalistes.
X-l
C- Analyse et interprétation des données recueillies
Comme nous l'avons antérieurement précisé, le cas de cette politique publique québécoise est
étudié à l'aide de deux techniques de cueillette de données : l'analyse de contenu d'articles de
presse et l'entretien semi-dirigé.
L'analyse des articles de journaux nous a renseignée sur les modalités de médiatisation des
problèmes publics, la nature de la couverture des mouvements sociaux. Grâce au contact direct
avec les acteurs de cette affaire, les entretiens nous ont éclairé sur les intentions des groupes de
pression, les stratégies de lobbying indirect qu'ils ont mis en œuvre pour attirer l'attention des
médias, orienter leur discours, mobiliser l'opinion publique et parvenir à infléchir la décision
gouvernementale.
Cette démarche nous offre la possibilité de croiser les informations obtenues à partir de
chacune des techniques et de pouvoir comparer l'objectif visé par les groupes avec la
couverture qu'ils ont eue dans les journaux.
/- Analyse de contenu : corpus et échantillonnage
Pour l'analyse documentaire, le corpus retenu est composé des articles de journaux qui sont
parus sur l'affaire des prêts et bourses pendant l'année scolaire 2004-2005, précisément entre le
mois de novembre 2004 et le mois de février 2005, dans deux journaux d'envergure (de
Montréal) et un journal local (de Québec) à savoir ; Le Devoir, La Presse et Le Soleil. Ce qui
nous donne au total 96 articles.
Cette période correspond à la phase de formulation de la politique publique. Elle est marquée
par une forte mobilisation de la part des groupes de pression qui s'opposent à la décision de la
coupe de 103 millions $ du régime des bourses d'études en faveur des prêts. Les associations
estudiantines ont multiplié les actions de lobbying et se sont montrés particulièrement actifs
dans leur tentative de dissuader le gouvernement Charest. Dès le début du mois de septembre,
et avec le retour des classes a commencé l'organisation de la représentation des intérêts, nous
pouvons observer une grande dynamique de discussion et de dialogue entre les différentes
associations étudiantes, ce qui a abouti à la formation de nombreuses coalitions et
l'organisation de nombreuses actions communes.
85
Comme nous l'avons largement exposé dans la chronologie de l'affaire, c'est effectivement
dans ce laps de temps qu'on peut observer la montée en crescendo du jeu de négociation entre
les acteurs : l'intervention de nouveaux acteurs, le ralliement des uns avec les autres, le
développement des arguments des parties opposées et l'apparition de nouvelles pistes
d'influences.
fous les événements qui se sont produits à cette étape du processus ont eu leur poids dans la
formulation de la résolution du problème. C'est pour cela que nous avons choisi de nous
pencher sur les écrits journalistiques qui ont couvert cette période. Nous allons tenter d'évaluer
le rôle joué par les médias pour soutenir la cause des groupes étudiants.
2- Analyse de contenu : grille de traitement des articles de journaux
À partir de l'analyse de contenu des articles de journaux, nous espérons pouvoir collecter des
informations qui répondent essentiellement à deux questions distinctes :
Comment les groupes de pression ont-ils fait pour réussir à intégrer l'ordre du jour
médiatique ? Plus précisément, quels éléments de mise en scène médiatique peut-on
relever dans leurs actions ?
Les journaux ont-ils pris position par rapport à l'action des groupes et leurs arguments ?
Ont-ils défendu ou dénigre leurs points de vue ?
À partir de ces questions, les deux principaux concepts que nous aurons à expérimenter sont la
mise en scène médiatique et / 'orientation de la couverture par les journaux.
a- Les variétés de mise en scène médiatique et leurs indices
À la lumière des écrits en rapport avec le fonctionnement des entreprises de presse, notamment
en ce qui concerne la médiatisation des problèmes publics et la construction de la nouvelle
journalistique, nous avons relevé six variétés de mise en scène dans les médias. Il est important
de définir ces différents concepts afin de faciliter leur opérationnalisation (De Bonville, 2006).
- La mise en scène des scandales : D'après Thompson (1995), les scandales sont déclenchés
suite à la divulgation d'une information ou d'une activité qui heurte la conscience, le bon sens
et la morale. Bile concerne de façon générale, une personnalité connue. Les scandales sont
susceptible de suscite l'émotion ou l'indignation de l'opinion publique.
86
- La mise en scène des spectacles : Le spectacle désigne tout ce qui se présente au regard, à
l'attention et qui est capable d'éveiller un sentiment.24
- La mise en scène du suspense : Dans le langage cinématographique ou littéraire correspond
au moment où l'action tient le spectateur, l'auditeur ou le lecteur dans l'attente angoissée de ce
qui va se produire.25
- La mise en scène de l'insolite : Un fait insolite est celui qui est différent de l'usage, de
l'habitude. Il est étrange, bizarre et surprenant.26
- La mise en scène de la dramatisation et du sensationnalisme : Llle correspond à présenter les
faits de manière dramatique et théâtrale afin de produire une impression de surprise, d'intérêt
ou d'admiration.27
- La mise en scène des conflits : Un conflit représente un antagonisme, une opposition de
sentiments, d'opinions entre des personnes ou des groupes.
Partant de ces définitions, nous avons repéré, dans le tableau suivant, les indicateurs qui
peuvent nous renseigner sur la présence de l'une ou l'autre de ces variétés dans les actions des
groupes de pression. I ,e scandale ou 1 ,e spectacle I ,c suspense L'insolite Dramatisation et Le conflit
l'événement choe sensationnalisme
- Présence - Investir de -Événements par - Faits - Témoignages - Menaces d'acteurs connus grands moyens épisodes imprévisibles,
inattendus, d'acteurs
- Insultes -Dévoiler des - Recourir au - Ne pas révéler étranges - Enquêtes, dossiers et secrels nombre toutes les conseils - Recours aux
informations, les - Faits suscitant la tribunaux - Recourir à la - Occuper des stratégies... curiosité - Panels ; échange vertu ; faits lieux publics entre spécialistes et inacceptables par grand publie la loi. la morale - Utiliser des ou l'autorité gadgets visuels : - Démonstration par sociale costumes,
pancartes, l'image
- Adopter un ton statuettes... - Victimisation des dénonciateur acteurs
- Éléments de proximités
- Recours à la vertu
' Bibliorom Larousse (version électronique) 25 Ibid. 2" Ibid. 27 Ibid. 28 Ibid.
87
b- L'orientation de la couverture médiatique et ses indices
La couverture des événements d'une affaire publique et des activités des groupes de pression
par les journalistes peut être favorable à la cause défendue par les groupes de pression ; elle
peut être contre leur position et leurs arguments ou bien, elle peut être tout simplement neutre
notamment quand il s'agit d'un article d'information. À ce sujet, Kerbrat- Orecchioni (2002 :
71) distingue deux types de discours. D'abord, le discours objectif qui s'efforce de gommer
toute trace de l'appartenance d'un énonciateur, et le discours subjectif dans lequel l'énonciateur
s'avoue explicitement comme la source évaluatrice de l'affirmation.
Notre analyse va tenter d'évaluer la couverture des journaux à partir de ce que disent
explicitement les journalistes, ce qu'ils rapportent au nom des acteurs et le fait qu'ils insistent
sur le fond ou la forme du message. Les indices dans le tableau ci-dessous nous aideront à
reconnaître l'orientation de l'article. Des exemples d'énoncés codés llgurent dans l'annexe 2.
Position favorable Position neutre Position défavorable
- Reprendre les arguments -Rapporter des faits sans les - Dénoncer le fond ou la forme des commenter messages
- Valider implicitement ou explicitement les arguments - Communiquer des informations - Insister sur l'action ou la forme du (introduire des témoignages qui statistiques message et mépriser le message de les confirment)
-Donner la parole aux adversaires fond
- Critiquer les arguments opposes d'une façon équitable - Contrarier les arguments explicitement ou implicitement
- Ignorer les arguments opposés
L'analyse de contenu médiatique va nous permettre de recueillir toutes ces données et bien
d'autres. La grille d'analyse29 que nous proposons pour décortiquer les articles journalistiques
se divise en trois grandes parties. La première regroupe les informations descriptives
concernant le fond et la forme des articles. La seconde s'intéresse aux interventions des
groupes de pression rapportées dans l'article (leurs caractéristiques et les stratégies aux quelles
elles font appels, ainsi que les éléments de leur mise en discours par le journal). Ln troisième
lieu, l'analyse se concentre sur l'orientation de la couverture.
Les opérations de dépouillement statistique seront faites à l'aide du logiciel SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences), destiné à l'analyse des données quantitatives en sciences
humaines. Voici les explications sur le codage des données :
29 Voir la fiche d'analyse en annexe 1
XK
Nous avons identifié au total 26 variables. Nous avons favorisé un codage basé sur les variables
dichotomiques -dites aussi « factices » dans le jargon des statistiques- parce que nous nous
sommes rendue compte, pendant le codage des articles de presse, qu'il existe souvent plusieurs
catégories d'une même variable dans un même article. Voici les différentes variables retenues
et les codes qui leurs sont attribuées.
- Le titre du journal : 1 - Le Soleil 2- La Presse 3-Le Devoir
- Type d'article : 1- Informatif 2- Opinion
- Source de l'article : 1- Communiqué 2- Entrevue 3- Couverture d'un événement 4-Commentaire d'un citoyen 5- Autre 6- Conférence de presse
-Auteur: I-Unjournaliste 2- Une personne affiliée à un groupe ou à un mouvement particulier 3- Un lecteur-citoyen
- Cite ou non un groupe : 0- ne cite pas de groupe, 1- cite un groupe Cite ou non la FEUQ : 0- ne cite pas la FEUQ, 1- cite la FEUQ Cite ou non la FECQ : 0- ne cite pas la FECQ, 1 - cite la FECQ Cite ou non l'ASSÉ : 0- ne cite pas FASSE, 1- cite FASSE Cite ou non d'autres groupes : 0- ne cite pas d'autres groupes, 1- cite un autre groupe
- Cite ou non une action : 0- ne cite pas d'action, 1- cite une action
- Catégorie des actions citées : 1 - événementielle 2- pseudo événement 3- lobbying direct 4- publicitaire 5- autre
- Cite ou non une déclaration : 0- ne cite pas de déclaration, I - cite une déclaration
- Ton des déclarations : Ton d'expertise : 0- non indiqué, 1- indiqué
Ton de détermination et de persévérance : 0- non indiqué, I- indiqué
Ton ironique : 0- non indiqué, 1- indiqué
Ion de colère : 0- non indiqué, I- indiqué
Ton compréhensif : 0- non indiqué, I- indiqué
- Stratégie de mise en scène: Choc et Scandale : 0- non indiqué 1- indiqué
89
Spectacle : 0- non indiqué, 1- indiqué
Suspense : 0- non indiqué, 1- indiqué
Insolite : 0- non indiqué, 1- indiqué
Dramatisation et sensationnalisme : 0- non indiqué, 1- indiqué
Conflit : 0- non indiqué, 1- indiqué
- Orientation de la couverture 0 - Défavorable I - neutre 2- Favorable
Il aurait était souhaitable, dans d'autres circonstances, d'effectuer un double codage, des tests
de fidélité ainsi que des prétests afin de peaufiner notre dispositif de codage. Nous avons été
particulièrement contrainte par les délais pour la réalisation de ce mémoire.
3-Analyse de contenu : traitement des données et interprétation des résultats
Le total des 96 articles étudiés est partagé comme suit entre les trois journaux : 38 articles dans
La Presse, 32 dans Le Soleil et 28 dans Le Devoir.
Ce qui implique que dans la période en question, La Presse est le journal qui a publié le plus
grand nombre d'articles traitant le sujet de la modification du programme de l'aide financière
aux étudiants.
Avec les variables que nous avons identifiées, le logiciel SPSS nous permet de vérifier un
grand nombre d'hypothèses et d'obtenir des résultats intéressants concernant la couverture de
cette politique publique.
Nous allons focaliser sur les opérations statistiques susceptibles de nous aider à vérifier nos
hypothèses. Pour cela, nous allons nous attarder sur trois axes d'interprétation distincts ;
l'accessibilité des groupes étudiants aux journaux, l'orientation de la couverture qui leur est
donnée et la distribution de la parole entre les acteurs dans les journaux.
a) Accès des groupes étudiants aux journaux
Dans 54,2% des articles qui ont couvert la politique publique des bourses et prêts entre
novembre 2004 et février 2005, les journalistes ont cité un ou plusieurs groupes étudiants et ont
relaté leurs activités.
90
Dans le reste des articles, les auteurs présentent une analyse ou un commentaire général sur la
situation, l'enjeu de la politique publique en question, ou sur les interventions du reste des
acteurs sans évoquer celles des groupes de pression.
Cilc ou non un groupe
Cite on non un groupe
Nous en déduisons que cette affaire intéresse les journaux dans la majorité des cas de part les
activités des groupes de pression. Toutefois, vu que les deux pourcentages se rapprochent, nous
concluons que d'autres acteurs ainsi que d'autres événements en dehors du champ d'action des
groupes étudiants suscitent l'intérêt des journaux.
Pour ce qui est du genre journalistique des articles qui ont traité de ce problème public, la
majorité d'entre eux sont de type informatif à savoir 61.5% par rapport à 38.5% d'articles
d'opinion, comme l'indique le tableau suivant.
fréquence Pourcentage Informatif 59 61,5
opinion 37 38,5 Total 96 100,0
ableau univarié: Type de l'article
De plus, les statistiques montrent que les groupes de pression sont moins cités dans les articles
d'opinion que dans les articles informatifs : sur 37 articles d'opinion, 27 n'évoquent nullement
les activités des groupes étudiants, tandis que parmi les 59 papiers informatifs, 42 ont repris les
activités des groupes. Ceci prouve que l'activité des groupes étudiants a suscité moins de
commentaires et de réflexions qu'elle n'a stimulé de nouvelles journalistiques. Nous pouvons
en conclure que les interventions des groupes de pression obtiennent une visibilité dans les
médias parce qu'elles répondent aux critères de la nouvelle journalistique.
91
Nous allons savoir plus loin les critères qu'ils remplissent et ce qui leur donne l'avantage de
pouvoir faire l'objet des nouvelles.
D'après le tableau ci-dessous, nous constatons que dans 65 % des cas, lorsqu'un article cite un
groupe, il cite une ou plusieurs actions de relations publiques organisées par ce groupe.
Toutefois, dans certains cas, les articles citent un groupe de pression sans parler de ses actions ;
dans 34.6% des articles, l'auteur se contente de reprendre des déclarations des membres des
organisations étudiantes ou d'expliquer leurs positions comme le montre l'extrait suivant d'un
article publié dans La Presse du 28/02/2005 :
Regroupés sous la bannière de la Coalition de l'Association pour une solidarité
syndicale étudiante élargie (CASSEE), les grévistes revendiquent l'abolition de la
réforme des prêts et bourses et l'arrêt du processus de décentralisation et d'arrimage
au marché du réseau collégial, le tout dans une perspective de gratuité scolaire et
d'éradication de l'endettement étudiant. " On a deux principaux buts dans cette
grève: instaurer un rapport de force vis-à-vis de l'État pour obtenir nos
revendications et éviter de se faire récupérer par les autres fédérations étudiantes. "
C'est le message qu'a répété le porte-parole de la CASSEE [...].
cite ou non une action
Total
ne cite pas cite Cite ou non
un groupe ne cite pas 39 5 44
88,6% 11,4% 100,0% 68,4% 12,8% 45,8%
cite 18 34 52
34,6% 65,4% 100,0°/ 31,6% 87,2% 54,2%
total 57 39 06 59,4% 40,6%o 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% Tableau croisé Cite ou non un groupe / cite ou non une action
* Le groupe le plus cité clam les journaux : Parmi les trois groupes de pression que nous avons
étudiés, la FEUQ est le plus cité dans les journaux (38% des articles), ensuite la FECQ est citée
dans 33.3% des articles et en troisième position, FASSE est citée dans 17.7 % des articles.
' ) . >
D'après les résultats de l'enquête, la FECQ était le groupe le plus évoqué dans Le Soleil tandis
que LASSÉ a été surtout citée dans Le Devoir et la FEUQ a été autant citée dans Le Soleil que
dans Le Devoir.
Nous allons vérifier dans les entrevues si les différents groupes ont tenté d'entretenir des
relations privilégiées avec l'un ou l'autre des journaux afin de pouvoir mieux commenter ce
constat.
* La catégorie d'action la plus présente dans les articles: Ce sont les pseudo-événements qui
représentent la catégorie d'action de relations publiques la plus reprise dans les journaux avec
un pourcentage de 36.5% suivie des actions de lobbying direct dans 7.3% puis la
communication publicitaire et la communication événementielle avec 2.1 % des cas.
Le tableau ci-dessous indique que parmi les 39 articles qui ont parlé des actions menées par les
groupes de pression, 33 reprennent des actions que nous avons classées comme des pseudo
événements. En voici un exemple:
Des collégiens qui voulaient dénoncer la conversion en prêts de 103 millions de dollars de bourses étudiantes ont manifesté hier en lâchant 103 souris blanches dans le bureau de circonscription du premier ministre Jean Charest, à Sherbrooke. Une douzaine de rongeurs ont également été abandonnés dans le bureau de la vice-première ministre Monique Gagnon-Tremblay, également à Sherbrooke. (La Presse, 03/02/2005).
Il paraît que le pseudo- événement est le genre d'activité qui suscite le plus l'intérêt des
journaux et des médias d'une façon générale.
Reste à vérifier si les groupes ont concentré leurs efforts dans un répertoire de pseudo
événements ou s'ils ont varié les répertoires, alors que les médias focalisent sur ce type
d'activités vu leur potentiel d'intéresser le public.
Pseudo événement
Total
non indiqué Indiqué Cite ou non
une action ne cite pas 55 2 57
Cite 6 33 39 Total (.1 35 96
Tableau croisé : Cite ou non une action / Pseudo-événement
93
* Accessibilité en fonction des éléments de mise en scène : À l'aide du logiciel SPSS, nous
avons effectué plusieurs tests de croisement de variables pour vérifier la relation entre le fait
d'évoquer une activité ou une action menée par un groupe de pression et les éléments
stratégiques de la mise en scène de cette action.
Les tests nous ont révélé que l'association est significative entre le fait qu'un groupe soit cité
dans les journaux et la présence d'éléments de spectacle et de suspense dans ses interventions
de protestation30.
En effet, dans 35.4% des articles journalistiques, les interventions des groupes comportent les
éléments de spectacle. Plus précisément, cette caractéristique du discours médiatique est
présente dans 31 des 39 articles qui ont évoqué des actions organisées par les groupes de
pression. Le passage ci-dessous témoigne de la couverture d'un événement spectaculaire :
À Montréal, en matinée, une centaine d'étudiants ont bloqué l'accès des bureaux du ministère de l'Éducation, rue Fullum, armés de sapins... À Québec, à l'heure du dîner, des étudiants membres du Front d'opérations régionales de la coalition étudiante de la région de Québec (FORCE) ont «ravivé la magie de Noël» à l'aide d'une crèche vivante devant l'entrée principale du complexe G pour inciter le gouvernement à verser 103 millions «dans le panier à cadeau (Le Devoir, 17/12/2004).
Ensuite, dans 21.9 % des cas, la couverture donnée privilégie les éléments de suspense. Il s'agit
concrètement de 21 articles sur 96. À l'aide de cette stratégie, le lecteur reste avide de connaître
la suite des événements, les groupes annoncent leurs actions et interventions comme les
épisodes d'une longue série de protestations. Il semble que les journaux apprécient cette façon
de construire l'actualité. En voici deux illustrations :
" On est au milieu d'un débat et on a un parti démocratique qui n'a pas peur de débattre, a indiqué M. Reid. La décision va se prendre en temps et lieu. " (Le Soleil, 23/11/2004).
"Cette manifestation n'est pas le point final de notre action", a prévenu Julie Bouchard, présidente de la Fédération étudiante collégiale, depuis Montréal, où 10 000 personnes se sont massées devant le bureau de Jean Charest. [...] La suite des choses est pour bientôt (Le Soleil : 11/11/2004).
94
En troisième position, on trouve les éléments de conflit. En effet 14.9% des articles soulignent
les relations conflictuelles entre les acteurs ; que ce soit entre les groupes de pression et le
gouvernement, les groupes et les forces de l'ordre, ou encore les conflits entre groupes
étudiants.
Par ailleurs, les éléments de dramatisation et de sensationnalisme sont présents dans à peine
10,4 % de l'échantillon. Dans ces articles, les auteurs ont tenté d'illustrer les conséquences de
ce problème public avec un registre émotionnel en évoquant des cas concrets et les
répercussions humaines et sociales de la décision gouvernementale sur les étudiants québécois.
Cependant ce pourcentage demeure faible et prouve que cette stratégie de médiatisation, prisée
dans le traitement d'autres facettes de la vie sociale, semble moins répandue pour la couverture
des politiques publiques.
Les actions originales et insolites ne sont présentes que dans 8.3% des articles, suivis des
éléments de choc et de scandale avec un pourcentage correspondant à seulement 2.1%.
Nous concluons donc que les journaux s'intéressent, en premier lieu, aux actions qui favorisent
le spectacle. Ces événements sont ceux qui mobilisent un grand nombre de personnes,
envahissent les lieux publics et interrompent le cours habituel de la vie des citoyens. Ils portent
avant tout un message visuel, scénique et spectaculaire à travers l'usage de banderoles,
mascottes, déguisement et autres gadgets.
La tendance des journaux à rapporter les interventions qui installent le suspense peut être
expliquée par plusieurs facteurs. L'effet de suspense ne pourrait qu'alimenter la popularité de
l'affaire publique et de ses acteurs. Le public est tenu en haleine, il serait de plus en plus
intéressé par l'avancement des événements et curieux de connaître le dénouement de la crise.
De cette façon, les médias gagneraient en construisant un potentiel de lecteurs qui
demanderaient à être servis en informations pour assouvir leur curiosité.
b) Orientation de la couverture
Cet axe d'analyse est attaché à notre deuxième hypothèse qui postule que la couverture
médiatique des mouvements sociaux est orientée par les stratégies de mise en scène de leurs
actions et leurs discours. En testant la corrélation entre plusieurs de nos variables, nous avons
tenté de cerner les critères qui influencent l'orientation de la couverture.
95
Le tableau ci-dessous indique que la couverture de l'affaire des bourses et prêts était
majoritairement favorable dans les trois journaux de l'échantillon : 56.3% des articles. Elle
était neutre dans 22.9% des cas et complètement défavorable dans 20.8 % des articles.
l-'réquence Pourcentages défavorable 20 / 20,8
neutre 22 / 22,9 favorable 54 1 56,3
Total 96 \ 100,0 Orientation de la couverture médiatique
En croisant l'orientation de la couverture avec le titre du quotidien où est apparu l'article, nous
découvrons que la plupart des papiers défavorables (13 /20) sont apparus au journal La Presse.
Pour le cas des articles neutres et favorables, nous constatons qu'ils sont quasi-
proportionnellement distribués entre les trois journaux, avec une légère majorité d'articles
favorables dans Le Soleil et une similitude d'articles neutres au Soleil et au Devoir.
Nature de la eouverture
Total
défavorable neuter ^__-iiworable
Le nom du journal
Le Soleil 4 A 19 \ 3 1
La Presse 13 I 6 17 \ 36
Le Devoir 3 1 8 17 1 28
Total 20 \ 22 53 / 9 5
Tableau croisé : Nature de la couverture en fonction du nom du journal
Le tableau suivant nous indique si l'orientation de la couverture dépend de la source de l'article.
Il apparaît que lorsque l'article est stimulé par le commentaire d'un citoyen, la couverture est
dans la plupart des cas favorable: sur 25 articles issus d'un commentaire d'un citoyen, 17
articles projettent une opinion favorable sur les groupes étudiants et soutiennent leur cause. De
même, lorsqu'il s'agit d'une entrevue avec un membre d'un groupe étudiant, la couverture a été,
5 fois sur 7, favorable.
96
Ainsi nous concluons que la tendance positive de la couverture médiatique se maintient pour
les différentes catégories de la source sauf lorsque l'article est stimulé par une conférence de
presse, ici la couverture est neutre dans la majorité des cas.
défavorable neutre Favorable Total Source de
l'article Communiqué 1 1
Entrevue <CZ 1 1 5 _ _ - = > couverture
d'un événement
6 17 25 48
Commentaire d'un citoyen
Commentaire d'un citoyen <rrnZL s 17
opinion du journaliste
4 1 ^ J 8
Conférence de presse
1 3 2 6
Total 20 22 53 95 Tableau croisé : Nature de la couverture en fonction de l'initiative de l'article
Nous avons également cherché à cerner la corrélation entre l'orientation de la couverture et
l'auteur de l'article. En croisant ces deux variables, nous avons trouvé que les journalistes
étaient dans la plupart des cas favorables aux revendications des étudiants (37 articles), ils
étaient dans 22 articles neutres et dans I I autres hostiles vis à vis de la cause étudiante. Dans
les forums des citoyens, 15 articles sur 23 soutiennent les étudiants. Nous concluons alors que
la tendance à appuyer la cause étudiante est conservée pour les différentes catégories d'auteurs.
défavorable Neuter favorable Auteur de
l'article Journaliste II 22 37 70
Une personne affiliée à un
groupe
1 2 i
Un lecteur citoyen
8 15 23
Total 20 22 54 96 Tableau croisé : Orientation de la couverture en fonction de l'auteur de l'article
En posant le titre du journal comme variable de contrôle, nous constatons que la variation de la
couverture en fonction de l'auteur se distribue presque de la même façon dans les trois
journaux. Les trois catégories d'auteurs ont été majoritairement favorables aux revendications
dans les trois journaux. La seule exception est marquée par La Presse puisque les articles signés
par les lecteurs citoyens étaient, en majeure partie, contre la position des groupes étudiants.
97
Auteur de l'article
l'otal
Le nom du journal
Journaliste Une personne affiliée à un
groupe
Un lecteur citoyen
Le soleil Nature de la couverture
défavorable •4 1
neutre 8 8 favorable 15 1 3 19
Total 27 1 3 31 La Presse Nature de la
couverture défavorable 4 1 8 13
neutre 6 6 favorable 9 1 7 17
Total 19 2 15 36 Le Devoir Nature de la
couverture Défavorable 3 3
Ncuter S 8 favorable 12 5 17
Total 23 5 28 Tableau croisé: Auteur de l'article / Nature de la couverture / Le nom du journal
* Orientation de la couverture en fonction du ton adopté par les groupes de pression : Certes,
que ce soit sous forme d'actions ou de déclarations, toutes les interventions des groupes
étudiants transmettent des messages et contribuent à en construire une image. Nous allons
savoir si la couverture des journaux a été influencée par le ton des déclarations des différents
groupes et leurs leaders. Tout d'abord, comment a t-on représenté les groupes de pression dans
notre échantillon d'articles? L'enquête révèle que dans 27.1% des articles, on a présenté les
groupes de pression comme étant déterminés à poursuivre la lutte, ils sont persévérants malgré
la fermeté du discours gouvernemental.
FORCE-Québec, la FEUQ et la FECQ invitent les jeunes à reprendre leurs pancartes et leurs slogans sans pitié le 20 novembre à Montréal, lors du congrès annuel du Parti libéral » (Le Soleil, 11/11/2004).
«On ne lâchera pas ce morceau», explique le président de la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ), Pier-André Bouchard. «On va régler cela avec des moyens de pression et monter le ton. Nos actions seront de plus en plus soutenues et viseront le gouvernement.» (Le Devoir, 17/12/2004.)
Les journaux reprennent souvent mot à mot les propos des leaders, ils insistent sur les passages
qui dénotent de leur courage, leur force et leur détermination à atteindre leur objectif.
OS
Dans 26% des cas, les articles reprennent les passages où les leaders présentent leurs arguments,
discutent, expliquent les enjeux de la décision gouvernementale, ils sont montrés comme des
experts dans le dossier et maîtrisent parfaitement ses détails. Ci-dessous un exemple de citation
rerpise dans un article du journal Le Soleil.
Si l'intention de réinvestir dans le système est intéressante, la FLUQ juge "franchement ridicule" de parler d'une révision globale du programme. "Cette révision a été faite lors de la première session parlementaire du PLQ au pouvoir par le projet de loi 19, affirme M. Bouchard. Cette révision, c'est changer quatre 30 sous pour une piasse." (Le Soleil 21/11/2004)
De plus, l'analyse statistique montre que dans la plupart des cas où les groupes adoptent un ton
de détermination et de persévérance, ils obtiennent une couverture favorable.
détermination et persévérance
Total
non indiquée indiqué Nature de la
couverture défavorable 19 1 20
neutre 15 7 22 favorable 36 18 54
Total 70 26 96
Tableau croisé: Nature de la couverture/ Ton de détermination et de persévérance
Comme l'indique le tableau ci-dessous, le résultat est toujours favorable lorsque les groupes se
présentent comme des experts et manifestent leur maîtrise du dossier. De même pour le ton de
colère, la couverture est favorable lorsqu'il est plutôt absent.
Nature de la couverture
Total
Défavorable neutre favorable maîtrise et
expertise non indiquée 19 15 37 71
% Nature de la couverture
95,0% 68,2% 68,5% 74,0%
1,00 indiqué Count 1 7 17 25 % Nature de la couverture
5,0% 31,8% 31,5% 26,0%
Total 20 22 54 96 % Nature de la couverture
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Tableau croisé: Nature de la couverture/ Ton d'expertise
99
Pour ce qui est du ton ironique, nous avons constaté que la relation d'association est négative
entre cette variable et la nature de la couverture. Cette situation signifie que dans la majorité
des cas où ce ton est absent, le groupe obtient une couverture positive.
Nature de la couverture
Total
défavorable neutre favorable insulte et
ironie non indiquée 20 22 51 93
Nature de la couverture
100,0% 100,0% 94,4% 96,9%
Indiqué 3 3 Nature de la
couverture 5,6% 3,1%
Total 20 22 VI 96 Nature de la
couverture 100,0% 100,0% 100.0% 100,0%
Tableau croisé: Nature de la couverture / Ton ironique
Nous arrivons maintenant à l'hypothèse de savoir si la couverture journalistique des groupes de
pression dépend des caractéristiques de la mise en scène de leurs actions. Après avoir croisé la
variable nature de la couverture avec chaque stratégie de médiatisation, nous avons obtenu les
résultats suivants.
Sur 34 articles comportant des éléments de spectacle, 22 articles ont donné une opinion
positive de la cause étudiante. De même, la couverture était favorable dans 12 sur 21 articles
contenant des éléments de suspense. Pour les articles qui ont traité l'affaire avec
sensationnalisme, 9 articles sur 10 donnent une impression positive sur la position des groupes
de pression étudiants. Dans le cas des articles qui ont souligné l'existence de relations
conflictuelles entre les acteurs de cette politique publique, l'orientation de la couverture
demeure assez partagée. Pour un total de 14 articles, 6 présentent un jugement favorable et 5
sont neutres vis-à-vis de la position des groupes, ils se contentent d'annoncer les faits sans les
juger.
Pour ce qui est des articles privilégiant le scandale et les faits insolites, la recherche montre
qu'il existe, là aussi, une corrélation négative entre chacune de ces variables et la couverture
donnée par les journaux. Les tableaux statistiques nous révèlent que l'opinion est favorable
notamment lorsque ces deux catégories sont absentes de l'article.
100
* Tableaux indicatifs de l'orientation de la couverture en fonction des stratégies de mise en scène médiatique
Tableau croisé: Spectacle / Nature de la couverture
Nature de la couverture
Total
défavorable neutre favorable
Spectacle non 15 15 32 62
oui 5 7 22 34
Total 20 22 54 96
Tableau croisé : Suspense / Nature de la couverture
Nature de la couverture
Total
défavorable neutre favorable
Suspense non 19 14 42 75
oui 1 8 12 21
Total 20 22 54 96
- Tableau croisé : Sensationnalisme / Nature de la couverture
Nature de la couverture
Total
défavorable neutre favorable Sensationnalisme non 20 21 45 86
oui 1 9 10 Total 20 22 54 96
- Tableau croisé: Conflit / Nature de la couverture
Nature de la couverture
Total
défavorable neutre favorable Conflit non 16 17 48 Kl
oui 3 5 6 II Total 19 22 54 95
- Tableau croisé : Insolite / Nature de la couverture
Nature de la couverture
Total
défavorable neutre favorable Insolite non 19 18 51 88
oui 1 4 3 8 Total 20 22 54 96
1(11
Tableau croisé : Scandale / Nature de la couverture
Nature de la couverture
'Total
défavorable neutre favorable Scandale ou
choc non 20 20 54 94
1,00 oui 2 2 Total 20 '?.?. 54 96
c) La distribution de la parole dans les journaux
Le tableau suivant indique l'identité des personnes qui ont signé les articles publiés dans les
trois journaux en question et qui ont traité de l'affaire des prêts et bourses d'études. Nous
relevons que 72.9 % des papiers sont signés par des journalistes. Toutefois, il est important de
souligner que les trois journaux confondus ont donné l'opportunité aux citoyens de s'exprimer
dans leurs pages : 24% des articles étaient alors signés par des lecteurs.
Fréquence Pourcentage Journaliste 70 72,9
Une personne affiliée à un
groupe
3 3,1
Un lecteur citoyen
23 24,0
Total 96 100,0 Tableau univarié : Auteur de l'article
Par ailleurs, dans l'ensemble de l'échantillon, trois articles étaient écrits par des membres ou
des dirigeants des groupes de pression étudiants. Le journal La Presse était celui qui a donné le
plus d'espace aux lecteurs citoyens et qui a publié 2 sur les 3 articles signés par les groupes
étudiants. Le troisième article était publié dans Le Soleil. Nous en concluons que La Presse est
le journal qui été le plus soucieux de donner la parole à d'autres acteurs touchés par le dossier.
Le tableau ci-dessous prouve de même que La Presse était le journal qui a publié le plus grand
nombre de papiers défavorables aux revendications des étudiants. Sur un total de 20 articles
défavorables, La Presse en a publié 13. Il paraît que le journal s'est non seulement soucié de
varier les auteurs des articles mais aussi les points de vue.
102
Nature de la couverture
Total
défavorable neutre favorable Le nom du
journal Le Soleil 4 8 19 31
La Presse 13 6 17 36 Le Devoir 3 8 17 28
Total 20 22 53 95 Tableau croisé: Titre du journal / Nature de la couverture
D'ailleurs, pour la couverture de cette politique publique, le journal La Presse a privilégié
l'opinion ; il a publié plus d'articles d'opinion que d'articles de type infirmatif. En revanche,
Le Soleil était le quotidien qui a publié le plus grand nombre d'articles d'information.
Type de l'article Total 1,00 Informtif 2,00 opinion
1 ,e nom du journal
1,00 Le Soleil 22 9 il
2,00 La Presse 17 19 36 3,00 Le Devoir 19 9 28
Total 58 37 95 Tableau croisé : Le nom du journal /Type de l'article
En résumé, l'étude statistique a démontré que le pseudo-événement est l'activité des groupes
étudiants la plus présente dans la couverture médiatique de la politique publique des prêts et
bourses. Le spectacle apparaît comme le principal critère permettant aux actions promues par
les groupes de pression de franchir les médias de masse. Dans la plupart des cas, la couverture
a été en faveur de la cause étudiante.
Nous allons compléter notre démarche avec des entretiens semi-dirigés avec les leaders des
groupes de pression. Nous abordons dans ce qui suit le déroulement et les résultats des
entrevues.
103
4- Entretiens semi-dirigés : échantillonnage
Nous avons envisagé de mener des entretiens semi-dirigés avec les leaders des trois groupes de
pression suivants :
- La Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ), principal coordinateur du
mouvement protestataire ;
- La Fédération étudiante collégiale de Québec (FECQ) ;
- L'Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ).
Ces groupes étudiants sont les protagonistes de l'affaire des bourses et prêts. Ils ont occupé la
scène médiatique pour les nombreuses actions qu'ils ont organisées.
Les leaders de ces groupes vont nous expliquer comment ils ont organisé leurs interventions et
comment ils se sont pris avec les journalistes pour faire l'objet de leurs papiers à maintes
reprises. Nous allons savoir de même si ces groupes estiment avoir atteint leurs objectifs en
matière de visibilité médiatique et s'ils ont réussis par la même occasion à passer le bon
message à travers les médias.
Les entretiens tournent autour de trois thèmes principaux : la planification des actions des
groupes, leur accès aux médias et leurs tentatives d'orienter le discours des journalistes.
Le guide des questions se trouve en annexe 4 et le texte du courriel qui a servi au recrutement
des participants se trouve en annexe 5. Quant au formulaire de consentement, il se trouve en
annexe 6.
5- Entretiens semi-dirigés : traitement des données et interprétation des résultats
Il est à préciser que nous avons eu quelques difficultés à rejoindre les membres des trois
groupes étudiants, d'autant plus que nous avons entrepris cette enquête au mois de juillet 2007,
pendant que plusieurs personnes étaient en vacances. Nous nous sommes entretenue avec le
président de FASSE, le vice-président et l'attaché politique de la FEUQ de l'année
universitaire 2004-2005. Mais nous n'avons pu recueillir le témoignage d'un leader de la
FECQ.
104
Après trois conversations téléphoniques qui ont duré à peu près 45 minutes avec le représentant
de PASSÉ et 30 minutes avec les représentants de la FEUQ, nous avons eu une idée claire des
démarches des deux groupes de pression et des stratégies de contestation qu'ils ont adoptées.
L'ex-président de l'association nous a expliqué que PASSÉE compte beaucoup sur l'action
collective et le principe d'installer un rapport de force avec le gouvernement avant d'entrer en
négociation avec lui. Ce rapport de force se manifeste par la fédération et la mobilisation des
membres de l'association et de toute la population étudiante autour de la cause défendue, ainsi
que par la sensibilisation de la population d'une façon générale. L'association envisage que
l'appui de l'opinion publique est la principale arme de pression susceptible de pousser le
gouvernement à revenir sur ses décisions. Pour ce qui est de la FEUQ, l'un des répondants a
souligné que le recours aux médias visait essentiellement à rejoindre la population et gagner
leur adhésion aux revendications des étudiants. Dans les premières phases de l'affaire, l'enjeu
principal était de pouvoir fédérer les gens et augmenter la légitimité et la popularité de la cause.
Le répondant de PASSÉ précise que son association ne peut pas passer outre les médias pour
atteindre ses objectifs. Les médias de masse constituent un relais qui lui permet d'atteindre ses
cibles primaires. Le représentant de la FEUQ ajoute que les médias leur permettent de toucher
à la foi les étudiants, les décideurs publics et la population.
Interrogé sur la constitution de coalitions entre les groupes étudiants, un des répondants de la
FEUQ a déclaré que son association a été, dès le déclenchement de l'affaire, consciente de
l'importance stratégique du rapprochement entre les groupes étudiants et l'organisation
collective des actions de protestation pour transmettre un message unifié qui puisse avoir plus
d'impact auprès des décideurs publics. Il ajoute que la FEUQ prenait l'initiative de contacter
les autres groupes, indépendamment de leur orientation, et les invitait à prendre part à leurs
meetings. Mais il reproche aux autres associations de pas avoir réagit de façon réciproque à
plusieurs reprises.
L'ASSÉ était le principal coordinateur de la grève générale illimitée. Son représentant déclare
qu'ils avaient voulu éviter cette action, mais la fermeté de la position gouvernementale les a
conduit à y recourir et à paralyser le système éducatif pendant plus de cinq semaines. Selon
cette organisation, la contestation doit se baser sur une escalade des moyens de pression.
105
Pour ce qui est de cette affaire, c'est la rigidité du gouvernement Charest qui les a poussé à
appeler les étudiants à une grève générale.
Pendant la mobilisation pour l'affaire des bourses et prêts, PASSÉ avait une cellule consacrée
aux relations avec les médias. Elle se chargeait d'informer les journalistes des actions à venir et
de communiquer leurs arguments et leur point de vue. Le représentant de cette association
déclare avoir privilégié le contact direct avec les journalistes. Quant aux représentants de la
FEUQ, ils nous informent que c'est leur attaché de presse qui assumait la gestion des rapports
avec les médias. Des communiqués étaient envoyés quotidiennement aux différents organes de
presse pour annoncer leurs activités futures, expliquer leurs motivations et étaler leurs
arguments. Souvent, des informations exclusives sont données, en alternance, à un média ou à
un journaliste en particulier afin de gagner leur sympathie. En pensant ses actions de
protestation, la PEUQ a toujours veillé à ce que ses activités puissent faire la nouvelle dans les
journaux du lendemain, déclare l'un des répondants. Tout au long de l'affaire, l'équipe essayait
de proposer aux journalistes un nouvel angle pour aborder le débat sur les prêts et bourses
d'études. De plus, la FEUQ misait beaucoup sur l'aspect visuel de ses activités afin d'être
repris par la télévision.
E'ASSÉ était surtout soucieuse de transmettre un message intelligible, réaliste et rationnel et de
veiller à ce qu'il ne soit pas altéré ou mal interprété. Pour les deux organisations, malgré les
efforts de planification, les actions de communication menées étaient souvent le fruit de
l'ébullition des événements de l'époque.
Pour ce qui est de leurs relations avec les journalistes, nous avons appris qu'avant la grève les
membres de l'association s'adressaient quotidiennement aux journalistes pour communiquer
leurs messages et tenter d'avoir une couverture de leurs activités. Avec le déclenchement de la
grève, la donne a changé. Ce sont les journalistes qui prenaient l'initiative de les contacter et
qui s'intéressaient de plus en plus à ce qu'ils faisaient. L'événement était d'une telle envergure
que les médias et leurs publics étaient en attente d'information. Un participant de la FEUQ
affirme que « la dynamique a changé avec la grève, les médias couraient derrière l'information,
plus besoin d'envoyer nos communiqués, ce sont les journalistes qui appellent pour solliciter
des entrevues ».
106
Cette mobilisation de masse qui a traversé la population étudiante est l'une des plus
importantes dans l'histoire du Québec de par le nombre de participants à la grève et la durée de
la suspension des cours. Ce bouleversement dans le système éducatif ne pouvait passer
inaperçu. Son caractère spectaculaire l'a imposé comme un thème prioritaire dans l'agenda des
médias québécois.
Avec le recul, nos répondant attestent que les médias ont considérablement servi leur cause
parce qu'ils lui ont permis de rejoindre leurs membres, informer et conscientiser l'opinion
publique des enjeux de la coupe dans le programme des bourses et prêts et surtout de lancer un
débat public autour de la question du financement des études au Québec.
Les répondants de la FEUQ estiment que la couverture médiatique de l'affaire a été de façon
globale favorable à leurs objectifs, et qu'ils ont réussi à contrôler les messages qui étaient
publiés à leur sujet. Cependant, le participant de la l'ASSÉÉ rapporte que certains médias, qu'il
décrit de tendance droite, ont fait des tentatives pour nuire à l'ASSÉ. Il estime que ces médias
ont fait une mauvaise lecture de leur argumentaire et l'ont dénigré. Il nous a parlé également
d'un journaliste du journal Le Devoir qui a attribué une déclaration à un membre de l'ASSÉ,
alors que celle-ci venait d'un citoyen rapproché de l'organisation mais qui s'est exprimé de sa
propre voix sur un forum Internet. Notre répondant ajoute que ce geste dénote un manque de
professionnalisme puisque le journaliste n'a pas pris la peine de vérifier la crédibilité de la
source.
L'exemple de la couverture médiatique de la grève coordonnée par la PASSÉ confirme l'attrait
des médias pour les actions spectaculaires et les pseudo-événements. Nous en tirons aussi qu'il
suffit que les groupes de pression essayent d'encadrer cette couverture et la contrôler pour
bénéficier d'un jugement favorable de la part des journalistes. La situation nous confirme, de
même, que les appartenances idéologiques et les impératifs de l'audience conditionnent
largement les priorités des médias et leurs discours.
Si nous mettons en perspectives les données recueillies par les entretiens et celles issues de
l'analyse de contenu des journaux, nous pouvons prendre connaissance d'éléments pertinents.
107
D'après les déclarations du représentant de l'ASSÉ, son groupe n'a pas entretenu de relation
spéciale avec un journal en particulier. Leurs messages s'adressaient à l'ensemble des médias
québécois. Ce qui n'apporte pas d'éléments explicatifs au fait que l'activité de L'ASSÉ a été
reprise massivement dans le journal Le Devoir31.
Malgré le désagrément de la fausse déclaration qu'a eu ce groupe avec Le Devoir, les
statistiques montrent que ce journal a produit des articles qui étaient majoritairement favorables
à la position des groupes de pression et celle de l'ASSÉ en particulier.
En confrontant les données issues des deux outils d'investigation, nous déduisons, de même,
que l'ASSÉ a adopté une bonne démarche en veillant à établir un rapport de force avec les
médias étant donné qu'il est apparu, à travers les statistiques, que l'attitude confiante et
déterminée des groupes et leurs leaders permet de leur conférer une image positive dans les
médias et de renforcer leur chance d'obtenir une couverture favorable par les journalistes.
Par ailleurs, cette recherche nous a appris essentiellement que les pseudo-événements organisés
par la FEUQ et par l'ASSÉ étaient les actions de protestation les plus reprises dans les journaux.
D'autre part, les propos de nos répondants confirment que les groupes de pression québécois
privilégient ces actions spectaculaires parce qu'ils sont conscients qu'ils constituent un moyen
efficace pour attirer les médias et atteindre leurs publics. Ceci nous révèle qu'il existe une
réelle concordance entre le fonctionnement des médias et l'orientation des techniques de
relations publiques mises en œuvre par les groupes de pression.
31 Voir page 92
108
CONCLUSION GÉNÉRALE
Notre recherche a focalisé sur la question de l'accès aux médias des groupes de pression et la
couverture médiatique de leurs interventions sur les politiques publiques. L'étude que nous
avons menée a tenté de cerner les stratégies déployées par les groupes étudiants pour s'adapter
aux exigences de l'activité journalistique.
Nous reconnaissons que notre travail n'a pas suffisamment étudié la corrélation entre le rôle
joué par les médias et l'issue du conflit entre les groupes étudiants et le gouvernement. En ce
qui concerne la méthodologie, nous relevons également l'absence d'une analyse de contenu
qualitative qui aurait été tout aussi bénéfique pour notre travail, notamment pour étudier la
couverture médiatique des groupes de pression.
Néanmoins, nous avons démontré que le pseudo-événement constitue l'activité des groupes
étudiants la plus citée par les médias, dans la foulée des événements de contestation de la
politique publique des prêts et bourses. Cette stratégie de communication est celle qui garantit
au groupe prometteur une accessibilité quasi-automatique à l'actualité telle qu'elle est définie
par les médias. À cet égard, Charron (1991) précise que le pseudo-événement ne devient
nouvelle que s'il s'appuie sur des dimensions spécifiques de la conception de la nouvelle,
comme le spectacle, le conflit, l'incongru, etc. Notre étude a révélé que le spectacle est le
principal critère qui a permis aux actions promues par les groupes étudiants de franchir les
médias de masse. Le pseudo-événement est, par définition, un événement conçu à l'intention
des médias. Il est riche en éléments de spectacle et répond parfaitement aux critères de
sélection de la nouvelle journalistique.
Contrairement à l'idée récurrente chez plusieurs auteurs, dont Charron, qui estiment que les
médias ont plutôt tendance à ne couvrir que le spectacle de la contestation plutôt que son objet,
le cas étudié prouve que les pseudo-événements à caractère spectaculaire obtiennent une
couverture médiatique qui appuie la cause des groupes étudiants et leur permet de transmettre
leurs messages au public. La couverture médiatique de l'affaire des prêts et bourses a tenu
compte des dimensions scenique et symbolique des pseudo-événements dans la mesure où
l'attention des médias n'a pas été portée uniquement sur la forme de la contestation, mais elle
est allée plus en profondeur pour tenter de comprendre et analyser la situation problématique.
109
Cette stratégie n'empêche pas les groupes de pression de garder le contrôle sur les messages
qu'ils émettent, au contraire, dans le cas étudié, le pseudo-événement a provoqué une
couverture médiatique favorable aux objectifs de ses organisateurs.
Il en ressort donc que l'organisation de pseudo-événement à caractère spectaculaire est
parfaitement compatible avec l'activité de contestation qui est perçue par Lipsky (1981)
comme « un mode d'action politique, s'opposant à une ou plusieurs politiques, caractérisé par
une mise en scène et des manifestations non conventionnelles, et entrepris pour obtenir des
réponses de la part des systèmes politique et économique » (Charron, 1991).
Contrairement à l'idée de Charron (1986) de considérer cette stratégie comme un remède au
problème d'accès aux médias, particulièrement adapté aux groupes politiquement et
économiquement faible, le pseudo-événement semble être un moyen apprécié même par les
groupes ayant déjà d'importantes ressources politiques et une assez forte notoriété. Les groupes
étudiants qui ont fait l'objet de notre étude à savoir la FHUQ, la FECQ et l'ASSÉ sont des
organismes qui possèdent une grande expérience en matière de protestation puisqu'ils ont
participé à nombreux débats publics et ont mené plusieurs batailles contre le gouvernement, ils
en ont souvent obtenu gain de cause.
Le pseudo-événement qui provoque presque inévitablement une couverture de presse, se
présente ici comme le moyen évident pour les groupes de pression d'agir vite et efficacement
sur l'opinion publique et faire évoluer la décision gouvernementale. Avant d'aboutir à une
entente avec le gouvernement Charest, les groupes ont dû exhiber toutes leurs ressources
communicationnelles et ont dû utiliser plusieurs moyens de pression. Les négociations ont duré
une année complète. Les groupes étudiants avaient besoin d'agir avec efficacité face à la
fermeté du gouvernement Charest. Ils avaient besoin d'utiliser les grands moyens pour garantir
les résultats. Rien de plus approprié dans ces conditions que de recourir aux activités les plus
spectaculaires et les plus accrocheuses pour les médias et leur public.
Cependant, le fait que les groupes auxquels nous nous sommes intéressée soient politiquement
et socialement reconnus dans l'espace public québécois, et par conséquent constituent une
source crédible aux yeux des journalistes, nous amène à nous interroger sur l'influence qu'ils
pourraient avoir sur les médias et leur potentiel à orienter la couverture que leur accordent les
journalistes.
110
Ceci nous ramène à l'hypothèse de Charron (1991) qui semble être toujours valable; le
pseudo-événement permet, certes, de faciliter l'accès aux médias quelles que soient les
ressources et le poids des groupes de pression, mais sa capacité à orienter la couverture de la
presse et à contrôler les messages diffusés demeurerait tributaire de ces facteurs et de la
perception des groupes aux yeux des journalistes.
La recherche menée ne peut nous éclairer davantage sur ce point. D'autres études sur la
rhétorique et le discours médiatique développés par les différentes catégories de groupes de
pression pourraient révéler les véritables facteurs qui conditionnent la couverture médiatique
des mouvements sociaux.
Dans la couverture de l'affaire des prêts et bourses d'études, la presse a favorisé les trois
grands groupes étudiants, en dépit de l'existence d'autres associations locales qui se sont
mobilisées, que ce soit pour contester la décision gouvernementale ou pour la soutenir. Il
apparaît que ces trois pivots de la contestation estudiantine ont monopolisé l'attention des
médias par la nature des activités qu'ils ont organisées, leur habileté à s'adapter aux exigences
de la nouvelle au sens journalistique du terme et en toute évidence, l'abondance de leurs
ressources financières, sans lesquels ils n'auraient la possibilité d'intervenir.
Ainsi, les entreprises de presse privilégient des sources d'information plus que d'autres et
nuisent, par conséquent, à la vertu de l'expression plurielle des opinions. À vrai dire, dans la
presse écrite, des rubriques comme le courrier des citoyens permettent de combler, au moins
partiellement, cette faille dans la mesure où on permet à des citoyens ayant des convictions
différentes d'intervenir dans les débats publics.
Toutefois, il serait légitime de conclure que le mode de fonctionnement des médias
s'opposerait à leur mission démocratique qui consiste à offrir un espace de dialogue entre tous
les points de vue et à garantir aux citoyens la possibilité de recevoir, produire et émettre une
information plurielle.
III
BIBLIOGRAPHIE
AXFORD, Barrie et Richard HUGGINS (2001), New Media and Politics, Londres: SAGE Publications, 229 p.
BAKER, Edwin (2002), Media, Markets and Democracy, Cambridge: Cambridge Press University, 377 p.
BÉLANGER André et Vincent LEMIEUX (1996), Introduction à l'analyse politique, Montréal : Presse de l'Université de Montréal, 326 p.
BERNIER, Marc- François, François DEMERS, Alain LAVIGNE, Charles MOUMOUNI, et Thierry WATINE (2005), Pratiques novatrices en communication publique : journalisme, relations publiques et publicité, Québec : Presses de l'Université Laval, 176 p.
BOULANGER, Dominique (1999), «Coalition de groupes de pression: Le projet Grande-Balaine, 1988-1994», Thèse de doctorat présentée à la Faculté des études supérieures de l'Université Laval, 514 p.
BRECHON, Pierre (2000), La gouvernance de l'opinion publique, Paris : L'Harmattan, 200 p.
BRETON, Philippe et Serge PROULX (1994), L'explosion de la communication, Montréal : Boréal, 333 p.
BRIN, Colette (2003), « L'organisation médiatique et le changement des pratiques journalistiques: Adaptation, innovation et réforme», in l a science politique au Québec, le dernier des maîtres fondateurs : Hommage à Vincent Lemieux, Québec : Les presses de l'Université Laval, pp 417-431.
BUSSMAN, Werner, Peter KNOEPFEL et Ulrich KIÔT1 (1998), Politiques publiques: Évaluation, Paris : Economica, 327 p.
CAYROL, Roland (1997), Médias et démocratie : La dérive, Paris : Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 115 p.
CI IABAUD, Pascal (2002), Médias, pouvoirs et société, Paris : Ellipses, 96 p.
CHARRON Jean (1986), Le pseudo-événement de contestation comme stratégie d'accès aux médias : une étude de cas, mémoire de maîtrise présenté au département d'information et de communication de l'Université Laval, 115 p.
CHARRON, Jean (1991), «Les pseudo-événements de contestation: le cas du groupement autonome des jeunes (RAJ) », in Jean CHARRON, Jacques LEMIEUX et Florian Sauvageau, Les journalistes, les médias et leurs sources, Boucherville : Gaétan Morin, pp. 102-133.
112
CHARRON, Jean (1995), « [.es médias et les sources : Les limites du modèle de l'agenda-setting », Paris : Hermès 17-18, pp. 73-92.
CHARTIER, Lise (2003), Mesurer l'insaisissable : Méthode d'analyse du discours de presse, Québec : Presses de l'Université du Québec, 263 p.
CHOMSKY, Noam et Robert McCHESNEY (2000), Propagande, médias et société, Montréal : Les éditions Écosociété, 202 p.
CLAMEN, Michel (2000), Le lohbying et ses secrets; Guide des techniques d'influence, Paris : Dunod, 277 p.
COOK, Constance Ewing (1998), Lobbying for Higher Education: How Collèges and Universities Influence Fédéral Policy, Nashville : Vanderbilt University Press, 248 p.
DAHLGREN, Peter (1994), « L'espace public et les médias », Espace public en images, Paris : Hermès 13-14, pp 243-258.
DE BON VILLE, John (2006), L'analyse de contenu : de la problématique au traitement statistique, Québec : De boeck, 45 1 p.
DELACROIX, Xavier (sous la direction de) (2004), Influencer la démocratie, démocratiser l'influence. Enjeux et perspectives d'un lohbyisme démythifié, Paris : Association Française des conseils en affaires publiques, 239 p.
DELFORCE, Bernard et Jacques NOYER (1999), sous la direction de, «La médiatisation des problèmes publics», Etudes de communication n° 22, Lille : Université Charles de Gaulle -Lille 3, 158 p.
DEMERS, François (2000), « Qu'arrive t-il à la politique ? » in Rémy RIEFFEL et Thierry WATINE, Les mutations du journalisme en France et au Québec, Paris: Edition Panthéon-Assas, pp 235-250.
DEMERS, François (2003), « Fenêtre d'opportunité et émergence de propriété politiques : Le cas du glissement de la recherche des effets des médias vers l'étude de la réception », in Jean CRETE (sous la direction de), La science politique au Québec, le dernier des maîtres fondateurs : Hommage à Vincent Lemieux, Québec : Les Presses de l'Université Laval, pp 432-452.
DESLAURIERS, Jean Pierre (1991) Recherches qualitatives : guide pratique, Montréal : McGraw-Hill, 142 p.
DE VIRIEU, François-Henri (1990), La médiacratie, Paris : Flammarion, 292 p.
DYE, Thomas (2005), Understandingpublic policy, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 356 p.
113
ESQUENAZI, Jean Pierre (2002), L'écriture de l'actualité ; Pour une sociologie du discours médiatique, Grenoble : Presses Universitaire de Grenoble, 183 p.
FALISE, Michel (2003), La démocratie participative : Promesses et ambiguïtés, Paris,
Editions de l'Aube, 199 p.
l'RASER Nancy (1992), « Repenser la sphère publique : une contribution à la critique de la démocratie telle qu'elle existe réellement», in Habermas and the public sphère, l'opinion publique ; perspectives anglo-saxonnes, Hermès numéro 31, pp 125-156.
GABSZEWICZ, Jean et Nathalie SONNAC (2006), L'industrie des médias, Paris: Ea Découverte, 121 p.
GAUTHIER, Benoît (sous la direction de) (2003), Recherche sociale : de la problématique à la collecte des données, Québec : Presse de l'Université du Québec, 619 p.
GINGRAS, Anne-Marie (2006), Médias et démocratie; le grand malentendu, Québec : Presses de l'Université du Québec, 287 p.
GRABER, Doris, Denis McQUAIL et Pippa NORRIS (1998), The politics of news, The news of politics, Washington, DC: CQ Press, 268 p.
GROSSMAN, Emiliano et Sabine SAURUGGER (2006), Les groupes d'intérêt; Action collective et stratégie de représentation, Paris : Armand Colin, 251 p.
GRYSPEEDRDT, Alex (2000), « Construire les relations publiques pour les comprendre et les analyser », Sciences de la société n° 50/51, mai/octobre 2000, pp. 261 -276.
GUSSE, Isabelle (2006), sous la direction de, Diversité et indépendance des médias, Montréal: Presses de l'Université de Montréal, 291 p.
HOWEEÏT, Michacl et Margaret M. Hill RAMESH (2003), Studying public policy; Policy cycles and policy subsystems, New York: Oxford University Press, 311p.
JONES, Bryan (sous la direction de) (2005), The politics of attention: how government prioritizes problems, Chicago: University of Chicago Press, 316 p.
JORDAN, Cirant (sous la direction de) (1998), Protest Politics : Cause Groups and Campaigns (Parliamenlary Affairs), vol. 51, n° 3, juillet.
JUHEM, Philippe (1999), « Médias, mouvements sociaux et espace public». Réseaux n" 98, Paris : Hermès Science Publications, pp 20-85.
KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine (2002), L'énonciation : de la subjectivité dans le langage, Paris : Armand Colin, 267p.
KOEEMAN, Ken (1998), Outside lobbying; public opinion &interesl groups slralegy, New Jersey: Princeton University Press, 215 p.
114
LAVIGNE, Alain (2005), « L'omniprésence des relationnistes: des relations de presse stratégiques aux pratiques hors contrôle des journalistes », in Pratiques novatrices en communication publique : journalisme, relations publiques et publicité, (dir) Bernier Marc-François, Québec : Presses de l'Université Laval, pp 103-126.
LEMILUX, Vincent (1991), « Les politiques publiques et l'exercice du pouvoir », Cahier H6-01 du Groupe de recherche sur les interventions gouvernementales, Avril 1991, Québec: Laboratoire d'études politiques et administratives de l'Université Laval, 118 p.
LIPPMAN, Walter (1922), Public opinion, New York, Harcourt Brace.
LEMIEUX, Vincent (2002), L'étude des politiques publiques ; Les acteurs et leur pouvoir, La Québec : Presses de l'Université Laval, 195 p.
LE PICARD, Olivier, Jean-Christophe ADLER et Nicolas BOUVIER (2000), Lobbying : intérêts particuliers-bénéfices collectifs, les règles du jeu, Paris : Editions d'Organisation, 223 P-
LORIOT, Gérard (1998), La démocratie au Québec : Origines, structure et dynamique, Montréal : Décarie Éditeur, 456 p.
L'OBSERVATOIRE DU QUÉBEC, L'urgence d'agir ; la société québécoise en quête de repères, Québec : Presse de l'université du Québec.
MAIGRET, Eric, 2004, Sociologie de la Communication et des Médias, Armand Colin, Paris,
287 p.
MAISONNEUVE, Danielle (2004), Les relations publiques ; le syndrome de la cage de Faraday, Québec : Presses de l'Université du Québec, 311p.
MANIN, Bernard (1996), Principes du gouvernement représentatif, Flammarion, coll.
« Champs »n° 349, 319 p.
MAZEY, Sonia et Jeremy RICHARDSON (1996), « Faire face à l'incertitude ; Stratégies des groupes de pression dans l'union européenne, in «Les groupes d'intérêt» Pouvoirs n° 79, Paris : Seuil, pp 51-67.
MENY, Yves et Jean Claude THOENIG (1989), Politiques publiques, Paris: Presse Universitaire de France, 391 p.
MOSSÉ, Claude (2000), Politiques et société en Grèce ancienne : le « modèle » athénien, Flammarion, coll. « Champs ».
115
MOUMOUNI, Charles (2006), « Le discours normatif des journalistes et les pratiques de publi-rcportage dans les journaux québécois », Les Cahiers du journalisme n" 16, l'Ecole supérieure de journalisme de Lille et le département d'information et de communication (Québec), pp 130-164.
MIEGE, Bernard (1997), La société conquise par la communication tome 2, Presses universitaires de Grenoble, Coll. Communication, Médias et Sociétés, 122 p.
MUCCHIELLI, Alex (1996), Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et
sociales, Paris : Armand Colin, 275 p.
MULLER, Pierre (2006), Les politiques publiques, Paris : Editions Que sais-je ?, 126 p.
NEVEU, Erik (1999), « Médias, mouvements sociaux et espace public», Réseaux n° 98 -Paris : Hermès Science Publications, pp 20-85.
NEVEU, Erik (1999), « L'approche constructiviste des problèmes publiques: Un aperçu des travaux anglo-saxons », Etudes de Communication numéro 22 ; La médiatisation des problèmes publics, Lille : Université Charles de Gaulle Lille 3, pp 74-92
OITERLE, Michel (1994), « Sociologie des groupes d'intérês », Paris : Montchrestien, 149 p.
OLLITRAULT, Sylvie (1999), « De la caméra à la pétition-web : le répertoire médiatique des écologistes », Réseaux n° 98, Paris : Hermès Science Publications, pp 153-185.
PAILLART, Isabelle, dir, ( 1995), L 'espace public et l'emprise de la communication, Grenoble : Ellug Université Stendhal, 205 p.
POULIN, Maxime (2004), Lobbying ; étude de cas en milieu universitaire, Mémoire de maîtrise présenté à la Faculté des Lettres de l'Université Laval, 107 p.
QUIVY, Raymond et Luc Van CAMPENHOUDT (2006), Manuel de recherche en sciences sociales, Paris : Dunond, 256 p.
RICHAN, Willard (1991), Lobbying for Social Change, New York: The Haworth Press, 302 p.
ROMAGNI, Patrick (1993), Le lobbying. Voyage au centre des groupes de pression et des réseaux d'influence, Noisiel : Les Presses du Management, 205 p.
ROY, Simon. N (2003), « I/étude de cas», in Recherche sociale de la problématique à la collecte des données, (dir) Gauthier Benoît, Québec : Presse de l'Université du Québec pp 159-184.
SAVOIE-ZAJC, Lorraine (2003), « L'entrevue semi- dirigée », in Recherche sociale de la problématique à la collecte des données, (dir) Gauthier Benoît, Québec : Presse de l'Université du Québec pp 293-316.
116
SÉNÉCAL, Michel (1995), L'espace médiatique; la communication à l'épreuve de la démocratie, Éditions Liber, 254 p.
SIMPSON, David (1999), Pressure Croups, Londres : Hodder & Stoughton, 137 p.
THOMPSON, John B. (1995), The Media and Modernity; a social theory of the médias, UK: Polity Press et Blackwell Publishers, 314 p.
TREMBLAY, Gaétan (1991), « L'opinion publique », in Michel Beauchamp (sous la direction de), Communication publique et société : repères pour la réflexion et l'action, Québec : Gaétan Morin, pp 149-181.
TREMBLAY, Manon (sous la direction de) (1998), Les politiques publiques canadiennes, Québec : Les presses de l'université Laval, 314 p.
WATIN, Michel (2001), «L'espace public», in Communication et espace public, Paris: Anthropos, pp 49- 70.
WILSON, Laurie (1990), « Corporate Issue Management: An International View», Public Relations Review, vol. 16, numéro I, pp.40-51.
WANTA, Waync (1997), The public and the national agenda; How people learn about important issues, Mahwah: Lawrence Erlbaum Association, 119 p.
YIN, Robert (2003), Case study research: design and methods, Californie: Sage Publications, p 181.
Références tirées du Web
Association étudiante du Cégep de Sainte-Foy, Coupure dans le Programme
de l'aide financière aux études: Chronologie des événements, en ligne,
« http://asso.cegep-ste-foy.qc.ca/dossiers/04-05/afe/chronologie.htm#Anchorhaut », consulté le
20 mai 2007.
- Association pour une Solidarité Syndicale Etudiante, en ligne, « http://www.asse-
solidarite.qc.ca/spip.php?articlel7&lang=fr », consulté le 2 juin 2007.
- Fédération étudiante collégiale du Québec, en ligne, http://www.fecq.org, consulté le 2 juin
2007.
- Fédération étudiante universitaire du Québec, en ligne, « http://www.feuq.qc.ca/ », consulté le
2 juin 2007.
117
- MONTMARQUETTE, Claude (2006), Le remboursement proportionnel au revenu (RPR):
Un système alliant efficacité et accessibilité, en ligne, « http://www.cirano.qc.ca/
pdf/publication/2006RP-08.pdf », consulté le 05/06/2007.
- ROMDHANI, Aymen (2005), Quartier Libre : Le journal des étudiants de l'université de
Montréal, numéro 12: février 2005, en ligne, «http://www.ql.umontreal.ca/volumel2/
numéro 12/campusv I2nl2a.html », consulté le 4 juin 2006.
Dictionnaire
Bibliorom LAROUSSE (Version électronique)
Entretiens
- Président de TASSÉ de l'année universitaire 2004-2005, réalisée le 30 juin 2007.
- Vice président de la FEUQ de l'année universitaire 2004-2005, réalisée le 14 décembre 2007.
118
Annexe 1
Mclie d'analyse de contenu de presse
1- Description de l'article
Journal Date Rubrique Type: Informatif/ Opinion
Initiative de l'article
Auteur
Titre Idée générale Groupes de pression cités
2- Les interventions des groupes de pression reprises dans les journaux
Les actions des groupes Les déclarations
Description Catégorie Description Ton
- Eléments de mise en scène médiatique
Scandale et Choc
Spectacle Suspense Insolite Emotions et sensationnalisme
Conflit
Indices
3- Orientation de la couverture
Position favorable Position neutre Position défavorable
Annexe 2 Exemples de codage
1- La mise en scène médiatique
- Spectacle : « À Québec, 2500 universitaires et collégiens [...] venant d'aussi loin qu'Aima et Saint-Félicien se sont réunis pour entourer l'Assemblée nationale d'une immense banderole colorée signée par quelque 6000 étudiants » ("So so so, sauvons l'éducation", Le Soleil : 11/11/2004)
- Sensationnalisme : « Détenteur d'une maîtrise en sociologie, je travaille depuis un an et demi comme commis dans un club vidéo à 8,15 $ de l'heure parce que je ne trouve pas d'emploi dans mon domaine. Heureusement, comme j'ai eu la chance de terminer mes études avant que le rouleau compresseur libéral ne s'abatte sur le Québec, ma dette d'études ne s'élève qu'à 18 000 $ (...) Malgré cela, je suis incapable de la rembourser » (Témoignage: Une maîtrise en sociologie, dans un dépanneur, à 8,15 $ l'heure, Le Soleil, 6/12/2004)
- Suspense : « "Cette manifestation n'est pas le point final de notre action", a prévenu Julie Bouchard, présidente de la Fédération étudiante collégiale, depuis Montréal, où 10 000 personnes se sont massées devant le bureau de Jean Charest. "Aujourd'hui, nous avons fait la démonstration claire que les jeunes sont mobilisés, et nous prendrons tous les moyens pour atteindre notre but [...] La suite des choses est pour bientôt. FORCE-Québec, la FEIJQ et la FECQ invitent les jeunes à reprendre leurs pancartes et leurs slogans sans pitié le 20 novembre à Montréal, lors du congrès annuel du Parti libéral » ("So so so, sauvons l'éducation", Le Soleil : i 1/1 1/2004).
- Insolite : « Les jeunes libéraux ont mis une bonne dose d'eau dans leur vin, hier. Ils n'exigent plus le réinvestissement des 103 millions $ soustraits du programme de bourses, au grand dam du mouvement étudiant. La rumeur qui circulait déjà en après-midi au Palais des congrès s'est concrétisée. La proposition de la Commission-Jeunesse du Parti libéral du Québec demandant que le gouvernement "réinvestisse impérativement la somme retirée au programme de prêts et bourses dès le prochain budget" a été indéniablement diluée » (Congrès du PLQ : Les jeunes libéraux reculent, 21/11/2004).
-Conflit : « La Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) et son équivalent du collégial, la FECQ, promettent d'utiliser un "crescendo" de moyens de pression "radicaux" pour amener le gouvernement Charest à réviser sa position sur la question des prêts et bourses. "C'est clair qu'on ne va pas lâcher le morceau, a dit hier le président de la FEUQ, Pier-André Bouchard. On prévoit plusieurs actions plus radicales, plus directes, et la désobéissance civile n'est pas exclue." » (Les étudiants promettent un hiver agité, Le Soleil, 29/11/2004)
- Choc et scandale : « Pris à contre-pied, les policiers de la Sûreté du Québec et les gardes du corps qui assurent la sécurité des élus ont eu du mal à repousser les manifestants qui ont fracassé une des portes d'entrée de l'hôtel. Des bombes de poivre de Cayenne lurent utilisées, mais le vent a repoussé les effluves irritantes à l'intérieur de l'établissement, indisposant les forces de l'ordre. Défendant l'entrée, les policiers ont distribué des coups de matraque, blessant légèrement une dizaine de manifestants. Sept étudiants ont été arrêtés. Dix-huit gardes du corps et sept policiers ont subi des blessures mineures » (Une manifestation étudiante vire à l'émeute, Le Devoir, 17/02/2005)
120
2- Orientation de la couverture des journaux
Citations qui traduisent une position favorable :
- Commentaire sur les actions des groupes : « Ils ont bravé le froid. Ils ont marché. Ils ont crié [...] La manifestation avait des airs de fête, et elle s'est déroulée dans le calme, mais la colère des jeunes était visiblement très vive. » ("So so so, sauvons l'éducation", Le Soleil : 11/11/2004).
- Reprise des actions et les arguments des groupes: « Dans le même ordre d'idées, la Fédération étudiante universitaire du Québec (FFAJQ), a rendu public, hier, un sondage révélant que 73 % des Québécois s'opposent à la coupe de 103 millions $ dans l'aide financière aux étudiants. Ce sondage Léger Marketing a été mené auprès de 1001 personnes et présente une marge d'erreur de 3,4 %, 19 fois sur 20. " Ça démontre qu'il y a un vaste consensus à l'effet qu'il s'agit d'une mauvaise décision du gouvernement, a déclaré Pier-André Bouchard, président de la FHUQ. Tous les groupes sont sortis pour dire que ça n'a aucun sens" » (Congrès du PLQ à Montréal : Les étudiants crient leur opposition, Le Soleil : 20/1 1/2004).
- Critique la partie opposée : « Il est frustrant de voir que les jeunes libéraux se sont écrasés devant le gouvernement Charest sur la question des coupures au programme de prêts et bourses. Pour satisfaire le ministre de ITducation et le premier ministre, le président des jeunes libéraux a floué les étudiants les plus pauvres, donné son appui à l'endettement de la génération montante et dit oui au dégel des frais de scolarité. On peut se demander si les jeunes libéraux défendent vraiment les jeunes. J'en doute fort !» ( Coup dur, Le Soleil : 24/11/2007)
Citations qui traduisent une position défavorable :
- Discrédit de la mobilisation étudiante : « . . . ceux qui participent, pas certain qu'ils savent pourquoi ils le font. Un participant à la manif a Uni par me l'avouer. Ok, c'est vrai, on sait pas trop pourquoi on est là, je veux dire on le sait, mais on ne sait pas tout. On nous a dit des p'tits bouttes, des mots-clés à répéter, comme ça, avec la pancarte, mais on ne connaît pas les détails de l'affaire, c'est ben sûr » (Prêt pas prêt, on débourse, Le Soleil : 11/11 /2004).
- Reprise des arguments de la partie adverse : « La députée de Jean-Talon, Margaret Delisle, estime justifiée la transformation de 103 millions $ de bourses en prêts pour les étudiants. "Cette décision n'a pas été prise de façon irréfléchie, a-t-elle commenté, hier. Elle a été prise en fonction du manque à gagner des finances publiques avec à l'esprit que tout le monde doit faire sa part." Lors du congrès des membres du PLQ de la semaine prochaine, une proposition portera sur une hausse des frais de scolarité pour améliorer le financement des universités. Sans se prononcer sur la question, la présidente du caucus régional a indiqué qu'il serait "irresponsable d'escamoter ce débat" » (« fout le monde doit faire sa part », dit Delisle, Le Soleil, 12/11/2004).
121
Annexe 3 : Résultats de l'analyse statistique des données
Corrélation : L'accès aux journaux et les stratégies de mise en scène médiatique
Cite ou non
un groupe
Scandale ou choc Spectacle
Suspcnce Insolite Sensationnalisme Conflit
Cite ou non un groupe
Pearson Corrélation
1 ,134 ,419 ,436 ,050 ,245 ,139
Sig. (2-tailed)
' ,192 ,000 ,000 ,626 ,016 ,178
Sum of Squares
and Cross-products
23,833 ,917 9,583 8,625 ,667 3,583 2,337
Covariance ,251 ,010 ,101 ,091 ,007 ,038 ,025 N 96 96 96 96 96 96 95
Scandale ou choc Pearson Corrélation
,134 1 ,197 -,077 -,044 ,189 ,353
Sig.(2-tailed)
,192 ' ,054 ,455 ,670 ,065 ,000
Sum of Squares
and Cross-products
,917 1,958 1,292 -,438 -,167 ,792 1,705
Covariance ,010 ,021 ,014 -,005 -,002 .008 ,018 N 96 96 96 96 96 96 9.5
Spectacle Pearson Corrélation
,419 ,197 1 ,082 ,092 ,318 ,309
Sig. (2-tailed)
,000 ,054 ' ,425 ,373 ,002 ,002
Sum of Squares
and Cross-products
9,5X3 1,292 21,958 1,562 1,167 4.458 4,989
Covariance ,101 ,014 ,23 1 ,016 ,012 ,047 ,053 N 96 96 96 96 96 96 95
Suspense Pearson Corrélation
,436 -,077 ,082 1 -,160 .067 ,065
Sig. (2-tailed)
,000 ,455 ,425 ' ,120 ,516 ,533
Sum of Squares
and Cross-products
8,625 -,438 1,562 16,406 -1,750 ,812 ,905
Covariance ,091 -.005 ,016 , 173 -,018 ,009 ,010 N 96 96 96 96 96 96 95
Insolite Pearson Corrélation
,050 -,044 ,092 -,160 1 -,103 -,126
Sig. (2-tailcd)
,626 ,670 ,373 ,120 ' ,319 ,223
Sum of Squares
and Cross-products
,667 -.167 1,167 -1,750 7,333 -,833 -1,179
Covariance ,007 -,002 ,012 -,018 ,077 -,009 -,013 N 96 96 96 96 96 96 95
Sensationnalisme Pearson ,245 ,189 ,318 ,067 -,103 1 ,148
122
Corrélation Sig. (2-tailed)
,016 ,065 ,002 ,516 ,319 • ,153
Sum of Squares
and Cross-products
3,583 ,792 4,458 ,812 -,833 8.958 1,526
Covariancc ,038 ,008 ,047 ,009 -,009 ,094 ,016 N 96 96 96 96 96 96 95
Conflit Pcarson Corrélation
,1 39 ,353 ,309 ,065 -,126 ,148 1
Sig. (2-tailcd)
,178 ,000 ,002 .5 ï i .223 .153
Sum of Squares
and Cross-products
2,337 1.705 4,989 ,905 -1,179 1,526 11,937
Covariance ,025 ,018 ,053 ,010 -,013 ,016 ,127 N 95 95 95 95 95 95 95
** Corrélation is significant at the 0.01 level (2-tailed). * Corrélation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Annexe 4
Guide des entretiens avec les leaders des groupes de pression
- Avez-vous tenté de vous adresser directement aux députés et aux membres du gouvernement pour essayer d'infléchir leur décision ?
- Comment avez vous planifié vos actions ? Aviez vous une équipe qui se chargeait de réfléchir aux actions de mobilisation et de les organiser?
- À qui s'adressaient les actions que vous avez organisées ? Aux étudiants, à l'opinion publique, aux journalistes ?
- Comment jugez vous le rôle des médias dans ce genre de situations ?
- Quelles sont les techniques que vous utilisez pour faire publier des informations ou annoncer une action?
- Est-ce que vous privilégiez le contact personnel avec les journalistes ? Pourquoi ?
- Avez-vous des interlocuteurs particuliers dans différents médias ?
- Donniez vous l'exclusivité des informations à un média ou à un journaliste en particulier ?
- Que faites vous pour garantir que l'événement que vous organisez intéresse les médias ?
- Aviez-vous eu recours aux productions prêtes à la diffusion médiatique (comme des reportages ou autres...) ?
- Quelles sont d'après vous les caractéristiques des événements qui intéressent les médias ?
- Quelle est l'action qui a constitué un bon coup médiatique, d'après vous ? Pourquoi ?
- Pensez vous que les médias vous ont donné suffisamment d'espace pour vous exprimer et défendre votre point de vue ?
- Aviez-vous par moments été déçus par la couverture que vous a fait un journal en particulier ?
- Aujourd'hui avec le recul, est ce que vous estimez que les médias ont servi votre cause ? Quels objectifs vous ont-ils aidé à atteindre? (La sensibilisation de l'opinion publique, la mobilisation des étudiants et l'augmentation du nombre d'adhérents, ou encore le renforcement de votre crédibilité ?)
124
Annexe 5
Courriel pour le recrutement
Bonjour,
Mon nom est Seima Souissi, je suis étudiante de maîtrise en communication publique à
l'Université Laval. Présentement, je me consacre à la rédaction de mon mémoire de fin
d'études. Ma recherche s'articule autour de la relation entre les médias et les groupes de
pression dans la formulation des politiques publiques au Québec. Le projet a été approuvé par
le Comité d'éthique de la recherche de l'Université Laval le 18 juin 2007, il porte le numéro
d'approbation : 2007-137.
Le problème de recherche s'intéresse à la manière avec laquelle les groupes de pression
participent aux débats publics, défendent leurs intérêts et influencent les décisions
gouvernementales en faisant usage des médias. J'ai choisi d'étudier le cas de la politique
publique relative à la modification des régimes des bourses et prêts d'études dont les péripéties
se sont déroulées en 2004-2005.
Pour les fins de cette recherche, j 'ai jugé important d'effectuer des entrevues avec les leaders
des groupes de pression ayant témoigné de ces événements. Étant donné que votre organisme
était l'un des principaux coordinateurs de ce mouvement de contestation étudiante, j'estime que
la participation, à cette enquête, de l'un des membres de l'équipe de 2004-2005 est susceptible
de fournir des informations précieuses et d'enrichir mon étude. Je pense particulièrement à l'ex
président , le vice président , l'attaché de presse
Je m'adresse à votre organisme via ce courriel, dans l'objectif d'avoir votre consentement pour
contribuer à ma recherche et pour m'aider à prendre contact avec les membres de cette équipe.
Si cette proposition vous intéresse, je suis prête à vous donner des détails supplémentaires
quant aux objectifs de l'enquête et à son déroulement.
En attendant votre réponse, que je souhaite favorable, je vous prie d'agréer, monsieur, mes
salutations les meilleures.
Seima Souissi
Étudiante en maîtrise à l'Université Laval
Téléphone :
125
Annexe 6
Médias et groupes de pression dans la formulation des politiques publiques au Québec :
Le cas de la modification du programme des prêts et bourses d'études
Formulaire de consentement
Mon nom est Seima Souissi. Je suis inscrite au programme de maîtrise en communication
publique à l'université Laval. Cette enquête s'inscrit dans le cadre d'un mémoire qui s'articule
autour de la relation entre les médias et les groupes de pression dans la formulation des
politiques publiques au Québec. Mon directeur de recherche est M. Charles Moumouni,
professeur au département d'information et de communication de la faculté des lettres de
l'université Laval.
Avant d'accepter de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire et de
comprendre les renseignements qui suivent. Ce document vous explique le but de ce projet de
recherche et ses procédures. Nous vous invitons à nous poser toutes les questions que vous
jugerez utiles.
Objet de la recherche : Notre étude s'intéresse à la manière avec laquelle les groupes de
pression participent aux débats publics, défendent leurs intérêts et influencent les décisions
gouvernementales en faisant usage des médias. Nous allons nous attarder sur l'étude d'une
politique publique québécoise, celle de la modification des programmes des prêts et des
bourses d'études dont les péripéties se sont déroulées pendant l'année scolaire 2004-2005.
Notre objectif est de savoir comment les groupes de pression montent leurs actions de manière
à attirer l'attention des médias et à réussir à intégrer leur ordre du jour. Nous espérons
également pouvoir vérifier si, par ces actions, les groupes parviennent à orienter la couverture
médiatique dans le sens favorable à leur cause.
126
Médius et groupes de pression dans la formulation des politiques publiques au Québec :
Le cas de la modification du programme des prêts et bourses d'éludes
Méthodologie : Nous avons choisi de combiner deux techniques de cueillette de données. Nous
avons opté d'une part pour l'analyse de contenu des articles journalistiques qui couvrent
l'affaire de la modification du programme des prêts et bourses d'études et d'autre part, pour les
entrevues semi dirigées avec les leaders des groupes de pression qui ont témoigné des
événements de protestation en 2004 et 2005.
L'analyse des articles de journaux servira à nous renseigner sur les techniques de médiatisation
des problèmes publics et l'orientation de la couverture des mouvements sociaux. Grâce au
recours au contact direct avec les acteurs de cette affaire, les entretiens serviront à nous éclairer
sur les intentions des groupes de pressions, les stratégies qu'ils ont voulu mettre en œuvre pour
attirer l'attention des médias et leurs tentatives d'orienter le discours médiatique. Cette
démarche nous permettra de croiser les informations obtenues à partir de chacune des
techniques et pouvoir comparer l'objectif visé par les groupes et la couverture qu'ils ont eue
dans les journaux.
Par conséquent, votre participation à cette enquête, en tant que représentant de l'un des
principaux acteurs du mouvement de protestation, est d'un apport considérable pour notre
recherche.
L'entrevue sera individuelle. Elle sera enregistrée et est prévue pour une durée de 45 minutes
aux cours desquels nous allons vous poser quelques questions liées à votre expérience par
rapport à l'affaire des bourses et prêts d'études. Les informations que vous allez nous procurer
seront utilisées uniquement pour les fins de cette étude. Les enregistrements ne seront
accessibles qu'à notre directeur et nous-même, ils seront détruits une fois qu'on aura achevé le
travail sur ce mémoire vers le mois d'octobre. 11 n'y a aucun autre risque connu à votre
participation sauf celui d'être reconnu par votre identité et par le fait que vous représentez votre
organisme.
127
Médius et groupes de pression dans la formulation des politiques publiques au Québec :
Le cas de la modification du programme des prêts et bourses d'études
Vous avez totalement le droit de refuser ou d'accepter de participer à la recherche. Vous êtes en mesure de mettre fin à notre collaboration, en tout temps et sans préjudice, le cas échéant, toute les données vous concernant seront détruites. Vous pouvez également refuser de répondre à certaines questions sans conséquence négative.
Pour des renseignements supplémentaires, vous pouvez me joindre par courriel à l'adresse suivante : [email protected] ou bien, par téléphone au numéro (418) 558 47 11.
Nous vous remercions vivement d'accepter de nous aider à la concrétisation de ce projet de mémoire.
Je soussigné(e) consens librement
à participer à la recherche intitulée : «Médias et groupes de pression dans la formulation des
politiques publiques au Québec : Le cas de la modification du programme des bourses et prêts
d'études ». J'ai pris connaissance du formulaire et je comprends le but, la nature, et les
procédures du projet de recherche. Je suis satisfait(e) des explications, précisions et réponses
que la chercheure m'a fournies, le cas échéant, quant à ma participation à ce projet.
Date Signature du participant, de la participante
J'ai expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de
recherche au participant. J'ai répondu au meilleur de ma connaissance aux questions posées et
j 'ai vérifié la compréhension du participant.
Date Signature de la chercheure
128
Médias et groupes de pression dans la formulation des politiques publiques au Québec :
l.e cas de la modification du programme des prêts et bourses d'éludes
Toutes plaintes ou critiques concernant ce projet pourront être adressées au bureau de l'Ombudsman de l'Université Laval dont les coordonnées sont les suivantes :
Pavillon Alphonse-Desjardins bureau 3320 Université Laval, Québec (Québec) GIK 7P4 Renseignements - Secrétariat : (418) 656-3081 Télécopieur: (418) 656-3846 Courriel : [email protected]
Copie de
Projet approuvé par le Comité d'éthique de l'Université Laval le 18 juin 2007, le numéro d'approbation est : 2007-137
Initiales
Annexe 7 :
DÉCLARATION Di; MONSIEUR JEAN-MARC FOURNIER
MINISTRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
À L'OCCASION DU DÉVOILEMENT DU CONTENU D'UNE ENTENTE DE PRINCIPE AVEC LES LEADERS ÉTUDIANTS
BUREAU DU MELS À MONTRÉAL
LE SAMEDI 2 AVRIL 2005
Mesdames, Messieurs,
Merci de votre présence pour cette conférence de presse annonçant une entente de principe
avec les leaders étudiants. Une entente qui améliore les bourses dans le respect du cadre
budgétaire du gouvernement du Québec. D'abord, je tiens à rappeler que le 15 mars nous avons
fait une offre substantielle qui témoignait de notre sensibilité à la question de l'endettement
étudiant. Soulignons que les recteurs d'universités, la Fédération des cégeps et la Chambre de
commerce du Québec ont noté l'importance des sommes mises sur la table, soit 342 M$ sur 5
ans. Il est apparu que pour en arriver à une entente avec les leaders étudiants, il fallait dégager
d'autres sources de financement. Dès le départ, nous avons précisé que les discussions devaient
se tenir à l'intérieur de notre cadre budgétaire. On ne pouvait pas accepter d'améliorer les
bourses aux étudiants en enlevant des crédits aux universités. Cela aurait constitué un recul.
Nous cherchions à avancer en améliorant l'aide financière tout en protégeant les autres missions
en éducation. Pour cela, il n'y avait qu'une piste : développer une nouvelle marge de manoeuvre
par l'apport d'argent neuf et non par un transfert de fonds existants.
Aujourd'hui, je vous annonce que nous avons avancé. D'abord, un premier pas de 40 M$ grâce
à une entente entre le Ministère et la Fondation des bourses fédérales du millénaire. Entente
obtenue avec la collaboration des étudiants et des autorités fédérales. Notons que ce 40 M$ est
un ajout aux 70 M$ annuels des Bourses du millénaire.
130
Ensuite, nous avons avancé d'un second pas de 100 M$ pour les 5 prochaines années, suite à
nos discussions avec le gouvernement fédéral à l'égard du Programme canadien des prêts aux
étudiants. Certains échanges administratifs restent à compléter, mais grâce aux démarches des
dernières semaines, et plus particulièrement des derniers jours, à l'égard des fonds annoncés au
budget fédéral, nous sommes passés d'une simple éventualité, à une réelle capacité d'affecter de
nouveaux fonds dans un ordre de grandeur de 25 M$ par année, à compter de l'an prochain,
pour les étudiantes et les étudiants du Québec qui en ont le plus besoin. Nous avons fait des
progrès en améliorant notre marge de manoeuvre de 140 M$ sur 5 ans suite à nos discussions
avec le gouvernement fédéral. Je tiens d'ailleurs à souligner la contribution de la ministre
Lucienne Kobillard qui durant les dernières semaines à permis ce progrès.
Ainsi donc, à notre cadre budgétaire de 342 M$ sur 5 ans annoncé le 15 mars, nous pouvons
maintenant ajouté 140 M$ sur 5 ans provenant du fédéral, nous permettant de disposer de 482
M$. Aujourd'hui, j'annonce une entente de principe avec les leaders étudiants qui distribue ces
482 M$ en bourses supplémentaires sur 5 ans de la façon suivante : 70 M$ la première année et
103 M$ les 4 autres années. Pour les étudiants, cette entente signifie des bourses
supplémentaires : la première année de 1400 $ à l'université et de 700 $ au cégep. Les 4 autres
années de 1980 $ à l'université et de 1055 $ au cégep. Pour le gouvernement du Québec, il
s'agit d'une entente qui nous permet d'améliorer une mission, soit l'accès aux études, non pas en
déshabillant une autre mission, mais par l'apport d'argent neuf du gouvernement fédéral.
Pour les Québécois, cela constitue d'abord un gain en éducation mais aussi une preuve que les
relations fédérales-provinciales peuvent aussi être synonymes de collaboration et d'entente.
Source : Portail Québec :
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Avril2005/02/cl465.html
I il