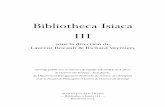Guindon, A. 2013. Première approche des recettes de glaçures du centre potier de Sadirac, Gironde....
Transcript of Guindon, A. 2013. Première approche des recettes de glaçures du centre potier de Sadirac, Gironde....
Université Michel de Montaigne BORDEAUX 3
MASTER 2 - HISTOIRE DE L�ART ET PATRIMOINE
Spécialité Recherche
MATÉRIAUX DU PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHÉOMÉTRIE
MEMOIRE DU STAGE EFFECTUE AU
C.R.P.A.A. UMR CNRS 5060 IRAMAT
Centre de Recherche en Physique Appliquée à l'Archéologie Maison de l'Archéologie, Esplanade des Antilles, Domaine Universitaire,
33607 - PESSAC cedex, France Tél.: 05.57.12.45.53. Fax : 05.57.12.45.50
Première approche des recettes de glaçures du centre potier de Sadirac, Gironde.
GUINDON Amélie Licence d�Anthropologie
Juin 2013 MEMOIRES DE LA SERIE "FORMATION A ET PAR LA RECHERCHE" MASTER 2 Rech.
1
Table�des�matières�
Table des cartes, figures, graphiques et tableaux .......................................................................... 3
Avant-propos .................................................................................................................................. 5
Introduction ................................................................................................................................... 6
1. État des connaissances ........................................................................................................... 9
1.1. Données historiques et archivistiques ............................................................................ 9
1.2. Données archéologiques .............................................................................................. 12
1.3. Économie portuaire et poterie ..................................................................................... 15
1.4. Données archéométriques ........................................................................................... 16
2. Objectifs de l�étude .............................................................................................................. 18
2.1. Qu�est-ce qu�une glaçure ? ........................................................................................... 18
2.2. Les objectifs de l�étude des glaçures de Sadirac ........................................................... 19
3. Présentation du matériel étudié ........................................................................................... 22
3.1 Les échantillons de la Maison de la Poterie de Sadirac ................................................. 24
3.2 Les échantillons de l�INRAP ........................................................................................... 25
4 Méthodologie mise en �uvre .............................................................................................. 32
4.1 Démarches préliminaires .............................................................................................. 32
4.2 Préparation des échantillons ........................................................................................ 32
4.3 Observations sous loupe binoculaire ............................................................................ 33
4.4 Mesure physique de la couleur..................................................................................... 33
4.5 Observations en microscopie électronique à balayage ................................................ 35
4.6 Analyses élémentaires par MEB-EDS ............................................................................ 37
5. Colorimétrie ......................................................................................................................... 43
5.1 Identification des chromogènes ................................................................................... 43
5.2 Mesure physique de la couleur..................................................................................... 46
6. Observations de la texture des glaçures ............................................................................... 49
6.1 Observations en lumière naturelle ............................................................................... 49
6.1.1 Les objets : leurs surfaces ..................................................................................... 49
6.1.2 Les sections polies ................................................................................................ 51
6.2 Observations en microscopie électronique à balayage ................................................ 52
Les sections polies ................................................................................................................ 52
7. Résultats des analyses en MEB-EDS ..................................................................................... 56
2
7.1 L�analyse des terres cuites ............................................................................................ 56
7.2 L�analyse des glaçures .................................................................................................. 56
8. Comparaison des résultats par site :..................................................................................... 57
8.1 Les glaçures .................................................................................................................. 58
8.2 Les terres cuites ............................................................................................................ 62
8.3 Discussion ..................................................................................................................... 65
9. Comparaison des résultats par période : .............................................................................. 66
9.1 Les glaçures .................................................................................................................. 66
9.2 Les terres cuite ............................................................................................................. 70
9.3 Discussion ..................................................................................................................... 72
Bilan général et perspectives........................................................................................................ 73
3
Table�des�cartes,�figures,�graphiques�et�tableaux�Carte 1 : Carte des zonages archéologiques décrétés sous Arrêté par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (ARRÊTÉ N° AZ.07.33.14, Préfecture de la Gironde, Aquitaine). ............................................... 13 Carte 2 : Détail de la Carte de Cassini ........................................................................................................ 23 Carte 3 : Limites communales de Sadirac .................................................................................................. 23
Figure 1 : Sommaires des principales méthodes de production d�une glaçure plombifère (Tite et al., 1998). ................................................................................................................................................................. 18 Figure 2 : Échantillons de Laurent Videau. ................................................................................................ 27 Figure 3 : Échantillons de Tioulet. ............................................................................................................. 29 Figure 4 : Échantillons de Lorient aménagement LaVie. ............................................................................ 31
Figure 5 : le modèle L*a*b* de façon schématique. ÓA. Guindon ........................................................... 35 Figure 6 : Poire de diffusion du faisceau incident d�électrons. (http://www.culture.gouv.fr/culture/conservation/fr/methodes/meb_01.htm) ...................................... 36 Figure 7 : Démonstration de la stabilisation de la moyenne en SiO2 de la glaçure d�un échantillon entre 6 et 10 spectres. .......................................................................................................................................... 39 Figure 8 : Démonstration de la stabilisation de la moyenne en PbO de la glaçure d�un échantillon entre 6 et 10 spectres. .......................................................................................................................................... 39 Figure 9 : Spectres d�absorption optique de l�ensemble glaçure � terre cuite et de la terre cuite (Ben Amara, 2002). ........................................................................................................................................... 43 Figure 10 : Spectre de l�échantillon BDX 15732 présentant une nette absorption vers350 et 550 nm, typique de la présence des ions Fe3+ et Cu2+ comme éléments chromogènes de la matrice vitreuse. ....... 44 Figure 11 : Spectre de l�échantillon BDX 15725 présentant une absorption vers 350 nm, typique de la présence de l�ion Fe3+. .............................................................................................................................. 44 Figure 12 : Schéma du trajet optique de la lumière incidente (Ben Amara, 2002). .................................... 45 Figure 13 : Spectres d�absorbance de huit échantillons présentant une absorption à 550 nm................... 46 Figure 14 : Système XYZ de la CIE 1931. Principales tonalités portées dans le diagramme de chromaticité (x y) (Dupont et Steen, 2004). ....................................................................................................................... 47 Figure 15 : Image en lumière naturelle de l�échantillon BDX 15733 et ses craquelures. ............................ 50 Figure 16 : Image en lumière naturelle de l�échantillon BDX 15741 présentant un exemple de creux dans la terre cuite................................................................................................................................................. 50 Figure 17 : Image en lumière naturelle de l�échantillon BDX 15728 présentant un exemple de petit cratère dans la glaçure. ......................................................................................................................................... 50 Figure 18 : Image en lumière naturelle de l�échantillon BDX 15728 qui présente une masse jaunâtre dans sa glaçure. ................................................................................................................................................ 51 Figure 19 : BDX 15740 Gx100 .................................................................................................................... 51 Figure 20 : BDX 15726 Gx50 ...................................................................................................................... 51 Figure 21 : Images réalisées au microscope électronique à balayage (mode BSE ou ER) de l�ensemble glaçure-terre cuite et de leurs textures. .................................................................................................... 54 Figure 22 : Résultats des analyses MEB-EDS des glaçures présentés en box plot selon les sites. Les valeurs entre parenthèses exprimées en rapport expriment les échantillons où l�élément a été détecté par comparaison à l�ensemble. ....................................................................................................................... 60 Figure 23 : Résultats des analyses MEB-EDS des glaçures présentés en box plot selon les sites (suite)...... 61 Figure 24 : Résultats des analyses MEB-EDS des terres cuites présentés en box plot selon les sites. ......... 64 Figure 25 : Résultats des analyses MEB-EDS des glaçures présentés en box plot selon les périodes. ......... 68 Figure 26 : Figure 27 : Résultats des analyses MEB-EDS des glaçures présentés en box plot selon les périodes (suite)......................................................................................................................................... 69 Figure 28 : Figure 29 : Résultats des analyses MEB-EDS des terres cuites présentés en box plot selon les périodes. .................................................................................................................................................. 71
4
Graphique 1 : Représentations des coordonnées a* et b* des mesures de couleur des échantillons de l�étude selon le système L*a*b* (CIE1976). Nous y avons ajouté une ellipse de confiance à 95%. ............ 47 Graphique 2 : Répartition des coordonnées L*a*b* selon les périodes. ................................................... 48 Graphique 3 : Répartition des coordonnées L*a*b* selon les sites. .......................................................... 49 Graphique 4 : Diagramme présentant les épaisseurs des glaçures selon les périodes. .............................. 52 Graphique 6 : Les rapports SiO2/Al2O3 des glaçures et des terres cuites montrent une correspondance dans la majorité des cas. Ceci implique l�utilisation des mêmes argiles pour la confection des terres cuites et des glaçures. ......................................................................................................................................... 65 Graphique 7 : Variation des concentrations en CuO par rapport à l�As2O3. ................................................ 66 Graphique 8 : Variation des concentrations de ZnO par rapport à CuO. .................................................... 66
Tableau 1 : Tableau récapitulatif des échantillons confiés par le Musée de la Poterie de Sadirac .............. 25 Tableau 2: Échantillons provenant de Laurent Videau .............................................................................. 26 Tableau 3 : Échantillons provenant de Tioulet .......................................................................................... 28 Tableau 4 : Échantillons provenant de Lorient, aménagement LaVie ........................................................ 30 Tableau 5 : Résultats d'analyseS MEB-EDS de BCR-126A selon différents temps d'acquisition. ................. 37 Tableau 6 : Résultats d'analyses MEB-EDS de BCR-126A selon différents temps d'acquisition après traitement avec des standards pour les matrices vitreuses. ...................................................................... 38 Tableau 7 : Tableau présentant les concentrations en cuivre des huit échantillons. .................................. 45 Tableau 8 : Moyennes des épaisseurs de glaçure des échantillons de Sadirac selon les sites. ................... 53 Tableau 9 : Moyennes des épaisseurs de glaçure des échantillons de Sadirac selon les périodes. ............. 53 Tableau 10 : Valeurs moyennes obtenues en MEB-EDS sur les pâtes des céramiques de Sadirac (n = 58). 56 Tableau 11 : Valeurs moyennes obtenues en MEB-EDS sur des glaçures de céramiques de Sadirac (n = 61). ................................................................................................................................................................. 57 Tableau 12 : Valeurs moyennes obtenues en MEB-EDS sur des glaçures de céramiques de Sadirac (n = 61) selon les sites à l�étude. ............................................................................................................................ 59 Tableau 13 : Valeurs moyennes obtenues en MEB-EDS sur les terres cuites des échantillons de Sadirac (n = 58) selon les sites à l�étude. ...................................................................................................................... 62 Tableau 14 : Valeurs moyennes obtenues en MEB-EDS sur les glaçures des échantillons de Sadirac (n = 61) selon les périodes à l�étude. ..................................................................................................................... 67 Tableau 15 : Valeurs moyennes obtenues en MEB-EDS sur les terres cuites des échantillons de Sadirac (n = 58) selon les périodes à l�étude. ............................................................................................................... 70 Tableau 16 : Composition moyenne d�une glaçure plombifère contenant 60% de PbO et dont la densité est équivalente à 4g/cm3. ............................................................................................................................... 75
5
Avant-propos�
Ma volonté de travailler sur les poteries de Sadirac est née en 2011 à la suite d�un cours à l�Université de Montréal. Les problématiques concernant les transferts et les échanges coloniaux entre l�Europe et les Amériques m�ont depuis ce moment intéressé. En constatant le manque de données sur cette période, il m�est apparu que le travail devait d�abord continuer sur le vieux continent...De ce fait, travailler à mieux définir un centre potier impliqué dans le commerce colonial portuaire et ses productions céramiques semblait être un bon engagement. Malgré quelques difficultés concernant la formation d�un corpus d�échantillons représentatif des nombreux ateliers, le travail qui suit s�applique à décrire, avec l�aide de l�archéométrie, les techniques de glaçures des potiers de Sadirac.
!
Ce travail de recherche a été élaboré au sein du Centre de Recherche en Physique Appliquée à l�Archéologie (CRP2A), un laboratoire associé au CNRS (UMR 5060 � IRAMAT) et dirigé par Monsieur Pierre Guibert, que je tiens à remercier pour m�avoir permis de mener à bien ce projet. Dans un premier temps, j�aimerais particulièrement remercier Monsieur Ayed Ben Amara pour m�avoir encadré et conseillé tout au long de ce stage, ainsi que Monsieur Pierre Régaldo sans qui ce projet n�aurait jamais eu lieu. Je tiens également à exprimer toute ma reconnaissance aux nombreuses personnes du laboratoire qui ont contribué de près ou de loin à ce projet. Je pense tout particulièrement à Monsieur François-Xavier Le Bourdonnec, Madame Nadia Cantin et Monsieur Yannick Lefrais, mais aussi à Madame Brigitte Spiteri et Monsieur Floréal Daniel. Un grand merci à mes collègues stagiaires, Réjane, Pierre, Youness et Tifenn, pour les moments de folie, les discussions philosophiques et les mots d�encouragement. Merci aussi aux thésards : Aurélie et Aurélie pour les déjeuners conviviaux, Nicolas et Nino pour leur sérieux.
Finalement, je tiens à remercier tous les gens qui m�ont soutenu. Merci à mes parents et ma famille qui, malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent, ne cessent de m�encourager à continuer, merci à mon frère qui me manque beaucoup, merci à mes ami(e)s qui sont loin ou proches, et finalement, un merci particulier à Jonathan pour son soutient, son affection et son aide.
�
6
Introduction��
La céramique est un matériau omniprésent sur les sites archéologiques. En plus d�être présente en grande quantité, elle permet de réaliser des datations relatives des sites archéologiques par associations typo-chronologiques. La céramique est aussi un marqueur culturel et identitaire. Elle est utilisée dans toutes les sphères de l�économie domestiques, mais aussi dans l�économie de marché comme bien d�échange et outils de production alimentaire, etc. À l�Époque moderne, les centres potiers les plus productifs coordonnent leurs activités artisanales avec les demandes des grands centres urbains aux alentours. Certains centres potiers ruraux se développent et deviennent de véritables agglomérations artisanales. Les potiers s�installent essentiellement sur des terres riches en bonnes argiles, le centre potier de Sadirac en est un bel exemple. Cette commune, située près de Bordeaux en Gironde, a bénéficié de l�importance du commerce portuaire bordelais et de la fonctionnalité de l�axe garonnais pour écouler ses productions sur les marchés, allant même jusqu�à fournir les colonies françaises des Amériques. Malgré le peu d�intérêt voué à ces périodes récentes en archéologie, les questionnements soulevés ces dernières années par les chercheurs et le nouvel intérêt envers les céramiques de la fin du Moyen Âge et de l�Époque moderne ont entrainés des recherches multidisciplinaires sur ces matériaux notables que sont les céramiques. Le travail qui suit s�appliquera à présenter l�aboutissement de quatre mois et demi de recherche concernant une première étude des glaçures de céramiques du centre potier de Sadirac. Le choix de l�étude des glaçures succède aux nombreuses recherches menées jusqu�à ce jour sur les céramique de cette commune, et tentera d�apporter de nouvelles connaissances concernant les savoir-faire et techniques des portiers sadiracais. La méthode d�approche est essentiellement basée sur la caractérisation physico-chimique de ces glaçures dans le but d�en détacher des résultats probants, en liens avec l�activité artisanale de la poterie et ses attributs. Ces résultats seront confrontés aux données archéologiques, archivistiques et historiques.
�
9
1. État�des�connaissances��
Plusieurs auteurs ont précisé que l�artisanat de la poterie médiévale et moderne du Sud-Ouest, mais surtout du Bordelais, est pratiquement inconnue (Boüard (de), 1975 ; Hanusse, 1982). Ce constat a récemment fait l�objet d�une table ronde rassemblant des archéologues (INRAP, ADES, SRA�) et des chercheurs de l�Université Bordeaux 3, organisée dans le cadre du LabEx LASCAR. Malgré la pauvreté des informations concernant ces périodes, il semblerait qu�un grand centre rassemble la majorité de la production céramique de la région bordelaise, il s�agit de Sadirac. Cette commune aurait été depuis le XIIe siècle le lieu d�une activité potière intense. De par sa proximité avec la ville portuaire de Bordeaux à 20 kilomètres au Nord-Ouest et de la richesse de ses sols en bonnes terres argileuses, l�importance de ce centre de production n�aurait cessé de croître jusqu�au fatidique XIXe siècle, époque à laquelle l�industrie sucrière française de la canne à sucre tombe ; la transformation radicale du marché impose l�industrialisation au dépend des activités plus artisanales ; le commerce colonial est perdu, et les produits de terre cuite sont tranquillement remplacés par des objets en verre moulé et en tôle émaillée. Malgré tout, la tradition de la poterie de terre continue encore aujourd�hui à Sadirac avec les artistes-céramistes venus s�installer dernièrement. Il y a de cela quelques années, des potiers faisaient encore perdurer le savoir-faire ancestral, Sylvie Bordelais (1984) s�y est intéressé pendant sa thèse d�ethnologie. Après plus de 30 années de recherche, les connaissances sur Sadirac comme centre potier sont vastes�
1.1. Données�historiques�et�archivistiques�
Sadirac aurait été un centre potier majeur dans la région de Bordeaux à l�Époque moderne. Une étude archivistique réalisée par Claire Hanusse (1982, 1988) sur des documents datant des XVIIe et XVIIIe siècles a révélé la présence de 255 potiers ou potiers-journaliers entre 1733 et 1773 dans la commune de Sadirac. Le dépouillement de ces actes notariés, inventaires, baux à ferme, documents de quittance et de partage de biens, et quelques contrats de location du XVIe siècle ont permis non seulement d�apporter des informations cruciales qui manquaient à nos connaissances sur ce centre potier girondin, mais aussi d�obtenir une idée sur l�organisation de l�artisanat potier. De ce fait, ces documents d�archives nous renseignent sur le nombre de fours en fonction à cette période, à savoir une quarantaine, les potiers propriétaires de ces fours, ou d�une part de four, et finalement les outils possédés par les artisans. De plus, ces documents nous permettent d�obtenir des informations quant à l�organisation spatiale des maisons et la place de l�atelier, bradeuil, au sein de celles-ci. Claire Hanusse continue son étude et restitue l�assortiment du potier. Les textes ne sont pas toujours explicitent quant à la panoplie d�objets et d�outils qu�avaient en leur possession les potiers. Il est donc nécessaire de confronter ces données avec des informations contemporaines, des ouvrages, et de les comparer avec des données ethnologiques et archéologiques. Surtout, il est important de tenter de rapprocher ces éléments avec le matériel recueilli en fouilles à Sadirac, cela même si « les découvertes d�outils dans les ateliers fouillés sont peu fréquentes et peu explicites » (Hanusse, 1982). Nonobstant, malgré la richesse des informations textuelles, il ne faut pas oublier qu�une multitude d�outils ont pu être jugés comme anodins. Cette panoplie d�objets non-inventoriés peut être
10
composée par exemple de maints petits outillages en bois qui étaient probablement bricolés et non pas des objets manufacturés, sans valeur réelle, cela malgré leur importance, leur utilité et leur ingéniosité. Les outils qui eux sont présents dans les sources écrites sont au nombre de neuf. Cependant, il est nécessaire de préciser que « le mot outil est entendu ici dans un sens plus large que la définition normalement admise : ce sont tous les objets utilisés activement ou non par les potiers et énumérés dans les ateliers » (Hanusse, 1982). Puisque ce lieu, l�atelier, était un endroit bien distinct dans les habitations, il est par conséquent bien distinct dans les textes. Il nous est donc possible d�isoler le mobilier et les outils qui s�y trouvent en s�assurant de leur utilisation effective par les potiers. Voyons maintenant ces outils de potiers et leurs fonctions. Les premiers intègrent les phases de préparation de l�argile. Ainsi, les textes répertorient le banchet à battre terre ou banchau fait de bois ou de fer et rencontré sous diverses tailles. C�est en fait un battoir qui servait à enlever toutes les pierres qui pourraient nuire à l�homogénéité de l�argile. Dépendamment des savoir-faire ou des techniques mis en �uvre, le potier pouvait tout aussi bien marcher la terre argileuse et la battre au battoir long, ou bien la marcher et ensuite l�étendre sur une table et la battre avec un outil court. Comme la forme exacte des outils présents à Sadirac est inconnue, nous devons imaginer qu�une des deux méthodes ou peut-être même les deux étaient pratiquées. Après le battage, l�argile ainsi nettoyée était mise au meuil. C�est en fait la pelle à meuil en fer qui est présente dans les données archivistiques et atteste de cette sorte de fosse de petite dimension servant au trempage de l�argile, où la matière était retournée maintes fois à l�aide de la pelle. Le meuil en lui-même a pu être un objet de type bassine ou cuve lorsque présent dans l�atelier, comme l�atteste un inventaire de 1649 : parmi le mobilier de l�atelier, entre la roue à poterie et le battoir, un meuil1(Hanusse, 1982). Celui-ci a pu servir à travailler de petites quantités de terre pour la fabrication d�anses ou de décors, ou même servir l�hiver. L�étape suivante concerne le malaxage de l�argile. Elle intègre deux outils, un actif et un passif. Le premier est le coultre à battre terre. C�est une sorte d�instrument coupant qui permet de morceler la terre. Le deuxième, le bancq à hacher terre, assiste le coultre et sert de support lors de cette opération. Se présentant sous la forme d�un établi, on le nomme aujourd�hui pastourney. Ces deux outils, servant au malaxage de la terre argileuse, sont à présent remplacés par un broyeur électrique. Cependant, le pétrissage final se fait encore et toujours à la main. Concernant l�outillage pour le tournage des poteries, aucune description n�est disponible. On note néanmoins une différence de vocabulaire dans les textes notariés qui pourrait nous permettre d�imager ce dispositif tournant. En effet, le terme le plus récurant est roue à poterie, il s�oppose à celui de tour de potier. Nous avons probablement affaire à une différence morphologique : la roue à poterie « devait se composer d�une simple roue à rayons en bois lancée par un grand bâton tenu par le potier lui-même » (Hanusse, 1982). Ce type de roue assez rudimentaire est probablement l�outil du potier de terre et le tour de potier, celui du faïencier. Ceci s�atteste dans un acte notarié de 1752 où on fait référence à deux outils utilisés dans le même atelier, un tour à manivelle et l�autre à pied2. « Il s�agit d�un contrat de location passé par l�un des deux faïenciers ayant exercé dans la paroisse »
1 Inventaire des biens de Bernard Fau le 14 octobre 1649 (3E 10469, Archives départementales de la Gironde). 2 Location prise par Jean Lavergne, faïencier, le 10 novembre 1752 (3E 37334, Archives départementale de la Gironde).
11
de Sadirac au XVIIIe siècle (Hanusse, 1982). Ceci démontre également que cet outil servant au façonnage de l�argile était probablement le plus coûteux. Les outils du potier sont divers et intègrent plusieurs phases de la préparation et du façonnage de l�argile. Grâce à son savoir-faire, l�artisan réalise des pâtes propres à l�utilisation qui en sera faite, il tourne la terre et la façonne en des poteries, des formes et des plats soignés. Ceux-ci seront glaçurés par la suite, par esthétisme, utilité, ou simplement par habitude. Même si, contrairement aux gestes de préparation de l�argile, les procédés de fabrication des glaçures ne sont que sommairement décrits, les outils servant à la leur préparation apparaissent de façon systématique dans les textes notariés du XVIIIe siècle (Hanusse, 1982). Le premier consiste en une meule actionnée à la main. Celle-ci permet de broyer les différentes substances entrant dans la composition du mélange glaçurant. Avec un apport en eau, le broyage devient plus facile. Une pâte plus ou moins visqueuse était obtenue et s�écoulait probablement par une ouverture ou des petits trous pratiqués dans la partie inférieure de la meule. Différentes substances pouvaient entrer dans la composition du mélange glaçurant : sable, argiles, oxydes métalliques (plomb, cuivre, �), etc. Si le broyage à la meule permettait d�avoir un mélange de fine texture aidant à l�application, celle-ci avait surtout la fonction de meulle à moudre plomb. Elle était toujours accompagnée du rasclet à brûler plomb. Cet outil permettait de transformer le plomb et/ou d�autres métaux, ayant probablement la même utilité qu�un creuset selon l�auteure. On pouvait donc passer différents objets métalliques ou matières minérales au feu dans le but d�en changer la forme afin d�aboutir à différents oxydes. Les opérations de garnissage des poteries incluaient non seulement l�application de la glaçure par trempage ou saupoudrage, mais aussi la pose d�anses, de décors, etc. Ces gestes avaient lieu sur le bancq à garnir poterie de l�atelier3(Hanusse, 1982). Ce travail d�archives réalisé par Claire Hanusse (1982, 1988) nous a permis de prendre connaissance de l�outillage du potier, mais particulièrement de celui utilisé par les potiers sadiracais. L�outillage de base du potier de terre à Sadirac semble perdurer sur au moins quatre siècles si on se fie aux sources écrites, aux données ethnologiques (Bordelais, 1984 ; Fescia-Bordelais, 1985) et aux descriptions faites au XVIIIe siècle. Il va de soi que chaque artisan ne devait probablement pas posséder la totalité de ces objets. Comme nous l�avons vu, certains de ces outils étaient parfois loués et peut-être empruntés. En cas de sous-équipement, il était obligatoire de trouver des solutions de remplacement. De la même manière, les potiers partageaient les fours (Hanusse, 1982, 1988) et s�entraidaient probablement pour une multitude de travaux en liens avec leur profession (collecte de l�argile, abatage du combustible ligneux, etc.).
3 Inventaire des biens de Bernard Siron les 17 et 19 octobre 1733 (3E 37315, Archives départementales de la Gironde).
12
1.2. Données�archéologiques�
À la fin des années 1970, un groupe de recherche de l�Université Bordeaux 3 entreprend des opérations archéologiques dans la commune de Sadirac sous la direction de Pierre Régaldo-Saint Blancard. Déjà attesté comme un centre potier ayant participé aux négoces transatlantiques par John Bosher (1983), Sadirac s�avère riche en témoins archéologiques. Les fouilles continueront jusqu�en 1985, menant à la publication de plusieurs articles et à la création d�un Musée, La Maisons de la Poterie de Sadirac. Dès lors, les multiples opérations archéologiques menées à Sadirac dévoileront un important centre potier. La commune répertorie maintenant au moins 22 zones décrétées à fort potentiel archéologique par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Carte 1) (Annexe 1). La plupart de ces zonages archéologiques sont en lien avec l�artisanat potier, totalisant 18 zonages, les autres étant relatifs à la présence de constructions du Moyen Âge, de type château ou église. Les archives bordelaises signalent les premiers potiers de Sadirac durant la période anglaise du XVe siècle. Cependant, les opérations archéologiques font remonter cet artisanat au XIIe siècle (Régaldo-Saint Blancard et al., 1986), et même jusqu�à l�Antiquité (Régaldo-Saint Blancard, 1988a). Des travaux portant sur les fours de potiers sadiracais ont permis de révéler des changements d�organisation sociale au sein de la commune à travers les siècles. En effet, la nature des fours et les liens avec les autres sphères de l�unité de production dégagent trois phases distinctes (Régaldo-Saint Blancard, 1982b, a ; Hanusse, 1985 ; Régaldo-Saint Blancard, 2000). Les premiers fours sont des fours villageois. Isolés de l�atelier de façonnage et souvent communautaires, ces fours reflètent une entente entre les artisans. Ceux-ci diffèrent des fours domestiques du XVIIIe siècle, qui, annexés à la maison tout comme l�atelier, sont souvent propriété de l�artisan. Malgré tout, ce type de four n�empêche pas les interactions entre potiers. Les artisans ne possédant pas de moyen de cuisson peuvent louer des parties de fournée, promettre une portion de leur production en échange d�un droit de cuire, etc. À ces périodes où la coopération est de mise, l�artisanat de la poterie implique grandement la famille nucléaire comme unité de production centrale (Musgrave, 1998). Bien entendu, ces deux précédents types de fours ne vont pas de pair avec une homogénéisation des productions. Il faudra attendre le deuxième quart du XIXe siècle pour voir apparaître des fours plus grands associés à des ateliers de production indépendants. Ainsi, vers 1830, l�activité de la poterie ne se pratique plus à l�intérieur de la sphère familiale, mais plutôt à la « fabrique ». La poterie ne se rapproche plus d�un artisanat qu�on pratique en parallèle de l�agriculture, mais plutôt d�un métier (Musgrave, 1998). Le terme « journalier » apparaît (Régaldo-Saint Blancard et al., 1986). Cette mutation de l�organisation sociale et professionnelle des potiers sadiracais s�observe en archéologie (Régaldo-Saint Blancard, 2000). Elle est visible non seulement dans la forme des fours et dans les liens entre les différentes sphères de la production (four, atelier, glaisière, etc.), mais aussi à travers les productions céramiques. En effet, une grande étude des formes et surtout des gestes potiers ont permis de révéler des changements dans les productions sadiracaises (Régaldo-Saint Blancard, 1988a). Ceux-ci sont probablement dus aux fluctuations de la situation économique et commerciale de la région (Chapelot, 1978 ; Bosher, 1983 ; Amouric, 1985 ; Chapelot, 1985 ; Gouger et Mathieu, 1988 ; Hanusse, 1988 ; Delsalle, 1993 ; Musgrave, 1998).
13
1. Maroc : château, Moyen Age· Époque moderne 2. Darrigaud : villa antique et ateliers de potiers d'Époque moderne 3. Le Ruzat : La Porterie : ateliers de potiers. Époque moderne 4. Bourry : moulin et tuilerie, Moyen Age 5. Fréchinet : atelier de potiers, habitat, Époque moderne 6. Michau : vestiges artisanaux (bas fourneaux et tullerie?) gallo-romains 7. Jean d'Arnaud, Landot : ateliers de potiers, Époque moderne 8. Menusey : ateliers de potiers, Époque moderne 9. Blayet : ateliers de potiers, Époque moderne 10. Bourg de Sadirac : église, cimetière et habitat, Moyen Age et Époque moderne 11. Piron : ateliers de potiers, Époque moderne 12. Le Casse, Les Merles : ateliers de potiers, faïencerie, Époque moderne
13. Calamiac : ateliers de potiers, Époque moderne 14. Tustal : château, Moyen Age· Époque moderne 15. Sanslne, Minguet, Boutin : tuileries et ateliers de potiers, Époque moderne - Époque contemporaine 16. Bel-air (Le Bols Troué) : atelier de potiers, vestiges d'extraction, Époque moderne 17. Poupat : atelier de potiers, Époque moderne 18. Le Grand Verdus : château, Époque moderne 19. Sableyre, Siron : quartier de potiers, Moyen Age· Époque moderne 20. Pelisse, Le Petit-Verdus : quartier de potiers, Époque moderne 21. Lorient, Laurent-Videau, Farizeau : ateliers de potiers, chapelle non localisée, Époque moderne 22. Tioulet, Les Faures : ateliers de potiers, Époque moderne
Carte 1 : Carte des zonages archéologiques décrétés sous Arrêté par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (ARRÊTÉ N° AZ.07.33.14, Préfecture de la Gironde, Aquitaine).
14
Ces périodes de mutations importantes sont intercalées de périodes dites stables, marquant la production sadiracaise du XIVe au XIXe siècle en quatre grandes phases (Régaldo-Saint Blancard, 1988a). La première période est caractérisée par une évolution lente. Elle intègre la seconde moitié du XIVe siècle et le XVe siècle. C�est à cette époque que Sadirac s�impose progressivement comme centre potier important et acquiert le quasi-monopole des productions céramiques dans la région bordelaise. On y voit apparaître la glaçure, même si elle ne forme souvent qu�un décor très simple. Une mutation survient lors de la première moitié du XVIe siècle, voire même à l�extrême fin du XVe siècle dans certains secteurs plus précoces. Par la suite, une certaine stabilité s�installe du XVIIe jusqu�à la première moitié du XIXe siècle. On observe une panoplie de formes due à une évolution qui se fait vers une variation et une multiplication des profils, au dépend des décors qui tendent à se simplifier. À cette période, la glaçure devient plus apparente : certaines formes sont souvent entièrement glaçurées, sans toutefois que l�application d�un mélange glaçurant ne soit systématique. De plus, on voit naître une forme d�art populaire relevant du contexte de la contre-réforme catholique : le bénitier de chevet. Cette poussée vers une religiosité domestique s�insère dans l�artisanat sadiracais. Certains potiers se mettent au moulage de ces petits objets et les produisent en série (Régaldo-Saint Blancard, 1988b). Vers les années 1830, des modifications s�opèrent à Sadirac : l�origine des productions n�est plus artisanale. Découlant du déclin général de la céramique au XIXe siècle, la production change pour offrir des formes plus « standardisées ». Ce même schéma semble s�observer dans toute la France où on tend à souligner l�uniformité des productions. Tout cela démontre bien que « ce qui compte par-dessus tout, c�est que la production céramique, par nature extrêmement malléable, s�adapte aux besoins. La profonde différence entre les panoplies médiévale et moderne, c�est une différence de besoins, une différence de civilisation » (Régaldo-Saint Blancard, 1988a). Les récentes fouilles archéologiques menées à Sadirac depuis les années 2000 ont été réalisées par l�Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), sous l�autorité de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d�Aquitaine (DRAC). Suite au décret de zonages archéologiques, l�Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) peut opérer des diagnostics archéologiques, et si nécessaire des fouilles, sur toutes les parcelles amenées à recevoir des aménagements affectant le sous-sol. Ces opérations ont non seulement permis d�agrandir le corpus de données sur Sadirac, mais aussi de mettre au jour des vestiges de périodes encore non-définies ou sous-représentées à Sadirac. Ainsi, les archéologues de l�INRAP travaillent de pair avec Pierre Régaldo pour faire avancer nos connaissances sur ce centre potier. Finalement, dans la région de Bordeaux, mais surtout dans cette grande ville portuaire, les poteries ont été grandement utilisées jusqu�au XIXe siècle. Ces poteries traversaient la Garonne, et se vendaient sur les berges. Les fouilles du site de Godefroy, situé sur le chantier de l�autoroute N230 traversant la plaine de Bouliac, ont révélé des phases d�occupation de la berge et deux petites embarcations datant d�environ 1680. Les céramiques recueillies aux abords de ces deux épaves sont typiques d�une période s�inscrivant entre le XVIIe et le XIXe siècle. Les fouilles ont donc permis de restituer le passé de cette berge et de ces épaves, mais aussi de mieux comprendre les aménagements des berges garonnaises qui étaient, à cette époque, sous une probable autorité du Port de Bordeaux (Bizot et al., 1991).
15
1.3. Économie�portuaire�et�poterie�
Le port de Bordeaux devenant l�un des ports français les plus achalandés aux XVIIe et XVIIIe siècles, plusieurs navires, mais aussi des nombreuses petites embarcations y jettent l�ancre. Le commerce s�étend dorénavant jusqu�aux colonies françaises outre-Atlantique, sans toutefois délaisser les nations européennes. Accompagnées de divers et nombreux produits, les céramiques bordelaises intégrèrent différents marchés de distribution via le négoce portuaire de Bordeaux.
Les�échanges�
Les terres cuites étaient principalement produites par des artisans de l�arrière-pays bordelais dont Sadirac fait partie. Elles étaient destinées à la consommation domestique quotidienne et au transport de marchandises alimentaires ou non. Le commerce régional ou local traditionnel garantissait un approvisionnement aux communes des alentours et des villes à proximité (Hanusse, 1988). Pour acheminer les poteries, on avait recourt au transport terrestre et mettait ensuite à profit les voies fluviales, surtout grâce à la fonctionnalité de l�axe garonnais. Selon Huetz de Lemps (1975), les productions bordelaises ont permis la naissance d�un cabotage maritime très actif. En effet durant l�année 1699, plus de cent caboteurs ont des tuiles et des poteries dans leurs cargaisons. On évalue le trafic à plus de 16 000 poteries par an acheminées ainsi jusqu�à destination de la région d�Aunis et de la Saintonge. Les poteries bordelaises auraient même été expédiées jusqu�en Bretagne et au pays Basque. On les chargeait en période creuse de l�activité portuaire, soit l�été. On explique ces distributions extrarégionales à leur emploi comme fret de retour pour les barques venues apporter du sel ou du poisson séché à Bordeaux. Même si ce type de commerce nous semble modeste, il reste néanmoins actif sur une longue période. En effet, même en temps de guerre, les transports des poteries bordelaises ne cessent pas. Cela probablement puisque leur principale fonction est celle de récipient pour les productions de sel de l�Île d�Yeu, d�Oléron, de Ré, etc., ou de moule ou pot pour la production sucrière de la région bordelaise (Huetz de Lemps, 1975 ; Régaldo-Saint Blancard et al., 1986). Le commerce local ou régional des céramiques bordelaises semble donc répondre aux demandes quotidiennes des foyers, mais aussi aux exigences des industries bordelaises et de l�économie portuaire. Les potiers s�affaireront donc à la production de formes communes et domestiques, mais devront se spécialiser dans diverses productions au fil des siècles, allant des formes pour la production sucrière jusqu�aux récipients de toutes sortes pour le transport. Les céramiques bordelaises ont aussi intégré des réseaux d�échanges à longue distance, dont le commerce colonial. En effet, les expéditions vers les Îles de l�Amérique ou la Nouvelle-France sont diverses, mais ne représenteront qu�une minorité des 3000 sorties de navires enregistrées dans les années les plus prospères4. D�innombrables marchandises, dont beaucoup sont des produits manufacturés, transitent vers les colonies. Ceci n�est pas un hasard, mais souligne le cadre classique du Pacte Colonial5. En effet, la dépendance commerciale des colonies à l�égard de la métropole est délibérée. On observe un type
4 Le commerce portuaire en Gironde est prospère des années 1680 jusqu�au déclanchement de la Guerre de la ligue d�Augsbourg (1688). Par la suite, on observe une reprise du négoce jusqu�au commencement de la Guerre de Succession d�Espagne (1701). Finalement, la prospérité reprend dans les années 1720 à 1750. 5 Aussi appelé l�Exclusif.
16
de « conception mercantiliste de la colonisation qui visait à l'enrichissement de la métropole. Il stipulait : l'interdiction totale ou partielle du marché colonial aux produits étrangers ; l'obligation d'exporter les produits coloniaux exclusivement ou principalement vers la métropole ; l'interdiction, par la colonie, de produire des objets manufacturés, son rôle économique se bornant à celui de productrice de matières premières et de débouché commercial ; le traitement de faveur accordé par la métropole aux produits coloniaux, accompagné d'une aide politique, militaire, culturelle et souvent économique, fournie par la métropole »6. Ainsi, en étudiant la cargaison des navires partant pour les Îles et la Nouvelle-France, on constate une très grande diversité de marchandises (Dagneau, 2009). Certaines sont des faïences embarquées à Bordeaux, de la vaisselle de terre, des pots de terre et de la porcelaine7. D�autres formes sont les pots et moules sadiracais pour la production sucrière (Huetz de Lemps, 1975 ; Delsalle, 1993). Les productions céramiques de la région bordelaise ont donc intégré non seulement les marchés locaux et régionaux, mais aussi le marché colonial. L�écoulement des poteries françaises vers le marché colonial présente deux éléments : le lieu de production et le lieu de consommation. La nature du lien qui joint ces deux lieux s�explique de différentes façons selon les auteurs. Cependant, deux types d�explication ressortent. Premièrement, la nature du lien entre le lieu de production et celui de consommation peut être de nature sociale. Dans ce cas, l�attachement à une région ou à un lieu géographique, des valeurs personnelles ou identitaires sont à mettre en avant (Bosher, 1983 ; Amouric, 1985 ; Gouger et Mathieu, 1988 ; Loewen, 2004). Dans cet ordre d�idées, au milieu du XVIIe siècle en Amérique du Nord et dans les Caraïbes, les colons exigent la commande d�items qu�ils utilisaient à la maison. En plus de leur rappeler leurs habitudes, ces objets apparaissent comme exotiques comparés à ceux qui commencent à être fabriqués sur place. Les biens d�exportation concernent donc les articles de luxe de toutes sortes, mais aussi les biens ordinaires (Musgrave, 1998). Deuxièmement, d�autres auteurs attribut au lien entre lieu de production et lieu de consommation une origine strictement économique. De ce fait, les études de provenance et de circulation des biens seraient strictement le reflet des réseaux commerciaux de l�époque colonial (Chapelot, 1978, 1985 ; Molho et Ramada Curto, 2003). Cependant, il est plus que probable que ces deux aspects de la nature du lien entre centre de production et lieu de consommation soient à mettre en cause.
1.4. Données�archéométriques�
Comme nous l�avons vu, les poteries de Sadirac ont probablement traversé l�Atlantique pour se rendre jusque dans les colonies françaises d�Amérique. Bien que les archives semblent témoigner de ce commerce suprarégional, la certitude des origines sadiracaises de certaines poteries glaçurées du Nouveau Monde n�en est pas attestée. Comme « les terres cuites jouent un rôle fondamental en archéologie historique de la période coloniale française dans la reconstruction et la compréhension des liens géographiques transatlantiques » (Monette et al., 2010), les archéologues cherchent à rattacher les lieux de consommation avec ceux de fabrication (Loewen, 2004).
6 Définition de pacte colonial selon l�Encyclopédie contributive Larousse en ligne. 7 Respectivement plus de 3000 unités, 600 unités, 1400 unités et 15 unités en 1717 (selon les documents de congé des navires de cette année-là).
17
Les méthodes centrales de l�archéologie comme la comparaison visuelle à des typologies et à des formes connues nous apportent des informations majeures. En effet, les attributs qui sont communément considérés se basent sur les techniques, la mise en forme, le style de glaçure� et incluent l�épaisseur de la terre cuite, sa couleur, sa densité, ses inclusions, sa dureté, � (Rice, 1987). Suite à des collaborations de part et d�autre de l�Atlantique concernant une emphase s�articulant autours du rôle des villes portuaires françaises, les archéologues ont pu rapprocher des céramiques trouvées en contexte colonial aux céramiques de Sadirac (Chapelot, 1978 ; Loewen, 2004 ; Dagneau, 2009). Cependant, la question de provenance de ce type céramique appelé « vert de France » suscite plusieurs hypothèses dont celle d�une provenance saintongeaise. Dans le but d�évaluer une provenance précise exempte de toute ambigüité stylistique, des chercheurs ont choisi des procéder à des comparaisons géochimiques de ces terres cuites (Monette et al., 2010). Ainsi, des échantillons coloniaux, des échantillons saintongeais et des échantillons de Sadirac ont été analysés par spectrométrie d�émission atomique à source plasma (ICP-AES) et par spectrométrie de masse à source plasma (ICP-MS) dans le but :
a. De vérifier l�homogénéité chimique interne du type « vert de France » d�un site colonial (l�îlot Du Palais) ;
b. De vérifier si ces compositions correspondent aux poteries de la Saintonge ; c. Et finalement, de vérifier si la composition chimique du type « vert de France » correspond
aux poteries sadiracaises.
Cette étude préliminaire n�a cependant pu révéler une origine précise du type « vert de France ». En effet, les différences chimiques observées à l�intérieur même de ce corpus peuvent renvoyer à des ateliers différents, autant qu�à des centres potiers différents. De ce fait, il devient difficile d�utiliser ce groupe hétérogène pour effectuer les comparaisons. Les auteurs précisent qu�un plus grand échantillonnage permettrait d�avancer sur la question. Cependant, il a été possible d�exclure l�hypothèse d�une provenance saintongeaise. Même si les compositions des pâtes céramiques de Sadirac se rapprochent du type « vert de France », les tests statiques confirment une différence significative entre les deux ensembles. Il est donc impossible jusqu�à ce jour d�appuyer une hypothèse de provenance pour ces céramiques. Les auteurs n�écartent cependant pas l�hypothèse d�une provenance sadiracaise de leurs céramiques. Ils proposent d�effectuer un échantillonnage plus exhaustif et circonscrit selon les périodes, les formes et les nombreux ateliers situés dans la commune de Sadirac pour définitivement infirmer ou confirmer cette hypothèse (Monette et al., 2010).
18
2. Objectifs�de�l�étude�
Compte tenu des connaissances que nous avons sur les poteries de Sadirac, nous avons décidé de nous orienter vers l�étude des glaçures de ces céramiques, sujet qui n�a fait l�objet d�aucune étude importante jusqu�à ce jour.
2.1. Qu�est-ce�qu�une�glaçure�?�
La glaçure est un type de verre. Elle est formée d�une substance amorphe qui résulta de la fusion et du refroidissement rapide de minéraux et d�oxydes à la surface d�une céramique. La glaçure est esthétique et fonctionnelle. Elle permet non seulement de colorer une céramique, mais elle apporte aussi imperméabilité et résistance mécanique à son support. Certaines glaçures sont transparentes tandis que d�autres sont opaques, prêtes à recevoir un décor. Les mélanges glaçurants peuvent être apposés à l�état solide (poudre) ou liquide à la surface d�une forme avant cuisson, ou sur le « biscuit » (Tite et al., 1998). Ces différents procédés ont leurs avantages et inconvénients, reste au potier à choisir son mode opératoire. Les mélanges glaçurants pouvant varier énormément d�un potier à l�autre, d�une technique à une autre ou d�une région à une autre, nous pouvons parler de recettes différentes. Cependant, les glaçures intègrent dans leur recette : des éléments formateurs (Si), des éléments modificateurs (Pb, Na, K, Ca, Mg) et des chromogènes (Cu, Fe, Mn, Co,�) (Rice, 1987).
Figure 1 : Sommaires des principales méthodes de production d�une glaçure plombifère (Tite et al., 1998).
19
2.2. Les�objectifs�de�l�étude�des�glaçures�de�Sadirac�
L�étude des glaçures peut nous apporter des informations sur le travail des potiers, leurs techniques et savoir-faire, mais aussi sur l�organisation sociale et professionnelle de cet artisanat. En effet, la glaçure est constituée de matières premières qui sont parfois dispendieuses et inaccessibles localement, contrairement aux argiles. D�ailleurs, ces matières premières, comme les oxydes métalliques et le plomb, ne sont souvent accessibles que par l�intermédiaire d�un marchand. Ainsi, l�étude des glaçures permet non seulement de restituer une chaîne opératoire d�un matériau notable comme la céramique glaçurée, mais aussi de comprendre les relations économiques et l�organisation sociale qu�implique l�artisanat potier. De ce fait, les objectifs de cette première étude des glaçures de Sadirac du XIVe au XIXe siècle seront doubles. Nous effectuerons une première approche des recettes de glaçure à Sadirac dans le but de comprendre les matières premières intégrées dans les mélanges glaçurant, les techniques de fabrication mises en �uvre et ainsi, tenter de remonter à la chaîne opératoire des glaçures des ateliers sadiracais à l�aide des compostions chimiques de celles-ci. Cette première partie permettra aussi de vérifier certaines hypothèses formulées par Pierre Régaldo-Saint Blancard lors de réunions de travail concernant les recettes de glaçure à Sadirac :
· Les potiers utilisaient probablement l�argile comme source principale de silicium ;
· Le cuivre est l�élément chromogène majoritairement utilisé.
La deuxième partie concernera l�étude des variations spatio-temporelles des glaçures. En effet, les céramiques de Sadirac témoignent de profonds changements à certaines périodes qui sont probablement de nature économique et sociale. De plus, la commune de Sadirac ayant accueilli de nombreux ateliers de potiers, ces artisans peuvent avoir eu recours à des savoir-faire distincts et des matières premières différentes. Dans cette perspective, les glaçures peuvent avoir suivi les mêmes mutations, ayant pour conséquences des variations de compositions chimiques. Ainsi, dans le cadre de cette étude nous allons analyser des échantillons de céramiques glaçurées provenant d�ateliers sadiracais datant du XIVe au XIXe siècle. Ceux-ci seront divisés en quatre périodes. Ces quatre périodes découlent des mutations observées à Sadirac. De ce fait, la première période concerne le XIVe siècle et le début du XVe ; La deuxième période inclue la fin du XVe siècle jusqu�au début du XVIIe siècle, le XVIe siècle étant une période d�intenses changements à Sadirac ; La troisième période implique la fin du XVIIe et le XVIIIe siècle ; Finalement le XIXe siècle est à part dans le but d�observer une possible transition vers la mutation des années 1830.
�
22
3. Présentation�du�matériel�étudié�
Sadirac est connu comme un centre potier majeur. Les fouilles archéologiques qui y sont menées depuis plus de trente ans et les récentes opérations d�archéologie préventive ont permis de faire remonter la présence de potiers dès l�Antiquité à Sadirac. L�artisanat de la poterie dans cette commune n�est pas fortuit. En effet, les sols contiennent des terres argileuses de grande qualité, tant recherchées par les potiers. Ce contexte particulier présente deux formations géologiques souvent difficiles à discerner du aux fortes altérations locales des horizons argileux. La Formation de Brach date de la période du Pléistocène, mais plus précisément du terme supérieur de la Formation de Belin. Elle se caractérise par des sols à faciès argileux gris bleu à gris noir, présentant des marbrures ocre lorsqu�elle est peu altérée. Cette formation est un témoin des anciennes nappes alluviales du Pléistocène. Les dépôts de la formation de Brach sont souvent sous forme de lentilles de sables argileux et d�argiles silteuses plastiques dont la teneur en argile peut atteindre entre 70 et 90 %. Ils sont essentiellement composés de kaolinite (30 à 80 %) associée à de l�illite et à des interstratifiés Illite/Smectite (10 à 20 %) (Platel et Spencer, 2001 ; Chrétien, 2010 ; Corbier et Pust, 2010) (voir Carte BRGM - Annexe 2). Le matériel échantillonné dans le cadre de cette étude provient de différents sites potiers de la commune de Sadirac. Certains de ces sites ont fait l�objet de fouilles programmées, tandis que d�autres sont des découvertes faites lors de diagnostics effectués par l�INRAP. Ces sites sont représentés sur les cartes suivantes ( Carte 2) selon la légende suivante.
1. Sadirac 2. Fréchinet 3. Jean d�Arnaud 4. Le Casse
5. Siron-Sableyre 6. Lorient-LaVie 7. Laurent Videau 8. Tioulet
Tous les échantillons provenant de diagnostics archéologiques nous ont été confiés par l�INRAP de Pessac, tandis que les autres sont sortis des réserves du musée de la Maison de la Poterie de Sadirac. Le corpus étudié comporte un total de soixante-et-un échantillons de terres cuites glaçurées. Ces échantillons ont été choisis pour la couleur verte de leur glaçure, conformément à notre problématique. Chaque pièce devait impérativement s�inscrire dans la période d�étude (XIVe au XIXe siècle), être rattachée à une chrono-typologie (directement ou indirectement) et préférablement provenir d�un contexte archéologique bien défini.
23
Les échantillons de la Maison de la Poterie de Sadirac Carte 2 : Détail de la Carte de Cassini
Carte 3 : Limites communales de Sadirac
24
3.1 Les�échantillons�de�la�Maison�de�la�Poterie�de�Sadirac�
Des soixante-et-un échantillons étudiés, seize de ceux-ci nous furent confiés par le Musée de la Poterie de Sadirac, représentés dans le Tableau 1. Les échantillons présentent tous une forme plus ou moins complète, ce qui facilite leur association à une chrono-typologie. De ce fait, nous avons pu réaliser des profils pour chacune des formes. Les formes représentées sont des écuelles, des pots, des assiettes plates, une jatte, � (DAO Annexe 4). Les échantillons proviennent tous de fouilles archéologiques réparties sur cinq lieux-dits différents, sauf un qui est un ramassage de surface dont le site est indéterminé.
Sableyre�
Ce lieu-dit, situé sur un plateau, présente un terrain plus sablonneux qu�argileux, caractéristique ayant assurément un lien avec son toponyme Sableyre. Douze à quinze ateliers de potiers s�y sont rassemblés il y a de cela quelques siècles, cinq ont été fouillés à ce jour, dont un intégralement. Du fait de cette concentration d�unités de production, Sableyre peut être caractérisé d�ancien « quartier potier ». Plusieurs puits d�extraction d�argile, des fosses d�entreposage, des fosses comblées de rebuts de cuissons, des structures de cuisson et des traces de bâtiments s�observent dans ses sols. Les poteries tournées à Sableyre accusent d�une profonde mutation au XVIe siècle. La qualité des productions semble s�appauvrir au profit d�une production en série, plus rentable. Les formes de ce « lotissement » artisanal changeront beaucoup, s�adaptant à la demande, mais aussi aux concurrences locales (Régaldo-Saint Blancard, 1985, 1988b, 2000). Deux échantillons étudiés proviennent des secteurs A et C de Sableyre, fouillés par Pierre Régaldo. Le premier, BDX 15725, est un fond de marmite basse à fond rond. Le deuxième, BDX 15730 provenant du secteur C, est une jatte.
Siron�
En marge du « quartier potier » de Sableyre se trouve le village de Siron. Il fut le siège d�une activité potière régulière du XVIe au XIXe siècle. De nombreuses structures en creux y attestent l�extraction des terres argileuses (Régaldo-Saint Blancard, 1992). Neuf échantillons de notre corpus sont originaires de ce site : BDX 15731, BDX 15735 à 15737 et BDX 15741 à 15745. Ce sont des céramiques pour la cuisson des aliments ou de la vaisselle individuelle comme des pots, assiettes, bord de lèchefrite, poignée d�une jatte et tessons d�écuelles à oreilles.
Fréchinet�
Contrairement à ce qui se passa à Sableyre, Fréchinet montre une phase de dispersion des unités potières dans la commune de Sadirac qui s�opère entre le Moyen Âge et l�Époque moderne (Régaldo-Saint Blancard, 1985, 1988a). En effet, en ce lieu reclus on pratiquait aussi l�artisanat de la poterie. Deux fours, un plus ancien que l�autre, ont probablement fonctionné simultanément. Cependant, ce lieu ne donnant pas accès à l�argile essentielle pour la production, l�extraction se faisait probablement ailleurs, hors du site (Régaldo-Saint Blancard, 2000). On devait acheminer les terres argileuses jusqu�à l�atelier, labeur qui devait être contraignant. Les deux échantillons provenant de Fréchinet sont en fait une écuelle à oreilles et une assiette, respectivement BDX 15732 et 15733.
25
Jean-d�Arnaud,�Château�Pabus �
Les fouilles effectuées au Château Pabus au lieu-dit Jean-d�Arnaud ont permis de mettre au jour les vestiges d�un four de potier et de plusieurs ensembles de fosses (Régaldo-Saint Blancard, 2000). L�échantillon provenant de ce site, BDX 15734, est une forme particulièrement intéressante. En effet, cet échantillon est un réchaud de table quasiment complet.
Le�Casse�
Le site de Le Casse a lui aussi révélé un four bien préservé et des fosses (Régaldo-Saint Blancard, 1982b, a). L�échantillon BDX 15728 est une écuelle à anses découverte lors des fouilles opérées à ce lieu-dit.
Tableau 1 : Tableau récapitulatif des échantillons confiés par le Musée de la Poterie de Sadirac
�3.2 Les�échantillons�de�l�INRAP�
En plus des seize échantillons provenant du Musée de la Poterie de Sadirac, quarante-cinq autres échantillons viennent compléter le corpus. Ceux-ci nous ont été confiés par l�INRAP de Pessac. Ils proviennent de trois diagnostics différents effectués à Sadirac : un mené au lieu-dit Laurent Videau, un autre à Tioulet et un dernier à Lorient.
Réf. CRP2A
Réf. Maison
de la Poterie
de Sadirac N° fouille Site Description Datation
BDX15725 19 SAD-86-SBA-1 Sableyre secteur A Marmite basse à fond rond 14e-15e
BDX15727 323 nd Ramassage de surface Petit pot à anse 14e-15e
BDX15728 281 SAD-19-266 Le Casse Ecuelle à anses 17e-18e
BDX15730 223 SAD-84-SBC-52 Sableyre secteur C Gardale/Jatte 16e-17e
BDX15731 nd nd Siron Pot 1er ¼ du 19e
BDX15732 102 SAD-FC-10 Fréchinet Ecuelle à oreilles 16e-17e
BDX15733 100 SAD-FC-140 Fréchinet Assiette 16e-17e
BDX15734 ND SAD-09-JAPB-16 Jean d'Arnaud, Château Pabus Réchaud de table 17e-18e
BDX15735 ND SAD-09-SR-254 Siron Pot 1er ¼ du 19e
BDX15736 ND SAD-09-SR-255 Siron Pot 1er ¼ du 19e
BDX15737 ND SAD-09-SR-243 Siron Assiette 17e-18e
BDX15741 ND SAD-09-SR-65 Siron Lèchefrite (bord) 1er ¼ du 19e
BDX15742 ND SAD-09-SR-240 Siron Jatte (poignée) 1er ¼ du 19e
BDX15743 ND SAD-09-SR-80 Siron Ecuelle à oreilles 17e-18e
BDX15744 ND SAD-09-SR-72 Siron Ecuelle à oreilles 17e-18e
BDX15745 ND SAD-09-SR-74 Siron Ecuelle à oreilles 17e-18e
26
Les fouilles menées sur des parcelles en voie d�aménagement ont permis de réaliser des diagnostics donnant lieu à la reconnaissance de la présence d�éléments du patrimoine archéologique. Le matériel archéologique étudié ici a été sélectionné selon trois critères. Premièrement, la céramique doit présenter une glaçure verte. Deuxièmement, le contexte doit être bien défini et le matériel doit y être daté par associations typo-chronologiques. Finalement, les échantillons sélectionnés seront des tessons individuels. Ainsi, ce dernier critère permet de travailler sur des objets qui sont souvent disponibles à profusion sur les sites, sans toutefois condamner certaines pièces qui pourraient être importantes dans la datation d�une structure ou autre. Cependant, tous ces tessons ont pu être datés indirectement par des formes caractéristiques situées dans la même structure (st) ou la même unité stratigraphique (US).
Laurent�Videau,�Route�de�Lorient�
Les fouilles menées à Laurent Videau par Nadine Béague à l�automne 2010 comprennent cinq sondages qui ont révélé un total de 29 structures. La plupart de celles-ci sont des fosses et des aménagements en creux qui ont pu avoir diverses utilités : drains, fosses d�extraction de l�argile, comblements de débris, rebuts de cuisson, etc. Les échantillons étudiés ici proviennent des structures 2, 3 et 15 (Figure 2). De nombreuses fosses témoignent d�une activité intensive d�extraction de l�argile. L�argile bleue si convoitée par les potiers de Sadirac restant encore à certains endroits sous la forme de bourrelets, on pense à la logistique de creusement et à la prévention d�éboulement. De pair avec cette activité d�extraction, nous rencontrons une activité potière. Les nombreux rejets de céramiques servent à combler les fosses d�extraction. Ces rebuts de cuisson, tessons de céramique et poteries quasi-complètes datent tous des XVIIe et XVIIIe siècles suivant la typo-chronologie des formes rencontrées (Béague, novembre 2010). Onze échantillons proviennent de Laurent Videau (Tableau 2), certains manque de description. Ce sont en fait des fragments de céramique non corrélés à une typologie, tandis que seulement cinq présentent des formes caractéristiques comme un bord d�assiette, une pointe de réchaud, etc.
Tableau 2: Échantillons provenant de Laurent Videau
Réf. CRP2A N° OA
Responsable
d'opération
N°
inventaire Site Description Datation
BDX15726 25731 2010 N. Beague 1.2.1 Sadirac Laurent Videau st 2 Assiette (bord) 17e-18e
BDX15729 25731 2010 N. Beague 1.2.1 Sadirac Laurent Videau st 2 Réchaud (pointe) 17e-18e
BDX15738 25731 2010 N. Beague 1.3.30 Sadirac Laurent Videau st 3 Assiette (bord) 17e
BDX15739 25731 2010 N. Beague 1.3.30 Sadirac Laurent Videau st 3 Fond 17e
BDX15740 25731 2010 N. Beague 1.3.30 Sadirac Laurent Videau st 3 Fond 17e
BDX15990 25731 2010 N. Beague 2.15.01 Sadirac Laurent Videau st 15 nd 17e
BDX15991 25731 2010 N. Beague 2.15.01 Sadirac Laurent Videau st 15 nd 17e
BDX15992 25731 2010 N. Beague 2.15.01 Sadirac Laurent Videau st 15 nd 17e
BDX15993 25731 2010 N. Beague 2.15.01 Sadirac Laurent Videau st 15 nd 17e
BDX15994 25731 2010 N. Beague 2.15.01 Sadirac Laurent Videau st 15 nd 17e
BDX15995 25731 2010 N. Beague 2.15.01 Sadirac Laurent Videau st 15 nd 17e
28
Tioulet�
L�opération de diagnostic archéologique menée au lieu-dit Tioulet en mai 2012 par Vanessa Elizagoyen a permis de suggérer trois phases d�occupation distinctes, dont une est en association avec un four de potier. Un seul échantillon vient de la structure 1001. Celle-ci est une fosse qui n�a pu être fouillée intégralement, mais elle présenterait une forme plutôt quadrangulaire. Son comblement est fait de limon argileux comprenant de petits charbons, de petits cailloux chauffés et de nombreux tessons de céramique. Quatre échantillons sont issus de la structure 2002 qui présente une grande quantité de céramique de la fin du XVe siècle. Cette structure résulterait de l�épandage d�un lot de céramiques. Conséquemment, sa profondeur est faible mais sa dispersion est grande. Dix autres échantillons nous proviennent de la structure 6003. C�est en fait une fosse circulaire présentant un comblement de limon argileux, une grande quantité de céramique, quelques restes de faunes, des scories de fer et des fragments de paroi rubéfiée. Ceci démontre bien l�étroite connexion entre l�habitat et l�activité potière à Sadirac vers la fin du Moyen Âge (Elizagoyen, 2012). Ce diagnostic archéologique mené à Tioulet ne révèle donc pas de puits d�extraction de l�argile, mais plutôt de l�artisanat potier et des activités domestiques. Les quinze échantillons issus du diagnostic effectué à Tioulet sont tous représentés dans le Tableau 3. Aucun de ceux-ci ne présente de description puisque ce sont tous de petits fragments de poterie non corrélés à une typologie. Toutes les photos des échantillons sont visibles dans la Figure 3.
Tableau 3 : Échantillons provenant de Tioulet
Réf. CRP2A N° OA
Responsable
d'opération
N°
inventaire Site Description Datation
BDX15996 26073 2012 V. Elizagoyen 3.00.01 Sadirac Tioulet st 6003 nd 1er ¼ du 14e
BDX15998 26073 2012 V. Elizagoyen 3.00.01 Sadirac Tioulet st 6003 nd 1er ¼ du 14e
BDX15999 26073 2012 V. Elizagoyen 3.00.01 Sadirac Tioulet st 6003 nd 1er ¼ du 14e
BDX16000 26073 2012 V. Elizagoyen 3.00.01 Sadirac Tioulet st 6003 nd 1er ¼ du 14e
BDX16001 26073 2012 V. Elizagoyen 3.00.01 Sadirac Tioulet st 6003 nd 1er ¼ du 14e
BDX16003 26073 2012 V. Elizagoyen 3.00.01 Sadirac Tioulet st 6003 nd 1er ¼ du 14e
BDX16005 26073 2012 V. Elizagoyen 3.00.01 Sadirac Tioulet st 6003 nd 1er ¼ du 14e
BDX16006 26073 2012 V. Elizagoyen 1.00.1 Sadirac Tioulet st 1001 nd 15e-16e
BDX16007 26073 2012 V. Elizagoyen 1.00.8 Sadirac Tioulet st 2002 nd fin 15e
BDX16008 26073 2012 V. Elizagoyen 1.00.8 Sadirac Tioulet st 2002 nd fin 15e
BDX16009 26073 2012 V. Elizagoyen 1.00.8 Sadirac Tioulet st 2002 nd fin 15e
BDX16010 26073 2012 V. Elizagoyen 1.00.8 Sadirac Tioulet st 2002 nd fin 15e
29
Figure 3 : Échantillons de Tioulet.
Lorient,�aménagement�LaVie�
Ce diagnostic archéologique a été mené en 2013 par Bertrand Ducournau suite à un projet de construction d�une maison individuelle dans le hameau de Lorient à Sadirac. Les fouilles ont révélé plusieurs structures fossoyées comblées de rejets de céramique et de fragments d�argile rubéfiée. Ce dernier point pourrait éventuellement marquer la présence d�un four de potier à proximité. Les échantillons étudiés ici proviennent en partie de la structure 1. Cette structure d�environ 1,50 m de profondeur apparait comme une fosse d�extraction de l�argile remblayée de rebuts de cuissons. La structure 3 quant à elle nous a fourni d�autres échantillons. Cette structure était aussi probablement une fosse d�extraction d�argile. Son comblement est fait de plusieurs céramiques typiques des XVIIe et XVIIIe siècles. De plus, le fond de cette structure était couvert de fragments d�argile rubéfiée (Ducournau, mars 2013). Le reste des échantillons étudiés provient d�une structure non définie, mais comprise dans l�US 1001 du sondage 1, située au dessus de la structure 1. Ainsi, dix-neuf tessons sont issus des fouilles du diagnostic de l�aménagement LaVie à Lorient (Figure 4), ils sont tous présentés dans le Tableau 4, sans description de leur forme puisqu�ils ne sont pas corrélés à des typologies.
30
Tableau 4 : Échantillons provenant de Lorient, aménagement LaVie
Réf. CRP2A N° OA
Responsable
d'opération
N°
inventaire Site Description Datation
BDX16011 26212 2013 B. Ducournau 2.00.03 Sadirac Lorient LaVie st 3 nd 17e-18e
BDX16012 26212 2013 B. Ducournau 2.00.03 Sadirac Lorient LaVie st 3 nd 17e-18e
BDX16013 26212 2013 B. Ducournau 2.00.03 Sadirac Lorient LaVie st 3 nd 17e-18e
BDX16014 26212 2013 B. Ducournau 2.00.03 Sadirac Lorient LaVie st 3 nd 17e-18e
BDX16015 26212 2013 B. Ducournau 3.00.06 Sadirac Lorient LaVie st 3 nd 17e-18e
BDX16016 26212 2013 B. Ducournau 3.00.06 Sadirac Lorient LaVie st 3 nd 17e-18e
BDX16017 26212 2013 B. Ducournau 3.00.06 Sadirac Lorient LaVie st 3 nd 17e-18e
BDX16018 26212 2013 B. Ducournau 3.00.06 Sadirac Lorient LaVie st 3 nd 17e-18e
BDX16019 26212 2013 B. Ducournau 3.00.06 Sadirac Lorient LaVie st 3 nd 17e-18e
BDX16020 26212 2013 B. Ducournau 5.00.11 Sadirac Lorient LaVie st 1 nd 17e-18e
BDX16021 26212 2013 B. Ducournau 5.00.11 Sadirac Lorient LaVie st 1 nd 17e-18e
BDX16022 26212 2013 B. Ducournau 5.00.11 Sadirac Lorient LaVie st 1 nd 17e-18e
BDX16023 26212 2013 B. Ducournau 5.00.12 Sadirac Lorient LaVie st 1 nd 17e-18e
BDX16024 26212 2013 B. Ducournau 5.00.12 Sadirac Lorient LaVie st 1 nd 17e-18e
BDX16025 26212 2013 B. Ducournau 5.00.12 Sadirac Lorient LaVie st 1 nd 17e-18e
BDX16026 26212 2013 B. Ducournau 5.00.08 Sadirac Lorient LaVie st x nd 17e-18e
BDX16027 26212 2013 B. Ducournau 5.00.08 Sadirac Lorient LaVie st x nd 17e-18e
BDX16028 26212 2013 B. Ducournau 5.00.08 Sadirac Lorient LaVie st x nd 17e-18e
BDX16029 26212 2013 B. Ducournau 5.00.08 Sadirac Lorient LaVie st x nd 17e-18e
32
4 Méthodologie�mise�en��uvre�
Chaque échantillon arrivant au laboratoire doit subir des démarches préliminaires conformément à la procédure analytique de l�IRAMAT-CRP2A. Ce n�est qu�après ces démarches qu�il est possible de préparer les échantillons pour ensuite procéder à des analyses. Le choix des méthodes d�analyse découle non seulement du matériau étudié, mais aussi des problématiques de recherches et des appareils d�analyses disponibles.
4.1 Démarches�préliminaires�
À son arrivé au laboratoire, chaque échantillon se voit attribuer une référence. Cette référence permet d�accéder au dossier de l�échantillon et forme ainsi sa « carte d�identité ». La référence de l�échantillon comporte un préfixe BDX, de Bordeaux, ainsi qu�un numéro d�inventaire. Dans le cadre de cette étude, les échantillons de céramiques glaçurées de Sadirac se réfèrent aux BDX15725 à BDX15745 et BDX15990 à BDX16029 (Annexe 3). Par la suite, les échantillons sont photographiés dans le but de préserver en image numérique l�objet à son entrée au laboratoire. Cette étape permet d�enregistrer l�état de l�objet avant prélèvement ou analyse, mais aussi de préciser les zones de prélèvement sur celui-ci. Finalement, les objets attribuables à une typologie on été dessinés (Annexe 4). Les échantillons céramiques non-assignables à une typologie, c�est le cas des tessons de panse et des fonds, n�ont pas été dessinés. Le dessin permet non seulement d�avoir une vue plus complète de l�objet, mais aussi de mieux appréhender sa forme, ses détails, etc. Le dessin des céramiques doit suivre les grandes règles du dessin archéologique et peut par la suite être refait par ordinateur, comme ce fut le cas ici.
4.2 Préparation�des�échantillons�
La préparation des échantillons est une étape importante pour obtenir des sections polies convenables. Nous avons donc réalisé des lames épaisses avec une scie précise dont la lame est adaptée aux matériaux durs comme la terre cuite, et utilisé de l�eau comme lubrifiant. Un prélèvement perpendiculaire à l�épaisseur est réalisé sur une zone glaçurée de la céramique. Ainsi, on obtient une lame épaisse présentant une coupe transversale du tesson. On y observe en coupe les parties interne et externe du tesson : la pâte et la glaçure. Les prélèvements sont par la suite mis à sécher dans un four à 55°C pendant quelques heures. Cela permet de retirer toute humidité de l�échantillon, étape nécessaire à l�enrobage. Par la suite, on doit préparer un certain nombre de moules pour procéder à l�enrobage. Un agent silicone est pulvérisé dans les moules pour faciliter le démoulage. Les prélèvements sont déposés soigneusement, un par un, dans les moules, en s�assurant que la face à analyser soit bien orientée. L�agent silicone aide aussi à fixer en place les échantillons pendant le remplissage du moule et le temps d�induration de la résine. On doit préparer la résine en mélangeant soigneusement et lentement les deux composés 2020A et 2020B dans un rapport 100g/30g. La résine utilisée est un époxy transparent Araldite 2020 A/B de la marque Escil présentant un très faible retrait au séchage. Ensuite, on verse cette résine dans les
33
moules, qu�on place sous vide, et qu�on laisser reposer le temps de l�induration, c�est-à-dire au moins 24 heures.
Les résines peuvent après coup être démoulées et polies. On débute avec un prépolissage à 75 mm
pour retirer la couche de résine en surface et on continue avec un papier de 35 mm, pour finaliser
avec un de 26 mm de granulométrie. Il s�agit d�une étape importante puisque la qualité finale de la surface polie dépendra de celle du prépolissage. Entre chaque changement de granulométrie, des observations à la loupe binoculaire (ou au microscope métallographique) sont nécessaires pour éviter tout défaut ou rainure, mais aussi pour voir l�avancement de l�opération. De plus, des bains en cuve à ultrasons successifs sont à prescrire entre chaque changement de granulométrie pour retirer toutes particules qui pourraient nuire aux étapes postérieures. Par la suite, nous pouvons procéder au polissage qui se fera en trois étapes. On débute avec une
granulométrie de 6 mm, puis on passe à 3 mm et finalise avec du 1 mm. Le local de préparation des échantillons de L�IRAMAT � CRP2A possédant une polisseuse automatisée, le travail en fut simplifié. Le polissage s�est fait par rotation et pression constante avec des tissus sur lesquels sont disposées des suspensions diamantées à granulométrie contrôlée. Ici encore, il sera nécessaire de procéder à des observations sous loupe binoculaire et à des bains en cuve à ultrasons entre chaque changement de granulométrie. Le rendu final doit présenter une surface lisse, sans défaut ou rainure. Il est primordial de vérifier tout au long du processus de polissage l�état de la glaçure. Étant un matériau fragile, elle peut parfois se disjoindre de la terre cuite et même s�abraser rapidement, au grand malheur du chercheur qui doit recommencer toutes les étapes de la préparation de l�échantillon.
4.3 Observations�sous�loupe�binoculaire�
Suite aux études préliminaires du matériel, il est nécessaire de procéder à des observations sous loupe binoculaire. Dans le cadre de cette étude, ces examens ont été faits sur la surface des objets, mais aussi sur les sections polies enrobées. On peut ainsi observer l�état de surface de l�échantillon, des craquelures ou des bulles, ainsi que de nombreux défauts lié à la cuisson ou à l�altération.
4.4 Mesure�physique�de�la�couleur�
Toutes les céramiques échantillonnées dans le cadre de cette étude comportent une glaçure plombifère verte. Cependant, différents tons de vert sont observables. On passe du vert clair au vert sombre, allant du vert vif au vert forêt� Cette multitude de verts pourrait être longuement décrite, mais par qui ? Puisqu�un objet est coloré car il absorbe ou diffuse certaines longueurs d�onde de la lumière dite visible, sa couleur est pourtant inhérente à la sensibilité spectrale de l��il de son observateur. Toutefois, la perception des couleurs chez l�humain est non seulement un mécanisme physiologique, mais aussi psychologique et culturel (Tornay, 1973 ; France, 1992 ; Bouveresse, 2004). De ce fait, il devient nécessaire de trouver un moyen objectif pour caractériser la couleur des glaçures. Le vocabulaire subjectif habituellement utilisé est remplacé par des mesures physiques de la couleur. Ainsi entre en jeu un appareil capable de décrire une couleur respectivement par sa luminosité, des coordonnées chromatiques et un spectre d�absorption. Cette description de la couleur sera totalement indépendante de l�éclairage ambiant et de l�observateur.
34
L�appareil utilisé pour cette étude est un spectrophotomètre CM-2600d de Konica Minolta. Nous avons choisi de travailler avec un angle d�observation de 10°, sur une surface de 3 mm de diamètre avec l�illuminant D65 (CIE8) correspondant à la lumière naturelle moyenne en plein jour et donc à un blanc de 6500 K. Les mesures des réflexions spéculaires incluse (SCI) et exclue (SCE) ont été faites simultanément, puisque la composante spéculaire permet de qualifier la brillance de la couleur, ainsi que l�état de surface. Cependant, sur des surfaces glaçurées, SCI et SCE risquent fort de présenter les mêmes résultats ou presque. Le spectrophotomètre est un appareil portable qui permet l�analyse spectrale dans le domaine du visible9 (360 à 740 nm) d�une lumière réfléchie par une surface. En effet, après calibration de l�appareil (blanc de référence et noir), on pose celui-ci sur la surface étudiée et une lumière polychromatique est émise puis réfléchie. La lumière recueillie par l�instrument est traitée pour en séparer les différentes longueurs d�onde. On obtient ainsi un spectre et le calcul des coordonnées chromatiques. Tout cela se fait bien certainement sans prélèvement, de manière non destructive, dans un but de conservation pérenne. Il ne faut cependant pas négliger que même si on propose ici de mesurer physiquement les couleurs des glaçures, on mesure en fait la glaçure sur son support céramique. Ce matériau étant plus ou moins transparent, il va de soi que son support participe à la couleur mesurée. Néanmoins, la couleur que l�on observe résulte du même fait. C�est pour ces deux raisons que nous avons décidé de procéder sur la surface des échantillons. Les coordonnées chromatiques obtenues seront ici traitées selon le modèle de représentation des couleurs L*a*b* (CIE 1976). Ce système a été spécialement conçu pour que les distances inter-couleurs correspondent aux différences perceptibles par l��il humain (Leblanc).
· La composante L* définie la luminosité de la couleur, c�est-à-dire son intensité. Elle s�échelonne de 0 à 100, respectivement le noir et le blanc.
· La composante a* correspond à un point dans la gamme des 600 niveaux sur l�axe vert � rouge, qui passe du vert (-100), au gris (0) et au rouge (100).
· Quant à la composante b*, elle correspond à un point dans la gamme des 600 niveaux sur l�axe bleu � jaune, qui passe du bleu (-100), au gris (0) et au jaune (100) (Dupont et Steen, 2004).
8 Selon la commission internationale de l�éclairage (CIE). 9 Nous avons décidé de travailler avec la lumière visible excluant les UV (200 à 360 nm).
35
La Figure 5 représente schématiquement ce modèle L*a*b*. Il est important de concevoir cet espace de manière tridimensionnel, à la façon d�une sphère. Cependant, lorsque nous présenterons les résultats des mesures physiques de couleur relatif à notre étude, seul les coordonnées a* et b* seront disposées dans un graphique. Cette présentation plus simplifiée permettra de mieux réaliser la dispersion des couleurs. En ce qui concerne les spectres, nous avons procédé à un calcul simple pour changer la nature de ceux-ci. Partant des spectres de réflectance acquis avec le spectrophotomètre, nous avons redéfini des spectres d�absorption. Pour ce faire, chaque valeur de chaque longueur d�onde doit être intégrée dans cette équation :
Ceci permet d�obtenir des valeurs positives pour chaque longueur d�onde.
4.5 Observations�en�microscopie�électronique�à�balayage�
Les observations en microscopie électronique à balayage permettent une toute autre approche du matériel étudié. Deux modes différents d�imagerie sont possibles : le premier se sert des électrons secondaires, produits par l�interaction faisceau-matière et donc extraits des couches atomiques superficielles des atomes, pour produire des images de la topographie de l�échantillon ; Le deuxième mode utilise les électrons rétrodiffusés pour créer des images de contrastes chimiques, résultant des différences de densité électronique des atomes présents dans l�échantillon.
Figure 5 : le modèle L*a*b* de façon schématique. ÓA. Guindon
36
Le principe du microscope électronique à balayage est de bombarder avec un fin faisceau d�électrons (d�environ 3 à 15 nm de diamètre) la surface de l�échantillon. Ces électrons, générés par un filament de tungstène chauffé à 2700 K, interagissent avec la matière et en résulte différents types de rayonnements : des rayons X, des électrons rétrodiffusés et secondaires, des photons, etc. (Figure 6). Différents capteurs couplés au microscope permettent par la suite de réaliser de l�imagerie ou des analyses de compositions élémentaires (voir Analyses élémentaires par MEB-EDS). Dans le cadre de notre étude, des observations en microscopie à balayage utilisant les électrons rétrodiffusés ont été réalisées avec un MEB JEOL, modèle JSM 6460 en mode LV 20 Pa sans métallisation des échantillons. Les électrons rétrodiffusés sont le résultat des collisions élastiques entre les électrons du faisceau incident et les électrons du nuage électronique des atomes présents dans la matière. Leur énergie est légèrement inférieure à l�énergie du faisceau incident et est proportionnelle à la nature des atomes rencontrés. En effet, le coefficient de rétrodiffusion est fonction de la densité électronique, c�est-à-dire du numéro atomique. Ces électrons proviennent d�une profondeur allant de 10 à 300 nm dans la matière, dépendamment de plusieurs facteurs (nature de l�atome rencontré, voltage, distance de travail, pression, densité de l�échantillon, etc.).
Ainsi, on obtient une image des contrastes chimiques en niveaux de gris : la surbrillance de l�image (ou blancheur) représentant des atomes lourds et des gris sombres à noirs traduisant des éléments légers. Pour l�étude des glaçures, ce type d�imagerie est particulièrement efficace pour détecter des hétérogénéités de compositions chimiques, des contrastes, etc. Il permet surtout de comprendre la zone d�interaction glaçure�terre cuite, de localiser des cristaux de néoformation ou des grains non fondus.
Figure 6 : Poire de diffusion du faisceau incident d�électrons.
(http://www.culture.gouv.fr/culture/conservation/fr/methodes/meb_01.htm )
37
4.6 Analyses�élémentaires�par�MEB-EDS�
En couplant le microscope électronique à balayage à un détecteur de rayons X en dispersion d�énergie (MEB-EDS), il devient possible de réaliser des analyses élémentaires. En effet, les rayons X résultant de l�interaction faisceau-matière ont des énergies caractéristiques des éléments chimiques présents dans l�échantillon analysé. Cette technique d�analyse permet donc de connaître les compositions élémentaires de nos échantillons, mais surtout d�étudier la terre cuite, la zone d�interface et la glaçure de façon individuelle. Dans un souci de vérifier l�exactitude des analyses, nous avons procédé à des expérimentations sur un matériel de référence certifié par le Joint Research Centre (Annexe 5) de l�Institute for Reference Materials and Measurements. Ce verre au plomb BRC-126A a fait l�objet de six analyses dans le but d�évaluer le temps d�acquisition nécessaire pour quantifier des éléments présents dans un verre ou une glaçure. Ainsi, nous avons procédé à six analyses dans les mêmes conditions expérimentales, en changeant le temps d�acquisition pour : 20, 30, 50, 80, 120 et 180 secondes avec les standards par défaut d�Oxford Measurment. Ces résultats ont par la suite été comparés aux valeurs certifiées du matériel de référence pour en observer l�écart relatif (Tableau 5). Les écarts relatifs rencontrés ne sont pas exprimés en absolu dans le but de démontrer le surdosage ou sousdosage.
Tableau 5 : Résultats d'analyseS MEB-EDS de BCR-126A selon différents temps d'acquisition.
À la lumière de ces résultats, nous voyons une forte variabilité des données selon le temps d�acquisition choisi. Les éléments majeurs (>10%) (Pb, Si, K) ne dépasse cependant pas les 10% d�écart relatif aux valeurs du standard, ce qui est raisonnable. Les éléments mineurs (>1%) (Na, Ca, Zn, Ba) ont quant à eux des écarts relatifs compris en 12% et 18%, atteignant jusqu�à 22% pour les éléments légers (Na). Les éléments traces (<1%), à l�exception du Mg dont l�écart relatif ne dépasse pas 13%, sont détectés avec des écarts relatifs importants. Les teneurs en fer sont quant à elles trop faibles pour être détectées. Tout ceci doit cependant prendre en compte l�erreur systématique engendrée par chaque mesure physique, puisque seulement un spectre a été enregistré pour chaque temps d�acquisition. Le Tableau 6 présente les mêmes données mais traitées avec les standards pour le verre (BCR-126A, Corning B et D), prédisposés à être utilisés pour traiter les données des glaçures.
Temps d'acqui. Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO ZnO Sb2O3 BaO PbO Total
20 sec. Valeurs analysées 4.24 0.55 0.16 60.65 9.57 0.95 0.96 nd 0.97 21.94 100
Écart relatif (%) 19 7 27 5 -4 -8 -5 - -8 -9
30 sec. Valeurs analysées 4.36 0.55 nd 60.60 9.61 0.91 0.84 nd 1.01 22.14 100
Écart relatif (%) 22 7 - 5 -4 -12 -17 - -4 -8
50 sec. Valeurs analysées 4.14 0.58 nd 60.61 9.52 0.85 0.89 nd 0.94 22.47 100
Écart relatif (%) 16 13 - 5 -5 -18 -12 - -11 -6
80 sec. Valeurs analysées 4.09 0.52 0.06 60.87 9.50 0.89 0.93 nd 0.93 22.21 100
Écart relatif (%) 15 2 -52 5 -5 -14 -8 - -12 -7
120 sec. Valeurs analysées 4.03 0.54 0.05 60.83 9.61 0.87 0.83 nd 1.04 22.20 100
Écart relatif (%) 13 5 -60 5 -4 -16 -18 - -1 -7
180 sec. Valeurs analysées 4.02 0.54 0.08 60.81 9.55 0.88 0.86 0.15 0.97 22.13 100
Écart relatif (%) 13 5 -37 5 -4 -15 -15 -48 -8 -8
Oxydes en %m Valeurs certifiées 3.57 0.51 0.13 57.80 9.99 1.03 1.01 0.29 1.05 23.98 99.37
s 0.07 0.01 0.01 0.11 0.07 0.03 0.04 0.01 1.05 0.06
38
Tableau 6 : Résultats d'analyses MEB-EDS de BCR-126A selon différents temps d'acquisition après traitement avec des standards pour les matrices vitreuses.
Comparé au tableau précédent, les résultats sont beaucoup plus probants. Les écarts relatifs sont beaucoup moins élevés pour tous les éléments. Ces standards déjà utilisés pour d�autres analyses de glaçures et d�émaux ont fait leurs preuves. Nous voyons donc l�utilité d�utiliser ces standards pour le traitement des spectres MEB-EDS de notre étude. Les mesures se faisant habituellement avec 60 secondes d�acquisition, nous avons décidé de procéder aux analyses des échantillons avec ce temps d�acquisition. Cette décision tient aussi du fait des bons résultats obtenus avec 50 et 80 secondes, 60 secondes étant un intermédiaire. Il est à noter que ce même matériel de référence BCR-126A servira aussi de standard pour les matrices vitreuses. Nous avons déterminé le nombre d�analyse à effectuer par échantillon grâce à l�observation de la stabilisation de la moyenne. En observant les Figure 7et Figure 8, nous pouvons définir la stabilisation de la moyenne à partir de 6 spectres quantitatifs. De ce fait, nous avons décidé de réaliser 7 à 10 spectres pour chaque glaçure et chaque terre cuite d�un échantillon.
Temps d'acqui. Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO ZnO Sb2O3 BaO PbO Total
20 sec. Valeurs analysées 3.57 0.6 0.17 58.17 10.26 1.01 1.05 nd 1.07 24.1 100
Écart relatif (%) 0 17 35 1 3 -2 4 - 2 1
30 sec. Valeurs analysées 3.67 0.6 nd 58.12 10.3 0.97 0.91 nd 1.11 24.33 100
Écart relatif (%) 3 17 - 1 3 -6 -10 - 5 1
50 sec. Valeurs analysées 3.48 0.64 nd 58.1 10.2 0.91 0.97 nd 1.03 24.67 100
Écart relatif (%) -3 25 - 1 2 -12 -4 - -2 3
80 sec. Valeurs analysées 3.44 0.57 0.07 58.36 10.18 0.95 1.01 nd 1.02 24.39 100
Écart relatif (%) -4 11 -44 1 2 -8 0 - -3 2
120 sec. Valeurs analysées 3.39 0.59 0.06 58.32 10.29 0.93 0.9 nd 1.15 24.37 100
Écart relatif (%) -5 15 -52 1 3 -10 -11 - 9 2
180 sec. Valeurs analysées 3.38 0.59 0.08 58.3 10.23 0.94 0.94 0.16 1.07 24.3 100
Écart relatif (%) -5 15 -37 1 2 -9 -7 -45 2 1
Oxydes en %m Valeurs certifiées 3.57 0.51 0.13 57.80 9.99 1.03 1.01 0.29 1.05 23.98 99.37
s 0.07 0.01 0.01 0.11 0.07 0.03 0.04 0.01 1.05 0.06
39
Figure 7 : Démonstration de la stabilisation de la moyenne en SiO2 de la glaçure d�un échantillon entre 6 et 10
spectres.
Figure 8 : Démonstration de la stabilisation de la moyenne en PbO de la glaçure d�un échantillon entre 6 et 10 spectres.
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Val
eur
mo
yen
ne
SiO
2
Nombre de spectres
Stabilisation de la moyenne SiO2
64
65
66
67
68
69
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Val
eur
mo
yen
ne
Pb
O
Nombre de spectres
Stabilisation de la moyenne PbO
40
De plus, toutes les analyses par spectrométrie de rayons X en dispersion d�énergie sont faites sous les mêmes conditions expérimentales dans un souci de comparaison. Sans métallisation des échantillons, nous avons travaillé avec les paramètres suivants :
· Temps d�acquisition réelle : 60 secondes
· Temps de mise en forme : 5
· Game de spectre de 0-10 keV, sauf si présence d�arsenic (0-20 keV)
· Tension d�accélération des électrons de 20 kV
· Temps mort entre 30-40 %
· Pression LV de 20 Pa
· Distance de travail de 8 mm
· Nombre de coups : > 300 K coups/sec.
Concernant le traitement des données acquises au MEB-EDS, nous proposons d�utiliser des standards de correction des matrices vitreuses. Nous avons eu recourt à trois standards de verres, soient le BCR-126A, le Corning B et le Corning D (Annexe 6). Le Corning B, verre sodique, est employé comme standard pour le sodium. Le BCR-126A est un verre au plomb utilisé comme standard pour le silicium, le potassium et le plomb. Finalement, le Corning D, un verre potassique, sert à standardiser le calcium. Les compositions de ces verres doivent être intégrées comme nouveau standard dans le logiciel INCA. Par la suite, chaque élément chimique à standardiser doit être sélectionné et intégré dans l�ordre décrit ci-haut.
�
43
L�intérêt de l�étude archéométrique des poteries de Sadirac réside dans une meilleure connaissance de ce centre potier. Il s�agit d�apporter des données techniques supplémentaires à notre compréhension des recettes de glaçure au moyen de diverses observations et analyses. La caractérisation des aspects technologiques et la détermination de leurs variations sont nos deux objectifs. Pour ce faire, nous avons échantillonné un total de 61 échantillons provenant d�ateliers de Sadirac. Ces échantillons sont probablement en majorité des ratés de cuissons, une minorité pouvant provenir de déchets domestiques rejetés dans les mêmes fosses. Les différentes parties constitutives de ces céramiques seront donc décrites et caractérisées visuellement ainsi que chimiquement, en portant une attention particulière aux glaçures, notre objet d�étude.
5. Colorimétrie��
Les glaçures étudiées ici sont en grande majorité définies comme vertes, d�autres plutôt miel, en observation à l��il nu. Comme nous l�avons vu, procéder à des études colorimétriques permettra d�avoir un point de vue objectif concernant leur coloration, en plus d�identifier les chromogènes et de déterminer les coordonnées chromatiques des glaçures.
5.1 Identification�des�chromogènes�
Les résultats des mesures de couleur sont sporadiques, restant toutefois dans des valeurs proches. Les spectres obtenus présentent majoritairement deux bandes d�absorption larges qui sont associées au fer des glaçures et des terres cuite (Figure 9), ainsi qu�au cuivre (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). En effet, la première bande d�absorption vers 380 nm est attribuable à l�ion chromogène Fe3+ dans une matrice vitreuse. De plus, le cuivre (Cu2+) a exactement ses radiations monochromatiques d�absorption entre 500 et 600 nm. Il est donc possible d�affirmer que la couleur verte de ces glaçures est due à une pigmentation à l�ion cuivre Cu2+ combinée à celle du fer Fe3+.
Figure 9 : Spectres d�absorption optique de l�ensemble glaçure � terre cuite et de la terre cuite (Ben Amara, 2002).
44
1.2
1.8
2.4
350 450 550 650 750
Ab
sorp
tio
n (
u.a
.)
Longueur d'onde (nm)
BDX15725
Figure 10 : Spectre de l�échantillon BDX 15732 présentant une nette absorption vers350 et 550 nm, typique
de la présence des ions Fe3+
et Cu2+
comme éléments chromogènes de la matrice vitreuse.
Cependant, la singularité de la bande d�absorption vers 550 nm n�est pas observable sur tous les spectres. En effet, certains échantillons présentent des spectres n�ayant que la première bande d�absorption due au Fe3+. Ce type de spectre, comparable à celui de l�échantillon BDX 15725 visible dans la Figure 11, dénote une glaçure moins verte. C�est exactement ceci que nous avions observé à l��il nu et qualifié de couleur miel. Ce phénomène est éventuellement le résultat d�une concentration beaucoup moins forte en cuivre, on simplement l�absence de ce chromogène. Ces glaçures se situent donc plutôt dans les jaunes que les verts.
1.8
2.1
2.4
350 450 550 650 750
Ab
sorp
tio
n (
u.a
.)
Longueur d'onde (nm)
BDX15732
Figure 11 : Spectre de l�échantillon BDX 15725 présentant une absorption vers 350 nm,
typique de la présence de l�ion Fe3+
.
45
Dans la perspective de confirmer cette relation entre la concentration en cuivre d�une glaçure et son spectre d�absorbance, comparons les résultats des spectres avec les résultats des analyses chimiques réalisées au microscope électronique à balayage couplé à un détecteur de rayons X en dispersion d�énergie. Pour ce faire, un total de 8 spectres a été sélectionné. Quatre de ces spectres présentent la bande d�absorption à partir de 550 nm caractéristique de la présence du cuivre sous la forme Cu2+. Quatre autres spectres se joignent à notre argumentation et ne présentent pas cette dernière bande, mais seulement la première bande relative au Fe3+. Observons maintenant les concentrations en cuivre des ces huit échantillons dans le Tableau 7. En comparant ces concentrations aux spectres obtenus en mesure physique de la couleur pour ces mêmes huit échantillons présentés dans la Figure 13, il est admissible d�avancer qu�une forte concentration en cuivre reflète un spectre présentant une bande d�absorption vers 550 nm. Ainsi, sans même avoir à faire d�analyse physico-chimique, il est possible de déceler le chromogène présent dans la glaçure des céramiques sadiracaises. En outre, l�absence de bande vers 550 nm est un critère qui permet d�évaluer une coloration à l�ion sous la forme Cu2+ à des teneurs très faibles, voire nulles. Cependant, il ne faut jamais oublier que la couleur d�une glaçure transparente ne dépend pas seulement de sa teneur en chromogène, mais aussi à la couleur de la terre cuite, son support, selon le schéma de la Figure 12. De ce fait, l�épaisseur de la glaçure joue aussi un rôle dans la perception de la couleur. Enfin, la couleur verte observée est aussi dépendante du type de fondant utilisé. En effet, une glaçure alcaline contenant du cuivre comme élément chromogène aurait une teinte turquoise, et non pas verte comme les glaçures plombifères de notre étude.
Réf. CRP2A CuO
BDX15725 0.1
BDX15730 2.6 BDX15732 BDX15733
1.2 1.7
BDX15734 0.3
BDX15735 0.8
BDX15736 0.5
BDX15742 0.4
Oxydes en %m
Tableau 7 : Tableau présentant les concentrations en cuivre des huit échantillons.
Figure 12 : Schéma du trajet optique de la lumière incidente (Ben Amara, 2002).
46
Figure 13 : Spectres d�absorbance de huit échantillons présentant une absorption à 550 nm.
�
5.2 Mesure�physique�de�la�couleur�
La fluctuation de couleur des glaçures est un fait établi. Nous avons pu le démontrer grâce aux spectres d�absorption. Voyons maintenant les résultats de la mesure physique de la couleur selon le système L*a*b*. Tous les résultats sont présentés dans le Graphique 1. On peut voir que les glaçures se situent dans la gamme du jaune-vert, selon des mesures de a* variant entre -14 et 8 et des valeurs de b* s�échelonnant de 3 à 38. Certains échantillons présentent donc une couleur tirant plus vers le jaune, ce sont ceux qui ont des valeurs de b* forte. Malgré tout, il semble que la majorité des céramiques étudiées comportent des couleurs de glaçure similaires, tirant vers le vert avec des valeurs de a* négatives. En traçant une ellipse de confiance à 95%, on observe que la plupart des couleurs mesurées sont significativement semblables. Seuls cinq échantillons ne rencontrent pas ces valeurs types et ne sont pas compris dans l�ellipse. La Figure 14 présente les différents sous-ensembles de couleurs. Les longueurs d�ondes dominantes de nos échantillons se situant entre 565 et 580 nm, elles se répartissent dans trois sous-ensembles : jaune-vert, jaune verdâtre et jaune. De ce fait, les échantillons se trouvant
1.3
1.6
1.9
2.2
2.5
2.8
350 450 550 650 750
Absorption (u.a.)
BDX15725 BDX15730 BDX15732 BDX15733
BDX15734 BDX15735 BDX15736 BDX15742
Longueur d�onde (nm)
47
Figure 14 : Système XYZ de la CIE 1931. Principales tonalités portées dans le diagramme de chromaticité (x y) (Dupont et Steen, 2004).
Graphique 1 : Représentations des coordonnées a* et b* des mesures de couleur des échantillons de l�étude selon le système L*a*b* (CIE1976). Nous y avons ajouté une ellipse de confiance à 95%.
48
dans les jaunes sont probablement ceux qui étaient qualifiés de miel. De plus, la pureté d�excitation moyenne est de 40 (D65), signifiant que les couleurs mesurées sont moyennement saturée. Quand à la luminosité (L*), elle varie beaucoup selon les échantillons et présente une moyenne de 50/100 (D65), c�est-à-dire moyennement claire. Cette luminosité ne semble aucunement corrélée avec la chronologie ou la nature des sites. Voyons maintenant si les couleurs de glaçure présentent une certaine répartition des coordonnées L*a*b*selon les périodes. Le illustre les quatre périodes étudiées et démontre clairement une absence de corrélation entre céramiques de la même période. De plus, les mêmes glaçures ne semblent pas présenter des correspondances selon les sites. En effet, le Graphique 3 démontre clairement que même si des céramiques proviennent d�un ensemble clos, et donc de la même production, leur couleur ne sera pas nécessairement identique. Ceci s�explique par plusieurs facteurs comme l�atmosphère de cuisson qui peut être très variable d�un endroit à l�autre à l�intérieur du four, les procédés d�application du mélange glaçurant ou la couleur du support. Ainsi, une même fournée peut présenter des variabilités de couleur. La gamme de couleurs observées n�est donc pas en lien avec la chronologie ou l�atelier de production. Elle découle plutôt de phénomènes aléatoires qui ne peuvent être contrôlés dans le cadre d�un artisanat potier. On peut finalement conclure qu�un décalage existe entre l�observation visuelle et la mesure physique de la couleur. Les échantillons étudiés présentent plutôt des composantes chromatiques jaunes que vertes. À la lumière des résultats, on devrait dorénavant parler de glaçures de couleur jaune-verdâtre plutôt que verte.
Graphique 2 : Répartition des coordonnées L*a*b* selon les périodes.
49
Graphique 3 : Répartition des coordonnées L*a*b* selon les sites.
6. Observations�de�la�texture�des�glaçures�
Préliminaires aux analyses physico-chimiques, les observations de la texture des glaçures est essentielle. Cette étape permet non seulement de relever de nombreux petits détails qui seront utiles à nos analyses, mais aussi de mieux appréhender la texture des glaçures.
6.1 Observations�en�lumière�naturelle�
Les observations en lumières naturelles permettent une première approche du matériel étudié : on explore les surfaces des objets et les sections polies. Ces observations sont faites sous une loupe binoculaire. Nous profitons donc d�un fort grossissement qui tient compte des couleurs réelles des objets.
6.1.1 Les�objets�:�leurs�surfaces�
Voyons maintenant les observations sous loupe binoculaire des objets étudiés et les caractéristiques propres à leurs glaçures. Concernant la surface des glaçures, celle-ci semble toujours présenter des craquelures, souvent appelées trésaillures (Figure 15). Plus ou moins importantes dépendamment des échantillons,
Légende
Lorient - LaVie
Tioulet
Sableyre
Laurent Videau
Siron
Féchinet
Autres
Site
-12 -8 -4 4 8
8
16
24
32
40
50
ces craquelures sont probablement le résultat d�un refroidissement trop rapide, d�une mauvaise concordance des coefficients de dilation de la glaçure et de la terre cuite, de l�épaisseur de la glaçure, etc. Deux autres aspects de surface ont retenus notre attention, ils sont tous les deux visibles à l��il nu. Le premier concerne des petits creux présents dans les glaçures. Ce sont de
nombreux petits cratères d�un diamètre de 25 à 100 mm qui forme un creux de la surface de la glaçure jusqu�à la terre cuite (Figure 17). Le deuxième type de cavités, de plus grande dimension que le phénomène précédent, est lui creusé dans le support argileux et recouvert de glaçure (Figure 16). Primo, ces cratères peuvent avoir pour cause une forte viscosité de la glaçure (Rice, 1987 ; Matthes et Avon, 2011). Ils sont souvent associés avec la monocuisson des terres cuites glaçurées, et seraient le résultat du dégazage du support de terre pendant la cuisson. Ces cratères sont donc des bulles d�air et seraient à mettre en lien avec d�autres bulles, celles-ci plus petites, contenues dans la glaçure. Pour éviter l�accumulation de bulles d�air, la glaçure devrait avoir une température de fusion la plus tardive possible pour permettre à ces gaz de s�échapper sans endommager la surface celle-ci. On nomme cette température « point de fermeture ». Après avoir dépassé cette température critique, la glaçure ne permet plus la libre évacuation des gaz (dioxyde de carbone, etc.) s�y retrouvent donc pris sous formes de bulles. Pour y remédier, les artisans potiers utilisent différentes solutions : allonger le temps de cuisson et surtout ralentir la montée en température (Tite et al., 1998), ajouter plus de fondant pour augmenter la fluidité du mélange, etc. Deuzio, puisque les glaçures plombifères peuvent simplement être le résultat d�un saupoudrage d�oxyde de plomb (litharge, minium, etc.) à la surface de la poterie, le silicium nécessaire à la formation d�une matrice vitreuse se trouve à être récupéré du support de terre cuite (Tite et al., 1998). Ce transfert de silicium résulterait en des creux dans le support, ceux-ci ayant la forme du grain de plomb. Cette technique de glaçurage a l�avantage d�être facile à mettre en �uvre pour les potiers. Elle permet aussi une bonne cohésion de la glaçure avec son support argileux (Rice, 1987).
Figure 17 : Image en lumière naturelle de l�échantillon BDX 15728 présentant un exemple de petit cratère dans la glaçure.
Figure 16 : Image en lumière naturelle de l�échantillon BDX 15741 présentant un exemple de creux dans la terre cuite.
Figure 15 : Image en lumière naturelle de l�échantillon BDX 15733 et ses craquelures.
51
6.1.2 Les�sections�polies�
Les observations en lumière naturelle sous loupe binoculaire des sections polies sont souvent nécessaires avant de réaliser des analyses MEB-EDS. Elles permettent d�associer des attributs observés en contraste à ceux vus à la loupe binoculaire, mais aussi d�anticiper les futures analyses. Ces images permettent d�observer les glaçures en section. Cela permet non seulement de prendre conscience de leur épaisseur, mais aussi d�apercevoir d�éventuelles particularités.
De ce fait, nous avons noté quelques particularités chez certaines glaçures. L�échantillon BDX 15728 (période XVII-XVIIIe siècle, Le Casse) présente une masse opaque dans sa glaçure (Figure 18). Cette masse jaunâtre s�est avérée être la diffusion d�un grain d�étain, ou possiblement de stannate de plomb (type II) aussi appelé Jaune des verriers. Sa composition en SnO2 est d�environ 23%, en PbO d�environ 62%, en SiO2 de 10% et en Al2O3 de 3% (Na2O, MgO, K2O, TiO2, Fe2O3, CuO <0.5%). Ce grain d�oxyde d�étain permet de nous interroger sur la présence d�ateliers potiers où la céramique glaçurée et la faïence étaient produites simultanément. Il semblerait qu�à cette même période, des faïenciers s�installent à Sadirac (Régaldo-Saint Blancard, 1988, 2000). L�observation des sections polies ont aussi permis de comprendre la pigmentation mouchetée de certaines
glaçures. En effet, ces glaçures mouchetées présentent de petites taches brunâtres, orangées ou même noires. Ces colorations sont dues à la présence de nodules ferrugineux
dans la terre cuite. Ceux-ci peuvent diffuser dans la glaçure et donner cette impression. Sinon, les mêmes nodules peuvent simplement être en surface des terres cuites et apparaitre par transparence, au travers de la glaçure. D�autre part, les images prises en lumière naturelle permettent de voir la finesse de la pâte. La totalité des céramiques semble être faite d�une terre argileuse comprenant peu de dégraissant, ceux-ci étant probablement d�origine naturelle. Un marqueur de l�utilisation des argiles de
Sadirac est la présence de nodules ferrugineux dans la pâte (Figure 20). L�atmosphère ou les atmosphères de cuisson sont aussi observables dans la couleur de la terre cuite. Les argiles de Sadirac étant des argiles siliceuses à faible teneur en fer, la pâte devrait avoir une teinte plutôt claire en atmosphère oxydante et plutôt grise en atmosphère réductrice.
Finalement, de rares céramiques ont un engobe. Celui est facilement visible en lumière naturelle et se dégage de l�ensemble par sa couleur plus pâle (Figure 19).
Figure 18 : Image en lumière naturelle de l�échantillon
BDX 15728 qui présente une masse jaunâtre dans sa glaçure.
Figure 20 : BDX 15726 Gx50 Figure 19 : BDX 15740 Gx100
52
6.2 Observations�en�microscopie�électronique�à�balayage�
Les�sections�polies�
Les observations en microscopie électronique à balayage nous permettent de voir l�agencement des deux fractions qui composent les objets étudiés : la terre cuite et la glaçure. De plus, ce type de microscopie permet de distinguer les spécificités de chaque glaçure comme des bulles, des cristaux de néoformation ou des grains non fondu. Dans un premier temps, nous avons mesuré l�épaisseur des glaçures. Celles-ci font en moyenne 100 µm, la plus fine faisant à peine 30 µm et la plus épaisse 220 µm. Cependant, ces épaisseurs peuvent varier fortement, aussi bien pour des céramiques venant du même assemblage que de la même structure. En effet, les variations peuvent être élevées sur un même site, comme le montre le Tableau 8. Cela s�explique peut-être par la ou les méthodes d�application du mélange glaçurant qui ne permettent pas un contrôle de la quantité de matière appliquée, ou tout simplement, le désir d�avoir une épaisseur de glaçure constante n�est pas réellement recherché par les potiers. Cependant, le Graphique 4 et le Tableau 9 montrent une certaine tendance à l�épaississement de la glaçure à l�Époque moderne. La période du XVe-XVIIe siècle présente la plus grande variabilité des épaisseurs.
Graphique 4 : Diagramme présentant les épaisseurs des glaçures selon les périodes.
53
Tableau 8 : Moyennes des épaisseurs de glaçure des échantillons de Sadirac selon les sites.
Tableau 9 : Moyennes des épaisseurs de glaçure des échantillons de Sadirac selon les périodes.
Ces glaçures sont ponctuées de bulles. Celles-ci présentent des diamètres variables et sont plus ou moins abondantes en fonction des tessons. Elles sont le résultat du dégazage de la terre cuite pendant la cuisson. De plus, les images réalisées au microscope électronique à balayage nous présentent plusieurs textures de glaçures (Figure 21).Certaines sont plutôt homogènes, d�autres présentent des cristaux de néoformation au niveau de la zone d�interface(a), probablement dus à un refroidissement lent, tandis que d�autres présentent ces cristaux dans toute l�épaisseur de leur glaçure fondus (b). L�absence ou la très rare présence de grains ou d�inclusions non fondus
Site Épaisseur (mm)
Sadirac Laurent Videau st 15 moy. 92
n=8 s 26
Sadirac Laurent Videau st 2 moy. 90
n=2 s 42
Sadirac Laurent Videau st 3 moy. 95
n=3 s 41
Sadirac Lorient LaVie st 1 moy. 73
n=6 s 12
Sadirac Lorient LaVie st 3 moy. 112
n=11 s 50
Sadirac Lorient LaVie st x moy. 122
n=4 s 38
Sadirac Tioulet st 2002 moy. 54
n=4 s 29
Sadirac Tioulet st 6003 moy. 97
n=7 s 30
Siron moy. 120
n=9 s 37
Période Épaisseur (mm)
XIVe-début XVe moy. 96
n=9 s 26
Fin XVe-début XVIIe moy. 81
n=8 s 65
Fin XVIIe-XVIIIe moy. 101
n=39 s 39
XIXe moy. 131
n=5 s 32
54
permet d�avancer que le mélange glaçurant est probablement de granulométrie plutôt faible, laissant penser aussi à un broyage ou à l�ajout de grandes quantités de fondant.
Figure 21 : Images réalisées au microscope électronique à balayage (mode BSE ou ER) de l�ensemble glaçure -terre cuite et de leurs textures.
55
On observe aussi plusieurs formes d�altération comme la lixiviation. Cette altération peut s�opérer en surface de la glaçure (c), par endroit suivre les fissures engendrées par le phénomène de trésaillure (d), ou simplement être présente sous la forme de craquelures ou d�irrégularités (e). Certaines glaçures sont dans un très mauvais état. Est-ce une altération naturelle, due à son emploi, à son enfouissement ou à sa mauvaise qualité ? La question se pose. De plus, certaines glaçures qui ont une forte concentration en étain présentent clairement de petits cristaux de cassitérite (g). Finalement, nous avons tenté de déterminer le nombre de cuisson des céramiques, et donc de comprendre si l�application du mélange glaçurant se faisait plutôt sur la forme crue ou sur le « biscuit ». Pour ce faire, nous avons non seulement pris en compte la largeur de la zone d�interaction terre cuite � glaçure, mais aussi les types de textures observées. Des travaux antérieurs nt permis de démontrer que dans le cas d�une application sur le support cru, les phénomènes d�interaction sont plus importants. Ainsi, mesurer l�épaisseur de cette zone d�interaction peut permettre d�avancer des hypothèses concernant le nombre de cuisson et la méthode d�application du mélange glaçurant (saupoudrage, au pinceau, trempage, etc.) (Tite et al., 1998 ; Rhodes, 1999 ; Ben Amara, 2002 ; Emery, 2012). De plus, le matériel trouvé en fouille présente pour les mêmes formes des exemples de biscuits et d�objets glaçurés. Cela est une preuve irréfutable du procédé de double cuisson à Sadirac. La monocuisson, elle, reste plus complexe à démontrer. Nous arrivons à la conclusion que certaines céramiques étaient glaçurées à cru, et d�autre suite à une première cuisson de la forme. De ce fait, au moins deux types d�application coexistent à Sadirac. Cependant, la double cuisson semble se rencontrer dans toutes les périodes étudiées. Il est difficile d�évaluer le nombre de cuisson pour certaines céramiques, puisqu�une grande surface d�interaction peut être due autant à une monocuisson, qu�à une double cuisson suivie d�un refroidissement lent. Toutefois, nous pouvons affirmer que les deux techniques sont utilisées dès le début de XIVe siècle. Deux céramiques d�une même structure peuvent aussi présenter des caractéristiques différentes. L�intérêt de pratiquer ces deux techniques simultanément est discutable. Il faut peut-être imaginer différentes techniques utilisées par des potiers de Sadirac qui viennent cuire dans un même four, ou bien penser à la production de glaçure de meilleure qualité pour certaines formes, etc.
�
56
7. Résultats�des�analyses�en�MEB-EDS�
Les échantillons de Sadirac ont été analysées par spectrométrie de rayons X en dispersion d�énergie couplée à un microscope électronique à balayage (MEB-EDS). Des soixante-et-un (61) échantillons à l�étude, cinquante-huit (58) ont pu être analysés dû au manque de temps. Les résultats des analyses seront présentés selon les sites et les périodes. Les données complètes des analyses sont présentées en Annexe 7.
7.1 L�analyse�des�terres�cuites�
Les terres cuites des échantillons ont été analysées et révèlent des compositions chimiques moyennes présentées dans le Tableau 10. Les teneurs en silicium et en aluminium sont majoritaires à 69% pour le SiO2 et 22%, ces éléments étant les deux principaux constituants des argiles (phyllosilicates ou aluminosilicates). Puisque ces céramiques contiennent moins de 5% de CaO, les argiles utilisées sont fortement siliceuses. En effet, le CaO présent à seulement 0.37% nous indique bien l�utilisation d�argiles d�origine lacustre ou fluviatile, plutôt que marine. Ceci confirme l�emploi des argiles siliceuses de Sadirac par les potiers. Les éléments mineurs sont le Fe2O3 et le K2O. Ils présentent respectivement des teneurs moyennes inférieures à 3%, soit 2.5% et 2.9%. L�oxyde de fer est présent a priori sous la forme d�hématite et donne une couleur beige-rosé à la pâte lorsque la poterie est cuite en atmosphère oxydante. Quand au potassium, il est présent naturellement dans les minéraux silicatés. Les éléments mineurs comme le sodium, le magnésium et le titane sont présents dans les sols et les argiles. Ils ont des teneurs inférieures à 1% : le TiO2 ayant une concentration de 0.97%, le MgO de 0.73% et le Na2O de 0.40%. Finalement, le phosphore et le chlore sont des éléments présents dans les terres cuites et liés aux procédés d�altération post-enfouissement. Ils sont contenus à des taux très faibles de 0.25% pour le P2O5 et 0.06% pour le Cl, et ne seront pas pris en compte lors des comparaisons.
Tableau 10 : Valeurs moyennes obtenues en MEB-EDS sur les pâtes des céramiques de Sadirac (n = 58).
7.2 L�analyse�des�glaçures�
Les glaçures d�objets et de tessons de huit sites différents répartis sur quatre périodes ont été analysées. Puisque certains échantillons comportent une glaçure double, c�est-à-dire sur la surface interne et la surface externe de l�échantillon, nous avons décidé d�analyser ces deux glaçures individuellement. Cette décision tient du désir de vérifier si ces deux glaçures d�un même échantillon ont des compositions chimiques identiques. Il existe supposément une méthode plus économique pour les potiers qui consistait en l�application d�une glaçure plombifère non colorée sur la face interne d�un objet. En cuisant cette forme glaçurée à l�envers, une atmosphère réductrice se produit à l�intérieure de celle-ci. Grâce au fer contenu dans la pâte, la glaçure prend une couleur verte, sans l�ajout de cuivre. On aurait probablement utilisée cette méthode sur les grandes formes comme les moules à pain de sucre et les recettes à
Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 Cl K2O CaO TiO2 Fe2O3
moy. 0.40 0.73 22.17 69.61 0.25 0.06 2.88 0.37 0.97 2.54
s 0.05 0.09 1.46 2.47 0.26 0.02 0.28 0.12 0.09 0.94
s relatif (%) 12 13 7 4 102 31 10 31 9 37
Oxydes en %m
57
mélasse produits à Sadirac. De ce fait, en comparant les compositions chimiques, nous pourrons voir si cette même technique s�applique aux céramiques étudiées ici. Ainsi, le total de glaçures analysées en spectrométrie de rayons X en dispersion d�énergie est de soixante-et-un (61). Les valeurs moyennes des glaçures sont présentées dans le Tableau 11. Les résultats montrent une glaçure fortement plombifère colorée au cuivre. En prenant en compte le fort taux d�Al2O3, nous proposons que les potiers aient utilisé l�argile comme source de silicium. Contrairement au sable qui se compose de SiO2 pratiquement pur, l�argile apporte une quantité non négligeable d�aluminium. Cet ajout d�argile au mélange glaçurant explique possiblement les 60% de PbO observé. En effet, l�Al2O3 et le SiO2 étant deux éléments réfractaires présents ici en grande quantité, il a fallu ajouter une quantité considérable de plomb pour amener le mélange glaçurant à une température de fusion atteignable avec les fours de potiers, soit environ 900 à 1000° C (Rice, 1987). Les autres éléments sont tous présents en traces (<1%). La présence des éléments Na, Mg, K, Ca, Ti et Fe est à mettre en lien avec l�ajout d�argile au mélange. Quant au zinc, à l�étain et à l�arsenic, leur présence est à corréler avec certains composés de la glaçure (plomb, cuivre,�).
Tableau 11 : Valeurs moyennes obtenues en MEB-EDS sur des glaçures de céramiques de Sadirac (n = 61).
8. Comparaison�des�résultats�par�site�:�
Voyons maintenant la distribution des compostions chimiques selon les sites sadiracais à l�étude. Ces sites ou fouilles archéologiques sont au nombre de huit, ils comprennent :
· Fréchinet
· Jean d�Arnaud au Château Pabus
· Trois structures de Laurent Videau
· Deux structures de Lorient à l�aménagement LaVie
· Le casse
· Deux secteurs de Sableyre (A et C)
· Les près de Siron
· Trois structures de Tioulet
· Et un échantillon provenant d�un ramassage de surface.
Chaque structure d�un même site a été considérée comme un ensemble clos lors des fouilles de L�INRAP. Ces « ensembles clos » constituent un concept essentiel de la pensée archéologique et sont indispensables aux interprétations archéologiques. De ce fait, leurs assemblages constituent des groupes non apparentés s�ils sont de périodes différentes.
Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 Fe2O3 CuO PbO ZnO SnO2 As2O3
moy. 0.15 0.36 7.70 27.55 0.79 0.49 0.38 0.91 1.13 60.04 0.37 0.70 0.64
s 0.05 0.08 1.87 3.80 0.24 0.46 0.09 0.25 0.76 5.42 0.17 0.96 0.37
s relatif (%) 33 24 24 14 31 93 23 27 67 9 46 136 58
Oxydes en %m
58
8.1 Les�glaçures�
Le Tableau 12 présente les différentes valeurs moyennes des glaçures par site. On peut voir que les éléments majeurs restent principalement constants. Les différences les plus significatives résident dans la variation des teneurs en cuivre et l�irrégularité des teneurs de zinc, d�étain et d�arsenic. Dans le but de mieux représenter ces compositions chimiques et d�évaluer leur distribution selon les sites, les données ont été repris sous la forme de box plots (ou boîtes à moustache). Les résultats obtenus pour les glaçures correspondent aux Figure 22 et Figure 23. Il est à noter que seuls les sites ayant livré plus de quatre échantillons sont représentés. Nous nous appuierons sur ces représentations graphiques des données pour fonder notre raisonnement. Tout d�abord, on remarque que certains éléments ne varient que très peu. Ceux-ci sont le sodium, le magnésium, le potassium, le calcium, le titane et le fer. Ces six éléments sont apportés dans le mélange glaçurant par l�ajout d�argile. Leurs concentrations ne dépassent pas les 1.2% (valeurs maximales pour K2O et Fe2O3). Quant au silicium et à l�aluminium, ils vont de pair. Tous les deux découlent de l�ajout d�argile au mélange glaçurant. Cependant, les concentrations en aluminium semblent varier selon les sites. La structure 1 et la structure x de Lorient LaVie et les deux structures de Tioulet sont les quatre ensembles de tessons dont les glaçures sont les plus riches en aluminium, leurs concentrations allant jusqu�à 11%. Tous les éléments que nous venons de citer ci-haut sont aussi présents dans les terres cuites. Lors de la cuisson, la glaçure étant en fusion, plusieurs éléments ont pu migrer du support vers la glaçure et inversement. Ce phénomène est d�autant plus important quand l�application du mélange glaçurant se fait sur une forme crue, c�est-à-dire lors d�une monocuisson. Les différences de composition selon les sites sont plus prononcées au niveau du plomb et du cuivre. En effet, les teneurs en PbO sont hétérogènes, passant de 48% à 73%. L�ensemble de la structure 1 et de la structure x du site de Lorient LaVie comporte une grande variation pour ses teneurs en PbO, présentant plus de 20% d�écart entre la teneur la plus forte et la plus faible. Ceci n�est pas le cas de l�ensemble de Laurent Videau (structures 2 et 3). En effet, la distribution est très concentrée tout comme pour les céramiques de Siron. Quant au cuivre, une réelle différence s�observe entre deux structures du même site : la structure 15 et les structures 2 et 3 de Laurent Videau. Les concentrations en CuO sont deux fois plus élevées pour les céramiques de la structure 15. D�une manière générale, la structure 15 de Laurent Videau se détache des autres groupes à l�étude de par sa teneur en cuivre élevée.
59
Tableau 12 : Valeurs moyennes obtenues en MEB-EDS sur des glaçures de céramiques de Sadirac (n = 61) selon les sites à l�étude.
Ce même ensemble présente aussi des teneurs en As2O3 allant jusqu�à 1.19%. En réalité, tous les échantillons contenant des traces d�arsenic détectés par le MEB-EDS proviennent de Laurent Videau. Le zinc est un autre élément chimique retrouvé dans certaines glaçures. Encore une fois, il est présent dans les céramiques de Laurent Videau. Cependant, on le trouve aussi dans sept échantillons de la structure 3 de Lorient LaVie, dans tous les échantillons de Siron et dans les échantillons de Jean d�Arnaud, Le casse, Sableyre A et Fréchinet. Finalement, le SnO2 est présent dans les compositions des glaçures de sept ensembles. Tous les échantillons en contiennent à de très faible valeur (<0.6% en moyenne). Les échantillons de Laurent Videau en contiennent aussi, mais les ensembles de ce site n�ont pas des teneurs équivalentes. Les structures 2 et 3 en contiennent près de trois fois plus que la structure 15. Cependant, la structure 2 de Tioulet a livré un échantillon particulier. Celui-ci, le BDX 16007, compte une concentration en SnO2 de 4.77%. De même, pour l�échantillon BDX 15738 de Laurent Videau structure 3, la concentration en SnO2 dépasse les 2%. Avec une telle concentration en étain, le désir d�opacification de ces glaçures est évident.
Site moy./é.t. Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 Fe2O3 CuO PbO ZnO SnO2 As2O3
Fréchinet moy. 0.14 0.37 6.38 27.20 0.63 0.30 0.34 0.81 1.46 61.85 0.47 0.21 nd
n=2 s 0.04 0.06 0.35 1.27 0.09 0.00 0.02 0.17 0.38 2.48 0.17 � �
Sadirac Laurent Videau st 15 moy. 0.12 0.38 7.14 28.25 0.68 0.72 0.37 0.92 2.44 57.97 0.53 0.36 0.75
n=8 s 0.03 0.09 0.86 2.98 0.17 0.50 0.08 0.18 0.50 4.49 0.06 0.16 0.33
Sadirac Laurent Videau st 2 moy. 0.13 0.27 6.18 25.34 0.60 0.49 0.27 0.70 1.19 63.47 0.39 0.93 0.16
n=2 s 0.01 0.04 1.65 1.69 0.01 0.48 0.06 0.20 0.28 1.33 0.06 0.21 �
Sadirac Laurent Videau st 3 moy. 0.12 0.38 6.39 29.84 0.62 0.69 0.35 1.00 1.21 58.21 0.51 1.23 0.24
n=3 s 0.06 0.11 1.93 1.21 0.04 0.49 0.08 0.24 0.28 0.60 0.12 1.25 �
Sadirac Lorient LaVie st 1 moy. 0.13 0.34 8.70 25.91 0.78 0.31 0.42 0.87 0.88 61.65 nd 0.52 nd
n=6 s 0.04 0.05 1.40 4.33 0.21 0.16 0.08 0.18 0.34 6.06 � 0.43 �
Sadirac Lorient LaVie st 3 moy. 0.17 0.35 6.42 26.99 0.67 0.33 0.32 0.94 1.02 62.36 0.50 1.05 nd
n=10 s 0.07 0.11 1.94 3.38 0.18 0.19 0.08 0.29 0.55 4.42 0.19 � �
Sadirac Lorient LaVie st x moy. 0.16 0.37 9.69 26.36 0.88 0.43 0.44 1.15 0.56 60.04 nd nd nd
n=4 s 0.03 0.10 2.36 5.83 0.27 0.22 0.09 0.46 0.04 8.98 � � �
Sadirac Tioulet st 2002 moy. 0.16 0.38 8.58 27.68 0.91 0.75 0.44 0.94 1.04 57.73 0.24 2.67 nd
n=4 s 0.09 0.04 1.75 2.56 0.15 0.73 0.08 0.18 0.30 4.10 � 2.97 �
Sadirac Tioulet st 6003 moy. 0.16 0.41 9.73 29.21 1.15 0.48 0.44 1.01 1.22 56.19 nd nd nd
n=7 s 0.04 0.11 1.50 4.17 0.33 0.17 0.08 0.29 0.74 6.31 � � �
Siron moy. 0.16 0.32 6.90 27.65 0.78 0.35 0.35 0.79 0.50 61.77 0.26 0.23 nd
n=9 s 0.04 0.08 1.11 3.17 0.18 0.20 0.07 0.16 0.18 2.73 0.08 0.24 �
Site n=1 Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 Fe2O3 CuO PbO ZnO SnO2 As2O3
Jean-d'Arnaud, Château Pabus 0.20 0.34 9.36 35.84 0.92 0.15 0.51 1.15 0.29 50.29 0.23 0.74 nd
Le Casse 0.15 0.29 7.36 21.43 0.62 0.28 0.36 0.57 0.82 67.21 0.30 0.62 nd
Ramassage de surface 0.09 0.30 7.83 24.19 0.52 0.19 0.38 0.81 0.55 65.13 nd nd nd
Sableyre secteur A 0.16 0.34 8.07 22.25 0.72 0.38 0.40 0.68 0.11 66.94 0.07 nd nd
Sableyre secteur C 0.23 0.40 6.39 35.85 0.92 2.85 0.29 1.13 2.59 48.03 nd 1.34 nd
Sadirac Tioulet st 1001 0.15 0.38 9.88 25.26 1.02 0.42 0.35 0.64 0.16 61.75 nd nd nd
Oxydes en %m
60
Figure 22 : Résultats des analyses MEB-EDS des glaçures présentés en box plot selon les sites. Les valeurs entre parenthèses exprimées en rapport expriment les échantillons où l�élément a été détecté par comparaison à l�ensemble.
61
Figure 23 : Résultats des analyses MEB-EDS des glaçures présentés en box plot selon les sites (suite).
62
8.2 Les�terres�cuites�
Concernant l�analyse des pâtes, le Tableau 13 montre les moyennes et les écart-type pour chaque site. Toujours dans l�optique de mieux représenter ces résultats, la Figure 24 expose la distribution des données en box plot. Les analyses au MEB-EDS ont dévoilées des résultats constants pour le sodium, le magnésium et le potassium. Cependant, le site de Laurent Videau semble encore se détacher des autres de par ses compositions.
Tableau 13 : Valeurs moyennes obtenues en MEB-EDS sur les terres cuites des échantillons de Sadirac (n = 58) selon les sites à l�étude.
En effet, les teneurs en Al2O3, SiO2, CaO, TiO2 et Fe2O3 divergent des autres sites à l�étude, mais surtout, on remarque une discordance entre la structure 15 et les structures 2-3 du site Laurent Videau. Même si ces trois structures datent des XVIIe-XVIIIe siècles, la structure 15 semble
Site moy./é.t. Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 Cl K2O CaO TiO2 Fe2O3
Fréchinet moy. 0.37 0.65 20.35 72.18 0.13 0.06 2.63 0.30 0.80 2.55
n=2 s 0.03 0.16 1.65 2.15 0.04 0.00 0.32 0.10 0.02 0.19
Sadirac Laurent Videau st 15 moy. 0.40 0.81 23.99 65.59 0.13 0.04 2.94 0.46 1.10 4.49
n=6 s 0.02 0.06 0.46 1.23 0.03 0.01 0.08 0.03 0.04 0.83
Sadirac Laurent Videau st 2 moy. 0.38 0.69 22.75 69.66 0.14 0.07 2.97 0.34 0.96 2.09
n=2 s 0.01 0.08 1.54 0.72 0.00 0.02 0.17 0.08 0.02 0.85
Sadirac Laurent Videau st 3 moy. 0.36 0.71 21.09 70.99 0.15 0.05 2.76 0.30 0.94 2.65
n=3 s 0.04 0.02 0.17 0.52 0.03 0.01 0.03 0.01 0.06 0.46
Sadirac Lorient LaVie st 1 moy. 0.37 0.69 21.58 70.40 0.32 0.05 2.92 0.44 0.97 2.26
n=6 s 0.04 0.05 1.07 1.90 0.21 0.02 0.47 0.15 0.05 0.35
Sadirac Lorient LaVie st 3 moy. 0.39 0.81 21.78 69.83 0.17 0.06 2.95 0.35 0.94 2.72
n=9 s 0.03 0.08 0.85 1.28 0.03 0.01 0.24 0.05 0.05 0.62
Sadirac Lorient LaVie st x moy. 0.42 0.75 22.85 68.58 0.49 0.05 3.00 0.49 1.05 2.30
n=4 s 0.04 0.02 0.60 1.74 0.59 0.01 0.29 0.29 0.11 0.36
Sadirac Tioulet st 2002 moy. 0.34 0.69 21.80 70.90 0.28 0.07 2.81 0.31 0.92 1.88
n=4 s 0.03 0.05 2.44 3.24 0.16 0.02 0.28 0.04 0.13 0.29
Sadirac Tioulet st 6003 moy. 0.37 0.68 22.20 70.17 0.51 0.06 2.73 0.37 0.96 1.94
n=7 s 0.03 0.08 1.07 1.85 0.48 0.01 0.21 0.11 0.05 0.26
Siron moy. 0.44 0.72 21.85 70.29 0.17 0.08 3.03 0.34 0.93 2.14
n=9 s 0.07 0.11 1.85 2.48 0.05 0.03 0.26 0.09 0.06 0.34
Site n=1 Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 Cl K2O CaO TiO2 Fe2O3
Jean-d'Arnaud, Château Pabus 0.49 0.57 21.02 72.30 0.08 0.08 2.16 0.19 0.87 2.24
Le Casse 0.47 0.54 21.59 72.09 0.15 0.12 2.58 0.34 0.86 1.27
Ramassage de surface 0.48 0.69 22.27 70.12 0.34 0.09 2.70 0.36 0.93 2.02
Sableyre secteur A 0.46 0.69 25.00 65.64 0.62 0.08 3.39 0.49 1.12 2.52
Sableyre secteur C 0.42 0.66 20.63 72.31 0.22 0.07 2.51 0.29 0.94 1.96
Sadirac Tioulet st 1001 0.39 0.66 22.85 70.20 0.19 0.07 2.80 0.27 0.93 1.64
Oxydes en %m
63
révéler un ensemble d�objets singulier. Les quantités respectives de CaO et de TiO2 sont supérieures pour la structure 15. De plus, les teneurs en aluminium sont plus élevées par rapport aux autres. Surtout, les concentrations en silicium sont beaucoup plus basses. Elles présentent une moyenne autour de 65%, quand les autres sites ont plutôt des valeurs de 70%. Quant aux teneurs en Fe2O3 des terres cuites des échantillons de la structure 15, elles se détachent particulièrement des autres ensembles, la quantité de fer y étant presque doublée, résultant en des pâtes visiblement plus rouge, tout comme les structures 2 et 3 de Lorient LaVie. La structure 15 de Laurent Videau se détachait des autres structures du même site et des objets des autres sites avec les compositions de ses glaçures, les terres cuites viennent confirmer cette dissemblance.
64
Figure 24 : Résultats des analyses MEB-EDS des terres cuites présentés en box plot selon les sites.�
65
8.3 Discussion�
Si nous résumons, nous avons vu que tous les échantillons des ensembles clos et des sites présentaient des compositions chimiques semblables pour tous les éléments majeurs et mineurs des glaçures et des terres cuites. Certains éléments traces comme le Na, le Mg, le K, le Ca, le Ti et le Fe sont aussi plutôt stables dû à leur constance dans l�argile. De plus, les analyses ont permis de révéler l�utilisation de la terre argileuse comme source de silicium dans le mélange glaçurant. Le Graphique 5 montre que les rapports SiO2/Al2O3 des glaçures et des terres cuites sont les mêmes dans la grande majorité des cas. Cependant, une structure a livré du matériel présentant des compositions chimiques différentes non seulement des autres sites, mais aussi des autres structures du même site. Ainsi, la structure 15 du site Laurent Videau présente des quantités singulières de CaO, de TiO2, de Fe2O3, de SiO2 et d�Al2O3 de ses terres cuites, mais aussi des teneurs différentes en As2O3 et en cuivre de ses glaçures. Ces résultats doivent possiblement être mis en lien avec un changement de source d�argile et l�utilisation de matières premières différentes pour la production des objets provenant de cette structure. Quelques échantillons présentent des concentrations faibles en ZnO, SnO2 et As2O3 dans leurs glaçures. Ces éléments chimiques ont peut-être été ajoutés aux glaçures involontairement si on considère qu�ils sont parfois présents en traces dans des minerais de plomb ou de cuivre. Le Graphique 6 montre le rapport CuO/As2O3. Il semblerait que la quantité d�arsenic dans les glaçures soit à mettre en lien avec la quantité de cuivre ajouté. De ce fait, l�arsenic serait un élément contenu en traces dans le minerai de cuivre utilisé par certains potiers comme élément chromogène. Dans ce même ordre d�idées, le zinc semble aussi ajouté involontairement au mélange glaçurant par l�intermédiaire du cuivre (Graphique 7). Quant à l�étain, il semble n�avoir aucun rapport avec le plomb ou le cuivre. Seulement deux échantillons montrent un ajout de SnO2 intentionnel. En effet, plus de 2% et de 4% d�étain sont présents dans ces glaçures. À ces teneurs, l�opacification de la glaçure est intentionnelle (Rhodes, 1999). On peut se demander si ceci fait partie d�expérimentations d�opacification par la cassitérite vers le XVIe siècle à Sadirac.
Graphique 5 : Les rapports SiO2/Al2O3 des glaçures et des terres cuites montrent une correspondance dans la majorité des cas. Ceci implique l�utilisation
des mêmes argiles pour la confection des terres cuites et des glaçures.
66
Graphique 6 : Variation des concentrations en CuO par rapport à l�As2O3.
��
�
9. Comparaison�des�résultats�par�période�:�
Suivant nos objectifs d�étude, voyons maintenant les compositions chimiques des glaçures et des terres cuites, ainsi que leur distribution selon les quatre périodes déterminées :
· Période 1 : XIVe � début XVe siècle ;
· Période 2 : fin XVe � début XVIIe siècle ;
· Période 3 : fin XVIIe � XVIIIe siècle ;
· Période 4 : XIXe siècle (nos échantillons sont tous du premier ¼).
Pour créer ces groupes, nous avons séparé tous les échantillons indépendamment de leur provenance respective. Le but de cette approche est de vérifier si des tendances se dessinent au cours des siècles, laissant apparaître des changements de la structure sociale et professionnelle dans l�artisanat potier de Sadirac.
9.1 Les�glaçures�
Le Tableau 14 présente les moyennes et écarts-types des compositions chimiques obtenues pour chaque période. Dans le but de mieux visualiser d�éventuelles variations selon les périodes, les Figure 25 et Figure 26 montrent les dispersions des données concernant les glaçures sous la forme de box plot.
Graphique 7 : Variation des concentrations de ZnO par rapport à CuO.
67
Tableau 14 : Valeurs moyennes obtenues en MEB-EDS sur les glaçures des échantillons de Sadirac (n = 61) selon les périodes à l�étude.
Le Na2O, le MgO, le CaO et le TiO2 semblent présenter des quantités semblables pour toutes les périodes. Les moyennes de ces éléments restent aussi plutôt stables. Comme nous l�avons vu plus haut, ces éléments sont apportés par l�argile ajoutée au mélange glaçurant. Leurs teneurs sont donc faibles (éléments traces). D�autres éléments proposent des tendances. Effectivement, les quantités de PbO augmentent dans les glaçures au fil des siècles, tandis que le potassium, l�oxyde d�étain, le ZnO et l�aluminium diminuent. Le silicium semble aussi suivre cette tendance et diminue lentement jusqu�à la dernière période. En général, toutes les données de la dernière période qui concerne le tout début du XIXe siècle présentent des dispersions plus faibles, ceci apparaît par des box plots plus condensés. En d�autres mots, cette période 4 impliquerait des recettes de glaçures moins hétérogènes, plus contrôlées. De plus, cette dernière période montre une forte diminution des teneurs en cuivre, en fer et en silicium, mais une augmentation des teneurs en plomb de plus de 4% par rapport à la période 1 (XIVe-XVe siècle).
Période moy./é.t. Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 Fe2O3 CuO PbO ZnO SnO2 As2O3
1 moy. 0.15 0.39 9.34 27.88 1.03 0.44 0.43 0.95 1.02 58.38 0.07 nd nd
n=9 s 0.04 0.10 1.52 4.50 0.37 0.18 0.07 0.28 0.76 6.99 � � �
2 moy. 0.16 0.38 7.92 28.28 0.85 0.86 0.38 0.89 1.23 58.05 0.39 1.72 nd
n=8 s 0.07 0.04 1.77 3.61 0.18 0.96 0.08 0.19 0.72 5.34 0.18 2.09 �
3 moy. 0.15 0.35 7.30 27.62 0.73 0.44 0.36 0.92 1.22 60.36 0.43 0.62 0.64
n=39 s 0.05 0.09 1.87 3.93 0.19 0.34 0.09 0.26 0.78 5.24 0.18 0.50 0.37
4 moy. 0.16 0.35 7.39 26.24 0.70 0.42 0.38 0.80 0.53 62.66 0.27 0.16 nd
n=5 s 0.03 0.07 0.82 2.63 0.10 0.21 0.06 0.09 0.17 2.56 0.06 0.07 �
Oxydes en %m
68
Figure 25 : Résultats des analyses MEB-EDS des glaçures présentés en box plot selon les périodes.
69
�
Figure 26 : Figure 27 : Résultats des analyses MEB-EDS des glaçures présentés en box plot selon les périodes (suite).
70
9.2 Les�terres�cuite�
Considérant l�analyse des pâtes, les analyses archéométriques ont été menées sur cinquante-huit (58) échantillons et le Tableau 15 montre les moyennes et les écarts-types pour chaque période à l�étude. Toujours dans une optique de mieux représenter ces résultats, la Figure 28 expose la distribution des données en box plot.
Tableau 15 : Valeurs moyennes obtenues en MEB-EDS sur les terres cuites des échantillons de Sadirac (n = 58) selon les périodes à l�étude.
Les analyses au MEB-EDS ont dévoilées des résultats constants pour la plupart des éléments chimiques. En effet, aucune variabilité marquée n�apparaît. Cependant, certaines tendances se dessinent. Le sodium et le potassium semble en suivre une. En effet, de faibles augmentations des taux de ces composés sont visibles. Concernant le fer, la période 3 (fin XVIIe-XVIIIe) montre une nette différence dans sa distribution. Les quantités de Fe2O3 semblent plus variables et sont étendues. Certains échantillons présentent des teneurs allant jusqu�à plus de 5%. De même pour le CaO qui présente des teneurs plus élevées, mais surtout plus variables, pendant la période 3. Les échantillons de la structure 15 du site de Laurent Videau faisant partie de cette période 3 expliquent probablement la variation observée. La structure 15 s�étant démarquée des autres ensembles, il est logique qu�elle tende à faire varier les distributions selon les périodes.
�
Période moy./é.t. Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 Fe2O3
1 moy. 0.39 0.69 22.52 69.66 2.80 0.39 0.98 2.01
n=9 s 0.05 0.07 1.31 2.20 0.29 0.11 0.07 0.29
2 moy. 0.37 0.67 21.42 71.31 2.73 0.30 0.90 2.03
n=8 s 0.03 0.07 1.93 2.41 0.25 0.05 0.10 0.39
3 moy. 0.40 0.74 22.22 69.37 2.90 0.39 0.98 2.72
n=36 s 0.04 0.09 1.27 2.24 0.29 0.13 0.09 0.92
4 moy. 0.47 0.70 21.68 70.53 3.07 0.35 0.93 2.01
n=5 s 0.06 0.08 1.98 2.69 0.29 0.11 0.06 0.40
Oxydes en %m
71
Figure 28 : Figure 29 : Résultats des analyses MEB-EDS des terres cuites présentés en box plot selon les périodes.
72
9.3 Discussion��
En général, pour les distributions selon les périodes, une grande tendance s�impose. En effet, il semblerait qu�on observe une diminution des composés réfractaires et une augmentation du fondant. Ainsi, la dernière période montre une baisse de silicium et d�aluminium, mais une augmentation considérable en plomb. Ces choix sont techniques, puisqu�ils mènent à une diminution de la température de fusion du mélange glaçurant. De plus, face à la baisse de variabilité des mélanges glaçurants, il est possible d�avancer que les potiers préparaient des mélanges selon des recettes plus strictement suivies. En effet, les matières premières composant la glaçure sont consciencieusement intégrées, dans des quantités probablement calculées. Les périodes qui précèdent ces changements présentent cependant de fortes variabilités des recettes, en plus de fort variabilité des épaisseurs de glaçure. Ces deux constats sont probablement à mettre en lien avec les modes d�application de la glaçure (saupoudrage, au pinceau, par trempage,�) et la nature de mélange glaçurant (poudre, liquide, �) qui doivent différer d�une production à l�autre. De plus, la diminution du fer dans les glaçures peut nous proposer une tendance à contrôler la couleur des glaçures, c�est-à-dire à leur donner une teinte plus neutre. En effet, le fer colore la glaçure de pâles teintes de jaune et d�orangé qui sont imprévisibles. S�en affranchir peut permettre de diminuer la quantité de cuivre ajouté. Tout ceci porte à proposer un changement dans l�artisanat potier : la recherche de rentabilité des productions. Abaisser la température de fusion des glaçures implique une diminution des temps de cuisson ou sinon, une diminution de la température maximale atteinte dans les fours. De ce fait, soit les fours deviennent plus grands, soit on garde les mêmes fours et on réalise une économie de combustible. « Au milieu du XVIIe siècle, une nouvelle génération de fours voit le jour » (Régaldo-Saint Blancard, 2000). Ceux-ci ont des capacités équivalentes à huit fois celles d�un four du Moyen Âge. Dès lors, l�artisanat potier évolue tranquillement vers une industrialisation qui s�installe au XIXe siècle. Par conséquent, on voit apparaître un tout nouveau genre d�organisation sociale chez les potiers. Les productions sont rentabilisées et plus industrialisées.
�
73
Bilan�général�et�perspectives�
L�objectif de cette étude était de présenter les analyses réalisées au Centre de Recherche en Physique Appliqué à l�Archéologie (CRP2A) sur soixante-et-un échantillons de céramiques provenant de Sadirac. Ces céramiques datent de périodes s�inscrivant du XIVe au XIXe siècle et proviennent de huit sites archéologiques différents, répartis sur la commune. Nous avons travaillé à la caractérisation des glaçures des poteries de Sadirac en ayant un double objectif. Premièrement, nous voulions effectuer une première approche des recettes de glaçures pour comprendre les matières premières et techniques mises en �uvre pour leur fabrication. Deuxièmement, nous avions l�objectif d�évaluer et d�interpréter les variations spatio-temporelles des glaçures.
! Les résultats d�analyses par spectrométrie de rayons X en dispersion d�énergie couplée à un microscope électronique à balayage (MEB-EDS) ont permis de mieux définir l�artisanat potier de Sadirac. Parmi les résultats, nous retiendrons en premier lieu que les recettes de glaçures présentent de taux de silicium et d�aluminium menant à la confirmation de l�intégration de l�argile dans le mélange glaçurant. De fortes teneurs en plomb servent à pallier cet ajout d�argile, tandis que l�ajout du cuivre (Cu2+) apporte la coloration verte. Cependant, même si la tendance à diminuer la quantité de fer dans les céramiques impliquait probablement un contrôle de la couleur des glaçures, les mesures physiques de la couleur n�ont pu démontrer cette atténuation de l�influence du fer. En effet, ceci s�explique par la nature transparente d�une glaçure. De ce fait, le support aura toujours une implication dans le couleur finale observée ou mesurée, sauf si la glaçure est plus épaisse et potentiellement opaque. En deuxième lieu, à la lumière des variations de compositions chimiques observées, nous ne pouvons démontrer statistiquement de groupes selon les sites ou les périodes, les variations étant trop importantes. Les variations spatiales découlent probablement de techniques mises en �uvre par les potiers et de l�utilisation de matières premières d�origines diverses. Par surcroît, les sols de Sadirac renferment des gisements d�argiles de familles différentes que les potiers mélangent probablement dans des proportions variables. L�exemple du site Laurent Videau (structures 2, 3 et 15) montre clairement que les variations intrasites sont aussi importantes, voire plus importantes, que les variations intersites, cela pour les terres cuites et les glaçures. Cependant, nous avons vu que des éléments traces comme l�arsenic, le zinc et l�étain sont parfois caractéristiques de certaines productions. Quant aux variations temporelles, elles semblent être beaucoup plus marquées pour la dernière période à l�étude, le XIXe siècle. Même si de grandes tendances se dessinent à partir du XVIIe siècle, ce n�est qu�à partir de cette période que les céramiques présentent des recettes plus uniformes et adaptées à une production protoindustrielle. L�optimisation de la production et son uniformisation, ainsi que la recherche de meilleurs rendements démontrent une réorganisation sociale à Sadirac. On passe de productions artisanales élaborées par des potiers mi-artisans, mi-cultivateurs, à l�affectation d�un métier. Enfin, nous avons vu que des éléments comme le Zn, le Sn et l�As, présents principalement à l�était de traces (<1%), peuvent être rattachés aux minerais ou oxydes métalliques intégrés au mélange glaçurant. De ce fait, nous avons avancé que le cuivre apporte probablement l�arsenic et le zinc dans des teneurs variables. Cependant, la présence fortuite du SnO2 n�est liée à aucun autre élément présent dans le mélange glaçurant, du moins dans des rapports significatifs. De ce
74
fait, il est possible d�avancer que la cassitérite soit une pollution. Nous proposons trois hypothèses. Premièrement, cette pollution de SnO2 retrouvée dans les compositions chimiques d�échantillons pourrait nous mener à une pollution dans l�atelier. Il faut donc imaginer un atelier produisant à la fois des céramiques glaçurées et des faïences ou autres types de céramiques comportant une glaçure opacifiée à l�oxyde d�étain, ou sinon une pollution dans le four communautaire. Sachant que deux échantillons présentent des teneurs en SnO2 de plus de 2% et de 4%, cette hypothèse n�est pas improbable puisqu�il semble exister des productions ou des essais épisodiques présentant une glaçure volontairement opacifiée à l�oxyde d�étain. De plus, des faïenciers sont signalés à Sadirac au XVIIe siècle. Deuxièmement, ces teneurs en oxyde d�étain pourraient être le résultat du recyclage d�objets en plomb. Il semblerait que ce type de recyclage soit récurent. Les objets étant mis au feu, oxydés et réduits en poudre pour ensuite être intégrés au mélange glaçurant. Ces objets étaient possiblement faits d�alliages ou de mélanges de métaux, dont l�étain peut faire partie. Troisièmement, l�étain peut être contenu en traces dans le minerai de plomb selon des teneurs très variables. Ainsi l�étain serait apporté par une matière première, sans toutefois présenter des rapports significatifs avec celle-ci.
! À l�issus de ce travail, il ne fait aucun doute qu�une approche multidisciplinaire des céramiques enrichisse nos connaissances sur les techniques, les procédés de fabrication et l�organisation sociale des potiers de Sadirac. Cette première approches des glaçures nous a donc permis d�en apprendre d�avantage, mais aussi de vérifier scientifiquement des hypothèses technologiques, ainsi que des faits archéologiques (mutation des fours, industrialisation des procédés, �). Aussi, nous avons pu démontrer que les variations entre les différentes productions sont substantielles. De ce fait, il est malheureusement cohérent que les études de provenances opérées jusqu�à maintenant en Amérique du Nord faillent (Monette et al., 2010). Cependant, il est possible que cette dispersion des données soit à mettre en lien avec notre échantillonnage. L�agrandissement du corpus d�analyse à d�autres sites sadiracais, l�addition de nouveaux échantillons, ainsi que l�apport d�autres méthodes adaptées pour l�analyse des éléments traces (PIXE, LA-ICP-MS, Microsonde électronique, etc.) seraient bénéfique à cette étude et permettraient d�aller plus loin dans la compréhension des productions de ce centre potier qu�est Sadirac. Enfin, l�étude des glaçures nous permet de voir les relations économiques ainsi que l�organisation sociale et professionnelle qu�implique l�artisanat potier. Les glaçures sont composées de matières premières non disponibles localement. Les portiers doivent donc obligatoirement passer par l�intermédiaire d�un marchand pour se procurer les quantités de plomb, de cuivre et possiblement d�oxyde d�étain qu�ils utilisent. Dans le but de vérifier les quantités qui sont utilisées, nous avons calculé la densité d�une glaçure plombifère et en somme venu à la constatation qui suit. Un verre contenant approximativement 60% de PbO, comme nos glaçures, a une densité d�environ 4g/cm3 10. Sachant que nos glaçures font en moyenne 100 µm d�épaisseur, une surface de glaçure de 10 cm2 nécessite l�emploi d�environ 2.40 grammes de PbO (Tableau 16).
10 http://www.lemerpax-materiaux.com/, consulté le 01-06-2013
75
Tableau 16 : Composition moyenne d�une glaçure plombifère contenant 60% de PbO et dont la densité est
équivalente à 4g/cm3.
En calculant la quantité de glaçure présente sur une céramique et le nombre de pièces produites par un potier sur un intervalle de temps X, il est possible de calculer les quantités annuelles de matières premières utilisées par l�artisan.
�
Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 Fe2O3 CuO PbO ZnO SnO2 As2O3
Oxydes en %m 0.15 0.36 7.70 27.55 0.79 0.49 0.38 0.91 1.13 60.04 0.37 0.70 0.64
Oxydes en grammes 0.01 0.01 0.31 1.10 0.03 0.02 0.02 0.04 0.05 2.40 0.01 0.03 0.03
76
Bibliographie
Amouric, H., 1985. La diffusion des produits céramiques en Provence : XIVe-XIXe siècle. Flux, diffusion marginale, aléatoire, immédiate, médiate, dans: La céramique (Ve-XIXe s.) : Fabrication-Commercialisation-Utilisation, 1er Congrès International d'Archéologie Médiévale (Paris, 4-6 octobre 1985), Caen, pp. 227-233.
Béague, N., novembre 2010. Laurent Videau Route de Lorient, Sadirac, Rapport final d'opération n°OA 025731, INRAP du Grand Sud-Ouest, pp. 1-64.
Ben Amara, A., 2002, CÉRAMIQUES GLAÇURÉES DE L'ESPACE MÉDITERRANÉEN (IXe � XVIIe SIÈCLES AP. J.-C.) : MATÉRIAUX, TECHNIQUES ET ALTÉRATION, Thèse de l'Université Bordeaux 3, Bordeaux, 318 p.
Bizot, B., Rieth, É., Régaldo, P., 1991. Deux épaves d'époque moderne à Bouliac (Gironde), Aquitania tome 9, pp. 177-213.
Bordelais, S., 1984, Artisanat rural et techniques séculaires. Étude des potiers de Sadirac (Entre-Deux-Mers), Thèse de 3e cycle, Université de Bordeaux 2, Bordeaux, 326 p.
Bosher, J., 1983. Une famille de Fleurance (Gers) dans le commerce du Canada à Bordeaux (1683-1979), Annales du Midi tome 95, n°162, pp. 159-184.
Boüard (de), M., 1975. Manuel d'archéologie médiévale : de la fouille à l'histoire, Paris, 340 p. Bouveresse, J., 2004. Langage, perception et réalité : Physique, phénoménologie et grammaire,
Éditions Jacquelines Chambon, 430 p. Chapelot, J., 1978. La céramique exportée au Canada français, Dossiers de l'archéologie 22, pp.
104-113. Chapelot, J., 1985. Aspects socio-économiques de la production, de la commercialisation et de
l'utilisation des la céramique, dans: La céramique (Ve-XIXe s.) : Fabrication-Commercialisation-Utilisation, 1er Congrès International d'Archéologie Médiévale (Paris, 4-6 octobre 1985), Caen, pp. 167-178.
Chrétien, M., 2010, Compréhension des mécanismes de retrait-gonflement des sols argileux : approche sur site expérimental et analyse de sinistres sur constructions individuelles, Thèse du Département des Sciences et Environnement, Université de Bordeaux 1, Bordeaux, 315 p.
Clémens, J., 1981. Les fours à céramique à Sadirac au XIXe siècle, dans: Périgueux, le Périgord : les anciennes industries de l'Aquitaine, Actes du 30e congrès d'études régionales de la Fédération historique du Sud-Ouest (22 et 23 avril 1978, Périgueux), Bordeaux : Fédération Historique du Sud-Ouest, pp. 327-352.
Corbier, P., Pust, P., 2010. Projet Water and Territories : Application au bassin versant de la Pimpine (33), BRGM, pp. 1-93.
Dagneau, C., 2009, La culture matérielle des épaves françaises en Atlantique Nord et l'économie-monde capitaliste (1700-1760), Thèse du Département d'Anthropologie, Université de Montréal, 578 p.
Delsalle, P., 1993. La France industrielle aux XVIe-XVIIe-XVIIIe siècles, Synthèse et Histoire, Editions Ophrys, 280 p.
Ducournau, B., mars 2013. Lorient, Sadirac, Rapport final d'opération n°OA 026212, INRAP du Grand Sud-Ouest, pp. 1-54.
Dufournier, D., Picon, M., 1985. Technologie céramique : Rapport introductif, dans: La céramique (Ve-XIXe s.) : Fabrication-Commercialisation-Utilisation, 1er Congrès International d'Archéologie Médiévale (Paris, 4-6 octobre 1985), pp. 71-75.
Dupont, D., Steen, D., 2004. Calorimétrie: Éléments théoriques, Techniques de l'ingénieur. Mesures et contrôle, pp. 1-14.
77
Elizagoyen, V., juillet 2012. Tioulet, Sadirac, Rapport final d'opération n°OA 026073, INRAP du Grand Sud-Ouest, pp. 1-52.
Emery, L., 2012, APPROCHES ARCHÉOMÉTRIQUES DES PRODUCTIONS FAÏENCIÈRES FRANÇAISES DU XVIIIE SIECLE :LE CAS DE LA MANUFACTURE BABUT À BERGERAC (env. 1740 � 1789), Thèse de l'Université Bordeaux 3, Bordeaux, 363 p.
Fescia-Bordelais, S., 1985. Les tours de potiers à Sadirac (Entre-deux-Mers), Société Archéologique de Bordeaux LXXVI, pp. 73-77.
France, D.d.m.d., 1992. Vision des couleurs et peinture, Direction des musées de France, Paris, 71 p.
Gouger, L., Mathieu, J., 1988. Transferts de population, Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, pp. 337-345.
Hanusse, C., 1982. L'outillage du potier de terre aux XVIIe et XVIIIe siècles à Sadirac (Gironde), d'après les sources écrites, Archéologie médiévale XII, pp. 289-296.
Hanusse, C., 1985. La relation four-atelier d'après les sources écrites : L'exemple de Sadirac (Gironde) du XVIe au XVIIIe s., dans: La céramique (Ve-XIXe s.) : Fabrication-Commercialisation-Utilisation, 1er Congrès International d'Archéologie Médiévale (Paris, 4-6 octobre 1985), pp. 101-105.
Hanusse, C., 1988, L�artisanat de la poterie de terre en bordelais-bazardais du moyen âge au XVIIIe siècle d�après les sources écrites, Thèse du Département d'Histoire de l'Art et Archéologie, Université Bordeaux 3, Bordeaux, 265 p.
Huetz de Lemps, C., 1975. Géographie du commerce de Bordeaux à la fin du règne de Louis XIV, Mouton, Paris, 661 p.
Leblanc, B., « COLORIMÉTRIE », Encyclopaedia Universalis [en ligne], URL: http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/colorimetrie/, consulté le 10 mai 2013
Loewen, B., 2004. Céramiques françaises et réseaux de commerce transatlantique aux XVIe et XVIIe siècles, dans: Champlains ou les portes du Nouveau Monde. Cinq siècles d'échanges entre le Centre-Ouest français et l'Amérique du Nord (XVIe-XXe siècles), Gestes Éditions, sous la direction de Mickaël Augeron et Dominique Guillemet, pp. 217-221.
Matthes, W.-E., Avon, A., 2010. Émaux et glaçures céramiques: plus de 1100 formules, Eyrolles, 502 p.
Molho, A., Ramada Curto, D., 2003. Les réseaux marchands à l�époque moderne, Annales. Histoire, Sciences Sociales n°3, pp. 569-579.
Monette, Y., Loewen, B., Aznar, J.-C., Régaldo, P., 2010. La provenance des terres cuites vernissées vertes de France du XVIe au XVIIIe siècle, dans: De l'archéologie analytique à l'archéologie sociale, Recherches amérindiennes au Québec : Paléo-Québec n°34, Montréal, pp. 78-102.
Musgrave, E., 1998. Pottery Production and Proto-Industrialisation : Continuity and Change in the Rural Ceramics Industries of the Saintonge Region, France, 1250 to1800, Rural History, Society, Culture (9), n°1, pp. p. 1-18.
Platel, J.P., Spencer, C., 2001. Les matériaux industriels, roches et ressources minérales de la région Aquitaine, BRGM, pp. 1-96.
Régaldo-Saint Blancard, P., 1982a. Gironde - Sadirac : le Bourg, Blayet, Le Casse, Archéologie Médiévale XII, pp. 381-382.
Régaldo-Saint Blancard, P., 1982b. Le four du village de Casse à Sadirac (Gironde), Revue Historique et Archéologique du Libournais Tome 50, pp. 57-64.
Régaldo-Saint Blancard, P., 1985. Sadirac à la fin du Moyen Âge : le site potier de Sableyre, Société Archéologique de Bordeaux LXXVI, pp. p. 57-71.
78
Régaldo-Saint Blancard, P., 1987. Sadirac au début de l'époque moderne : Fréchinet, un village de potiers abandonné au début du XVIIe siècle, Société Archéologique de Bordeaux 78, pp. 11-20.
Régaldo-Saint Blancard, P., 1988a. Cruches, pichets et cruchons de production sadiracaise du XIVe au XIXe siècles, dans: L'Entre-deux-Mers à la recherche de son identité, Actes du 1er colloque tenu à Branne, CLEM-AHB, pp. 81-98.
Régaldo-Saint Blancard, P., 1988b. Reliefs de Sadirac : Éléments de statuaire et bénitiers de chevet, Revue Archéologique de Bordeaux LXXIX, pp. 115-133.
Régaldo-Saint Blancard, P., 1988c. Sadirac : Fréchinet, Gallia Informations 1, pp. 114. Régaldo-Saint Blancard, P., 1988d. Sadirac : Sableyre, Gallia Informations 1, pp. 114-115. Régaldo-Saint Blancard, P., 1992. Sadirac : Les Prés de Siron, Gallia Informations 1, pp. 63-64. Régaldo-Saint Blancard, P., 2000. Le centre potier de Sadirac, dans: 2000 ans de pots en
Aquitaine, Catalogue d�exposition, Saint-Emilion, DRAC et Musée de la poterie des Hospices de la Madeleine, pp. 49-57.
Régaldo-Saint Blancard, P., Fescia-Bordelais, S., Duverneuil, A., 1986. Les céramiques de raffinage du sucre : Typologie, technologie, Archéologie du midi médiéval Tome IV, pp. 151-168.
Rhodes, D., 1999. Terres et glaçures - Les techniques de l�émaillage, Paris, 223 p. Rice, P.M., 1987. Pottery analysis : a Sourcebook, Univiversity of Chicago Press, 559 p. Tite, M.S., Freestone, I., Mason, R., Molera, J., Vendrell-Saz, M., Wood, N., 1998. Lead glazes in
antiquity�methods of production and reasons for use, Archaeometry 40, pp. 241-260. Tornay, S., 1973. Langage et perception: La dénomination des couleurs chez les Nyangatom du
sud-ouest éthiopien, L'Homme T. 13, No. 4 (Oct. - Déc.), pp. 66-94.
Webographie Définition de pacte colonial, L�Encyclopédie contributive Larousse en ligne, Conculté [en ligne] le
20-05-2013. http://www.culture.gouv.fr/culture/conservation/fr/methodes/meb_01.htm, consulté le 10-04-
2013 http://www.lemerpax-materiaux.com/, consulté le 01-06-2013
�
Liste des échantillons
Réf. CRP2A Site Description Datation Période
BDX15725 Sableyre secteur A Marmite basse à fond rond 14e-15e 1
BDX15726 Sadirac Laurent Videau st 2 Assiette (bord) 17e-18e 3
BDX15727 Ramassage de surface Petit pot à anse 14e-15e 1
BDX15728 La Casse Ecuelle à anses 17e-18e 3
BDX15729 Sadirac Laurent Videau st 2 Réchaud (pointe) 17e-18e 3
BDX15730 Sableyre secteur C Gardale/Jatte 16e-17e 2
BDX15731 Siron Pot 1er ¼ du 19e 4
BDX15732 Fréchinet Ecuelle à oreilles 16e-17e 2
BDX15733 Fréchinet Assiette 16e-17e 2
BDX15734 Château Pabus Jean d'Arnaud Réchaud de table 17e-18e 3
BDX15735 Siron Pot 1er ¼ du 19e 4
BDX15736 Siron Pot 1er ¼ du 19e 4
BDX15737 Siron Assiette 17e-18e 3
BDX15738 Sadirac Laurent Videau st 3 Assiette (bord) 17e 3
BDX15739 Sadirac Laurent Videau st 3 Fond 17e 3
BDX15740 Sadirac Laurent Videau st 3 Fond 17e 3
BDX15741 Siron Lèchefrite (bord) 1er ¼ du 19e 4
BDX15742 Siron Jatte (poignée) 1er ¼ du 19e 4
BDX15743 Siron Ecuelle à oreilles 17e-18e 3
BDX15744 Siron Ecuelle à oreilles 17e-18e 3
BDX15745 Siron Ecuelle à oreilles 17e-18e 3
BDX15990 Sadirac Laurent Videau st 15 nd 17e 3
BDX15991 Sadirac Laurent Videau st 15 nd 17e 3
BDX15992 Sadirac Laurent Videau st 15 nd 17e 3
BDX15993 Sadirac Laurent Videau st 15 nd 17e 3
BDX15994 Sadirac Laurent Videau st 15 nd 17e 3
BDX15995 Sadirac Laurent Videau st 15 nd 17e 3
BDX15996 Sadirac Tioulet st 6003 nd 1er ¼ du 14e 1
BDX15998 Sadirac Tioulet st 6003 nd 1er ¼ du 14e 1
Liste des échantillons (Suite)
Réf. CRP2A Site Description Datation Période
BDX15999 Sadirac Tioulet st 6003 nd 1er ¼ du 14e 1
BDX16000 Sadirac Tioulet st 6003 nd 1er ¼ du 14e 1
BDX16001 Sadirac Tioulet st 6003 nd 1er ¼ du 14e 1
BDX16003 Sadirac Tioulet st 6003 nd 1er ¼ du 14e 1
BDX16005 Sadirac Tioulet st 6003 nd 1er ¼ du 14e 1
BDX16006 Sadirac Tioulet st 1001 nd 15e-16e 2
BDX16007 Sadirac Tioulet st 2002 nd fin 15e 2
BDX16008 Sadirac Tioulet st 2002 nd fin 15e 2
BDX16009 Sadirac Tioulet st 2002 nd fin 15e 2
BDX16010 Sadirac Tioulet st 2002 nd fin 15e 2
BDX16011 Sadirac Lorient LaVie st 3 nd 17e-18e 3
BDX16012 Sadirac Lorient LaVie st 3 nd 17e-18e 3
BDX16013 Sadirac Lorient LaVie st 3 nd 17e-18e 3
BDX16014 Sadirac Lorient LaVie st 3 nd 17e-18e 3
BDX16015 Sadirac Lorient LaVie st 3 nd 17e-18e 3
BDX16016 Sadirac Lorient LaVie st 3 nd 17e-18e 3
BDX16017 Sadirac Lorient LaVie st 3 nd 17e-18e 3
BDX16018 Sadirac Lorient LaVie st 3 nd 17e-18e 3
BDX16019 Sadirac Lorient LaVie st 3 nd 17e-18e 3
BDX16020 Sadirac Lorient LaVie st 1 nd 17e-18e 3
BDX16021 Sadirac Lorient LaVie st 1 nd 17e-18e 3
BDX16022 Sadirac Lorient LaVie st 1 nd 17e-18e 3
BDX16023 Sadirac Lorient LaVie st 1 nd 17e-18e 3
BDX16024 Sadirac Lorient LaVie st 1 nd 17e-18e 3
BDX16025 Sadirac Lorient LaVie st 1 nd 17e-18e 3
BDX16026 Sadirac Lorient LaVie st x nd 17e-18e 3
BDX16027 Sadirac Lorient LaVie st x nd 17e-18e 3
BDX16028 Sadirac Lorient LaVie st x nd 17e-18e 3
BDX16029 Sadirac Lorient LaVie st x nd 17e-18e 3
���������� �� ����������� ������� ���������� ������� �������
�� ���������������
�� ������������������������������ �� ���� �������������� �� ���� �����
��� �����
��� ����� � ��� ����������� � ���� �� ���������� � ���� �� �������
���������
��� ������������������������������ �������������������� ����������
EUROPEAN COMMISSION
JOINT RESEARCH CENTRE
Inst i tute for Reference Mater ials and Measurements
CERTIFIED REFERENCE MATERIAL BCR
®� 126A
CERTIFICATE OF ANALYSIS
LEAD GLASS
Mass Fraction
Certified value 1) Uncertainty 2) Unit p
SiO2
PbO K2O Al2O3
Fe2O3
Sb2O3
BaO CaO MgO ZnO Na2O Li2O
57.80 23.98
9.99 0.126 0.0055 0.291 1.053 1.033 0.512 1.01 3.57 0.494
0.11 0.06 0.07 0.013 0.0012 0.012 0.030 0.030 0.013 0.04 0.07 0.016
g/100 g g/100 g g/100 g g/100 g g/100 g g/100 g g/100 g g/100 g g/100 g g/100 g g/100 g g/100 g
11 14
9 8 8 7
13 8 8 8 8 7
Physical properties
Certified value 1) Uncertainty 2) Unit p
Density at 20 °C Refractive index nD
20 at 589 nm
2.99051.55967
0.00160.00022
g/cm3 10 11
1) Unweighted mean value of the means of p accepted sets of data, each set being obtained in a different laboratory and/or with a different method of determination. The certified value and its uncertainty are traceable to the International System of Units (SI).
2) The certified uncertainty is the half-width of the 95 % confidence interval specified in 1).
This certificate is valid for five years after purchase.
Sales date:
The minimum amount of sample to be used for chemical composition is 7.5 g.
NOTE This material has been certified by BCR (Community Bureau of Reference, the former reference materials programme of the European Commission). The certificate has been revised under the responsibility of IRMM.
Brussels, June 1982 Latest revision: March 2010
Signed:
Prof. Dr. Hendrik Emons European Commission Joint Research Centre Institute for Reference Materials and Measurements Retieseweg 111 B-2440 Geel, Belgium
All following pages are an integral part of the certificate. Page 1 of 3
Annexe 5
Page 2 of 3
DESCRIPTION OF THE SAMPLE
The reference material is supplied in the form of a slab 100 mm x 100 mm x 10 mm weighing about 300 g.
ANALYTICAL METHOD USED FOR CERTIFICATION
- Colorimetry (Si, Al, Fe, Sb) - Gravimetry (Si, Pb, K, Al, Sb, Ba, Ca, Zn, Na, Mg) - Titrimetry (Si, Pb, Sb, Ca, Zn) - Polarography (Pb, Sb) - Atomic absorption spectrometry (Si, Pb, K, Al, Fe, Sb, Ba, Ca, Mg, Zn, Na, Li) - Plasma emission spectrometry (Pb, K, Al, Fe, Sb, Ba, Ca, Mg, Zn, Na, Li) - Flame emission spectrometry (K, Na, Li) - X-ray fluorescence spectrometry (Sb) - Density: sink and float technique, pycnometer technique, buoyancy method - Refractive index: commercially available refractometers
PARTICIPANTS
- British Glass Industry Research Association, Sheffield (GB) - Chance Brothers Ltd., Smethwick, Warley (GB) - Forschungsgemeinschaft für Technisches Glas E.V., Wertheim (DE) - Glasforskningsinstitutet, Växjö (SE) - Institut du Verre, Paris (FR) - Institut für Silikatforschung der Fraunhofer Gesellschaft, Würzburg (DE) - Institut National du Verre, Charleroi (BE) - Instytut Szklo i Ceramiki, Warsawa (PL) - Jenaer Glaswerke Schott u. Gen., Mainz (DE) - Kimble Italiana SpA, Pisa (IT) - Owens Illinois Glass Container Division, Toledo, Ohio (US) - Pilkington Brothers Ltd., Lathom, Ormskirk (GB) - S.A. Glaverbel, Jumet (BE) - Saint-Gobain Industries, Aubervilliers (FR) - Sovirel, Bagneaux-sur-Loing (FR) - Statni Vyzkumny Ustav Sklarsky, Hradec Kralove (CZ) - Stazione Sperimentale del Vetro, Murano Venezia (IT) - Vereinigte Glaswerke, Aachen (DE)
SAFETY INFORMATION
The usual laboratory safety measures apply.
INSTRUCTIONS FOR USE
The material is intended to be used for method validation and for demonstration of laboratory proficiency. As glass powder easily adsorbs humidity or atmospheric gases, it is recommended not to prepare amounts in large excess, as compared to what is required by the work to be done. For chemical analysis, the sample aliquot shall be crushed and finely ground, either manually or mechanically, using grinding tools (mortar and pestle, jar and balls) made of a hard material unable to seriously contaminate the ground glass. Agate tools are quite suitable. The grain size of the glass powder shall be of the order of 40-50 µm. The grinding has to be carried out immediately prior to the analysis and the powder stored in a closed container like a weighing bottle in a desiccator. If the ground glass has to be stored before being used, it is preferable to leave the weighing bottle in a laboratory oven at 100-105 °C.
Page 3 of 3
STORAGE
The sample should preferably be stored in a glass or a plastic container like a Petri dish, placed in a moisture-free atmosphere, for instance in a desiccator. Alternatively, for the part devoted to chemical purposes, the slab may be roughly crushed into pieces not smaller than 5 mm in dimension and these pieces stored in a glass or a plastic container in the same conditions as here above. However, the European Commission cannot be held responsible for changes that happen during storage of the material at the customer's premises, especially of opened samples.
LEGAL NOTICE
Neither IRMM, its subsidiaries, its contractors nor any person acting on their behalf, (a) make any warranty or representation, express or implied that the use of any information, material, apparatus, method or process disclosed in this document does not infringe any privately owned intellectual property rights; or (b) assume any liability with respect to, or for damages resulting from, the use of any information, material, apparatus, method or process disclosed in this document save for loss or damage arising solely and directly from the negligence of IRMM or any of its subsidiaries.
NOTE
A technical report on the production of BCR®-126A is available on the internet
(http://www.irmm.jrc.be). A paper copy can be obtained from IRMM on request.
European Commission � Joint Research Centre Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM)
Retieseweg 111, B - 2440 Geel (Belgium) Telephone: +32-(0)14-571.722 - Telefax: +32-(0)14-590.406
Corning B BCR-126A Corning D
Élément (verre sodique) (verre au plomb) (verre potassique)
Oxygène 44.84 36.03 43.5
Sodium 12.8 2.65 0.98
magnésium 0.72 0.31 2.47
Aluminum 2.23 0.07 2.87
silicium 28.77 27.02 25.82
phosphore 0.37 nd 1.75
Soufre 0.22 nd 0.12
Potassium 0.91 8.29 9.51
Calcium 6.23 0.74 10.76
Titane 0.06 nd 0.24
Manganèse 0.22 nd 0.44
Fer 0.24 nd 0.35
Cobalt 0.28 nd 0.02
Nickel 0.07 nd 0.05
Cuivre 2.16 nd 0.32
Zinc 0.16 0.81 0.08
Zirconium nd nd 0.01
Argent nd nd 0.01
Etain 0.03 nd 0.1
Antimoine 0.35 0.24 0.72
Baryum 0.13 0.94 0.3
Plomb 0.37 22.26 0.25
Total 101.16 99.36 100.67
Ordre de standardisation des éléments
1 Na
2 Si
3 K
4 Pb
5 Ca
Composition des terres cuiteRéf. CRP2A Site Période Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 Cl- K2O CaO TiO2 Fe2O3
BDX15725 Sableyre secteur A 1 0.46 0.69 25.00 65.64 0.62 0.08 3.39 0.49 1.12 2.52
BDX15726 Sadirac Laurent Videau st 2 3 0.38 0.63 23.84 69.15 0.14 0.08 3.09 0.28 0.98 1.49
BDX15727 Ramassage de surface 1 0.48 0.69 22.27 70.12 0.34 0.09 2.70 0.36 0.93 2.02
BDX15728 Le Casse 3 0.47 0.54 21.59 72.09 0.15 0.12 2.58 0.34 0.86 1.27
BDX15729 Sadirac Laurent Videau st 2 3 0.37 0.74 21.66 70.17 0.14 0.05 2.85 0.39 0.95 2.69
BDX15730 Sableyre secteur C 2 0.42 0.66 20.63 72.31 0.22 0.07 2.51 0.29 0.94 1.96
BDX15731 Siron 4 0.40 0.68 22.38 70.47 0.14 0.08 3.00 0.27 0.88 1.71
BDX15732 Fréchinet 2 0.39 0.77 21.51 70.66 0.16 0.06 2.85 0.37 0.81 2.41
BDX15733 Fréchinet 2 0.35 0.53 19.18 73.70 0.10 0.07 2.40 0.23 0.78 2.68
BDX15734 Château Pabus Jean d'Arnaud 3 0.49 0.57 21.02 72.30 0.08 0.08 2.16 0.19 0.87 2.24
BDX15735 Siron 4 0.45 0.61 20.04 73.14 0.12 0.11 2.75 0.34 0.86 1.59
BDX15736 Siron 4 0.44 0.80 22.89 69.19 0.20 0.09 3.21 0.31 0.95 1.93
BDX15737 Siron 3 0.50 0.70 22.76 68.96 0.20 0.13 3.18 0.41 1.02 2.15
BDX15738 Sadirac Laurent Videau st 3 3 0.37 0.70 20.97 70.56 0.16 0.04 2.79 0.31 0.99 3.13
BDX15739 Sadirac Laurent Videau st 3 3 0.38 0.71 21.28 70.83 0.12 0.06 2.75 0.29 0.97 2.62
BDX15740 Sadirac Laurent Videau st 3 3 0.32 0.73 21.03 71.57 0.17 0.07 2.73 0.31 0.88 2.22
BDX15741 Siron 4 0.51 0.66 19.20 73.05 0.15 0.11 2.90 0.29 0.93 2.21
BDX15742 Siron 4 0.56 0.78 23.90 66.78 0.26 0.07 3.49 0.55 1.02 2.60
BDX15743 Siron 3 0.40 0.65 20.49 72.10 0.14 0.06 2.78 0.27 0.89 2.22
BDX15744 Siron 3 0.37 0.67 20.50 72.05 0.12 0.06 2.76 0.32 0.89 2.25
BDX15745 Siron 3 0.38 0.98 24.48 66.84 0.23 0.05 3.22 0.32 0.94 2.57
BDX15990 Sadirac Laurent Videau st 15 3 0.38 0.78 23.45 66.17 0.13 0.04 2.81 0.45 1.13 4.68
BDX15991 Sadirac Laurent Videau st 15 3 0.43 0.80 23.65 66.65 0.16 0.05 2.88 0.43 1.06 3.90
BDX15992 Sadirac Laurent Videau st 15 3 0.40 0.89 24.37 64.80 0.10 <0.032 3.04 0.46 1.08 4.85
BDX15993 Sadirac Laurent Videau st 15 3 0.38 0.72 24.03 66.96 0.13 0.04 2.95 0.43 1.16 3.25
BDX15994 Sadirac Laurent Videau st 15 3 0.39 0.82 24.38 64.17 0.11 <0.0375 2.96 0.50 1.13 5.43
BDX15995 Sadirac Laurent Videau st 15 3 0.41 0.77 23.29 66.98 0.17 <0.035 2.92 0.44 1.05 3.54
BDX15996 Sadirac Tioulet st 6003 1 0.33 0.61 22.84 67.49 1.59 0.05 3.01 0.63 1.01 2.46
BDX15998 Sadirac Tioulet st 6003 1 0.36 0.61 20.18 73.20 0.24 0.06 2.51 0.31 0.88 1.66
BDX15999 Sadirac Tioulet st 6003 1 0.40 0.82 22.08 70.22 0.31 0.07 2.91 0.32 0.94 1.93
BDX16000 Sadirac Tioulet st 6003 1 0.35 0.65 22.33 70.57 0.32 0.06 2.61 0.34 1.00 1.78
BDX16001 Sadirac Tioulet st 6003 1 0.41 0.77 23.66 68.34 0.46 0.06 2.94 0.37 0.96 2.04
BDX16003 Sadirac Tioulet st 6003 1 0.37 0.67 22.53 70.34 0.37 0.06 2.52 0.32 0.95 1.88
BDX16005 Sadirac Tioulet st 6003 1 0.38 0.66 21.79 71.03 0.28 0.05 2.62 0.33 1.02 1.85
BDX16006 Sadirac Tioulet st 1001 2 0.39 0.66 22.85 70.20 0.19 0.07 2.80 0.27 0.93 1.64
BDX16007 Sadirac Tioulet st 2002 2 0.35 0.65 19.32 74.39 0.14 0.07 2.55 0.26 0.76 1.52
BDX16008 Sadirac Tioulet st 2002 2 0.31 0.68 20.45 72.63 0.22 0.06 2.58 0.29 0.92 1.87
BDX16009 Sadirac Tioulet st 2002 2 0.36 0.76 22.60 69.46 0.52 0.09 3.03 0.33 0.97 1.91
BDX16010 Sadirac Tioulet st 2002 2 0.37 0.67 24.85 67.13 0.25 0.05 3.08 0.35 1.06 2.22
BDX16011 Sadirac Lorient LaVie st 3 3 0.44 0.78 21.77 70.29 0.22 0.06 2.85 0.33 0.85 2.43
BDX16012 Sadirac Lorient LaVie st 3 3 0.37 0.87 21.30 70.34 0.14 0.04 2.91 0.37 0.99 2.69
BDX16013 Sadirac Lorient LaVie st 3 3 0.38 0.78 21.34 70.46 0.17 0.06 2.97 0.33 0.89 2.63
BDX16014 Sadirac Lorient LaVie st 3 3 0.43 0.83 21.68 70.02 0.19 0.05 2.93 0.31 0.96 2.60
BDX16015 Sadirac Lorient LaVie st 3 3 0.44 0.81 24.05 66.42 0.24 <0.0625 3.56 0.49 0.97 3.00
BDX16016 Sadirac Lorient LaVie st 3 3 0.36 0.68 21.24 69.42 0.15 0.06 2.61 0.36 0.93 4.20
BDX16017 Sadirac Lorient LaVie st 3 3 0.36 0.84 21.09 70.78 0.14 0.06 2.88 0.34 0.90 2.67
BDX16018 Sadirac Lorient LaVie st 3 3 0.38 0.68 22.00 70.84 0.15 0.06 2.91 0.33 0.99 1.68
BDX16019 Sadirac Lorient LaVie st 3 3 0.39 0.90 21.68 69.86 0.16 0.06 2.96 0.35 0.97 2.67
BDX16020 Sadirac Lorient LaVie st 1 3 0.31 0.71 20.93 71.40 0.32 0.05 2.46 0.49 1.01 2.34
BDX16021 Sadirac Lorient LaVie st 1 3 0.36 0.73 21.69 70.78 0.19 0.06 2.68 0.36 1.01 2.15
BDX16022 Sadirac Lorient LaVie st 1 3 0.35 0.63 20.08 72.95 0.17 0.07 2.58 0.29 0.87 2.02
BDX16023 Sadirac Lorient LaVie st 1 3 0.37 0.63 21.68 70.36 0.17 0.06 3.69 0.36 0.96 1.79
BDX16024 Sadirac Lorient LaVie st 1 3 0.45 0.77 23.31 67.27 0.71 0.03 3.24 0.71 1.01 2.50
BDX16025 Sadirac Lorient LaVie st 1 3 0.37 0.70 21.76 69.64 0.39 0.07 2.90 0.45 0.95 2.75
BDX16026 Sadirac Lorient LaVie st x 3 0.48 0.76 23.28 68.81 0.18 0.05 2.85 0.35 1.00 2.26
BDX16027 Sadirac Lorient LaVie st x 3 0.40 0.78 23.12 68.73 0.23 0.05 3.29 0.35 1.05 2.02
BDX16028 Sadirac Lorient LaVie st x 3 0.40 0.72 23.03 66.28 1.37 0.04 3.20 0.93 1.21 2.82
BDX16029 Sadirac Lorient LaVie st x 3 0.41 0.75 21.96 70.50 0.19 0.07 2.67 0.34 0.96 2.11
Annexe 7
Réf. CRP2A Site Péri. Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 Fe2O3 CuO PbO ZnO SnO2 As2O3
BDX15725 Sableyre secteur A 1 0.16 0.34 8.07 22.25 0.72 0.38 0.40 0.68 0.11 66.94 0.07 nd nd
BDX15726 Laurent Videau st 2 3 0.13 0.24 7.34 24.15 0.59 0.15 0.31 0.56 1.00 64.41 0.35 0.78 nd
BDX15727 Surface 1 0.09 0.30 7.83 24.19 0.52 0.19 0.38 0.81 0.55 65.13 nd nd <0.16
BDX15728 La Casse 3 0.15 0.29 7.36 21.43 0.62 0.28 0.36 0.57 0.82 67.21 0.30 0.62 nd
BDX15729 Laurent Videau st 2 3 0.12 0.30 5.01 26.53 0.60 0.83 0.22 0.84 1.39 62.53 0.43 1.08 0.16
BDX15730 Sableyre secteur C 2 0.23 0.40 6.39 35.85 0.92 2.85 0.29 1.13 2.59 48.03 nd 1.34 nd
BDX15731 Siron 4 0.13 0.35 8.22 27.47 0.84 0.28 0.43 0.83 0.61 60.52 0.29 0.08 <0.2
BDX15732 Fréchinet 2 0.11 0.33 6.13 26.30 0.57 0.31 0.33 0.68 1.19 63.60 0.34 0.21 nd
BDX15733 Fréchinet 2 0.17 0.42 6.63 28.10 0.69 0.30 0.36 0.93 1.72 60.10 0.59 nd nd
BDX15734 Jean d'Arnaud 3 0.20 0.34 9.36 35.84 0.92 0.15 0.51 1.15 0.29 50.29 0.23 0.74 nd
BDX15735 Siron 4 0.19 0.31 6.63 28.25 0.74 0.66 0.33 0.69 0.77 61.03 0.32 0.18 nd
BDX15736 Siron 4 0.14 0.46 8.22 25.11 0.61 0.28 0.46 0.94 0.52 62.78 0.32 0.27 nd
BDX15737 Siron 3 0.21 0.27 5.49 30.49 1.02 0.50 0.26 0.61 0.38 59.50 0.41 0.87 nd
BDX15738 Laurent Videau st 3 3 0.19 0.36 4.37 30.81 0.65 1.25 0.28 0.75 1.32 57.51 0.42 2.11 nd
BDX15739 Laurent Videau st 3 3 0.12 0.29 6.59 30.24 0.58 0.34 0.33 1.05 1.41 58.54 0.60 nd nd
BDX15740 Laurent Videau st 3 3 0.06 0.50 8.21 28.49 0.63 0.49 0.43 1.22 0.89 58.57 nd 0.34 0.24
BDX15741 Siron 4 0.16 0.28 6.54 28.26 0.73 0.24 0.33 0.80 0.37 62.00 0.23 0.16 nd
BDX15742 Siron 4 0.19 0.36 7.36 22.14 0.59 0.65 0.35 0.75 0.38 66.97 0.19 0.12 nd
BDX15743 Siron 3 0.21 0.33 7.40 30.04 1.10 0.28 0.41 1.01 0.77 58.26 0.16 0.09 nd
BDX15744 Siron 3 0.12 0.18 5.01 32.25 0.67 0.17 0.23 0.55 0.47 60.10 0.21 0.16 nd
BDX15745 Siron 3 0.13 0.33 7.23 24.87 0.74 0.10 0.35 0.92 0.26 64.76 0.20 0.17 nd
BDX15990 Laurent Videau st 15 3 0.11 0.36 7.57 28.63 0.94 0.27 0.47 0.95 2.51 57.19 nd nd 1.00
BDX15991 Laurent Videau st 15 3 0.18 0.41 7.09 30.01 0.75 0.58 0.34 0.71 1.81 57.21 nd nd 0.93
BDX15992e Laurent Videau st 15 3 0.15 0.31 5.94 27.23 0.76 1.12 0.27 0.81 1.78 61.23 nd 0.29 0.30
BDX15992i Laurent Videau st 15 3 0.10 0.57 8.68 34.05 0.75 1.19 0.46 1.28 3.35 48.35 nd 0.27 1.19
BDX15993 Laurent Videau st 15 3 0.10 0.33 7.82 27.06 0.61 0.20 0.46 0.99 2.32 59.48 nd nd 0.71
BDX15994e Laurent Videau st 15 3 0.13 0.29 6.83 23.59 0.42 0.64 0.32 0.83 2.47 63.36 0.49 0.28 0.39
BDX15994i Laurent Videau st 15 3 0.11 0.41 6.55 28.32 0.47 1.52 0.33 1.05 2.68 56.91 0.57 0.60 0.52
BDX15995 Laurent Videau st 15 3 0.09 0.36 6.65 27.12 0.71 0.24 0.33 0.79 2.63 60.05 nd nd 1.01
BDX15996 Tioulet st 6003 1 0.11 0.27 6.89 21.58 0.73 0.38 0.31 0.67 0.92 68.16 nd nd nd
BDX15998 Tioulet st 6003 1 0.11 0.31 9.43 30.71 1.11 0.20 0.40 0.87 2.71 54.18 nd nd nd
BDX15999 Tioulet st 6003 1 0.21 0.58 11.28 34.70 1.35 0.45 0.57 1.54 0.95 48.38 nd nd nd
BDX16000 Tioulet st 6003 1 0.14 0.37 9.66 27.20 0.89 0.44 0.47 0.83 0.79 59.18 nd nd nd
Annexe 7 (suite)
Composition des glaçures
Réf. CRP2A Site Péri. Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 Fe2O3 CuO PbO ZnO SnO2 As2O3
BDX16001 Tioulet st 6003 1 0.21 0.50 11.28 29.79 1.63 0.65 0.41 1.14 0.48 53.87 nd nd nd
BDX16003 Tioulet st 6003 1 0.14 0.43 9.32 28.34 0.90 0.71 0.44 0.88 1.60 57.26 nd nd nd
BDX16005 Tioulet st 6003 1 0.19 0.41 10.27 32.14 1.42 0.52 0.50 1.15 1.07 52.33 nd nd nd
BDX16006 Tioulet st 1001 2 0.15 0.38 9.88 25.26 1.02 0.42 0.35 0.64 0.16 61.75 nd nd nd
BDX16007 Tioulet st 2002 2 0.29 0.37 6.09 30.44 1.08 1.82 0.33 0.92 0.70 53.02 0.24 4.77 nd
BDX16008 Tioulet st 2002 2 0.11 0.40 10.06 29.29 0.88 0.20 0.52 1.17 1.19 55.61 nd 0.57 nd
BDX16009 Tioulet st 2002 2 0.12 0.44 9.46 25.55 0.96 0.50 0.49 0.91 0.89 60.68 nd nd nd
BDX16010 Tioulet st 2002 2 0.11 0.34 8.70 25.46 0.71 0.48 0.40 0.75 1.38 61.60 nd <0.26 nd
BDX16011 Lorient LaVie st 3 3 0.16 0.33 5.39 28.05 0.69 0.44 0.24 0.71 1.10 62.46 0.39 nd nd
BDX16012 Lorient LaVie st 3 3 0.24 0.61 7.09 29.64 0.85 0.79 0.35 1.52 0.85 56.64 0.39 1.05 nd
BDX16013 Lorient LaVie st 3 3 0.14 0.36 7.18 27.65 0.62 0.27 0.33 1.07 0.76 61.36 0.26 nd nd
BDX16014 Lorient LaVie st 3 3 0.16 0.34 5.14 26.35 0.55 0.39 0.28 0.76 1.55 63.84 0.61 nd nd
BDX16015 Lorient LaVie st 3 3 0.00 0.18 2.85 23.18 0.29 0.12 0.19 0.54 1.68 70.49 0.57 nd nd
BDX16016 Lorient LaVie st 3 3 0.18 0.28 5.15 26.02 0.60 0.34 0.24 1.13 1.12 64.50 0.43 nd nd
BDX16017a Lorient LaVie st 3 3 0.24 0.31 5.43 34.43 0.80 0.33 0.30 0.93 1.31 55.09 0.84 nd nd
BDX16017b Lorient LaVie st 3 3 0.25 0.38 6.40 33.05 0.85 0.31 0.31 1.04 1.34 55.39 0.69 nd nd
BDX16018 Lorient LaVie st 3 3 0.18 0.34 8.48 26.71 0.78 0.21 0.43 0.70 1.54 60.65 nd nd nd
BDX16019e Lorient LaVie st 3 3 0.20 0.33 8.51 22.48 0.89 0.12 0.39 0.93 0.22 66.01 nd nd nd
BDX16019i Lorient LaVie st 3 3 0.18 0.44 8.92 25.37 0.65 0.29 0.41 1.15 0.09 62.51 nd nd nd
BDX16020 Lorient LaVie st 1 3 0.10 0.33 7.74 24.97 0.63 0.17 0.34 0.80 <0.21 64.74 nd 0.22 nd
BDX16021 Lorient LaVie st 1 3 0.19 0.44 11.19 32.70 1.13 0.61 0.56 1.15 0.55 51.48 nd nd nd
BDX16022 Lorient LaVie st 1 3 0.11 0.32 9.44 27.40 0.91 0.20 0.44 0.96 1.45 58.79 nd nd nd
BDX16023 Lorient LaVie st 1 3 0.15 0.36 8.18 25.24 0.73 0.26 0.41 0.69 0.87 63.12 nd nd nd
BDX16024 Lorient LaVie st 1 3 0.09 0.30 7.44 19.26 0.59 0.30 0.36 0.69 0.81 69.37 nd 0.83 nd
BDX16025 Lorient LaVie st 1 3 0.14 0.32 8.24 25.90 0.68 0.31 0.39 0.95 0.73 62.41 nd nd nd
BDX16026 Lorient LaVie st x 3 0.19 0.45 10.81 28.31 0.80 0.52 0.50 1.10 0.55 56.78 nd nd nd
BDX16027 Lorient LaVie st x 3 0.18 0.37 10.75 27.49 1.06 0.17 0.46 1.77 57.61 nd nd nd
BDX16028 Lorient LaVie st x 3 0.12 0.23 6.16 18.03 0.53 0.34 0.31 0.66 0.53 73.11 nd nd nd
BDX16029 Lorient LaVie st x 3 0.17 0.42 11.04 31.61 1.13 0.68 0.49 1.08 0.61 52.67 nd <0.31 nd
Annexe 7 (suite)
Composition des glaçures (suite)
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
MASTER 2 Histoire de l’Art et Patrimoine Spécialité MATÉRIAUX DU PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHÉOMÉTRIE
Première approche des recettes de glaçures du centre potier de Sadirac, Gironde.
GUINDON Amélie Licence d’Anthropologie
Stage de recherche effectué à Pessac
Résumé Cette recherche porte sur une première approche des glaçures du centre potier de Sadirac, en
Gironde. Des productions de huit sites datant du XIVe au XIXe siècle sont étudiées par microscopie
électronique à balayage avec spectrométrie de rayons X en dispersion d’énergie (MEB-EDS).
L’étude des glaçures peut nous apporter des informations sur le travail des potiers, leurs techniques
et savoir-faire, mais aussi sur l’organisation sociale et professionnelle de cet artisanat. En effet, la
glaçure est constituée de matières premières qui sont parfois dispendieuses et inaccessibles
localement, contrairement aux argiles.
Cette étude des glaçures du centre potier de Sadirac effectue une première approche des recettes de
mélanges glaçurant dans le but de comprendre les matières premières utilisées, ainsi que les
techniques et méthodes de fabrication mises en œuvre. Une première partie concernant la
caractérisation physico-chimique de 61 échantillons de céramiques glaçurées vert précédera
l’évaluation des variations spatio-temporelles de ces recettes de glaçure.
Les résultats tendent à démontrer une variabilité conséquente au sein des ateliers pour toutes les
périodes confondues. De plus, il a été possible de corréler certaines tendances avec des mutations
profondes de l’artisanat, déjà entraperçues historiquement et archéologiquement.
Mots-clés : Glaçure, Sadirac, MEB-EDS, poterie.
Abstract This study is a first approach to glazes of the traditional potter’s village of Sadirac, Gironde.
Productions from eight sites from the 14th
to the 19th
centuries are studied by scanning electron
microscopy with energy dispersive X-ray spectrometer (SEM-EDS).
Because of their composition in costly and often inaccessible raw materials unlike clay, looking at
glazes can bring information about potter’s work, skills and know-how, besides to inform about social
and professional organisation.
The main purpose of this research is to understand raw materials, methods and techniques
implemented in conception and recipes of glazing mixture. A first part dealing with physicochemical
characterisation of 61 ceramic samples with green glaze will precede the evaluation of the spatial-
temporal variations of their compositions.
Results tend to show substantial variations between workshops for all periods. Furthermore, it was
possible to correlate some tendencies with deep mutations of this handcraft already describe
historically and archeologically.
Key words: Glaze, Sadirac, SEM-EDS, pottery.