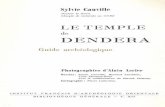An exposition of the "reasons" contained in the counter petition of ...
Exposition archéologique: Un pont sur l'Oyapock 2011
Transcript of Exposition archéologique: Un pont sur l'Oyapock 2011
2Un PONT sur l ’OYAPOCK Introduction 3 Un PONT sur l ’OYAPOCKIntroduction
Commissaire de l’exposition : Gérald Migeon, Conservateur régional de l’archéologie de Guyane, avec l’aide de Mme Sophie Vessière et M. Claude Le Reun de la DEAL.
aveC l’aimable appui de Matthieu Hildebrand et Mickaël Mestre de l’IN-RAP Guyane (panneaux INRAP), Mariana Cabral et João Saldanha du IEPA de l’Amapa (panneaux IEPA). Damien Hanriot de l’Ecomusée de Régina-Kaw (panneau EMAK). Damien DAVY et le CNRS pour la mise à disposition de plusieurs photographies.
sont remerCiés pour le prêt des pièces archéologiques Mmes Marie-Paule Jean-Louis et Claude Coutet du Musée des cultures guyanaises, David Carita du Musée Franconie, et Damien Hanriot de l’EMAK.
Création, ConCeption graphique et maquette : Fanny Poncet
FinanCement : Etat/Ministère de l’Ecologie du Développement Durable des Transports et du Logement/Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de Guyane.
l’exposition « un pont sur l’oyapock » se tient à l’hôtel de la préfecture à Cayenne depuis la
fin octobre 2011.
elle est organisée dans le cadre de l’achèvement des travaux de la route d’accès et du pont
sur l’oyapock, fleuve qui fait le lien entre deux régions, deux pays, deux etats.
elle traite à la fois de la construction de cette nouvelle liaison et d’un ouvrage d’art, le pont, et
d’une histoire en train de s’écrire grâce aux découvertes archéologiques les plus récentes.
elle comporte 20 panneaux et une douzaine de pièces archéologiques et ethnographiques
issues des fouilles et appartenant à l’etat, (service régional de l’archéologie, daC) en partie
mises en dépôt au musée des Cultures guyanaises et au musée Franconie, à Cayenne.
elle est le fruit d’une coopération continue entre la direction des affaires culturelles (daC) et
la direction de l’environnement de l’aménagement et du logement (deal).
après une introduction sur le milieu, une première partie de l’exposition traite des occupa-
tions amérindiennes anciennes, des premiers explorateurs, conquérants et colons européens
des xvi° et xviième siècles, et soldats, missionnaires, colons, savants et explorateurs aven-
turiers des xviii et xixème siècles.
les fouilles préventives récentes de l’inrap, qui ont permis de mettre au jour des puits funé-
raires exceptionnels composent le deuxième ensemble.
les recherches archéologiques en cours en amapa (sur les rives du pont, à Calçoene et à
macapa), dont la présentation a été rédigée en collaboration avec les chercheurs brésiliens
du iepa forment la troisième partie de l’ensemble.
la construction du pont et de la route d’accès côté français, constitue sa quatrième partie.
une brève présentation des populations contemporaines riveraines du fleuve termine cette
exposition documentée.
le pont et l’ouverture d’une liaison routière entre l’amapa et la guyane suscitent de nom-
breuses attentes. il s’inscrit dans un contexte historique dont cette exposition veut aussi
témoigner.
Cette exposition a vocation à être ensuite présentée dans d’autres lieux de guyane et notam-
ment à saint georges de l’oyapock.
Cré
dits
pho
tos c
ouve
rtur
e : ©
J.P.
Cou
rau,
A. C
risti
noi,
D. D
avy,
Dec
io, D
. Han
riot,
DEA
L, R
. Lié
tard
, F.P
once
t.
1
2
4Un PONT sur l ’OYAPOCK Un fleuve entre monts et marécages 5 Un PONT sur l ’OYAPOCKUn fleuve entre monts et marécages
Un fleuveentre monts
et marécageS
lA CôTe sAUvAge
La région du Bas-Oyapock, entre l’embouchure et le premier saut, saut Maripa, est parsemée de reliefs montagneux côtiers. Entre l’Oréno-que et l’Amazone, ce sont les seuls reliefs existants, hormis les monts de Kourou, de Cayenne, les îles du Salut et de Rémire.
La côte des Guyanes, appelée côte sauvage à la période coloniale, est, en effet, très majoritairement com-posée de mangroves.
En arrivant par l’Océan, le premier mont sur l’Oyapock, très vite repéré par les navigateurs, est la Montagne d’Argent, qui culmine à 94m, et constitue une véritable sentinelle à l’en-trée du fleuve. Son nom vient des feuilles des arbres dominants, lesquelles sont argentées et se reflètent au soleil.
En remontant le fleuve, apparaît la Monta-gne Bruyère (171m), dont les flancs tombent de manière abrupte dans l’Oyapock ; elle est flanquée à l’ouest du Mont Lucas (179m) qui jouxte la rivière Ouanary.
Sites Archéologiques
Villes, villages et Sauts
LEGENDE
Montagned'Argent
PointeBruyère
MontagneBruyère
Fouillesbrésiliennes
Point Morne
Fort St Louis
Saut Maripa
Oiapoque
St Georges
OuanaryUNe végéTATION lUxUrIANTe
La végétation est très diversifiée : maré-cages et forêt ripicoles (1), forêt inter-flu-viale, irriguée par les criques et parse-mée de savanes-roches (2) et de petits
mornes.
UN fleUve ImPéTUeUx
La région géographique du Bas-Oyapock se termine à Saut Maripa, un des nom-
breux sauts de ce fleuve tumultueux.
2
lA PlAge d’ANse brUYère
Une des rares plages de sable de l’embou-chure de cet immense fleuve, située dans l’anse Bruyère, a été propice aux installa-tions humaines : celles des Amérindiens, puis des explorateurs et colons européens.
Les autres élévations - Monts de l’Obser-vatoire qui culminent à 166 m ou ceux des Trois Pitons à 341 m - sont situés
plus en retrait des côtes et des fleuves.
Embouchure de l’Oyapock © G.MIGEON, SRA
© J.MAILLET, G.MIGEON, SRA
Monts Bruyère et Lucas © G.MIGEON, SRA
Plage d’Anse Bruyère © G.MIGEON, SRA
Côte à palétuviers à l’embouchure de l’Oyapock © G.MIGEON, SRA
© G.MIGEON, SRA
© G.MIGEON, SRA
Saut Maripa © F.PONCET
6Un PONT sur l ’OYAPOCK Historique des recherches
Historiquedes recherch
es archéologiques
Une intense occupationamérindienne anciennesur le bas o
yapock
d’IllUsTres ArCHéOlOgUes
L’ancienneté du peuplement amé-rindien de l’Oyapock remonte pro-bablement à plusieurs millénaires, mais seuls quelques objets archéo-logiques issus des grottes ou abris amérindiens anciens de Ouanary et de Saint-Georges de l’Oyapock, ont pu être rattachés à un complexe chronologique daté, en l’occurrence l’Aristé.
Le brésilien Emilio Goeldi d’origine suisse avait mis au jour, en 1895, plusieurs urnes funéraires à l’esthé-tique remarquable, mais d’un style alors inconnu.
Il fallut attendre 1957 pour que soit créé par Betty Meggers et Clifford Evans le complexe Aristé, à partir de certains types de céramiques funé-raires découvertes en dépôt sous grotte, dans le nord de l’Amapa.
des mIgrATIONsveNUes de lOIN
Le peuplement amérindien précolom-bien et post-colonial est mal connu et apparaît complexe. Il est proba-blement lié à des migrations suc-cessives de groupes repoussés vers l’Oyapock, de l’Est (id est de l’Amapa et de l’Amazonie) ou de l’Ouest (du centre de la Guyane française ou des Guyanes hollandaise et anglaise, et de l’Orénoque), à la suite de ten-sions politiques diverses ou pour des motifs qui nous échappent.
“TrOUs” eT UrNes fUNérAIres
Les sites amérindiens d’habitat de plein air repérés sont rares, et constitués essentiellement de tessons éparpillés ou de quartz grossièrement taillés. Les “trous” sont de petits abris, des fissures, des galeries ou des puits, dans la cuirasse latéritique, bouchés intentionnellement parfois par les Amérindiens qui y ont déposé, à même le sol ou dans des anfractuosités, des urnes funéraires de grande qualité esthétique.
Dans les années 70 et 80, Hughes Petitjean-Roget et ses compagnons retrouvent diverses céramiques Aristé dans plusieurs trous des Monts Bruyère, Lucas et de l’Obser-vatoire.
En 1994, Stephen Rostain, dans sa thèse de doctorat, propose à partir des mobiliers provenant de sondages de la région de Ouanary, une partition en trois phases du complexe Aristé : ancien (entre 350 et 850 de notre ère), moyen (entre 850 et 1350 de notre ère) et récent (entre 1350 et 1750 de notre ère).
les fOUIlles PréveNTIves réCeNTes
Depuis les recherches de terrain de Rostain achevées en 1991, les seules opérations archéologiques de la région ayant apporté des données nouvelles sont celles réalisées récemment par Mickaël Mestre et Matthieu Hildebrand de l’INRAP Guyane, lors du diagnostic et de la fouille du site de Pointe Morne (voir panneaux 7 à 10) pour les rives françaises. Et celles des chercheurs brésiliens, Mariana Cabral et Joao Saldanha, du IEPA de Macapa, sur la rive brésilienne du pont, à Calçoene et dans d’autres sites de l’État d’Amapa (voir panneaux 14 à 17).
2
1 5
4
3
7 Un PONT sur l ’OYAPOCKOccupation amérindienne
UN ArT rUPesTre Très CArIbéeN
Deux sites principaux de roches gra-vées ont été repérés sur la Montagne d’Argent. Une cinquantaine de gra-vures réparties sur une quinzaine de roches ont fait l’objet de relevés par l’équipe de Guy et Marlène Mazière dans les années 90.
Les représentations, comme dans le reste de la Guyane sont anthropomor-phes, zoomorphes, géométriques et abstraites ; leur datation est impos-sible, elles peuvent être précolom-biennes ; des auteurs les attribuent aux Yayo arrivés à la fin du XVIème siè-cle de l’île de Trinidad. En tout cas, les registres iconographiques sont clairement caribéens (têtes ovales, zémi…).
Migration des populations amérindiennes
© Conception : G.MIGEON, C.COUTETRéalisation : F.PONCET
Trou Platine © G.MIGEON, SRA
Site de l’Anse, tête de tortue, © G.MIGEON, SRA
Site de l’Anse, figure anthropomorphe, © G.M
Site de l’Anse, figure anthropomorphe, © G.M
1 : Urne quadrangulaire Aristé, Trou Delft
© Coll. SRA, J.P COURAU
2 : Urne anthropomorphe Aristé, Trou Biche
© Coll. SRA/MCG, J.P COURAU
3 : Détail d’une urne anthropomorphe Aristé, Trou Gros
Montagne © Coll. SRA/Franconie, J.P COURAU
4 : Couvercle urne Aristé, Trou Biche
© Coll. SRA/MCG, J.P COURAU
5 : Urne anthropomorphe Aristé, Trou Gros Montagne
© Coll. SRA/Franconie, J.P COURAU
8Un PONT sur l ’OYAPOCK xvIe et xvIIème siècles
Les XVI et XVIIèmes sièclesdécouvreurs,
conquérants et colons e
uropéens
1500 : PINzóN
De sa découverte jusqu’à la fin du XIXème, voire du XXème siècle, l’Oya-pock est la voie de passage privilé-giée empruntée par les explorateurs, missionnaires, officiers... pour péné-trer à l’intérieur de la Guyane et atteindre l’Amazonie et ses mirages : Eldorado, Amazones...
Plusieurs navigateurs célèbres auront rendez-vous avec la Guyane et l’Oyapock autour de 1500.
En 1499, le navigateur espagnol, Alonso de Ojeda, accompagné du pilote Juan de la Cosa et d’Amerigo Vespucci, avait visité les côtes du continent sud-américain, près de l’embouchure de l’Orénoque; nul ne sait s’il avait atteint les côtes de Guyane française.
les lUTTeseNTre ANglAIs, frANçAIseT HOllANdAIs
Ensuite, et pendant plus de trois siècles, les commerçants et colons européens, principalement anglais, français, hollandais, viennent com-mercer ou s’installer sur l’Oyapock.
Les Anglais sont, d’après les sources historiques connues, les premiers arrivants en 1604 ; ils essaient de fonder une colonie sur la rive gau-che de l’Oyapock.
Le navigateur espagnol,
Vicente Yáñez Pinzón, est le premier européen, dont
la présence est attestée, en 1500, sur l’Oyapock.
En 1607, les Français essaient d’éta-blir une colonie sur l’Oyapock ; en vain. Les Hollandais sont les plus actifs ; entre 1623 et 1625, Jesse de Forest reconnaît l’Oyapock au nom de la Dutch West India Com-pany. Puis en mai 1625, des Hol-landais fuyant devant les Portugais installent un fort sur la rive gauche de l’Oyapock. Ils seront chassés par les Amérindiens.
A partir de 1677, avec la prise du fort hollandais de l’Oyapock, les Français occupent la région du Bas-Oyapock avec plus de succès, même si les pirates (en particulier hollandais et anglais) et les Amérin-diens contrecarrent leurs desseins.
Carte de Juan de la Cosa, datant de 1500.
Pays des Caribes et Guiane, 17ème siècle.
Carte de Mentelle, 18e siècle. Carte de C.Raleigh, début 17e siècle.
XVIII et XIXèmes siècles européensSoldats, missionnaires, colons,savants et explorateurs aventuriers
Les XVIIIe et XIXe siècles voient les Français s’installer dans le Bas-Oya-pock ; mais la construction du fort Saint-Louis et du bourg de Saint-Georges en 1725, et la création de la mission jésuite en 1727, où exerça le Père Fauque, se déroulent dans un climat d’insécurité.
La construction du fort n’empêche pas, en effet, les raids portugais et anglais. En 1726, les Portugais ten-tent de s’établir à la Montagne d’Ar-gent, mais ils sont repoussés. Un officier portugais, Diego de Pinto laissera un compte-rendu daté de
1728, localisant et décrivant som-mairement quelques roches gravées amérindiennes.
Le 11 novembre 1744, un corsaire anglais, Siméon Potter, s’empare du fort Saint-Louis et met en fuite les Amérindiens, alliés des Français.
Les Français s’installent une nouvelle fois et, en 1776, est fondée la Compa-gnie de la Guyane française, conces-sionnaire du Bas-Oyapock, de la Ouanary et de l’Approuague ; elle fait faillite en 1783 et renaît sous le nom de “Compagnie de la traite de la gomme du Sénégal”.
Dans les années 1790, les habita-tions de la compagnie comptent plus de trois cents esclaves noirs.
9 Un PONT sur l ’OYAPOCKxvIIIe et xIxème siècles
Au XVIIIe siècle, plusieurs savants parcourent la région de l’Oyapock : le géographe Simon, en 1766, puis Patris, médecin botaniste, en 1767, qui, rencontre les Émerillons sur l’Inini.
Entre 1788 et 1790, les voyages de Jean-Baptiste Leblond, médecin naturaliste qui lève une carte très précise de l’Oyapock, sont les derniers du siècle des Lumières.
A la fin du XIXe siècle, les explorateurs Jules Crevaux et Henri Coudreau parcourent la Guyane et le territoire contesté entre la France et le Brésil.
Enfin, au début du XXe siècle, le voyageur naturaliste, Fran-çois Geay collecte, à Ouanary, des urnes funéraires iden-tiques à celles qu’Emilio Goeldi a découvertes en Amapa sur la montagne Aristé. Il sera le dernier explorateur de l’Oyapock, au moment même où l’arbitrage suisse règle le problème du contesté avec le Brésil.
Carte de ??, datant de ??
sOldATs eT mIssIONNAIres
sAvANTs eT exPlOrATeUrs
10Un PONT sur l ’OYAPOCK fouilles préventives
Pointe-Mornela rencontre
de deux mondes amérindi
ens
La fouille du site de Pointe-Morne a succédé à une cam-pagne de diagnostics menée en 2006 sur la commune de Saint-Georges-de-l’Oyapock.
Elle a été réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la DDE, à l’emplacement du futur pont entre la Guyane française et le Brésil. Les vestiges de deux groupes de populations, Aristé et Koriabo, ont été mis au jour. Le site, dans un remarquable état de conservation, a permis de mieux comprendre les interactions entre les groupes humains installés dans cette région.
La fouille a révélé que ce groupe humain a fréquenté les lieux uniquement à des fins funéraires et cérémonielles, la localisation du village Aristé restant encore une énigme à ce jour. Cet espace, qui semble avoir été symboliquement délimité par le creusement d’un fossé, regroupe quatre tombes profondes de 1,20 m à 3 m. Elles sont consti-tuées d’un puits d’accès et d’une chambre sépulcrale voûtée et orientée à l’est, dans laquelle ont été disposées des urnes funéraires anthropomorphes* et polychromes accompagnées de poteries-offrandes.
*Anthropomorphe : ensemble de caractères ou d’attributs qui rappellent le corps humain
Ces urnes peuvent être considérées comme la symbo-lisation du corps des défunts. Leurs dimensions et leurs attributs doivent être associés à l’identité sexuelle du mort, son âge, voire sa position sociale. Près de ces puits, des structures archéologiques plus communes témoi-gnent d’activités ou d’aménagements reliés au caractère mortuaire des lieux.
Selon les premières datations, cette nécropole pourrait avoir fonctionné régulièrement entre la fin du Xe siècle et le début du XVe siècle de notre ère.
Au début du XVe siècle de notre ère, la Pointe-Morne est investie par une population rattachée au groupe Koriabo. Ces nouveaux occupants implantent un petit village et conservent le fossé comme limite de leur extension sur le plateau. De nombreux objets utilitaires, en pierre ou en terre cuite, destinés à un travail spécialisé ou à une activité quotidienne témoignent de ce changement d’oc-cupation et de destination du site.
Les puits funéraires aménagés par les occupants Aristé sont visités et réutilisés sans aucun ménagement comme de simples dépotoirs par les Koriabo. Les premiers occu-pants du site semblent ainsi dépossédés de ce lieu de mémoire qu’ils étaient seuls à fréquenter depuis plu-sieurs siècles. Les pratiques funéraires des Koriabo ne sont en revanche pas connues.
11 Un PONT sur l ’OYAPOCKfouilles préventives
Les traces d’occupation s’étendaient sur l’ensemble du sommet de la Pointe-Morne, naturellement déli-mité par des pentes abruptes et un fossé creusé par les occupants des lieux afin de barrer la partie la plus étroite de la ligne de crête. eperon barré : promontoire protégé par un fossé creusé dans sa partie la plus étroite, les autres étant défendus naturellement par des pentes, une rivière ou la mer.
l’eNsemble fUNérAIre ArIsTé
le sITe d’HAbITAT KOrIAbO
Décapages archéologiques sur le chantier du pont.
accès
CarbetDépot
site
0.00
0.00
5.00
5.00
10.00
10.00
10.00
15.00
15.00
15.00
20.00
20.0
0
20.00
25.00
25.0
0
25.00
30.00
30.0
0
30.00
35.00
40.00
45.00
BRESIL
terre
GUYANE FRANCAISE
0 100m
N
Fleuve Oyapock
Fossé
Puits funéraires Aristé
Fouille
-1m
-2m
0m
croquis non-contractuel
Dépôt de vases funéraires de type Aristé en place © Matthieu Hildebrand, Inrap
-2m
0m
croquis non-contractuel
Couches KoriaboCouches Aristé
Interprétation de la réutilisation des puits funéraires © Matthieu Hildebrand, Mickaël Mestre, Inrap
Vases de type Koriabo © Martijn Van Den Bel, Inrap
12Un PONT sur l ’OYAPOCK fouilles préventives
NETTOYER
Les pièces archéologiques retirées du sous-sol se présen-tent le plus souvent à l’état de fragments et sont recou-vertes d’une pellicule de terre qu’il faut soigneusement retirer. Ces vestiges en terre cuite ou en pierre font géné-ralement l’objet d’un simple lavage à l’eau claire. Néan-moins, la fragilité des décors peints sur certaines pote-ries ne permet pas toujours d’employer cette méthode. Un protocole de nettoyage spécifique est donc appliqué afin de débarrasser la surface du sédiment qui s’est aggloméré au cours de l’enfouissement. Le nettoyage est alors effectué à sec à l’aide de bâtonnets en bois ou en caoutchouc ou encore par l’intermédiaire d’une solution d’éthanol et d’eau.
Les manifestations archéologiques des sociétés Aristé et Koriabo ont été mises en évidence pour la première fois aux confins oriental et occidental du plateau des Guyanes.
13 Un PONT sur l ’OYAPOCKfouilles préventives
A lA CONvergeNCe de deUx mONdes AmérINdIeNsAPrès lA fOUIlle : lA CONsOlIdATION
Nettoyage au laboratoire d’une écuelle décorée © Sandra Kayamaré, Inrap
Récipient décoré en cours de consolidation © Lydie Joanny, Inrap
CONSOLIDER
La cassure, ou tranche, des fragments est très soigneu-sement nettoyée, puis consolidée par une résine avant d’être encollée pour réaliser le remontage, qui permettra de mieux comprendre la forme initiale de l’objet. Ces col-lages restent fragiles et il est parfois nécessaire d’avoir recours à des attelles pour remplacer des morceaux manquants ou renforcer la structure d’un objet très fra-gilisé. Ces techniques de conservation préventive doivent toujours rester lisibles et réversibles et ne doivent pas dénaturer la pièce consolidée.
Ecuelle décorée après consolidation © Ronan Liétard
Urne funéraire consolidée© Ronan Liétard
Cette urne funéraire, destinée à contenir des ossements, a été reconstituée à partir de 207 fragments retrouvés éparpillés dans un des puits. Le remontage permet de mieux comprendre l’objet et son symbolisme. On s’aperçoit ainsi qu’il a été humanisé par des attributs propres au corps humain - oreille, nez, bouche - positionnés sur la partie la plus haute du col. Il porte également un revêtement uniforme blanc et des dessins géométriques rouges très partiellement conservés à cause de son enfouissement pendant plusieurs centaines d’années.
ÉTUDIER
Les différentes étapes de conservation réalisées, les for-mes et les décors peuvent être étudiés pour mieux com-prendre la société dans laquelle ils ont été produits. Sur le site de Pointe-Morne 24 vases Aristé en terre cuite ont ainsi été remontés et consolidés à partir de 918 fragments pré-levés dans dif-férentes couches archéologiques.
Urne funéraire consolidée © Ronan Liétard
Cette urne n’a pas pu être reconstituée entièrement, la partie supérieure, supposée accueillir des attributs humains, est man-
quante. Elle présente par contre une ornementation riche et bien conservée, constituée de motifs géométriques répétitifs et de thèmes plus symboliques...
Carte dressée par Jesse de Forest lors d’un voyage de reconnaissance effectué en 1623-25 de l’embouchure de l’Oyapock jusqu’au Saut Maripa. Elle montre plusieurs villages et populations amérindiens qui peuplaient alors les berges du fleuve.
Extrait du journal du voyage fait par les pères de familles envoyés par Mrs les Directeurs de la Compagnie des Indes Occidentales pour visiter la coste de la Gujane de 1623-25, p 170 in De Forest, Emile Johnston A Waloon Family in America; Lockwood De Forest and His Forbears; in Two Volumes. Together with a Voyage to Guiana, Being the Journal of Jesse De Forest and His Colonists 1623-1625 (The Apple Manor Press. 2007, originally published in 1914).
Le groupe Aristé est essentiellement connu à travers ses centres funéraires. Il est mentionné pour la première fois en Amapá par Emilio Goeldi après la découverte en 1895 de puits funéraires dans la région de Cunany. Les Aristé occupaient un vaste territoire qui s’étendait selon toute vraisemblance entre le fleuve Araguari et les berges du bas-Oyapock. Le calage dans le temps de cette culture reste encore approximatif, les rares datations s’étalant entre le IIIe siècle et le XVe siècle après J.-C. Néanmoins, des objets européens en verre et en faïence associés à certains ensembles funéraires semblent prolonger l’utili-sation des urnes jusqu’au XVIIIe siècle.
Le groupe Koriabo est à l’origine d’un style céramique découvert au Guyana dans les années cinquante par les archéologues Clifford Evans et Betty Meggers. Ces mani-festations sont maintenant reconnues sur un vaste terri-toire s’étendant du Guyana au Brésil. Cette population, dont la culture matérielle a été mentionnée sur de nom-breux sites, paraît émerger au début du premier millénaire de notre ère et occuper presque simultanément l’ensem-ble du plateau des Guyanes jusqu’à la fin du XVe siècle.
La succession de ces deux groupes humains sur le site de Pointe-Morne, l’un semblant remplacer l’autre, permet d’entrevoir concrètement pour la première fois sur un site précolombien de Guyane française des changements régio-naux, politiques et culturels. Ce nouveau paysage géopo-litique sera renversé par l’arrivée des premiers Européens dans le bassin de l’Oyapock au cours du XVIe siècle.
Le site en cours de fouille vu depuis la rive brésilienne © Mickaël Mestre, Inrap
Guyane française
Brésil
Océan Atlantique
Amapá
Suriname
Guyana
Equateur
60° 57° 54° 51°
3°
6°
KORIABO ARISTE
Positionnement des aires culturelles Aristé et Koriabo © M. Hildebrand, Inrap
14Un PONT sur l ’OYAPOCK Un village amérindiens de 850 ans
Un village amérindiende 850 ans
Pelleteuse en action sur le site du côté brésilien © G.MIGEON, SRA
1 - Mégalithe au moment du solstice de décembre © IEPA Macapá
2/3 - Offrandes et sépultures retrouvées auprès du site des mégalithe © IEPA Macapá
4 - Vue du site principal de Calçoene © IEPA Macapá
Vases de type Koriabo © Martijn Van Den Bel, Inrap
Vases de type Koriabo© Martijn Van Den Bel, Inrap
Dans une autre aire du site, sur les rives du fleuve Oyapock, les archéologues brésiliens ont identifié les fondations d’une habitation coloniale, construi-tes en blocs de roche graniti-que et en briques. Les trous des deux poteaux principaux ont aussi été retrouvés, signa-lant une véranda sur un des côtés de l’habitation. Selon les pièces collectées, on suppose que cette habitation fut habi-tée entre la fin du XVIIIème et le début du XIXème siècle.
Le site mégalithique et rituel précolombien
de Calçoene
Les fouilles archéologiques réalisées dans quelques-uns de ces sites indiquent qu’ils furent utilisés pour des fêtes et des célébrations, étant donné le nombre élevé d’offrandes. Dans certains cas, des sépultures ont été mises à jour. Les restes mortuaires étaient conditionnés dans des vases en céramique, certains de forme anthro-pomorphe. Ces vases, qui contiennent peu d’ossements, étaient déposés au fond de puits funéraires, dont les entrées étaient bouchées par de grands blocs de granite. Les datations obtenues permettent de dire que ces sites furent utilisés il y a 1000 ans.
Les recherches réalisées par les archéologues du IEPA dans le territoire communal de Calçoene et ses environs ont aussi porté sur des sites moins spectaculaires que les constructions mégalithiques. D’anciens villages indi-gènes où les constructeurs des mégalithes vivaient, sont une source très importante pour les archéologues pour reconstruire l’histoire des ces peuples anciens. Les étu-des réalisées sur ce type de site dans l’Amapá, montrent que les groupes indigènes des cette région habitaient de petits villages, constitués de quelques maisons, en géné-ral de forme circulaire, avec un diamètre d’une dizaine de mètres.
15 Un PONT sur l ’OYAPOCKle site de Calçoene
Dans le territoire communal de Calçoene, où l’équipe d’archéologie du IEPA travaille depuis 2006, un type de site archéologique attire par-ticulièrement l’attention. Il s’agit de monuments mégalithiques construits avec des grands blocs de granite, appelés mégalithes. Les blocs ont été pla-cés de manière organisée sur le sommet de petites élévations, proches des criques. Ils sont de forme circulaire ou linéaire et peuvent être construits avec plus d’une centaine de blocs. 32
4
1
La construction du pont binational entre Saint Georges et la ville d’Oiapo-que a permis la découverte d’un site archéologique du côté brésilien, ainsi que du côté français.
Les fouilles archéologiques du site du Pont de l’Oyapock ont révélé deux aires d’occupation humaine ancienne. Dans l’aire où commence le pont du côté brésilien, sur le som-met du morne, était située une partie du site archéologique avec l’occupa-tion la plus ancienne. Les vestiges d’un village indigène, habité il y a environ 850 ans, y ont été retrouvés. Les archéologues ont identifié une série de trous de poteaux qui ont servi pour les habitations et d’autres structures.
Grâce aux fouilles, il a été possible d’identifier des fosses rectangulaires, qui pourraient avoir servi de sépul-tures, ainsi que d’autres structures enterrées, remplies de terre et de tessons céramiques.
16Un PONT sur l ’OYAPOCK les urnes funéraires
Les urnes funéraires
du site de l’Université (UN
IFAP)
Vue d’ensemble des fouilles du site funéraire de l’université © IEPA Macapá
Urne Caviana retrouvée à Curiavi © IEPA Macapá
Le fort de Macapaet la ville coloniale de Mazagão
17 Un PONT sur l ’OYAPOCKle fort de macapa
L’archéologie de l’État de l’Amapá s’est énormément développée ces dernières années. L’accom-pagnement des travaux d’in-frastructures par des équipes d’archéologues, en application de la législation de protection du patrimoine archéologique brésilien, a permis de multiplier les connaissances disponibles sur la préhistoire de la région de Macapá, capitale de l’État.
Les recherches réalisées par l’équipe du IEPA dans cette région ont démontré que différents groupes indigènes ont cohabité dans cette aire, partageant dans certains cas, les mêmes sites.
C’est ce qui arriva dans le cime-tière indigène localisé à l’intérieur du campus de l’université fédé-rale de l’Amapá (UNIFAP). Les fouilles effectuées entre 2008 et 2010 ont révélé un ensemble d’urnes funéraires de différents styles ; On retrouve même des pièces de style marajoara, qui prouvent que dans la préhistoire, des réseaux de relations entre l’archipel (l’île de Marajo) et le continent étaient en action.
Grâce aux vestiges de charbon, on sait que ce cimetière fut utilisé durant près de trois siècles, entre 1000 et 1300 de notre ère.
Dans les environs de Macapa, l’existence d’au moins trois fortifications militaires coloniales est connue, ce qui démontre le haut potentiel de cette région pour des recherches archéologiques sur les premiers siècles de l’occupation européenne en Amazonie. En plus des sites militaires, de petits bourgs coloniaux offrent aussi beau-coup d’informations pour l’archéologie historique. Sur le territoire communal de Mazagão, la ville de Mazagão Velho
(Mazagan le Vieux), distante de près de 60 km de Macapá, garde encore des vestiges de l’église de la période colo-niale. Au XVIIIème siècle, le bourg fut fondé pour accueillir des immigrants portugais venus de la ville marocaine de Mazagan. Les fouilles réalisées par l’Université fédérale du Pernambuco ont mis au jour de nombreuses sépultu-res et les fondations de l’église, qui a continué à servir de cimetière après son abandon.
Les vestiges archéologiques postérieurs à l’arrivée des Européens dans cette région, peuvent être retrouvés dans l’État de l’Amapá. Dans la capitale, Macapá, la splendide forteresse de São José, construite au XVIIIème siècle par le Portugal, a été étudié archéologiquement, pendant la mise en valeur de ses abords. De nouvelles structures architecturales furent identifiées par l’équipe d’archéologues de l’Université du Pernambuco (Recife) ; le fort constitue la plus grande construction militaire de la période coloniale en Amérique latine.
Fortaleza de Macapá © IEPA Macapá Fortaleza de Macapá © G.MIGEON, SRA
Fortaleza de Macapá © G.MIGEON, SRA
© G.MIGEON
© G.MIGEON © G.MIGEON
18Un PONT sur l ’OYAPOCK Historique
HistoriqueDE LA CONSTR
UCTION DU PONT
faune & florecontexte
19 Un PONT sur l ’OYAPOCKfaune et flore
L’achèvement en 2003 de la liaison routière entre Régina et Saint Georges de l’Oyapock a créé un accès routier à la frontière brésilienne. Cette liaison devait naturellement se prolonger vers le Brésil en franchissant le fleuve Oyapock. Les premières études du franchissement de l’Oyapock ont été menées au début des années 2000.
L’aménagement du franchissement du fleuve Oyapock a été confirmé par le comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire (CIADT) du 18 décembre 2003.
ObJECTIfS DE L’ÉTUDE
Une étude sur la faune et la flore a été réalisée avant l’aménagement de la voie d’accès au pont sur l’Oyapock afin de déterminer le tracé le moins impactant et les mesures d’insertion pouvant être mises en oeuvre.Un layon piéton a tout d’abord été ouvert entre Saint Georges et l’emplacement du pont. Ce layon présentait une largeur de 1 à 2m de sorte qu’il pouvait ensuite être rapidement résorbé par la forêt.
L’accord franco-brésilien relatif à la construction d’un pont sur le fleuve Oyapock et de la liaison routière reliant la Guyane et l’Etat de l’Amapa a été signé le 15 juillet 2005, à l’oc-casion de la visite du président LUIZ INACIO DA SILVA LULA en France.
Cet accord a été ratifié par le Brésil en 2006 et par la France par une loi du 18 janvier 2007.
Il prévoit que chaque État réalise les voies d’accès au pont et les postes de contrôle situés sur son territoire et que le pont sera construit sous maîtrise d’ouvrage brésilienne.
Il a institué deux commissions char-gées de coordonner les différentes étapes du projet : une commission intergouvernementale, en charge du pilotage global, et une commission technique.
l’Axe rN1/rN2 eN gUYANe
L’axe RN1/RN2 assure la liaison entre Saint Laurent du Maroni (frontière surinamaise) à l’Ouest, Cayenne et les villes du littoral, et Saint Georges de l’Oyapock (frontière brésilienne) à l’Est.
l’Axe rN1/rN2 à grANde éCHelle
A grande échelle la route RN1/RN2 constitue un maillon d’une “panaméricaine atlantique” reliant le Guyana, le Surinam, la Guyane et le brésil. Le franchissement du fleuve Oyapock permet d’ouvrir la Guyane vers l’Etat voisin de l’AMAPA et constitue un lien routier entre la france et le brésil.
la rencontre des présidents sArKOzY et lUIz INACIO dA sIlvA lUlA à saint georges de l’Oyapock en février 2008 a été
l’occasion de réaffirmer leur volonté commune de faire aboutir rapidement la réalisation de cette liaison.
LES GRANDES ÉTAPES
> 1997 : rencontre présidents Chirac Carduzzo> 2003 : confirmation par le CIADT> 2005 : accord franco-brésilien,approbation de l’APS> 2008 : déclaration d’utilité publique> 2008-2011 : travaux
Scytale © M.Blanc Harpie féroce © M.BParesseux © M.Blanc Punctatus © M.Blanc
Hortia superba © J.J de Granville
fAUNe / mIlIeU fOresTIer
La diversité des espèces rencontrées est très faible. Seules des espèces très communes et peu sensibles à la perturbation des habitats ont été observées (agouti, tamarin, écu-reuil...).
> 145 espèces d’oiseaux ont été identifiées, dont deux rares.
> 13 espèces de lézards et 7 espèces de serpents ont été recensées.
fAUNe / mIlIeU AqUATIqUe
31 espèces d’amphibiens,1 espèce de tortue et 39 espèces de poissons ont été inventoriées. L’élément le plus important de l’inventaire est la découverte d’une espèce d’amphi-
bien peu connue en Guyane.
flOre
Plusieurs formations végétales ont été rencontrées :
> Des formations secondaires : provenant d’anciens abbatis.> Des forêts marécageuses : riches en palmiers “pinot” et “toulouri” et en espèces végétales rares dont une espèce protégée.
> De magnifique forêts primaires de terre ferme, âgées, encore préservées sur les sommets et les pentes de certaines collines.
Ces études ont conduit le maitre d’ouvrage à choisir un tracé qui évite les zones basses les plus riches dans les domaines floristiques et faunistiques.
Platemys © M.Blanc
Osteocephalus taurinus © M.Blanc
Dendropsophus sp1. © M.Blanc
Pterocarpus officinalis © J.J de Granville
Forêt haute © J.J de Granville
Sipanea biflora© J.J de Granville
Picrolemma pseudocoffea© J.J de Granville
CARACTÉRISTIqUES PRINCIPALES
> Pont à haubans
> 2 pylônes, 104 haubans
> hauteur des pylônes : 83 m
> Longueur : 378 m
> 2 voies de 3,45 m pour la chaussée
> 2 voies piétons/cycles de 1,75 m
> gabarit de navigation : 50 m
> Coût : environ 20 M€(dont 10 M€ financés par la france)
mATérIel
Afin de réaliser les travaux dans des délais très courts, des matériels spé-cifiques ont été amenés par convois exceptionnels, en provenance de Cayenne, de métropole ou de la répu-
blique Dominicaine.
TrAvAUx de TerrAssemeNT
Les matériaux extraits des déblais ont servi à construire les trois grands remblais de franchissement des criques. Les matériaux restant ont permis de créer une pla-teforme necéssaire au déplacement de l’ancien champ de tirs de l’armée. Plusieurs grands bassins ont été construits pour traiter les eaux de pluies de la route.
OUvrAges HYdrAUlIqUes
Trois ouvrages hydrauliques assurent le franchissement des criques interceptées et permettent ainsi une transpa-rence hydraulique. Ces ouvrages sont particulièrement adaptés aux fortes hauteurs de remblais. Ils comportent des passages latéraux afin de permettre les traversées
des petits mammifères, reptiles et batraciens.
CHAUssée
Les trois couches de la chaussée sont constituées de matériaux latéritiques extraits du chantier et traitées au ciment ou de matériaux provenant de la
carrière de St Georges.
COUlOIrs éCOlOgIqUes
Pour réduire l’effet de coupure produit par la route, deux couloirs écologiques sont créés : la forêt est ainsi maintenue de part et d’autre jusqu’en bord de
route.
les éqUIPemeNTs
le parc de la DEAL a assuré l’installa-tion des équipements de sécurité et de
signalisation.
Chantiervoie d’accès
au pont sur l’Oyapock Côté frança
is Chantierdu pont sur l’oyapock
21 Un PONT sur l ’OYAPOCKChantier du pont
CARACTÉRISTIqUESPRINCIPALES
DE LA VOIE ACCèS
> Longueur : 5,7 km> 600 000m3 déblais/ 215 000m3 remblais> 4 bassins de traitementdes eaux de la chaussée> 3 ouvrages hydrauliques de franchissement de criques> 2 couloirs écologiques> Coût : 25M€> Vitesse circulation : 90km/hAUTRES OUVRAGES
un giratoire d’extrémité de la déviation permet l’accès direct à Saint-Georges et à la zone d’activité. Un poste de contrôle a été créé à proximité du pont.
L’appel d’offres relatif à la construction du pont a
été lancé fin novembre 2008. Cinq groupements
ont répondu. C’est le groupement EGESA/CMT
(groupement brésilien) qui a présenté une offre variante la
plus intéressante.
Le choix de l’entreprise a été validé par la commission intergouverne-mentale le 29 avril 2009.
L’ordre de service de démarrage des travaux du pont a été donné le 13 juillet 2009.
Des travaux préparatoires sur la zone de chantier ont été nécessaires: sondages complémentaires, appon-tement d’accès... Des travaux de dia-gnostics et de fouilles archéologiques ont également été réalisés préalable-ment aux travaux.
Les pylônes du pontont été réalisés en 2010
et le tablier a été posé en 2011.samedi 28 mai 2011,vers 22h30, la jonction
entre les 2 rives du tablier du pont sur l’Oyapock
a été effectuée.
20Un PONT sur l ’OYAPOCK Chantier voie d’accès
Installé à Régina sur les berges du fleuve Approuague, l’EMAK est ouvert depuis mai 2008. En lien étroit avec la population, il étudie, conserve et valorise un patrimoine aux composantes multiples : archéologie, his-toire, environnement naturel, traditions, industries…
22Un PONT sur l ’OYAPOCK l’écomusée municipal
L’Écomusée municipald’Approuague
-Kaw (EMAK), Régina
Ancré dans le territoire d’Approuague-Kaw, voisin de celui d’Oyapock, ce “musée de France” est un acteur du développement culturel, éducatif social et économique local. Il développe à ce titre des partenariats et des projets nombreux qui lui confèrent un caractère structurant à l’échelle du terri-toire Est-guyanais.
L’EMAK propose à la visite un ensemble de bâtiments sur plus de 1 500 m² : une vaste bâtisse à l’archi-tecture traditionnelle reconvertie en exposition per-manente qui retrace le fil rouge de l’histoire locale, et une ancienne scierie qui a conservé ses vestiges industriels, ou encore des machines agricoles. Cet ensemble est l’héritage d’un très riche passé.
Le territoire local est également doté d’un environne-ment naturel exceptionnel, que souligne la présence de trois réserves naturelles sur la commune de Régina-Kaw : Les Nouragues, les marais de Kaw-Roura, l’île du Grand Connétable.
Un programme d’animations et d’événements variés qui se décline en visites, ateliers, spectacles, confé-rences, découvertes hors les murs, etc, permet à l’Écomusée de recevoir 6 000 visiteurs par an.
© EMAK
Bâtiment de l’exposition permanente © K. Vulpillat, EMAK, 2008
mercià tous les acteurs
de ce projet
© R.LIETAR © RIbAL, R.LIETAR
© R.LIETAR© DEAL
© R.LIETAR© R.LIETAR © DEAL © R.LIETAR
© R.LIETAR
© f.PONCET
© R.LIETAR