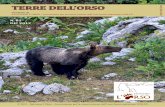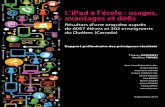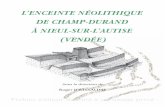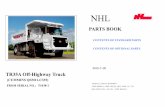La "Terre sans Mal". La trajectoire historique d'un mythe guarani et d'un mythe anthropologique
Milieu extrême, marge inhospitalière ? Enquête archéologique en terre de Sologne (1994-2014)
-
Upload
univ-paris1 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Milieu extrême, marge inhospitalière ? Enquête archéologique en terre de Sologne (1994-2014)
1
Raphaël ANGEVIN et Valérie SCHEMMAMA
Milieu extrême, marge inhospitalière ? Enquête archéologique en terre de Sologne (1994-2014)
1- Introduction
La Sologne est avant tout une terre de contrastes. Si d’un point de vue physique, elle se présente comme un espace naturel homogène, à l’unité géographique indéniable, sa définition relève presque toujours d’une caractérisation par défaut : trop souvent dans la littérature, elle se détermine en miroir des régions voisines, grande plaine céréalière de la Beauce au nord, paysages vallonnés du Berry et du Pays Fort au sud et à l’est, terrains calcaires du val de Loire et de la Touraine à l’ouest. Son modelé, il est vrai, ne présente que de rares variations et trahit une monotonie presque imperturbable entre val de Loire et val de Cher : dans ce secteur du bassin ligérien, le relief apparaît en effet si faiblement marqué de l’est vers l’ouest que les nombreux cours d’eau qui forment sa chevelure divaguent à l’envi dans une plaine marécageuse dont le substrat argilo-sableux favorise par ailleurs la stagnation des eaux superficielles. S’il en est ainsi, c’est que la Sologne constitue, aujourd’hui encore, une vaste cuvette, empreinte fossile de l’ancien lac de Beauce formé au cours du Miocène et partiellement rechargé à la fin de l’ère Tertiaire par des apports alluviaux massifs provenant du Massif central et de ses marges et qui n’a jamais été totalement comblé. Ces dépôts se sont accumulés en couches irrégulières entre les différents bassins versants, parfois sur plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur, effaçant les particularismes géographiques les plus forts et atténuant les formes les plus prononcées du relief. D’un point de vue géologique, ces sables et ces argiles en sont venus à former un large cône sédimentaire, entraînant de profondes modifications du paysage et une reconfiguration irréversible du tracé des différents cours d’eau, à la transition entre le socle cristallin et les franges méridionales du Bassin parisien. Ces bouleversements, perceptibles sur la longue durée des temps géologiques, ne sont évidemment pas restés indifférents quant à la nature des sols : des terres sablonneuses, légères et perméables, aux formations lourdes et argileuses où l’eau ne pénètre pas, la Sologne présente une variété de faciès pédologiques, à la structure nettement différenciée et dont la mise en valeur agricole ou forestière se révèle particulièrement délicate. En cela, la Sologne est assurément un espace de marge. Les traits communs de pauvreté de la végétation et d’austérité des sols trouvent un écho dans ses références étymologiques, qu’elles renvoient à un pays de seigle (Secalonia, de secale en latin), à une terre sablonneuse (Sabulonia), à un sol boisé (solum lignaeum) ou à un terroir marécageux1. Bien souvent présentée comme un milieu extrême, une terre inhospitalière, la Sologne aurait été sporadiquement occupée par l’homme qui ne se serait investi qu’à la marge dans son développement. Cette impression tient également à sa position excentrée au sein du système territorial hérité du Second âge du Fer. Frontière entre deux provinces – l’Aquitaine et la Lyonnaise – et deux cités antiques – celle des Bituriges au sud et celle des Carnutes au nord –, partagée entre trois diocèses (Blois, Orléans et Bourges) et autant de départements (Loir-et-Cher, Loiret, Cher), elle n’a jamais constitué une entité administrative, politique ou religieuse cohérente et ses limites demeurent floues. Sous ce regard, il est éclairant de constater que la première mention de la Secalonia apparaît en 651 dans le Testament de Léodebaud2, au cœur d’un VIIe siècle qui voit l’estompe progressive des cadres antiques et l’émergence de nouvelles structures territoriales qui trouvent leur plein achèvement dans le puissant mouvement de réorganisation de la période carolingienne.
1. Terme formé sur la racine hydronomique - sec et désignant un pays de rivières, d’étangs, de marais. 2. Abbé de Saint-Aignan d’Orléans au milieu du VIIe s.
2
Les différentes entités qui la composent se fondent en grande partie pourtant sur la trame tissée de manière assez lâche au Bas-Empire : lorsqu’à la fin du IIIe siècle, le sud de la cité carnute est arraché à la tutelle de Chartres-Autricum pour former la Civitas Aurelianorum, les espaces compris entre Loire et Beuvron sont logiquement rattachés à l’ancien emporium de Cenabum, promu chef-lieu de cité. Jusqu’au plein Moyen Âge, ils se retrouvent ainsi en position de marches par rapport aux unités politiques voisines, faisant tour à tour l’objet de convoitises ou de renoncements dans le cadre des stratégies militaires ou matrimoniales plus ou moins explicites mises en œuvre pour asseoir une domination pérenne sur ces territoires. Ce constat est renforcé par l’étude de l’organisation interne de ces espaces. Car, par-delà une position intermédiaire qui semble tenir une place de choix dans les rapports de force géopolitiques, l’originalité de la Sologne semble avant tout « s’exprimer dans l’absence de subdivisions nettes, les traits communs à la région l’emportant sur tous les facteurs de différenciation3 ». De fait et jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, cette dernière ne sera concernée qu’à la marge par les grands mouvements de découpage administratif et religieux qui accompagnent la structuration des régions plus vastes auxquelles elle s’intègre. En cela, elle apparaît donc susceptible, plus que d’autres régions peut-être, d’avoir conservé l’empreinte des anciens schémas territoriaux, à travers notamment une « fossilisation » des cadres antiques. Entre le Xe et le XIIIe siècle, l’encadrement de ces territoires par les centres du pouvoir se révèle d’ailleurs extrêmement limité : si nous bornons notre regard aux seules structures ecclésiastiques, il apparaît que les églises placées sous le patronat de l’archevêque de Bourges, de l’évêque d’Orléans et de leurs chapitres cathédraux sont presque totalement absentes des confins méridionaux et septentrionaux de ces diocèses, tandis que l’implantation du clergé régulier et séculier ne vient que partiellement combler ces lacunes et prendre localement le relai de l’autorité épiscopale (abbaye bénédictine de Pontlevoy, collège de chanoines de La Ferté-Imbault). De même, « l’encellulement » paroissial qui s’inscrit partout ailleurs dans la dynamique de la réforme grégorienne et sur la lancée du renouveau des bourgs ne trouve qu’un écho limité en Sologne au début du XIIIe s. capétien, alors même que les créations de villages y sont quasi-inexistantes et que l’essor économique tarde à trouver dans cette région une expression concrète4. Nous aurions sans doute tort d’imputer cet état de fait à la seule inertie des cadres régionaux. Il est vrai cependant qu’au sud, diocèse et pagus recouvrent dès la période mérovingienne, l’ensemble du territoire de l’antique civitas. Dans les décennies qui suivent, les carolingiens ne cherchent d’ailleurs pas à fractionner cet ensemble pourtant fort vaste, beaucoup trop pour être administré convenablement. En Sologne plus qu’ailleurs, les structures du pouvoir peinent d’ailleurs à s’enraciner durablement : aux IXe-Xe siècles, les vigueries ne se retrouvent que le long des grands axes de communication des vallées, tandis qu’aux siècles suivants, les rares châtellenies répertoriées semblent témoigner d’une féodalité tardivement reprise et mal assimilée. Du fait de la faiblesse de cet encadrement, le Berry et ses marges septentrionales semblent régulièrement tiraillés, politiquement et culturellement, entre la Francia au nord et l’Aquitaine au sud. Les conflits y sont nombreux et les équilibres temporels précaires. De ce point de vue, seule l’intégration au domaine royal capétien change radicalement la donne au début du XIIIe siècle, ouvrant sur de nouvelles dynamiques de développement dans les régions de France centrale. Nous pourrions déployer à l’envi et sans difficulté cette présentation des cadres géopolitiques, jusqu’à la Révolution au moins. Ces observations posent toutefois plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. Elles livrent en effet une vision nécessairement tronquée de la Sologne et restitue la trajectoire surprenante d’un territoire laissé en friche, éloigné des grands centres de décision et de production et placé à l’écart des axes majeurs de communication et d’échange. Or, si cette perception traduit une réalité incontestable, pour les périodes historiques en tout cas, elle n’en estompe pas moins la spécificité de cet espace et l’originalité de son peuplement. Elle fait fi des dynamiques propres à ce territoire, de sa capacité de réaction à une forme d’isolement, des mécanismes originaux et des formules singulières qu’il est diversement en capacité de déployer 3. GILLARDOT, 1981 : 7, cité dans HEUDE, 2012. 4. DEVAILLY, 1973.
3
pour répondre à des contraintes mais également à des opportunités d’évolution. En somme, tout ce qui fait la trame historique des événements que nous venons succinctement de rapporter. Invariablement, cette posture contraint donc à poser un regard ambigu, inconfortable sur l’objet de notre étude, depuis un hypothétique centre vers une périphérie qui reste à définir. Elle nous force en outre à mesurer la singularité de ces espaces à l’aune des seuls modèles familiers que nous avons l’habitude de manipuler et en miroir desquels la marge semble se déterminer. Car c’est bien à cette notion de marge qu’il faut revenir. Dans l’historiographie, la Sologne a presque toujours été envisagée sous le prisme étroit d’une périphérie débitrice : en la matière, l’archéologie ne fait pas exception et nous ramène méthodiquement, depuis le milieu du XIXe siècle, à la perception sans nuance d’un saltus inhospitalier. Or, ce topos ne traduit au mieux qu’une situation conjoncturelle qui ne peut logiquement être systématisée, notamment pour les périodes pré- et protohistoriques pour lesquelles les équilibres socioculturels ressortissent à une toute autre logique que ceux de leurs épigones. De nos rêves à la réalité historique, il y a donc une marge et c’est bien cette dernière que nous devons questionner. À cet égard, la Sologne mérite une histoire longue : ici plus qu’ailleurs en effet, les découpages chronologiques conventionnels se révèlent peu opérants et les dynamiques lentes que nous pouvons percevoir à différentes échelles s’accommodent difficilement d’une Histoire traditionnelle, « attentive au temps bref, à l’individu, à l’événement5 ». Refusant tout récit précipité, dramatique, de souffle court, la Sologne invite plutôt à parier sur la durée. Dans la suite de notre exposé, nous essayerons donc de mettre en place, à côté d’un simple récitatif des faits, un révélateur des conjonctures qui convoquera le passé par longues séquences chronologiques, d’ampleur séculaire ou millénaire. Dans ce contexte, la documentation archéologique apparaît comme une source privilégiée pour saisir les évolutions du territoire dans la longue durée. Par-delà la nécessaire constitution d’un répertoire des découvertes et des opérations réalisées depuis vingt ans sur ce territoire, l’objet de ce bilan sera donc d’enquêter plus spécifiquement sur la notion de marge en archéologie et de discuter la pertinence de son application à la Sologne. À cette fin, une réflexion sera proposée autour de ce concept, afin de préciser ses inférences tout à la fois géographiques, sociologiques et historiques et d’expliciter son contenu sémantique. Dans un deuxième temps, la présentation des sites fouillés et la description minutieuse des témoignages recueillis nous permettront d’interroger les modes d’occupation du sol au sein de cet espace et de dégager à grands traits les dynamiques d’aménagement qui lui sont propres. In fine, la mise en lumière des apports récents de la recherche, combinés aux éclaircissements terminologiques proposés plus tôt, conduira à une nouvelle instruction de ce dossier, dans le cadre d’un essai d’Histoire « totale ». 2- Les représentations de la Sologne Sous ce regard, il convient de rappeler une évidence : la Sologne est une construction historique, mais également historiographique. Cette réalité n’est évidemment pas indifférente car elle oriente, aujourd’hui encore, le regard que l’historien porte sur elle. De ce point de vue, l’abondante littérature du XIXe siècle éclaire cette construction. Ainsi, au travers de la lecture d’articles et de monographies, une perception singulière de la Sologne se dessine. Du reflet négatif, où se mêlent répulsion, déconsidération et méfiance à celui plus positif et dynamique fait de réactions, d’innovations et de rebonds, le territoire et ses occupants peuvent être diversement appréhendés. Le lecteur est alors partagé entre la sensation d’être confronté à des réalités fidèlement transmises par les témoins d’une époque et celle d’assister à la consolidation de lieux communs. Une multitude de qualificatifs nourrissent ces discours. Le choix de quelques-uns permet d’aborder quatre angles d’observations, plus ou moins abondamment, en lien avec notre questionnement préalable : la Sologne constitue-t-elle un territoire de marge ? Le contraste terre/eau est un des éléments essentiels de ces écrits, fomentant un enchaînement délétère de conditions défavorables, aux conséquences fâcheuses. La terre décrite
5. BRAUDEL 1958, p. 727.
4
comme stérile6, ingrate7 (avec le double sens que l’on peut y voir dans sa relation avec le paysan) devient ainsi sans valeur8, provoquant famine, misère9 et abandon10. Terre desséchée11 ou, au contraire, tellement gorgée d’eau qu’elle s’efface devant les inondations12. L’eau est omniprésente par la multitude des étangs13, des marais14 si souvent décrits comme mal entretenus15 (cet état de fait a du reste une résonance particulière pour la communauté scientifique du XIXe siècle16). L’eau stagnante devient néfaste à la végétation et par ricochet à l’animal17 et à l’homme18. Elle provoque le développement des fièvres19, de la maladie20. L’agonie21 et la mort s’en mêlent. La Sologne répulsive, suggérée comme un non-lieu. George Sand qualifie pour sa part de « vulgaire » le territoire solognot22 et cristallise ainsi bon nombre d’appréciations dévalorisantes. Sentiment accentué par le mimétisme23 entre le pays et l’habitant et que croient déceler ceux qui traversent ce lieu. Imprégnés qu’ils sont l’un de l’autre, ils sont ainsi et tour à tour perçus comme pauvres et sauvages. Le villageois aimable24 mais aussi paresseux25, est souvent dédaigné26 et livré à lui-même (fig. 1)27. Cette forme de repli, loin d’être atténuée par le développement des communautés et des solidarités familiales28, est d’ailleurs amplifiée par un réseau de communication par bien des aspects déficient29. Le paysage lui-même porte l’empreinte de ce cloisonnement : un pays bocager de taillis et de haies30. La Sologne isolée, déconsidérée, loin d’un centre de « civilisation ». Mobilités et échanges sont perceptibles sur le territoire, lors des guerres31, des marchés32, des foires33. Traversé et plus ou moins meurtri pendant les conflits, il est tantôt resserré sur lui-même – car il a parfois moins besoin que d’autres d’une immigration pour se reconstruire34 – ou tantôt ouvert, par nécessité35 ou pure bienveillance36. Il initie des élans de colère, la révolte en ce pays pouvant alors s’étendre aux contrées voisines37.
6. DELOYNES 1826, p. 17. 7. DELOYNES ibid., p. 1. 8. DELOYNES ibid., p. 8, 14. 9. DELOYNES ibid., p. 1, 7, 17 ; LE BORGNE 1854, p. 141 ; MONIN 1887, p. 3, 5. 10. DELOYNES ibid., p. 3, 6, 17. 11. DELOYNES ibid., p. 2 ; MONIN id, p. 6, 7, 10. 12. DELOYNES ibid., p. 2, 12. 13. MONIN ibid., p. 6, 12, 13. 14. LE BORGNE ibid., p. 140. 15. MONIN ibid., p. 5 : « Flaques d’eau fangeuses, putréfiées, insalubres, stagnantes ». 16. CORBIN 1986, p. 38-39. 17. LE BORGNE ibid., p. 142 ; MONIN ibid., p. 3. 18. MONIN ibid., p. 14. 19. ARDOUIN-DUMAZET 1893-1921, p. 103-104. 20. MONIN ibid., p. 3 « misères physiologiques et pathologiques ». 21. MONIN ibid., p. 3. 22. Citée dans POITOU 1985, p. 10 « mortellement maussade et vulgaire..., sans grandeur et sans poésie ». 23. MONIN ibid., p. 8 « les habitants portent sur eux l’empreinte générale et morbide de leur région ». 24. DELOYNES ibid., p. 22. 25. DELOYNES ibid., p. 7. 26. DELOYNES ibid., p. 1. 27. EDEINE 1972b, p. 577 citant le prieur de Sennely « ... on peut conclure que c’est une petite République de gens qui se suffisent à eux-mêmes parce que peu de choses leur suffit ». 28. EDEINE 1972a, p. 67. 29. EDEINE ibid., p. 217. 30. EDEINE ibid., p. 39, 73. 31. DELOYNES ibid., p. 4 ; LE BORGNE ibid., p. 140 ; La Géographie 1924, p. 227. 32. ARDOUIN-DUMAZET ibid., p. 137. 33. EDEINE ibid., p. 89. 34. EDEINE ibid., p. 133 : « ... la Sologne n'était pas suffisamment ruinée pour avoir besoin d'être colonisée par des étrangers comme le furent certaines parties de l'Orléanais en particulier le Gâtinais ». 35. EDEINE ibid., p. 206, 207. L’auteur fait référence au cahier de Viglain où il est indiqué « Aussi lorsqu’ils ont quelque ouvrage extraordinaire tel que la moisson, des arrachis de bois, des piochis ou curage d’étangs, ils ne le peuvent faire que par les bras des Auvergnats et Berrichons qui leur font payer bien cher le service qu’ils leur rendent ».
5
Dans ce contexte défavorable apparaissent aussi les limites aux contacts, réelles ou fantasmées : le langage spécifique, le parler solognot38, la perception désobligeante d’une « dégradation morale d’un spectacle affligeant pour l’humanité39 ». La Sologne perçue comme une frontière, à la fois zone de contact et territoire inspirant mépris et méfiance. Et puis surgit la capacité de rebond, de réaction, dynamique constante de l’histoire solognote, qu’elle provienne de l’intérieur ou qu’elle soit engagée par des apports extérieurs (idées, techniques, capitaux, intérêt et/ou installation des instances du pouvoir, etc.). Énergie pour défricher40 et reboiser41, assainir42, améliorer les techniques agricoles, développer les réseaux de communication (routes, canaux, voies ferrées). Au cours de ces périodes, la population s’accroît, les récoltes deviennent plus abondantes, les maladies plus rares, la durée de vie s’allonge. Les qualificatifs changent alors radicalement : on parle d’innovation43, d’activité44, de productivité45, de force46, d’enthousiasme47, de courage48, sans oublier l’embellissement et le charme de la Sologne49 à la « transformation merveilleuse50 ». La Sologne dynamique ou la possibilité du mieux. Fig. 1 – Paysage de la Sologne près de la Main-Ferme. Gravure de GRANDSIRE publiée dans Le Magasin pittoresque, 31e année, 1863, p. 4.
36. EDEINE 1972b, p. 577 faisant référence au manuscrit du prieur de Sennely « ... leur charité envers les pauvres, même les étrangers et les passans (sic). Nous avons vu avec admiration dans cette paroisse qui est asses (sic) pauvre, plus de mille pauvres du Berry et de la Beauce et du Limosin (sic) tous nouris (sic) et hébergés pendant la famine de 1694 ». 37. EDEINE 1972a, p. 177 : l’auteur cite la guerre des Sabotiers dès 1658, suivie par le Berry, la Beauce et le Gâtinais. 38. HUBERT-FILLAY, RUITTON-DAGET 1933. 39. LE BORGNE ibid., p. 141. 40. DELOYNES ibid., p. 4, 11, 13, 14, 16, 17, 21 ; ARDOUIN-DUMAZET ibid., p. 98, 99. 41. LESBAZEILLES 1884, p. 25, 60-61 ; MONIN ibid., p. 6. 42. GUILLAUMIN 1853, p. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18. 43. DELOYNES ibid., p. 1, 8, 18. 44. DELOYNES ibid., p. 7. 45. DELOYNES ibid., p. 11, 14, 16. 46. DELOYNES ibid., p. 8 . 47. GESSAT 1959, p. 66. 48. ARDOUIN-DUMAZET ibid., p. 100. 49. DELOYNES ibid., p. 18, 19, 21. 50. MONIN ibid., p. 3.
6
3- La Sologne comme construction historique Nous avons pu nous en rendre compte au détour des lignes qui précèdent : dans l’historiographie, les visions de la Sologne apparaissent par nature diverses, révélant une variété de points de vue qui tranche avec une perception essentiellement négative qui veut faire de ce territoire un espace de marge. Car, sous la plume des archéologues et des historiens, cette qualification revêt bien souvent un caractère péjoratif qui renvoie tout à la fois à l’insalubrité des sols, à leur déclassement et à leur abandon. Or, il semble bien que la Sologne recouvre différents caractères de la marge, dont seul un aperçu succinct vient d’être livré ici. La définition de la Sologne comme un désert trahit donc un topos dont la construction relève d’une lecture sélective de l’Histoire. Car l’ensemble des observations formulées précédemment ne s’inscrivent pas simultanément dans le temps : en la matière, les oscillations sont nombreuses et les changements d’orientation fréquents. Dans la suite de notre exposé s’imposera donc la nécessité d’ordonner les faits en chronologie, afin de saisir les modalités et les rythmes de la construction de ce qui ne constitue in fine qu’une « image d’Épinal ». Pour comprendre la « fabrique » de cette vision dominante, notre attention se concentrera sur les époques moderne et contemporaine, périodes où cet espace semble correspondre à « une immense plaine de landes marécageuses parcourues par des centaines de milliers de moutons51 ». Le XVIIe siècle se présente de ce point de vue comme une succession de périodes d’instabilités économiques et sociales aux conséquences lourdes pour un royaume qui alterne crises d’autorité et exacerbations du prestige monarchique. De Henri IV à Louis XIV, l’agriculture, aux pratiques traditionnelles obsolètes et aux rendements souvent insuffisants, semble parfois loin des priorités affichées52. L’exaspération des prélèvements sera l’une des causes, parmi d’autres, d’un bouleversement de la sphère rurale, au profit de la création de grands domaines. Ce constat se décline particulièrement en Sologne où la prédominance de la petite propriété s’estompe dès la seconde moitié du XVIe siècle53. Ce phénomène ne cessera de s’amplifier. Le déficit d’amendement des terres, combiné à la moindre qualité des sols, implique des rendements d’autant plus médiocres qu’une grande partie d’entre eux est absorbée par une imposition croissante, dont les référentiels ressortissent à un passé révolu. Les terres des paysans endettés sont bradées notamment à une bourgeoisie qui favorise les grandes métairies et l’élevage du mouton, en réponse à l’essor du commerce des peaux qu’elle maîtrise depuis longtemps. L’espace de culture s’amenuise considérablement au profit de terres en friche, lieux de landes et de bruyères constituant le parcours privilégié du mouton et perçus comme richesse de plus en plus prégnante. En dépit de la consolidation de cette « valeur-refuge », une paupérisation graduelle du monde paysan s’installe à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles. La diminution des labours a une incidence sur la demande en main d’œuvre, plus rare également pour assurer l’entretien des fossés, des étangs, des bois et dont l’exil commence54. La mortalité explose, en lien avec les épidémies et les famines55, entraînant une diminution de la population, à l’exception de quelques communes de la Sologne des vignobles56. Les réactions de colère qui éclatent dans le royaume n’épargnent pas la région (soulèvement de Romorantin en 164957), parfois soutenues ou entretenues par la noblesse (jacqueries paysannes, « Guerre des Sabotiers »58). Au cours du XVIIIe siècle, la Sologne voit se renforcer tous les indicateurs décrits au siècle précédent. Les prélèvements en cascade, qu’ils dépendent des droits féodaux ou des expédients royaux, grèvent puissamment le revenu du paysan59, très rarement propriétaire des terres qu’il
51. HEUDE 2012, p. 15. 52. DEYON 1986. 53. HEUDE, ibid. 54. EDEINE ibid., p. 167-177. 55. HEUDE ibid., p. 33-35. 56. EDEINE ibid., p. 177. 57. EDEINE ibid., p. 175. 58. EDEINE ibid. 59. Jusqu’à 80 % (EDEINE ibid., p. 215).
7
exploite. Celles-ci, véritables placements fonciers et terrains de loisirs pour la noblesse, n’ont plus véritablement d’enjeu héréditaire. La destruction de métairies permet l’extension des domaines, sans réel investissement. Les étangs ne sont plus entretenus, les bois cèdent la place aux bruyères et viennent finalement à manquer60, les terres arables sont en constante régression (fertilisation insuffisante61, assolement de plus en plus long62, remise en cause de la diversité des cultures au profit de la récolte du seigle63, affaiblissement des cheptels qui conduit à une plus forte sollicitation des bêtes de somme64). L’élevage, principalement ovin, se présente comme le moteur économique prépondérant de la Sologne, en lien avec le développement de l’activité lainière industrielle, l’une des plus mobilisées en France65. Cependant, un déséquilibre s’exprime de plus en plus en miroir de ce choix exclusif, entraînant un cercle inévitable de carence et de dépendance : le mouton produit peu de fumier, pourtant nécessaire pour les cultures. Dans ce contexte, la sous-alimentation devient récurrente et l’appauvrissement des ressources une constante66. A cela s’ajoute une succession d’épisodes météorologiques désastreux tout au long du siècle : froids, pluies, inondations, sécheresses provoquent épizooties et épidémies67. À la faveur des thèses nouvelles des physiocrates, réel programme économique qui fonde la prospérité du royaume sur le progrès agricole68, la Sologne devient pourtant, dès les années 1750-1760, un « laboratoire » innovant, aux approches originales et ouvert à l’expérimentation. Ce regain d’intérêt qui tient à l’intense activité des sociétés savantes d’agriculture nouvellement créées et à la multiplication des enquêtes diligentées par le pouvoir royal ne suffit toutefois pas au rebond du pays69. La Révolution ne change en rien la donne, n’appliquant qu’à la marge la redistribution des terres promise au lendemain de la confiscation des biens de la noblesse. Si vers 1793-1794, la mise en vente de parcelles de faible superficie permet à de petits paysans et à des journaliers de devenir propriétaires ou d’agrandir leur terrain70, la situation apparaît donc extrêmement précaire en Sologne où les équilibres anciens ne sont pas rompus71. Quand commence le XIXe siècle en Sologne, la misère semble ainsi avoir figé le territoire et les êtres. Sous l'Empire, le gouvernement n'est pas indifférent à la situation. Des enquêtes et des statistiques diligentées par les préfets sont mises en place tandis que les mémoires des sociétés savantes, en lien étroit avec des initiatives d'ordre privé, proposent des solutions d'assainissement et de régénération des espaces, des essences et des espèces. L'élevage est en grande partie ciblé : se créent des fermes modèles, dont l’activité accompagne l’introduction de nouvelles variétés : moutons espagnols (mérinos) croisés avec le mouton solognot, vaches provenant du Jura et de la Suisse et la constitution d’un haras très important à La Ferté-Beauharnais en Loir-et-Cher72. Ces noyaux d'innovation fomentent un frémissement de changement, initié à l’origine par les grands propriétaires dont les expériences font école auprès des marchands et des paysans aisés. Défrichements, cultures de prairies artificielles, de céréales plus diversifiées et plantations de pins maritimes s’inscrivent dans les pratiques. Ces expériences sont confirmées durant la Restauration et la Monarchie de Juillet, période d'accroissement de la population, des revenus et de la valeur des terres73. La grande propriété prédomine aux mains de résidents urbains74 tandis qu’en 1848, la
60. Dans certaines paroisses, les bruyères constituaient les ¾ des terrains (EDEINE ibid., p. 198). 61. On fumait en Sologne à la fin du XVIIIe s. 10 à 12 fois moins que dans les meilleures terres de Beauce et de Flandre et on répandait du fumier sur la terre que tous les 10 ans environ (EDEINE ibid., p. 191). 62. Jachère d’une durée de 10 à 12 ans à Soings-en-Sologne (EDEINE ibid.). 63 EDEINE ibid., p. 194-195. 64. EDEINE ibid., p. 192. 65. HEUDE ibid., p. 300. 66. EDEINE ibid., p. 201, 203. 67. Une invasion de chenilles est signalée en 1758 (EDEINE ibid., p. 183). 68. ASSELAIN 1984, p. 26-27. 69. EDEINE ibid., p. 223, 228, 229. 70. ASSELAIN ibid., p. 115-116. 71. EDEINE ibid., p. 228. 72. EDEINE ibid., p. 230, 233, 235. 73. HEUDE ibid., p. 301 ; POITOU 1985, p. 26, 29, 33. 74. Les propriétés de plus de cent hectares couvrent 82 % de la superficie totale. (POITOU ibid., p. 72).
8
proportion des terres cultivées tend à augmenter légèrement75. La Sologne va en outre bénéficier de l'intérêt personnel de Louis-Napoléon Bonaparte, dans une politique globale d'expansion de l'économie et de la société : création de trois fermes impériales, du service des marnes, d'un réseau de communications dense (canal de la Sauldre et routes agricoles). Cependant, si le chemin de fer bénéficie dès 1847 d'une ligne reliant Orléans à Vierzon, aucun réseau secondaire privilégiant le local n’est dressé avant la fin du XIXe siècle et le succès en est très limité dans le temps, au profit de la communication routière76. Enfin, le comité central agricole de Sologne créé en 1859 se veut le lien cohérent entre trois départements aux faciès et activités divers et oriente une politique de gestion rurale. Cette dernière conforte la progression de la forêt en pins maritimes puis en pins sylvestres après l'hiver de 1878-1879, au détriment de l'élevage ovin qui perdurait jusque-là, soutenu par la demande en viande et en laine commune77. Le succès du coton se confirme, porté par la concurrence étrangère, notamment australienne78. Si la IIIe République conforte l'extension de la forêt, domaine de la chasse et du loisir, elle voit également l'accession à la propriété d'un grand nombre de fermiers et de locaturiers dans la Sologne de l'ouest et du centre. Cet élan se poursuit jusqu'aux prémices du premier conflit mondial, avant que ne survienne la chute des surfaces cultivées en céréales79, après l'élimination quasi totale de l'élevage ovin80. Nous le voyons donc : la vision qui domine dans l’historiographie ressortit à un changement d’orientation majeur dans l’occupation du sol qui intervient en Sologne à la fin d’un long Moyen Âge. C’est celle d’une lande désertée, parsemée d’étangs et livrée aux marais, qui sera progressivement gagnée par la forêt au cours des siècles suivants. Son occupation sporadique trahit un mode original de gestion du sol, fondé sur la complémentarité de grands domaines agricoles suffisamment dispersés pour apparaître comme « invisibles » et dont le maillage se révèle assez lâche pour nous renvoyer l’image déformée d’un territoire inhabité. Or, ce lieu commun correspond à un temps précis de l’Histoire de la Sologne, en rien représentatif de sa trajectoire : sur le temps long, l’objet de notre étude semble plus se comporter comme une marge, géographique et historiographique, que comme un vide. En cela, la diversité des conjonctures mises en lumière plus haut trahit son caractère singulièrement dynamique, en dysfonctionnement toutefois avec le système territorial dominant. 4- La marge : un aperçu théorique Le concept de marge, souvent mobilisé en archéologie, mérite d’être clairement explicité, tant il est riche de sens mais aussi source de profondes ambiguïtés (fig. 2). De prime abord, la notion paraît susceptible d’alimenter une réflexion féconde sur l’occupation du sol et ses évolutions dans la longue durée. D’un point de vue épistémologique pourtant, la marge se présente comme un objet d’étude paradoxal et, par certains aspects, bien incommode à manipuler81. Ainsi, dans l’analyse de l’organisation des territoires, la marge est souvent présentée comme une donnée secondaire, négligeable voire inutile pour comprendre les dominantes propres à ces systèmes. Elle exprime un « non-lieu », un no man’s land, un « angle mort » du peuplement qui ne mérite pas que l’on se penche avec attention sur son organisation. Dans un schéma hiérarchique quelque peu simpliste, ce pré-requis a retenu toute l’attention des archéologues, et ce depuis les origines de la discipline. Dans leur perception des marges territoriales, ils ont ainsi privilégié l’image d’espaces à l’occupation lâche, rarement mis en valeur et à la densité extrêmement faible.
75. EDEINE ibid., p. 240. 76. POITOU ibid., p. 45, 48,53, 62, 64. 77. HEUDE ibid., p. 303. 78. POITOU ibid., p. 64, 65, 155. 79. EDEINE ibid., p. 245. 80. HEUDE ibid., p. 303. 81. COLLECTIF 1997a ; BRUNET, FRANÇOIS, GRASLAND 1997 ; CARROUE 2002 ; BRUNET, FERRAS, THERY 2005.
9
Dans l’œil de l’archéologue, la marge est ainsi et avant tout un « espace invisible » dont l’appréciation ne peut s’opérer qu’en miroir d’un centre dynamique82. Dans une dialectique évidente entre centre et périphérie, la marge se détermine avant tout par défaut : elle est presque toujours définie par rapport à un pôle centralisateur avec lequel elle entretient des relations privilégiées, notamment d’ordre économique. D’un point de vue socioculturel toutefois, la situation apparaît beaucoup plus indécise : du fait de son éloignement relatif, la marge se présente comme une « zone d’incertitude » dont la dimension identitaire fait sans cesse l’objet de négociations, de compromis. En cela, elle induit une mise à l’écart en vertu d’un consensus et, partant, un rapport différent aux modèles politiques et aux normes sociales. Cette réalité n’est pas indifférente car elle nous renvoie au statut même de la marge et de ses habitants : sa position « excentrée » – d’un point de vue géographique, cela va sans dire, mais également anthropologique – soulève avec acuité le problème de son positionnement sociologique et des diverses formes que peut revêtir la marginalité.
Fig. 2 – Les différentes dimensions de la marge :
un essai de restitution théorique. DAO R. ANGEVIN 2011
82. BRUNET 1968 ; PROST 2004.
10
Car chercher à appréhender la marge comme construction historique suppose au préalable de comprendre comment les « gens de la marge » ont diversement tenté d’apprivoiser la singularité géographique et sociale. Sous ce regard, les deux modèles que nous avons présentés plus haut – le « non-lieu » et la périphérie – nous renvoient invariablement à la vision de populations en situation de repli, dont les références culturelles et sociales apparaissent plus diffuses qu’ailleurs. Cette réalité ne correspond toutefois qu’à une dimension de la marge qui est celle de confins territorial. D’un point de vue spatial, la marge peut cependant être approchée comme une région intermédiaire, un espace de transition, qui se déterminerait alors en miroir d’une frontière83. Dans ce troisième schéma, la marge s’inscrirait donc dans des rapports de pouvoir spatialisés, non plus avec un centre dominant dont elle dépendrait directement mais avec plusieurs pôles dynamiques situés à son contact et qui exerceraient sur elle une influence plus ou moins grande. Sous cet aspect, la marge serait une zone d’hybridation, tiraillée entre des références nettement contrastées84. La frontière, qu’elle soit solidement bornée ou aux limites imprécises, est toujours l’expression d’une représentation mentale ambiguë : ce point de vue, abondamment développé en sociologie, a trouvé un écho important dans la notion de société de frontière proposée par Turner en 189385. Ce dernier décrit une forme d’organisation singulière reposant sur un système économique ouvert, au comportement autonome, distinct de toute formule autarcique, un mode de vie composite fondé sur un syncrétisme culturel, un encadrement plus lâche et, partant, une propension plus forte qu’ailleurs sans doute à développer des comportements déviants. Socialement donc, la marge déploie sa cohérence sous le double signe du métissage et de la transgression : en cela, elle opère la synthèse entre des emprunts diversifiés et un système porteur d’inégalité, au contenu subversif86. La frontière, entendue ici au sens d’interface, témoigne donc d’une forme de marginalité consciente, assumée qui se démarque nettement de celle de la périphérie, forgée depuis le centre, perçue à distance et qui apparaît plus subie que construite. Quelle soit zone de transition ou zone de rupture, région en développement ou front de conflit, la marge est donc un espace particulier dont la consistance est liée à des contraintes, mais aussi à des opportunités d’action87.
Ce constat nous permet de dégager une quatrième dimension de la marge : celle d’un territoire dynamique qui trahit des modalités d’investissement particulières. De « l’angle mort » au pôle émergent, la marge éclaire donc des systèmes spatiaux qui peuvent se comporter tantôt comme des périphéries débitrices, tantôt comme des périphéries créatrices. Dans ce dernier cas, elle se révèle finalement un espace stimulant et soumis à des mécanismes originaux qui peuvent conduire soit au développement d’un nouveau centre, soit à une impasse évolutive. Dans ce contexte, la trajectoire de la marge est soutenue par des dynamiques socioéconomiques plus vastes et puise substantiellement dans des mouvements de vaste ampleur liés aux contacts et aux échanges. Sous ce regard, la marge est ainsi le lieu privilégié de la diffusion, du transfert mais également de l’innovation, impulsant et relayant d’importants flux d’objets, d’idées et d’informations sur des distances parfois considérables88. En cela, elle est le produit des chocs et des connexions qui s’établissent en un temps et un espace donnés. La société de marge est donc bien plus qu’une société en réaction et pose avec acuité la question de la « fabrique » du social dans ces régions. Qui façonne en effet les catégories sociales et culturelles dans les zones de marge ? Et, en retour, comment les marginaux, en tant qu’acteurs, produisent-ils du territoire ? C’est à ces différentes interrogations que nous allons consacrer les développements qui vont suivre, en cherchant au premier chef à percevoir les discontinuités existant entre la Sologne et les entités voisines. Une telle approche suppose toutefois de se départir de ses repères les plus familiers, car en archéologie, la marge territoriale est bien souvent aussi une marge historiographique qui déstabilise par ses références et ses modèles. L’histoire de la recherche est
83. PHALIP (dir.) 2002. 84. Cette question était au cœur de la journée d’étude Géographie des marges, marges en géographie organisée en 2013 à l’Institut de géographie de Paris. 85. TURNER 1893. 86. BERTRAND, PLANAS 2011. 87. BAVOUX (dir.) 1994. 88. LAMPIN-MAILLET et al. 2010.
11
donc un paradigme fondamental que nous devons prioritairement prendre en compte (fig. 3)89 : ses orientations et ses délaissements sont susceptibles d’éclairer, à différents niveaux, les formes que peut prendre notre « objet », en miroir des systèmes territoriaux connexes.
Fig. 3 – Vue des fouilles à Gièvres. Lithographie de LEMERCIER publiée dans J.-B. JOLLOIS, Mémoire sur
l’exploration d’un ancien cimetière romain situé à Gièvres, département du Loir-et-Cher, et sur la découverte de l’emplacement de l’ancienne Gabris, Orléans, Danicourt-Huet, 1830, pl. 2.
5- Le dossier des sources Prolégomènes À la suite de ces digressions qui nous ont conduits à observer la Sologne sous le prisme des territoires de marge et à redéfinir ces derniers, il est temps désormais de revenir à l’ambition qui fonde ce bilan, à savoir la présentation et l’analyse des modes d’occupation du sol dans la région depuis la fin de la Préhistoire. Cela suppose au préalable de présenter le dossier des sources : celui-ci se fonde, pour une large part, sur l’importante activité préventive développée ces dernières années. Elle a permis de réinvestir des secteurs tenus jusque-là à l’écart de la recherche, sans a priori ni déterminisme géographiques. Elle a été favorisée en cela par plusieurs projets d’aménagement de grande ampleur : la création de l’autoroute A85, bien sûr, mais aussi l’ouverture du gazoduc de l’artère du Centre, les déviations de Contres, Cellettes ou la création de ZAC, comme celles de La Grange et des Grandes Bruyères à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher ; fig. 4). De manière plus ponctuelle, plusieurs agglomérations d’origine gauloise ou antique ont bénéficié d’une vigilance accrue de la 89. Sur l’histoire de la recherche en Sologne, voir la Carte archéologique de la Gaule (Loir-et-Cher, PROVOST 1988) ainsi que les contributions de L. DE LA SAUSSAYE (1844), E. FLORANCE. (1922-1928) et H. DELETANG (1984).
12
part du Service régional de l’archéologie. C’est le cas notamment des bourgs de Soings-en-Sologne, Neung-sur-Beuvron, Cour-Cheverny, Candé-sur-Beuvron, Pierrefitte-sur-Sauldre (Loir-et-Cher) ou Jouy-le-Potier (Loiret) dont la requalification et la densification ont fait l’objet d’un accompagnement systématique et d’une évaluation attentive. Au total et si nous excluons de notre présentation les vallées majeures qui cernent de part et d’autre la Sologne, ce sont près de 115 diagnostics et évaluations qui ont été réalisés depuis 1994, portant sur une surface de plus de 1000 ha. Ils ont été complétés par 32 opérations de fouille, pour la plupart engagées préalablement aux grands travaux de l’A85 (tab. 1).
Fig. 4 – Cadres physiques et administratifs de la Sologne et localisation des principales opérations
d’archéologie préventive mentionnées dans le texte. Outre les préfectures, chefs-lieux d’arrondissement et de canton, régulièrement explorés en contexte
préventif, les communes ayant fait l’objet d’une ou plusieurs opérations archéologiques entre 1994 et 2014 sont signalées dans le document par une étoile.
Cartographie et DAO R. ANGEVIN 2014.
Ces investigations ont concerné au premier chef les occupations protohistoriques, déjà finement documentées par les études anciennes : ainsi, huit sites de l’âge du Bronze et quatre de l’âge du Fer ont pu être explorés sur de vastes surfaces, articulant plus étroitement qu’auparavant approches domestiques et funéraires. De manière moins flagrante mais tout aussi significative, un gisement épipaléolithique, deux sites mésolithiques et deux habitats néolithiques sont venus compléter notre vision des périodes anciennes, alors même que la séquence pléistocène ne pouvait être totalement approchée du fait du trop faible recouvrement sédimentaire et de la déstructuration locale des terrains d’origine quaternaire.
13
Pour les périodes historiques, sept sites gallo-romains et douze établissements médiévaux et modernes ont été minutieusement étudiés dans le cadre de l’archéologie préventive. Ils concernent tout à la fois le monde rural et l’espace urbain, le domaine funéraire et la sphère domestique. Au cœur du plein Moyen Âge, le tissu ecclésial et le maillage aristocratique ont de même pu être abordés, ouvrant largement les perspectives sur une société féodale étonnamment polymorphe et dont le modèle apparaît ici tardivement assimilé.
Tab. 1 – Catalogue des opérations de fouille archéologique préventive réalisées en Sologne
entre 1994 et 2014. Source : base de données nationale Patriarche, Service Régional de l’Archéologie, DRAC Centre, état au 31 décembre 2014.
14
Si l’on dresse un premier bilan quantitatif et qualitatif de ces travaux, il apparaît donc que la Sologne a été, depuis près de vingt ans, le lieu privilégié de l’intensification de nos recherches : les centaines de données indexées dans la base nationale Patriarche illustrent parfaitement la politique volontaire engagée par l’ensemble de la communauté scientifique autour de cet objet depuis plusieurs décennies. Elle trouve sa pleine expression dans la complémentarité existant entre le suivi vigilant engagé dans un cadre préventif et la poursuite des travaux de prospection et de fouille, à l’initiative de C. Leymarios, H. Delétang, P. Amelin ou L. Magiorani. Leur action combinée a notamment permis de déjouer deux difficultés persistantes en Sologne : l’importance du couvert forestier tout d’abord, qui rend inopérante toute exploration strictement mécanique des terroirs à une vaste échelle ; la faible densité de l’habitat ensuite, qui s’accommode bien mal d’une archéologie préventive intimement liée en définitive aux aménagements de grande ampleur. L’ensemble de ces opérations livre donc une documentation de premier choix pour saisir les évolutions socioéconomiques du pays de Sologne, dans la longue durée et à différentes échelles. Dans la suite de notre exposé, les fouilles préventives constitueront ainsi l’essentiel de nos matériaux : plus ponctuellement toutefois, nous n’hésiterons pas à faire appel aux résultats de diagnostics restés sans suite ou d’investigations anciennes. Leur mobilisation se révélera alors nécessaire du fait d’impasses thématiques qui pourraient sembler inopportunes ou de déséquilibres chronologiques trop criants au regard du projet que nous nous sommes fixé. Le Paléolithique supérieur et le Mésolithique : le temps des globalisations En l’état de la documentation, les données relatives à la Préhistoire ancienne font encore largement défaut en Sologne : cette réalité tient en grande partie à la nature des sols et aux profondes modifications dont ces derniers ont fait l’objet au cours des millénaires holocènes, n’autorisant que très rarement la préservation des vestiges d’occupation humaine. Ceux-ci se révèlent en effet bien souvent totalement déstructurés au sein des alluvions récentes ou dans les formations superficielles encore présentes sous forme de lambeaux au-dessus du substrat tertiaire. Leur reconnaissance se limite généralement à des témoignages sporadiques qui ne viennent que ponctuellement abonder notre connaissance : pour le Paléolithique inférieur et moyen, quelques objets isolés sont à signaler sur les tracés de l’A85 et de l’artère du Centre (bifaces de Villefranche-sur-Cher90, Pruniers-en-Sologne91, Romorantin-Lanthenay92 et Châtres-sur-Cher93). Plusieurs assemblages, qui ne dépassent cependant jamais la dizaine d’artefacts, ont en outre été reconnus ces dernières années dans le cadre de diagnostics : c’est le cas notamment aux « Fosses Plates » à Contres94 ou sur le site des « Malabris » à Chémery95 où deux petites séries moustériennes d’affinité clairement Levallois ont pu être retrouvées en position secondaire. En miroir, le portrait n’apparaît guère plus favorable pour le Paléolithique supérieur : si nous faisons exception du site magdalénien supérieur du « Laitier-Pilé » à Saint-Palais (Cher)96, remarquablement conservé, seuls quelques rares outils aménagés sur lames provenant des prospections de l’A85 sont présents dans la documentation, sans précision toutefois quant à leur provenance exacte (Sections 1 et 2). De même, quelques industries laminaires ont été identifiées lors de l’évaluation des sites des « Perreaux » à Méry-ès-Bois97 ou du « Grille Midi » à Contres98. Déplacées dans les formations des affluents du Cher, elles ne bénéficient d’aucun cadre stratigraphique : leur identification reste donc dans une situation d’attente, bien inconfortable il faut dire, sans qu’aucune attribution chrono-culturelle efficace ne puisse être proposée.
90. KRAUSZ 1999. 91. KRAUSZ 1997. 92. RAUX 2002. 93. KRAUSZ 1999. 94. LANDREAU 2009 ; FROQUET 2010. 95. COUDERC 2013. 96. Fouilles Françoise TROTIGNON : DEPONT, TROTIGNON 1984 ; VALENTIN 1995. 97. TROTIGNON 2006. 98. DALAYEUN 2013.
15
Dans ce contexte, il pourrait être tentant d’interpréter les lacunes de la documentation en termes de vide. Cette interprétation, sensible à l’idée de rupture, a notamment été privilégiée par les synthèses récentes pour lesquelles la Sologne n’a sans doute constitué, au cœur du grand paléolac miocène, qu’un « espace de passage » faiblement investi par les groupes humains, à l’opposé des grandes vallées du chevelu ligérien, densément et régulièrement occupées99. Or, si les rares attestations mobilisées plus haut se révèlent dans l’incapacité de nous renseigner sur les modalités d’occupation de ce territoire au cours de la période, elles nous permettent toutefois d’amender ce modèle dominant quelque peu simpliste. Car il existe une autre manière de raisonner sur l’absence. À cet effet, il peut se révéler particulièrement utile d’ouvrir la réflexion vers les régions périphériques : pour la séquence qui s’étire de 45 ka BP à 10 ka BP100, ce sont incontestablement les occupations égrenées le long des parcours du Cher et de la Loire qui doivent retenir l’essentiel de notre attention, tant ces grands axes fluviaux semblent largement orienter et conditionner les stratégies territoriales tout au long de la Préhistoire récente. Sous ce regard, la circulation sur de longues distances des silex marins provenant de la bordure méridionale du Bassin parisien (Turonien inférieur) jusque dans le Massif central apparaît comme un fait particulièrement significatif : solidement établi pour l’ensemble de la séquence, il traduit une véritable construction territoriale dont la logique n’est jamais réellement remise en question. En miroir, la situation au nord de la Loire apparaît quant à elle sensiblement différente, alors même que les productions « de masse » signalées plus au sud sont totalement absentes et que leur dispersion semble connaître un effet de « seuil »101. Dans ce contexte, la Sologne se présente donc comme une interface entre deux bassins économiques majeurs, ce qui n’est pas sans conséquence évidemment quant aux équilibres et mouvements de la période. De puissants phénomènes d’hybridation culturelle peuvent ainsi se faire jour, sans que l’on puisse toutefois en préciser les ressorts sociologiques et spatiaux. De ce point de vue, l’exemple du site épipaléolithique du « Pont de Sauldre », à Châtillon-sur-Cher102, à l’instar de celui du « Bas du Port » à Muides-sur-Loire103, se révèle particulièrement éclairant pour comprendre les processus à l’œuvre au sein des dernières sociétés de chasseurs-collecteurs mobiles104 : l’association, dans les industries qui succèdent immédiatement aux témoignages du Magdalénien final105, de pointes de Malaurie d’affinité méridionale avec un débitage de grandes lames présentant de nombreuses convergences avec les technocomplexes septentrionaux de la Long Blade Technology illustre ainsi de manière évidente les relations entre les groupes culturels du nord de l’Europe (Belloisien) et ceux du sud-ouest de la France106 (Laborien) au cours d’un Xe millénaire marqué par d’importantes recompositions territoriales et démographiques (fig. 5). Ces tendances lourdes se retrouvent d’ailleurs pour la période suivante, en dépit de changements d’orientation socioéconomique majeurs. Si on les compare à leurs prédécesseurs toutefois, il apparaît que les sites du Mésolithique n’ont pas bénéficié de conditions de conservation aussi favorables, ce qui ne nous autorise que difficilement à dépeindre l’organisation de ces groupes humains, en l’absence de toute analyse palethnologique véritable. En la matière cependant, nous aurions tort de déclarer prématurément forfait car les sources ne font pas totalement défaut. Ainsi et à côté des importants gisements repérés dans les vallées, en contexte alluvial récent107, quelques indices ont pu être mis en évidence au cœur de la Sologne, aux lieux-dits « Marmagne » (Pruniers-en-Sologne)108 ou « Larray » (Billy)109. Ces témoignages viennent principalement documenter les 99. AGOGUE 2005, p. 519. 100. 45 000 à 10 000 années Before Present, « avant le présent », avant les premiers essais de datation au C 14. 101. SURMELY et al. 2008 ; ANGEVIN, SURMELY 2013. 102. Ce site a fait l’objet d’un sauvetage urgent en 1999, sous la responsabilité de M.-F. CREUSILLET (Afan). 103. IRRIBARRIA 1993 et 2014 ; HANTAÏ 1994, 1997 ; DESCHAMPS 2002 ; KILDEA 2009. 104. CREUSILLET 2000. 105. Il s’agit d’un amas de débitage localisé à mi-hauteur, sur le versant du côteau. 106. VALENTIN 2008 ; LANGLAIS 2010. 107. Sans chercher à être exhaustif : « La Croix-de-Bagneux » (Mareuil-sur-Cher), « Le Pont de Sauldre » (Châtillon-sur-Cher), « Le Chêne des Fouteaux » (Saint-Romain-sur-Cher), « Le Bas-du-Port » (Muides-sur-Loire) ou Saint-Laurent-Nouan (Loir-et-Cher). 108. LANG, KILDEA 2003. 109. VERJUX et al. 2013.
16
phases ancienne et moyenne du Mésolithique, à la transition des courants septentrionaux (Beuronien) et méridionaux (Sauveterrien) dont les attributs sont subtilement représentés, sans que l’identité des industries en question puisse être réellement évaluée cependant.
Fig. 5 – Industrie épipaléolithique du « Pont de Sauldre » (Châtillon-sur-Cher, Loir-et-Cher). 1 : nucléus bipolaire à lames de grand module de tradition belloisienne septentrionale ;
2 à 5 : « pointe de Malaurie » d’affinité laborienne méridionale. Dessins M. -F. CREUSILLET dans CREUSILLET 2000, fig. 14, 21 et 22.
Néolithique et Protohistoire : le temps des convergences Cette situation d’interface n’est toutefois pas l’apanage des phases tardi- et immédiatement post-glaciaires. Elle peut également être plaidée pour le Néolithique et l’âge du Bronze dont le raffinement culturel a permis de questionner les notions très actuelles de frontière et de transgression, à la charnière des différents courants d’affinité. Dans ces débats, la Sologne et, plus largement, les régions de France centrale articulées autour de la Loire et de ses affluents, occupent une place de premier choix, tant elles signalent la présence d’intéressants phénomènes de convergence dont le compromis ne sera que tardivement remis en question.
De par sa position géographique, le Bassin ligérien se place en effet à la confluence des grandes vagues de néolithisation des VIe et Ve millénaires : notons d’ores et déjà que cette situation constitue une constante de la Préhistoire récente régionale et qu’elle entérine sa spécificité tout au long de la séquence qui s’étire jusqu’à la fin du IIIe millénaire. De ce fait, le centre de la France a donc connu des influences variées qui ont parfois entraîné la genèse d’ensembles culturels originaux. Sous ce regard, les recherches récentes ont permis d’amender et d’enrichir considérablement les modèles de diffusion proposés depuis les années 1960 et 1970 en Europe occidentale. L’archéologie de sauvetage puis préventive a, de ce point de vue, apporté une contribution fondamentale : elle a provoqué l’exploration de zones laissées jusque-là en « friche » par la recherche, alors même que ces régions étaient susceptibles de préciser les dynamiques et les rythmes d’évolution des sociétés néolithiques, entre le nord et le sud de la France.
Logiquement, la Sologne n’a pas été tenue à l’écart de ce mouvement : depuis le milieu des années 1980, elle a régulièrement été questionnée par les archéologues, à l’occasion notamment de travaux d’extraction de carrière. Près de vingt-cinq ans plus tard, force est pourtant de constater que les données manquent encore cruellement. Depuis 1994, seuls deux habitats du Néolithique moyen
17
ont été fouillés : il s’agit des sites des « Augeries » à Châtres-sur-Cher110 et du « Pont-de-Sauldre » à Châtillon-sur-Cher111 dont le statut et la fonction paraissent assez analogues. Aucune de ces opérations n’a toutefois permis de reconnaître des vestiges évidents d’architecture et d’explorer les niveaux associés aux différentes occupations, ce qui ne va pas sans poser de problèmes quant à la connaissance précise de leur organisation.
À Châtres-sur-Cher, l’érosion active du plateau marneux sur lequel se sont installés les hom-mes a ainsi entraîné la disparition presque totale des sols d’activité, alors même que l’emprise fouil-lée semble correspondre à la périphérie de l’habitat. Dans ce contexte, seules quelques structures en creux subsistent, ce qui permet difficilement d’interpréter plus avant leur structuration. A Châtillon-sur-Cher, la situation apparaît quant à elle d’autant moins favorable que le coteau sur lequel s’est implanté cet établissement a été partiellement déstructuré par d’importants phénomènes de pente. Ces découvertes viennent toutefois préciser les informations recueillies anciennement sur la carrière de « Château Gabillon » à Contres112, dans le cadre d’un sauvetage programmé réalisé entre 1990 et 1998 sous la direction de P. Amelin, C. Verjux, puis R. Irribarria. Implanté sur le sommet d’une légère éminence, ce village daté du Néolithique moyen I – dont deux locus seulement ont pu être étudiés – était vraisemblablement cerné par un fossé et une palissade légère. Il ne subsiste des unités d’habitation qu’ils enserraient que d’imposantes structures en creux (fosses, silos) délimitant ponctuellement des zones de vide qui correspondent à l’emplacement des maisons. L’identification de ces « fantômes » ne permet pas d’aller plus loin toutefois dans leur caractérisation : l’étude de rares sols d’occupation et des concentrations de mobilier qui leur sont associées éclaire laborieusement l’organisation de cet habitat ainsi que ses réaménagements successifs, alors même que la discrimination spatiale des activités témoigne d’une gestion raisonnée de l’espace.
À l’instar des périodes anciennes, ce sont une nouvelle fois les sources provenant des vallées majeures qui permettent de lisser les déséquilibres de la documentation et de saisir toute l’originalité de l’occupation néolithique régionale. Si nous mettons à profit les recherches engagées au cours des années 1980 et 1990, il apparaît que des plans de maisons ont pu être identifiés sur quelques sites, particulièrement dans le val de Loire, à Fossé113 et Muides-sur-Loire114, gisements qui appartiennent l’un et l’autre à la zone du « groupe de Chambon ». Ils éclairent pour l’essentiel de bâtiments sub-rectangulaires, de taille modeste115 et à murs porteurs en clayonnage, parfois adossés à une palissade ceignant le village. Des traces de cloisonnement et une répartition différentielle du matériel atteste une organisation interne complexe de l’habitat qui renvoie à une distribution réfléchie de l’espace domestique. Ces formules font écho à d’autres solutions architecturales contemporaines plus innovantes comme les grandes « maisons circulaires » reconnues en région Centre (Auneau, Orval), mais aussi dans l’Yonne et en Île-de-France116. Après la disparition de la maison danubienne, omniprésente au sein de la nébuleuse rubanée et diversement réinterprétée par les sociétés de la culture de Villeneuve-Saint-Germain (à Sublaines, Suèvres « Les Sables »117), le Néolithique ligérien illustre une diversification des modèles de l’architecture domestique, sans que ces formules soient exclusives des entités culturelles en présence.
Sous ce regard, il faut admettre qu’il est difficile de percevoir une répartition évidente de ces groupes, notamment dans les régions de France centrale. Dans la première moitié du Ve millénaire, la Sologne, tout comme le sud de la Touraine et le nord du Berry, appartient à la zone de recouvrement entre les traditions issues du Danubien de la moyenne vallée du Rhin et de ses épigones, et celles du Chasséen ancien héritées des cultures cardiales du littoral méditerranéen. Ce territoire voit l’émergence d’un groupe original, le « groupe de Chambon », dont la céramique se
110. RANGER 1998, LANG et al. 1999. 111. CREUSILLET 2000. 112. AMELIN et al.1995 ; IRRIBARRIA 1998. 113. « La Vallée aux Fleurs » : DESPRIEE 1986. 114. « Le Bas du Port » : IRRIBARRIA 1996, 1997. 115. 5 à 10 m. de longueur pour 4 à 7 m. de large pour les exemplaires les plus monumentaux. 116. VERJUX 1998. 117. FRENEE, GUIOT 2011 ; COUDERC 2008 ; IRRIBARRIA 2008 ; COUDERC 2012.
18
singularise par l’association de caractères issus de ces deux courants de néolithisation, comme en témoignent les corpus des sites de Contres, Muides-sur-Loire et Châtres-sur-Cher (fig. 6)118. Mais la chose n’est pas aussi simple : dans le détail, son identité et sa cohérence résultent de l’assimilation d’influences diverses, en provenance du bassin de la Seine, du Languedoc, mais aussi des Pyrénées, de la Vallée du Rhône et jusqu’à l’Italie du nord, ce qui tranche nettement avec les situations de continuum perçues au même moment au nord (culture de Cerny) et au sud (Chasséen). Plutôt qu’un faciès isolé au sud-ouest du Bassin parisien, cet ensemble témoigne donc d’une vaste interface culturelle centrée sur le bassin de la Loire moyenne ; entité dont les limites – floues à l’évidence – n’outrepassent pas les zones d’influence « classique » du Cerny méridional et du Chasséen septentrional (Massif central) qui ne sont que peu affectés par ces processus d’acculturation119.
Fig. 6 – Céramique décorée du Néolithique moyen I de type Chambon du site de « Château Gabillon » (Contres, Loir-et-Cher). 1-2 : vase à décor à nervures « en sourcil » commun au groupe de Chambon et au complexe culturel proto-chasséen et chasséen ancien du Languedoc ; 3-4 : céramique à décor de double ligne de boutons au repoussé sur bord de tradition Villeneuve-Saint-Germain ; 5 : individu présentant un décor hybride de lignes poinçonnées sur bord et « en sourcil ». Dessins R. IRRIBARRIA dans PIERRAT 2010, fig. 11.
De par ces puissants phénomènes d’hybridation, la « culture de Chambon » témoigne donc
de frontières stylistiques perméables qui expriment tout à la fois des dynamiques régionales particulières mais aussi une véritable émulation sociale dans toute l’Europe de l’ouest120. Au cours d’un Néolithique moyen volontiers enclin à un certain morcellement des groupes culturels, cette réalité n’est évidemment pas indifférente : elle signale une flagrante communauté idéologique et économique qui s’appuie sur une exploitation intensive des territoires et un mode d’occupation fortement hiérarchisé, comme en témoignent, sur les marges du Bassin ligérien, le développement des enceintes monumentales et la complexification des pratiques funéraires dont le mégalithisme atlantique ne constitue in fine que l’une des formes paroxysmiques.
Sous cet aspect, les occupations du « groupe de Chambon » se démarquent pourtant sans ambiguïté des cultures contemporaines : en Sologne comme ailleurs, elles attestent une certaine indifférenciation des établissements qui contraste nettement avec les témoignages connus plus au nord, en contexte domestique ou funéraire (enceintes palissadées, structures de type Passy). Les nécropoles semblent ainsi relativement peu hiérarchisées et les habitats, de dimensions modestes, témoignent de réseaux assez lâches et sans réelle complémentarité121.
En dépit de ces données essentielles, il devient extrêmement délicat de suivre la trajectoire évolutive des sociétés néolithiques au-delà de cette première phase moyenne qui s’achève vers 4300
118. PIERRAT 2010. 119. Sur le Groupe de Chambon : BAILLOUD 1971 ; BERTHOUIN, VILLES 1980 ; CONSTANTIN 1990 ; IRRIBARRIA 1995. 120. HAMON et al. 1997 ; PIERRAT ibid. 121. AGOGUE, LEROY, VERJUX 1999.
19
av. J.-C. À partir de là, la documentation se révèle en effet totalement indigente et les conditions de l’expansion chasséenne restent, par exemple, parfaitement obscures. Il en va de même pour le déploiement des cultures du Néolithique récent et final dont les mutations apparaissent pour leur part totalement insaisissables122. Dès lors, il se révèle en l’état difficile d’interpréter efficacement les modalités et les rythmes de l’occupation de la Sologne au cours d’un long IIIe millénaire qui confine aux marges chronologiques du complexe culturel de l’âge du Bronze.
Plus ponctuellement, des indices inédits ont malgré tout pu être collectés à l’occasion de diagnostics ou de fouilles d’évaluation : c’est le cas notamment à Soings-en-Sologne, au lieu-dit « le Sauveur »123 où quatre fosses du Néolithique récent ont été mises au jour dans l’emprise de la nécropole du Haut-Empire et pourraient correspondre à des fosses sépulcrales. En cela, elles viendraient donc compléter les rares données concernant les pratiques funéraires de la période, alors même que la seule occurrence assurée reste pour l’instant la tombe du Néolithique ancien reconnue dans les années 1960 à Thenay124 (Loir-et-Cher) à l’occasion du recul d’un front de carrière. À Méhers125 enfin, une nappe de mobilier datée du Néolithique récent et final a été circonscrite à l’occasion de la fouille d’évaluation du site de « l’Étang de Rontigny », sans qu’aucune structure ne vienne toutefois préciser l’organisation de cette occupation.
La situation n’apparaît guère plus favorable pour les premiers temps de l’âge du Bronze126. Seules quelques rares découvertes de mobilier, isolées, permettent d’évoquer une occupation de la Sologne au cours des premiers siècles du IIe millénaire. Au sein de cette étroite fenêtre, le site de « l’Étang de Rontigny » à Méhers127 constitue toutefois une formidable exception. À l’occasion de la fouille préventive réalisée par l’Inrap préalablement à l’aménagement de l’A85, les archéologues ont en effet recueilli un important lot de céramiques au sein d’une emprise limitée qui correspond certainement à une étroite portion d’un vaste habitat. Cet ensemble est complété par deux bracelets en bronze et quelques rares outils en silex. Les comparaisons établies entre les vases de grandes dimensions mis au jour et les productions provenant des aires culturelles périphériques signalent un vaste réseau d’affinités qui s’étend de la Bretagne à l’est de la France et à la Suisse, ce qui confirme le statut du bassin de la Loire comme région « réceptrice » d’influences diverses, notamment entre le XVIIIe et le XVIe siècle av. J.-C. Durant le IIe millénaire, et comme le rappelle avec pertinence J. Gasco et M. Dauvois, « l’indéniable force culturelle du centre est-européen (Allemagne du Sud, Suisse, France orientale) y impose en effet précocement sa marque » et cette région se présentera toujours, malgré une forte identité « atlantique », comme une zone éloignée de toute sujétion128.
Cette propension à élargir les aires culturelles et à favoriser les métissages apparaît d’ailleurs comme un trait commun à toutes les sociétés de l’âge du Bronze dans les pays de Loire moyenne. Les échanges à longue distance, largement banalisés à la période précédente, ne minimisent cependant pas les atouts régionaux et des caractères propres aux groupes du centre de la France se font rapidement jour au milieu du IIe millénaire. Au Bronze moyen, les mentions, tout à la fois plus nombreuses et mieux assurées à l’échelle régionale (« Le Grand Ormeau » à Sublaines129, etc.), nous permettent alors de préciser ces évolutions. Dans la vallée du Cher, un imposant bâtiment, à abside et deux nefs, daté des XVIe et XVe siècles av. J.-C.130 a été fouillé sur le site des « Barres » à Châtres-sur-Cher131 (fig. 7) : d’une longueur de 24,50 m., il affecte un plan allongé et légèrement
122. Seul le site de « Marmagne » à Pruniers-en-Sologne livre quelques formules – sporadiques – de continuité du Néolithique final à la fin de l’âge du Bronze (LANG, KILDEA 2003). 123. Pour les découvertes récentes en contexte préventif, voir DE FILIPPO 2012. 124. AGOGUE, LEROY, VERJUX, ibid. 125. VATAN 2002. 126. De rares structures en creux, mal datées par ailleurs, ont ainsi été découvertes au hasard des diagnostics : une fosse de l’âge du Bronze est ainsi signalée à Theillay, « Les Bruyères des Roubins » (RANGER 1998). 127. VATAN ibid. 128. GASCO, DAUVOIS 2010. 129. FRÉNÉE 2008. 130. Les datations sur charbons de bois provenant de quatre trous de poteau réalisées à l’occasion de cette fouille ont fourni des dates situées entre 1575 et 1335 av. J-C., ce qui n’est pas indifférent lorsque l’on songe que ce bâtiment a initialement été daté du Néolithique ancien. 131. RANGER 1998 ; KRAUSZ (dir.) 2003.
20
trapézoïdal et témoigne d’une construction en torchis sur poteaux dont la charpente était supportée par sept tierces. Cet édifice reste un exemple unique pour la période et témoigne d’originalités évidentes dans le domaine de l’architecture et des pratiques domestiques. Ces dernières font écho aux nouveaux corpus matériels qui s’élaborent progressivement au cours de la seconde moitié du IIe millénaire av. J.-C. en Sologne et, plus largement, en région Centre.
Fig. 7 – Vue générale du bâtiment du Bronze moyen des Augeries (Châtres-sur-Cher, Loir-et-Cher), en cours de fouille et levé en plan de la structure (XVIe-XVe s. av. J.-C.). DAO R. ANGEVIN 2014 d’après RANGER 1998, cl. 1 et fig. 4.
Sur le seul fondement des données de la Carte archéologique, il pourrait être tentant de
considérer que la documentation disponible pour le Bronze final est tout à la fois abondante et fiable. Des déséquilibres frappants subsistent toutefois, tant les sources funéraires se révèlent omniprésentes et tendent à masquer les autres réalités, notamment domestiques. Ces dernières ne sont pas indifférentes cependant et trahissent une mutation profonde des pratiques funéraires : ainsi, à Mennetou-sur-Cher132 (« Les Barres ») ou à Contres133 (rue de la Plaine et « Chemin des Aulnes », Bf IIb-IIIa), le rite de l’incinération semble avoir totalement supplanté celui de l’inhumation, alors même que les premiers tertres de terre se développent au-dessus des tombes.
Plusieurs tumulus ont ainsi été explorés aux « Barres », sans que l’on puisse, en l’état, préciser les conditions de ce changement d’orientation. L’ensemble funéraire de Contres, riche de plusieurs dizaines de sépultures sans doute, se présente quant à lui comme l’une des plus vastes nécropoles connues pour la période, avec un effectif très proche sans doute des immenses « champs d’urnes » d’Europe orientale. Les sites d’habitat demeurent moins connus : nous signalerons
132. KRAUSZ, RAYMOND 1998 ; SALANOVA 1999 ; DURAND, SAMZUN 1999. 133. JOLY 2005 ; PORCELL 2006 ; FROQUET, étude en cours.
21
toutefois les occupations fossoyées et palissadées de Vienne-en-Val134 (« La Ferrière », « Le Grand Montmasse II », « Les Terres de Saint-Germain »), et Pannes135 dans le Loiret, Villebarou136, Châtillon-sur-Cher137, Villefranche-sur-Cher138, Contres139 dans le Loir-et-Cher et « Port-Sec sud » à Bourges (Cher)140 qui ont livré de très rares témoignages d’architecture sur poteaux ainsi que plusieurs assemblages de mobilier céramique et lithique. D’un point de vue culturel, leurs modèles expriment un rééquilibrage sensible entre les types atlantiques et les formes continentales (RSFO), alors que les références italiques et d’Europe du nord restent prégnantes (fig. 8).
Fig. 8 – Corpus céramique du Bronze final IIIb des « Fosses Plates » (Contres, Loir-et-Cher). 1 : fragment d’assiette à marli et décor complexe peint à l’hématite présentant des similitudes avec les ensembles céramiques du centre-ouest de la France ; 2 : pot à décor polychrome rouge et noir d’affinité atlantique ; 3 : jatte ornée de filets incisés réalisés au peigne à trois dents et organisés par bandes de tradition continentale (groupes culturels du Loiret et du sud de l’Île-de-France, de tradition RSFO). Dessins M. F. FROQUET-UZEL dans FROQUET-UZEL 2012, fig. 34, 38 et 49.
Au Premier âge du Fer, la balance de la documentation apparaît sensiblement identique : la
majorité des données provient de sites funéraires ou de dépôts métalliques, sans que l’occupation du territoire puisse être clairement restituée dans ses dimensions économique et spatiale. En dépit de ce constat, ces sources ne peuvent être considérées comme insignifiantes : elles nous livrent de précieuses informations d’ordre culturel et social ; réalités historiques dont les ressorts évolutifs apparaissent désormais mieux maîtrisés, à défaut d’être parfaitement connus.
Les grandes nécropoles tumulaires du sud de la Sologne ont ainsi fait l’objet d’un examen attentif par P.-Y. Milcent dans le cadre de sa thèse de doctorat141, publiée en 2004. Sous un prisme culturel, elles témoignent de relations privilégiées avec les complexes du nord de l’arc alpin et font de la Sologne l’un des pôles les plus dynamiques et les plus occidentaux du grand complexe princier qui s’établit dans toute l’Europe tempérée au cours du Hallstatt. Des contacts avec l’Allemagne et l’est de la France sont alors à signaler à travers les productions à caractère ostentatoire, alors même que cette période semble marquer un essor de l’artisanat régional, notamment métallurgique, sur la lancée des expériences de la période précédente. 134. NOËL 2005 ; MERCEY et al. 2006 ; JAN 2010 ; DE SOURIS 2009 et 2010. Une nécropole du Bronze final, découverte fortuitement, est également signalée par la documentation ancienne, dans un champ de la ferme « La Bergeresse » (base de données Patriarche 2014). 135. CORDIER 2009. 136 CORDIER ibid. 137. « Le Pont de Sauldre », CREUSILLET 2000. 138. « Les Fontaines », MUSCH 1998. 139. « Les Fosses Plates » (Déviation) : FROQUET-UZEL 2012 ; « La Fosse des Roches » : GRANSAR, FROQUET 2013. 140 .AUGIER, FROQUET, MILCENT 2001; BUCHSENSCHUTZ et al. 2007 et 2012. 141. MILCENT 2004.
22
Ces liens supra-communautaires142 comme les appelle P.-Y. Milcent concernent avant tout l’aristocratie : ils constituent, sans doute, l’un des paramètres des profondes reconfigurations sociales qui se font jour au début de l’âge du Fer et accompagnent une importante mutation des pratiques funéraires. L’érection systématique d’un tertre de sable vient alors sanctionner de nouveaux rituels étroitement liés à la résurgence et au développement de l’inhumation. De nouveaux viatiques s’élaborent, autour des armes (épées en fer en Sologne) pour les sépultures masculines et à travers la présence de luxueuses parures dans les tombes féminines143.
D’un point de vue topographique, les nécropoles tumulaires charpentent désormais solidement l’espace et fondent leur implantation sur de puissants axes structurants qui s’esquissent aujourd’hui encore à une très vaste échelle dans la répartition des chapelets de tumulus parfaitement conservés sous le couvert forestier dans ce secteur (fig. 9)144 : ainsi, les mêmes logiques spatiales se retrouvent, depuis Theillay, Salbris et Pierrefitte-sur-Sauldre jusqu’aux vallées du Beuvron et du Cosson145, sans que nous soyons réellement en capacité de saisir les attendus de cette géographie symbolique qui nous fournit toutefois les clefs de l’appropriation de ce territoire par les sociétés hallstattiennes du second quart du Ier millénaire.
En miroir, ces témoignages funéraires supposent un habitat relativement dense. Les occupations domestiques ne sont toutefois connues que par quelques rares attestations ponctuelles : deux fosses datées du VIIIe siècle av. J.-C. ont ainsi été fouillées sur le site du « Bas de l’Étang neuf » à Méhers146 (Loir-et-Cher), sans plus de précision quant à leur fonction et leur statut. De manière plus consistante, les explorations conduites dans le cadre de l’évaluation du site de la ZAC des « Grandes Bruyères » à Romorantin-Lanthenay147 (Loir-et-Cher) ont permis de mettre au jour de petites unités d’habitat rural du Hallstatt ancien/moyen, distantes d’une centaine de mètres environ les unes des autres et formées de bâtiments légers polarisant l’ensemble des activités agricoles et artisanales. Les fosses d’extraction et les silos s’articulent autour de ces ensembles et nous livrent la perception d’une occupation assez lâche, sans organisation évidente.
Fig. 9 – Tumulus du Premier âge du Fer en
forêt de Salbris (Hallstatt, 800-450 av. J.-C.).
Cliché V. SCHEMMAMA 2009, © Service régional de
l’archéologie, DRAC Centre.
142. MILCENT 1995, p. 71. 143. MILCENT ibid. 144. MILCENT 2004. 145. Des tumulus sont ainsi signalés par L. Magiorani en forêts de Chambord et Boulogne, sur les communes de Dhuizon, Neuvy, Tour-en-Sologne, Chambord et Thoury. 146. DOYEN 2001.OK 147. FROQUET 2002.
23
Du second âge du Fer à la période carolingienne : Le temps de la construction Le début du second âge du Fer signale, dans les régions du centre de la France, un basculement sans précédent, en tout point crucial pour la connaissance des sociétés protohistoriques de l’Europe tempérée à l’aube de la romanisation. Ce dernier s’exprime d’abord – et peut-être avant tout – par une anomalie : au VIe siècle av. J.-C., un établissement princier semble ainsi s’établir sur le site de Bourges-Avaricum, bientôt cerné par une zone de production artisanale, diffuse sur une centaine d’hectares au pied de l’éperon148. Cette expérience proto-urbaine ne connaîtra pas de postérité immédiate : dès le IVe siècle av. J.-C., des batteries de silos à céréales, utilisés secondairement pour abriter des sépultures, succèdent aux installations du Hallstatt final et de la Tène ancienne, marquant une déprise évidente du territoire de la ville et un regain des activités agricoles149. Au siècle suivant, une autre logique territoriale semble d’ailleurs s’exprimer, à l’intérieur de ce qui deviendra par la suite, par différents phénomènes d’accrétion et d’assimilation culturelle, le territoire des Bituriges Cubi au sud et celui des Carnutes au nord150 : un réseau assez dense d’agglomérations artisanales se met ainsi en place au début du IIIe siècle ap. J.-C., rapidement transformées en habitats fortifiés, sans doute dès la première moitié du IIe siècle ap. J.-C.151. Ce sont, pour partie, les témoignages des douze oppida attribués par César aux Bituriges152, nœuds stratégiques d’une trame économique et politique par ailleurs assez serrée et qui perdure tout au long de la période romaine et jusqu’aux premiers siècles du Moyen Âge. C’est aussi au cours de cette période que se font jour deux questionnements fondamentaux pour notre enquête : le premier a trait aux logiques de peuplement à l’échelle du bassin de la Loire moyenne, alors que se développent d’importants centres de pouvoir qui perdurent tout au long de la période antique. Le second renvoie au statut des zones de marge dans le système territorial laténien, tandis que le IIIe siècle av. J.-C. voit l’émergence de nouveaux cadres politiques et les limites des cités gauloises se stabiliser définitivement. Dans cette nouvelle donne, la Sologne est établie durablement dans une position de confins153. Entre cités des Bituriges et des Carnutes, la frontière s’appuie sur une logique de bassins versants : c’est ainsi qu’au cœur du chevelu ligérien, les vallées de la Sauldre et de ses affluents sont biturige, tandis que celle du Beuvron est carnute. Seul le contrôle du secteur au sud de Neung-sur-Beuvron, dont l’emplacement correspond sans doute à celui de l’oppidum de Noviodunum, semble vouloir mettre un « nez » biturige dans les affaires carnutes. Ces entités ne forment pas toutefois des provinces naturelles aux caractères homogènes. Dans ce contexte, la cité se présente avant tout comme une réalité administrative : dès le Second âge du Fer – et a fortiori au cours de la période antique – elle constitue le cadre indispensable permettant un relais efficace de l’autorité et de l’information entre les différents centres du pouvoir, économiques, politiques et religieux154. Face à ces différentes spécificités, les stratégies de mise en valeur du territoire ont donc pu varier, en fonction des atouts et des potentialités de chaque région : ainsi, à l’intérieur des territoires de la Gaule Chevelue, l’évolution du peuplement ne s’est pas faite partout selon les mêmes modalités et les mêmes rythmes, en fonction des formes du paysage et de l’intensité de l’emprise anthropique sur ce dernier. Nous l’avons rappelé plus haut : l’analyse de l’occupation du territoire au cours des périodes anciennes de l’âge du Fer, en Sologne comme ailleurs, souffre à l’évidence d’importantes lacunes documentaires. Des déséquilibres flagrants sont ainsi à souligner, en faveur des données funéraires notamment et alors même que les nécropoles tumulaires, pourtant très nombreuses, sont loin d’être
148. BUCHSENSCHUTZ et al. 2007 et 2012 ; MILCENT 2007. 149. BUCHSENSCHUTZ, ibid. 150. Les conditions de la formation des cités gauloises ont été largement débattues depuis JULLIAN (1907-1926). 151. BUCHSENSCHUTZ 2004. 152. Sur l’histoire des villes fortifiées de hauteur de la Gaule celtique entre le IIe et le Ier s. av. J.-C., leur mise en réseau et leur complémentarité, voir notamment FICHTL 2000. 153. DUMASY 2001, ROBREAU 2012. 154. FERDIÈRE 2005.
24
toutes connues et exploitées. Sous ce regard d’ailleurs, cette concentration n’exprime sans doute qu’un « effet de source », fréquent en archéologie : les propriétés du pays de Sologne ont facilité la reconnaissance des tertres funéraires, dès lors que les archéologues étaient en mesure de pénétrer sous le couvert forestier qui a bien souvent fossilisé les nécropoles. Ainsi, ce groupe ne représente sans doute qu’un fragment « émergé » d’une entité beaucoup plus étendue au sein du système territorial de la Tène ancienne. En dépit de ces conditions favorables, il est difficile de proposer une sériation efficace des sépultures qui composent ces vastes nécropoles. Les rares fouilles ont livré des armes et des parures mais il est difficile actuellement d’avoir une idée précise de l’évolution chronologique et de la hiérarchie de ces ensembles, notamment après le VIe siècle av. J.-C.155. Si les données relatives à la nature du peuplement apparaissent totalement indigentes pour la Tène ancienne, il n’en va pas de même pour les périodes suivantes156. A partir de la Tène B puis, de manière plus prégnante sans doute, au cours de la Tène finale, les habitats, sensiblement plus nombreux qu’aux périodes précédentes, apportent quelques informations nouvelles sur l’aspect que pouvait prendre l’occupation du territoire, à l’interface des cités bituriges et carnutes. À partir de la Tène C2, vers 200 av. J.-C., des agglomérations à vocation artisanale émergent en différents points de France centrale, donnant rapidement naissance à des oppida fortifiés au siècle suivant. En Sologne, seul l’éperon de Neung-sur-Beuvron semble prendre part à cette hiérarchisation du territoire, même si les nombreux diagnostics archéologiques réalisés ces dix dernières années n’ont pas permis de préciser clairement l’extension de cet habitat et la manière dont il est érigé en oppidum157. Ce constat ne va pas sans soulever quelques difficultés quant à l’interprétation exacte du statut de ce site de hauteur qui semble par ailleurs être abandonné assez rapidement au début de la période romaine au bénéfice d’un vaste habitat groupé de fond de vallée qui se substitue à lui dès la période augustéenne. Quoi qu’il en soit, le caractère isolé de cette attestation doit nous interroger sur les modalités d’une éventuelle « reprise du contrôle des activités artisanales et commerciales par une partie de l’aristocratie 158» dans ces zones tenues à l’écart des centres de pouvoir. En Sologne, l’occupation du sol entre le IIIe et le Ier siècle av. J.-C. semble répondre à d’autres logiques, alors même que les routes commerciales paraissent soigneusement éviter l’interfluve Loire/Cher au profit des axes fluviaux, à l’exception notable de la voie d’Avaricum à Cenabum159.
Les sites d’habitat ruraux sont quant à eux mieux connus en Sologne : plusieurs fermes gauloises, échelonnées entre la Tène C2 et la Tène D2 ont ainsi été identifiées au « Bas de l’Étang Neuf » à Méhers160, sur le tracé de la déviation de Contres161 ou sur la commune de Gy-en-Sologne162. Certains de ces établissements sont parfois délimités par un enclos fossoyé comme au « Vivier » à Saint-Laurent-Nouan163 (Tène C2/D1) ou sur le site de « La Pénetterie » à Theillay164, repéré sur le tracé de l’A85 (fig. 10). Il est délicat toutefois d’introduire un critère de hiérarchie dans cette présentation : ces exploitations présentent toutes en effet des dimensions modestes, leur surface n’excédant jamais un hectare, tandis que l’organisation des bâtiments, notamment à l’intérieur des rares enclos, semble réduite à la plus simple expression. De même, la faible densité des structures rencontrées et la rareté du mobilier d’importation, généralement cantonné à quelques fragments de céramiques allochtones (céramique de type « Besançon », etc.), plaide en faveur du caractère tout à la fois dispersé et peu hiérarchisé de l’habitat au tournant de notre ère : les « fermes dominantes », de rang aristocratique, de même que les hameaux et villages fortifiés, témoins d’une profonde mutation du réseau rural et d’une évolution sensible des pratiques agricoles dans les régions périphériques, sont ainsi totalement absents du territoire de Sologne, révélant un mode original d’exploitation des sols sans doute fondé sur la polyculture vivrière.
155. MILCENT 2004. 156. BUCHSENSCHUTZ ibid. 157. Pour un état précis de ce dossier, voir notamment CHIMIER 2013. 158. BUCHSENSCHUTZ ibid, p. 345. 159. MENU, BUCHSENSCHUTZ 2001. 160. DOYEN 2001. 161. « Les Maisons rouges » : CHERDO 2012. 162. DOYEN ibid. 163. SALE, GRANSAR, GAY à paraître. 164. DURAND, MILCENT, MUSCH 1999.
25
Il n’est pas aberrant de penser que, dans cette région, agriculture et élevage étaient étroitement associés, les exploitations devant alors composer, sur un terroir unique, avec une rotation des cultures et des jachères permettant un accroissement notable des rendements, sur des sols par ailleurs assez pauvres. Dans ce contexte, les petits établissements ruraux paraissent s’affranchir des grandes structures domaniales qui charpentent partout ailleurs l’espace rural et faire l’impasse sur les modèles les plus complexes, fondés sur une complémentarité des installations et des sols aux propriétés agronomiques différenciées. Sous ce regard cependant, nous buttons sur une difficulté récurrente en Sologne : l’absence de toute approche paléoenvironnementale qui nous permettrait, comme dans d’autres secteurs aux conditions climatiques et pédologiques similaires (nous pensons en premier lieu ici à la Brenne165), de mieux saisir, dans la longue durée, la logique des interactions sociétés-milieu. Le dossier socio-environnemental, qui constitue pourtant la clé de notre compréhension de l’occupation du sol dans l’interfluve Loire/Cher, reste en effet à construire dans ce secteur, pour la fin de la période protohistorique comme pour celles qui la précède et lui succède : nul doute que son élaboration permettra de préciser les premières impressions formulées plus haut et dégagées à grands traits, en éclairant les formes anciennes d’un paysage qui a peut-être plus évolué que nous ne l’imaginions jusqu’à présent.
Fig. 10 – Plan de l’enclos
fossoyé de la Tène finale de
« la Pénetterie » (Theillay,
Loir-et-Cher). DAO R.
ANGEVIN 2014 d’après
DURAND, MILCENT et
MUSCH 1999, fig. 2.
A partir du dernier quart du Ier siècle av. J.-C. se met en place dans les cités des Trois Gaules
un vaste réseau d’agglomérations hiérarchisé auquel fait écho la nouvelle organisation territoriale proposée par Auguste et ses successeurs (fig. 11)166. Il s’articule étroitement, dans la dynamique régionale, avec les chefs-lieux de cités carnute et biturige, Chartres-Autricum et Bourges-Avaricum et, dans une moindre mesure, avec l’important emporium des Carnutes, Cenabum. Au sein de cet espace, les agglomérations secondaires identifiées se concentrent dans le val de Loire (Saint-Satur, Vienne-en-Val, etc.) et le long du parcours du Cher (Vierzon, Gièvres, Saint-Romain-sur-Cher, Thésée-Pouillé)167. En Sologne, les sites de Neung-sur-Beuvron et Neuvy-sur-Barangeon représentent les seules attestations confortées par l’archéologie168. La situation de Soings-en-Sologne reste, pour sa part, extrêmement délicate à interpréter : dans ce cas précis, l’important « cimetière romain » fouillé depuis le début du XIXe siècle laisse supposer la présence d’un habitat pérenne à proximité169. Le fonctionnement de la nécropole couvre en effet les quatre premiers siècles de notre ère – comme à Gièvres – et son recrutement laisse à penser qu’au Bas-Empire au 165. BENARROUS 2009. 166. JACQUES, SCHEID 2010. 167. BELLET et al. 1999 ; CRIBELLIER, FERDIERE 2012. 168. PALLU DE LESSERT 1996 ; BOUKEF 1996 ; CRIBELLIER, MAILLOT 2000 ; CHIMIER 2005 et 2011. 169. LA SAUSSAYE 1844 ; AGEORGES 1938 ; DEBAL 1970 ; RUFFIER DES AIMES 1995.
26
moins une partie des défunts occupait un rang social élevé, en lien avec la militia bureaucratique et l’administration provinciale. Pour le reste, le réseau local s’appuie sur de modestes habitats groupés qui s’installent essentiellement au carrefour des voies ou sur les tracés antiques : c’est le cas des relais routiers de Souesmes et Vouzon qui jalonnent l’itinéraire principal entre Orléans et Bourges170.
Dans le même temps, l’habitat rural ne semble pas connaître d’essor véritable : le recensement effectué à l’échelle du territoire biturige par l’équipe du PCR sur le Berry antique trahit la faible densité du maillage rural dans le sud Sologne, en miroir notamment de la Champagne berrichonne ou du Pays Fort171. Si l’on prend quelque distance avec le miroir déformant de Soings-en-Sologne (fig. 12)172, seules de rares nécropoles à incinérations du Haut-Empire, limitées dans leur emprise, leur recrutement et leur mobilier, viennent éclairer les dynamiques démographiques dans la région (les « Mahis » à Gy-en-Sologne173, les « Cloubeaux » à Billy174). En la matière cependant, il convient de rester très prudent quant à l’interprétation des vides des cartes de répartition : cet inventaire s’appuie sur un récolement de la documentation ancienne et l’analyse croisée des données issues de la couverture aérienne du territoire et de prospections systématiques au sol. Or, force est de constater qu’en la matière, ces méthodes se révèlent singulièrement inadaptées au territoire solognot (couvert forestier, etc.), alors même que l’histoire de la recherche le place dans une configuration épistémologique propre aux marges historiographiques.
En dépit de ces réserves, la distribution de l’habitat apparaît malgré tout assez lâche, témoignant de la mise en place de domaines étendus ou ramifiés du fait du faible rendement des terres, sans qu’il soit possible de poursuivre plus avant la réflexion quant à la gestion des sols – notamment du point de vue des parcellaires qui doivent sans doute s’adapter au morcellement des écosystèmes –, à la diversité des exploitations et à l’émiettement de la propriété, par nature polynucléaire. Quoi qu’il en soit, nous ne ressentons pas, en Sologne comme ailleurs, les effets d’une planification et d’une mise en valeur des sols directement liées à la présence romaine175 : en la matière, les formules de continuité l’emportent finalement sur toute logique de rupture et l’occupation rurale antique se caractérise avant tout par un maintien des structures laténiennes176.
Parmi les instruments laissés à notre disposition pour mesurer l’impact de la Conquête romaine sur les campagnes des Gaules, l’évolution architecturale a longtemps tenu une place privilégiée177. En Sologne, ce critère doit toutefois être lissé, tant le mode de construction « à la romaine » semble faire défaut et les formes de l’habitat répondre à des logiques de longue durée. A cet égard, l’absence du modèle de la villa, combinant étroitement partie résidentielle (pars urbana) et exploitation agricole proprement dite (pars rustica), ne doit pas être considérée comme indifférente : plus qu’une étroite association entre structures de confort et unités de production, elle traduit un mode d’organisation particulier des grands domaines agricoles, exploités en faire-valoir direct au moyen d’une main-d’œuvre importante, d’origine essentiellement servile178. Si la présence de la villa joue un rôle central dans l’historiographie, ce n’est donc pas tant du fait de son originalité architecturale qu’en raison des réalités socioéconomiques qu’elle recouvre. Son modèle – transposé des réalités italiques contemporaines – se fonde en effet sur une logique de complémentarité des terres, passées le plus souvent aux mains de grands propriétaires fonciers issus de la petite aristocratie gauloise ou, dans une moindre mesure, de l’ascension de la plebs media179 ; classes sociales qui forment le socle de l’élite municipale et provinciale dès le Haut-Empire.
170. CRIBELLIER, FERDIÈRE ibid. 171. BATARDY, BUCHSENSCHUTZ, DUMASY 2001. 172. DE FILIPPO 2012. 173. COUDERC 2000 et 2001. 174. DOYEN 2000. 175. INGLEBERT 2005. 176. LE ROUX 2004 ; GOUDINEAU 2010 ; DUMASY 2010 ; TREMENT 2010. 177. FERDIERE 1988. 178. OUZOULIAS 2010. 179. VEYNES 2000.
27
Fig. 11 – Un espace de transition : place de la Sologne au sein du réseau des villes et agglom
érations secondaires antiques aux lim
ites des cités des Carnutes, des T
urons et des Bituriges (H
aut Em
pire, I er-III e s. ap. J.-C.).
Cartographie et D
AO R. A
NG
EVIN 2014 d’après BELLEY et al. 1997 et C
RIBELLIER et FERD
IERE 2012.
28
Fig. 12 – Corpus du mobilier céramique et en verre de la tombe 1 de la nécropole flavienne du « Sauveur » (Soings-en-Sologne, Loir-et-Cher, seconde moitié du Ier s. ap. J.-C.). 1 : assiette Menez 7/11, Terra Nigra 2 : coupe Menez 96, Terra Nigra 3 : gobelet à paroi fine, production régionale 4 : pot, céramique commune sombre 5 : biberon, céramique commune claire 6 : cruche Vertet 60, céramique à engobe plombifère 7 : gobelet miniature à paroi fine, production régionale 8 : bouteille miniature, céramique commune sombre 9 : gobelet miniature, paroi fine engobée 10 : fiole Ising 16, AV 130, verre 11 : fiole Ising 8, AV 117, verre 12 : canthare en verre. Dessins A. FOURRE et C. AULNAY dans FILIPPO 2012, p. 65, 66, 77 et 78.
Si un tel système prévaut dans un certain nombre de régions, notamment celles des grandes plaines céréalières, mérite revient à l’archéologie d’avoir révélé la diversité des types d’organisation de l’habitat rural dont on ne soupçonnait pas, il y a encore vingt ans, l’extraordinaire diversité. En Sologne, le corpus de ces établissements s’est ainsi considérablement enrichi dans le sillage de l’archéologie préventive et des tracés routiers : plusieurs exploitations gallo-romaines ont ainsi été reconnues à « la Jeunebardière » à Pruniers-en-Sologne180, au « Petits Bois » de Theillay181, au « Grand Saulé » à Gy-en-Sologne182, au « Chêne vert » de Monthou-sur-Bièvre183, sur le site des ZAC des « Grandes Bruyères184 » et de « La Grange185 » ou sur l’empreinte de la déviation routière de Romorantin-Lanthenay186 (Loir-et-Cher). Ces fermes modestes ont des morphologies et des capacités productives très variables : organisées autour d’un parcellaire assez lâche et de constructions isolées en matériaux périssables, plus rarement en pierre (Pruniers-en-Sologne187), elles révèlent la présence de petites unités dépendant de domaines plus vastes ou, plus sûrement sans doute, à la conduite parfaitement autonome, sans qu’il soit pour autant question d’autarcie.
180. BEGUIN 2000 ; DESFONDS 2001. 181. TALIN D’EYZAC 1999. 182. OLIVEAU 2001a ; JOLY 2002. 183. RAUX, TRICOIRE 2001. 184. RAUX 2002 ; FROQUET 2002 185. CHAUDRILLER 2007. 186. FRENEE et al. 1998. Pour une analyse des traces parcellaires à plus vaste échelle, voir aussi JOLY 2007. 187. BEGUIN, ibid. ; KRAUSZ (dir.) 2003.
29
Leur fonction économique se distingue donc très nettement de celle de la villa et de ses installations satellites, agricoles ou de villégiature. Au-delà de la « dignité architecturale » mise en relief par Varron188, c’est donc la question de la sériation et de la hiérarchisation de l’habitat rural qui se pose, sur des critères strictement socioéconomiques. Fortement consommateur de terres, de main-d’œuvre et d’équipements logistiques, le modèle de la villa apparaît ainsi singulièrement inadapté aux réalités de la Sologne : tout à la fois structure de production et de consommation, il inscrit ses activités agricoles mais aussi ses pratiques somptuaires dans un faisceau d’échanges économiques et de relations sociales étroitement lié à l’expression de la romanité au sein du réseau des villes et des agglomérations secondaires189.
À l’écart de ce système territorial, la Sologne se distingue par une mise en valeur originale du sol fondée sur un maillage assez lâche de petites fermes dont la densification n’est cependant pas évidente à la période antique. Porté par le développement économique engagé dès le Second âge du Fer, son aménagement révèle tout à la fois la transformation progressive de l’ager et le développement d’un nouveau système agraire dont le socle reste l’assolement et la polyculture vivrière. Par ailleurs, il traduit une singularité du comportement social des propriétaires terriens et, sans doute, une stratification particulière des communautés en présence : l’essentiel de la production agricole repose alors sur une masse de petits paysans que leur modestie tient à l’écart du fait épigraphique et des formes supérieures de l’habitat rural190.
La structure sociale de ces populations évolue d’ailleurs très peu au cours de l’Antiquité tardive. Les mutations qui interviennent à la fin du IIIe siècle ap. J.-C. et dans la première moitié du IVe siècle ap. J.-C. concernent avant tout les cadres politiques et administratifs, alors que la Civitas Aurelianorum est détachée de la tutelle carnute et que les diocèses reprennent, peu ou prou, les limites des cités de Gaule centrale191. Au début du haut Moyen Âge, Grégoire de Tours ne mentionne toutefois ni vicus, ni castrum, ni castellum pour la Sologne192. Dans ce contexte, l’un des problèmes majeurs concerne l’expansion chrétienne dans la région et la mise en place du premier réseau d’églises, en relation avec un système territorial hérité de la Protohistoire récente et de l’Antiquité que nous ne connaissons finalement qu’à la marge193. La question est évidemment intéressante car elle rejoint, pour partie, celle de la constitution de la parrocchia (paroisse), si prégnante en Sologne à partir de l’époque carolingienne194. Sa consistance, en tant que communauté de fidèles mais aussi comme territoire d’encadrement à partir du plein Moyen Âge, est entourée de nombreuses zones d’ombre que la documentation du premier Moyen Âge ne vient guère éclairer.
Ainsi, l’archéologie nous renseigne assez peu sur le développement et les rythmes de l’implantation chrétienne, et ce en dépit d’un abondant matériel funéraire : plusieurs nécropoles, échelonnées entre le VIe et le VIIIe siècle ont ainsi été fouillées, notamment sur le tracé de la déviation de Contres195. Elles ne semblent toutefois pas s’établir en lien avec un établissement religieux connu. Les attestations écrites sont quant à elles d’un secours limité, car ce n’est réellement qu’à la fin de la période considérée que le dossier des sources, formé par quelques rares témoignages narratifs ou hagiographiques, s’épaissit réellement grâce aux chartes de donation des Xe et XIe siècles. Dans ce contexte, G. Devailly livre une hypothèse séduisante : les paroisses de Sologne s’appuieraient essentiellement sur les anciens pôles de peuplement et auraient fossilisé très tôt le territoire des vastes domaines antiques qui n’auraient pas été démembrés à l’occasion de l’émergence de la seigneurie196. La proposition mérite à l’évidence attention – et confirmation – 188. VARRON, Agr., III, 2, 7. 189. BELLET et al.1999 ; CRIBELLIER, FERDIERE ibid. 190. MALRAIN 2010. Cette différence apparaît d’autant plus significative en miroir de la situation d’autres régions du centre de la Gaule, comme le Berry ou la cité des Arvernes, où dominent les inscriptions et les marqueurs traditionnels du pouvoir local. Voir notamment LAMOINE 2009. 191. BÜHRER-THIERRY, MERIAUX 2010. 192. HERVE 1999. 193. GANDINI, LAÜT 2013. 194. PERICARD, BOUISSIERE 2013. A cet égard, Grégoire de Tours ne mentionne aucun établissement religieux en Sologne au VIe s. VIEILLARD-TROIEKOUROFF 1976. 195. LAHAYE 2011. 196. DEVAILLY 1973.
30
même si les réalités historiques plaident en faveur d’une telle évolution. Mais nous reviendrons par la suite sur les mutations et les résistances engendrées par la mise en place du système féodal.
L’habitat rural ne connaît quant à lui que peu de transformations entre le Ve et le Xe siècle : les fermes, pour certaines fossoyées, explorées sur les sites de « Ganay » à Saint-Laurent-Nouan197 (Ve-Xe s. ; fig. 13), « Le Chêne vert » à Monthou-sur-Bièvre198, « Les Marnières de Plaisance » à Romorantin-Lanthenay199 (IXe-XIe s.), « La Charmille » à Lassay-sur-Croisne200 (IXe-XIIIe s.), « La Grande Coudre » à Pruniers-en-Sologne (Xe-XIe s.)201 illustrent parfaitement la continuité qui s’éta-blit dans l’occupation du sol entre l’Antiquité et le Moyen Âge, sans solution évidente liée à une désertion des campagnes durant les IVe-Ve siècles. Cette idée, postulée par la première historiographie à partir d’une lecture sélective des sources relatives aux invasions, ne tient pas compte des formules de continuité d’occupation mises en évidence par ailleurs entre les implantations gallo-romaines et celles du haut Moyen Âge : ainsi, sur le site des « Cormins », à Saint-Romain-sur-Cher202, un nouvel établissement carolingien s’installe sur le site antique qui semble péricliter dès le IIIe siècle, sans disparaître totalement toutefois. Cette période se caractérise malgré tout par l’irruption de nouveaux modèles et une évolution des techniques de construction : ainsi, aux « Marnières de Plaisance203 » ou au « Tertre » de la commune de Saint-Gervais-la-Forêt204, dans le val de Loire, des bâtiments de dimensions importantes, à plusieurs nefs, sont construits aux IXe-Xe siècles, esquissant de nouvelles formes d’habitat à proximité des grands centres de décision (Romorantin et Blois).
Fig. 13 – Plan de l’occupation rurale
du haut Moyen Âge de « Ganay » (Ve-Xe s., Saint-Laurent-Nouan,
Loir-et-Cher). Les nombreuses concentrations de trous
de poteaux et de silos de dimensions réduites témoignent, soit de la multi-
polarisation de l'habitat, soit du déplacement de celui-ci sur de courtes
distances au cours du haut Moyen Âge. Relevé topographique et DAO M.
VANTOMME et C. BEN KADDOUR 2014, courtoisie des auteurs.
197. BEN KADDOUR, en cours. 198. RAUX, TRICOIRE 2001. 199. POULLE 2002 ; CHIMIER 2002. 200. BOUILLON 2009 ; MUNOZ, en cours. 201. BRYANT 2001. 202. SALE 2004 ; KRAUSZ (dir.) 2003. 203. POULLE ibid. ; CHIMIER ibid. 204. ROY, en cours.
31
Féodalités (Xe-XIIe siècles) : le temps de l’originalité
Cette cristallisation de l’habitat autour des pôles émergents du pouvoir, installés dans l’entourage immédiat des représentants de l’autorité royale (comes), va toutefois se heurter, dès la fin du IXe siècle, à la crise du modèle carolingien de gouvernement et à la régionalisation des aristocraties. Au tournant du Xe siècle, un nouveau monde se dessine : à travers l’enracinement et la féodalisation de la seigneurie, se met en place, en Francia occidentalis et au-delà, un vaste réseau d’encadrement qui s’exprime notamment, à partir de la seconde moitié du Xe siècle, dans le dense maillage castral qui couvre l’ensemble du territoire du royaume, à quelques exceptions près205. Nouvel horizon politique et idéologique, le modèle féodal s’affirme à travers l’établissement de liens vassaliques puissants et une compétition seigneuriale extrêmement vive : le morcellement territorial qui accompagne l’affirmation de plus en plus forte des lignées locales charpente ainsi puissamment la société, soumise à une autorité fractionnée, bien souvent aux dépens du pouvoir royal206. Symboles de ce pouvoir fragmenté et finalement peu hiérarchisé, les élévations de tours et de châteaux se multiplient à partir du milieu du Xe siècle, et ce jusqu’au XIIIe siècle, avec deux phases de construction exacerbées entre 1060-1110 et 1170-1220207. En Sologne, les nombreuses références, certifiées ou hypothétiques, d’enceintes en terre, peu documentés et difficilement datables, mais aussi de mottes208 et de forteresses posent de ce point de vue problème. L'ambiguïté des termes « seigneuries », « châteaux » ne nous facilite d’ailleurs pas la tâche et rend délicate la hiérarchisation de ces éléments, souvent difficiles à interpréter. Ainsi, si ces mentions attestent une position de contrôle territorial de ces structures, elles ne doivent pas faire illusion sur l’installation de lieux de pouvoirs autonomes. Sous ce regard, le donjon de pierre, structure monumentale emblématique et expression de l’emprise de l’aristocratie, est rare sur le territoire solognot tel que nous l’avons délimité : il est présent à Romorantin, la Chapelle-d’Angillon et Neuvy-Deux-Clochers. Densité bien faible en comparaison de celle connue en région Centre209, où une soixantaine de ces donjons, dont environ le tiers a été détruit, ont marqué ou marque encore l’espace, en particulier à l’ouest d’une ligne allant de Dreux à Issoudun favorable aux grandes vallées (Beaugency, Meung-sur-Loire, Selles-sur-Cher, Saint-Aignan, etc.). Dans ce schéma territorial contrasté, la Sologne occupe à l’évidence une place singulière (fig. 14) : au gré des turbulences successorales, elle a été tour à tour placée sous la domination – successive ou simultanée – des comtés de Blois et de Champagne, du Domaine royal capétien ou de la seigneurie de Sancerre, devenue comté en 1152. À cet égard, l’ensemble seigneurial fortifié de la Tour de Vesvre à Neuvy-Deux-Clochers constitue un objet d’étude particulièrement intéressant pour la connaissance de ces évolutions, à travers la trajectoire ordinaire mais exemplaire de ses chevaliers devenus seigneurs. À l’écart de la Sologne, il éclaire la situation consacrée de certaines régions de France moyenne dont la mutation féodale s’opère sans heurt entre le XIe et le XIIe siècles et nous renvoie de la Sologne une image sans cesse divergente, miroir atypique et déformant d’une société qui refuse de s’organiser autour des pôles émergents du pouvoir. À ce titre, le site de Vesvre a fait l'objet d'un mémoire de maîtrise en 1992 par M. Jouanin, dont l'étude archivistique est précieuse. Il a en outre bénéficié de plusieurs interventions archéologiques dès 1998 sous la direction de V. Mataoucheck, responsable depuis 2012 d’un projet collectif de recherche axé sur la connaissance de cet ensemble castral. Le site, implanté en fond de vallée, dans un milieu extraordinairement humide, est aujourd’hui organisé selon un modèle bipolaire, structuré et cerné par un réseau de fossés : une motte castrale, haute de plus de 10 m et de 40 m de diamètre (motte de guet ?), et une plateforme supportant une tour résidentielle quadrangulaire, séparées par une basse-cour d’1,5 ha, marquent aujourd’hui le paysage.
205. MAZEL 2010. 206. DUBY 1986. 207. MAZEL ibid., p. 447. 208. FLORANCE 1922-1928, 5e volume : mottes gauloises. 209. Seigneurs de pierre, COLLECTIF 1997b.
32
Fig. 14 – Un encadrement limité : centres de décision et relais locaux du pouvoir féodal et ecclésiastique
en Sologne entre la fin du XIe s. et le début du XIIIe s. Les limites actuelles des communes font ici écho aux contours des paroisses d’Ancien Régime, médiévales et modernes,
dans un contexte où ces dernières n’ont fait l’objet que de remembrements limités après la Révolution française. Cartographie et DAO R. ANGEVIN 2014 d’après DEVAILLY 1973, GALINIE et AUDINET, 1993, COLLECTIF 1997b, MAZEL
2010 et CASSART 2011.
Les études historiques et archivistiques210 fournissent de précieuses indications quant au choix du lieu d’implantation du site, aux liens vassaliques dont dépendent ses occupants, à leur statut et à l’évolution de ce dernier au fil du temps, à la place enfin qui est la leur et à sa perception dans l’échelle hiérarchique. Les premières mentions de la famille de Vesvre datent de 1034, 1064, 1085 et font référence à leur statut de témoins lors de l’élaboration d’actes divers (fondation, restitution, donation). Un double lien les unit à la famille de Sully211 : lien de dépendance vassalique, mais également lien de parenté. La vaste seigneurie de Sully dispose de deux forteresses dans son territoire berrichon : la châtellenie des Aix et le château de la Chapelle. Les Vesvre en assurent la protection en tant que chevaliers212 et obtiennent ainsi la concession d’une terre qui devient rapidement leur fief. Il est établi à proximité des deux forteresses, en position stratégique de défense à la frontière du comté de Sancerre, qui ne dépend pas du comté de Blois en ce début de siècle. Entre 1085 et 1162, aucune mention de la famille de Vesvre n’est faite dans les documents juridiques. Il faut attendre cette date pour voir évoqué le nom de Hugues 1er, qui « agit comme un seigneur213 » et 1190 pour que Eudes 1er soit présenté comme dominus de Vevra214. Bien qu’aucune citation des Vesvre n’ait été retrouvée durant la première moitié du XIIe siècle, c’est vraisemblablement au cours de cette période qu’une autre dimension relative à leur stature sociale se fait jour. Sous ce regard, ils profitent certainement de la mort de leur suzerain Gilon 1er vers 1098, sans héritier mâle et de la fragilisation successorale qui s’ensuit, entraînant un
210. DEVAILLY 1973 et JOUANIN 1992. 211. Ces derniers ont acquis d’importants domaines dans le bassin de la Sauldre, au nord du Berry, sans doute par le biais des comtes de Blois et ce dès le milieu du Xe siècle. Son dernier représentant, Gilon de Sully qui meurt vers 1098, dominait un territoire estimé à environ cinq ou six cantons actuels (Devailly 1973, p. 363-364). 212. JOUANIN 1992, p. 26. Il mentionne plusieurs miles castri de la seigneurie des Sully : Godefroi et Ebrard (il s’agit vraisemblablement de ceux dont il relève le nom dans l’acte de 1034) et Gérald et Norman (cités dans un acte de 1064). 213. JOUANIN ibid., p. 17-18 : « Hugues passe un accord avec les chanoines de Saint-Ursin au sujet des dîmes de Neuvy, Humbligny et Neuilly ». 214. JOUANIN ibid., p. 28 : l’auteur mentionne D. Barthélemy qui indique que « les chevaliers accaparent ce titre nouveau dominus le jour où ils se mettent à faire des actes sous leur propre intitulé et à utiliser un sceau ».
33
conflit avec le nouveau seigneur des Aix215. Outre la captation de dîmes, l’évolution vers le statut de dominus confère également le droit de ban (contraindre, juger, punir) et offre un élan nouveau à la terre de Vesvre et à ses seigneurs dès la première moitié du XIIe siècle216. A la fin du siècle, le neveu de Eudes Ier, Hugues II, seigneur de Mennetou-Salon, réinvestit son bien dès 1191. Il décède avant 1202, et c’est alors sa femme qui apparaît comme domina. La construction de la tour en pierre daterait de l’époque de leur retour en terre de Vesvre217. Cette dernière fait alors l'objet d'un partage successoral entre leurs deux fils : Hugues III, l'aîné, reçoit la motte, tous les droits qui y sont associés et les deux tiers des rentes féodales ; Eudes II hérite de la tour et du tiers des rentes218. Quant à la basse-cour, elle aurait été liée à la motte jusqu'au début du XIIIe siècle avant d’être intégrée au domaine de la tour219. Buhot de Kersers fait d’ailleurs une distinction entre ces deux fiefs : la motte relèverait de la seigneurie des Aix, tandis que la tour serait sous dominance du comté de Sancerre220. Cette indication, peut-être jugée fantaisiste, n'est reprise ni par M. Jouanin ni par G. Devailly. La mort de ces deux frères, sans héritiers mâles, marque la disparition du patronyme des Vesvre221. Le parcours des seigneurs de Vesvre fait écho à l’ascension classique de l’ordre chevaleresque au cours de la période féodale. Il traduit toutefois une originalité à l’échelle des pays de France moyenne : comme le rappelle G. Devailly222, presque tous les donjons en pierre du XIIe s. dans le Berry « ont été construits par des membres de famille placées à la tête de vieilles châtellenies ». Font exception les chevaliers de la tour de Vesvre et le château de Ramefort, à Ruffec. Les Vesvre se situent également à un échelon intermédiaire de l’ordre seigneurial : ils font figure de privilégiés auprès d’autres chevaliers qui vivent dans l’entourage du châtelain et ne disposent pas de demeure fortifiée, mais ils n’atteignent pas néanmoins la condition d’autres seigneurs indépendants tels ceux de « Cluis, Châteaumeillant, Sainte-Sévère et Lignières223 ». La fouille archéologique réalisée sur un secteur de la plateforme complète ces données et apporte un nouveau regard quant aux sources manuscrites, à leur lecture et à leur interprétation. Elle offre une profondeur de champ et met en valeur des occupations dont on ne trouve aucune trace dans les archives. C'est ainsi que la date de l’édification de la plateforme est estimée désormais à la fin du IXe siècle, ce qui traduit un ancrage plus ancien que nous le laissaient soupçonner les textes. Cinq périodes d’occupation s’échelonnent par ailleurs de la première moitié du Xe siècle à la fin du XIe siècle et attestent les nombreux remaniements de l’espace. La présence de plusieurs bâtiments est ainsi signalée, dont l’un au moins témoigne de la présence d’une aire résidentielle précoce, de rang aristocratique sans doute (logement « seigneurial » de la période 5, centrée sur la première moitié du XIe s.)224. Le mobilier est quant à lui varié et abondant : « vaisselle en céramique et en verre, pièces de jeux, appliques en os, éléments de harnachement de cheval225 ». De nombreux témoignages d’artisanat, essentiellement métallurgiques, sont également à relever. L’ensemble de cette documentation témoigne donc de la mise en place d’un pôle de pouvoir sur le site dès les premiers temps du délitement carolingien. Son consensus ne sera d’ailleurs que tardivement remis en question : la destruction des premiers aménagements de la plateforme s’accompagne, dès la seconde phase des travaux, de l’édification d’une tour résidentielle, dont les 215. JOUANIN ibid., p. 30 : il s’agit de Guillaume, fils aîné du comte de Blois, privé de son droit d’aînesse à cause de son incapacité à gouverner. Il épouse Agnès, la fille de Gilon et devient seigneur des Aix-d’Angillon de 1098 à 1140. 216. JOUANIN ibid., p. 30. 217. JOUANIN ibid., p. 21. 218. JOUANIN ibid., p. 22. 219. JOUANIN ibid., p. 48 (information de l'auteur sans référence archivistique). 220. BUHOT DE KERSERS 1889, p. 323. 221. JOUANIN ibid., p. 23 : la fille aînée de Hugues, Alix, épouse Jean Bréchard, qui devient seigneur de Vesvre et de Sens et la fille de Eudes, Marguerite, se lient avec Guillaume de Meausse qui devient à cette occasion seigneur de Meausse et de la tour de Vesvre. 222. DEVAILLY 1973, p. 365 : l’auteur cite à cet effet la thèse de P. CHAPU sur les châteaux en Berry (1961). 223. DEVAILLY ibid., p. 321-322 : « ces derniers sont placés sur le même plan que les parents des sires de Déols installés à Issoudun ou la Châtre. » 224. MATAOUCHEK 2009a, p. 1, 4, 124, 126, 149, 170, 171, 172, 182, 184, 191, 215, 216. 225. MATAOUCHEK 2009b, p. 45.
34
espaces sont clairement définis, avec une grande salle au rez-de-chaussée226. Dans ce contexte, les évolutions de l’ensemble castral de Vesvre témoignent d’une mutation achevée, expression du consentement nouveau à un système fondé sur une déclinaison locale de l’autorité.
En contraste, elles mettent en exergue une Sologne tenue à l’écart des centres de pouvoir et qui ne répond que d’une manière assez libre à la mainmise des cadres territoriaux. Dans la longue durée, elle renvoie finalement l’image d’une acceptation limitée du modèle féodal, alors même que sur ses marges, dans le Pays Fort ou le Berry, ce dernier est communément assimilé, non sans ajustements toutefois227. Cette intégration inaboutie de la seigneurie castrale au cours des Xe-XIe siècle – qui fait l’une des spécificités de la Sologne – trouve une résonance somme toute assez logique dans l’implantation des centres du pouvoir ecclésiastique.
Depuis l’Antiquité tardive, la Sologne est écartelée entre trois diocèses : Orléans, Bourges et Chartres. Sur ces marges, les paroisses présentent un canevas territorial assez distendu228, possible mémoire fossilisée des anciens domaines antiques. En domaine urbain, Romorantin s’inscrit d’ailleurs dans cette logique et occupe une place à part au sein des grands centres de décision régionaux avec sa paroisse unique dédiée à Notre-Dame229. Quelques lieux de culte de moindres dimensions (chapelles, oratoires, etc.) viennent alors scander ces vastes territoires peu affectés par l’encellulement paroissial : l’ancienne chapelle Saint-Martin, mentionnée en 1178, s’élève par exemple sur l’un des côtés du cimetière à l’emplacement de l’actuelle Place de la Paix, à l’extérieur de la première enceinte. L’opération archéologique réalisée sous la direction de P. Salé lors du réaménagement de la place a permis de confirmer son emplacement et d’une partie de la galerie du cimetière. Des questions restent toutefois en suspens : la chapelle était-elle antérieure à sa première mention archivistique, disposait-t-elle d’un chevet plat, a-t-elle été reconstruite ? Et, finalement, quelle fut sa place réelle dans le dispositif d’encadrement paroissial des fidèles ? Quatre sépultures ont été fouillées : deux sépultures d’enfants en pleine terre et deux d’adultes, l’une en pleine terre, l’autre placée dans un cercueil. Un vase appartenant au mobilier funéraire pourrait être daté des XIVe ou XVe siècles, ce qui traduirait un changement de statut tardif, au cours du bas Moyen Âge. Les auteurs du rapport avancent ainsi l’hypothèse selon laquelle la chapelle Saint-Martin pourrait être une église paroissiale déclassée, dont l’espace funéraire serait devenu un temps exclusif230. Pour le reste, la documentation disponible trahit une situation assez lâche : quelques collégiales sont présentes sur le territoire solognot dont celles de La Ferté-Beauharnais, La Ferté-Imbault, La Ferté-Saint-Cyr ou Romorantin231. Dans la fourchette chronologique qui est la nôtre, cette région n’est en outre concernée que par très peu de fondations d’abbayes : Pontlevoy, en limite ouest de la Sologne, Selles-sur-Cher et Lorroy (à Méry-ès-Bois, presque à l’extrémité orientale), qui dépendent respectivement des ordres bénédictins, augustins et cisterciens232. De rares prieurés (prieurés-cures inclus) viennent par ailleurs difficilement combler ce vide233. Malgré tout, l’impression ressentie d’une quasi-absence du clergé régulier ne doit pas dissimuler un autre état de fait : bon nombre d’églises paroissiales dépendent d'abbayes ou de prieurés extérieurs concédés par
226. MATAOUCHEK 2009a, p. 194, 217. La tour, initialement datée du XIIe s., pourrait cependant n’avoir été élevée qu’au début du XIIIe s., d’après les derniers résultats énoncés. MATAOUCHEK 2013, p. 399. 227. A Fougères-sur-Bièvre, la place du château a fait l’objet d’un diagnostic archéologique réalisé par P. JOYEUX et V. MATAOUCHEK en 2003, à l’occasion de la réfection des réseaux du centre bourg et de l’aménagement des abords du château. Un fossé parallèle au corps de bâtiment sud du château correspond au dernier vestige du fossé en eau du château. Cependant, son tracé exact n’a pu être précisé ainsi que ses dates de creusement et de comblement. JOYEUX, MATAOUCHEK 2003. 228. À quelques exceptions près comme La Ferté-Beauharnais et Bracieux, dont les territoires très restreints font presque figures d'anomalies. 229. POITOU 2002, p. 40. 230. SALE, BECQ 1998. 231. LESUEUR 1969, p. 162, 163, 164, 314. 232. GUERIN 1960, carte des limites ecclésiastiques. 233. F. LESUEUR cite les prieurés suivants pour le Loir-et-Cher : Bracieux, Chambord, Contres, Huisseau-sur-Cosson, Monthou-sur-Bièvre, Neung-sur-Beuvron (en limite avec La Ferté-Beauharnais), Lanthenay, Salbris (dès le IXe s.), Sambin, Vouzon (LESUEUR 1969, p. 87, 97, 134, 187, 244, 267, 318, 378, 380, 495).
35
un seigneur laïc234 ou par un évêque235. Si l’on se réfère à l’étude de F. Lesueur consacrée au Loir-et-Cher, c’est Pontlevoy qui en détiendrait le plus, très largement devant Selles-sur-Cher, le prieuré de Cornilly (Contres) et le chapitre de Saint-Taurin de La Ferté-Imbault236. De ce point de vue donc, l'encadrement local présente la particularité d’être principalement le fait du clergé régulier qui se voit confier, dès la fin du XIe siècle, la plus grande part de la cura animae des fidèles. En cela, il bénéficie d'une forme de renoncement du clergé séculier et prend localement le relais de l’Église épiscopale, au sein d’un territoire marqué par une relative déprise ecclésiastique. Nous le voyons donc : les pays de France moyenne, très vite placés dans l’orbite capétienne, parviennent, au tournant de l’an Mil, à une situation d’équilibre dont le pilier central repose sur un ordre féodal plus ou moins bien assimilé selon les régions. En Sologne, la situation apparaît nettement plus contrastée toutefois, tant l’éloignement du pouvoir semble jouer ici un rôle primordial, à l’origine du succès de certaines solutions originales dans l’encadrement des populations et le développement économique de ce territoire (maillage castral lâche et densification du réseau des mottes qui témoigne d’une militarisation des marches, délégation du soin des fidèles au clergé régulier dans le cadre d’une structuration paroissiale relativement plastique). Une première rupture s’amorce toutefois dès le début du XIIe siècle à travers les prémices de l’essor urbain et les signes d’une première croissance, essentiellement rurale237. Il est difficile d’en percevoir l’écho en Sologne, tant ce territoire semble marqué par une certaine résilience sociale. Malgré tout, le déploiement d’activités nouvelles entraîne, ici comme ailleurs, une mutation des systèmes productifs (exploitation plus marquée de l’énergie hydraulique, développement de l’artisanat céramique, etc.) qui ne connaîtra un coup d’arrêt significatif qu’à la veille de la Guerre de Cent Ans. Le second Moyen Âge et la Période moderne : le temps de l’estompe A partir du XIVe siècle en effet, le relatif dynamisme perçu au cours du plein Moyen Âge tend brutalement à s’estomper, livrant l’image – sans doute largement déformée par les sources – d’un territoire sur le déclin. Le bas Moyen Âge est marqué, il faut dire, par d’importants phénomènes de rupture qui contrarient fortement l’équilibre des conjonctures : conflits, épidémies, crises frumentaires, disettes récurrentes, fractures politiques et religieuses en cascade238. Sur la longue durée, ces événements scandent toutefois des mutations plus profondes de la société : nous pensons ici aux reconfigurations des territoires ruraux et aux phénomènes de déprises urbaines qui caractérisent le XIVe siècle et qu’il est difficile de corréler par ailleurs avec une autre réalité sociologique, à savoir l’émergence de la ville comme nouveau centre du pouvoir. Dans la France des Capétiens et des Valois, le second Moyen Âge voit en effet l’éclosion de nouvelles forces politiques à côté du pouvoir royal et en marge des pouvoirs seigneuriaux ou ecclésiastiques qui dominaient jusque-là la scène féodale : celles des communes de plein exercice239. La ville, enjeu de convoitise et de conflits, devient le lieu de l’expression des corps constitués, à travers le développement des institutions et des administrations municipales, et un relai puissant de l’autorité royale. En marge de la Sologne, on observe dès le XIIe siècle la promulgation de chartes de franchise accordées à des seigneurs locaux240. Elles ouvrent la voie au regroupement des corps constitués et à l’établissement des premières communautés d’habitants, dès la fin du XIIIe siècle à Blois, au XIVe ou au début du XVe siècle à Montrichard, Saint-Aignan ou Suèvres241. Deux bailliages royaux sont en outre instaurés dans la région dans la seconde moitié du XVe siècle : 234. Église Saint-Martin de Monthou-sur-Bièvre par Garnegaud, vicomte de Blois ; église Saint-Denis de Neung-sur -Beuvron par Hervé de la Porte (LESUEUR ibid., p. 244, 267). 235. F. LESUEUR cite Jean II, évêque d’Orléans, « donateur » de plusieurs églises au clergé régulier dans les paroisses suivantes : Billy, Chaon, Gy, Méhers, Pruniers (LESUEUR ibid., p. 47, 100, 181, 224, 304). 236. Outre ces mentions, une dizaine d’abbayes et de prieurés sont signalés comme titulaires d’églises paroissiales en territoire de Sologne : Saint-Cosme-lès-Tours, Micy-Saint-Mesmin, Bourgmoyen, Saint-Sulpice de Bourges et dans une moindre mesure Ferrières-en-Gâtinais, Marmoutier, Vierzon, Saint-Satur, Beaugency, Jargeau. 237. CASSARD 2011. 238. BOVE 2010. 239. GALINIE 1993. 240. Pour le comté de Vendôme, voir notamment BARTHELEMY 1993. 241. GALINIE, AUDINET 1993.
36
Montrichard en 1461 et Blois en 1498242. L’équipement religieux se concentre alors logiquement dans les zones de plus forte démographie : entre Loire et Cher, seules l’abbaye bénédictine réformée de Pontlevoy, fondée en 1034 par Gueldouin, comte de Blois, et la collégiale de La Ferté-Imbault, installée au XIIIe siècle, à l’histoire singulière, semblent faire exception243. Ils trouvent alors un relais efficace auprès des baillis seigneuriaux du Vendômois et de la vallée du Cher tandis que, d’un point de vue fiscal, les greniers à sel signalés tout au long des grands axes fluviaux participent, sans discontinuité majeure, à une perception stable de la gabelle244. Leur répartition n’est pas indifférente : elle trahit les disparités évidentes existant entre les terres fertiles de la Beauce et des vals et celles arénacées de la Sologne, en termes de rendements agricoles mais aussi d’intégration des activités économiques. Les corporations d’artisans et de commerçants sont quasi inexistantes, alors même que les échanges semblent faire l’objet de circuits courts, du producteur au consommateur. Les halles, lieux de sociabilité par excellence où se tiennent foires et marchés, mais aussi tribunaux et assemblées communes, ne sont présentes qu’à Contres et, au-delà, Romorantin, ce qui traduit l’ancrage limité des réseaux économiques dans la région, et ce même après la Guerre de Cent Ans. Cette réalité fait écho à la faible densité de l’habitat à la fin du Moyen Âge, comme en témoigne le recensement des paroisses effectué dans le cadre de l’Atlas des villes et des réseaux de ville de la région Centre245. Lorsque le récit atteint les années 1300-1320, il faut braquer le projecteur sur les seuls établissements qui, précisément, nous informent : en creux de ce que nous pourrions percevoir dans le val de Loire ou plus au sud, dans le Berry, où le cheminement des sociétés s’inscrit dans le sillage des centres urbains de décision (Blois, Orléans, Bourges) et le développement des grands pôles monastiques, ce sont ici les occupations rurales qui nous renseignent sur les mouvements presque imperceptibles de l’Histoire. Par la suite, il faudra donc décrire leur nature aussi justement que possible puisque nous serons presque toujours sur leur pas pour comprendre la trajectoire de la Sologne jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Le nombre de sites fouillés reste toutefois limité. De petits établissements agricoles sont mentionnés aux « Barres » de Châtres/Mennetou-sur-Cher246 (XIIIe -XIVe s.), à « La Gastière » de Pruniers-en-Sologne247 (XIVe -XVe s.), au « Petit Bois » de Theillay248 ou à « La Lyaudière » de Gy-en-Sologne249. Il s’agit dans la plupart des cas de petites unités autonomes formées de bâtiments à structure légère en matériaux périssables et pratiquant une polyculture vivrière, réduite à la stricte nécessité d’une consommation domestique, et l’élevage ovin. Ces fermes dessinent un paysage rural au tissu extrêmement lâche, dont les caractéristiques ne sont sans doute pas très éloignées de celles de la Période moderne décrites par les savants du siècle des Lumières : dépendant de vastes domaines fonciers, à l’écart des bourgs et des centres paroissiaux, elles prennent place dans un environnement de landes et d’étangs dont la création pourrait remonter aux XIVe-XVe siècles. En cela, bas Moyen Âge et Époque moderne traduisent une évidente formule de continuité : les cinq siècles qu’ils couvrent accompagnent la constitution progressive du territoire solognot tel qu’il est dépeint au début du XIXe siècle, avant la mise en place du couvert forestier actuel. Au sein de ce vaste espace, de prime abord indifférencié, quelques attestations entrent toutefois en dissonance. Dans le domaine agricole, quelques établissements se démarquent ainsi, aux marges de la Sologne, comme la ferme fortifiée des « Bordes » à Saint-Laurent-Nouan250 (XIIIe-XVIe s.), explorée en contexte préventif au printemps 2014 : rattachée directement à l’abbaye Notre-Dame de Beaugency, elle confirme l’existence de variantes dans les modèles d’exploitation, même si sa position de dépendance lui confère un statut tout à fait particulier. Sous un autre regard, 242. GALINIE, AUDINET ibid. 243. Voir supra, la partie consacrée aux « féodalités ». 244. GALINIE ibid. 245. GALINIE ibid. 246. BRYANT 1998. 247. OLIVEAU 2001b. 248. TALIN D’EYZAC 1999. 249. CHAMPAGNE 2001. 250. POULAIN, en cours.
37
quelques installations artisanales viennent atténuer le portrait sans nuance que nous avons esquissé plus haut : la présence d’ateliers de potiers entre le XIIIe et le XVIe siècle à Jouy-le-Potier251 (Loiret) rappelle ainsi que le potentiel des matériaux locaux a pu être ponctuellement sollicité, au côté d’une pratique agricole traditionnelle qui reste toutefois dominante jusqu’à la Révolution. Renaissance : la parenthèse royale La question de la transition du Moyen Âge vers la Période moderne a fait l’objet d’une abondante bibliographie sur laquelle il est inutile de revenir ici. Celle-ci se fonde pour l’essentiel sur une approche macro-régionale qui fait logiquement fi des situations locales. D’un point de vue économique et social, il apparaît d’ailleurs délicat de se faire l’avocat de découpages trop tranchés dans ce que certains auteurs considèrent avec pertinence comme un « long Moyen Âge252 » : ainsi, en Sologne comme ailleurs, les modes de subsistance des populations, fondés sur la paysannerie et son encadrement étroit par le clergé et la noblesse, ne semblent guère dévier de ce que nous pouvons percevoir au cours des siècles qui précèdent, alors même que le schéma d’organisation sociale est et restera jusqu’à la Révolution celui que nous qualifions communément d’Ancien Régime. Dans ce contexte, toute tentative de sériation chronologique se heurterait logiquement à d’évidentes formules de continuité que nous ne pouvons que souligner dans le cadre de ce travail, si attaché par ailleurs à l’idée de longue durée. En dépit de ce constat pourtant, les trajectoires historiques connaissent aussi parfois des ruptures brutales. Au tournant du XVIe siècle, la Sologne va ainsi être confrontée à un basculement sans précédent, sur la lancée de la « Renaissance ». Son territoire est mis en lumière sous le règne de François 1er, à la faveur des itinérances d’une cour royale qui gravite désormais autour du val de Loire et de ses affluents immédiats253. Le souverain s’intéresse tout d’abord à Romorantin, avec laquelle des liens puissants sont déjà créés depuis la fin du XVe siècle, qu’ils soient familiaux ou de villégiature. Il souhaite y établir une résidence et une ville royales, dont il confie le programme à Léonard de Vinci. Ce dernier développe un projet gigantesque : un palais majestueux254 et toute une ville comprenant des quartiers aristocratiques soigneusement agencés autour de jardins, places, réseaux de rues. Cette requalification suppose d’importants travaux de canalisation de la Sauldre et des aménagements hydrauliques d’ampleur sont proposés afin de pallier ces difficultés techniques. Le projet intègre plusieurs variantes255 mais n’aboutit finalement pas, sans que l’on sache si le décès de Vinci en 1519 est la cause principale de ce revirement. Cependant, des sources contemporaines suggèrent que des travaux préparatoires ont pu être engagés dès 1516, à travers la réfection de la voirie et la construction d’une levée de pierre. Sur l’un des plans d’ensemble réalisé par Vinci, une plateforme dominant la Sauldre à l’ouest de la ville semble ainsi correspondre à l'emplacement d'une vaste terrasse de 3 m de haut, libre de toute construction jusqu’au XIXe s. C'est pour vérifier l'éventuelle concordance entre le projet de Vinci et les anomalies observées, qu'une fouille programmée, conduite par S. Bryant256, a été autorisée en 2009257. Si aucune levée de pierre n’a été mise en lumière, un exhaussement accentuant la pente naturelle du terrain a bien été réalisé, probablement au cours des premières décennies du XVIe siècle Cependant, rien n'indique que ces travaux puissent être effectivement corrélés au projet royal. Très tôt cependant, François 1er se détourne de Romorantin au profit d'un autre site éloigné de tout contexte urbain mais plus proche du val de Loire qui constitue désormais le cœur du pouvoir Valois : Chambord. Les travaux, commencés dès 1520 à la suite du changement d’orientation du 251. METENIER, JESSET 2006. 252. LE GOFF 2004. 253. DELUMEAU 1986, p. 110. 254. VASSORT 2012, p. 49 : « un palais quadrangulaire, bâti autour d’une cour d’honneur et précédé d’une avant-cour, toutes deux dotées d’un portique, ainsi que la façade méridionale du palais édifiée le long de la Sauldre, sur laquelle étaient prévus des spectacles navals. Le palais est cantonné de quatre tours d’angle et desservi à proximité de ces dernières, par quatre escaliers rampe sur rampe ». 255. Codex Atlanticus, f°209r°. 256. BRYANT 2010a. 257. À la demande du Musée de Sologne dans le cadre de la préparation d’un colloque « Léonard ingénieur, peintre et architecte de François 1er » qui a eu lieu en juin 2010.
38
projet initial, se poursuivent jusqu’au début du règne de Henri II. Le château est construit sur un terrain marécageux, à l'emplacement d'une ancienne forteresse appartenant aux comtes de Blois qui sera rasée à cette occasion. Il s'agit de la dernière demeure royale construite sur un plan médiéval, avec des tours d'angle circulaires258. L'influence italienne est toutefois bien perceptible et s’accommode ici parfaitement des techniques de l'architecture traditionnelle française dont elle n’occulte aucune spécificité, dans un souci de synthèse artistique innovante. Chambord, comme Blois, ou Fontainebleau fait écho à un culte monarchique en plein essor259. À partir de 1525, les logis royaux du val de Loire ne seront plus que des résidences secondaires, toujours activement fréquentées cependant. Ainsi, Louis XIV se rend volontiers à Chambord et y organise des travaux de grande ampleur (construction des écuries temporaires, aménagement partiel des jardins et canalisation du Cosson) jusqu’en 1685 qui marque généralement, sous la plume des historiens, le début d’une longue période de délaissement260. Ce constat doit cependant être nuancé au regard des importants travaux qui se font jour à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles, comme nous allons nous en rendre compte. Depuis le début des années 2000, Chambord a fait régulièrement l'objet d'opérations archéologiques, sous la responsabilité de S. Bryant. Au fil du temps, plusieurs hypothèses – fondées sur une analyse critique des sources écrites – ont ainsi pu être confirmées, infirmées, complétées ou proposées. Ainsi dans la cour intérieure, les vestiges de l'ancien château des comtes de Blois ont été révélés à travers la découverte d’une tour circulaire de 8 m de diamètre datant des XIIe-XIIIe siècles, mais peut-être antérieure (fig. 15). Son aspect suggère la présence d’une forteresse visiblement plus imposante que ne le laissaient supposer les documents anciens261.
Fig. 15 – Vue des vestiges de la tour médiévale découverte en 2007 au pied de la Tour des Cloches de l’œuvre Renaissance à l’occasion de la fouille de la cour du château de Chambord (Loir-et-Cher). D’après BRYANT 2007b, fig. 6.
Le remblaiement massif et le nivellement systématique du site pour l’installation de l’œuvre Renaissance, confirmés par ces investigations, ne doit pas masquer les hésitations de sa réalisation : la construction du château s’est en effet accompagnée de multiples repentirs qui inscrivent le « rêve de pierre » de François 1er dans un long processus de création262. Sous ce regard, l’intervention au niveau de l'aile sud a permis d’accréditer les nombreux changements dans la conduite du chantier263 qui, loin d’être indifférents, nous éclairent sur l’évolution du programme architectural initial. Elle a ainsi mis en lumière, dans la cour intérieure, les différents niveaux de travail associés à la construction des années 1520 à 1530264. En confrontant les observations archéologiques avec une
258. VASSOR, ibid., p. 50-51, 86, 88. 259. DELUMEAU ibid., p. 110, 136. 260. VASSOR, ibid., p. 141, 185-186, 203, 207. 261. BRYANT 2007 a et b. 262. JOSSET, AUBOURG-JOSSET 1996. 263. BRYANT 2006. 264. BRYANT 2007a et b.
39
gravure de 1570, le mur des fausses-braies a pu être mis au jour, ponctué à intervalles réguliers par des balcons en encorbellement. Ce projet est cependant resté inachevé : les fossés des douves n’ont pas été terminés, tandis que le mur de contrescarpe n’a pas été dressé265. La connaissance des espaces paysagers aux abords du château a également bénéficié des dernières opérations préventives qui se sont déroulées sur les parterres ouest, est et nord des jardins du château. Elles ont notamment permis de reconnaître l’emplacement du petit jardin antérieur au XVIe siècle, le long de l’ancien axe reliant Chambord à la vallée266, ainsi que celui du jardin régulièrement planté en 1734 sous le règne de Louis XV à la suite de la canalisation du Cosson267. Une prospection géophysique réalisée par le Domaine de Chambord en juillet 2014268 promet d’ores et déjà d’apporter d’intéressantes informations quant au tracé ancien de la rivière et à ses franchissements. Par ailleurs, l’hypothèse de la réalisation d’une partie des jardins dessinés en 1681-1682 à la demande de Louis XIV, alors qu’on imaginait jusqu’à présent que ces derniers étaient restés à l’état de projet269, est des plus stimulantes pour notre compréhension de l’évolution de ce secteur et de l’historique de l’aménagement des jardins de Chambord. Dans ce contexte, le projet avorté de Romorantin et la construction de la demeure emblématique de Chambord témoignent d’une Sologne envisagée, au cours d’un bref instant, comme le cœur du royaume. De cette mise en lumière subite découlera une période de prospérité qui couvrira toute la première moitié du XVIe siècle. Ses répercussions se feront d’ailleurs encore longtemps sentir, alors même que sa situation se sera nettement dégradée270. 6- Un modèle de développement original ? Les recherches que nous venons de présenter s’inscrivent dans le vaste mouvement de renouvellement des connaissances impulsé, il y a près de vingt ans, par les premières investigations préventives sur le tracé de l’autoroute A85. Confortées par une relecture attentive des sources historiques et le recours de plus en plus systématique aux approches paléoenvironnementales, elles bouleversent profondément notre vision des dynamiques de peuplement entre Loire et Cher, depuis la fin du Paléolithique jusqu’à l’orée de l’Époque moderne. À l’origine, la démarche adoptée souhaitait questionner la position de marge de la Sologne au sein du système territorial de France centrale : à cet effet, elle débouche sur un foisonnement de résultats et une diversité de points de vue qui reflètent la complexité des réalités sociales en présence ; réalités que l’histoire et l’archéologie, pourtant soutenues par un fort contingent de disciplines alliées, ne perçoivent malgré tout qu’avec une faible acuité. Dans ce contexte, tout essai de synthèse devient une entreprise extrêmement délicate, tant elle porte dans son principe le risque d’une simplification abusive, d’une globalisation caricaturale. Sous ce regard – et nous avons pu nous en rendre compte précédemment –, la question de l’évolution des territoires dans la longue durée invite historiens et archéologues à se tourner vers d’autres disciplines, en particulier la géographie du développement qui pose avec efficacité le problème du statut réel de la marge au sein d’un système dominant.
Pour rendre compte des processus en jeu, et notamment de leurs dimensions spatiale et temporelle, il est important d’étudier avec précision les inégalités régionales du développement271 : dans le cas de la Sologne, une telle démarche suppose d’inscrire les données recueillies dans une
265. Sur la confrontation des données archéologiques avec la gravure d’Androuet du Cerceau, voir BRYANT 2010b. 266. BRYANT 2013a. 267. BRYANT 2013b. 268. RUELLEU 2014. 269. Plan du projet pour l’avant cour de 1682 (Bibliothèque nationale, département des Estampes et photographies, FT 6-VA-432, image extraite de MELISSINOS, MARCHANT 2003). 270. B. EDEINE indique que jusqu’au milieu du XVIIe siècle « la Sologne conservera cette réputation de pays où il fait bon vivre ». Il mentionne le témoignage d’un conseiller au Présidial d’Orléans, François Lemaire qui en 1645 écrit : « Si la Beauce se trouve privée de tant de choses, la Sologne la récompense, car elle est abondante en prez, bois de haute futaie, buissons, étangs et rivières, terres labourables portant bled, méteil et seigle ; elle abonde aussi en bestial et gibier et en toute sorte de chasse... » (1972a, p. 139, 140, 141). 271. Sur cette question d’une archéologie du développement des territoires, voir notamment TREMENT (dir.) 2013.
40
construction plus vaste qui permet de saisir précisément le rôle de la marge en un temps et un contexte sociopolitique donnés. Cette approche doit alors permettre de répondre à quelques questions essentielles que l’archéologie se refuse obstinément à investir, plus par confort que par désintérêt il est vrai. Car cette ambition suppose au préalable de reformuler ces problématiques, afin de les inscrire dans une histoire longue : quelle place a pu occuper la Sologne dans le système territorial de France centrale depuis les prémices des économies de production ? Quel fut son niveau de développement réel au cours des différentes séquences considérées et dans la longue durée ? Les processus impliqués à différents niveaux ont-ils conduit à l’émergence de différenciations spatiales persistantes, à l’échelle régionale et au-delà ? Et, si tel est le cas, est-il possible de mettre en évidence un modèle de développement spécifique aux zones de marge ?
À la suite de ce tour d’horizon, plusieurs réponses peuvent être formulées qui nous renvoient à la richesse polysémique de la marge. La première d’entre elles éclaire le caractère réducteur du topos hérité de la Période moderne et qui fait de la Sologne une terre de désolation, tenue à l’écart des grands mouvements de l’Histoire. Nous l’avons vu : devenue aux XVIIe-XVIIIe siècles un pays de landes, elle apparaît sans conteste dans les sources comme un « angle mort » du développement, éprouvé par un faible dynamisme économique et une démographie en berne. Cette réalité a largement conditionné la perception de la Sologne au cours des siècles qui ont suivi, marquant durablement les esprits et les mentalités et livrant une vision tronquée de ce territoire. Car cette situation, étroitement liée à la conjoncture économique de la fin de l’Ancien Régime, à travers la mutation des pratiques agricoles et la crise d’un « modèle solognot » fondé sur l’élevage intensif du mouton, ne saurait être considérée comme définitive et atemporelle.
À cet égard, il est intéressant de constater que, selon les périodes considérées, la Sologne se comporte tantôt comme un centre dynamique, tantôt comme une marge créatrice ou débitrice. Cette dernière position est d’ailleurs la plus fréquente, mais ne nous y trompons pas : une histoire de la longue durée272 nous révèle la parfaite intégration de cette région à des systèmes territoriaux plus vastes mais plus vulnérables qui ne cessent pour leur part jamais d’évoluer. Nous aurions donc tort d’envisager cette marginalité en termes de stricte exclusion. De par la faible « sensibilité » évolutive de ses modèles, la Sologne apparaît naturellement moins exposée à des déstabilisations que les régions limitrophes, plus dynamiques mais plus solidement ancrées aussi dans des relations de pouvoir spatialisées. Seule la Renaissance et l’investissement du val de Loire par l’autorité royale signalent de ce point de vue une anomalie, faisant temporairement de la Sologne un centre de décision important, inscrit dans un schéma territorial parfaitement codifié.
Dans le cheminement historique que nous avons essayé de retracer, les exemples sont ainsi nombreux qui illustrent une réelle souplesse de l’occupation du sol et des modes de peuplement : au cours de la période antique, la Sologne se démarque ainsi nettement des grandes vallées densément peuplées et des plaines agricoles intensivement exploitées de Beauce et du Berry. Sous ce regard, l’archéologie livre les témoignages fugaces – mais bien réels – d’une organisation dispersée dans laquelle les marqueurs habituels du territoire – villae, vici, agglomérations secondaires, réseau viaire – ne jouent qu’un rôle accessoire ou secondaire. Par une structuration très lâche et finalement peu hiérarchisée de l’habitat, la Sologne se démarque ainsi des cadres classiques de l’Occident romain. Au cours de la longue séquence qui va du Ier au VIIe siècle ap. J.-C., la mise en valeur des terroirs s’exprime à travers un modèle agro-pastoral de type familial qui s’accommode aisément de l’éloignement des grands centres de décision : leur participation apparaît ainsi limitée dans l’espace et dans le temps et leur capacité d’investissement ne se trouve que très rarement sollicitée, alors même que les productions, agricoles ou artisanales, à haute valeur ajoutée restent rares. Dans ce contexte, les activités privilégiées requièrent des équipements logistiques restreints et une emprise réduite sur le territoire, ce qui explique pour partie la difficulté rencontrée par les archéologues pour caractériser précisément ces occupations.
Au cours de certaines périodes toutefois, la Sologne se présente plutôt comme une région de transition économique, pour reprendre la terminologie de Friedmann (1966) adaptée par Trément273. 272. BRAUDEL 1958. 273. TREMENT (dir.) 2013.
41
Sa capacité d’innovation apparaît alors avec plus de force, sans que soient remises en question l’adaptabilité et la permanence qui fondent en grande partie son modèle de développement. Cette propension s’exprime notamment dans une évolution des modes de subsistance : à la fin du haut Moyen Âge et, de manière plus évidente, au cours du Moyen Âge central, se font jour des installations plus spécialisées, notamment le long des axes fluviaux, en lien avec le développement de nouvelles activités (polyculture céréalière, minoterie, optimisation de l’énergie hydraulique) et en réponse probablement aux sollicitations extérieures. Mais cette spécialisation ne s’accompagne que très rarement d’une nouvelle structuration sociale de l’espace : ainsi, le succès limité du modèle féodal, entre le XIe et le XIIIe siècle, témoigne parfaitement de l’inadéquation de ce type de référence dans une région où les disparités géographiques et économiques sont minimes et, partant, les entités plus difficiles à hiérarchiser et à « territorialiser » dans leur complémentarité. Dans ce contexte, où les formules de continuité l’emportent logiquement sur toute solution de rupture, les cadres administratifs anciens semblent avoir été très tôt « fossilisés », au moment de la création des paroisses au XIe siècle, alors même que les structures intermédiaires du pouvoir (abbayes, prieurés, collégiales, donjons, fiefs, etc.) faisaient cruellement défaut, à de rares exceptions près.
En dépit de ce sursaut, la conjoncture globale du second Moyen Âge apparaît toutefois nettement défavorable au développement de la Sologne. Les XIVe et XVe siècles éclairent de ce point de vue une tendance lourde de la dynamique du territoire qui se signale par une certaine stagnation démographique et plusieurs récessions économiques que la parenthèse de la Renaissance ne vient que ponctuellement remettre en cause. Ce mouvement se poursuit d’ailleurs tout au long de la Période moderne et jusqu’à la Révolution industrielle, sur la lancée d’un long Moyen Âge cher à J. Le Goff et qui prend ici tout son sens274. Dans la longue durée, ce basculement progressif ne s’opère toutefois pas sans inflexion ponctuelle, comme le signalent les grandes réflexions engagées dès la seconde moitié du XVIIIe siècle autour de la rationalisation des systèmes de production agricole et de la régulation de l’élevage ovin, en vue de meilleurs rendements. En dépit de la volonté affichée d’un renouveau, les solutions formulées au cours de cette période ne rencontrent toutefois qu’un écho de confidence, sanctionnant définitivement l’idée d’une stagnation275.
Fig. 16 – Une position d’interface : place de la Sologne à la charnière des grands courants culturels du Néolithique moyen I et de la fin l’âge du Bronze final.
Cartographie et DAO R. ANGEVIN 2014 d’après IRRIBARRIA 1995 et 1996, AGOGUE, LEROY, VERJUX 1999, CORDIER 2009 et FROQUET-UZEL 2012.
274. LE GOFF 2014. 275. HEUDE 2012.
42
Mais cette rémanence ne saurait éclipser totalement le dynamisme culturel de la région, et ce depuis la fin de la Préhistoire. Cette réalité tient en grande partie à la position d’interface qu’a occupée la Sologne au cours des millénaires holocènes et qui fait fi des cadres de l’histoire politique récente, pour partie hérités de l’Âge du Fer (fig. 16). Au Ve millénaire déjà, elle établit la confluence des courants rubané et cardial en France centrale avant de signaler la convergence des grands ensembles du Néolithique moyen, à la charnière du Massif central et du Bassin parisien (Chasséen, culture de Chambon). Au cours de l’âge du Bronze – et singulièrement du Bronze final où les attestations sont relativement nombreuses, notamment autour de Contres – la Sologne marque le point d’équilibre entre traditions continentale et atlantique, dans un syncrétisme qui trahit le caractère extrêmement flou des lisières culturelles. Le Hallstatt et la Tène ne remettent d’ailleurs pas en cause cette position de confins, définitivement entérinée par l’établissement des cités gauloises dont les contours se stabilisent au IIIe siècle av. J.-C.
C’est à ce moment sans doute que le modèle économique que nous avons décrit plus haut – et dont nous avons pu suivre les évolutions – se met en place, porté en cela par une certaine imperméabilité aux stimuli extérieurs qui n’exclut toutefois pas d’importants phénomènes d’acculturation comme nous pouvons le percevoir notamment à travers l’établissement des corpus céramiques276. La stabilité de ce modèle, polynucléaire et peu hiérarchisé, repose sur une économie agricole et sylvicole quasi-exclusive qui se satisfait difficilement d’un schéma pyramidal fondé sur une complémentarité des activités et des fonctions. À cet égard, le moindre succès de la villa antique ou le refus du système féodal né des soubresauts du Xe siècle s’explique plus par cette inadéquation que par une forme d’exclusion socioculturelle.
Nous le voyons donc : sans cesse intégrée aux systèmes territoriaux de France centrale, la
Sologne a presque toujours adopté une posture de zone périphérique dont le rejet n’a cependant jamais été consommé. Dès lors, son histoire ne peut être évoquée en termes d’absence de développement mais plutôt d’originalité de celui-ci277 : sa marginalité repose tout à la fois sur la nécessité de son intégration, les limites posées à cette dernière, et sur sa capacité à innover pour développer un mode d’organisation adapté aux contraintes et potentialités des cadres physiques et environnementaux, mais aussi aux contingences sociales. En cela, le développement de la Sologne fait écho à d’autres constructions socioéconomiques de longue durée comme celles des Landes de Gascogne278 dont l’étonnante stabilité témoigne des dynamiques propres aux zones de marge. Et qui n’ont rien à voir, à l’évidence, avec l’inertie des déserts de peuplement.
© Raphaël ANGEVIN et Valérie SCHEMMAMA, 2015 Raphaël ANGEVIN Valérie SCHEMMAMA Conservateur du patrimoine Ingénieur d’études Ministère de la Culture et de la Communication Ministère de la Culture et de la Communication Service régional de l’archéologie – DRAC Centre Service régional de l’archéologie – DRAC Centre 6 rue de la manufacture 6 rue de la manufacture UMR 7041 - ArScAn [email protected] [email protected] Remerciements Nous adressons nos plus sincères remerciements aux responsables des opérations mentionnées dans le texte pour leur chaleureuse collaboration et les échanges fructueux que nous avons pu engager avec eux autour de la Sologne et de son riche passé. Notre gratitude va également à M. Bernard HEUDE dont l’immense érudition, souvent sollicitée, a grandement contribué à l’enrichissement du manuscrit. 276. HUSI (dir.) 2013. 277. SALE 2014. 278. ANGEVIN 2009.
43
Bibliographie AGEORGES (H.) 1938 – « Fouilles effectuées en Loir-et-Cher », Supplément à la Revue académique du Centre, Châteauroux. AGOGUE (O.) 2005 – « Autour du grand paléolac miocène : continuités et ruptures de l’occupation territoriale au Paléolithique
supérieur en région Centre », Bulletin de la Société préhistorique française, t. 102, p. 509-526. AGOGUE (O.), LEROY (D.), VERJUX (C.) 1999 – Les premiers paysans en région Centre (5000-2000 av. J.-C.), Catalogue
d’exposition, Musée des Beaux-Arts d’Orléans (1999-2000), Orléans, Arep, 119 p. AMELIN (P.), CREUSILLET (M.-F.), HAMON (T.), IRRIBARRIA (R.), VERJUX (C.) 1995 – « Un village du Néolithique moyen I en
Sologne controise », Bull. Group. de Recherche archéologique et historique de la Sologne, 17-3, p. 21-44. ANGEVIN (R.) 2009 – Sous les godets, la plage ! Approche scientifique, méthodologique et réglementaire des problématiques
liées à la mise en œuvre des opérations d’archéologie préventive sur un linéaire d’aménagement. Étude du projet autoroutier A.65 (Langon-Pau), rapport scientifique, Institut national du patrimoine, ex. multigraph.
ANGEVIN (R.), SURMELY (F.) 2013 – « Le Magdalénien moyen et la trajectoire historique des sociétés du XVIe millénaire av. J-C en France centrale », Palévol - Comptes rendus de l’Académie des Sciences, p. 57-68.
ARDOUIN-DUMAZET (V.-E.) 1893-1921 - Voyage en France, t. 1, Paris, Berger-Levrault, p. 96-143. ASSELAIN (J.-C.) 1984 - Histoire économique de la France du XVIIIe siècle à nos jours. Tome 1 : de l’Ancien Régime à la
Première Guerre mondiale, Paris, éditions du Seuil, 221 p. AUGIER (L.), FROQUET (H.), MILCENT (P.-Y.) 2001 – « Port Sec nord : des ateliers de La Tène A dans les environs de Bourges
(Cher) », Bulletin de l’Association française pour l’étude de l’âge du Fer, vol. 19, p. 11-12. BAILLOUD (G.) 1971 – « Le Néolithique danubien et le Chasséen dans le Centre et le nord de la France », In : H. Schabedissen,
J. Lüning, Die Anfänge des Neolithikums vom Orient bis Nordeuropa, Fundamenta, Reihe A, Band 3/6, Böhlau Verlag, Köln-Wien, p. 225-226.
BARTHELEMY (D.) 1993 – La société dans le comté de Vendôme de l’an Mil au XIVe s., Paris, Fayard, 1110 p. BATARDY (C.), BUCHSENSCHUTZ (O.), DUMASY (F.) 2001 – Le Berry antique. Milieu, hommes, espaces. Atlas 2000, 21e
Supplément à la Revue archéologique du centre de la France, 190 p. BAVOUX 1994 – Les espaces intermédiaires, un nouveau concept ?, Dijon, publications du laboratoire de Géographie humaine
de l'Université de Bourgogne, 282 p. BEGUIN (F.) 2000 – A85 Tours-Vierzon, section M2. L'établissement antique de "la Jeunebardière" à Pruniers-en-Sologne (L.
et C.). Site 14. DFS de fouille d'évaluation, 2000, 8 p., 12 fig., photogr. BELLEY (M.-E.), CRIBELLIER (C.), FERDIERE (A.), KRAUSZ (S.) 1999 – Agglomérations secondaires antiques en région Centre,
17e Supplément à la RACF, FERACF, Tours. BENARROUS (R.) 2009 – La Grande Brenne (Indre) aux périodes pré-industrielles : contribution à l’histoire des paysages, des
étangs et des relations sociétés/milieux dans une zone humide continentale, thèse de doctorat de l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 4 vol.
BEN KADDOUR (C.) en cours – Saint-Laurent-Nouan, « Ganay », un site d’habitat fossoyé du haut Moyen Âge (Ve-VIIe s. ap. J.-C.), rapport de fouille archéologique préventive, SRA Centre/Evéha.
BERTHOUIN (F.), VILLES (A.) 1980 – « À propos d’un vase provenant de Chambon, nouveaux éléments sur le “ groupe de Chambon ” », Bulletin de la Société des Amis du Musée préhistorique du Grand-Pressigny, t. 31, p. 21-29
BERTRAND (M.), PLANAS (N.) 2011 – Les Sociétés de frontière de la Méditerranée à l’Atlantique (XVIe-XVIIIe s.), Madrid, Casa de Velasquez, 122, 426 p.
BOVE (B.) 2010 – Le temps de la Guerre de Cent Ans (1328-1453), Paris, Belin, 669 p. BOUILLON (J.) avec la collab. DI NAPOLI (F. ), RAUDIN (S. ), TRICOIRE (J.) 2009 – Lassay-sur-Croisne "VC n°9 - bourg de
Lassay" (Loir-et-Cher), rapport de diagnostic, 36 p., annexes. BOUKEFF (Y.) 1996 – Neung-sur-Beuvron (Loir-et-Cher). Le Bourg Neuf, le lotissement des Bruyères, rapport d'évaluation
archéologique, 22 p., 7 fig., photogr., annexes. BRAUDEL (F.) 1958 – « La longue durée », Annales. Histoire, sciences sociales, 13, p. 725-753. BRUNET (R.) 1968 – Les phénomènes de discontinuité en géographie, Paris, éd. CNRS, Mémoires et Documents, 117 p. BRUNET (R.), FRANÇOIS (J.-C.), GRASLAND (C.) 1997 – « La discontinuité en géographie : origines et problèmes », L'Espace
géographique, n°4, p. 297-308. BRUNET (R.), FERRAS (R.), THERY (H.) 2005 – Les Mots de la géographie, Dictionnaire critique, Paris, La Documentation
française, 470 p. BRYANT (S.) 1998 – A85 Tours-Vierzon - Section M1 - Theillay-Villefranche-sur-Cher. Commune de Mennetou-sur-Cher
(Loir-et-Cher). Opération n°2- Site n°41 135 001 AH Les Barres, rapport d'évaluation archéologique, 16 p. ; 29 fig. ; 3 photogr. en coul..
BRYANT (S.) 2001 – A85 Tours-Vierzon, section M2. Un site rural de la fin du haut Moyen Âge "La Grande Coudre" à Pruniers-en-Sologne (L. et C.). Site 18. DFS de fouilles d'évaluation, 9 p., 16 pl., annexes.
BRYANT (S.) 2006 - Le château de Chambord (Loir-et-Cher) : l'aile sud du château, rapport de surveillance archéologique des travaux d'aménagement de l'accueil (décembre 1999 à janvier 2000), 109 p., 88 fig., photogr.
BRYANT (S.) 2007a - Chambord "Le Château" (Loir-et-Cher), rapport de la fouille archéologique de la cour intérieure du château, 162 p., 201 fig., photogr. en coul., annexes.
BRYANT (S.), PONSOT (P.), HOFBAUER (D.), CAILLOU (J.-S.) 2007b – « Le château de Chambord (Loir-et-Cher) : un monument trop (peu) regardé », In : Medieval Europe, actes du congrès tenu à l’INHA, Paris (septembre 2007), publication en ligne, http://medieval-europe-paris-2007.univ-paris1.fr/S.Bryant.pdf.
BRYANT (S.) 2010a - Romorantin-Lanthenay, Loir-et-Cher, Le Grand Jardin - Le centre hospitalier. Étude du site d'un projet abandonné d'urbanisme Renaissance, rapport de fouille programmée, 55 p., annexes.
BRYANT (S.) 2010b - Chambord (41) château, tour de la chapelle, aile et tour des Princes, porte Royale, tour du Chaudron. Diagnostic général des vestiges des aménagements anciens des abords du château (du XVIe au XVIIIe siècle), rapport de diagnostic archéologique, 107 p., ill., annexes.
BRYANT (S.), avec la collab. David (F.), Devillers (P.-Y.), Juge (P.) 2013a - Chambord, Loir-et-Cher, Le Château parterre ouest. Les abords du château et le bourg : des traces d'occupation de la fin du Moyen Âge au XVIIIe s., rapport de diagnostic archéologique, 178 p.
44
BRYANT (S.), avec la collab. Gardère (P.), Juge (P.), Lallet (C.), Pradat (B.), Travers (C.), Wedajo (B.). 2013b – Chambord, Loir-et-Cher, château de Chambord, rapport de diagnostic archéologique, 161 p.
BUCHSENSCHUTZ (O.). 2004 – Projet collectif de recherches. Du territoire biturige au Berry, approches spatiales, rapport, Service régional de l’archéologie, DRAC Centre, 88 p.
BUCHSENSCHUTZ (O.), AUGIER (L.), RALSTON (I.) 2008 – Un complexe princier de l’âge du Fer : l’habitat du promontoire de Bourges (Cher), Ve-IVe s. av. J.-C., Bituriga, Bourges Plus, 200 p.
BUCHSENSCHUTZ (O.), AUGIER (L.), DURAND (R.) 2012 – Un complexe princier de l’âge du Fer : le quartier artisanal de Port-Sec sud à Bourges (Cher), 41e Supplément à la RACF/Bituriga, Tours, FERACF/Bourges Plus, 2 vol.
BUHOT DE KERSERS (A.) 1889 - Histoire et statistique monumentale du département du Cher, t. IV, Bourges, Tardy-Pigelet, 335 p.
BÜHRER-THIERRY (G.), MERIAUX (C.) 2010 – La France avant la France (481-888), Paris, Belin, 687 p. CARROUE (L.) 2002 – Géographie de la mondialisation, Paris, Armand Colin. CASSART (J.-C.) 2011 – L’Âge d’or capétien (1180-1328), Paris, Belin, 776 p. CHAMPAGNE (F.) 2001 – Gy-en-Sologne "la Lyaudière" [A85 site 12]. DFS de fouille d'évaluation archéologique, 10 p., 6 fig.,
photogr. en coul. CHAUDRILLER (S.), avec la collab. COUVIN (F.), PASQUIER (F.), PONT-TRICOIRE (C.), ARQUILLE (J.), CLEMENT PALLU de
LESSERT (M.-P.) 2007 – Romorantin-Lanthenay "Les Forêts, ZAC de La Grange II" (Loir-et-Cher), rapport de diagnostic, 4 p., 47 fig., annexes.
CHERDO (F.), AUNAY (C.), CHAMBON (M.-P.), DI NAPOLI (F. ), FONTAINE (A. ), GARDERE (P.), LUSSON (D. ), MILLET (S. ), ROBIN (B.), avec la collab. RIQUIER (S.), TROUBADY (M.) 2012 – Contres, Loir-et-Cher, Les Maisons Rouges, Baldu. Des occupations en milieu humide de La Tène à nos jours, rapport de fouille archéologique, 235 p., annexes.
CHIMIER (J.-P.) avec la collab. NEURY (P.) 2002 - Communes de Romorantin-Lanthenay et de Villefranche-sur-Cher (Loir-et-Cher) ZAC de Plaisance, extension de l'usine Matra "Romo III", phase 1, rapport d'évaluation archéologique, 20 p., fig., 4 photogr. en coul.
CHIMIER (J.-P.), JUGE (P.), CHAMBON (M.-P.) 2005 - Neung-sur-Beuvron (Loir-et-Cher) "rue du 11 novembre, parcelle A 386", rapport de diagnostic archéologique, 37 p., 18 fig., photogr. en coul..
CHIMIER (J.-P.), GARDERE (P.) 2011 – Neung-sur-Beuvron (41), Domaine de Villemorant, "Bethaux", route de Blois. Extension de l'Écoparc d'affaires de Sologne, rapport d'opération de diagnostic, 27 p., 14 fig., annexes.
CHIMIER (J.-P.) 2013 – Neung-sur-Beuvron, Loir-et-Cher, 48 rue des Prés, rapport de diagnostic archéologique, 9 p., 3 fig. COLLECTIF 1997a – Marges, périphéries et arrière-pays, Actes du colloque d'Annonay, Montagnes Méditerranéennes,
Grenoble, n°6. COLLECTIF 1997b – Catalogue de l’exposition Seigneurs de pierre, Caisse nationale des monuments historiques et des sites,
Paris, éditions du Patrimoine, 20 p. CONSTANTIN (C.) 1990 – « À propos du Cerny-sud : un ensemble culturel néolithique de grande étendue dans la France
moyenne », Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 87, p. 206-215. CORBIN (A.) 1982 - Le miasme et la jonquille, Paris, Flammarion, 336 p. CORDIER (G.) 2009 – L’Âge du Bronze dans les pays de la Loire moyenne, Joué-lès-Tours, La Simarre, 702 p. COUDERC (A.), GEORGES (P.) 2000 - A85 Tours-Vierzon, section M2. Le site gallo-romain des Mahis à Gy-en-Sologne
(L.-et- C.), un ensemble funéraire à incinération. Site 13, DFS de fouille d'évaluation, 24 p., 18 fig., photogr. COUDERC (A.) 2001 – A85, section M2, site 13 : la nécropole à incinérations gallo-romaines des "Mahis", Gy-en-Sologne
(Loir-et-Cher). DFS de fouille, 64 p., 28 fig., 1 pl., annexes, photogr. COUDERC (A.), GARDERE (P.), IRRIBARRIA (R.), LIVET (J.), avec la collab. BARTHELEMY-SYLVAND (C), BOUILLON (J.),
CREUSILLET (M.-F.), FONTAINE (A.) 2012 - Suèvres (Loir-et-Cher), La Croix Rouge, rapport de diagnostic archéologique, 111 p., annexes.
COUDERC (A.), THIERRY (G.), BARRET (M.), ROY (G. ), ARQUILLE (J.), TRICOIRE (J.), BADEY (S.) 2008 – Suèvres "Les Sables", rapport de fouille, 2 vol., 130 p., 85 fig., annexes.
COUDERC (A.), DELEMONT (M.), DJEMMALI (N.-E.), GARDERE (P.) 2013 – Chémery (Loir-et-Che)r, Les Noëls, Les Malabris, Les occupations domestiques et artisanales protohistorique et gallo-romaine. L'ensemble funéraire des Ve-VIe siècles, rapport de diagnostic archéologique, 95 p., ill.
CREUSILLET (M.-F.) avec la collab. CAROZZA (J.M.), NEURY (P.) 2000 - Le pont de Sauldre, Châtillon-sur-Cher (Loir-et-Cher), DFS de sauvetage urgent, 70 p., 30 fig., photog., annexes.
CRIBELLIER (C.), MAILLOT (J.-F.) 2000 – Neung-sur-Beuvron. Le Bourg Neuf/lot 13, rapport de surveillance de travaux, 2000, 6 p.
CRIBELLIER (C.), FERDIERE (A.) 2012 – Agglomérations secondaires antiques en région Centre, actes de la table ronde d’Orléans, vol. 2, 42e Supplément à la RACF, Tours, FERACF, 184 p.
DALAYEUN (M.-D.) 2013 – Extension de la zone d’activités « Le Grille Midi », rapport de diagnostic, SRA Centre/Inrap, Orléans, 70 p.
DEBAL (J.) 1970 – « Le "Cimetière romain" de Soings-en-Sologne (Loir-et-Cher) », Revue archéologique du Centre de la France, t. 9, p. 20-31.
DELOYNES DE GAUTRAY (M.) 1826 - Éloge de la Sologne, Orléans, Imprimerie de Guyot aîné, 24 p. DELETANG (H.) 1984 – Voirie antique et occupation du sol en Sologne, le chemin gallo-romain d’Orléans à Bourges, thèse de
doctorat, Université de Tours, 3 vol. DELUMEAU (J.) 1986 – « Renaissance et discordes religieuses, 1515-1589 », In : Duby (G.), Histoire de la France de 1348 à
1852. Paris : Larousse, p. 93-144. DEPONT (J.), TROTIGNON (F.) 1984 – « Le Magdalénien supérieur du Laitier Pilé, commune de Saint-Palais (Cher) », Cahiers
d’archéologie et d’histoire du Berry, t. 78, p. 33-51. DESCHAMPS (S.) 2002 – Analyse critique des témoins d’occupation lithiques du Paléolithique final au « Bas du Port-Nord » à
Muides-sur-Loire (Loir-et-Cher), mémoire de DEA, université de Paris 1, ex. multigraph. DESFONDS (A.) avec la collab. BEGUIN (F.) 2001 - A85, section M2, site 14 : l'établissement antique de "la Jeunebardière" à
Pruniers-en-Sologne (Loir-et-Cher), DFS de fouille, 24 p.
45
DESPRIEE (J.) 1986 – « Le village néolithique de la "Vallée aux fleurs", commune de Fossé (Loir-et-Cher), In : G. Aubin, Actes du Xe colloque interrégional sur le Néolithique, Revue archéologique de l’Ouest, p. 51-52.
DEVAILLY (G.) 1973 - Le Berry du Xe siècle au milieu du XIIIe. Étude politique, religieuse, sociale et économique, Paris-la Haye, Mouton, 636 p.
DEYON (P.) 1986 – « La France baroque, 1589-1661 », In : Duby (G.), Histoire de la France de 1348 à 1852. Paris, Larousse, p. 145-197.
DOYEN (D.) avec la collab. LE GOFF (I.) 2000 - A85 Tours-Vierzon, section M2. La nécropole antique "Les Cloubeaux" à Billy (L.-et-C.), Site 17, DFS de fouille d'évaluation, 18 p., fig., photogr.
DOYEN (D.) 2001 – A85 - Section M2 : occupations multiples : La Tène moyenne, la Tène finale et gallo-romaine "le Bas de l'Etang-Neuf" à Méhers (Loir-et-Cher), site 20, DFS, 32 p., 53 pl., annexes, photogr.
DUBY (G.) 1986 – « Les féodaux, 980-1075 ». In : Duby (G.), Histoire de la France des origines à 1348, Paris, Larousse, 1986, p. 285-322.
DUMASY (F.) 2001 – « Les limites de la cité des Bituriges », In : C. Batardy, O. Buchsenschutz et F. Dumasy, Le Berry antique. Milieu, hommes, espaces. Atlas 2000, 21e Supplément à la Revue archéologique du centre de la France, p. 21-22.
DUMASY (F.) 2010 – « Villes, agglomérations, campagnes : comment évoluent-elles au début de la période romaine ? », In : P. Ouzoulias et L. Tranoy, Comment les Gaules devinrent romaines, actes du colloque international de Paris (2007), Inrap/La Découverte, p. 143-158.
DURAND (S.), MILCENT (P.-Y.), MUSCH (J.) 1999 – A85 - Section M1 – Theillay/Villefranche-sur-Cher "Un enclos du second âge du Fer à Theillay, La Pénetterie (Loir-et-Cher), site 10, DFS, 32 p., 12 fig., photogr.
DURAND (S.), SAMZUN (A.) 1999 – A85 Tours-Vierzon, section M1. Rapport d'évaluation archéologique complémentaire du site n°1 commune de Mennetou-sur-Cher, Les Barres. (Loir-et-Cher), 8 p., 4 fig., 7 photogr.
EDEINE (B.) 1972a - La Sologne. Contribution aux études d’ethnologie métropolitaine, tome 1, Paris, Mouton éditeur, 1974, 568 p.
EDEINE (B.) 1972b - La Sologne. Contribution aux études d’ethnologie métropolitaine, tome 2, Paris, Mouton éditeur, p. 492 p. FEBVRE (L.) 1928 – « Frontière : le mot et la notion », Revue de Synthèse historique, XLV, juin 1928, p. 31-44. FERDIERE (A.) 1988 – Les campagnes en Gaule romaine, Paris, Errance, 2 vol. FERDIERE (A.) 2005 – Les Gaules. IIe siècle av. J.-C. – Ve siècle ap. J.-C., Paris, Armand Colin, 446 p. FICHTL (S.) 2000 – La ville celtique. Les oppida de 150 av. J-C à 15 ap. J.-C., Paris, Errance, 190 p. FILIPPO (R.) (DE) 2012 – Soings-en-Sologne (Loir-et-Cher), « Le Sauveur », rapport de diagnostic, SRA Centre/Inrap, Orléans,
93 p. FLORANCE (E.-C.) 1922-1928 – Archéologie préhistorique, protohistorique et gallo-romaine en Loir-et-Cher, Blois,
imprimerie centrale administrative et commerciale, 409 p. FRENEE (E.), GUIBERT (P.), LADUREAU (P.), MUCH (J.) 1998 - Déviation de Romorantin-Lanthenay de la RD 765 à la RD 922
(Loir-et-Cher), document final de synthèse, 15 p., 11 planches. FRENEE (E.) avec la collab. AUBIER (M.), BAGUENIER (J.-P.), COUBRAY (S.), DAVID (F.), DI NAPOLI (F. ), FOURRE (A.), GUERIT
(M.), LIARD (M.), LUSSON (D.), MERCEY (F. ), POUPON (F.), PRADAT (B.), RIQUIER (S. ), TEXIER (M.), THIERY (G.), TROUBADY (M.), BARAY (L.), BOECKLER (S.) 2008 - A85 Sublaines "Le Grand Ormeau" (Indre-et-Loire), rapport final d'opération de fouille archéologie préventive, 3 vol. [520-566-527 p.], annexes.
FRENEE (E.), GUIOT (T.) 2011 – Sublaines (Indre-et-Loire), Bois Gaulpied et Grand Ormeau, rapport de diagnostic, 173 p., ill., annexes, 1 pl. hors texte.
FROQUET (H.) 2002 – Romorantin-Lantenay (Loir-et-Cher), ZAC Les Grandes Bruyères, Document final de synthèse d’évaluation préventive, SRA Centre/Inrap, Orléans, 22 p., 28 fig., annexes.
FROQUET-UZEL (H.) avec la collab. MILLET (S.), PAILLER (Y.), LANG (L.) 2010 - Déviation de Contres tronçon 3 (Loir-et-Cher), rapport de diagnostic, 80 p., ill., annexes.
FROQUET-UZEL (H.) 2012 – Contres, Loir-et-Cher. Un habitat protohistorique à vocation agro-pastorale, rapport final d’opération, SRA Centre/Inrap, Orléans, ex. multigraph., 148 p.
GALINIE (H.) 1993 – « Les villes et les agglomérations secondaires au bas Moyen Âge : le Loir-et-Cher, XIVe-XVe siècles », In : H. Galinié et M. Royo (dir.), Atlas des villes et des réseaux de villes en région Centre, Tours, Association en région Centre pour l’histoire et l’archéologie.
GALINIE (H.), AUDINET (I.) 1993 – « Les villes, les agglomérations secondaires et les couvents mendiants, XIIIe-XVe siècles », In : H. Galinié et M. Royo (dir.), Atlas des villes et des réseaux de villes en région Centre, Tours, Association en région Centre pour l’histoire et l’archéologie.
GANDINI (C.), LAÜT (L.) 2013 – Regards croisés sur le Berry ancien : sites, réseaux et territoires, 45e Supplément de la RACF, Tours, FERACF, 226 p.
GASCO (J.), DAUVOIS (M.) 2010 – « L’âge du Bronze dans les pays de Loire moyenne. Recension de l’ouvrage de G. Cordier (2009), Revue archéologique de l’Ouest, t. 27, p. 224-229.
GESSAT (R.) 1959 - Les assolements en Sologne depuis cent ans. Annales du comité central agricole de la Sologne, n° 3, p. 66-77.
GOUDINEAU (C.) 2010 – « Comment les Gaules devinrent romaines : aspects méthodologiques », In : P. Ouzoulias et L. Tranoy, Comment les Gaules devinrent romaines, actes du colloque international de Paris (2007), Inrap/La Découverte, p. 11-19.
GRANSAR (M.), FROQUET (H.) 2013 – La Fosse des Roches à Contres (Loir-et-Cher), rapport d’opération de diagnostic, SRA Centre/Inrap, Orléans, ex. multigraph.
GUERIN (I.) 1960 - La vie rurale en Sologne aux XIVe et XVe siècles. École pratique des Hautes études, Centre de recherches historiques, 339 p.
GUILLAUMIN (A.) 1853 - Mémoire à l’appui d’un placet présenté à l’Empereur sur la question d’amélioration et d’assai-nissement de la Sologne. Orléans, imprimerie de Pagnerre, 18 p.
HAMON (T.), IRRIBARRIA (R.), RIALAND (Y.), VERJUX (C.) 1997 – « Le groupe de Chambon en région Centre à la lumière des découvertes récentes », In : C. Constantin, D. Mordant et D. Simonin, La culture de Cerny. nouvelle économie, nouvelle société au Néolithique, Actes du Colloque International de Nemours (9-11 mai 1994), Mémoires du Musée de Préhistoire d’Île-de-France no 6, APRAIF, p. 195-218.
46
HANTAÏ (A.) 1994 – La long Blade Technology sur les bords de la Loire, mémoire de DEA de l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ex. multigraph.
HANTAÏ (A.) 1997 – « Le « Belloisien » jusque sur les bords de la Loire : les gisements du Paléolithique final de Muides-sur-Loire (Loir-et-Cher), Revue archéologique du Centre de la France, t. 36, p. 5-22.
HERVE (C.) 1999 – « Liste des vici, castra, castella cités par Grégoire de Tours en région Centre », In : M.-E. Bellet, C. Cribellier, A. Ferdière et S. Krausz (dir.), Agglomérations secondaires antiques en région Centre, 17e Supplément à la RACF, Tours, p. 219-220.
HEUDE (B.) 2012 - La Sologne. Des moutons, des landes et des hommes (XVIIIe siècle-Second Empire), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 358 p.
HUBERT-FILLAY, RUITTON-DAGET (L.) 1933 - Le parler solognot. Glossaire du Pays de Sologne, Blois, éditions du Jardin de la France, 64 p.
HUSI (P.) 2013 – La céramique du haut Moyen Âge dans le centre-ouest de la France : de la chronologie aux aires culturelles, 49e Supplément à la RACF, Tours, FERACF, 268 p.
INGLEBERT (H.) 2005 – Histoire de la civilisation romaine, Paris, Presses Universitaires de France, 512 p. IRRIBARRIA (R.) 1993 – Les occupations du Paléolithique final, du Néolithique moyen et de l’âge du Bronze à Muides-sur-
Loire, « le Bas du Port-Nord », rapport triannuel d’opération, SRA Centre, Orléans, 190 pages. IRRIBARRIA (R.) 1995 – « Le Néolithique moyen 1 de la Loire moyenne, nouvelles données », In : C. Billard (dir.), Actes du 20e
colloque interrégional sur le Néolithique (Evreux, 1993), 7e Supplément à la Revue Archéologique de l’Ouest, Rennes, p. 65-74.
IRRIBARRIA (R.) 1996 – « Groupe de Chambon et Cerny-sud d’après les fouilles de Muides-sur-Loire », In : P. Duhamel (dir.), La Bourgogne entre les Bassins rhénan, rhodanien et parisien, carrefour ou frontière ? Actes du 18e colloque interrégional sur le Néolithique (Dijon, 25-27 novembre 1991), 14e Supplément à la Revue Archéologique de l’Est et du Centre-Est, Dijon, p. 375-382.
IRRIBARRIA (R.) 1997 – « La néolithisation en région Centre, le site de Muides (Loir-et-Cher) », In : Groupe d’Étude sur le Néolithique Ancien du Centre-Ouest, rapport annuel, Orléans, Service régional de l’archéologie du Centre, p. 7-16.
IRRIBARRIA (R.) 1998 – Contres « Le Château-Gabillon » (Loir-et-Cher), rapport d’opération de diagnostic archéologique, Orléans, Service Régional de l’Archéologie de la Région Centre.
IRRIBARRIA (R.), HAMON (T.), MERCEY (F.), LIARD (M.), DESCHAMPS (S. ) 2008 – Suèvres "Les Sables", Néolithique et Protohistoire, rapport de fouille, 2 vol., 240 p., 103 fig.
IRRIBARRIA (R.) 2014 – Les occupations préhistoriques à Muides-sur-Loire (Bas du Port-Sud), rue de la Croix, rapport de fouille, 180 p., 43 fig.
JACQUES (F.), SCHEID (J.) 2010 – Rome et l’intégration de l’Empire (44 av. J.-C.-260 ap. J.-C.), Paris, PUF, 2 vol. JAN (E.) 2010 – Vienne-en-Val (Loiret) "Le Grand-Montparnasse II", fosse de l'âge du Bronze final Iia, document final de
synthèse de l'opération de sondage, 39 p., ill. JOLY (S.) 2002 – A85, section M2, site 16 : l'établissement antique du "Grand-Saulé" à Gy-en-Sologne (Loir-et-Cher), DFS de
fouille, 36 p., fig., photogr. en coul. JOLY (S.), MORTREAU (J.), DELEMONT (M.), FROQUET-UZEL (H.) 2005 - Contres (Loir-et-Cher). Rue de la Plaine et rue Abel
Poulin, rapport de diagnostic, 29 p., 33 fig.. JOLY (S.) 2007 – Romorantin-Lanthenay et Villefranche-sur-Cher. Saint-Martin et Les-Terres-Fortes, rapport d’opération de
diagnostic archéologique, SRA Centre/Inrap, Tours, 21 p. JORRIS (A.) 1986 – « L’essor du XIIe siècle, 1075-1180 », In : Duby (G.), Histoire de la France des origines à 1348, Paris,
Larousse, p. 323-363. JOSSET (D), AUBOURG-JOSSET (V.) 1996 - Chambord (Loir-et-Cher) "Château", DFS d'opération de surveillance
archéologique, 80 p., 34 fig. JOUANIN (M.) 1992 - Une seigneurie en Haut Berry : la terre de Vèvre du début du XIe à la fin du XIIIe s,. Mémoire de
maîtrise, université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. JOYEUX (P.), MATAOUCHEK (V.) 2003 - Fougères-sur-Bièvre (Loir-et-Cher). Place du Château, rapport de diagnostic, 15 p. 6
fig. JULLIAN (C.) 1907-1926 – Histoire de la Gaule, Paris, Hachette, 8 vol. KILDEA (F.) 2009 – Muides-sur-Loire (Loir-et-Cher). Les vestiges préhistoriques de camps de nomades sur les bords de Loire,
rapport final d’opération, Inrap/SRA Centre, Orléans, ex. multigraph., 97 p. KRAUSZ (S.), avec la collab. COUDERC (A.), DURIEUX (J.-F.), LALLET (C.), MUCH (J.) 1997 - La prospection pédestre sur le
tracé de l'autoroute A 85 Theillay Pruniers-en-Sologne (Loir-et-Cher), document final de synthèse (DFS), 592 p., fig. KRAUSZ (S.) avec la collab. RAYMOND (P.) 1998 - A85 Tours-Vierzon - Section M1- Theillay/Villefranche-sur-Cher, commune
de Mennetou-sur-Cher (Loir-et-Cher). Opération n°1 nécropole tumulaire des Barres, rapport de diagnostic, 133 p., 7 fig. 6 photogr. en coul., 1 pl.
KRAUSZ (S.), MUSCH (J.) 1999 - A85 Tours-Vierzon- Section M1-Theillay/Villefranche-sur-Cher (Loir-et-Cher). Les prospections archéologiques sur la section M1 de l'A85. Phase 2 : la prospection mécanique, du 17 mars au 31 décembre 1998, DFS, 3 vol., vol. 1 : 194 p., 59 fig., vol. 2 : 280 p., vol. 3, 70 plans, 80 coupes, 12 planches.
KRAUSZ (S.) (dir.) 2003 – Les fouilles sur l’autoroute A85, entre Theillay et Saint-Romain-sur-Cher, Catalogue d’exposition, Musée de Sologne, Les Amis du Musée de Sologne, 80 p.
LAHAYE (M.), avec la collab. BOUTONNET (E.), GERMAIN (E.), ANDRE (S.), MOREAU (C.), LEVILLAYER (A.), BORET (B.), SCAON (C.), VORENGER (J.), HARSTER (M.), LERAY (S.), JOLY (C.) 2011 - Contres "La Côte Rôtie", rapport final d'opération, 3 vol. (92-97-237 p.), ill., annexes.
LAMOINE (L.) 2009 – Le pouvoir local en Gaule romaine, Presses universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 468 p. LAMPIN-MAILLET (C.), PEREZ (S.), FERRIER (J.-P.) 2010 – Géographie des interfaces : une nouvelle vision des territoires,
Versailles, éd. Quae, 165 p. LANDREAU (C.), FROQUET (H.), CHAUDRILLER (S.), HOLZEM (N.), LOZAHIC (Y.) 2009 - Contres/Fresnes déviation de Contres
(Loir-et-Cher), rapport de diagnostic, 16 p., ill., annexes.
47
LANG (L.) 1999 – A85- Section M1-Theillay/Villefranche-sur-Cher, Loir-et-Cher - Le site néolithique et protohistorique n° 6 : Châtres-sur-Cher, Les Augeries, DFS de fouille archéologique, 52 p., 67 fig., 11 tabl., 8 pl., photogr. en coul., plan hors texte.
LANG (L.), KILDEA (F.) 2003 – A85 Tours-Vierzon - Section M2 Villefranche-sur-Cher - Saint-Romain-sur-Cher (Loir-et-Cher), commune de Pruniers-en-Sologne "la Marmagne", site 11, rapport d'évaluation archéologique, 23 p., 10 fig.
LANGLAIS (M.) 2010 – Les Sociétés magdaléniennes de l’isthme pyrénéen, Paris, éd. du CTHS, 336 p. LA SAUSSAYE L. (DE) 1844 – Mémoire sur les antiquités de la Sologne blésoise, Blois, 50 p. LE BORGNE (G.) 1854 - Hygiène publique : considérée principalement dans ses sujets les moins abstraits et les plus à la portée
des gens du monde, Paris, V. Masson, 300 p. LE GOFF (J.) 2004 – Un long Moyen Âge, Paris, éd. Taillandier. LE GOFF (J.) 2014 – Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches ?, Paris, éd. Seuil. LE ROUX (P.) 2004 – « La romanisation en question », Annales. Histoire, Sciences sociales, t. 59, p. 287-311. LESBAZEILLES (E.) 1884 - Les forêts, Paris, Hachette, 311 p. LESUEUR (F.) 1969 - Les églises de Loir-et-Cher, Paris, Picard, 517 p. MALRAIN (F.) 2010 – « L’économie agraire en Gaule septentrionale », In : P. Ouzoulias et L. Tranoy, Comment les Gaules
devinrent romaines, actes du colloque international de Paris (2007), Inrap/La Découverte, p. 59-72. MATAOUCHEK (V.), avec la collab. Serre (S.) 2009a - Neuvy-Deux-Clochers (Cher, Centre) - Tour de Vesvre, rapport
préliminaire des surveillances et fouilles archéologiques préventives 2003-2006 (4 volumes), vol. 1 : 258 p., vol. 2 : 77 pl., vol. 3 : 144 p., vol. 4 : annexes.
MATAOUCHEK (V.) 2009b - La plateforme de Neuvy-Deux-Clochers, In : I. Cattedu (dir.), Archéologie médiévale en France, le premier Moyen Âge (Ve-XIe siècles), Paris, La Découverte, p. 44-45.
MATAOUCHEK (V.) 2013 - Naissance et évolution de l’ensemble castral de Vesvre à Neuvy-Deux-Clochers (Cher), rapport d’activité du projet collectif de recherche, 408 p.
MAZEL (F.) 2010 - Féodalités 888-1180. Paris, Belin, 783 p. MENU (M.), BUCHSENSCHUTZ (O.) 2001 – « L’habitat rural à l’âge du Fer », In : C. Batardy, O. Buchsenschutz et F. Dumasy,
Le Berry antique. Milieu, hommes, espaces. Atlas 2000, 21e Supplément à la Revue archéologique du centre de la France, p. 58-59.
MERCEY (F.), avec la collab. LADIRE (D.), JESSET (S.), CANY (D.), POUPON (F.) 2006 - Vienne-en-Val, "La Ferrière" (Loiret), rapport de fouille, 159 p., ill., photogr. en coul..
MELISSINOS, (A.), MARCHANT (P.) 2003 – Étude urbaine et patrimoniale du village de Chambon. 1 dossier 2001/006 - Études diverses, Grahal (Médiathèque de l’architecture et du patrimoine).
METENIER (F.), JESSET (S.) 2006 – « Bilan des connaissances sur l’activité potière médiévale à Jouy-le-Potier (Loiret) », Revue archéologique du Loiret, t. 29, p. 55-74.
MILCENT (P.-Y.) 1995 – « La Sologne entre Bronze et Fer (XIIIe-Ve s. av. J.-C.) », In : H. Delétang, Bulletin du Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne, vol. 17, 3, p. 45-73.
MILCENT (P.-Y.) 2004 – Le Premier âge du Fer en France centrale, Mémoires de la Société préhistorique française, 2 vol., 718 p.
MILCENT (P.-Y.) 2007 – Bourges-Avaricum : un centre proto-urbain celtique du Ve siècle av. J.-C. Les fouilles du quartier Saint-Martin-des-Champs et les découvertes des établissements militaires, Bituriga, Bourges, 176 p.
MONIN (E.) 1887 - La prévention des fièvres en Sologne, esquisse d'hygiène pratique, Paris, bureau de la Société, 15 p. MUNOZ (M.) en cours – Lassay-sur-Croisne, « Le Bourg », un site fossoyé médiéval en Sologne, rapport de fouille
archéologique préventive, SRA Centre/Inrap. MUSCH (J.), avec la collab. HERMENT (H.) 1998 - A85 Tours-Vierzon, section M1, Theillay/Villefranche-sur-Cher, commune de
Villefranche-sur-Cher (Loir-et-Cher), opération n° 8, Les Fontaines-la Gouabinière, rapport d'évaluation, 61 p. , ill., 2 pl. hors texte.
NOËL (M.) 2005 – Vienne-en-Val (Loiret). ZAC de la Bergeresse et Pièce de Saint-Germain, chemin du Paradis et route de Tigy ; ZAC de la Ferrière, rue de la Ferrière et chemin du Paradis, rapport de diagnostic, 95 p., 40 fig., photogr. coul.
OLIVEAU (B). 2001a - A85 Tours-Vierzon, section M2. L'établissement antique du "Grand Saulé" à Gy-en-Sologne (L.-et-C.). Site 16, DFS de fouille d'évaluation, non pag., 13 fig., photogr. en coul.
OLIVEAU (B.) 2001b - A85 Tours-Vierzon, section M2. L'établissement médiéval de "la Gastière" à Pruniers-en-Sologne (L.-et-C.). Site 15, DFS de fouille d'évaluation, non pag., 14 fig., photogr. en coul.
OUZOULIAS (P.) 2010 – « L’agriculture gallo-romaine : quelle place pour la villa ? », In : P. Ouzoulias et L. Tranoy, Comment les Gaules devinrent romaines, actes du colloque international de Paris (2007), Inrap/La Découverte, p.189-211.
PALLU DE LESSERT (M.-P.) 1996 – Neung-sur-Beuvron, "Le Bourg neuf, les Bruyères" (Loir-et-Cher), DFS de sondage, 30 p., 16 fig.
PERICART (J.), BOUISSIERE (A.) 2013 – « L’expansion chrétienne de l’Antiquité tardive au haut Moyen Âge », In : C. Gandini et L. Laüt, Regards croisés sur le Berry ancien : sites, réseaux et territoires, 45e Supplément de la RACF, Tours, FERACF, p. 213-238.
PORCELL (F.) 2006 avec la collab. FROQUET (H.), BINEAU (J.- M.).- Contres (Loir-et-Cher) "Chemin des Aulnes", rapport de diagnostic, 11 p., 15 fig., photogr. en coul.
PHALIP (B.) 2002 – Marges et marches médiévales, Siècles, Cahiers du CHEC, Clermont-Ferrand. PIERRAT 2010 – « La céramique du site néolithique de Contres, « Château Gabillon » (Loir-et-Cher) au sein de la Culture de
Chambon », Revue archéologique du Centre de la France, t. 49, article en ligne : http://racf.revues.org/1436. POITOU (C.) 1985 - Paysans de Sologne dans la France ancienne. La vie des campagnes solognotes, Le Coteau, Horvath, 272
p. POITOU (C.) 2002 - Paroisses et communes de France. Loir-et-Cher, Paris, CNRS éditions, 591 p. (collection dir : J.-P. Bardet
et C. Motte). POULAIN (P.) en cours – Saint-Laurent-Nouan, « Ganay », une dépendance prieurale à la fin du Moyen Âge et à la Période
moderne, rapport de fouille archéologique préventive, SRA Centre/Evéha. POULLE (P.) 2002 – Romorantin-Lanthenay ( L.-et-C.) Matra automobile ZAC les Marnières de Plaisance, rapport de fouille
préventive, 8 fig. ; photogr. en coul ; 9.
48
PROST (B.) 2004 – « Marge et dynamique territoriale », Géocarrefour, vol. 79/2, p. 175-182. PROVOST (B.) 1988 – Carte archéologique de la Gaule. Le Loir-et-Cher, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
159 p. RANGER (O.) 1998 – A85 Tours-Vierzon- Section M1- Theillay/Villefranche-sur-Cher. Opération n°6 - Site n°41, Les Augeries,
rapport de fouille d'évaluation archéologique commune de Châtres-sur-Cher (Loir-et-Cher), 17 p. ; 42 fig. ; 4 pl. ; photogr. en coul.
RAUX (S.) 2002 – Romorantin (L.-et-C.), ZAC les Grandes Bruyères, rapport de fouille, N. P., 22 fig., photogr. en coul. RAUX (S.), TRICOIRE (J.) 2001 – Monthou-sur-Bièvre, « Le Chêne Vert », rapport d'opération de fouille préventive. Canalisation
de transport de gaz "artère du Centre". Section Chouzy-sur-Cisse-Chémery (Loir-et-Cher), 23 p., 34 fig. ROBREAU (B.) 2012 – « Territoires et frontières des cités antiques de la région Centre », In : C. Cribellier et A. Ferdière,
Agglomérations secondaires antiques en région Centre, Actes de la table ronde d’Orléans, vol. 2, 42e Supplément à la RACF, Tours, FERACF, p. 49-58.
ROY (G.) en cours – Saint-Gervais-la-Forêt, « Le Tertre », un habitat carolingien dans le val de Blois, rapport de fouille archéologique préventive, SRA Centre/Inrap.
RUELLEU (S.) 2014 - Cartographie géophysique. Site de Chambord, parterres Nord et Est (Loir-et-Cher). Géocarta, 40 p., 3 annexes.
RUFFIER DES AIMES (O.) 1995 – « Le Cimetière romain de Soings-en-Sologne : inventaire de la collection Henry-Ageorges au musée de Blois », In : H. Delétang, Bulletin du Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne, vol. 17, 3, p. 95-113.
SALANOVA (L.) 1999 – A85 Tours-Vierzon. Le monument nº 1 de la nécropole tumulaire des Barres à Mennetou-sur-Cher, Document final de synthèse de fouille préventive, SRA Centre/Afan, Orléans, 127 p.
SALE (P.) 1999 – Canalisation de transport de gaz Artère du Centre, section Chémery (Loir-et-Cher) – Roussines (Indre), rapport de fouille d’évaluation préventive, SRA Centre/Afan, Orléans, 2 vol.
SALE (P.), FOURNIER (L.), avec la collab. BLANCHARD (P.) 2004 - Saint-Romain-sur-Cher, "les Cormins". Autoroute A85 - Sites 25 et 26, rapport de fouille archéologique, 3 vol., vol. 1 : 287 p., 287 fig., vol.2 : 209 p., 439 fig., vol.3 : 240 p.
SALE (P.) 2014 – « Un terroir réputé inhospitalier. Les occupations de la Sologne, du Paléolithique au XIXe s. », Archéopages, t. 38, p. 6-13.
SALE (P.), BECK (G.) 1998 - Romorantin, la place de la Paix, rapport de fouille d’évaluation préventive, 21 p., 9 fig. SALE (P.), GRANSAR (M.), GAY (J.-P.) à paraître – « Un établissement rural à enclos fossoyé de La Tène C2/D1 en Val de
Loire : le site du Vivier à Saint-Laurent-Nouan (Loir-et-Cher) », Revue archéologique du centre de la France. SOURIS (L.) (DE), LAURENT (A.), HAMEL (A.), JAUDON (A.) 2009 - Vienne-en-Val, "Les Terres de Saint-Germain" (Loiret),
rapport de diagnostic, 106 p., ill., annexes. SOURIS (L.) (DE), avec la collab. LAURENT (A.), HAMEL (A.), JAN (S.), LEJAULT (C.), LABILLE (M.), MAZEAU (Y.) 2010. -
Vienne-en-Val, "Les Terres de Saint-Germain (Loiret – Centre), rapport de diagnostic, 184 p., 83 fig., annexes. SURMELY (F.), BOUDON (P.), BRIOT (D.), PIN (C.) 2008 – « La diffusion des silex crétacés dans le centre du Massif central
durant la Préhistoire (Paléolithique, Mésolithique, Néolithique). Contribution à l’étude des circulations des matières premières sur de longues distances », Paléo, n° 20, p. 115-144.
TALIN D’EYZAC (S.), avec la collab. BECQ (G.) 1999 - A85 Tours-Vierzon-Section M1-Theillay/Villefranche-sur-Cher, Loir-et-Cher - Le site antique et médiéval des Petits-Bois à Theillay (Loir-et-Cher) - Site 9. DFS de fouille d'évaluation, 1999, 16 p., 9 fig., photogr. en coul..
TREMENT (F.) 2010 – « Romanisation et développement dans les campagnes de Gaule », In : P. Ouzoulias et L. Tranoy, Comment les Gaules devinrent romaines, actes du colloque international de Paris (2007), Inrap/La Découverte, p. 159-176.
TREMENT (F.) (dir.) 2013 – Les Arvernes et leurs voisins du Massif central à l’époque romaine : une archéologie du développement des territoires, Presses universitaires Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, 2 vol.
TROTIGNON (F.) 2006 – Les Perreaux, commune de Méry-ès-Bois (Cher), rapport de sondage programmé, septembre 2006, 2006, 15 p., ill.
TURNER (F. J.) 1893 – « The Significance of the Frontier in American History », Report of the American Historical Association, p. 199-227.
VALENTIN (B.) 1995 – Les groupes humains et leurs traditions au Tardiglaciaire dans le Bassin parisien, thèse de doctorat de l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 3 vol., dactyl.
VALENTIN (B.) 2008 – De l’Oise à la Vienne, en passant par le Jourdain. Jalons pour une Paléohistoire des derniers chasseurs (XIVe-VIe millénaire av. J-C), Paris, Publications de la Sorbonne, 325 p.
VASSORT (J.) 2012 - Les châteaux de la Loire au fil des siècles. Paris, Perrin, 379 p. VATAN (A.), avec la collab. AUGIER (L.), HAMON (T.), MUSCH (J.) 2002 - A85, section M2, site 21 : "Étang de Rontigny" à
Méhers (Loir-et-Cher). DFS de fouille, 117 p., 45 pl., photogr. en coul. VERJUX (C.) 1998 – « Des bâtiments circulaires du Néolithique moyen à Auneau (Eure-et-Loir) et Orval (Cher). Note
préliminaire », Revue archéologique du Centre de la France, t. 37, p.179-190. VERJUX (C.) SOUFFI (B.), RONCIN (O.), LANG (L.), KILDEA (F.), DESCHAMPS (S.), CHAMAUX (G.) 2013 – « Le Mésoli-thique
en région Centre : un état des recherches », In : B. Valentin, B. Souffi, T. Ducrocq, J.-P. Fagnart, F. Séara et C. Verjux (dir.), Palethnographie du Mésolithique. Recherches sur les habitats de plein air entre Loire et Neckar, Actes de la Table ronde internationale de Paris (2010), Mémoire de la Société préhistorique française, p. 69-90.
VEYNE (P.) 2000 – « La "plèbe moyenne" sous le Haut-Empire romain », Annales. Histoire, Sciences sociales, t. 55, p. 1169-1199.
VIEILLARD-TROIEKOUROFF (M.) 1976 – Les monuments religieux de la Gaule d’après les œuvres de Grégoire de Tours, Paris, Champion, 491 p.