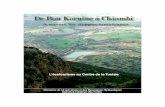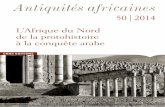Etude epidémiologique et pathologique des abcés chez les ovins dans la région de l'oriental au...
Transcript of Etude epidémiologique et pathologique des abcés chez les ovins dans la région de l'oriental au...
I
ROYAUME DU MAROC
INSTITUT AGRONOMIQUE ET VETERINAIRE HASSAN II
RABAT
THESE
POUR L’OBTENTION DU DOCTORAT VETERINAIRE
Présentée et soutenue publiquement par :
Mr : MECHAAL ABDELFATTAH
Devant le jury composé de:
Président : Pr. BERRADA J. (I.A.V. HASSAN II)
Examinateur : Pr. BENAZZI S. (I.A.V. HASSAN II)
Examinateur : Dr. BERRICHI N. (Vétérinaire sanitaire, Oujda)
Rapporteur : Pr. KICHOU F. (I.A.V. HASSAN II)
Rapporteur : Pr. BOUSLIKHANE M. (I.A.V. HASSAN II)
Septembre 2005 -
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II-B.P.6202- Instituts, 10 101 Rabat
Tél. : (037) 77 17 58/59/45 ou 77 07 92, Fax : (037) 77 81 35 ou 77 58 38
ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE ET PATHOLOGIQUE DES ABCES CHEZ LES OVINS DANS LA REGION
DE L’ORIENTAL
II
DEDICACE
Je dédie ce travail :
A ma chère mèreA ma chère mèreA ma chère mèreA ma chère mère
A la mémoire de mon cher pèreA la mémoire de mon cher pèreA la mémoire de mon cher pèreA la mémoire de mon cher père
Pour leur amour, leurs innombrables concessions…. Qu’ils trouvent dans ces quelques pages une juste récompense à leurs
efforts et le fruit de ma profonde affection.
A mesA mesA mesA mes très cher très cher très cher très cherssss frère frère frère frèressss Omar et Omar et Omar et Omar et Mohammed.Mohammed.Mohammed.Mohammed.
A mes A mes A mes A mes très chères très chères très chères très chères sœurssœurssœurssœurs Fatima et Hajiba Fatima et Hajiba Fatima et Hajiba Fatima et Hajiba....
A mA mA mA maaaa famille á Rabat,famille á Rabat,famille á Rabat,famille á Rabat,
A toute ma A toute ma A toute ma A toute ma grande grande grande grande famillefamillefamillefamille….
A tous mes amisA tous mes amisA tous mes amisA tous mes amis et amies à l’école, au collège, au lycée et à l’IAV et amies à l’école, au collège, au lycée et à l’IAV et amies à l’école, au collège, au lycée et à l’IAV et amies à l’école, au collège, au lycée et à l’IAV
Hassan II.Hassan II.Hassan II.Hassan II.
ÀÀÀÀ :::: Lhouss Mohamed, Oubennaceur Tarik, Elbouamri Mounir, El
hayany Nourredine, Sabir Rachid, Foughali Youssef, Oumahmoud
Mohamed, Marrakh Hicham, Belamri Mostapha, Ouardi Jaouad,
Hardal Nourredine, Tabit Hakim, Zaazaoui Ahmed, Mimouni Aimad,
Belfalah Khalid, Sbihi Youssef , Imassi Ali, Kassraui Aziz,….
III
REMERCIEMENTS
Au terme de ce travail il m’est agréable d’exprimer ma haute gratitude et ma sincère
reconnaissance á l’égard de mes encadrants Pr. KICHOU F. et Pr. BOUSLIKHANE
M. pour l´intérêt qu´ils ont accordé á ce travail avec un esprit instructif. Je tiens á les
remercier pour leur encadrement exemplaire, pour leurs précieux conseils et pour
m’avoir donné l’occasion de bénéficier de leurs compétences.
Monsieur le Pr. BERRADA J. qui a accepté de présider le comité de jury. Qu’il me
soit permis de vous témoigner ma très haute considération et ma profonde gratitude
pour l’honneur que vous m’avez accordé en acceptant de jurer ce travail.
Ma gratitude et mon respect vont encore au docteur N. BERRICHI pour son soutien et
ses conseils professionnels.
Ma reconnaissance va également au Pr. BENAZZI S. qui a accepté de bien vouloir
juger ce travail. Qu’elle accepte l’expression de ma sincère reconnaissance et mon
respect.
Je remercie sincèrement monsieur le Dr. HALOTE I. du service vétérinaire de Oujda,
pour son appui à la réalisation des enquêtes lésionnelles. Mes hommages respectueux.
Je remercie vivement les techniciens de l’association nationale des ovins et des caprins
de Ain Beni Mathar (ANOC), et particulièrement á Mr. BEN AICHA M. pour ses
qualités humaines et sa disponibilité et lui exprime mes vifs
remerciements.
Mes remerciements et mes sentiments respectueux sont adressés à la Direction
Provincial de l’Agriculture pour son aide.
IV
Je remercie vivement les Techniciens du Département d’Histologie et de l’anatomo-
pathologie pour les efforts déployés et l’intérêt porté au présent travail.
Je remercie enfin tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, m’ont aidé à mener à
bien ce travail.
V
RESUME
L’étude réalisée dans la région de l’oriental avait pour objectifs de déterminer la
prévalence de la maladie des abcès, de ressortir ses caractéristiques épidémiologiques
et pathologiques chez les ovins de la région et d’orienter le diagnostic étiologique.
Pour cela, des enquêtes dans les élevages ovins intéressant différentes zones de la
région ont été effectuées durant la période d’Avril à Juillet 2005. Ces enquêtes ont
porté sur 6368 animaux répartis sur 107 élevages. De même, cinq abattoirs de la
région ont été sujets à des enquêtes lésionnelles et à une récolte de prélèvements de
ganglions et d’abcès en vue de leur examen histopathologique.
Les résultats obtenus montrent qu’environ 100% des élevages sont affectés par
cette pathologie. La prévalence moyenne des abcès a été de 27,75% dans les élevages
et de 15,93% au niveau des abattoirs. L’hygiène défectueuse, le confinement des
animaux dans des locaux étroits, en plus d’un équipement traumatisant (les
mangeoires, les abreuvoirs et la clôture) semblent constituer les principaux facteurs
favorisants la dissémination des abcès entre les animaux d’un même troupeau. Les
abcès superficiels ouverts ou non avec l’ hypertrophie ganglionnaire satellite sont des
lésions quasiment constantes chez tous les animaux atteints mais dont la localisation
est variable, même si la plupart se situent au niveau de la tête et de l’encolure avec une
fréquence de 79%.
L’examen histopathologique des ganglions a révélé deux types de lésions, des
lésions d’abcès évolutifs classiques (86,7%) et des lésions de nécrose et de
suppuration diffuse et sévère du tissu lymphoïde (13,3%). Au niveau des poumons
examinés la plupart des abcès étant bien délimités et circonscrits. Etant donnés ces
aspects lésionnels, Corynebacterium pseudotuberculosis et Staphylococcus aureus
subsp anaerobius pourraient être retenus comme les principales causes possibles de
l’apparition de ces abcès chez les ovins dans la région de l’oriental.
Mots clés : Ovins, Abcès, clinique, épidémiologie, pathologie, histopathologie.
VI
ABSTRACT
The aim of this study carried out in the Eastern area of Morocco (Oujda) was to
determine the prevalence of disease and their epidemiological and pathological
features in sheep and to direct the etiologic diagnosis. To do so, field investigations
were carried out in sheep flocks from different zones of the study area during the
period of April-July 2005. They included 6368 sheep distributed over 107 flocks.
Furthermore, in five slaughter-houses of the study area, sheep carcasses were
inspected and subjected to abscess harvest for histopathological examination.
The results showed that approximately 100% of investigated flocks were affected
by this pathological process. The mean prevalence of abscesses within flocks was
27.75% and 15.93% within the slaughter-houses. Defective hygiene and confinement
of animals, in addition to traumatizing equipment (metallic feeders, drinkers, and
fences) seem to constitute the major predisposing factors for the dissemination of
abscesses among animals and flocks. Superficial abscesses (opened or not) with loco-
regional hypertrophic lymphadenitis are the constant pathological changes in all
examined animals with a variable localization even that most cases were located in the
head and neck area with a frequency of 79%.
Histopathological findings revealed two types of lymph node lesions, classical
abscesses (86.7%) and lesions of diffuse and severe necrosis and suppuration of the
lymphoid tissue (13.3%). In the lungs, the majority of abscesses were well delimited
and circumscribed. According to this pathological features, Corynebacterium
pseudotuberculosis and S taphylococcus aureus subsp anaerobius may be
considered as the main possible causes of the appearance abscesses in Moroccan
sheep.
Key words: Sheep, Abscess, clinical, epidemiology, pathology, histopathology
VII
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE .....................................................................14 REVUE BIBLIOGRAPHIQUE……………………………………………….2 I. DEFINITION .................................................................................................16 II. SYNONYMES ..............................................................................................17 III. HISTORIQUE ............................................................................................17 IV. REPARTITION MONDIALE ET PREVALENCE : .......... ..................18 V. IMPORTANCE ............................................................................................21
1. Importance économique ................................................................................................... 21 2. L’importance hygiénique ................................................................................................. 22
VI. ETIOLOGIE ...............................................................................................23 1. Dénominations ................................................................................................................. 24 2. Systématique .................................................................................................................... 24 3. Caractères bactériologiques.............................................................................................. 24 4. Les caractères biochimiques............................................................................................. 25 5. Caractéristiques culturales................................................................................................ 25 6. Pouvoir pathogène............................................................................................................ 25
6.1. Lipide pariétal ...................................................................................................... 26 6.2. Phospholipase D........................................................................................................ 26
7. Réaction immunitaire ................................................................................................... 27 VII. PHYSIOPATHOGENIE ..........................................................................27 VIII. EPIDEMIOLOGIE..................................................................................32
1.1. Sources de germes et matières virulentes.................................................................. 32 1.2. Modalités de la transmission et voie de pénétration ................................................. 33 1.3. Réceptivité................................................................................................................. 35
1.3.1. Facteurs intrinsèques ......................................................................................... 35 a. Espèce................................................................................................................... 35 b. Sexe ...................................................................................................................... 35 c. Age ....................................................................................................................... 35 d. Race...................................................................................................................... 36 e. Saison ................................................................................................................... 36
1.3.2. Facteurs extrinsèques ......................................................................................... 37 a.. Nature du sol et alimentation............................................................................... 37 b. Modes d’élevage .................................................................................................. 37
IX. SYMPTOMES ET EVOLUTION............................................................38 4. Forme mammaire ............................................................................................................. 42 5. Forme articulaire .............................................................................................................. 42 6. Forme septicémique ......................................................................................................... 43 7. Forme de myélite ascendante ........................................................................................... 43
X. DIAGNOSTIC ..............................................................................................43 1. Clinique ............................................................................................................................ 43 2. Epidémiologie .................................................................................................................. 44
VIII
3. Nécropsique...................................................................................................................... 44 4. Diagnostic différentiel...................................................................................................... 47 5. Diagnostic expérimental................................................................................................... 47
5.1. Bactériologie ............................................................................................................. 47 5.1.1. Prélèvement....................................................................................................... 47 5.1.2. Envoi .................................................................................................................. 48 5.1.3. Méthode.............................................................................................................. 48 5.2. Sérologie : ............................................................................................................. 49
XI. TRAITEMENT ...........................................................................................50 XII. PROPHYLAXIE .......................................................................................51
1. Prophylaxie sanitaire .................................................................................................... 51 1.1. Locaux....................................................................................................................... 51 1.2. Elevage ...................................................................................................................... 52 1.3. Manipulations............................................................................................................ 52
2. Prophylaxie médicale ....................................................................................................... 53 MATERIEL ET METHODES.........................................................................56 I. Choix de la région ..........................................................................................56 II. Monographie de la région............................................................................57
1. Situation géographique..................................................................................................... 57 2. Superficie ......................................................................................................................... 57 3. Altitude et morphologie du territoire ............................................................................... 57 4. Climat ............................................................................................................................... 58 5. Ressources du territoire.................................................................................................... 59
5.1. Ressources naturelles ................................................................................................ 59 5.2. L’eau, une denrée rare dans la région ....................................................................... 60 5.3 Patrimoine d’hydrologie, bois et forêts, flore et faune............................................... 60 5.4. La surface arable irriguée.......................................................................................... 61 5.5. Elevage ...................................................................................................................... 61
6. Association Nationale Ovine et Caprine (ANOC) dans la région orientale..................... 62 III. Enquêtes au niveau des élevages ovins .....................................................62
1. Choix des élevages ........................................................................................................... 63 2. Enquêtes et examen clinique du troupeau ........................................................................ 63
IV. Enquêtes et collecte des prélèvements au niveau des abattoirs..............63 1. Choix des abattoirs ........................................................................................................... 63 2. Enquêtes et recherche des abcès sur les carcasses ........................................................... 64 3. Prélèvements .................................................................................................................... 65
V. Examen histopathologique...........................................................................65 1. Préparation des coupes ..................................................................................................... 65 2. Lecture des coupes et description lésionnelle .................................................................. 67
VI Analyse des données : ..................................................................................67 RESULTATS .....................................................................................................68 I. Présentation des élevages enquêtés ..............................................................68
1. Distribution des élevages enquêtes ................................................................................ 68 2. Conduite des élevages ...................................................................................................... 70
IX
2.1. Mode d’élevage ......................................................................................................... 70 2.2. Hébergement ............................................................................................................. 71 2.3. Races exploitées ........................................................................................................ 72 2.4. Type de production.................................................................................................... 73 2.5. Tonte.......................................................................................................................... 73 2.6. Conduite alimentaire ................................................................................................. 74 2.7. Reproduction ............................................................................................................. 75 2.8. Hygiène et prophylaxie ............................................................................................. 76
3. Historique de la maladie des abcès ................................................................................. 76 II. Prévalences de la maladie des abcès dans les élevages .............................78
1. Prévalence dans les élevages enquêtés............................................................................ 78 4. Localisation et distribution des lésions ........................................................................... 79 5 Analyse des facteurs de risque de la maladie des abcès.................................................... 81
III. Résultats des enquêtes au niveau des abattoirs ......................................83 1. Effectif abattu et leurs caractéristiques ............................................................................ 83 2. Caractéristiques des animaux abattus.............................................................................. 83 3. Prévalence des abcès ....................................................................................................... 85
3.1. Prévalence globale au niveau des abattoirs ............................................................... 85 3.2. Prévalence globale chez les animaux examinés........................................................ 86 3.3. Prévalence par classe d’âge....................................................................................... 86 3.4. Prévalence par sexe ................................................................................................... 87
4. Nature et localisation des lésions observées ................................................................... 87 IV. Caractéristiques lésionnelles microscopiques des abcès ganglionnaires et pulmonaires....................................................................................................92
1. Lésions des ganglions....................................................................................................... 92 2. Lésions pulmonaires......................................................................................................... 97
DISCUSSION...................................................................................................102 CONCLUSIONS..............................................................................................107 RECOMMANDATIONS................................................................................108
X
Liste des tableaux
Tableau 1: Séroprévalence de la lymphadénite caséeuse dans différent pays [78] :................ 20
Tableau 2: La fréquence de l’infection par C. pseudotuberculosis dans les pays à haute
production ovine et caprine [78] .............................................................................................. 20
Tableau 3: Effet de l’intervalle entre la tonte et les bains parasitaires sur la prévalence de la
lymphadénite caséeuse [82]. .................................................................................................... 37
Tableau 4: Techniques utilisés pour le diagnostic de la lymphadenite caséeuse[79]. ............. 49
Tableau 5: la prévalence de la lymphadénite caséeuse associée à l’utilisation de différents
programmes de vaccination [81]. ............................................................................................. 54
Tableau 6: Données climatiques de quelques station de l’Oriental ......................................... 59
Tableau 7: Effectifs du cheptel selon les provinces (Annexe : 2)............................................ 62
Tableau 9: Distribution par province des abattoirs concernés par l'enquête: ...........................64
Tableau 10: nombre de visites par abattoirs enquétés.............................................................. 65
Tableau 11: Distribution par province des effectifs enquêtés .................................................. 69
Tableau 12: les systèmes d'élevages prédominant dans la région d'étude ............................... 70
Tableau 13: Fréquence des élevages selon la densité.............................................................. 71
Tableau 14: Nature des équipements dans les élevages........................................................... 71
Tableau 15: Le sexe ratio dans les élevages enquêtés.............................................................. 75
Tableau 16: Mesures d’hygiène et de prophylaxie dans les élevages enquêtés ....................... 76
Tableau 17: Prévalences moyennes et globales des abcès à l’intérieur des élevages .............. 78
Tableau 18: Prévalence de la lymphadénite caséeuse par catégorie d’age. ............................. 79
Tableau 19: Résultats de l’analyse statistique des facteurs de risque des abcès dans les
élevages enquêtés : ................................................................................................................... 82
Tableau 20: Effectifs abattus par abattoir et par sexe dans les provinces d’Oujda, Jerrada et
Taourirt..................................................................................................................................... 83
Tableau 21: Prévalence moyenne de la maladie au niveau des abattoirs................................. 85
Tableau 22: Prévalence moyenne de la maladie chez les animaux examinés.......................... 86
Tableau 23: Prévalence moyenne de la maladie par classe d’age............................................ 86
Tableau 24: Prévalence moyenne de la maladie par sexe ........................................................ 87
XI
Listes des figures
Figure 1: La localisation des nœuds lymphatiques superficiels ............................................... 28
Figure 2: Detail d’un granulome de la lymphadenite caséeuse :.............................................. 29
Figure 3: La physiopathogénie de la lymphadénite caséeuse .................................................. 31
Figure 4: mode de contamination et facteurs de réceptivité [21] :........................................... 34
Figure 5: La prévalence de la lymphadénite caséeuse selon l’âge [52]. .................................. 36
Figure 6: Une brebis présentant de plusieurs abcès cutanés[85].............................................. 39
Figure 7: Hypertrophie des ganglions mandibulaire chez une brebis[85]. .............................. 40
Figure 8 : La pseudotuberculose pulmonaire chez une brebis : Des nodules pulmonaires
multiples [85]. .......................................................................................................................... 41
Figure 9 : Respiration buccale d’un ovin atteint d’une pneumonie de la pseudotuberculose
« syndrome de pneumonie chronique » [85]............................................................................ 41
Figure 10: Une brebis atteint par « le syndrome de la brebis maigre » [85]. ..........................42
Figure 11: Ganglion inguinale affecté par LC chez une brebis souffrant ................................42
Figure 12: Abcès au niveau de l’articulation metacarpienne chez un ovin [85]. ..................... 43
Figure 13: Image d’un nodule lymphatique en aspect ............................................................. 45
Figure 14: Poumon d’ovins abattus présentant une abcèdation ............................................... 45
Figure 15: un grand abcès au niveau de le foie d’un caprin [85]. ............................................ 46
Figure 16: Granulome de la pseudotuberculose a niveau du poumon d’un ovin..................... 46
Figure 17 :Centre d’un abcès de LC presentant un magma caséo-nécrotique [85].................. 47
Figure 18: cartographie de la région d’Oujda (Source : Délégation Régionale de l'Oriental de
la Prévision Economique et du Plan). ...................................................................................... 58
Figure 19: Répartition selon la taille du troupeau .................................................................... 69
Figure 20: Répartition selon les provinces enquêtées .............................................................. 70
Figure 21: Mangeoires métallique utilisés dans un élevage ovin............................................. 72
Figure 22: Répartition des animaux enquêtés selon la race ..................................................... 73
Figure 23: Type d’ouvrier responsable de la tonte................................................................... 74
Figure 24: Traitements couramment utilisés par les éleveurs pour lutter ................................ 77
Figure 26: Une brebis de race Beni Guil présentant un abcès au niveau du ganglion
mandibulaire qui laisse couler un pus épais de couleur blanchâtre à verdâtre......................... 80
Figure 27 Une brebis de race Ouelad Jellal présentant ............................................................ 80
XII
Figure 28: Une brebis de race Beni Guil présentant une hypertrophie très marquée au niveau
des ganglions parotidien et du ganglion sous maxillaire.......................................................... 81
Figure 29: Répartition des animaux abattus en fonction du sexe............................................. 84
Figure 30: Répartition des animaux abattus en fonction de la classe d'âge .............................84
Figure 31: Abcès du ganglion poplité d’une carcasse............................................................. 88
Figure 32: Abcès du ganglion poplité d’une carcasse inspectée............................................. 88
Figure 33: Abcès au niveau des ganglions mediastinaux présentant ....................................... 89
Figure 34: Fréquence des associations des lésions internes et superficielles........................... 89
Figure 35: Localisation des lésions de la lymphadénite caséeuse............................................ 90
Figure 36: Abcès multiples au niveau du parenchyme ............................................................ 91
Figure 37: Abcès des ganglions mediastinaux et du poumon .................................................. 91
Figure 38: Ganglion parotidien d'un agneau – Abcès avec une coque fibreuse s’étendant au
reste su parenchyme ganglionnaire (grande flèche), zone cellulaire très réduite (petite flèche)
et centre caséo-calcaire (A). X4, H&E..................................................................................... 94
Figure 39: Centre caséeux d’abcès ganglionnaire constitué de débris nécrotiques (A), de
polynucléaires neutrophiles (petite flèche), de fibrine (B) et de précipitation de calcium
(grande flèche). X40, H&E. ..................................................................................................... 94
Figure 40: Centre caséeux d’abcès ganglionnaire constitué de débris nécrotiques de
polynucléaires neutrophiles, de fibrine (petite flèche) et de précipitation de calcium (grande
flèche). X10, H&E. .................................................................................................................. 95
Figure 41: Ganglion parotidien – Destruction massive du parenchyme lymphoïde avec fibrose
diffuse et sévère (A) emprisonnant les quelques vestiges de follicules lymphoïdes en cours de
suppuration (B). X16, H&........................................................................................................ 95
Figure 42: Ganglion mandibullaire – Abcès (A) avec nécrose du parenchyme lymphoïde
avoisinant (B). X16, H&E........................................................................................................ 96
Figure 43: Ganglion - Suppuration et nécrose diffuse et très sévère du tissu lymphoïde
folliculaire (A) et parafolliculaire (B). X10, H&E................................................................... 96
Figure 44: Poumon d'une brebis - abcès multiple avec coque fibreuse (A) et centre caséeux à
aspect en oignon caractéristique de la lymphadénite caséeuse (B). X4, H&E......................... 98
Figure 45: Poumon de brebis - un grand abcès pulmonaire avec un Centre caseo-nécrotique
occupant la majorité de l'abcès (A), une couche lympho-plasmocytaire et de macrophage (B),
le tout entouré d’une coque de fibrose (C) délimitant le processus de suppuration. X4, H&E.
.................................................................................................................................................. 98
Figure 46: Centre d’abcès pulmonaire constitué de plusieurs couches ou lamelles caseo-
XIII
nécrotiques. X10, H&E. ........................................................................................................... 99
Figure 47: Deux petits abcès confluents dans le poumon d'une brebis. X10, H&E. ............... 99
Figure 48: Poumon de brebis - Paroi d’un grand abcès - Un tissu de fibrose (A) alterné avec
de la nécrose et de suppuration (B) et une couche macrophages, lymphocytes et
plasmocytes(C). X10, H&E. .................................................................................................. 100
Figure 49: Poumon de brebis - Fibrose pulmonaire interstitielle localisée au pourtour d’une
coque d’abcès (petite flèche) X10, H&E. .............................................................................. 100
Figure 50: Poumon – Suppuration et fibrose péribronchiolaire (grande flèche) et inter-
alvéolaire (petite flèche) X16, H&E. ..................................................................................... 101
14
INTRODUCTION GENERALE
La lymphadénite caséeuse des ovins ou « maladie des abcès » a été décrite dans
tous les pays où l'élevage ovin est important et dont le mode d’élevage est
essentiellement extensif [82]. Elle est due à Corynebacterium pseudotuberculosis, bacille
à Gram positif, immobile et aéro-anaérobie. Chez les ovins, la maladie se caractérise par
la formation de pyogranulomes (abcès granulomateux) localisés principalement dans les
nœuds lymphatiques superficiels (nœuds lymphatiques parotidien, mandibulaire,
rétropharyngien, précapsulaire, préfémoral, poplité, rétromammaire), dans les nœuds
lymphatiques profonds et dans les poumons. Plus rarement, d'autres localisations sont
observées : foie, reins, cœur, scrotum et mamelle. .
Une contamination précoce des jeunes animaux par les mères conduit à des lésions de
petite taille et pouvant passer inaperçues. Ces lésions évoluent lentement et une
expression clinique manifeste n'est observée que chez les adultes (animaux âgés de plus
d'un an) à la suite de réinfections ou de réactivations qui provoquent un état
d'hypersensibilité de type IV. Aussi, le pourcentage d'animaux porteurs d'abcès de
grande taille augmente avec l'âge [56 ; 59].
L’importance de la maladie tient aux pertes économiques qu’elle engendre. La
présence d'abcès superficiels altère la qualité et la valeur commerciale des animaux alors
que la présence d'abcès profonds et d'abcès pulmonaires est associée à un
amaigrissement progressif. Les pertes économiques sont représentées par la diminution
de la production (viande, laine et lait), de l’efficience de reproduction, de la valeur
marchande des animaux et par la dévalorisation des peaux et les saisies de carcasses et
d’organes à l'abattoir.
Au Maroc la lymphadénite caséeuse chez les ovins n’a fait son émergence qu’à partir
de la fin des années 1980 suite à l’introduction massive à partir des frontières élevages
d’ovins de race Ouled Jellal. Depuis, la maladie a connu une émergence alarmante dans
les troupeaux ovins à l’échelle nationale et particulièrement dans les régions de l’oriental
où la maladie occasionne des pertes économiques considérables. Les conditions
environnementales dans ces régions semi-arides à arides seraient propices pour
15
l’établissement de l’enzootie chez les petits ruminants. De même, la maladie a été
caractérisée comme dominante pathologique dans d’autres régions du royaume,
notamment chez les caprins et les camélidés des régions Nord et sud Maroc,
respectivement [1 ; 64]. Les pertes liées à cette maladie sont considérables et peuvent
s’alourdir davantage en l’absence d’un plan de lutte.
Ainsi cette étude, qui a lieu dans la région orientale, a pour objectif de déterminer la
prévalence de cette maladie et ses caractéristiques épidémiologique et pathologique dans
la région orientale par le biais:
- D’enquêtes cliniques, épidémiologiques et pathologiques au niveau des
élevages
- D’enquêtes lésionnelles au niveau des abattoirs ;
- Description lésionnelle macroscopique et microscopique
17
La lymphadénite caséeuse est une maladie infectieuse, contagieuse, inoculable,
d’allure subaigue ou chronique, due à l’action pathogène de Corynebacterium
pseudotuberculosis [70 ; 74].
Cette entité morbide se traduit par des abcès à pus caséeux ou par des
suppurations chroniques, localisées aux noeuds lymphatiques, aux viscères (Poumons,
foie), à la peau et à la mamelle, et par des formes septicémiques chez les agneaux.
Très largement répandue, elle évolue souvent sous forme d’enzootie de troupeau.
II. SYNONYMES
Cette infection connaît diverses appellations : Maladie caséeuse,
pseudotuberculose, adénite caséeuse, furonculose cutanée, corynébacteriose sont tous
des noms francophones de cette maladie. Les anglophones la nomme, caseous
lymphadenitis [10], cheesy gland, yolk boils. Les arabophones « l’appellent »
« ا���» Le nom vernaculaire dans la région orientale est .« داء �� ا�� ا���دب» [70]
(Alour).
III. HISTORIQUE
Diverses affections du mouton se traduisant par des phénomènes suppuratifs ont
été décrites dans la littérature.
Un micro-organisme ressemblant à C. pseudotuberculosis a été décrit pour la
première fois par DICKERHOFF et GRAVITZ en 1888 à partir de lésions de la
dermatite pustuleuse du cheval, puis par NOCARD (1892) dans la lymphangite
ulcéreuse équine [56 ; 59].
La maladie a été décrite, dans ses multiples localisations, pour la première fois en
France en 1891 par PREIS GUINARD [52] puis par TURSKI en Allemagne,
SIVORY en Argentine, CHERRY BULL en Australie et NORGAART et MOHLER
aux Etas-Unis [21].
18
En 1923, Carré confirme l’étiologie multiple des affections pyogènes des petits
ruminants. Cependant, pour plusieurs auteurs, le bacille de Preisz-Nocard reste l’agent
spécifique de la lymphadénite caséeuse des ovins et des caprins [56].
Actuellement encore, pour les auteurs anglo-saxons, le bacille de Preisz-Nocard
ou Corynebacterium pseudotuberculosis demeure l’agent responsable d’une entité
pathologique spécifique, la lymphadénite caséeuse (cheesy gland), maladie chronique du
mouton caractérisée par des abcès ganglionnaires et parfois par des abcès des poumons
et de la rate [56].
IV. REPARTITION MONDIALE ET PREVALENCE :
La lymphadénite caséeuse existe partout dans le monde et elle est endémique et
importante dans les régions de grandes populations de mouton et de chèvres : Australie
Nouvelle-Zélande, Brésil, Etats- Unis, Argentine, Norvège, Pays Bas, Grande Bretagne ,
Espagne, Canada , Chine et France (Tableaux 1 et 2) [59].
L’Australie compte l’un des plus grands troupeaux de moutons au monde orienté
essentiellement vers la production de laine à partir de la race principale Mérinos [50].
En 1984, une enquête réalisée dans les abattoirs australiens a montré que plus de la
moitié (54 %) des animaux de réforme envoyés à l’abattoir étaient porteurs d’abcès à C.
pseudotuberculosis. En 1986, une enquête semblable a été réalisée dans les abattoirs de
l’Australie occidentale a révélé que 0,3 à 18,8% des animaux abattus avaient des abcès
(Tableau 2) [5].
En Europe, la diminution des contrôles aux frontières européennes, le libre
déplacement des troupeaux entre les nations, les pays préalablement indemnes de la
lymphadénite caséeuse ont rapporté des apparitions. La première apparition aux Pays
Bas était en 1984 [72]. Elle a été reliée aux caprins importés de France [66]. Cette
apparition n’a pas été maîtrisée et plus tard la lymphadénite caséeuse atteint l’industrie
laitière caprine [36].
19
Au Royaume Uni, la lymphadénite caséeuse a été rapportée pour la première fois
en 1990 [40] chez des caprins qui ont été en contact avec leurs semblables de la race
Boer importés d’Allemagne [39]. En dépit des instructions de restriction rigoureuses sur
les déplacements du bétail, et le traçage des contacts entre animaux, la première
apparition de la maladie chez les ovins a eu lieu en 1991[69]. Depuis, des cas ont été
identifiés dans les troupeaux en Angleterre [39], en Ecosse [37] et en Island [46] et plus
récemment en Irlande du nord [37]. En 2001, une étude sur la séroprévalence du cheptel
ovin au Royaume Uni a montré que 9,93% est positif à la lymphadénite caséeuse
(Tableau 1).
En France l’infection à Corynebacterium pseudotuberculosis est connue depuis
longtemps dans les troupeaux d’ovins et de caprins, mais elle a été souvent confondue
avec les autres causes des abcès [61].
En Egypte : En 1999 l’incidence de l’infection était 6.78% dans les troupeaux ovins et
4.81% chez les caprins. Le ganglion parotidien était le plus souvent affecté (Tableau 1)
[49].
En chine, une étude sur la séroprévalence de la maladie a montré que 16,6% des
caprins est positifs (Tableau 1).
Au Kenya, Lors d’une étude de la lymphadénite caséeuse chez les ovins et caprins
au Kenya, 54 de 757 chèvres (1.13%) et 6 de 378 moutons examinés ont été trouvés
atteints d’un ou plusieurs abcès ; l’abcèdation était plus fréquente dans le ganglion
préscapulaire (68.5%) suivi par le précrual (14.28%) [38].
Au Maroc, la lymphadénite caséeuse chez les ovins n’a fait son émergence qu’à
partir de la fin des années 1980 suite à l’introduction massive à partir des frontières
algériennes d’ovins de race Ouled Jellal (DPA d’Oujda). Deux études ont été réalisée
pour évaluer son importance, l‘une dans la région de Ouarzazate qui a montré que la
prévalence de la LC chez les ovins et caprins variait de 0 à 24.5% dans les bergeries les
20
plus touchées [1] et l‘autre dans la région dans le sud du Maroc chez le dromadaire qui a
révélé une prévalence de 0 à 15% [64].
Tableau 1: Séroprévalence de la lymphadénite caséeuse dans différent pays [78] :
Pays
Espèces
Séroprévalence %
Ovin 3.5 Turquie
Caprin 1.1
Ovin 2.2 Allemand
Caprin 10
Ovin 6.35 Soudan
Caprin
7.05
Ovin
6.78
Egypte
Caprin
4.81
Chine Caprin 16.6
UK Ovin 9.93
Tableau 2: La fréquence de l’infection par C. pseudotuberculosis dans les pays à
haute production ovine et caprine [78]
Espèce
Critères de
prévalence
Fréquence
Pays
21
Individus avec abcès
0,3-18,8%
Australie
Individus séropositifs
50-94 %
Canada
Individus avec abcès
51%(28%)
France
Individus séropositifs
15,3% Jordanie
Individus séropositifs
27,8 % Japon
Troupeaux 70-80 %
Ovin
Individus avec abcès dans des
troupeaux
45,6%
Espagne
Individus avec abcès 41,6
Individus avec abcès
5 8,4%
Brésil
Individus avec
abcès
8,l%(70%)
Individus avec abcès
70%
Etats Unis
Individus avec abcès
61%
Individus séropositifs
94%
Norvège
Individus séropositifs
(3 troupeaux)
100%, 87%,
64%
République
Tchèque
Mammite clinique
0,3 %
Nigeria
Troupeaux 72,5 %
Individus avec abcès dans des
troupeaux
2 5,8%
Caprin
Mammite subclinique
0,3 %
Espagne
V. IMPORTANCE
1. Importance économique
22
L’importance économique de la maladie réside dans l’énorme perte infligée à
l’industrie ovine. En Australie les pertes se chiffre en millions de dollars chaque année.
Ces pertes économiques résultent d’une diminution de la prise du poids, de la
reproductivité, de la production de laine et de lait ainsi que de la condamnation des
carcasses (1/3 des saisies aux état- unis) et la dévaluation des peaux [74]. Entre 1991 et
1992, les pertes en viande et en laine ont atteint 30 à 50
millions de dollars dans l’ensemble de l’Australie [81]. Une enquête d’abattoir conduite
par de NSW agriculture (New South Wales) en1995 a montré que 97% des animaux
abattus étaient atteints de la « cheesy gland » [83].
La maladie présente un grand fardeau économique au pays exportateur de
mouton, vu que beaucoup de pays importateurs refusent d’importer les moutons
provenant de pays oŭ la lymphadénite caséeuse est déclarée. D’autres pays insistent sur
le fait que seulement les carcasses complètement exemptes de la maladie sont
acceptables pour leurs marchés [47 ; 83].
L’infection à C. pseudotuberculosis a été décrite chez de nombreuses autres
espèces animales domestiques ou sauvages, mais reste le plus souvent anecdotique. à
l’exception des cheveux chez lesquels l’agent bactérien provoque une affection
connue sous le nom de lymphangite ulcéreuse [2 ; 54 ; 59 ; 80].
Récemment, des foyers importants d’infection de C. pseudotuberculosis ont été
décrit en Israël dans des troupeaux de vaches laitières, ce qui constitue un cas
inhabituel, avec des abcès localisés essentiellement à la peau et à la mamelle. Une
étude récente de ces cas pourrait impliquer les mouches comme vecteur passif de la
bactérie d’un animal à un autre [54 ; 59].
2. Importance hygiénique
La maladie présente un risque sanitaire aux humains. Plusieurs cas d’infection
bactérienne ont été décrits chez des personnes travaillant dans les industries de viande.
23
(Vingt deux cas ont été recensés en Australie depuis l966 à 1995) [55 ; 56 ; 59]. Ainsi, il
existe une grande possibilité que la maladie se transmette par ingestion de lait cru ou de
viande contaminés issus de chèvres et de vaches atteintes [29 ; 62].
VI. ETIOLOGIE
L’agent causal spécifique de la lymphadénite caséeuse (LC) est
Corynébactérium pseudotuberculosis mais il est souvent associé à d’autres germes de
24
complication, notamment Corynebacterium pyogènes et Staphylococcus aureus subsp
anaerobius [67 ; 70].
•
1. Dénominations
Corynebacterium pseudotuberculosis a plusieurs dénominations :
« Bacillus pseudotuberculosis-ovis ». « Corynebactérium ovis ». « Corynebactérium
pseudotuberculosis-ovis », « Corynebactérium preisz-nocardi ». « Mycobacterium
tuberculosis-ovis ». Actuellement, le nom systématiquement utilisé est
Actinomyces pseudotuberculosis. Nom vernaculaire est le bacille de Preisz-Nocard.
2. Systématique
Cette bactérie appartient au groupe de Corynebacterium diphtheriae constitué
de Corynebacterium diphtheriae, de Corynebacterium pseudotuberculosis et de
Corynebacterium ulcerans [42 ; 59].
Le test de réduction des nitrates permet de définir deux biovars : le biovar Equi
(nitrate réductase positive) isolé des chevaux et des bovins et le biovar Ovis (nitrate
réductase négative) isolé des petits ruminants, des bovins et exceptionnellement du
cheval. L’existence de ces deux biovars a été confirmée par des études génétiques
(polymorphisme de restriction de F ADN, ribotypage) [17 ; 59 ; 76]. Certaines
souches nitrate réductases positives, isolées de mammites chez les bovins, pourraient
représenter un troisième biovar caractérisé par son habitat, son pouvoir pathogène et
ses caractères bactériologiques [17].
3. Caractères bactériologiques
•
Corynebacterium pseudotuberculosis est un bacille à Gram positif, immobile,
non sporulé, de forme irrégulière, de 0.5 à 0.6 µm de diamètre sur 1,0 à 3,0 µm de
25
longueur, présentant des formes en massue et des granulations métachromatiques,
aéro-anaérobie, catalase positive, non lipophile (croissance non stimulée par 1 p. cent
de Tween 80 en gélose cœur-cervelle) [17 ; 67].
•
4. Les caractères biochimiques
Les souches du biovar Ovis sont nitrate réductase négative alors que les
souches du biovar Equi et du « Biovar 3 » sont nitrate réductase positive. Le « Biovar
3 » se différencie du biovar Equi par l’aspect des colonies et par une réponse
faiblement positive au CAMP test-reverse [17; 69].
• 5. Caractéristiques culturales :
Corynebacterium pseudotuberculosis cultive à 20 °C, ne présente pas
d’exigences particulières et l’adjonction de Tween-80 ou de sérum n’est pas
indispensable à la croissance [17; 69].
Sur une gélose au sang de mouton, incubée 24 heures à 37 °C, dans une
atmosphère normale, les colonies sont minuscules et non hémolytiques.
Après 48 heures d’incubation, les colonies formées par les souches des biovars Equi et
Ovis ont un diamètre de 1 mm, elles sont blanches ou légèrement jaunâtres, très
sèches, convexes et à contour régulier. Les souches du « Biovar 3 » sont légèrement
plus grosses (entre 1 et 2 mm de diamètre) et leur aspect est moins sec. Les colonies
des 3 biovars s’entourent d’une étroite zone d’hémolyse bêta due à l’excrétion de la
phospholipase D [17 ; 42; 69 ].
En bouillon, la croissance est faible et se traduit par la présence d’un sédiment
et d’un léger voile en surface [17 ; 42; 69].
6. Pouvoir pathogène
26
Les facteurs de pathogénicité intrinsèques sont liés à la présence d’un lipide
pariétal et à la synthèse de phospholipase D. Ces 2 facteurs n’expliquent cependant
pas le développement des lésions granulomatoses qui résultent en fait de la réponse
immunitaire.
• 6.1. Lipide pariétal
Le lipide pariétal analogue au « cord factor » de Mycobacterium tuberculosis est
responsable d’une action cytotoxique sur les cellules phagocytaires et d’une résistance
à l’action bactéricide de ces cellules. Cette action sur les phagocytes confère à
Corynebacterium pseudotuberculosis le statut de bactérie intracellulaire facultative
[60]. Le lipide pariétal semble un facteur de virulence important car les souches les
plus riches en lipides induisent les lésions les plus importantes [21].
• 6.2. Phospholipase D
La phospholipase D, d’un poids moléculaire de 31 kDa, hydrolyse la
sphingomyéline des membranes cellulaires ce qui aboutit à la libération de choline
alors que le céramide phosphate reste associé à la membrane [14 ; 15].
La phospholipase D augmente l’activité hémolytique de 2 toxines
(phospholipase C et cholestérol oxydase) produites par Rhodococcus equi ce qui est à
l’origine de la positivité du test de CAMP. Inversement, la bêta hémolysine d’une
souche de Staphylococcus aureus subsp aureus est inhibée (positivité du CAMP test-
reverse) car elle est incapable d’agir sur le céramide phosphate. L’inhibition pourrait
également résulter d’un encombrement stérique [42].
Les souches ne produisant pas de phospholipase D (absence du gène ou
présence d’un gène défectif) ont une virulence atténuée [14 ; 21].
27
• 7. Réaction immunitaire
La réponse immunitaire à médiation cellulaire est à l’origine d’un état
d’hypersensibilité de type IV conduisant à la formation de pyogranulomes au point
d’inoculation et dans les nœuds lymphatiques drainant la région [30 ; 54].
Ces granulomes présentent un centre nécrotique (pyogranulomes) entouré de
macrophages et de lymphocytes [58].
A leur périphérie se développe une zone de fibrose isolant le granulome des
tissus. Comme c’est le cas pour tous les granulomes résultant d’une hypersensibilité de
type IV, l’organisation des granulomes est dynamique : en permanence des
macrophages se lysent, libèrent des bactéries qui sont alors phagocytées par de
nouveaux macrophages. La formation de ces granulomes immuns inhibe la
dissémination bactérienne mais conduit à des lésions tissulaires [59 ; 58].
• VII. PHYSIOPATHOGENIE
Les mécanismes d’apparition de la maladie des abcès ne sont pas parfaitement
connus. Après introduction du germe par traumatisme inoculateur, inhalation, voire
ingestion, les facteurs de pathogénicité des germes jouent un rôle important en
association avec la réceptivité de l’animal (race, alimentation, maladies intercurrentes ...)
(Figure 3) [35; 61].
II s’agit de germes pyogènes et c’est au niveau de la porte d’entrée de l’infection
que l’on observe les lésions élémentaires marquées au début par des signes
inflammatoires, suivis rapidement de phénomènes suppuratifs [58 ; 62]. A partir de ce
foyer initial, le processus tend à diffuser: rôle de la toxine de
C. pseudotuberculosis par son action vasodilatatrice [9]. Cette diffusion gagne en
premier lieu les nœuds lymphatiques régionaux, ceci explique l’atteinte des ganglions
28
carrefours à savoir les mandibulaires, les parotidiens, les préscapulaires, les précruraux,
les inguinaux et les poplités (Figure 1).
Figure 1: La localisation des nœuds lymphatiques superficiels chez un mouton [85]
1.parotidien 2.cervical 3.mandibulaire 4.préscapulaire 5.précrural 6.ichiatique 7.poplité
8.inguinal
Les essais de reproduction expérimentale de la maladie chez le mouton montre
que l’inoculation de C. pseudotuberculosis entraîne une focalisation très précoce des
lésions accompagnée d’un recrutement massif de granulocytes neutrophiles, ce qui
montre le rôle essentiel de ces cellules phagocytaires au cours de la phase d’initiation de
l’inflammation [7 ; 23]. Passé ce premier stade, le rôle des granulocytes s’atténue
considérablement pour laisser la place à la réponse immunitaire spécifique avec une
implication croissante des macrophages et des lymphocytes [9].
Dès le 6éme jour après l’inoculation, les premiers granulomes à centre nécrotique
(ou pyogranulôme) apparaissent au point d’inoculation et dans les ganglions qui le
drainent [7 ; 28 ; 63].
29
L’extension de l’infection peut apparaître comme étant le résultat du transport par
des leucocytes du germe pathogène qui a la propriété d’être un parasite intracellulaire
facultatif qui gagnent ainsi les ganglions lymphatiques et les organes internes [8 ; 28 ;
67 ; 75].
Les granulomes sont constitués d’un centre nécrotique, entouré, depuis le centre
vers la périphérie, par une vraie palissade de macrophages de phénotype varié, une
épaisse couche de cellules composée surtout de lymphocytes B et T (comprenant à la
fois des lymphocytes auxiliaires et des lymphocytes cytotoxiques) et une zone de
fibrose qui sert à isoler le pyogranulôme du reste du tissu ganglionnaire (Figure 2) [53 ;
57 ; 60].
Figure 2: Detail d’un granulome de la lymphadenite caséeuse :
Couche intermediare de cellules plasmatiques et épithéliales A
entourant un magma necrotique. capsule fibrosé B.
Tissu pulmonaire C. Hematoxine-eosina x 100. [85]
Le granulome ainsi élaboré peut être considéré comme un moyen de défense de
l’hôte infecté, mais aussi comme un moyen de persistance de la bactérie. En dépit de
l’apparence statique, cette organisation typique du pyogranulôme connaît une
évolution dynamique continuelle avec la production de facteurs cellulaires ou
cytokines produits par les cellules en place qui contribuent à entretenir la réaction
inflammatoire (plutôt au centre du granulome) et la réaction cicatricielle (plutôt à la
périphérie de la lésion) [23 ; 42].
30
Ces modifications cellulaire et moléculaire en fonction du statut immunitaire de
l’animal infecté et des réinfections ou des réactivations endogènes, conduisent le plus
souvent à une augmentation de la taille des lésions, mais peuvent aussi conduire à une
stabilisation des lésions voire à une guérison complète [46 ; 48].
Les lésions pulmonaires associées à C. pseudotuberculosis présente une
prédominance de macrophages avec un complexe de histocompatibilité
classe II au niveau de sa surface, des lymphocytes T et des lymphocytesT4 (helper) qui
sont les majoritaire (avec un ratio de T4/T8 = 3.5). Cette étude suggère que l’activité
des macrophages et des lymphocytes T4 joue un rôle majeure dans la pathogénicité des
lésions pulmonaires chez les ovins atteints de la forme viscérale de la lymphadénite
caséeuse [22].
32
VIII. EPIDEMIOLOGIE
• 1. Epidémiologie descriptive
La lymphadénite caséeuse est le type même de maladie enzootique
atteignant les troupeaux surtout en bergerie, du fait du rassemblement sur un espace
restreint d’un grand nombre d’animaux séjournant longtemps sur une même litière,
dans des locaux peu aérés; mais elle peut évoluer aussi à l’extérieur au pâturage
(élevage extensif) [21 ; 61].
Les taux de morbidité sont très variables, mais peuvent atteindre selon les
auteurs jusqu’à 20% des animaux d’un même effectif; en moyenne, ils sont de l’ordre
de 5 à 10 %. En revanche, les taux de mortalité et les taux de létalité sont très faibles,
hormis chez les agneaux atteints de septicémie [21 ; 61].
Le pourcentage d’exploitations atteintes varie sensiblement selon les pays et
surtout les régions: ainsi dans la vallée du Rhône où 48 % des exploitations sont
atteintes alors que dans les zones de montagne le nombre d’exploitations infectées peut
s’élever jusqu’à 75 % [21].
• 2. Epidémiologie analytique
• • 1.1. Sources de germes et matières virulentes :
Le pus des abcès ouverts représente la principale source de matières virulentes
[16]. Mais l’excrétion des germes peut s’effectuer aussi vraisemblablement par les
fèces ; les éleveurs signalent, en effet, que la maladie apparaît souvent dans un
troupeau après introduction d’animaux apparemment sains et dépourvus de lésions
visibles. Enfin, il est classiquement admis que l’agent bactérien responsable est
présent dans l’environnement, notamment dans les bergeries et aux abords des locaux,
où ils persistent presque indéfiniment sur le sol, les litières, les murs, le matériel
d’élevage, les auges et râteliers, les barrières de couloirs, des embrasures de passages
33
et des portes [21 ; 61 ; 73].
Les bains parasiticides sont également une source de contamination, car C.
pseudotuberculosis est capable de survivre dans le produit antiparasitaire pendant au
moins 24 heures et l’infection peut se faire à travers une peau saine [12].
• 1.2. Modalités de la transmission et voie de pénétr ation (Figure
4)
La principale voie de pénétration des bactéries est tégumentaire [20]. II est
admis aussi que C. pseudotuberculosis peut provoquer des abcès après simple dépôt
sur la surface cutanée [12].
Des études australiennes ont montré que les animaux porteurs d’abcès
pulmonaires peuvent être une source de contamination directe pour les autres animaux
à la suite de la rupture des abcès pulmonaires profonds [22].
On constate souvent la disparition des abcès après suppression des agents
traumatisants: clous, fils de fer, barrières et cloisons aux arêtes vives, rebords de
mangeoires métalliques coupantes, irrégularités traumatisantes des obstacles à la
circulation et attaches [21].
Nombre d’éleveurs attachent aussi une importance aux fourrages vulnérants,
aux epillets de graminées, aux buissons épineux des abords de bergerie et des
parcours. L’attention est attirée aussi sur le rôle des tiques [21].
La particulière fréquence des modes de pénétration des germes par effraction
cutanée explique que les lésions abcédatives siègent initialement dans les muqueuses
et le tissu conjonctif sous cutané et dans les ganglions correspondants, et soient bien
34
visibles au simple examen des animaux; elle explique aussi que dans 2/3 des
troupeaux envahis par la maladie, les abcès aient une nette tendance à survenir sur les
mêmes territoires corporels chez les divers malades: tête et côté de l’encolure, gorge,
encolure et devant d’épaule, abdomen, mamelles et bourses, flancs et membres [74].
Figure 4: mode de contamination et facteurs de réceptivité [21] :
35
1.3. Réceptivité
1.3.1. Facteurs intrinsèques :
• a. Espèce:
Les ovins et les caprins sont réceptifs. La prévalence peut atteindre 54% chez les
brebis adultes, mais ne dépasse pas 8 % chez les caprins [4].
La maladie a été décrite chez d’autres espèces mais sa prévalence reste très faible, à
l’exception du cheval chez lequel C. pseudotuberculosis provoque une affection connue
sous le nom de lymphangite ulcéreuse [43].
• b. Sexe:
Aucun élément ne permet d’affirmer que le sexe intervient dans la réceptivité de la
maladie, mais les abcès sur la tête des béliers sont plus fréquents que sur celle des
brebis [12].
• c. Age :
La maladie existe aussi bien chez les agneaux que chez les adultes. Cependant la
fréquence de la maladie augmente avec l’âge avec un pic chez les adultes. Cette
évolution est probablement due à l’exposition répétée à l’infection à chaque tonte
(Figure 5) [52].
Dans la plupart des exploitations, la maladie des abcès s’entretient sur des
animaux de 18 mois à 5 ans [21].
36
Figure 5: La prévalence de la lymphadénite caséeuse selon l’âge [52].
• d. Race:
La maladie atteint préférentiellement certaines races à peau fine enlainée [65]. En
France, la race ovine préalpés présente une prévalence significativement élevée en
comparaison avec les races mérinos et mestizos. Parfois la sensibilité de la race est liée
plus au type de production. En effet, les races laitières souffrent plus de la
pseudotuberculose mammaire que les races viandes [84].
• e. Saison :
La prévalence de la maladie varie aussi selon les saisons. En France , elle tend à
augmenter au cours de l’hiver et au printemps; mais un autre pic est constaté en Avril-
Juin à la suite de l’atteinte de jeunes agneaux nés en Mars-Avril et livrés plus
tardivement à l’abattage, après un séjour prolongé à l’herbe [21]. Le pourcentage des
saisies du à la LC au niveau des abattoirs oscille entre 6 à 10% de Janvier à Septembre et
augmente de 15 à 20% en Novembre. A la Californie, la lymphadénite apparaît chez les
équidés dans les saisons les plus froides et régresse en été. L’incidence des abcès est
importante dans les mois chauds qui précédents les périodes de hautes pluviométries, un
facteur nécessaire pour les insectes qui peuvent vehiculés la maladie.
37
• 1.3.2. Facteurs extrinsèques
• a.. Nature du sol et alimentation
La maladie parait être favorisée par les carences en Zinc et Magnésium et la nature
géologique des sols, surtout calcaires . Ainsi, une carence en Zn et Mg affaiblie la peau
et diminue sa protection contre les agressions externes [12 ; 65].
b. Modes d’élevage
Le maintien en bergerie et la forte densité des animaux dans les locaux, sont des
facteurs considérables de dissémination de la maladie parmi les adultes comme parmi
les agneaux. Les mesures hygiéniques habituellement pratiquées sont inefficaces pour
interrompre le cours de la maladie et son extension. Seule la qualité de la litière,
profonde, permanente (sèche sur toute la surface, propre, dure, bien empaillée
régulièrement) associée à une faible concentration des animaux est un facteur de
raréfaction de la maladie, avec la suppression de toute cause de traumatisme [50 ; 65].
La recherche des facteurs prédisposants et surtout des facteurs déterminants en
élevage extensif est beaucoup plus incertaine rendant toute prophylaxie très difficile.
Selon Paton et al. L’intervalle entre la période de tonte des animaux et les bains
antiparasitaire joue un rôle très important dans la propagation de la maladie. En effet,
plus la durée de cet intervalle est courte plus la prévalence élevée (Tableau 3) [70 ; 82].
Tableau 3: Effet de l’intervalle entre la tonte et les bains parasitaires sur la
prévalence de la lymphadénite caséeuse [82].
38
Intervalle entre
la tonte et les
bains
parasitaires
(Semaines)
Nombre
d’animaux
traités
Nombre
d’animaux avec
des lésions
Nombre
moyen des
ganglions
lymphatiques
atteints
Nombre
Moyen des
abcès
pulmonaires
0 41 24 (59%) 3.3 4.3 2 44 22 (50%) 1.8 2.8 4 47 25 (53%) 2.4 2.4 8 43 24 (56%) 1.5 2.7 24 14 8 (57%) 1.5 0.5
IX. SYMPTOMES ET EVOLUTION
La période d’incubation est très variable. Dans la plus part des cas il tend à devenir
lent et peut varie de 10 jours à plusieurs mois voir même des années. Les symptômes
cliniques de l’infection par C. pseudotuberculosis sont varies. Selon la fréquence
d’apparition de ses formes, on distingue deux catégories à savoir les formes typiques :
viscérale et cutano-ganglionnaire et les formes atypiques : mammaire, articulaire,
septicémique, myélite ascendante.
• 1. forme cutanée : (Figure 6)
Elle évolue sous forme d’une dermite suppurée. Elle est plus fréquente chez les
jeunes et se caractérise par la présence de petits abcès sous-cutanés, répartis en
différents points de l’organisme de l’animal (encolure, thorax, flanc, bourses chez le
mâle ou la mamelle chez la femelle). Il s’agit d’abcès froids, entourés d’une coque
épaisse, avec éventuellement une petite ouverture (fistule) [21].
39
Figure 6: Une brebis présentant plusieurs abcès cutanés[85].
• 2. Forme ganglionnaire (Figure 7)
La forme ganglionnaire peut être superficielle ou profonde. Dans la forme
superficielle, l’abcèdation intéresse surtout les noeuds lymphatiques rétro-pharyngiens,
parotidiens, cervicaux superficiels et les poplités. Elle est plus fréquente chez les
agneaux de 3 à 12 semaines [18 ; 44].
Les lésions de la forme superficielle s’ouvrent généralement sur l’extérieur et
laissent échapper un pus crémeux de couleur vert pistache.
Cependant, ces adénites superficielles ne semblent pas affecter sérieusement l’état
général de l’animal [67].
40
Figure 7: Hypertrophie des ganglions mandibulaire chez une brebis[85].
Dans le cas de la forme profonde, les abcès sont localisés aux noeuds
lymphatiques profonds, en particulier les nœuds lymphatiques médiastinaux. L’atteinte
de ces derniers peut être associée ou non à une atteinte simultanée des viscères. Par
ailleurs, l’atteinte des noeuds lymphatiques médiastinaux peut provoquer une
perturbation de la conduction vagale, ce qui est à l’origine des troubles d’e
fonctionnement des préestomacs (météorisation récidivante) [16 ; 25 ; 75].
En général, les adénites profondes entraînent un amaigrissement progressif de
l’animal. Néanmoins, le diagnostic n’est établi qu’au moment de l’autopsie ou lors de
l’inspection des carcasses aux abattoirs [81].
• 3. Forme viscérale
Les viscères les plus fréquemment atteints sont le poumon et le foie; mais d’autres
organes peuvent être touchés tels que la rate et les reins [10 ; 16 ; 75].
La localisation pulmonaire, qui est très répandue, se traduit par une
bronchopneumonie chronique, caractérisée par de la toux, de la dyspnée, un jetage
muco-purulent, et amaigrissement progressif. On ne constate pas d’hyperthermie (Figure
8 et 9)[18 ; 75].
41
Figure 8 : La pseudotuberculose pulmonaire chez une brebis : Des nodules pulmonaires
multiples [85].
Figure 9 : Respiration buccale d’un ovin atteint d’une pneumonie de la
pseudotuberculose « syndrome de pneumonie chronique » [85].
Les autres localisations viscérales sont généralement des trouvailles d’autopsie ou
d’abattoir. Elles sont souvent associées à des localisations sur des noeuds lymphatiques
profonds.
Il faut noter que la présence d’abcès sur de nombreux viscères peut correspondre à
une généralisation de la forme ganglionnaire ou à une septicémie qui fait suite à une
infection ombilicale [74 ; 75].
En plus, la forme viscerale peut etre accompagnée par de la cachexie associe à des
atteintes hematologique à savoir une anémie et une hypergammaglobunémie (Figure 10).
42
Figure 10: Une brebis atteint par « le syndrome de la brebis maigre » [85].
• 4. Forme mammaire (Figure 11)
•
Elle se manifeste par des abcès superficiels ou profonds, ou encore par une
mammite à caractère contagieux. Au début, la mamelle est chaude et douloureuse.
Ensuite, des nodules froids apparaissent et donnent à la mamelle un aspect bosselé.
Ces nodules ou abcès peuvent s’ouvrir à l’extérieur et contaminer ainsi le matériel de
traite et la litière, ce qui facilite la transmission de l’affection d’un animal à un autre.
Cette forme évolue vers l’atrophie et la sclérose du tissu mammaire, d’où la réforme de
l’animal [11 ; 64 ; 81].
Figure 11: Ganglion inguinale affecté par LC chez une brebis souffrant
de mammite [85].
• 5. Forme articulaire (Figure 12)
43
• Les articulations les plus concernées sont celles du carpe et du jarret. L’infect ion
fait suite à un traumatisme (piqûre, morsure…). L’évolution chronique aboutit à
l’ankylose de l’articulation [74 ; 75].
Cette forme est plus rencontrée chez les agneaux à la mamelle, et est souvent
associée à des abcès hépatiques [75].
Figure 12: Abcès au niveau de l’articulation metacarpienne chez un ovin [85].
6. Forme septicémique
Cette forme intéresse le nouveau-né et fait suite à une omphalophlébite. Elle se
manifeste par une inflammation du cordon ombilical et des symptômes généraux
graves, avec de l’hyperthermie [74 ; 75]. La maladie évolue vers la mort suite à une
septicémie ou à une péritonite.
7. Forme de myélite ascendante
Elle est rencontrée chez l’agneau et fait suite à une complication de la
caudectomie. Elle entraîne une parésie, puis une paralysie du train postérieur [21].
X. DIAGNOSTIC
• 1. Clinique :
44
Il repose sur l’observation d’abcès à coque épaisse et fibreuse dont les localisations
superficielles sont le plus souvent ganglionnaires. Il se révèle beaucoup plus délicat
lorsque ces abcès sont viscéraux. L’examen d’autres animaux du cheptel permet alors
parfois d’orienter le praticien [67].
• 2. Epidémiologie :
•
Dans les troupeaux atteints d’abcès purulents, Les principaux paramètres
épidémiologiques permettant de différencier la lymphadénite caséeuse des autres
infections purulentes (Arcanobacterium pyogenes, Staphylococcus aureus) sont :
- L’intervalle entre la primo-infection et l’apparition des premiers cas :
� A peu prés 6 mois pour LC .
� Inconnue chez les autres infections.
- La période nécessaire pour l’augmentation de la prévalence :
� 3 à 4 ans pour LC .
� Courte chez les autres infections.
- La période d’endémie :
� Illimité pour LC.
� Limité pour les autres infections.
- Age des animaux atteints :
� Adultes pour LC.
� Jeunes pour les autres infections.
• 3. Nécropsique :
•
Les abcès de la lymphadénite caséeuse sont très caractéristiques: coque épaisse,
pus crémeux souvent jaune verdâtre, parfois caséifié, en pelure d’oignon, sans réaction
périphérique [17 ; 74 ; 75]. L’aspect en oignon est très représentatif de la maladie,
cependant cette lésion disparaît avec l’évolution du processus nécrotique (Figure 13).
45
Figure 13: Image d’un nodule lymphatique en aspect
d’oignon caractéristique de la LC [85].
La pseudotuberculose viscérale est dans la plupart des cas est une trouvaille
d’autopsie d’animaux malades ou d’animaux inspectés dans les abattoirs (Figure 14 ,
15).
Figure 14: Poumon d’ovins abattus présentant une abcèdation
des ganglions lymphatiques mediastinaux [85].
46
Figure 15: un grand abcès au niveau du foie d’un caprin [85].
l’examen histopathologique d’abcès de LC montre la présence d’un centre
nécrotique, entouré, depuis le centre vers la périphérie, par une vraie palissade de
macrophages de phénotype varié, une épaisse couche de cellules composée surtout de
lymphocytes B et T (comprenant à la fois des lymphocytes auxiliaires et des
lymphocytes cytotoxiques) et une zone de fibrose qui sert à isoler le pyogranulôme du
reste du tissu ganglionnaire (Figure 16 et 17)
Figure 16: Granulome de la pseudotuberculose a niveau du poumon d’un ovin
C parenchyme pulmonaire, B coque de fibrose. Hematoxiline-eosine [85].
47
Figure 17 :Centre d’un abcès de LC presentant un magma caséo-nécrotique [85].
4. Diagnostic différentiel
•
Dans ses localisations superficielles, la maladie des abcès doit être différenciée de
toutes les affections nodulaires: hématome, actinobacillose, leucose, kyste salivaire ou
hernie ombilicale [16].
La ponction s’avère une manoeuvre sémiologique de grande intérêt.
Dans les localisations profondes, le seul symptôme observé est le plus souvent un
mauvais état général de l’animal. Il convient de différencier la maladie des abcès de
toutes les affections cachectisantes : sous-nutrition, carences nutritionnelles, tuberculose,
paratuberculose, parasitisme [16]. Le diagnostic nécropsique s’avère nécessaire.
• 5. Diagnostic expérimental
•
Le recours au laboratoire est indispensable pour préciser l’étiologie de la maladie,
pour apprécier les risques évolutifs et pour orienter la prophylaxie et la thérapeutique.
5.1. Bactériologie
5.1.1. Prélèvement
48
Le pus est recueilli aseptiquement, après tonte et désinfection cutanée, dans un
flacon stérile, soit par ponction d’un abcès fermé et fluctuant, soit par écouvillonnage de
la coque de l’abcès [12].
5.1.2. Envoi
Il est reconnu que Staphylococcus aureus et Corynebacterium pseudotuberculosis
se révèlent résistants dans le pus à la température ordinaire (au moins 3 mois); en
revanche, C. pyogènes est plus fragile et nécessite pour sa survie la réfrigération et un
transport rapide [12].
Dans l’ignorance du germe responsable, il est utile d’envoyer rapidement le
pus recueilli dans un flacon sous protection du froid (4-5°C), les écouvillons dans un
milieu de transport [12].
5.1.3. Méthode Le diagnostic bactériologique de la maladie des abcès ne présente pas de très
grandes difficultés. Le protocole suivant peut être proposé:
• Examen direct: Après coloration de gram d’un frottis de pus qui ne permet
pas cependant de différencier S. aureus et Micrococcus abscedens ovis d’une
part et C. pseudotuberculosis d’autre part[12].
• Identification: Par techniques bactériologiques classiques: recherche d’une
catalase, caractères biochimiques recherches en tubes et en plaques (galerie 50
CHS en anaérobiose pour C.pseudotuberculosis et C. pyogènes) [12 ; 49].
49
5.2. Sérologie :
Dans le cas de la lymphadénite caséeuse, la sérologie repose essentiellement sur la
détection des anticorps antitoxines [51].
Pour la fixation du complément malgré le fait qu’elle détecte une proportion
considérable d’animaux atteints, elle ne donne pas de bons résultats chez les animaux
récemment infectés [67].
La technique ELISA permet de quantifier la réponse humorale des animaux
infectés expérimentalement par C. pseudotuberculosis en utilisant comme suspension
antigénique un surnageant de culture contenant essentiellement de l’exotoxine, et des
fragments de paroi bactérienne [49 ;59 ; 67].
Mais ce test, comme d’ailleurs les autres techniques (SHI : Synergistic Hemolysis-
Inhibition test), ne donne pas de bons résultats lors des diagnostics individuels de la
lymphadénite caséeuse [24]. Par contre, il est plus efficace lorsqu’il s’agit d’un groupe
suspect [59].
Globalement la sérologie n’est pas satisfaisante, car les tests restent encore peu
sensibles et peu spécifiques [45]. Cependant, en associant le dépistage sérologique par
l’ELISA et les vaccins préventifs ont permet d’éradiquer la maladie dans des élevages
en Australie (Tableau 4) [45].
Tableau 4: Techniques utilisés pour le diagnostic de la lymphadenite caséeuse[79].
Méthode de
Spécificité
Sensibilité
Problèmes
Culture
+++
+++
RAS
PCR
+++
+++
Coûteux, absente
dans le commerce
50
ELISA
++
++
Utile pour
l’éradication
Interféron
++
++
Coûteux et difficile
Utile pour
l’éradication
Intradermoréaction
9
9
Absence de réactif
dans le commerce
Sensibilite élevée +++, sensibilite modérée ++
XI. TRAITEMENT
Le traitement de la lymphadénite caséeuse n’est habituellement pas entrepris,
bien que le micro-organisme soit sensible à la pénicilline [34 ; 45].
Cependant, certaines pratiques thérapeutiques existent. Dans le cas de la forme
cutanée ou ganglionnaire superficielle, et après avoir isolé l’animal malade, il est
possible de procéder à l’ouverture des abcès, à leur vidange et à leur désinfection par
un antiseptique (exp. l’eau de javel à un degré chlorométrique, teinture d’iode diluée
au 1⁄4 etc.) [59]. Il convient de recueillir le pus et le détruire. On peut aussi utiliser le
formol qu’on injecte à l’intérieur de l’abcès sans l’ouvrir ce qui permet de stériliser le
pus de tout agent bactérien et d’éviter toute souillure par la matière purulente [82]. Il est
51
également possible de procéder à l’exérèse totale de l’abcès après anesthésie
locale [67].
L’effet des antibiotiques par voie parentérale n’est pas évident, en particulier
dans la forme pulmonaire ou les lésions sont irréversibles et protégées par des coques.
Il est donc plus justifié, dans cette dernière forme d’éliminer les cas rnalades chroniques
et renforcer les mesures d’hygiène [12].
XII. PROPHYLAXIE
• 1. Prophylaxie sanitaire
1.1. Locaux
On procédera à des épandages réguliers de superphosphates sur la litière; au
minimum une fois par an, une désinfection complète devra être effectuée, après lavage
et décapage, avec du formol (3 g/1) ou du phénol (30 g/1) ou autres désinfectants
agrées. Eventuellement et dans la mesure du possible, il conviendra de prévoir des
périodes de vide sanitaire [21].
Les parcs de rassemblement seront assainis par usage de sulfate de fer à 5 %, de
52
sulfate de cuivre à 5 % ou de cyanamide calcique (250-300 kg/ha).
Enfin, tout objet traumatisant devra être éliminé: clous, fils de fer. arrêtes
rugueuses... [10].
1.2. Elevage
Il importe de :
• Diminuer la densité des animaux;
• Prévoir un espace particulier dans la bergerie pour les agneaux;
• Procéder à l’isolement et à la reforme rapide des animaux porteurs de
plaies rebelles suppuratives, d’abcès visibles et aussi des brebis âgées
cachectiques, souffrant ou non de difficultés respiratoires chroniques.
Tout animal nouvellement introduit dans le cheptel doit être examiné en
recherchant notamment les abcès ou les traces d’abcès. Pour les apparemment sains, il
convient de se renseigner sur l’état sanitaire du troupeau d’origine [10].
Enfin, il peut s’avérer intéressant de distribuer aux animaux une alimentation
enrichie en zinc (carbonate de zinc 40 à 100 mg/animal/jour) et en magnésium (de 1 à 5
g/animal/jour) [21].
1.3. Manipulations
L’accent doit être mis sur l’hygiène de toutes les plaies (plaies de tonte, cordon
ombilical, castration, pieds) [67].
Le matériel de tonte sera désinfecté par trempage dans des solutions antiseptiques
(ammoniums quaternaires, tensioactifs amphotères). D’autre part, les animaux porteurs
d’abcès seront triés et tondus en dernier [68].
53
Lors de l’agnelage, on veillera à une désinfection du cordon ombilical à l’aide de
teinture d’iode par exemple [61].
Les plaies occasionnées lors d’opérations telles que la caudectomie ou la castration
par la méthode sanglante, le parage des pieds, feront l’objet d’une désinfection soignée.
La castration sera effectuée de préférence à la pince.
2. Prophylaxie médicale
La vaccination contre LC chez le mouton a été tenté avec une variété
d’antigènes, mais le succès varie. JOLLY R.D a montré la participation d’une toxine
dans la protection. Plus récemment, on a pu purifié la toxine et prouvée son efficacité
dans la protection contre la maladie [35].
Des recherches récentes montrent que la propagation de l’infection dans un
troupeau vacciné est faible par rapport à un troupeau non vacciné (Tableau 6) [56].
Des auteurs expliquent que l’élaboration d’un vaccin combinant des bactéries
mortes par passage dans du formol et de l’exotoxine inactivée permet une meilleure
protection. Les anticorps produits contre la bactérie morte aide à l’élimination de
C. pseudotuberculosis au niveau du site d’infection et les anticorps produits contre la
toxine préviennent la propagation de l’infection depuis le site d’inoculation [44 ; 88].
Hodgson et al. a montré que l’infection du mouton avec une souche non virulente
de C. pseudotuberculosis dont le gène responsable de la production de La PLD toxine
a été inactivé induit une immunité forte à LC, ce qui signifie que des antigènes autre
que PLD contribuent à la protection [32 ; 33].
54
Actuellement, on a découvert l’existence d’une protéine de poids moléculaire de
40 KDA. Le prélèvement de lymphocytes au niveau d’un ganglion drainant un site
infecté par la lymphadénite caséeuse a révélé une spécificité envers la protéine [81].
L’analyse par immunoblot de sérum provenant d’un animal infecté a montrée la
présence de la protéine comme antigène dominant. L’injection de deux doses de
100 ug de la protéine adjuvé à l’hydroxyde d’aluminium garantie baisse de 82% de
l’infection et une réduction de 98% des lésions pulmonaires [81].
La dernière tendance, en Australie, est de développer des vaccins issus de souches
génétiquement modifiées, surtout au niveau du gène de l’exotoxine [71].
Tableau 5: la prévalence de la lymphadénite caséeuse associée à l’utilisation de
différents programmes de vaccination [81].
Programme de vaccination de la
lymphadénite caséeuse
L’incidence de la maladie %
Programme complet
2 prises plus implant annuel 3
Programme incomplet
Sans vaccination 29
Une prise pour les agneaux, pas
d’implant 33
Une prise pour les agneaux, implant 31
56
MATERIEL ET METHODES
I. Choix de la région
Le choix de la région orientale a été basé sur deux éléments importants : d'abord
l'importance des abcès observés dans différents services d’élevage et aussi, et surtout,
l'intérêt accordé par le Laboratoire Régional d’Analyse et de Recherches Vétérinaire et le
service de l'Elevage de la Direction Provincial d’Agriculture d’Oujda (DPA) au thème de
notre étude. Ce sont là, donc, les deux motivations pour le choix de cette région comme
zone d'étude.
57
II. Monographie de la région : (source Anonyme. Monographie de la région orientale.
Direction Provinciale de l’Agriculture de la région d’Oujda 2002).
1. Situation géographique
La région de l’Oriental est située à l’extrême Nord - Est du Royaume. Elle est limitée
au Nord par la Méditerranée, à l’Est par la frontière avec l’Algérie, à l’Ouest par les
régions de Taza Al Hoceima Taounat et au Sud par les régions de Fès Boulemane et
Meknès Tafilalt (Figure18).
2. Superficie
La superficie de la région et de l’ordre de 82 820 km² soit 11,6% du territoire
national (l’équivalent de la superficie de l’Autriche ou de la Corée du Sud)
3. Altitude et morphologie du territoire
L’Oriental est confiné entre le Moyen Atlas et le Rif à l’Ouest, la Méditerranée au
Nord et la frontière Algérienne au Sud et à l’Est. La région est située dans une fourche
d’altitude allant de 0 à 1 732m (Jbel Bou Khouali). Elle est constituée de vallées et
couloirs, de chaînes montagneuses et de hauts plateaux dont l’altitude moyenne
dépasse les 1100m.
58
Figure 18: cartographie de la région d’Oujda (Source : Délégation Régionale de l'Oriental de la Prévision Economique et du Plan).
4. Climat
Le territoire régional engendre une diversité de climat importante : une zone
climatique du Nord, influencée par le climat subhumide et frais méditerranéen et une
zone climatique Sud, influencée par le bioclimat semi-aride.
La région de l’Oriental se caractérise par une mauvaise répartition des pluies dans le
temps et dans l’espace. Sa pluviométrie est comprise en moyenne annuelle entre 350 et
400 mm, largement en dessous de la moyenne nationale. La partie littorale bénéficie
d’apports spécifiques en matière de précipitations procurées par la proximité de la mer.
Celles-ci diminuent énormément vers le Sud à cause de l’influence continentale et ne
59
dépasse guère les 100 mm . Seules les parties élevées et les versants exposés des
quelques massifs septentrionaux reçoivent des pluies relativement abondantes dépassant
les 500 mm (Tableau 6).
La région est aussi connue par ses grandes oscillations thermiques favorisées par la
continentalité fort prononcée, l’altitude, la sécheresse de l’air et la grande ouverture sur
le désert. Les contrastes saisonniers variant d’une zone climatique à l’autre.
Tableau 6: Données climatiques de quelques station de l’Oriental
Centre
Distance
de la
mer
(km)
Altitude
(m)
Max
°C
Min
°C
Max-
Min
Pluies
(mm)
Quotidien
pluviométrique
Nador 0 5 29 77 21.3 350 53
Berkane 20 140 32.2 6.3 25.9 362 43
Oujda 45 530 34.1 4 30.1 340 38
Taourirt 100 390 36 3.5 32.5 237 24
Bouarfa 280 1310 38 2 36 196 17
Figuig 340 900 42 3.5 38.5 106 9
Jerada 105 1100 42 -1 41 158 -
5. Ressources du territoire
5.1. Ressources naturelles
60
Les principales activités de production dans la région portent sur l’agriculture, les
activités pastorales, la pêche, l’activité minière, l’industrie, le tourisme, le bâtiment,
l’artisanat.
5.2. L’eau, une denrée rare dans la région
La rareté des ressources hydriques dans la région de l’Oriental est due
essentiellement à la faiblesse des précipitations et des potentialités hydriques
superficielles. Les principaux cours d’eau de la région sont le fleuve de la Moulouya et
l’Oued Za. La faiblesse des ressources souterraines caractérisée par leur rareté, leur
dispersion et parfois leur charge en sel.
L’eau revêt dans cette région une importance tout à fait primordiale et conditionne
la vie économique et sociale dans toutes ses dimensions.
Les ressources en eaux superficielles mobilisées sont de un Milliard de m3 par des
barrages et lacs colinéaires dont les principaux sont Mohamed V, Hassan II et Machrâa
Hammadi.
5.3 Patrimoine d’hydrologie, bois et forêts, flore et faune
La superficie de la forêt naturelle y est de 2,5 Millions ha, dont 2 millions
recouverte d’Alfa, et la superficie reboisée de 70 221 ha. Bien que dominée, du point de
vue surface par l’Alfa, une flore très diversifiée recouvre le territoire. En plus des
différentes espèces d’arbres : le Thuya, le Palmier Dattier, le Platane, le Pin d’Alep, le
Chêne Kermes, le Chêne vert, il y a une diversité de plantes aromatiques et médicinales
telles l’Armoise, le Romarin, la Lavande , etc. De plus, le sud de la région est connu
pour sa production de truffes.
61
Une importante et riche faune existe aussi dans la région : oiseaux migrateurs tels la
Cigogne , le Flamand Rose, le Héron,…, mais aussi le gibier tel le sanglier, le lièvre, la
perdrix, l’outarde,…
5.4. La surface arable irriguée
La Superficie Agricole Utile, caractérisée par un dualisme agricole bour (non
irrigué) et irrigué, est de 8% de la S.A.U. totale du Maroc. Plus de 9/10 des terres de la
région sont incultivables, 16% des S.A.U sont irriguées dont 62% par la grande
hydraulique. Elle connaît des systèmes de production agricole divers : système intensif
dans le périmètre d’irrigation moderne des plaines de la basse Moulouya ; système
intensif traditionnel dans les oasis ; système de polyculture mixte dans le bour favorable
et la petite irrigation ; et le système est basé sur la céréaliculture dans le bour.
5.5. Elevage
La Région compte dans sa partie Sud une étendue de terrains (hauts plateaux) vouée
exclusivement à l'élevage qui peut être considéré comme la vocation essentielle de la
Région.
La disponibilité des parcours sur un large espace de la Région notamment sa partie
Sud constituée par les hautes plateaux couverts de steppes dominées par l'Alfa, constitue
une richesse pouvant contribuer au développement et à l'amélioration de l'élevage.
Les éleveurs s’installent sur le site à Alfa, en automne et en hiver, tout en se
rapprochant des champs d’orge pour le déprimage. Au printemps il passe sur le à
armoise et l’été certains éleveurs exploitent en plus les chaumes (annexe1). La période
de complémentation s’étale entre mi-octobre et mi-mars en bonne année climatique et va
jusqu’à mi-mai en mauvaise année, les distribuées sont variables et non raisonnées.
Bulletin de l’ANOC 2000.
62
Le cheptel est constitue de quatre espèce (ovine, caprine, bovine, cameline). Les
ovins dominent avec 88% des UGB (unité globale bétail) totales (El Germai, 1989). La
taille moyenne du troupeau est de 100 à 149 tête (tableau 7).
Tableau 7: Effectifs du cheptel selon les provinces (Annexe : 2) Cheptel Provinces
Bovins Ovins Caprins
Total
Oujda-Angad
Berkane
Jerrada
Taourirt
41 500
534 300
175 900
751700
Nador 36 100 513 000 41 900
Figuig 10 700 699 300 158 300
Total 88 300 1 746 600 376 100
6. Association Nationale Ovine et Caprine (ANOC) dans la région orientale
Le secteur de l’oriental est l’une des principales zones d’action de l’ANOC, composé
actuellement de neuf groupements ovins et trois caprins, avec 821 éleveurs et plus de
158 068 brebis et chèvres encadrées. Tous les groupements encadrés bénéficient d’un
certains nombres d’actions et un programme d’encadrement de l’ANOC : sélection,
santé animal, l’approvisionnement, formation, vulgarisation et autres actions de
développement (Annexe 3).
III. Enquêtes au niveau des élevages ovins
63
1. Choix des élevages
Le choix a été essentiellement porté sur les élevages encadrés par l’ANOC pour les
raisons de la facilité d'accès à ces élevages grâce à la disponibilité du technicien et à la
présence d'un véhicule et à la collaboration des éleveurs.
D’autre part, quelques élevages non encadrés par l’ANOC, 3 à 4 élevages par zone, ont
également été enquêtés.
2. Enquêtes et examen clinique du troupeau
Afin de déterminer les différentes paramètres épidémiologiques de la maladie des abcès,
une enquêtes a été effectué auprès 107 élevages de la région à l’aide d’un questionnaire
(fiche enquête élevage voir annexe 4). A cet effet, nous avons recueillie les informations
relatives aux :
- Cheptel ovin et son mode de conduite.
- Antécédents pathologiques et l'historique de la lymphadénite caséeuse
(L.C).
- Etat actuel de la L.C dans l'élevage.
Par la suite les animaux de chaque troupeau visité ont fait l’objet d’un examen clinique
pour recueillir l’éventuelle présence d’abcès cutanées et/ou ganglionnaires et déterminer
leurs caractéristiques et leur répartition. Tous les renseignements cliniques ont été notés
sur une fiche clinique (voir annexe 4).
IV. Enquêtes et collecte des prélèvements au niveau des abattoirs
1. Choix des abattoirs
64
Sur la base de l'importance des abattages d'ovins (Annexe 5: tableau sur
l'importance des abattages) Le choix a été porté sur cinq abattoirs :
- L’abattoir municipal d’Oujda
- L’abattoir communal de Ain Beni Mathar
- L’abattoir communal de Merija
- L’abattoir communal Sidi lahcen
- L’abattoir communal Al ateuf
Tableau 8: Distribution par province des abattoirs concernés par l'enquête:
Province
Abattoirs
Jours d’abattage
Oujda Oujda Angad
L; M; M; J; S
Ain Beni Mathar
L; M; M; J; S Jerrada
Merija JEUDI
Sidi lahcen
MARDI Taourirt Al ateuf
SAMEDI
2. Enquêtes et recherche des abcès sur les carcasses
Les abattoirs concernée par l’enquête ont fait l’objet de visite (annexe 6) au cours des
quelles on a relevé sur une « fiche abattoirs » (annexe 4) les informations relatives aux :
- effectifs des abattages;
- caractéristiques des animaux abattus, à savoir l'espèce, la race, le sexe
et le stade physiologique ;
- nombre des animaux présentant des abcès leur race, sexe et age ; et
- á la nature, importance et distribution des abcès sur les carcasses.
65
Au total 32 visites ont été réalisées: 14 visites dans l'abattoir d'Oujda-Angad, 10
visites à l'abattoir de Ain Beni Mathar, 4 visites à l'abattoir de Merija et 2 visites à
l'abattoir de Sidi lahcen (Tableau10).
Tableau 9: nombre de visites par abattoirs enquétés
Province Abattoirs Nombre de visite
Oujda Oujda-Angad 14
Ain Beni Mathar 10 Jerrada
Merija 4
Sidi lahcen 2 Taourirt
Al ateuf 1
3. Prélèvements
Des échantillons représentatifs d’abcès ganglionnaires et viscérales ont fait l’objet
de prélèvements. Les ganglions et/ou organes présentant des abcès ont été sectionnés,
prélevés et placés dans un pot hermétique contenant du formol tamponné à 10% en vue
le but de leur examen histopathologique. Au total 42 échantillons ont été prélevés.
V. Examen histopathologique
1. Préparation des coupes
66
Les tissus fixés ont été préparés selon les techniques histologiques usuelles au
laboratoire d’histologie du département anatomie-histologie, ces techniques comportent
les étapes suivantes :
� Lavage des pièces à l'eau courante ;
� Déshydratation à l'aide d'une série de bains d'alcool :
- Alcool à 70° pendant 1h 30 mn - Alcool à 90° pendant 1h 30 mn - Alcool à 95° pendant 3h - Alcool à 100° pendant 4h - Alcool à 100° pendant 12 11
� Eclaircissement à l'aide de deux bains de toluène :
- Toluène (1) pendant 1h 30 mn - Toluène (2) pendant 1h 30 mn
� Imprégnation par la paraffine dans une étuve à 56°C ; on procède à deux bains
successifs :
- Paraffine (1) pendant 3h - Paraffine (2) pendant 2h
� Inclusion des tissus imprégnés dans la paraffine sous tonne de bloc à l'aide
des barres de Leuckart.
� Confection de coupes histologiques de 5u d'épaisseur à l'aide d'un microtome
Jung.
� Collage des coupes sur lame porte-objet préalablement nettoyée et imbibée d'une
solution d'eau albuminée.
� Séchage dans une étuve à 50°C.
� Coloration des coupes histologiques à l'hématoxyline éosine :
- Réhydratation à l'aide d'une série de bains d'alcool : - Alcool à 100° pendant 5 mn - Alcool à 95° pendant 5 mn - Alcool à 70° pendant 5 mn - Lavage à l'eau courante - Coloration à l'hématoxyline de Harris pendant 5 à 10 mn
67
- Lavage à l'eau jusqu'au bleuissement des coupes : 5 à 10 mn - Coloration à l'éosine pendant 10 à 15 mn - Lavage à l'eau courante - Déshydratation dans trois bains d'alcool à 100°, 5 mn chacun - Eclaircissement des coupes dans deux bains de toluène, 5 mn chacun - Montage des coupes entre lame et lamelle à l'aide d'une solution EU KIT.
2. Lecture des coupes et description lésionnelle
Les coupes histologiques ainsi préparées ont été observées sous microscope optique
et une description des lésions microscopiques présentent au niveau des ganglions et des
tissus a été faite afin de caractériser les abcès.
VI. Analyse des données :
Pour la premiere partie des enquêtes, les calculs seront faits sur le logiciel excel .
Pour la deuxieme partie, ils seront faits par la methode de comparaison des moyennes et
la methode de comparaison de deux proportions.
68
RESULTATS
I. Présentation des élevages enquêtés
1. Distribution des élevages enquêtes
Le cheptel ovin intéressé par l'étude est représenté par environ 6368 têtes réparties sur
107 élevages avec une taille moyenne par troupeau de 54 têtes (Figure 19). Les résultats
récapitulatifs des effectifs par exploitation et leur répartition selon les quatre provinces
de la région orientale sont rapportés sur le tableau 11.
Les proportions des ovins dans les provinces de Berkane, Figuig, Jerrada, Oujda et
Taourirt sont respectivement 8,24 %, 22,94 %, 28,91 %, 33,18 % et 6,72 % (Figure 20).
69
Tableau 10: Distribution par province des effectifs enquêtés
Catégorie d’age Province Nbr. élevages
Jeunes < 1an
Adultes 2 à 3 ans
Adultes >4ans
Total
Berkane 7 210 214 101 525
Figuig 17 466 837 158 1461
Jerrada 32 615 1046 180 1841
Oujda 46 818 961 334 2113
Taourit 5 147 231 50 428
Total 107 2256 3289 823 6368
Taille du troupeau
< 20(9%)
> 100(12%)
20- 100(79%)
Figure 19: Répartition selon la taille du troupeau
70
8,24
22,94
28,91 33,18
6,72
- 5
10 15 20 25 30 35
Pourcentage
Berkane Figuig Jerrada Oujda Taourite
Provinces
Figure 20: Répartition selon les provinces enquêtées
2. Conduite des élevages
2.1. Mode d’élevage
L'élevage ovin dans la région d’étude est soumis à un mode de conduite extensif,
type traditionnel, basé surtout sur la transhumance (Tableau 12). Cependant certains
éleveurs; cinq situés à Oujda, trois à Jerrada,deux à Figuig et un à Taourirt s'intéressent à
l'amélioration de leur système de production par l’intégration du mode semi-extensif
caractérisée par l’engraissement des antenais.
Tableau 11: les systèmes d'élevages prédominant dans la région d'étude
Systéme extensif Systéme semi extensif Province
Nombre d’élevage Nombre
d’élevages % Nombre
d’élevages %
Berkane 7 7 100 0 0
71
Figuig 17 15 88.24 2 11.76
Jerrada 32 29 90.63 3 9.38
Oujda 46 41 89.13 5 10.87
Taourirt 5 4 80.00 1 20.00
Total 107 96 89.72 11 10.28
2.2. Hébergement
Les types de logements utilisés par les éleveurs présentent un plan standard, on
trouve les locaux, « zriba » et les « nowailes ». Les bergeries sont toutes ventilées de
façon naturelle. La superficie des bergeries varie d’un élevage à un autre avec une
prédominance des élevages restreints qui représentent 71% des élevages enquêtés
(tableau 13). Quant aux équipements présents, ils sont dans la plupart des élevages de
nature métallique (61% des élevages ; tableau 14 ; Figure 3).
Tableau 12: Fréquence des élevages selon la densité
Densité Nombre d'élevages Fréquence %
Elevée (animal/ <1m2) 76 71,03
Optimale (animal/ ≥≥≥≥ 1 m2) 31 28,97
Tableau 13: Nature des équipements dans les élevages
Equipements Nature Nbre d'élevages Fréquence %
Caoutchouc (Pneu) 10 9.35 Ciment 16 14.95
Métallique 30 28.04 Abreuvoirs
Plastique 51 47.66 Ciment 22 20.56 Mangeoires
Métallique 65 60.75
72
Plastique 20 18.69 Ciment + Métallique 60 56.07 Branche de plantes
épineuses 6 5.61
Métallique 25 23.36 Clôture
Ciment 16 14.95
Figure 21: Mangeoires métallique utilisés dans un élevage ovin
dans la région d'Oujda
2.3. Races exploitées
Les races ovines exploitées peuvent être subdivisées en trois classes :
� Les races pures représentées essentiellement par les ovins de la race Beni Guil
avec 52% de l’effectif total
� Les races croisées sont essentiellement composées de croisement de la race
locale de Beni Guil avec les races locales (les races Sardi et D’man) ou avec
des races importé (la race Algérienne « Ouelad Jallal ») pour améliorer les
performances productives des animaux.
� Les races mixtes sont représentées par un métissage de races, composé par des
races pures et des races croisées.
73
La répartition de l’effectif total selon les classes de races est donné au niveau de la
figure 22.
15%
40%
45% Race mixtes
Races croisées
Race pure Beni Guil
Figure 22: Répartition des animaux enquêtés selon la race
2.4. Type de production Dans la plupart des élevages, la production est subdivisée en deux catégories d’élevage, il y a la
production saisonnière axé sur la fête du sacrifice et la production annuelle destinée aux
marchés de bétail ou aux abattoirs.
2.5. Tonte Tous les éleveurs procèdent à une tonte des ovins à l'age d'un an au mois de mai. La
tonte est réalisée en respectant un ordre particulier relié au statut de santé des animaux
pour 14,02% (15/107 élevages) des éleveurs. Pour ceux-ci, les ovins malades sont tondus
après les animaux sains. Cependant cette règle n’accorde pas une importance aux
animaux atteints d’abcès.
La tonte est à 100 % manuelle, le personnel responsable de la toison est soit un
ouvriers saisonnier dans 47,66 % des élevage (52/107 élevages), soit un membre de la
74
famille à 32 % (35/108) ou soit un ouvrier permanent à 16,82 % (18/107 élevages)
(Figure 23).
0
10
20
30
40
50
60Pourcentage %
Saisonnier Famille etSaisonnier
Permanent Famille
Type d'ouvrier
Figure 23: Type d’ouvrier responsable de la tonte Le matériel de la tonte est rudimentaire, composé de ciseaux et d’un bac d’eau pour
le nettoyage. La désinfection du matériel est absente.
2.6. Conduite alimentaire
Dans la majorité des élevages visités, l’alimentation est basée sur des aliments
composés notamment , la pulpe sèche de betterave, orge, mais. L’accès au pâturage est
faible cela peut être expliqué par la succession des années de sécheresse qui ont affaibli
les parcours.
La sortie au pâturage avait généralement lieu au cours des mois d’ avril à juillet,
tandis que la rentrée en bergerie se déroulée entre les mois de novembre et décembre.
Ces parcours comptent énormément d’espèces, parmi les plus représentées, on note
Artemisia herba alba (armoise), Stipa tenacissima et d’autres ligneux comme Noaea
mucronata et des graminées vivaces ainsi qu’un nombre important de plantes (annexe).
75
Toutefois, ces pâturages représentent une cause de traumatisme des animaux suite à
l’ingestion de plantes épineuses, parmi ses plantes on note Atractiles serratuloédes,
Noaea mucronata et Xantium spinoum.
2.7. Reproduction
Le nombre d’animaux pubère au niveau des élevages étudiés s’élevé à environ
4112 têtes. Les males pubères sont toujours accompagnés des femelles par conséquence,
les périodes d’agnelage sont variables d’une région à une autre et parfois au sein de la
même région et d’un élevage à un autre. Cependant les naissances se font durant la
période allant d’octobre jusqu'à décembre.
Le sexe ratio dans ces élevages varie entre 9% et 9,34% avec une moyenne de
8,61%. Pour les brebis de la zone de Ain Beni Mathar. 10% des producteurs (11/107
éleveurs) ont eu recours à des méthodes de synchronisation oestrale pour au moins
certaines d’entre elles (Tableau 5).
Tableau 14: Le sexe ratio dans les élevages enquêtés
Province Nbr Beliers Nbr Brebis Sexe ratio %
Berkane 26 289 9
Figuig 77 918 8,39
Jerrada 89 1137 7,83
Oujda 110 1185 9,28
Taourirt 24 257 9,34
Total 326 3786 8,61
De plus, la méthode du flushing a été utilisée par 28 % éleveurs (30/107) des
producteurs. Ce flushing a été accompagné soit en donnant des grains incluant de l’orge,
du maïs et/ou du blé.
76
2.8. Hygiène et prophylaxie
Le nettoyage et la désinfection des bergeries sont pratiqués uniquement par 16
éleveurs sur les 107 élevages. C’est une mesure qui intéresse le sol et les murs. Le
désinfectant communément utilisé est la chaux (Tableau 16).
Le ramassage du fumier est pratiqué par tous les éleveurs, c’est une tache
quotidienne.
On ce qui concerne l’isolement des animaux malades, 48 élevages le réalise
systématiquement après le diagnostic d’une maladie, ce qui représente un pourcentage de
44,86 % La cohabitation des espèces surtout pour les caprins et ovins existe dans 43
élevages ce représente 40,19% des 107 élevages visités.
Le vide sanitaire est réalisé dans 8 élevages ce qui représente 7,48% des 107
élevage enquêtés (Tableau 16).
Tableau 15: Mesures d’hygiène et de prophylaxie dans les élevages enquêtés
Moyens d’hygiènes Emploi du moyen
Nombre d’élevages
Fréquence
Absent 59 55,14 Isolement des animaux atteints
Présent 48 44,86 Absent 91 85,05
Désinfection des locaux Présent 16 14,95 Absent 99 92,52
Vide sanitaire Présent 8 7,48 Présente 43 40,19
Cohabitation des espèces Absente 64 59,81
3. Historique de la maladie des abcès
D’après les éleveurs la maladie a été observée en début des années 1982 dans la
commune rurale de Ain Beni Mathar. Selon les éleveurs les raisons d’apparition de la
maladie sont l’introduction de race ovine algérienne « Ouelad Jallal » et la nature de
77
l’aliment distribuée aux animaux. Parmi les éleveurs enquêtés, 72 pensent qu’une ration
riche en orge, maïs et pulpe sèche de betterave prédispose les animaux à la maladie.
D’autres pensent que après l’introduction de l’aliment concentrie dans la région les
éleveurs utilisaient de plus en plus des mangeoires et des abreuvoires metallique qui
favorise le traumatisme des animaux. Ils leur parait aussi que les animaux présentant un
bon état d’embonpoint sont les plus atteints par les abcès.
Pour le diagnostic des abcès, les éleveurs se basent principalement sur deux signes
cliniques, à savoir la présence d’hypertrophie ganglionnaires et les abcès cutanés. En se
basant sur de tels symptômes, la maladie des abcès a été rapporté dans tous les élevages
enquêtés ce qui revient à dire que 100% des troupeaux de la région ont déjà connu un
passage de la maladie. Dans les élevages qui traitent les abcès, les éleveurs utilisent un
badigeonnage à l'eau de javel, la bétadine ou le miel (Figure 6).
0
10
20
30
40
50
60
pourcentage %
vidange +lavage à l'eau
de javel
Pas detraitement
Vidange +desinfection +antibiothérapie
Vidange +desinfection +
miel
Vidange +huile brulé du
moteur
Sacrif iel'animal
Traitements
Figure 24: Traitements couramment utilisés par les éleveurs pour lutter
contre la maladie des abcès
78
II. Prévalences de la maladie des abcès dans les élevages
La lymphadénite caséeuse a été diagnostiquée cliniquement dans 106 élevages, ce
qui représente presque la totalité des troupeaux enquêtés.
Le statut des animaux atteints a été déterminé à la fois au niveau des élevages et au
niveau de chaque zone de la région d’étude.
1. Prévalence dans les élevages enquêtés
Parmi les 107 élevages visités, la prévalence à l’intérieur des élevages a varié de 0%
(indemnes) à 90,3% avec une moyenne des élevages de 27,75%. La prévalence
moyenne de la maladie chez les élevages enquêtés par zone est le nombre d’élevages
atteints d’abcès par rapport au nombre total des élevages présentent dans la même zone.
Les zones d’Oujda, Berkane et Jerrada sont les plus touchées avec respectivement des
prévalences de 30,16%, 29,03% et 27,75 % (Tableau 17).
Tableau 16: Prévalences moyennes et globales des abcès à l’intérieur des élevages
Province Nombre d’élevages
Effectif total
Effectif des atteints
Prévalence moyenne ± ES
Max Min
Berkane 7 525 147 29 ± 4.24 37.78 23.75
Figuig 17 1461 321 21.73 ± 4.09 35.56 7.69
Jerrada 32 1841 406 27.76 ± 4.38 56.67 5.75
Oujda 46 2113 594 30.16 ± 4.94 96.30 0.00
Taourite 5 428 104 24.22 ± 3.69 28.09 17.91 Prévalence
globale 107 6368 1572 27.75 ± 2.64 96.30 0.00
* ES : Erreur standard
2. Prévalence par catégorie d’âge
79
La prévalence de la lymphadénite caséeuse chez les jeunes varie de 0% à 100%
avec une moyenne de 25,78% dans les bergeries les plus atteintes (Tableau 8).
Sur les 4112 adultes examinés, et repartis sur 107 la prévalence moyenne chez les
adultes est de 30,58% (Tableau 18).
Tableau 17: Prévalence de la lymphadénite caséeuse par catégorie d’age.
Catégorie Nombre
d’élevages Effectif examiné
Effectif atteint
Prévalence Moyennes ±
ES* Max Min
Jeunes 107 2256 530 25.78 ± 3.41 100.00 0.00
Adultes 107 4112 1042 30.58 ± 3.08 100.00 0.00
Prévalence globale
107 6368 1572 27.75 ± 2.64 96.30 0.00
* ES : Erreur standard
Une analyse statistique par le test de comparaison de deux proportions (test Khi
carré) a été réalisée pour déterminer l’effet de l’age sur la prévalence des abcès au
niveau des élevages, le résultat obtenu montre que la prévalence des abcès chez les
adultes est significativement plus élevé que chez les jeunes (< 0,01).
4. Localisation et distribution des lésions
Les lésions retrouvées sont essentiellement des hypertrophies ganglionnaires et des
abcès sous cutanés. L’incision de ses abcès laisse couler un pus épais de couleur jaunâtre
à verdâtre (Figure 26).
Sur la base des déclarations des éleveurs et en association avec les examens
cliniques des animaux, on a pu identifier les localisations les plus fréquentes des lésions
d’hypertrophie ganglionnaire et de suppuration. Les localisations au niveau de la tête et
de la région préscapulaire sont les plus fréquemment rencontrées dans 79% des élevages
enquêtés. Les atteintes des ganglions de la tête ont été rapportées dans 100% des
80
élevages (Figures 26,27 et 28). Les localisations peuvent être unique ou multiples chez le
même animal.
Figure 25: Une brebis de race Beni Guil présentant un abcès au niveau du ganglion
mandibulaire qui laisse couler un pus épais de couleur blanchâtre à verdâtre
Figure 26 Une brebis de race Ouelad Jellal présentant une hypertrophie du ganglion parotidien
81
Figure 27: Une brebis de race Beni Guil présentant une hypertrophie très marquée au
niveau des ganglions parotidien et du ganglion sous maxillaire 5 Analyse des facteurs de risque de la maladie des abcès
En vue de connaître les facteurs de risque favorisant l’apparition des abcès dans les
élevages enquêtés, une analyse statistique de comparaison des moyennes (Test t de
student) a été entreprise.
A cet effet, les facteurs de risque pris en compte au cours de cette analyse sont les
suivants :
� Classe de race : les races mixtes formés un mélange de races locales, de races
croisées et importé. Les races croisées formées par le croisement de la race Beni
Guil et les autres races. Les races pures de Beni Guil.
� Nature du matériel d’élevage : les mangeoires, les abreuvoirs et la clôture
� Densité des élevages
� Hygiène : la désinfection des locaux, l’isolement des animaux et le vide sanitaire
Les résultats obtenus par le test de comparaison des moyennes des prévalences en
fonction de ces différents facteurs sont représentés dans le tableau 1.
82
Ainsi, pour le facteur classe de races, il est non significatif malgré que les
prévalences moyennes diffèrent entre les classes.
Quant au facteur nature du matériel, seul les abreuvoirs contribuent
significativement dans la variabilité de la prévalence par élevage. Ainsi les éleveurs
utilisant des mangeoires métalliques ont une prévalence significativement supérieure
à celle des autres élevages.
Pour le facteur hygiène, les élevages pratiquant l’isolement des animaux
malades ont une prévalence significativement plus faible que les autres élevages.
En conclusion le résultat de l’analyse montre que les principaux facteurs
prédisposant à une forte prévalence de la maladie sont constituées par la densité
élevée des animaux dans les bergeries, l’utilisation d’un matériel traumatisant
notamment les abreuvoirs et l’absence de l’isolement des animaux malades.
Tableau 18: Résultats de l’analyse statistique des facteurs de risque des abcès dans les élevages enquêtés :
Facteur Classe Prévalence moyenne
Nombre d’observation
Valeur de t
dl Valeur de P
Signification
Races mixtes 32,20 16 0,7336 57 > 0,1 Races croisées 28,95 43 1,4801 89 > 0,05 Race Race pure de
Beni Guil 25,20 48 1,6358 62 > 0,05
NS
Non traumatisant
27,66 42 0,0578 Matériel mangeoires
Traumatisant 27,82 65
105
> 0,1 NS
Non traumatisant
29,47 77 2,0186 Matériel abreuvoirs
Traumatisant 23,34 30
105
< 0,05 +++
Non traumatisant
29,45 16 0,5261 Nature de la clôture
Traumatisant 27,46 91 105 > 0,05 NS+
Elevée 30,36 76 3,1637 Densité
Optimale 21,36 31 105 < 0,01 ++++
Absent 29,80 59 1,7057 Isolement animaux atteints. Présent 25,23 48
105
< 0,05 +++
83
Absent 28,46 91 1,2554 Désinfection des locaux Présent 23,74 16
105
> 0,1 NS
Absent 27,73 99 0,0545 Vide sanitaire Présent 28,01 8
105
> 0,1 NS
*NS : Non significatif ; +++ : signifdicatif ; Hautement significatif ; dl : degré de liberté III. Résultats des enquêtes au niveau des abattoirs
1. Effectif abattu et leurs caractéristiques
D’après les données compilées à partir des enquêtes effectuées au niveau des abattoirs,
12345 ovins ont été abattus durant les trois mois de l’enquête avec 92% des abattages qui
se sont effectués dans l’abattoir d’Oujda (Tableau 20).
Tableau 19: Effectifs abattus par abattoir et par sexe dans les provinces d’Oujda,
Jerrada et Taourirt.
Catégorie d’animaux Province
Femelles abattues Mâles abattus Total abattu
Jerrada 523 383 756
Oujda 7952 3414 11367
Taourirt 153 69 222
Total 8642 3703 12345
2. Caractéristiques des animaux abattus
Deux tiers des animaux abattus sont des femelles tandis que les males représentent
le tiers restant. Cette répartition ne variait ni avec la région ni avec les mois d’abattage
(Figure 29).
84
70%
30%
Femelles abattues
Mâles abattus
Figure 28: Répartition des animaux abattus en fonction du sexe Les deux tiers environ des animaux abattus appartiennent à la première classe
d’age (> 1 an). Les adultes dont l’age est compris entre 2 à 3ans représentent 26% des
animaux abattus alors que les animaux âgés de plus de quatre ans représentent 7%
(Figure 13).
6,84%
26,08%
67,20%
Jeunes 0-1 an
Adultes 2-3 ans
Adultes > 4ans
Figure 29: Répartition des animaux abattus en fonction de la classe d'âge
85
3. Prévalence des abcès
3.1. Prévalence globale enregistrée au niveau des abattoirs
Selon les registres des abattoirs enquêtés, sur les 12345 ovins abattus au niveau des
abattoirs enquêtés, 902 avaient des lésions d’abcès, 654 cas étaient observés uniquement
au niveau de l'abattoir d'Oujda. La prévalence de la maladie au niveau des abattoirs
variait entre 2.44 % et 45 % avec une moyenne de 15,93 % selon la zone. La prévalence
la plus élevé par province a été observé à Oujda avec 25,36 % (Tableau 21).
Tableau 20: Prévalence moyenne de la maladie au niveau des abattoirs
Province Nombre d’observation
Effectif abattu
Effectif atteint Prévalence moyenne± ES
Jerrada 16 756 190 25,36 ± 4,11
Oujda 15 11367 654 5,93 ± 0,84
Taourirt 3 222 24 15,61 ± 4,89
Prévalence globale 34 12345 902 15,93 ± 3,73
* ES : Erreur standard
86
3.2. Prévalence globale chez les animaux examinés
La prévalence des individus atteints d'abcès varie entre 2,31% et 30% avec une moyenne
de 10,03%. La prévalence moyenne par province ne présente pas une variation très
importante (Tableau 11).
Tableau 21: Prévalence moyenne de la maladie chez les animaux examinés
Province Nombre d'observation
Animaux examinés
Effectif atteint
Prévalence moyenne ±
ES Max Min
Jerrada 16 610 64 10,87 ±1,48 16,67 5,36
Oujda 15 3200 226 9,58 ± 3,96 30,00 2,31
Taourirt 3 166 12 7,79 ± 5,00 11,90 3,13
Prévalence globale
34 3976 302 10,03 ± 1,91 30,00 2,31
* ES : Erreur standard
3.3. Prévalence par classe d’âge
La prévalence moyenne observée de la lymphadénite caséeuse ovine par classe
d'age est de 7,10% chez les jeunes de moins d'un an, de 10,02% chez les animaux de 2 à
3 ans et de 18,29% chez les adultes de plus de 4 ans. Aussi, la prévalence notée chez les
adultes de plus de 4 ans a atteint un maximum de 66,67% (Tableau 12).
Tableau 22: Prévalence moyenne de la maladie par classe d’age
Nombre d’animaux Catégorie
d’age Nombre d'observation Examinés Atteint
Prévalence moyenne ±
ES Max Min
< 1 an 34 2672 167 7,10 ± 2,68 29,17 0,00
2 à 3 ans 34 1037 88 10,02 ± 2,15 30,00 0,00
87
> 4 ans 34 272 46 18,29 ± 5,09 66,67 0,00
* ES : Erreur standard
3.4. Prévalence par sexe
On a constaté que la prévalence moyenne au niveau des abattoirs par sexe est élevée
chez les femelles par rapport aux males avec une moyenne de 12,53% et un maximum
de 44,44% (Tableau 24).
Tableau 23: Prévalence moyenne de la maladie par sexe
Mâles Sexe Nombre
d'observation examinés atteints
Prévalence moyenne ±
ES Max Min
Males 34 1674 91 8,19 +/-2,43 26,92 0,00
Femelle 34 2302 211 12,53 +/-
2,98 44,44 1,95
* ES : Erreur standard
4. Nature et localisation des lésions observées
L’examen anté-mortem des animaux abattus a montré la présence d’abcès localisé
au niveau du tissu sous cutané et des nœuds lymphatiques.
L’examen post-mortem a révèle de nombreuse lésions superficielles (Figure 31) et
interne. Au niveau superficiel, les ganglions lymphatiques apparaissent volumineux (2 à
15 cm de diamètre) et l’incision de ses derniers laisse couler un pus épais et dense de
couleur vert pistache (Figure 33), parfois ce pus est disposé en lamelle circulaire ce qui
donne à la lésion un aspect rappelant la forme de l’oignon (figure 33). En plus le tissu
ganglionnaire apparaît rongés par le processus de nécrose. Au niveau interne, le poumon
et le foie ont montré des lésions circonscrites contenant un pus caséeux. On a noté aussi
des lésions d’abcès au niveau des ganglions trachéo-bronchiques et mediastinaux.
88
Figure 30: Abcès du ganglion poplité d’une carcasse
inspectée au niveau de l’abattoir d’Oujda.
Figure 31: Abcès du ganglion poplité d’une carcasse inspectée
au niveau de l’abattoir d’Oujda montrant un écoulement
de pus épais de couleur blanchâtre à verdâtre
89
Figure 32: Abcès au niveau des ganglions mediastinaux présentant
un pus dense et épais disposé en lamelles sous forme d’oignon
Aussi, on a constaté que 36 % des animaux inspectés présentaient uniquement des
lésions internes, 1,98 % montre une association entre les lésions internes et superficielles
(Figure 34). Ceci explique l’importance des localisations interne qui ne sont pas
détectées au niveau des élevages.
62%
36%
2% Lésions superficiellesseules
lésions interne seules
Association lésionsinternes et superficielles
Figure 33: Fréquence des associations des lésions internes et superficielles
90
Les ganglions de la tête et l’encolure sont les plus touchés. Ils sont impliqués dans
plus de 60 % des atteintes ganglionnaires, dont 52 % touchent les ganglions parotidiens
et 16 % les ganglions mandibulaires (figure 35).
12,59%
0,74%
39,26%
4,20%
0,74%0,74%
0,49%2,22%
8,15%
1,48%
20,00%
7,41%
1,98%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%Pourcentage
Mandibulaire
Rétropharyngien
Parotidien
Préscapulaire
Précruraux
Mandibulaire
Scrotal
Poplité
Médiastinaux
Trachéo-bch
Poumon
FoieGanglions + organes
Localisation des lésions
Figure 34: Localisation des lésions de la lymphadénite caséeuse L’inspection des ganglions et des organes internes montre que parmi les lésions
trouvées, 20 % est localisées au niveau du poumon (Figure 36), 7,41% situées au niveau
du foie et 8,59 % au niveau des ganglions mediastinaux et trachéo-bronchiques.
Parmi les animaux présentant des lésions d’organe, 80,65% ont des abcès au niveau
du poumon, 12,9% ont des lésions au niveau du foie et 6,46% ont à la fois des lésions au
niveau du poumon et du foie. Ces lésions d’organe ont été retrouvées chez des brebis
âgées de plus de 2 ans.
91
Figure 35: Abcès multiples au niveau du parenchyme pulmonaire chez une brebis
Figure 36: Abcès des ganglions mediastinaux et du poumon
(petite flèche) chez une brebis
92
IV. Caractéristiques lésionnelles microscopiques des abcès ganglionnaires et
pulmonaires.
L'examen histopathologique a concerné les prélèvements au niveau des abattoirs de
ganglions lymphatiques abcédés et/ou des abcès pulmonaires issus de 15 carcasses
ovines affectées.
1. Lésions des ganglions
L’examen microscopique des ganglions a montré selon leur stade évolutif deux types
de lésions suppuratives :
� La présence de lésions suppurées chroniques à sub-chroniques évolutives sous forme
d'abcès uniques ou multiples au niveau du tissu lymphoïde ganglionnaire dans 86,7%
des ganglions examinés (Figure 38). Ces abcès sont de taille variable, petits et grands
abcès. La plupart d’entre eux est constituée de trois zones (Figure , 39 & 40) :
� un centre caséo-nécrotique et suppuré sous forme d’un magma contenant des
débris cellulaires nécrotiques (essentiellement des débris de polynucléaires
neutrophiles) et de la fibrine avec parfois un dépôt de calcium (Figure 39 &
40). Ce magma nécrotique occupe la majorité de l'abcès surtout dans les abcès
de grande taille et présente un arrangement particulier, en couches ou lamelles
plus ou moins distinctes. Cet arrangement est responsable de l'aspect en
oignon perceptible macroscopiquement sur des ganglions affectés de
lymphadénite caséeuse.
� Une couche cellulaire entourant le centre nécro-suppuré et constituée par des
macrophages (histiocytes), lymphocytes et des plasmocytes (Figure 40).
� Une couche de fibrose qui tend à délimiter le processus de nécrose (Figure
38). Son importance et son étendu varie selon les cas:
93
� La fibrose délimite bien l’abcès et forme une coque qui l’isole du reste du
tissu lymphoïde ganglionnaire (Figure 38).
� La fibrose s’étend de façon diffuse dans le tissu lymphoïde avoisinant
provoquant ainsi la destruction complète du parenchyme. Cette fibrose
forme de vastes cordons qui emprisonnent le tissu lymphoïde. Ainsi, on
observe une atrophie de ce dernier (Figure 41).
� Dans certains cas, la suppuration au niveau des ganglions se présente sous
forme d’abcès peu délimités par une réaction fibreuse, et associée à une
nécrose diffuse du parenchyme lymphoïde avoisinant au pourtour de
l’abcès (Figure 42).
� La présence de lésions aigues de nécrose et de suppuration diffuse et très sévère du
parenchyme lymphoïde folliculaire et parafolliculaire aboutissant à une destruction
massive de ce parenchyme dans 13,4% (Figure 43).
94
Figure 37: Ganglion parotidien d'un agneau – Abcès avec une coque fibreuse s’étendant au reste su parenchyme ganglionnaire (grande flèche), zone cellulaire très réduite (petite
flèche) et centre caséo-calcaire (A). X4, H&E
Figure 38: Centre caséeux d’abcès ganglionnaire constitué de débris nécrotiques (A), de
polynucléaires neutrophiles (petite flèche), de fibrine (B) et de précipitation de calcium
(grande flèche). X40, H&E.
A
A
B
95
Figure 39: Centre caséeux d’abcès ganglionnaire constitué de débris nécrotiques de
polynucléaires neutrophiles, de fibrine (petite flèche) et de précipitation de calcium
(grande flèche). X10, H&E.
Figure 40: Ganglion parotidien – Destruction massive du parenchyme lymphoïde avec
fibrose diffuse et sévère (A) emprisonnant les quelques vestiges de follicules lymphoïdes
en cours de suppuration (B). X16, H&
A
B
96
Figure 41: Ganglion mandibullaire – Abcès (A) avec nécrose du parenchyme lymphoïde
avoisinant (B). X16, H&E.
Figure 42: Ganglion - Suppuration et nécrose diffuse et très sévère du tissu lymphoïde
folliculaire (A) et parafolliculaire (B). X10, H&E.
A
B
A
B
97
2. Lésions pulmonaires
Les lésions pulmonaires sont essentiellement des lésions chroniques à subchroniques
correspondant à la présence de lésions suppurées chroniques à sub-chroniques évolutives
similaires à celles décrites pour les ganglions. Elles sont sous forme d'abcès multiples au
niveau du parenchyme pulmonaire (Figure 44). Ces abcès sont en général de taille plus
petite que ceux observés au niveau des ganglions mais beaucoup plus nombreux et plus
délimités. Ils sont constitués également de trois zones :
� un centre caséo-nécrotique et suppuré sous forme d’un magma plus ou moins
étendu contenant des débris cellulaires nécrotiques (essentiellement des débris
de polynucléaires neutrophiles) et dépôt de calcium (Figure 44 & 45).
L'aspect en oignon perceptible macroscopiquement sur les ganglions n’est pas
souvent retrouvé au niveau des abcès pulmonaires(Figure 46) .
� Une couche cellulaire entourant le centre nécro-suppuré et constituée par des
macrophages (histiocytes), lymphocytes et des plasmocytes (Figures 45, 47 &
48).
� Une coque de fibrose qui tend à bien délimiter le processus de nécrose et de
suppuration (Figures 44 & 45). La fibrose s’étend également de façon diffuse
dans le tissu pulmonaire interstitielle avoisinant l’abcès. On note aussi la
présence de lésions de bronchiolite et de péribronchiolite associés aux lésions
décrites (Figures 49 & 50).
98
Figure 43: Poumon d'une brebis - abcès multiple avec coque fibreuse (A) et centre
caséeux à aspect en oignon caractéristique de la lymphadénite caséeuse (B). X4, H&E.
Figure 44: Poumon de brebis - un grand abcès pulmonaire avec un Centre caseo-
nécrotique occupant la majorité de l'abcès (A), une couche lympho-plasmocytaire et de
macrophage (B), le tout entouré d’une coque de fibrose (C) délimitant le processus de
suppuration. X4, H&E.
A
B
A
A
B
C
99
Figure 45: Centre d’abcès pulmonaire constitué de plusieurs couches ou lamelles caseo-
nécrotiques. X10, H&E.
Figure 46: Deux petits abcès confluents dans le poumon d'une brebis. X10, H&E.
100
Figure 47: Poumon de brebis - Paroi d’un grand abcès - Un tissu de fibrose (A) alterné
avec de la nécrose et de suppuration (B) et une couche macrophages, lymphocytes et
plasmocytes(C). X10, H&E.
Figure 48: Poumon de brebis - Fibrose pulmonaire interstitielle localisée au pourtour
d’une coque d’abcès (petite flèche) X10, H&E.
A
B C
101
Figure 49: Poumon – Suppuration et fibrose péribronchiolaire (grande flèche) et inter-
alvéolaire (petite flèche) X16, H&E.
102
DISCUSSION
Dans la région étudiée environ 100% des élevages enquêtés ont été trouvé affectés
par les abcès. Cette prévalence entre les élevages est très élevé par rapport à ce qui est
décrit dans d’autre pays. Au Royaume Uni, au cours d’une étude récente 5 à 63% des
troupeaux ont présenté des abcès (BAIRD et MALONE 2005) [6 ; 41]. En Egypte, 80%
des élevages ont été atteint d’abcès (MUBARAK et al. 1999) [49]. En Australie
occidentale, 74% des troupeaux avaient des lésions caractéristiques de la lymphadénite
caséeuse (PEPIN et al. 1994a) [57].
La prévalence moyenne des abcès était de 27,75% à l’intérieur des élevages
enquêtés et de 15,93% dans les abattoirs. Ces prévalences sont plus élevées par rapport à
celles rapportés en Egypte et en Jordanie et qui sont respectivement de 6,79% et 15,3%
dans les élevages et de 12,54% et 5,23% dans les abattoirs (MUBARAK et al. 1999)
[49].
La prévalence réelle dans les troupeaux pourrait être plus élevée. En effet, sur les
3976 carcasses inspectés, 75 (36%) présentaient uniquement des lésions interne, Cela
signifie que la prévalence étudiée au niveau des élevages est sous-estimée vue que seul
les lésions externes ont été concernées par cette étude, par conséquent un certain nombre
de cas aurait pu échapper au diagnostic clinique lors du suivi des élevages. Cette même
situation a été rapportée par Al-QUARAWI (2005) en Arabie Saoudite et par
RAYMOND (1999) et MALONE (2005) en Angleterre [3 ; 41].
Cette forte prévalence des abcès chez les ovins de la région de l’Oriental pourrait
être expliquée par le mode d’élevage pratiqué dans la région et qui se base
essentiellement sur la transhumance de ce fait les animaux se confrontent à plusieurs
facteurs favorisant la transmission et la dissémination de cette pathologie, notamment le
partage des mêmes parcours par différent troupeaux et l’existence de nombreuses plantes
vulnérantes et de buissons épineux qui peuvent engendrer des traumatismes importants
capables de traumatiser les animaux. D’autres facteurs peuvent être également
103
incriminés. En effet, comme l’a montré l’analyse des facteurs de risque, les équipements
traumatisants, la densité élevée et le manque d'hygiène sont les facteurs prédisposant à
la contamination et la dissémination des abcès dans un élevage. Cette même
constatation a été rapportée par REHBY (1994) et par BLOOD et al.(1994) [11; 65 ].
Globalement, le système d’élevage est purement extensif avec des périodes
de transhumance à la recherche des pâturages. Les locaux ont des superficies très
réduites avec des densités d’animaux très élevées. C’est le cas de la région d’Oujda ou
on note une densité de cinq têtes par deux mètres carré, ce qui favorise le contact entre
les animaux sains et malades et par conséquence la contamination comme cela a été
suggéré par Rehby (1994) [65].
Les équipements d’élevage sont traumatisants ce qui facilite l’introduction des
germes. Aussi, la tonte représente le principal facteur favorisant la contamination des
animaux vu les blessures et les éraflures provoqués lors de la toison et l’absence totale de
la désinfection du matériel. 37,38% des équipements sont traumatisants notamment les
abreuvoirs, les mangeoires et la clôture métallique sont utilisés respectivement dans
28,04%, 60,75% et 23,36% des élevages enquêtés. Ces équipements peuvent être
considérés parmi les outils les plus responsables des effractions cutanées avec un grand
risque d’inoculation de bactéries pathogène. Ceci expliquerait la prévalence élevée de la
maladie chez les animaux âgés qui subissent la tonte à l’age d’un an. Les même résultat
en été rapporté par PATON et al. (1994) et SAYED et al. (1995) [51 ; 70]
D’après les résultats trouvés, seulement 2 à 6% des éleveurs isolent et traitent les
animaux malades et 7% réalisent le vide sanitaire. Ce qui prouve que les conditions
d’hygiènes où sont élevés ses animaux sont défavorables. Ceci à des conséquences
directes sur la propagation de la maladie qui est diffusée rapidement dans ses élevages.
Ce même résultat a été rapporté par REHBY (1994) et par BLOOD et al. qui ont étudie
le rôle du mauvais entretien des animaux et des locaux sur la dissémination de la
lymphadénite caséeuse [11 ; 65].
104
Les abcès ouverts représentent la principale source de matières virulentes. La
principale voie de pénétration des bactéries étant tégumentaire.
La prévalence de la maladie tend à augmenter avec l’âge. En effet 66% de
l’effectif des sujets atteints au niveau des élevages est représenté par les béliers et les
brebis de plus d’un an ce qui est en concordance avec les résultats obtenus au niveau des
abattoirs où les animaux âgés de 2 à 3 ans et de plus 4 ans présentaient respectivement
une prévalence élevée de 18,28% et de 10,02% par rapport à ceux âgés de moins d’un an
(7,1%). Cette même tendance a été rapportée par GIRONES O. et al. (1992) qui a
constaté que la prévalence globale des abcès augmente avec l’âge [28]. Cette évolution
est probablement due au risque d’exposition répétée à l’infection auxquels sont soumis
les ovins de cette catégorie d’âge suite aux traumatismes. Des données épidémiologiques
publiées sur la maladie, par PATON et al. (1988) et par BLOOD et al. (1994) rapportent
que la maladie atteint son pic à l’âge adulte et que la majorité des nouvelles infections
s’acquièrent au cours des premières tontes [12]. PATON et al. (1988) ont constaté que
dans le cas de la lymphadénite caséeuse les adultes sont les plus touchés alors que lors de
notre enquête on a trouvé que malgré l’existence de différence significative de la
prévalence chez les jeunes < 1 an et les adultes > 1 an, les jeunes animaux sont touchés
par les abcès avec une prévalence de 25.78% et qui est très proche de la prévalence
moyenne globale (27.75%) [53]. Cette constatation est similaire a ce qui a été décrit pour
l’infection par Staphylococcus aureus subsp anaerobius (SAYED et al.1995 ; MOLLER
et al. 2000 ; EUZEBY 1999) [26 ; 47 ; 70].
Lors de l’examen clinique des troupeaux, les lésions retrouvées sont
essentiellement des hypertrophies ganglionnaires et des abcès sous cutanés ouvert ou
non. Susan et al. (1990), BUXSTON et al. Et BATEY et al.(1986) ont constaté le même
tableau lésionnel dans leurs enquêtes épidémiologiques : des abcès avec des réactions
ganglionnaires satellites dans à peu prés 100% des cas [9 ; 17 ; 78]. L’incision de ses
abcès laisse couler un pus épais de couleur jaunâtre à verdâtre, ce qui a bien été rapporté
par PEPIN et al. (1999) [61]. Dans certaines abcès le pus peut s’organiser sous forme de
lamelles circulaires rappelant l’aspect d’oignon. Cette disposition est une caractéristique
105
des abcès de la lymphadénite caséeuse (SAYED et al.1995 et LEÓN-VIZCAINO 2002)
[ 70; 87].
Ces abcès ont une nette tendance à survenir sur les mêmes territoires corporels chez
les animaux affectés: tête et région préscapulaire ; tête et mamelle et tête, flancs et
membres. Ceci peut être expliqué par la particulière fréquence des modes de pénétration
des germes par effraction cutanée. La localisation au niveau de la tête et de la région
préscapulaire est la plus fréquemment rencontrée dans 79% des élevages enquêtés.
Probablement du fait que cette région du corps est la plus exposée aux traumatismes et
par conséquent aux infections soit lors de l’abreuvement, les prise des repas ou des
opérations de toison (mangeoires et abreuvoirs métalliques et les ciseaux de tonte),
comme cela a été rapporté par BATEY (1986) et SAYED et al. (1995) et Al-
QUARAWI (2005) [3 ; 9 ; 70].
La majorité des lésions internes se trouve au niveau des poumons (80,65% des cas),
ceci peut être expliqué par le contact direct qu’ont les poumons avec le milieu externe.
Ce résultat est comparable a ce qui a été rapporté par Al-QUARAWI (2005) en Arabie
Saoudite, SCHREUDER (1986) en Hollande, MALONE (2005) et SMITH (1997) en
Angleterre [3 ; 41 ; 72 ; 77].
Les abcès décrits au cours de cette étude, sont dans leur majeure partie des abcès
chroniques à sub-chroniques évolutifs et localisés au niveau des ganglions, du poumon et
du foie. Ils sont constitués d’un centre caséo-nécrotique et d’une double couche
cellulaire et de fibrose. Cette nature et ces caractéristiques correspondent à ce qui a été
rapporté sur les abcès des ovins par plusieurs auteurs. Les lésions microscopiques
observées sont caractéristiques des abcès induits par Corynebacterium
pseudotuberculosis chez les ovins (JENSEN 1974 , EUZEBY 1999) [34 ; 86]. Cependant,
il a été décrit que ses mêmes lésions peuvent être aussi causées par Staphylococcus
aureus subsp anaerobius (SAYED et al.1995 ; MOLLER et al. 2000 ; EUZEBY 1999)
[ 47; 70; 86].
106
L’examen microscopique des ganglions a révélé deux types de lésions, des abcès
évolutifs bien délimité par une réaction fibreuse dans 86,7% des cas et des lésions de
nécrose et de suppuration diffuse et severe dans 13,3% des cas. SAYED et al. (1995)
rapportent que les lésions sévères de nécrose et de suppuration sont liées au haut pouvoir
pathogène des germes responsables de la formation des abcès [1]. EUZEBY 1999 ont
montré que certaines souches de Corynebacterium pseudotuberculosis présentent une
haute virulence responsable de lésions sévères de nécrose lymphocytaire au niveau des
ganglions [86]. De même, DE LA FUENTE et al. (1985) ont noté que le Staphylococcus
aureus subsp anaerobius possède un pouvoir pathogène très important associé à une
sévère nécrose des ganglions [19].
Des lésions d’abcès ont été déjà rapporté chez les ovins de la race D’man au Maroc
par AIT BALAHCEN (2001) avec une prévalence de 24,5%[1]. Ils été attribués à
Staphylococcus aureus subsp anaerobius (61,5%), à Streptococcus dysgalactiae (9,6%),
à Actinomyces pyogenes (7,7%) et à Corynebacterium pseudotuberculosis (5,6%). Aussi,
des lésions d’abcès ont été décrites chez le dromadaire au sud du Maroc par RAMICHE
ALI (2001) avec une prévalence de 18% [64]. Ces lésions étaient de deux types : des
lésions de lymphadénite dans 68% des cas et des lésions de nécrose cutanée dans 32%
des cas. Les lésions de lymphadénite ont été associées à Staphylococcus aureus (75%), à
Corynebacterium ulcerans en association avec Staphylococcus aureus (10%), à
Corynebacterium pseudotuberculosis en association avec Staphylococcus aureus (5%) et
Streptococcus dysgalactiae en association avec Staphylococcus aureus dans (10%). Les
lésions de nécrose cutanée était dues principalement au Staphylococcus aureus.
Etant donné que les lésions observées au cours de notre étude sont similaires à
celles décrites lors des infections par Corynebacterium pseudotuberculosis ou
Staphylococcus aureus subsp anaerobius. Il est nécessaire, pour pouvoir trancher en
faveur de l’un ou de l’autre germe et d’établir un diagnostic étiologique sur, de procéder
à l’isolement et à l’identification de ses deux bactéries pathogènes à partir des lésions
d’abcès ganglionnaire rencontrés chez les ovins dans notre pays.
108
Au terme de cette étude sur les abcès des ovins dans la région de l’Orientale, nous
retenons ce qui suit ;
� La prévalence des abcès chez les ovins de la région orientale est très élevé, 100%
des élevages sont atteints avec une prévalence moyenne de 30% ce qui engendre
des pertes économiques importantes représentées par la diminution de la
production (viande, laine et lait), de la valeur marchande des animaux et par la
dévalorisation des peaux et les saisies de carcasses et d’organes à l'abattoir.
� Les animaux adultes sont les plus affectés.
� les principales sources de contamination sont l’introduction ou l'existence
d'animaux malades, notamment présentant des abcès superficiels ouverts.
� les facteurs prédisposant aux abcès sont les équipements traumatisants, la densité
élevée et le manque d'hygiène ; surtout lorsque les abcès sont traités
sommairement sans désinfection ni de la plaie, ni du matériel utilisé.
� Les abcès sous cutanés et ganglionnaires sont les formes cliniques les
plus rencontrées. Les localisations au niveau de la tête et de l'encolure sont les
plus fréquentes.
� Les caractéristiques lésionnelles des abcès sont semblables à celles décrites pour
les abcès dus à Corynebacterium pseudotuberculosis et à Staphylococcus aureus
subsp anaerobius.
RECOMMANDATIONS
109
La mise en place d’une stratégie de lutte contre ce fléau basée essentiellement sur:
� Renforcement des mesures d’hygiène
� amélioration des conditions d'hébergement avec notamment une réduction de la
densité animale et l'utilisation des équipements non traumatisants.
� instauration d'une quarantaine avant l'introduction de tout animal nouveau, et
isolement des moutons ayant des abcès externes.
� Traitement adéquat des animaux malades avec destruction du pus et élimination
des cas graves.
� Vulgarisation auprés des éleveurs de l’intêret des bonnes pratiques d’élevage
� Sensibilisation du pouvoirs publics de l’importance de la maladie dans les
élevages ovins.
De pousser les investigations épidémiologiques, pathologiques et bactériologiques
afin de déterminer d’avantage les facteurs de risque, d’evaluer l’impact eco-pathologique
et d’identifier les éventuelles étiologies qui seraient responsables de l’apparition des
abcès chez les ovins aussi bien dans la région de l’oriental que dans d’autres régions du
Maroc.
110
[1] AIT BALAHCEN M. (2000).
Etude clinique et épidémiologique de la lymphadénite caséeuse chez les petits ruminants
dans la région de Ouarzazate. Thèse de doctorat vétérinaire, IAV Hassan II.
111
[2] ALEMAN M., SPIER S.J., WILSON (D.), et DOHERR (M.) : (1996).
Corynebacterium pseudotuberculosis infection in horses: 538 cases (1982-1993). J. Am.
Vet. Med. Assoc. 209: 804-809.
[3] Al-QARAWI A. (2005).
Physiopathological changes associated with abscesses in sheep at AL-Qassim region of
Saudi Arabia. Proceedings of the 6th international sheep veterinary congress, Greece,
17-21 June 2005; p 126-127.
[4] ASHFAQ M.Q and CAMPBELL S.J. (1994).
Cellular composition of Corynebacterium pseudotuberculosis pyogranulomas in sheep.
J. Leuk. Biol. 56: 666-670.
[5] AUGUSTINE JOHN L. and HARLAND W. RENSHAW (1986).
Survival of Corynebacterium pseudotuberculosis in axenic purulent exudate on common
barnyard fomites. Am. J. Vet. Res. 47(4) April : 713-715.
[6] BAIRD G.J. and MALONE F.E. (2005).
Control of ovine caseous lymphadenitis based on regular ELISA testing. Proceedings of
the 6th international sheep veterinary congress, Greece, 17-21 June 2005; p 136-137.
[7] BATEY RG. (1986).
Frequency and consequence of caseous lymphadenitis in sheep and lambs slaughtered at
a western Australian abattoir. Amer. J. Vet. Res. 47:482-485.
[8] BATEY RG. (1986).
Pathogenesis of caseous lymphadenitisin sheep and goats. Aust Vet. J. 1986, 63(9): 269-
272.
[9] BATEY R.G. (1986).
112
Lésions of the head in ovine caseous lymphadenitis (bacteria sheep). Aust. Vet..J. 63(4):
131
[10] BEN TAHAR M. (1999).
Pathologies cutanées chez les ruminants domestiques. Thèse de doctorat vétérinaire IAV
Hassan II.
[11] BLOOD D.C., HENDERSON J.A and RADOSTITS O.M. (1994).
Veterinary Médecine, Baillère Tindal, 5éme édition , London, 1763p.
[12]BLOOD D.C., RADOSTITS O.M. and GAY C.C. (1994).
Veterinary Medicine. Baillière Tindall, 8th édition, London, 1763p.
[13] BRANCO J. (1992).
Incidence de la lymphadénite caséeuse. Rec. Med. Vet. Janvier : 35-40.
[14] BROGDEN, K.A., ENGEN, R.L., SONGER, J.G., GALLAGHER, J. (1990).
Changes in ovine erytrhocyte morphology to sphingomyelin dégradation by
Corynebacterium pseudotuberculosis phospholipase D. Microbiol Pathogen. 8: 157-
162.
[15] BROGDEN K.A. et ENGEN R.L. (1990).
Altérations in phospholipid composition and morphology of ovine erythrocytes after
intravenous inoculation of Actinomyces pseudotuberculosis. Amer. J. Vet. Res. 51(6):
874-877.
[16] BRUGERE-PICOUX J. (1994).
Maladie des Moutons - Manuel Pratique. Ed. France Agricole. 150p.
[17] BUXTON A. et FRASER G. (1984).
113
Animal microbiology. Volume 1 : Immunology, Bacteriology, Mycology, Diseases of
Fish and Laboratory Methods. Blachvell Scientifîc Publications. 178-183 p.
[18] CHIKAMATSU S., ZHAO H., KIKUCHI N., HIRAMUNE T. (19 89).
Seroepidemiological survey of Corynebacterium pseudotuberculosis infection in sheep
in Japan using Enzyme-linked Immunosorbent Assay and Immunodiffusion Jpn. J. Vet.
Sci. 51: 887-891
[19] DE LA FUENTE R., SUAREZ G. et SCHLEIFER K.H .(1985). Staphylococcus
aureus subsp. anaerobius subsp. nov., the causal agent of abscess disease of sheep. Int. J.
Syst. Bacteriol., , 35, 99-102.
[20] EGGLETON DG, DOIDGE CV, MIDDLETON HD, MINT DW. (199 1).
Immunization against ovine caseous lymphadenitis: Comparison of Corynebacterium
pseudotuberculosis vaccines with and without bacterial cells. Aust. Vet. J. 68: 317-319.
[21] EL FASSI FIHRI. (1988).
Les maladies infectieuses des ovins -Tome 1. Ed. actes editions 262p
[22] ELLIS J.A, CAMPOS M., SNYDER M., CHELAK B and HAINE S DM.
(1995).
Local production oftumor necrosis factor-a in corynebacterial pulmonary lésions in
sheep. Vet.Pathol. 32: 68-71.
[23] ELLIS JA, LAIRMORE MD, O'TOOLE DT, CAMPOS M. 1991.
Differential induction of tumor necrosis factor alpha in ovine pulmonary alveolar
macrophages following infection with Corynebacterium pseudotuberculosis, Pasteurella
haemolytica, or lentiviruses. Infect. Immun 59(9): 3254-3260.
114
[24] ELLIS TM, SUTHERLAND SS, WILKINSON FC, MERCY AR, PA TON
MW.(1987).
The role of Corynebacterium pseudotuberculosis lung lesions in the transmission of this
bacterium to other sheep. Aust. Vet. J. 64:261-263.
[25] ELLIS J.A. (1988).
Immunophénotype of pulmonaire cellular infiltrâtes in sheep
with viscéral caseous lymphadenitis. vet. Patho.25 : 362-368
[26] EUZEBY 1999.
List of Prokaryotic Names with Standing in Nomenclature. Immunology, Bacteriology,
Mycology, Diseases of cheep and Laboratory Methods. Blachvell Scientifîc
Publications. 178-183 p.
[27] GHANBARPOUR R., MOSHREF M. (2005).
A bacteriological study on superficial lymphadenitis in sheep slaughtered in southeastern
of Iran. Proceedings of the 6th international sheep veterinary congress, 17-21 June 2005;
p 181.
[28] GIRONÉS, 0., SIMON, M.C., ALONSO, J.L. (1992).
Linfadenitis caseosa. I. Importancia econômica-sanitaria. Etiologia, epidemiologia y
patogenia. Med. Vet. 9: 135-148.
[29] GOLDBERGER A.C., LIPSKY B.A., PLORDE J.J., (1981).
Suppurative granulomatous lymphadenitis caused by Corynebacterium ovis
(pseudotuberculosis). Am. J. Clin. Pathol. 76: 486–490.
[30] GUILLOTEAU L.P., PIN M., PARDON P et LE PAPE A . (1990). Recrutement
of 99m-Teenetium or 111- Indium-labelled polymorphonuclear leucocytes in
experimentally induced pyogranulomas in lambs. J. Leuk. Biol. 48: 343-352
[31] HODGSON A.L.M. et WOOD P.R. (1997).
115
Cytokine gène expression in sheep fonowing experimental infection with various strains
of Actinomyces pseudotuberculosis differing in virulence. Vet. Res.
[32] HODGSON ALM., BIRO P et NISBET I.T. (1990).
Cloning, nucleotide séquence and expression in Escherichia coli of thé phospholipase D
gène from Actinomyces pseudotuberculosis. J. Bacteriol. 172 : 1256-1261.
[33] HODGSON ALM; KRYWULT J; CORNER LA; ROTHEL JS; RADFO RD
AJ. (1992).
Rational attenuation of Corynebacterium pseudotuberculosis: potential cheesy gland
vaccine and live delivery vehicle. Inf. and immun.60(7) : 2900-2905
[34] JENSEN R. (1974).
Caseous lymphadenitis (pseudotuberculosis). Diseases of sheep. Philadelphia: Lea &
Febiger, 1974;366-369.
[35] JOLLY R.D. (1965b).
The pathogenic action of the exotoxin of Corynebacterium ovis. J. Comp. Pathol. 75:
417-431.
[36] JOLLY, R.D. (1965c).
The pathogenic action of the exotoxin of Corynebacterium ovis. J. Comp. Pathol. 75: 417-431.
[37] KATHLEEN M. CONNOR, MALCOM M. QUIRIE, GARAHAM BAIRD , and
WILLIAM DONACHIE (2002) .
Characterisation of United Kingdom isolates of Corynebacterium pseudotuberculosis
using pulsed-field gel electrophoresis. J. Clin. Microbio. July 2000. 38(7): 2633-2637.
[38] KURIA J.K., NGATIA TA. (1990).
Caseous lymphadenitis of sheep and goats in Kenya. Bulletin of Animal Health and
Production in Africa. 38(1): 15-18.
116
[39] LLOYD S. (1994).
Caseous lymphadenitis in sheep and goats. In Pract. 16:24-29.
[40] LLOYD S., H.J. LINDSAY, J.D. SLATER, and P.G.G. JACKSON. (1990).
Caseous lymphadenitis in goats in England. Vet. Rec. 127:478.
[41] MALONE F.E., S.A. FEE, E.M. KAMP, D.C. KING, G.J. BAIRD, K.M.
REILLY and F.E.A. MURDOCK. (2005).
A comparison of pathological, bacteriological and serological examinations in sheep
from four flocks naturally infected with caseous lymphadenitis. Proceedings of the 6th
international sheep veterinary congress, Greece, 17-21 June 2005; p 226-227
[42] MAKINDE A. (1982).
Diagnostic procédures in veterinary bacteriology and mycology. p. 420-432.
[43] MELDRUM K.C. (1990).
Caseous lymphadenitis outbreak. Vet. Rec. 126: 369.
[44] MICHAEL D., PIONTKOWSKI., DOUGLAS W. et SHIVVERS. ( 1998).
Evaluation of a commercially available vaccine against Corynebacterium
pseudotuberculosis for use in sheep. JAVMA. june l .11:212.
[45] MICHAEL J., WILSON., MALCOLM R., BRANDON. AND JOHN
WALKER. (1995).
Molecular and Biochemical Characterization of a Protective 40-
Kilodalton Antigen from Corynebacterium pseudotuberculosis. Infection and
immunity. p. 206-211.
[46] MIDDLETON, M.J., EPSTEIN, W.M., GREGORY, G.G., (1991).
117
Caseous lymphadenitis on Flinders Island: prevalence and management surveys. Aust.
Vet. J. 68: 311–312.
[47] MOLLER K., AGERHOLM JS, AHRENS P, JENSEN NE, NIELSE N TK
(2000).
Abscess disease, caseous lymphadenitis, and pulmonary adenomatosis in imported
sheep. J. Vet. Med B. 47:55-42
[48] MUCKLE C.A. and GYLES C.L. (1983).
Relation of lipid content and exotoxin production to virulence of Corynebacterium
pseudotuberculosis in mice. Am. J. Vet. Res. June 1983. 44(6) : 1149-1153.
[49] MUBARAK M, BASTAWROWS AF, ABDEL-HAFEEZ MM, ALI MM .
(1999).
Caseous lymphadenitis of sheep and goats in Assiut farms and abattoirs. Asst.Vet. Med.J.
42(83) : 89-112.
[50] NAIRN M.E et ROBERTSON J.P. (1974).
Actinomyces pseudotuberculosis infection of sheep : rôle of skin lésions and dipping
fluids. Aust. Vet. J. 50 : 537-542.
[51] PATON M.W., ROSE I.R., HART R.A., SUTHERLAND S.S., MERCY A.R.,
ELLIS T.M., DHALIWAL J.A., (1994).
New infection with Corynebacterium pseudotuberculosis reduces wool production. Aust.
Vet. J. 71: 47–49.
[52] PATON MW., SUTHERLAND S.S., ROSE AL., HART R.A MERCY A.R et
ELLIS TM. (1995).
118
The spread of Actinomyces pseudotuberculosis infection to unvaccinated and vaccinated
sheep. Aust. Vet. J. 72: 266-269.
[53] PATON MW, MERCY AR, SUTHERLAND SS, ELLIS TM. (1988) .
The influence of shearing and age on the incidence of caseous lymphadenitis in
Australian sheep flocks. Acta veterinaria sacandinavia. suppl. 84: 101-103.
[54] PATON M.W., ROSE I.R., HART R.A., SUTHERLAND S.S., MERCY A.R., ELLIS
T.M. (1996).
Post-shearing management affects seroincidence of Corynebacterium pseudotuberculosis
infection in sheep flocks. Prev. Vet. Med. 26:275-284.
[55] PEEL M.M., PALMER G.G., STACPOOLE A.M., KERR T.G., (1997). Human
lymphadenitis due to Corynebacterium pseudotuberculosis: report of ten cases from
Australia and review. Clin. Infect. Dis. 24:185–191.
[56] PEPIN M., PARDON P., MARLY J. et LANT1ER F. (1988).
Actinomyces pseudotuberculosis infection in adult ewes by inoculation in thé extemal
ear. A m. J. Vet.Res.49:459-463.
[57] PEPIN M., PATON M., et HODGSON L. M. (1994a).
Pathogenesis and epidemiology of Corynebacterium pseudotuberculosis infection in
sheep. Curr. Top. Vet. Res. 1:63-82.
[58] PEPIN M., PITTET JC., OLIVIER M., GOHIN I. (1994b).
Cellular composition of Corynebacterium pseudotuberculosis pyogranulomes in sheep.
J. Leuk. Boil. 56 :666-670.
[59] PEPIN M., FONTAINE J.J., PARDON P., MARLY J. et PARODI AL. (1991).
Histopathology of the early phase during expérimental Actinomyces
Pseudotuberculosis infection in lambs. Vet. Microbiol. 29: 123-134.
119
[60] PEPIN M., PARDON P., MARLY J., LANTIERF et ARR1GO J L. (1993).
Acquired immunity after primary caseous lymphadenitis in sheep. Am. J. Vet. Res. 54:
873-877.
[61] PÉPIN M., SANCHIS R. et PATON M. (1999).
La lymphadénite caséeuse des ovins et des caprins. Point. Vét. 30 : 33-40.
[62] PÉPIN, M., PARDON, P., LANTIER, F., MARLEY, J. , LEVIEUS, D., LAMAND, M.
(1991).
Experimental Corynebacterium pseudotuberculosis infection in lambs: kinetics of bacterial
dissemination and inflamation. Vet. Microbiol, 26: 381-392.
[63] RADAELLI G. (1998).
Corynebacterium. In : FARINA, R. AND SCATOZZA ,
F. (eds), Trattato di Mallatie Infettive degli Animais Domestici ( UTET, Torino).
[64] RAMICH A. (2001).
Etude des abcès superficiels chez le dromadaire (camelus dromaderius)dans le sud du Maroc.
Thèse de doctorat vétérinaire, IAV Hassan II.
[65] REHBY L. (1994).
Les maladies de la peau et de la laine. G.T.V., 3-OV.197-208
[66] RICARD J.P H.P . (1968).
Contribution à l’étude de la maladie caséeuse. Thèse de doctorat vétérinaire, ENVA.
[67] RICHARD Y., FONTAINE M., OUDAR J., FONTAINE MP. (19 79).
Contribution à l’étude de l’épidémiologie et de la pathogénie de la maladie des abcès du
mouton. Comp. Immun. Microbial. Infect. Dis. 2:125-148.
120
[68] RIZVI S., GRENN LE., GLOVER MJ. (1997).
Caseous lymphadenitis: an increasing cause for concern. Vet. Rec. 140:586-587.
[69] ROBINS R. (1991).
Focus on caseous lymphadenitis. State Vet. J. 1:7-10.
[70] SAYED AM, ABDEL-FATTAH AM, MANAA AM (1995).
Caseous lymphadenitis of sheep in Assiut governorate: disease prevalence, lesion
distribution, and bacteriological. Assiut Vet. Med. J. 33:65, 88-92.
[71] SAVEY M., et al. (1995)
Diagnostic des maladies à virus lent chez les ruminants
domestiques. Maghreb Vétérinaire. Déc. 5 :23.
[72] SHREUDER B. E. C., E. A. TER LAAK, and H. W. GRIESEN. (1986).
An outbreak of caseous lymphadenitis in dairy goats: 1st report of the disease in the
Netherlands. Vet. Q. 8:61-67.
[73] SHREUDER B. E. C., E. A. TER LAAK, DE GEE ALW (1990). Corynebacterium
pseudotuberculosis in milk of caseous lymphadenitis affected goats. Vet. Rec. 127:127.
[74] SCHREUDER B.E.C., LAAK E.A. et DERCKSEN D.P. (1994).
Eradication of caseous lympadenitis in sheep with the help of a newly developed ELISA
technique.Veterinary Record (United Kingdom). 138(8): 174-176.
[75] SERIKAWA S., ITO S., HATTA T., KUSAKARI N., SENNA K .,
HIRAMUNE T., KIKUCHI N. and YANAGAWA R. (1994).
Protection from caseous lympadenitis in sheep by spraying iodine tincture on shearing
wounds. J. Vet. Méd. Sc. 56 (2): 411-412
[76] SIMMONS CP, DUNNSTAN SJ, TACHEDJIAN M, KRYWULT J,
HODGSON ALM, STRUGNELL RA. (1989).
121
Vaccine potential of attenuated mutants of Corynebacterium pseudotuberculosis in
sheep. Infect. Immun. 66: 474-479.
[77] SMITH M.C. (1981).
Caprine Dematologie Problems : A Review. JAVMA. 178: 724.
[78] SUSAN E., AIEWO B.S. et al. (1990).
Lymphadenitis and lymphangitis. The Merck Veterinary Manuel, 8ème éd., Marck &
Co, inc. Whitehouse Station N.J, USA, 55-57
[79] SUTHERLAND S.S., HART R.A. et BULLER N.B. (1996).
Genetic differences between nitrate-negative and nitrate-positive C. pseudotuberculosis
strains using restriction fragment length polymorphisms. Vet. Microbiol. 49 : 1-9.
[80] WEISH R.D. (1994)
Corynebacterium pseudotuberculosis in the horse. Equine Practice. 12: 7-16.
[81] YERUHAM I., BRAVERMAN Y., SHPIGEL NY., CHIZOV- GINZBURG A.,
SARAN A., WINKLER M. (1996).
Mastitis in dairy cattle caused by Corynebacterium pseudotuberculosis and the feasibility of
transmission houseflies. Vet. Quart. 18:87-89.
Webographie : [82] ANONYME. (1996).
Cheesy Gland Caseous Lymphadenitis in Sheep. NSW AGRICULTURE AGFACT
A3.9.2 l, 2nd édition 1996.
122
[83] ANONYME . Monographie de la région orientale. Direction Provinciale de
l’Agriculture de la région d’Oujda 2002
[84] ANONYME .Bulletin de l’ANOC 2000. www.inra.ma
[85] CUBERO PABLO M.J., REAL VALCÂRCEL F., GONZALEZ CAN DELA
M., LEÔN-VIZCAINO L. (2005).
Epidemiologia de la Pseudotuberculosis. \ http://www.exopol.com/ EXOPOL Circular
188.htm.
[86] EUZEBY J.P. (2003).
List of Prokaryotic Names with Standing in Nomenclature.
http://www.bacterio.cict.fr/alintro.html, mise à jour du 16/12/2003
[87] LEÓN-VIZCAINO L., GARRIDO ABELLÁN F., GONZALEZ CANDELA M
et CUBERO PABLO M.J. (2002).
Anatomía patológica de la pseudotuberculosis. \ http://www.exopol.com/ EXOPOL
Circular 205.htm.
[88] VIRGIL FLEMING. (2000)
Formalin, Formaldehyde & Caseous Lymphadenitis.www. goatworId.com/Article.
124
'. Annexe 1 : Principales espèces pastorales rencontrées dans la région d’étude
Herbacées Armoise
Arteinisia herba alba
Ligneux
Salsola venniculata
Thymus sp
Atriplex halimus
Pithorantos scorapus
Marubum vulgare
Anabasis oropediorum
Helianthenum cf virgatum
Hemiaria fontanesil
Teurerium polium
Lycium intricatum
Salsola siaberi
Halogeton alopecuroides
Astractylis Serratuloides
Crucifères annuelles
Cf crotalaria soharse
Eruca vesicaria
Ronapharus raphanistrum
Filago cg gennanica
Plantago albicans
Schismus barbalus
Vella integrefolia
Frankenia corymbosa
Centauria tennifolia
Mocaudia suffructifolia
Paranychia sp
Astractylis polycephala
Lygeum spartum
Plantago sp
Salvi verbenaca
Erodium guttatura
Medicago sp
Stipa pivitlora
Koeleria valisiana
Horeum murinum
Schismus barbalus
126
Annexe 2..: Effectifs du cheptel de la région de l'oriental (2004)
Province Commune rurale Bovins Ovins Caprins J Merija 700 36000 1500 E Ouled Ghziel 1900 95000 4000 R Ouled Sidi Abdelliakem 1750 75000 12000 A Beni Mathar 2000 68000 10000 D Gafait 500 5000 2500 A Bkhata 280 3000 3500 Laaouinate 400 11 000 7000 Guenfouda 650 16000 10000 Tiouli 1300 55000 9000 Si di boubeker 180 12000 3000 Ras Asfour 300 7000 8500 TOTAL: 9960 383000 71000 T El Ateuf 360 40000 10000 A Ouled Mhamed 500 80000 10000 0 o led sidi Ali BeJgacem 400 30000 30000 U Si di Lahcen 320 28000 30000 R Ain lahjar 850 38000 20000 1 Tantcherfi 280 25000 30000 RT Mechma Hammadi 300 22000 22000 TOTAL: 3090 263000 152000 BERKA Taforalt 350 6000 1000 NE Rislane 200 15000 6000 Bouhria 980 20000 3000 TOT AL: 1530 41000 10000 OUJDA Ah! Angad 5500 35000 6000 A Isly 1300 25000 1500 N Si di moussa 650 20000 5000 G Mestferki 130 14000 8000 A Boulanoir 280 15000 7000 D Beni Khaled 2200 20000 3000 Ain sfa 800 24000 10000 Bsara 460 10000 1200 P.u. Oujda 1000 TOT AL: 12320 163000 41700 TOT AL GENERAL: 26820 850000 274700
127
Annexe 3: Distribution des brebis encadrées par éleveurs et par groupement: source:
Bulletin de l'Association nationale des ovins et des caprins de la région orientale 2000.
Nombre Nombre de brebis Province Groupements Espèces
d'éleveurs encadrées JERRADA A,B,M Ovins 58 13856 O,S,A Ovins 56 15700 O,S,ALI Ovins 87 21610 TIOULI. Ovins 68 7430 O,GHZEIL Ovins 61 18450
TOTAL 330 77 246
FIGUIG B,G,E Ovins 34 15235 B,G,O . Ovins 39 18250 B,G,C Ovins 53 13420 B,G,N Ovins 89 11600
TOTAL 215 58 505
OUJDA 1 256 TAZA 1 1500 BERKANE TAFOGHALT Ovins 89 2962 Caprins 2419
TOTAL ï137
TAOURIRT EL AIOUN Ovins 123 3842 Caprins 6098 TAOURIRT . Ovins 62 3011 Caprins 2229 . TOTAL 185 15180 TOTAL GENERAL ,
821 158068
133
Annexe 5 : Importance des abattages selon les communes dans la région orientale 2004 :
Ovins Abattoirs
Nombre Poids en kg
Communautaire d'Oujda 122792 1600928
Municipaux Beni Drar 14251 187045 Naima 1589 18732 J erada 6681 94564 Guenfouda 332 4100 Touissit 420 5051 Am Beni Mathar 8305 1 11404 Debdou 603 9165 El Aioun 2121 23530 Taforalt 1326 15624 Ruraux Tiouli 536 6420 Bouhria 1564 18768 -..,
Rislane 1916 23113 Am sfa 2379 28186 Mrija 1097 11343 Sidi Boubeker 281 3329 Total 166193 2161302
134
Listes des abattoirs contrôlés
Province Commune Jours d'abattage Jour du souk
L-M-M-J-S - Oujda Angad Oujda ville , , "
BniDrar Tous les jours Jeudi
Ain Sfa Samedi Samedi
Naima Jeudi Jeudi
Sidi Moussa Mardi Mardi
Berkane Bouhria Mer ;V ;D Vendredi
Taforalt Mer; V ; Mercredi
Rislane D Dimanche
Taourirt El Aioun L;M;M;J;S Mardi
Debdou L;M;M;J ;S Mercredi
Tencherfi Jeudi Jeudi
L-M-M-V-S Jerada Jerada Ville
S ,D
Ganfouda M; J ; S Samedi
L-M-M-J-S
Ain Bni Mathar
Mardi
Tiouli Jeudi Jeudi
T ouissit
Boubker
Merija V ;( Hssayan diab Vendredi L (Merija) Lundi
135
ا������ ا������� �� ا��� ا ����� ���#را!� و ا�����ة�
أ%�و$���دة ا��آ,+را* (� ا��) ا�����ي � ��.�
ة �� ��ف �� ا����2ل !�� ا�0,�ح
�� ���� : ا��م ا����� ا�
��ا��� ا����� ��#را!� وا�����ة ( ة ��اد 7+اد:ا45,�ذ ��ر:��): ��ا��� ا����� ��#را!� وا�����ة( �.�# ���4:ة�ذا45,�� :(�.�,��
��,��): ي @�صر��<( ��;= �>� ا��;�:ا��آ,+ر ��ا��� ا����� ��#را!� وا�����ة( (+زي آ2+: ا45,�ذ����Bر): ��ا��� ا����� ��#را!� وا�����ة ( �D�4ن�+ ����:ا45,�ذ����Bر):
�����2005
10101 ا ����ط ا� ,�ه*6002ب .�,+* ا�()� ا �'��& �را$� و ا�"! ��� ص
Tél. : (037) 77 17 58/59/45 ou 77 07 92, Fax : (037) 77 81 35 ou 77 58 38
درا�4 و��:�� و ���D�� ��Fار;E !.� ا��D(�ن��G�2ا� ��Hا� �)