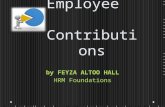Contribution du fleuve sebou (Maroc)
Transcript of Contribution du fleuve sebou (Maroc)
Sidi Mohammed AlaioudContribution du fleuve Sebou
dans le développement des sites antiquesdu Gharb (Maroc)
Le Sebou, Sububus, se présente comme une véritable voie de communicationqui a permis, à travers les âges une pénétration sur plusieurs dizaine de kilo-mètres depuis la cote atlantique jusqu’à la région de Fès. Il avait joué un roledans la genèse et le développement des villes antiques du Gharb, et en parti-culier, les sites majeurs de Banasa et de Thamusida. Les avantages du milieugéographique et la position des deux sites ont fait de ces derniers un poled’attraction pour une implantation humaine, qui va bénéficier des avantagesdu fleuve dans les relations avec le monde extérieur.
Mots-clés: Sebou, Thamusida, Banasa, Gharb, Maroc antique.
Le besoin de drainer les produits vers les ports, qui se trouvaientdans des régions non loin des fleuves navigables et dans les zoneslimitrophes à leur rives, pour les exporter vers Rome 1, déterminale role primordial de ces derniers comme moyen de communica-tion et de transport.
Ces voies de communication ont toujours été indispensables pourl’écoulement des produits de consommation dans les deux sens etont contribué au développement économique des sites qui s’y trou-vent sur leur bord, en assurant les contacts commerciaux du Marocantique avec plusieurs régions de la Méditerranée (FIG. 1).
Sebou dans la plaine du Gharb
Parmi les fleuves (navigables) les plus importants du Maroc onpeut citer le Sebou, Sububus, (FIG. 2) déjà dés les époques antiquescomme étant un fleuve navigable 2 durant l’époque antique au Ma-
* Sidi Mohammed Alaioud, ????????.1. Nous distinguons entre trois types de voies: maritime, fluviale et terrestre.2. D’après Pline l’Ancien c’est un fleuve magnificus et navigabilis, (PLIN., nat.
hist., V, 5).
L’Africa romana XIX, Sassari 2010, Roma 2012, pp. 00-00.
roc. Le Sebou prend naissance dans les gorges du massif dumoyen Atlas à environ 120 km au sud-est de Fès. Son cour esttrès tortueux et sa largeur ainsi que sa profondeur sont assez con-sidérables 3. Le régime hydraulique de ce fleuve est caractérisé parune irrégularité, liée à la variation de son débit qui dépend de laquantité des précipitations durant l’année. Pour ce qui est de soncour, J. Lecoz rapporte que «la marée se fait sentir le long du Se-bou jusqu’à sidi Allal Tazi ou ses effets sont très amortis» 4. Il
3. On ajoute à ces donnés géographiques les témoignages des textes. Dans cecontexte on cite Hassan Alwazzan (Léon l’Africain) «[...] Son cours est rapide, sonvolume d’eau considérable, mais il est guéable en maint endroit [...]», cfr. LEON L’A-FRICAIN, Description de l’Afrique, vol. 2, Paris MBCCCXCVII, p. 33, note 1.
4. J. LECOZ, Le Rharb: fellahs et colons: étude de géographie régionale, Rabat1964, p. 192.
Fig. 1: ??????.
Sidi Mohammed Alaioud2490
subit l’influence de la marée et peut abriter, avant que son embou-chure ne soit ensablée, des flottes dans ses vastes replies 5.
Tout au long de son trajet les dépots d’alluvions bordent lesdeux rives 6. Cet état qui est du à «[...] la nature du perchementdes cours d’eau et de merjas déprimées d’interfluve, indique unecertaine continuité dans l’entretien et l’alimentation de cette confi-guration. Ainsi il y a globalement confirmation du role des rivièresdans l’importation des matériaux fins et celui des inondations dansla redistribution apparemment généralisée de ces apports [...]» 7.Ce fleuve est aussi connu par ses richesses halieutiques, surtout l’a-lose qui n’a disparu que ces derniers temps à cause de plusieursfacteurs liés à la pollution de ses eaux par les unités industriellesde la région du Gharb 8. Ce genre de poisson s’exportait séché et
5. CH. TISSOT, Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie Tingitane,dans Mémoires présentés par divers savants à l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 1ère série, t. 9, Paris 1878, p. 90.
6. J. LECOZ, Banasa: contribution à l’étude des alluvions Gharbiennes, «BAM», 4,1960, p. 470.
7. D. FASSI, A propos du repérage archéologique dans une plaine d’inondation: Lecas du Gharb, VI Colloque international sur L’histoire et L’archéologie de L’Afrique dunord (Pau, octobre 1993, 118 congrès), Paris 1995, p. 293.
8. Ibn Abi Zar’rapporte que «[...] c’est dans ce fleuve que l’on pêche le chabel
Fig. 2: ??????.
Contribution du fleuve Sebou dans le développement des sites antiques du Gharb 2491
salé. Les témoins archéologiques sur la pratique de la pêche à l’é-poque antique sont des dizaines d’hameçon de différentes tailles enbronze, découverts lors des anciennes fouilles à Banasa 9, et la pré-sence probable d’une usine de salaison à Thamusida 10.
Ajoutons qu’il était pour longtemps un moyen d’acheminementessentiel dans la plaine du Gharb 11, en particulier au moment oùles routes connaissaient des difficultés liées aux aléas climatiques 12.
Ce fleuve court dans une plaine d’alluvions argileuses, de cou-leur rouge, rarement grisâtre. Ces alluvions forment, quand ellessont mouillées, une vase fluide. Elles constituent à la fin de l’étéun sol crevassé de nombreuses fentes 13. D’ailleurs toute la plaineapparait comme une construction du Sebou et de ses affluents 14.
et le boury (l’alose et le mulet), qui arrivent si frais et en si grande quantité sur lesmarchés de la ville [...]», IBN ABI ZAR’, Roudh el-kartas: Histoire des souverains duMaghreb (Espagne et Maroc) et Annales de la ville de Fés, traduit de l’arabe par A.Beumier, Paris MDCCCLX, p. 40. De même l’anonyme auteur d’Al Istibsar: «on pêchedans cette rivière grand quantité d’alose qui y remonte jusqu’a la source. Il s’y trouveaussi beaucoup d’autre poisson, parfois on y pêche des gros poissons. Le poisson estapporté à la ville à dos d’âne, cette espèce est appelé par les gens K’orb». ALMAJ-
HOUL, Kitab al Istibsar fi ’ajaib al-Amsar, Description de la Mekke et de Médine, del’Egypte et de l’Afrique septentrionale, texte arabe annoté par Saad Zaghloul Abde-Hamid, Casablanca 1985, p. 186. LEON L’AFRICAIN, Description de l’Afrique, cit., p.33, note 1, «[...] Il abonde en bons poissons, particulièrement en aloses [...]».
9. R. THOUVENOT, Une colonie romaine de la Maurétanie Tingitane Iulia ValentiaBanasa, Paris 1941, p. 54 et 95.
10. R. REBUFFAT, J.-C. CALLU, J. MOREL, G. HALLIER, J. MARION, Thamusida, 1,fouilles du service des antiquités du Maroc, Paris 1965, p. 5.
11. En plus de sa fonction comme une artère pour la navigation, il a été consi-déré comme limite naturelle, mais la découverte du site de sidi Mokhfi-Gadadrar re-met en cause cette hypothèse du Sebou en tant que limes. En plusles sites de sidiMokhfi-Gadadrar et de sidi Mhamed ben Ahmed prouvent que la zone située entreles merjas et le fleuve était occupé au moins dés la création de la colonie de Banasa:A. AKERRAZ, V. BROUQUIER-REDDE, E. LENOIR, Nouvelles découvertes dans le bassindu Sebou. 1. L’occupation antique de la plaine du Gharb; 2. Voie romaine et systèmede surveillance militaire sur la carte d’Arbaoua dans L’Afrique du Nord antique et mé-diévale. Productions et exportations africaines. Actualités archéologiques. 118e Congrès,VI
e Colloque international sur l’histoire et l’archéologie de l’Afrique du Nord, (Pau, oc-tobre 1993), Paris 1995, p. 254.
12. «Le Sebou arrose tout le riche pays du Gharb dont les produits en tant queleur exportation est permise, seraient facilement portés à la cote par cette voie écono-mique»: L. OSKAR, Timbouctou voyage au Maroc au Sahara et au Soudan traduit del’allemand par Pierre le Haut Court, t. 1, Paris 1886, p.142.
13. E. POBEGUIN, Sur la cote ouest du Maroc, Paris 1908, p. 35.14. J. CELERIER, Les mérjas de la plaine du Sebou, «Hespéris Tamuda», 2, 1er-
2ème trimestres, 1922, p. 132.
Sidi Mohammed Alaioud2492
Cette plaine est occupée par des collines qui accentuent les val-lées des rivières, barrée du coté de l’océan par un long cordon du-naire taillé en falaises qui s’ouvre à l’estuaire du Sebou.
Les crues périodiques de ce fleuve ont constitué une levée for-mée d’alluvions limono-sableux 15.
J. Lecoz a mentionné que «les alluvions rharbiennes sont d’âgehistorique, et que la formation de la levée du Sebou s’est dérouléà un rythme accéléré au cours des cinq siècles précédant l’èrechrétienne et à un rythme plus lent depuis lors [...]» 16. L’impor-tance des accumulations dans la plaine s’explique par la grandedifférence de phase entre l’amont et l’aval. Dans ce contexte liéaux crues et alluvions qui couvrent des sites du Gharb nous citonsles conclusions du Driss Fassi, «il peut s’agir des glissements de si-tes résiduels sur des berges déstabilisées faisant un affleurement desites enfouis» 17; nous avons les exemples des sites Souk Jem’a elHaouafat et Sidi Larbi Jem’a. Les vestiges archéologiques enfouistémoignent de l’ampleur et de la vitesse des sédimentations 18.Cette plaine renferme par endroits des marais temporaires, les mer-jas, qui se gonflaient à la première pluie, et qui ont été localiséespar J. Celerier sur des cartes 19. Malgré la présence de merjas et lesinondations répétitives du Sebou, l’installation humaine dans leGharb est attestée dans plusieurs zones. Les premières traces decette occupation se rencontrent dans la couche sableuse qui setrouve après la couche argileuse Mellahienne 20.
Le fleuve dans les sources
On trouve Sebou dans les textes sous différentes appellations:Ubus, Subus, Sububus, Subur, Soubour 21, Pline l’Ancien le nommeSububa 22. On ajoute que Ch. Tissot considère que Subur était lenom d’une ville qui a remplacé Tymiatirion d’Hannon 23.
15. AKERRAZ, BROUQUIER-REDDE, LENOIR, Nouvelles découvertes, cit., p. 237.16. LECOZ, Banasa, cit., p. 469.17. FASSI, A propos du repérage, cit., p. 296.18. Ibid., p. 294.19. CELERIER, Les merjas de la plaine du Sebou, cit., p. 109-38, 5 cartes.20. LECOZ, Le Rharb fellahs et colons, cit., p. 53.21. Son nom phénicien Soubour fait allusion à la masse de ses eaux: voir TISSOT,
Recherches sur la géographie comparée, cit., p. 89.22. R. ROGET, Index de topographie antique du Maroc, «PSAM», 4, 1938, p. 75.23. TISSOT, Recherches sur la géographie comparée, cit., p. 227.
Contribution du fleuve Sebou dans le développement des sites antiques du Gharb 2493
Pour ce qui est de l’étymologie du nom de Sebou nous nousréférons à l’hypothèse de R. Rebuffat qui a rapproché «les deuxformes Subul et Subur de mots puniques faisant allusion aux va-gues qui se brisent [...]» 24. Plusieurs textes s’accordent à le quali-fier comme le plus important des fleuves de l’Afrique septentrio-nale après le Nil 25. La navigabilité est attestée par les textes de-puis le v siècle av. J. C. jusqu’au début du xx siècle. Dans les an-ciens périples on cite que les galères puniques remontèrent le bas-Sebou jusqu’au port de Banasa:– Hannon aurait navigué, vers le v siècle av. J. C., dans le Cretes,qui n’est que l’actuel Sebou, jusqu’à Cerné qui correspondrait, d’a-près R. Rebuffat, à l’actuelle Djezira Sidi Youssef 26.– Pseudo Scylax: «après Lixos on trouve le fleuve Crabis, port etla ville phénicienne appelée Thymiateria [...]» 27, le fleuve Crabisdoit être le Sebou qu’Hannon atteignit deux jours après avoir fran-chi le détroit de Gibraltar 28. La grande ville des Ethiopiens citéedans le périple après Cerné ne pourrait être que le site de Banasa.Mnaseas d’après Pline l’Ancien, le nomme «Crathis, un fleuve quisort d’un lac pour se jeter dans l’océan» 29.– Pline l’Ancien «A cinquante milles de Lixus, on trouve le Sub-ubus, fleuve imposant et navigable [...]» 30.– Ptolémée le place entre 6,50-34,20 et son embouchure entre6,20-34,20 31.
Le fleuve Sebou est également mentionné par plusieurs auteurs dumoyen Age, et des époques moderne et contemporaine:– Albakri nous parle d’une «grande rivière nommée Sebou» 32 etil ajoute «le fleuve Sebou qui est à quatre milles de fez dont lesbords sont couverts de villages» 33. Ibn Abi Zar’ dans Roudh el-
24. REBUFFAT, CALLU, MOREL, HALLIER,MARION, Thamusida 1, cit., p. 56.25. M. BESNIER, Géographie ancienne du Maroc, «Archives Marocaines», 1904, p.
337.26. R. REBUFFAT, Recherches sur le bassin du Sebou, II. Le Périple d’Hannon,
«BAM», 16, 1985-86, p. 257-84.27. R. ROGET, Le Maroc chez les auteurs anciens, Paris 1924, p. 19.28. R. COINDREAU, La casbah de Mehdia, Rabat 1946, p. 17.29. ROGET, Index, cit., p. 75.30. ROGET, Le Maroc, cit., p. 30.31. Ibid., p. 36-38.32. ALBAKRI, Kitab al-Masalik wa al mamalik, Déscription de l’Afrique septentrio-
nale, trad. de M.G. DE SLANE, Paris 1965, p. 217-8.33. Ibid., p. 271-2.
Sidi Mohammed Alaioud2494
kartas décrit que «Le fleuve Sebou, qui n’a qu’une seule source,sort d’une grotte de cette montagne et suit son cours à l’est deFès, à une distance de deux milles [...]» 34.
L’anonyme auteur d’Al Istibsar disait «l’un des plus considéra-ble du Maghreb prend sa source dans la montagne des BenouWartin [...]l’eau jaillit d’un bosquet ou l’en redoute de pénétrer etoù il ya de la vase dont on ne peut atteindre le fond. Les locauxquand ils veulent s’assurer qu’un malade va guérir ou non, ilsl’emmènent à cette source» 35.
Al Idrissi nomme «un immense fleuve découlant des environsde la montagne d’alqalaa d’Ibn Tawala et passant non loin de Fas[...]» 36 et il ajoute «au sud d’al Basra, aux abords du Sebou, fleu-ve provenant des environs de Fas se situe un grand village, appeléMasna [...]» 37.
Le sultan mérinide Abou Inan a ordonné la construction dedeux vaisseaux à Khalouen, ils ont descendu le Sebou jusqu’àMaamora 38.
Vers le XIV siècle Ali Guéznayi dans Zahrat al Aass apporteque les barques et les navires pouvaient remonter l’oued depuisl’atlantique jusqu’au son confluent 39. Plusieurs bateaux ont descen-du le fleuve pour atteindre l’Atlantique et la Méditerranée 40. Ilajoute que Fez eu vers le milieu du XIV siècle un chantier de con-structions navales au lieu nommé Alhobbart 41.
H. Decastries apporte que «[...] Philippe III, avant de chercherà réaliser d’autres desseins, envoya Don Pedro de Tolède avec mis-sion de combler ce port, en y coulant des navires chargés de pier-res. L’opération ne réussit pas parce que Don Pedro ne pénétrapas assez avant dans l’estuaire de l’oued Sebou, le courant du fleu-ve et le ressac de la mer curent bien vite désobstrué le port» 42.
34. ABI ZAR’, Roudh el-kartas cit., p. 40.35. ALMAJHOUL, Kitab al Istibsar, cit., p. 184.36. AL IDRISSI, Nuzhat al Mustaq fi Dikr al Amsar wa al Aqtar, Napoli-Roma
1974-75, p. 535.37. Ibid., p. 531.38. G. S. COLIN, Fès port de mer, «BEPM», 31 année, n• 183, octobre-
decembre 1954, p. 260.39. ALJAZNAI, Jany Zahrat al-As fi Binai Madinat Fas, texte arabe annoté par A.
Ibn Mansour, (2 éd.), Rabat 1991, p. 37.40. ALJAZNAI, Jany Zahrat al-As, cit., p. 38.41. Ibid., p. 8.42. H. DECASTRIES, Sources inédites de l’histoire du Maroc, première série dynastie
Saadienne, t. 1, Paris-La Haye 1906, p. 624-5.
Contribution du fleuve Sebou dans le développement des sites antiques du Gharb 2495
Eloufrani, dans la Nozhet-Elhadi, «le prince Abou AbdellahMohammed fit exécuter de magnifiques travaux parmi lesquels oncite le pont de la rivière du Sebou» 43.
Dans d’autres textes «[...] le Seboû prend sa source, dans degrandes cavernes où l’eau jaillit d’une grotte formant fente dans lesrochers [...] Seboû jette ses eaux dans l’Océan, au lieu dit El-Ma’m» 44.
D’après Hassan al Wazzan (Leon L’Africain) «[...] Le fleuveSebou qui n’a qu’une seule source sort d’une grotte et suit soncour à l’est de Fez [...]» 45. Il ajoute «[...] l’oued Sebou ou Souboudes anciens. Il prend sa source dans une épaisse forêt du mont Se-lilga et avec tous ses méandres il parcourt un espace de deux centsmilles [...]» 46.
Parmi les importants documents, ceux qui proviennent des ar-chives portugais, il s’agit d’une instruction datée du 27 novembre1514 adressée par le roi à deux explorateurs portugais envoyéedans une mission secrète pour la reconnaissance du fleuve 47 «[...]vous écrivez un rapport complet, accompagné de plans du fleuveet de ses berges et agirez avec la plus grande discrétion [...]» 48.
Un autre auteur portugais du même siècle écrivait «pendantl’hiver les petits bateaux peuvent remonter le fleuve jusqu’à la villemême de Fez» 49.
Ajoutant à ces documents un autre daté de 1560, évoquant uneliaison entre Fez et Marseille via Sebou, il s’agit d’un bateau mar-seillais arrivant à Fez. Geoffroy de Buade disait qu’étant demeurémalade à Fès et n’ayant pas pu se mettre en route avec ses compa-gnons a débarqué a bord d’un navire de Marseille venant à Fès etqui avait affaire dans cette ville pour charger des tonneaux pourMarseille 50. D’après une lettre écrite en 1681 à Colbert «[...] la ri-
43. Mohammed Esseghir Ben Elhadj Ben Abdallah Eloufrani, Nozhat-Elhadi,Histoire de la dynastie Saadienne au Maroc (I 511-1670) trad. française par O. HOU-
DAS, Paris 1889, p. 76.44. Extraits inédits relatifs au Maghreb (géographie et histoire), traduits de l’arabe
et annotés par E. FAGNAN, Alger 1924, p. 14.45. LEON L’AFRICAIN, Description de l’Afrique, cit., p. 33, note 1.46. Ibid.47. G. DE TORCY, La navigabilité de l’oued Sebou, «BCAF», avril, 1912, p. 155.48. Ibid.49. Ibid.50. Ibid.
Sidi Mohammed Alaioud2496
vière y est de beaucoup plus facile accès que celle de Salé [...] ilpeut y entrer des navires de 5 à 600 tonneaux tout chargé [...]» 51.
R. Caillé cite «on s’arrêta dans un camp de soldats qui allaientrejoindre l’empereur, ils avaient dressé leurs tentes prés d’un brasde mer que mon guide me dit se nommer Sbo» 52.
Au début du xx siècle, le géographe Pobéguin a confirmé cettenavigabilité à 1905 en suivant le Sebou entre Mechra bel Ksiri etson embouchure 53.
En 1911 une reconnaissance à montré que le fleuve était navi-gable sans difficulté jusqu’en amont de Mechra bel Ksiri 54. La pé-nétration française a été faite en 1912 par une canonnière qui a re-monté l’Oued Sebou jusqu’à Fès, en partant de Mehdiya 55.
Ainsi, le Sebou se présente comme une véritable voie de com-munication qui a permis, à travers les âges une pénétration surplusieurs dizaine de kilomètres depuis la cote atlantique jusqu’à larégion de Fès. C’est une voie qui assuré le transport des matériauxde construction et des produits de consommation dans les deuxsens permettant ainsi la pénétration des influences extérieurs 56.
Le Sebou et la dynamique de développement des sites du Gharb
A travers les différentes civilisations, de toutes époques confon-dues, les voies fluviales ont joué un role très important dans la ge-nèse et le développement des villes 57. Le monde romain offre plu-sieurs exemples de ce phénomène 58.
L’objectif de cette contribution est de mettre le point sur le ro-le majeur que le Sebou avait joué dans la genèse et le développe-ment des villes antiques du Gharb, et en particulier, les sites ma-
51. REBUFFAT, CALLU, MOREL, HALLIER, MARION, Thamusida, 1, cit., p. 12.52. R. CAILLE, Journal d’un voyage à Toumbouctou et à Jenné, cité par REBUF-
FAT, Recherches sur le bassin du Sebou, cit., p. 261.53. DE TORCY, La navigabilité, cit., p. 156.54. REBUFFAT, CALLU, MOREL, HALLIER, MARION, Thamusida, 1, cit., p.9.55. E. M. BELLAIRE, Le Gharb, «Archives marocaine», t. 20, 1913, p. 73.56. M. PONSICH, Territoires utiles du Maroc punique, «Madrider Beitrage», 1982,
p. 439.57. Les romains avaient une préférence marquée pour les voies d’eau surtout
dans les endroits qui connaissent des aléas climatique.58. Y. BURNAD, Le role des communications fluviales dans la genèse et le dévelop-
pement des villes antiques du sud de la Gaule dans Thèmes de recherches sur les villesantiques d’occident, Paris 1977, p. 299-301.
Contribution du fleuve Sebou dans le développement des sites antiques du Gharb 2497
jeurs de Banasa et de Thamusida 59. C’est dans ce contexte qu’onva voir le Sebou entre Mechra’ bel Kçiri et la mer. Il a permitd’atteindre Thamusida, Banasa et approcher même Volubilis.
Les prospections archéologiques menées dans le Gharb par lamission du bassin du Sebou 60 a dressé un tableau exhaustif del’occupation antique, et où le fleuve Sebou se présente comme unfacteur important dans le développement de ces villes.
Plusieurs sites répertoriés par la mission sont situés aux limitesdes sables de la mamora et des tirs de la plaine 61. Citons commeexemple, au nord du Sebou l’occupation antique le long de la rivedroite du fleuve est depuis longtemps reconnue. Sur l’autre rive lesite de sidi Ahmed bou Khobbiz «confirme l’occupation de laplaine à partir de la rive gauche [...]» 62.
Le fait de trouver ces sites au milieu des alluvions témoignent queles crues et les merjas n’étaient pas défavorables pour l’occupation hu-maine dans cette plaine 63, et que cette occupation a su s’adapter auxconditions locales d’accessibilité et d’exploitation du sol.
C’est ainsi que les crues périodiques du Sebou ont contribué àentretenir une levée alluviale qui a facilité la fixation d’une popula-tion depuis l’antiquité et dans les temps modernes sous forme dedouars le long de l’oued. Les merjas ne constituaient pas un obsta-cle, malgré qu’elles étaient peu favorables à cette implantation, el-les ont été exploités en été comme pâturage depuis les époquesantiques jusqu’à nos jours. Dans ce milieu naturel les alluvions ontexhaussé le niveau du sol autour des deux collines sur lesquellesest placé le site de Banasa 64. Le même phénomène s’applique pourThamusida 65, où les recherches menées par les équipes de l’écolefrançaise de Rome (1932-62) et les travaux récentes maroco-italiens
59. Les sites mineurs sont le site Sidi L’arbi Boujem’a et le site Souq Jem’a elHaouafat. On ignore l’étendue des vestiges du souk Jemaa el Haouafate et même desidi Larbi Boujema: R. REBUFFAT, Recherches sur le bassin du Sebou, «CRAI», 1986,p. 640.
60. REBUFFAT, Recherches sur le bassin du Sebou, cit., p. 264.61. AKERRAZ, BROUQUIER-REDDE, LENOIR, Nouvelles découvertes, cit., p. 249.62. Ibid., p. 252.63. AKERRAZ, BROUQUIER-REDDE, LENOIR, Nouvelles découvertes, cit., p. 264.64. S. GIRARD, L’alluvionnement du Sebou et le premier Banasa, «BCTH», fasc.
17B, 1981, p. 145.65. La différence des niveaux ce voit à Thamusida, les égouts débouchent actue-
llement au dessous du niveau des hautes eaux, cfr. LECOZ, Le Rharb fellahs et colons,cit., p. 54.
Sidi Mohammed Alaioud2498
(1999-2007) ont démontré l’importance de l’occupation sur le pla-teau qui domine l’oued Sebou. Cette position des deux sites, sur lalevé du Sebou, les plaçait à l’abri des grandes crues 66, par contreles sites du souk el djemaa, Sidi Larbi Boujema’ ont été couvertd’alluvions et n’apparaissait qu’en coupe dans les falaises d’allu-vions 67.
Les avantages du milieu géographique et la position des sitesde Banasa et de Thamusida ont fait de ces derniers un pole d’at-traction pour une implantation humaine, qui va bénéficier desavantages du fleuve dans les relations avec le monde extérieur.
Pour comprendre le cheminement des relations commercialesentre les sites du Gharb et les autres régions, la Tingitane d’unepart et le monde extérieur d’autre part, les trouvailles archéologi-ques, à savoir la céramique et les amphores, sont des témoins ocu-laires de cette activité. Ces produits ont traversé plusieurs kilomè-tres de leurs lieux de production avant d’atteindre les lieux decommercialisation 68.
Le fleuve Sebou a joué un role important dans le cheminementvers les villes antiques, les materiaux de construction et les produc-tions de céramique, d’amphore et de bronze importées des diffé-rentes régions du bassin méditerranéen. Les deux sites étaient ou-verts au circuits commerciaux étant donné qu’ils étaient alimentépar tous les produits manufacturés dans les différents ateliers au-tour du bassin méditerranéen de l’Italie, la Bétique, la Gaule, l’O-rient et les provinces de l’Afrique du Nord, et ce depuis les VI-V
siècles av. J. C., ce qui explique le role du Sebou, dans la liaisondes sites du Gharb avec le monde extérieur via Lixus, Cadix, et delà vers les autres ports de la Méditerranée 69.
Dans ce contexte on ajoute un document épigraphique trouvé àBanasa, il s’agit de l’édit de Caracalla, si on adopte que le texteconcerne le site de Banasa, suivant l’hypothèse de plusieurs auteursqui ont étudié ce document 70, c’est par la voie fluviale que cesanimaux célestes vont regagner Rome.
66. GIRARD, L’alluvionnement du Sebou, cit., p. 145.67. REBUFFAT, Recherches sur le bassin du Sebou, cit., p. 644.68. S. M. ALAIOUD, L’économie de Banasa à l’époque provinciale, dans L’Africa
romana XV, p. 1899-911.69. S. M. ALAIOUD, Le site archéologique de Banasa, des origines à l’évacuation
romaine, contribution à l’étude des sites antique du Maroc antique (en arabe), Rabat2010.
70. Ibid.
Contribution du fleuve Sebou dans le développement des sites antiques du Gharb 2499
Autres documents archéologiques, qui peuvent renforcer ce roledu fleuve, l’absence de la pierre dans la plaine du Gharb a incitél’importation des matériaux de construction.
Des analyses ont été faites sur les pierres de Banasa et ils ontconfirmé que certaines pierres provenaient de la cote atlantique,des carrières qui se trouvent à une distance de 30 à 40 km des si-tes d’utilisation. Citons comme des exemples le calcaire de Ze-rhoun, G. Ferray et R. Paskoff ont démontré que la pierre de Vo-lubilis était transporté par Sebou jusqu’à Banasa 71. Le gré dunairedes carrières de la cote atlantique, la même chose pour le gré d’A-kreuch. Pour le molasse, les carrières ou était extraite cette pierre,doivent se situer aussi à l’est de Mechra’ Bel-Ksiri, et acheminépar voie fluviale vers Banasa 72. La pierre volcanique utilisée dansles meules de boulangerie et d’huilerie 73 était importé des gise-ments basaltiques au sud de Meknès 74. En ce qui concerne lemarbre trouvé dans le site, il est possible qu’il soit importé dunord du Maroc ou d’Espagne 75.
Pour les éléments décoratifs découverts dans le site, chapiteaux,colonnes de bases, meules, il est possible que ces éléments soientimportésintactes ou sous forme de bloc puis transformés locale-ment. Cela touche également les métiers ayant rapport avec les mi-nes de fer et d’argent.
Autre témoin archéologique, le fait de trouver les monnaies deGadès et d’autres villes de la péninsule Ibérique, à Thamusida etBanasa et d’autres sites de la Tingitane, témoigne de cette activitééconomique avec le monde extérieur 76.
De ces rapports avec le monde extérieur favorisé par Sebou,nos deux sites ont connu un essor commercial et industriel qui acontribué à leurs développements. La ville de Thamusida devient
71. G. FERRAY, R. PASKOFF, Recherches sur les carrières romaines des environs deVolubilis, «BAM», 6, 1966, p. 294.
72. J. BOUBE, Documents d’architecture maurétanienne au Maroc, «BAM», 7,1967, p. 273.
73. S. M. ALAIOUD, Les activités artisanales à Banasa: Témoignages archéologi-ques, dans L’Africa romana XVIII, p. 573-90.
74. R. THOUVENOT, L’urbanisme romain dans le Maroc antique, dans Homenaje aGarcia y Bellido,4, «Revista de la Universidad Comptulense», XVIII, 1979, p. 330.
75. R. THOUVENOT, Les maisons de Banasa, «PSAM», 11, 1954, p. 47.76. J. BOUBE, La circulation monétaire à Sala à l’époque préromaine, dans Lixus,
Actes du Colloque international de Larache, (8-11 novembre 1989), (Coll. EFR, 166),Rome 1992, p. 255-9.
Sidi Mohammed Alaioud2500
un port 77 important destiné au ravitaillement et à l’approvisionne-ment des centres urbains du Gharb et à l’exportation des produitsde ces derniers. La même chose pour Banasa dont le matériel ex-humé plaide en faveur d’une suprématie parmi les villes du Marocantique.
C’est ainsi que l’histoire du Gharb et des sites qui s’y trouvent,sont liées à celle du Sebou qui fut l’instrument véhiculaire de toutela vie économique de la plaine 78. C’est dans ce contexte qu’il fautsouligner le rapport qui existe entre l’activité commerciale d’uneville et les réseaux de voies de communication dans lequel elles’inscrit 79.
77. «L’importance de Thamusida comme port est confirmé par le grand entrepotqui est voisin du fleuve», voir R. REBUFFAT, Le Maroc et l’Atlantique dans Actes ducolloque international de Boulogne-sur-Mer, (12, 13,14 mai 2005), (Les cahiers du lit-toral, 2/6), Boulogne-sur-Mer 2008, p. 180.
78. PONSICH, Territoires utiles, cit., p. 441.79. D. vAN BERCHEM, Réflexions sur la dynamique de développement des villes
antiques, Thèmes de recherches sur les villes antiques d’occident, Paris 1977, p. 21.
Contribution du fleuve Sebou dans le développement des sites antiques du Gharb 2501