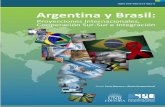Argentina y Brasil: proyecciones internacionales, Cooperación Sur-Sur e integración
Effets des préretraites sur l'emploi
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Effets des préretraites sur l'emploi
EFFET DES PRÉRETRAITES SUR L’EMPLOI
H. Sneessens, F. Shadman, O. Pierrard*
XV ième Congrès des économistes belges de langue française
Namur, novembre 2002
Résumé
L’analyse et l’exemple numérique développés dans cet article illustrent combien le coût de mesures
de réduction de la population active telles que les préretraites peut être élevé en termes d’emplois et
de niveau d’activité, même lorsque les retraits sont ciblés sur les populations les plus touchées par le
chômage. Au-delà des chiffres, l’objectif est également d’expliciter la nature et la diversité des
mécanismes par lesquels ces effets néfastes peuvent apparaître. La méthodologie utilisée prend en
compte les effets de la concurrence imparfaite et les négociations salariales, ainsi que les frictions
liées aux créations et destructions d’emplois et aux difficultés d’appariement. La réduction de la
population active induite par les préretraites a pour conséquence à long terme d’augmenter le coût de
la main-d’œuvre, soit directement via l’effet du taux de chômage sur les salaires, soit indirectement
via l’effet du taux de chômage sur les difficultés de recrutement.
* Les auteurs sont membres de l’IRES, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve. Le premier auteur est également professeur à l’Université catholique de Lille. Cette contribution s'inscrit dans le cadre du programme Pôle d'attraction interuniversitaire P5/10/28 pour le compte de l'Etat belge, Services du Premier Ministre - Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles. Elle a bénéficié également du soutien financier du Service des Etudes et de la Statistique (SES) de la Région wallonne.
- 2 -
1. Introduction
Nombre de pays européens ont, volens nolens, tenté de réduire le coût social du chômage par
l’introduction de mesures facilitant les retraits anticipés de la vie active. En Belgique, le nombre
moyen de travailleurs âgés en préretraite à plein temps ou dispensés d'inscription au chômage
représentait environ 1% de la population active fin des années soixante-dix. Ce chiffre augmente
régulièrement jusqu’au début des années quatre-vingt-dix et atteint un maximum d’environ 9% en
1992. Il diminue légèrement par la suite et vaut aujourd’hui (juin 2002) environ 6% de la population
active, soit environ 36% du total des demandeurs d’emploi inoccupés (concept BIT) plus chômeurs
âgés dispensés d’inscription et préretraités à temps plein.
Deux types d’argument au moins ont été utilisés pour justifier ces retraits anticipés de vie active : (i)
la faible employabilité des chômeurs âgés (difficulté de retrouver rapidement un emploi stable et
correctement rémunéré) ; (ii) la préférence donnée à l’emploi de jeunes travailleurs, en particulier des
moins qualifiés. Evaluer correctement la pertinence de ces arguments n’est pas chose aisée.
L’évaluation peut sembler à première vue relever de l’arithmétique la plus élémentaire : à volume
total d’emplois donné, réduire l’emploi des plus âgés permet d’augmenter l’emploi des plus jeunes.
Une telle approche est basée cependant sur des hypothèses implicites particulièrement fortes. Elle
n’est correcte que si l’évolution des salaires n’est pas affectée par les retraits de population active, si
travailleurs jeunes et moins jeunes sont parfaitement substituables du point de vue de l’entreprise, si
celle-ci n’est confrontée à aucune difficulté de recrutement, etc... Ces hypothèses sont pour le moins
hardies. Une évaluation sérieuse des effets des retraits anticipés de la vie active passe donc
obligatoirement par l’élaboration et l’utilisation d’un cadre analytique suffisamment général pour
prendre en compte ces divers aspects.
On se basera pour ce faire sur les méthodes d’analyse du marché du travail développées au cours des
vingt dernières années pour prendre en compte les effets de la concurrence imparfaite et des
négociations salariales, ainsi que les frictions liées aux créations et destructions d’emplois et aux
difficultés d’appariement. Ces développements ont conduit au concept de « taux de chômage
d’équilibre ». Les modèles de taux de chômage d’équilibre les plus simples (modèles de stock, sans
- 3 -
frictions et avec un seul type de main-d’œuvre) peuvent être résumés par deux équations, une
équation de détermination des prix (l’équivalent de la fonction de demande de travail en concurrence
parfaite) et une équation de fixation des salaires (qui joue le même rôle que l’offre de travail en
concurrence parfaite) 1. On peut montrer dans ce contexte qu’une réduction de la population active
implique dans un premier temps une réduction équivalente du taux de chômage. Il en résulte
cependant des tensions accrues sur le marché du travail, lesquelles génèrent des hausses de salaires et
de prix. L’indexation des prix sur les salaires et des salaires sur les prix engendre une spirale
inflationniste qui réduit progressivement les débouchés des entreprises, leur production et leurs
investissements, et ramène finalement l'économie aux taux de chômage et salaire réel de départ. Le
seul effet à long terme serait donc une réduction de la taille de l'économie (emploi, capacité de
production, niveau d'activité) proportionnelle à la réduction de la population active. Bien que les
destructions d’emploi résultent dans cette analyse de l’effet positif des baisses du taux de chômage
sur les salaires, le salaire réel reste in fine inchangé.
Ce cadre d'analyse, bien qu’extrêmement simple, a le mérite de souligner la différence entre effets à
court et à long terme ainsi que le rôle crucial des effets induits par les ajustements de salaires et de
prix. L’analyse doit cependant être élargie pour tenir compte du fait qu’en réalité chômage et retraits
anticipés concernent principalement les travailleurs les moins qualifiés. En d’autres termes, les retraits
anticipés (qui sont une réduction de l’offre) concernent un type de main-d’œuvre pour lequel la
demande est elle-même devenue moins forte. De tels retraits « ciblés » ont-ils des effets aussi
préjudiciables pour l’emploi que le suggère le modèle simple sans distinction de qualification ? La
réponse à cette question passe par une extension du schéma d’analyse initial pour distinguer à tout le
moins deux niveaux de qualification (faible et élevé) et deux types d’emploi, des emplois dits
« simples » pour lesquels un niveau de qualification faible est suffisant, et des emplois « complexes »
pour lesquels un niveau de qualification élevé est requis. Sneessens-Shadman (2000) montrent dans
un tel contexte que même des retraits ciblés de population active peuvent engendrer (par les mêmes
mécanismes que précédemment) des destructions d’emploi non négligeables dès lors que le salaire
des moins qualifiés réagit positivement aux baisses du chômage. Ces effets sur l’emploi sont
accentués si les variations des salaires des moins qualifiés induisent des variations de même sens des
1 Voir par exemple Layard et al. (1991)
- 4 -
salaires des plus qualifiés (wage-wage spiral via des « effets d’envie »). L’estimation du modèle sur
données belges permet d’évaluer l’importance quantitative de ces effets.
moins qualifiés
plus qualifiés
total
Réduction de l'offre
-250 (-14.0%)
- 0 (- 0.0%)
-250 (- 5.7%)
Scénario 1: élasticité normale (-0.030)
emploi - 69 -114 -183
taux de chômage - 7.3 + 4.4 - 0.8
Scénario 2: élasticité faible (-0.015)
emploi - 44 - 72 -116
taux de chômage - 8.7 + 2.8 - 2.4
Scénario 3: élasticité nulle
emploi - 0 - 0 - 0
taux de chômage -11.2 + 0.0 - 5.0
Tableau 1: Effets des retraits ciblés de population active sur l'emploi (en milliers) et le chômage (en points de pourcentage) en fonction de l’élasticité des salaires des moins qualifiés au taux de chômage correspondant. Source : tableau 3.2.1 de Sneessens-Shadman (2000), remanié.
Les résultats obtenus sont illustrés au tableau 1. La valeur absolue de l’élasticité des salaires des
moins et des plus qualifiés à leur taux de chômage respectif est estimée à 0.03, soit une valeur plutôt
inférieure aux estimations habituelles (Nickell-Bell (1997) obtiennent sur données britanniques une
valeur deux fois plus grande). Des retraits ciblés de l’ordre de 5.7% de la population active totale (soit
250 mille chômeurs peu qualifiés) engendrent des ajustements de prix et salaires tels que 69 mille
emplois peu qualifiés et 114 mille emplois qualifiés sont détruits. Le taux de chômage des moins
qualifiés baisse de 7.3 points mais celui des plus qualifiés augmente de 4.4 points, de sorte que le taux
de chômage agrégé demeure quasi inchangé (-0.8 point). Le tableau 1 indique les effets sur l’emploi
qui seraient obtenus ceteris paribus pour des valeurs plus faibles de l’élasticité des salaires des moins
qualifiés à leur propre taux de chômage. Dans le cas limite où cette élasticité serait nulle (l’élasticité
des salaires des plus qualifiés restant égale à 0.03), il n’y aurait aucune perte d’emploi et le taux de
- 5 -
chômage agrégé baisserait de 5 points. On notera cependant qu’il suffit d’une élasticité relativement
faible (0.015) pour engendrer des pertes d’emplois non négligeables (116 mille).
Le modèle de Sneessens-Shadman (2000) illustre l’importance potentielle des ajustements induits par
les comportements salariaux. D’autres facteurs cependant sont à prendre en compte. Le reste de cet
article est consacré à une analyse qui reprend celle de Sneessens-Shadman (2000) en la complétant
par la prise en compte des frictions et difficultés d’appariement. On utilisera pour ce faire un modèle
d’équilibre général dynamique combiné à une description du fonctionnement du marché du travail
inspirée de Pissarides et Mortensen (cf. par exemple Mortensen-Pissarides (1999)). Cette
méthodologie fut notamment utilisée par Andolfatto (1996) et Merz (1995) pour étudier la
contribution des frictions du marché du travail aux caractéristiques observées des cycles
conjoncturels. Nous adapterons leur outil d’analyse à notre propos en élargissant la description du
marché du travail pour distinguer deux types d’emploi et deux types de main-d’œuvre, nous appuyant
pour ce faire sur les travaux de Gautier (2002). Soulignons d’emblée que les salaires des moins
qualifiés seront supposés être purement et simplement indexés sur ceux des plus qualifiés, et donc
insensibles à l’évolution du taux de chômage des moins qualifiés. Cette hypothèse est compatible
avec la stabilité de la hiérarchie des salaires observée au cours des dernières décennies dans nombre
de pays européens (dont la Belgique). Elle présente en outre l’intérêt d’impliquer une élasticité nulle
des salaires des moins qualifiés à leur taux de chômage, comme dans le scénario 3 du tableau 1. Les
effets qu’auront sur l’emploi les retraits ciblés de population active seront donc dans cette analyse
imputables exclusivement aux frictions, difficultés d’appariement et comportements de recherche sur
le marché du travail.
2. Le modèle théorique
Le modèle théorique utilisé est repris de Pierrard-Sneessens (2002), auquel on se reportera pour une
présentation plus détaillée. Le modèle distingue trois types d’agents : les ménages (composés de
travailleurs plus et moins qualifiés), les entreprises de biens finals et les entreprises de biens
intermédiaires. Les biens intermédiaires sont de deux types, sophistiqués ou non (services aux
entreprises vs biens standardisés par exemple). La production des premiers implique des tâches
- 6 -
complexes et donc l’utilisation de main-d’œuvre qualifiée. La production des seconds est faite de
tâches plus simples qui peuvent être exécutées par des travailleurs moins qualifiés, avec une
productivité plus faible cependant que les travailleurs plus qualifiés2. La production de biens finals
requiert l’utilisation de trois facteurs de production, les deux types de biens intermédiaires et du
capital physique. Le stock de capital disponible est déterminé par l’épargne accumulée des ménages.
L’économie comporte donc trois types de marché : les marchés du travail (pour les emplois simples et
complexes), les marchés des biens (finals et intermédiaires) et le marché du capital. Les marchés des
biens et du capital sont des marchés de concurrence parfaite. Les marchés du travail sont caractérisés
par des "frictions", induites par les destructions et créations continuelles d’emplois et les difficultés
d’appariement. Tous les agents sont supposés avoir des anticipations rationnelles.
2.1. Les flux sur les marchés du travail
La double hétérogénéité (deux types d’emplois et deux types de main-d’œuvre) combinée à la
concurrence entre travailleurs plus et moins qualifiés sur le marché des emplois simples complique
passablement la description des flux sur le marché du travail. Notons htU le stock de chômeurs plus
qualifiés (h pour high-skilled) et ltU le stock de chômeurs moins qualifiés (l pour low-skilled).
ctN représente le stock d’emplois « complexes » ets
tN le stock d’emplois « simples ». Les premiers
sont occupés exclusivement par des travailleurs plus qualifiés ; les seconds peuvent être occupés par
l’un et l’autre type de travailleurs, de sorte que s sl sht t tN N N= + . Si le nombre total de travailleurs
est normalisé à 1 et la proportion de travailleurs plus qualifiés est égale à α, les stocks de travailleurs
en emploi et en chômage satisfont les identités suivantes :
(1) c sh ht t tN N U α+ + = et 1sl l
t t tN U α ε+ = − − ,
où εt représente le nombre de travailleurs moins qualifiés en retraite anticipée (ε pour early
retirement).
L’intensité de recherche des chômeurs moins qualifiés (lesquels prospectent exclusivement le marché
des emplois simples) est normalisée à 1. Les chômeurs plus qualifiés peuvent prospecter les deux
2 On pourrait supposer sans modifier vraiment les résultats que travailleurs plus et moins qualifiés ont la même productivité dans la réalisation des tâches simples. Supposer que les travailleurs plus qualifiés sont plus productifs permet de justifier la préférence des entreprises pour ce type de travailleurs.
- 7 -
marchés simultanément et concurrencent les travailleurs moins qualifiés sur le marché des emplois
simples. Leur intensité de recherche sur les marchés des emplois simples et complexes sont
représentées par stσ et ctσ respectivement ; elles sont fonction du gain attendu pour chaque type
d’emploi (cf. infra). Les travailleurs plus qualifiés occupant un emploi simple peuvent simultanément
continuer à rechercher un emploi complexe mieux rémunéré (on-the-job search) ; l’intensité de cette
recherche est représentée par ot. Les intensités de recherche stσ , ctσ et ot affectent les flux
d’embauche. Le nombre d’embauches réalisées au cours de la période t est déterminé par une fonction
d’appariement dont les arguments sont d’une part le nombre d’emplois vacants, et d’autre part le
nombre de travailleurs à la recherche d’un emploi, mesuré en unités de recherche efficaces. On a pour
le marché des emplois simples et des emplois complexes respectivement :
(2) stM = M s ( s
tV , ltU + .s h
t tUσ ) et ctM = M c ( c
tV , .c ht tUσ + . sh
t to N )
où stV et c
tV représentent le nombre d’emplois vacants respectivement simples et complexes ouverts
par les entreprises de biens intermédiaires. Ces fonctions d’appariement ont des rendements d’échelle
constants et sont concaves en chacun de leurs arguments. Les tensions sur chacun des marchés du
travail sont mesurées par le rapport du nombre d’emplois vacants et du nombre (mesuré en unités de
recherche efficaces) de travailleurs à la recherche d’un emploi, soit :
(3) stθ =
st
l s ht t t
V
U Uσ+ et
cc tt c h sh
t t t t
V
U o Nθ
σ=
+ .
pour le marché des emplois simples et celui des emplois complexes respectivement. La probabilité
qu’un travailleur trouve un emploi sur un marché est d’autant plus forte que les tensions y sont
élevées. Plus précisément, la probabilité qu’un chômeur moins qualifié trouve un emploi simple est
égale au rapport entre nombre d’appariements et nombre (en unités de recherche efficaces) de
travailleurs recherchant ce type d’emploi :
(4) ( )s
s s stt tl s h
t t t
Mp p
U Uθ
σ= =
+,
- 8 -
où ( )s stp θ est fonction positive de s
tθ . En suivant le même raisonnement, on trouve que la
probabilité qu’un chômeur plus qualifié obtienne un emploi simple est s st tpσ , la probabilité qu’un
travailleur qualifié en chômage obtienne un emploi complexe est c ct tpσ , et la probabilité qu’un
travailleur qualifié sur un emploi simple obtienne un emploi complexe est ct to p ,où c
tp est défini par :
(5) ( )c
c c ctt tc h sh
t t t t
Mp p
U o Nθ
σ= =
+ .
La probabilité qu’une entreprise avec un emploi vacant trouve un travailleur est égale au rapport du
nombre total d’appariements et du nombre total d’emplois vacants. C’est donc une fonction négative
des tensions. Plus formellement, on écrira :
(6) 1s
s stt s s
t t
Mq q
V θ
= =
et 1c
c ctt c c
t t
Mq q
V θ
= =
pour un emploi simple et un emploi complexe respectivement. L’emploi simple pouvant être occupé
par un travailleur plus ou moins qualifié, la probabilité stq est la somme des probabilités sh
tq et sltq de
recruter l’un ou l’autre type de travailleur. Ces probabilités sont fonction du nombre relatif (en unités
de recherche efficaces) de travailleurs plus et moins qualifiés en concurrence sur le marché des
emplois simples, d’où il résulte que / /sh sl s h lt t t t tq q U Uσ= .
Ns Nc
Ul Uh
σ c.pcps
σ s.ps
o.pc
χψχ
« on-the-job-search »
Figure 1: Flux d’entrées et sorties de l’emploi et du chômage dans un modèle avec double hétérogénéité et concurrence entre plus et moins qualifiés pour les emplois simples
- 9 -
La figure 1 résume l’ensemble des flux observés sur les marchés du travail. Le taux de destruction des
emplois (entrées en chômage) est supposé constant pour chaque catégorie d’emplois. Il est égal à χ
pour les emplois simples et ψ pour les emplois complexes. En chaque période, le stock d’emploi est
égal au stock de la période antérieure, moins les destructions d’emploi, plus les embauches nouvelles.
Valeurs des flux et des stocks sont donc liées par les relations suivantes :
(7.a) 1 (1 )
(1 )
sl sl sl st t t t
sl s lt t t
N N q V
N p U
χ
χ+ = − +
= − +,
(7.b) 1 (1 )
(1 )
sh c sh sh st t t t t t
c sh s s ht t t t t t
N o p N q V
o p N p U
χ
χ σ+ = − − +
= − − +,
(7.c) 1 (1 )
(1 )
c c c ct t t t
c c c h sht t t t t t
N N q V
N p U o N
ψ
ψ σ+ = − +
= − + +
Ces valeurs dépendront des comportements des entreprises et des travailleurs, comportements qu’il
nous faut maintenant décrire.
2.2. Le comportement des entreprises
L’entreprise de biens finals maximise la valeur actualisée des profits, sous contrainte d’une fonction
de production Cobb-Douglas à trois facteurs, biens intermédiaires complexes ctQ , biens
intermédiaires simples stQ et stock de capital tK :
(8) ( ), ,c st t t ty F Q Q K= .
Les deux premiers facteurs sont achetés aux entreprises de biens intermédiaires correspondantes, aux
prix de marché ctc et s
tc respectivement. Le capital est loué aux ménages au prix du marché tr δ+ ,
couvrant la rémunération nette et la dépréciation du capital. A l’optimum, chaque facteur est utilisé
en quantité telle que coût marginal et productivité marginale soient égaux. La quantité de biens
intermédiaires complexes produite et vendue satisfera donc la condition ( , , ) /c c s ct t t t tc F Q Q K Q= ∂ ∂ , et
semblablement pour les autres facteurs.
- 10 -
On supposera pour simplifier et sans perte de généralité que la production de biens intermédiaires
nécessite uniquement de la main-d’œuvre. Chaque entreprise utilise un travailleur. La productivité du
travailleur plus qualifié est normalisée à 1, tant pour la production de biens simples que pour celle de
biens complexes ; la productivité du travailleur moins qualifié est nulle pour la production de biens
complexes, égale à 0 < ν ≤ 1 pour la production de biens simples. Le profit courant réalisé par une
entreprise de biens intermédiaires à une date t donnée est fonction du type de biens produit et de son
niveau d’activité. Celui-ci est nul lorsque l’emploi vacant n’a pas été pourvu, égal à l’unité si
l’entreprise utilise un travailleur plus qualifié, et égal à ν si l’entreprise produit des biens simples avec
un travailleur moins qualifié. Les coûts supportés par l’entreprise sont les coûts d’annonce d’emploi
lorsque l’emploi est vacant (coût égal à a pour un emploi complexe et b pour un emploi simple) et les
salaires lorsque l’emploi est pourvu (ctw pour un emploi complexe et stw pour un emploi simple). A
situation initiale donnée, l’évolution future attendue des profits est déterminée par la probabilité
d’embaucher ou de perdre un travailleur. Plus formellement, la valeur actualisée des profits présents
et futurs attendus pour une entreprise produisant des biens intermédiaires complexes peut prendre
deux valeurs, notées cvtW et ch
tW , selon que l’emploi proposé est aujourd’hui vacant ou occupé par
un travailleur plus qualifié. Ces valeurs sont définies par3 :
(9.a) 1 1
1
(1 )E
1
c ch c cvcv t t t tt t
t
q W q WW a
r+ +
+
+ − = − + + ;
(9.b) 1 1
1
(1 )E
1
ch cvch c c t tt t t t
t
W WW c w
r
ψ ψ+ +
+
− + = − + + .
La valeur actualisée des profits s’obtient de même façon pour les entreprises de biens intermédiaires
simples, avec une complication supplémentaire due au fait que l’entreprise peut recruter un travailleur
plus qualifié ou moins qualifié, lesquels ont des productivités et des probabilités de départ différentes.
Utilisant le même type de notation que précédemment, on écrira :
3 On vérifie aisément que ch
tW est égal à (1 )( ) /c cr c w r+ − lorsque les prix constants et ψ = 0.
- 11 -
(10.a) 1 1 1
1
(1 )E
1
sh sh sl sl sh sl svsv t t t t t t t
t tt
q W q W q q WW b
r+ + +
+
+ + − − = − + + ;
(10.b) 1 1
1
(1 ) ( )E
1
c sh c svt t t t t tsh s s
t t t tt
o p W o p WW c w
r
χ χ+ +
+
− − + + = − + +
;
(10.c) 1 1
1
(1 ). E
1
sl svsl s s t t
t t t tt
W WW c w
r
χ χν + +
+
− + = − + + .
2.3. Condition de libre entrée et emploi
On suppose qu’il n’y a aucune barrière à l’entrée. Le nombre d’entreprises de biens intermédiaires et
le nombre d’emplois est donc toujours tel que l’espérance de profit pour une entreprise nouvelle serait
nulle ( 0cv svt tW W= = ).
On peut montrer qu’à l’équilibre stationnaire cette condition de libre entrée implique un niveau
d’emploi tel que la productivité marginale du travail est égale au salaire majoré d’un terme
correspondant à l’amortissement du coût de vacance. Pour les emplois complexes, cette condition
s’écrit sous la forme :
(11) ( )c ct t t c
t
ac w r
qψ= + + ,
où ctc est le prix de vente des biens intermédiaires complexes (lui-même égal à leur productivité
marginale dans la production de biens finals), a est le coût de vacance par période, 1/ ctq le nombre
moyen de périodes durant lequel un poste reste vacant. Le niveau d’emploi d’équilibre sera donc
d’autant plus faible ceteris paribus que les difficultés de recrutement sont élevées (ctq faible). Une
condition semblable vaut pour le nombre d’emplois simples à l’équilibre4.
4 Cette condition prend néanmoins une forme plus compliquée du fait que les emplois simples peuvent être occupés par des travailleurs plus ou moins qualifiés, lesquels ont des productivités et probabilités de départ différentes.
- 12 -
2.4. Le comportement des ménages
On suppose pour simplifier que les travailleurs font partie d’un seul et même ménage5. Les variables
de décisions du ménage sont le niveau de consommation Ct et les intensités de recherche ctσ , s
tσ et
to . Les intensités de recherche du chômeur qualifié sur les marchés des emplois complexes et simples
(respectivement ctσ et s
tσ ) sont fonction de la répartition du temps de recherche total (normalisé à 1)
entre les deux marchés. L’intensité de recherche sur le marché des emplois complexes des travailleurs
qualifiés exerçant un emploi simple est fonction du temps de loisir sacrifié à cet objectif. Si l’on
représente l’utilité instantanée de la consommation par ( )tCU et la désutilité de l’effort de recherche
par ( )tO o , le programme d’optimisation intertemporelle du ménage s’écrira sous la forme :
(12.a) { }, , ,
1( ) ( ) EmaxH H
c sC ot tt t
t t t t tW C O o Wσ σ
β + = − + U
sous les contraintes de stock (1) et (7.a-c) et sous la contrainte budgétaire :
(12.b) ( ) ( )1 (1 ) c c s sh sl u h s et t t t t t t t t t t t t t t tK r K w N w N N w U U w T Cε+ = Π + + + + + + + + − − ,
où Πt représente la masse des profits redistribués par les entreprises de biens intermédiaires (cf. infra
négociations salariales et partage des rentes) et Tt représente les prélèvements opérés pour financer
consommation publique, indemnités de chômage (utw ) et préretraites ( e
tw ). Pour éviter d’introduire
des effets de distorsion, on supposera des prélèvements forfaitaires. La valeur de la fonction objectif
HtW est bien sûr fonction des valeurs initiales des variables de stock :
(12.c) ( ), , ,H H c sh slt t t t tW W K N N N= .
Le plan de consommation optimal satisfait l’habituelle condition d’Euler : [ ]' '1 11t t trβ + += +U U . Les
valeurs optimales de ctσ et s
tσ sont telles que le gain marginal attendu de l’effort de recherche est
identique sur chacun des deux marchés ; la valeur optimale de to est telle que le coût marginal de la
recherche est égal au gain marginal attendu. L’évolution dans le temps des valeurs marginales du 5 Cette simplification revient à supposer en particulier que les travailleurs ont la possibilité de s’assurer parfaitement contre les risques de chômage. Cette hypothèse est traditionnelle dans les modèles d’équilibre général dynamique. Elle permet d’éviter la difficulté (à ce jour difficilement surmontable dans un cadre d’équilibre général) de prendre en compte l’effet du risque de chômage sur les comportements d’épargne.
- 13 -
capital et des différents types d’emploi (en d’autres termes, l’évolution dans le temps des dérivées
partielles de HtW par rapport à chacun de ses arguments) est déterminée par application du théorème
de l’enveloppe. Le comportement optimal du ménage est ainsi complètement déterminé.
2.5. La formation des salaires
On suppose que les travailleurs occupant un emploi complexe négocient leur salaire au début de
chaque période avec leur employeur. Le résultat de la négociation est déterminé par la maximisation
du produit de Nash généralisé (cf. Cahuc-Zylberberg (2001)) :
(13) ( )(1 )
'max
ct
ct
HN ch cv
t tw t
WW W
ηη−
−
U,
Le premier terme du produit de Nash ( '/HcNt tW U ) est la valeur marginale d’un emploi complexe pour
le travailleur (la dérivée partielle de la fonction HtW par rapport à l’emploi c
tN divisée par l’utilité
marginale de la consommation) ; le second terme est l’accroissement de la valeur actualisée des
profits attendus par l’entreprise lorsque l’emploi vacant est pourvu. Le paramètre η représente le
pouvoir de négociation du travailleur. Compte tenu de la condition de libre entrée 0cvtW = , le salaire
négocié ctw implique le partage suivant du surplus total :
(14) ( )'H Hc cN Nt t
cht tW W Wη= + U .
On pourrait de la même façon supposer que le salaire des travailleurs occupant des emplois simples
est négocié entre le travailleur et son employeur. La hiérarchie observée des salaires étant
particulièrement stable, il semble plus réaliste de supposer que le salaire stw payé aux travailleurs
occupant des emplois simples (qu’ils soient plus ou moins qualifiés) est indexé sur ctw . Les
indemnités de chômage et de préretraite (utw et e
tw ) sont exogènes.
- 14 -
3. Analyse des effets de retraits de la vie active
Les implications des comportements des agents et du fonctionnement des marchés décrits dans le
modèle théorique de la section 2 peuvent être étudiées par le biais de simulations numériques. Cet
exercice se fait en deux étapes. La première consiste à étalonner le modèle (c’est-à-dire spécifier les
fonctions utilisées et donner une valeur numérique à leurs paramètres). La seconde étape consiste à
simuler avec le modèle ainsi étalonné les effets à court et à long terme d’une réduction de la
population active peu qualifiée.
3.1. Etalonnage
On supposera une fonction d’utilité logarithmique, une fonction de production et des fonctions
d’appariement de type Cobb-Douglas ; les intensités de recherche seront représentées par des
fonctions linéaires de la racine carrée du temps consacré à la recherche. Les valeurs numériques des
paramètres de ces fonctions sont fixées sur base des informations disponibles. Des estimations
économétriques sont disponibles pour un certain nombre de paramètres ; pour les autres, les valeurs
seront choisies de sorte que la simulation de référence du modèle reproduise les valeurs observées au
cours d’une période donnée, en l’occurrence la situation de 1996 en Belgique6. La période de
référence est le trimestre.
Le taux de dépréciation du capital δ est fixé à 0.025 et le taux d’escompte β des ménages à 0.99 (de
sorte qu’à l’état stationnaire le taux d’intérêt réel vaille 4% l’an). Le coefficient du capital dans la
fonction de production Cobb-Douglas est fixé à 0.3, impliquant un rapport capital-output de 2 en
termes annuels7. Les coefficients des biens intermédiaires simples et complexes sont ceux estimés par
Shadman-Sneessens (2000), sur base de séries d’emplois et de salaires relatifs des travailleurs plus et
moins qualifiés. Le niveau de qualification est défini par le niveau d’études, les moins qualifiés ayant
au plus un diplôme du cycle inférieur de l’enseignement secondaire. L’efficacité relative des
travailleurs moins qualifiés dans la production de biens simples (paramètre ν) est fixée à 0.8 ; ce
6 Une justification détaillée des valeurs numériques des paramètres est donnée dans Pierrard-Sneessens (2002). 7 Cette valeur du coefficient de capital est plus faible que celle traditionnellement retenue dans les modèles RBC (0.33). Cela n’implique pas néanmoins que la part des salaires dans la valeur ajoutée soit plus élevée que celle retenue dans ces modèles (où elle vaut 1 moins la valeur du coefficient du capital). A cause des imperfections du marché du travail, la part des salaires dans la valeur ajoutée totale est inférieure à 0.7, et de l’ordre de 0.64.
- 15 -
choix arbitraire a peu d’incidence sur les résultats de simulation. La proportion α de travailleurs plus
qualifiés dans la population active est égale à 0.67 ; les taux de chômage sont de 7.3% et 20.5% pour
les plus et les moins qualifiés respectivement (source : Office National pour l’Emploi et Enquêtes
Forces de Travail). Les valeurs des taux de destruction d’emplois (ψ = 0.025, χ =0.05 ), des intensités
de recherche ( ctσ =0.55, s
tσ =0.83, to =0.77) et de la proportion de travailleurs plus qualifiés
occupant des emplois simples (ladder effect 8 égal à 8%) sont choisies de telle sorte qu’à l’état
stationnaire les flux décrits à la figure 1 génèrent les valeurs observées des stocks d’emploi et de
chômage. On obtient les valeurs désirées des intensités de recherche en fixant de manière appropriée
les valeurs des paramètres des fonctions décrivant ces intensités (fonctions linéaires de la racine
carrée du temps consacré à la recherche). L’élasticité des appariements au nombre d’emplois vacants
est fixée à 0.40 pour les deux types d’emploi, valeur compatible avec les résultats empiriques
disponibles. Comme Merz (1995) et Andolfatto (1996), on supposera également que ce paramètre
coïncide avec le pouvoir de négociation des entreprises et détermine donc le partage des rentes. Le
rapport des salaires « simples » et « complexes » et les indemnités de chômage utw sont fixés à des
valeurs correspondant à celles observées (/s ct tw w =0.66 et taux de remplacement moyen égal à 0.34 ;
cf. Van der Linden-Dor (2001)). On supposera enfin e ut tw w= (cette hypothèse n’a aucun impact sur
les résultats de simulation). Les coefficients d’efficacité des fonctions d’appariement ainsi que les
coûts de vacance (a =0.90, b=0.26) sont fixés de façon à obtenir les probabilités de recrutement (qc et
qs) et d’embauche (pc et ps) conformes aux évaluations disponibles (qc= qc=0.5 et pc=0.35, ps=0.20 ;
cf. Cockx-Dejemeppe (2002) et UPEDI (2001)). Ces valeurs impliquent un coût total des vacances de
l’ordre de 2.5% du PIB.
3.2. Simulations
Le scénario étudié est le suivant. La situation initiale de l’économie est celle de l’année de référence
(1996), considérée comme un état stationnaire. On suppose qu’à ce moment est prise la décision de
retirer définitivement du marché du travail (par départs en préretraite) un nombre de chômeurs peu
qualifiés correspondant à 5.7% de la population active totale (le même pourcentage que celui du
8 L’expression ladder effect traduit la propension des travailleurs plus qualifiés à rechercher des emplois simples, pour lesquels ils sont « sur-qualifiés », lorsque la probabilité de trouver un emploi complexe adapté à leurs qualifications est relativement faible.
- 16 -
tableau 1). On examine les conséquences à court et à long terme de cette politique en simulant le
modèle précédemment décrit. Cette simulation numérique est réalisée à l’aide du logiciel Dynare9.
-20%
-16%
-12%
-8%
-4%
0%
0 4 8 12
ul
uh
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
0 4 8 12
ns
nc
Figure 2: Evolution des taux de chômage des travailleurs plus et moins qualifiés (uh et ul) et du nombre d’emplois « simples » et « complexes » (ns et nc)
-1,4%
-1,0%
-0,6%
-0,2%
0,2%
0 8 16 24 32 40 48
wc
K
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0 4 8 12
ps
"ladder effect"
Nsh/Ns
Figure 3: Evolution du salaire des travailleurs exerçant des tâches complexes et du stock de capital (wc et K, panneau gauche), de la probabilité de sortie du chômage d’un travailleur peu qualifié et de la proportion d’emplois simples occupés par des travailleurs qualifiés (ps et ladder effect, panneau droit)
La figure 2 illustre les effets sur les taux de chômage et les niveaux d’emplois (les valeurs reportées
sont les écarts par rapport à la situation de référence). Les stocks d’emploi ne pouvant s’ajuster
instantanément, l’effet immédiat des préretraites est essentiellement de réduire le taux de chômage
des peu qualifiés d’un montant correspondant (quelque 17 points de pourcentage). A terme, cette
réduction de l’offre de main-d’œuvre peu qualifiée réduit la rapidité avec laquelle les emplois vacants
sont pourvus (baisse de la probabilité stq de pourvoir un emploi simple durant le trimestre en cours),
9 Logiciel mis au point au Cepremap ; voir notamment Juillard (1996).
- 17 -
ce qui accroît les coûts de vacance et donc le coût moyen de la main-d’œuvre, et réduit l’emploi
d’équilibre. La réduction du nombre d’emplois simples atteint 6.08% après quatre ans.
Le panneau gauche de la figure 3 montre que dans le long terme la baisse de l’emploi s’accompagne
d’une baisse du stock de capital (l’accroissement du coût de la main-d’œuvre provoqué par la baisse
de stq réduit la profitabilité de l’investissement). Le stock de capital et le nombre d’emplois simples
augmentent néanmoins transitoirement durant les premiers trimestres suivant la mise en œuvre des
préretraites. Cet accroissement transitoire du stock capital reflète l’augmentation transitoire de
l’épargne : dans le court terme (premier trimestre), le niveau d’activité et les revenus distribués
demeurent inchangés, cependant que la consommation est revue à la baisse en anticipation des baisses
futures de revenu (théorie du revenu permanent). La hausse transitoire du nombre d’emplois simples
est en partie le reflet de cette hausse transitoire du stock de capital (qui stimule la production et la
demande de main-d’œuvre) ; mais elle reflète aussi et surtout la présence plus forte des travailleurs
plus qualifiés (dont la productivité est plus élevée) sur le marché des emplois simples. Les préretraites
et la réduction de l’offre de main-d’œuvre moins qualifiée qui en découle augmentent en effet la
probabilité de trouver un emploi sur le marché des emplois simples ( stp augmente de 7.8% à court
terme, 10.9% à long terme ; cf. panneau droit de la figure 3). Cette hausse incite les chômeurs plus
qualifiés à intensifier leur effort de recherche sur le marché des emplois simples, ce qui augmente
progressivement la proportion de travailleurs plus qualifiés occupant ce type d’emploi. Le ladder
effect augmente au total de quelque cinq points, passant en quelques trimestres de 8 à 13%. Un effet
secondaire de ce comportement de recherche des travailleurs plus qualifiés est une baisse de la
rapidité avec laquelle les emplois complexes vacants sont pourvus, ce qui signifie ceteris paribus une
hausse du coût de la main-d’œuvre pour les entreprises de biens intermédiaires complexes. Le
panneau gauche de la figure 3 montre l’évolution du niveau des salaires. Après une légère hausse (liée
à l’accroissement du stock de capital), le salaire réel baisse progressivement. Cette baisse reflète la
baisse du surplus à partager entre entreprises et travailleurs, baisse engendrée par la hausse des coûts
de vacance.
On observe donc une réduction généralisée de l’emploi. La réduction est assez faible pour les emplois
complexes, très marquée pour les emplois simples. Il y a dans le même temps baisse généralisée des
taux de chômage. Pour les moins qualifiés cette réduction résulte directement de la réduction de la
- 18 -
population active ; pour les plus qualifiés, la baisse du chômage vient de la proportion accrue de
travailleurs qualifiés occupant des emplois simples. Les baisses de l’emploi s’accompagnent d’une
baisse de l’investissement, de la production et de la consommation (-2.3% à long terme).
4. Conclusions
L’analyse et l’exemple numérique développés dans cet article illustrent combien le coût de mesures
de réduction de population active peut être élevé en termes d’emplois et de niveau d’activité, même
lorsque les retraits sont ciblés sur les populations les plus touchées par le chômage (les travailleurs
moins qualifiés). Au-delà des chiffres, l’objectif de cet article était également d’illustrer la nature et la
diversité des mécanismes par lesquels ces effets néfastes apparaissent. La réduction de la population
active induite par les préretraites a pour conséquence à long terme d’augmenter le coût de la main-
d’œuvre, soit directement via l’effet du taux de chômage sur les salaires, soit indirectement via l’effet
du taux de chômage sur les difficultés de recrutement. On pourrait penser que ces effets sont faibles et
négligeables. Les évaluations quantitatives suggèrent qu’ils ne le sont pas. Les réductions d’emploi
sont particulièrement sévères pour le groupe directement concerné par les réductions de population
active : la réduction de l’emploi des moins qualifiés représente environ 50% de la réduction de leur
population active. En d’autres termes, une réduction de la population active moins qualifiée de 14%
engendre une baisse du taux de chômage de ce groupe de 7 points seulement. L’emploi des
travailleurs plus qualifiés diminue également, mais de façon plus ou moins prononcée suivant
l’intensité des interactions salariales (wage-wage spiral) et la plus ou moins forte segmentation du
marché du travail (possibilité ou non d’occuper des emplois traditionnellement réservés aux moins
qualifiés). Le taux de chômage des plus qualifiés augmente de 4 points dans le plus mauvais scénario,
reste quasi inchangé dans le meilleur.
Parce qu’elle est basée sur une analyse explicite des flux, la modélisation adoptée permet de montrer
que les préretraites ont néanmoins pour effet d’augmenter significativement la probabilité
d’embauche de ceux qui restent sur le marché du travail (les plus jeunes). De ce point de vue, la
politique des préretraites semble atteindre l’un des objectifs visés. La probabilité individuelle d’être
embauché augmente, mais le nombre total de travailleurs embauchés diminue… Ce paradoxe n’est
- 19 -
qu’apparent. Il vient simplement du fait que la réduction induite du nombre des emplois reste
(heureusement) plus faible que la réduction initiale de la population active.
- 20 -
Références
Andolfatto D. (1996) "Business Cycles and Labour-Market Search", American Economic Review, 86-1, 112-132.
Cahuc P. et A. Zylberberg (2001) Le marché du travail, Bruxelles : De Boeck Université.
Cockx B. et M. Dejemeppe (2002) "Is there Job Competition and Skill Mismatch among Unemployed Workers in Belgium", mimeo, IRES, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve.
Gautier P.A. (2002) "Unemployment and Search Externalities in a Model with Heterogeneous Jobs and Heterogeneous Workers", Economica, 69, 21-40.
Juillard M. (1996) "DYNARE : un programme pour la résolution et la simulation de modèles dynamiques avec variables avancées à l'aide d'un algorithme de relaxation", CEPREMAP working paper n°9602, Paris. Layard R., S.Nickell et R.Jackman (1991), Unemployment. Macroeconomic Performance and the labour market, Oxford : Oxford University Press.
Merz M. (1995) "Search in the labour market and the real business cycle", Journal of Monetary Economics, 36, 269-300.
Mortensen D.T. et C. A. Pissarides (1999) "Job reallocation, Employment Fluctuations and Unemployment", Ch 18 in J.B. Taylor et M. Woodford, eds, Handbook of Macro Economics, Vol. 1b, pp1171-1227, Amsterdam: Elsevier Science.
Nickell S. et B. Bell (1997) "Would cutting payroll taxes on the unskilled have a significant impact on unemployment ?", ch. 10 in D. J. Snower et G. de la Dehesa, eds, Unemployment Policy: Government Options for the Labour Market, pp296-328, Cambridge: Cambridge University Press (UK).
Pierrard O. et H.R. Sneessens (2002) "Low-Skilled Unemployment, Biased Technological Shocks and Job Competition ", mimeo, IRES, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve.
Sneessens H.R. et F. Shadman (2000) "Analyse macro-économique des effets de retraits de la population active", Revue belge de sécurité sociale 3, 631-640.
UPEDI (2001), "Les entreprises et le recrutement en Belgique", Bruxelles.
Van der Linden B. et E. Dor (2001) "Labor market policies and equilibrium employment: Theory and application for Belgium", IRES Discussion Paper 0105, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve.