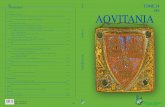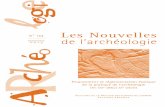HORRY (A.): Entre Nord et Sud. Céramiques médiévales en Lyonnais et Dauphiné
DU QUARTIER À LA VALLÉE. QUELS CADRES OUR LA GESTION DES MONTS DANS LES ALPES MÉDIÉVALES ?
-
Upload
univ-savoie -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of DU QUARTIER À LA VALLÉE. QUELS CADRES OUR LA GESTION DES MONTS DANS LES ALPES MÉDIÉVALES ?
Fabrice Mouthon
DU QUARTIER À LA VALLÉE
QUELS CADRES OUR LA GESTION DES MONTS DANS LES
ALPES MÉDIÉVALES ?
Les espaces collectifs dans les campagnes, XIe-XXIe siècle. Actes du colloque
organisé à l’université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand du 15 au 17 mars
2004, sous la direction de P. Charbonnier, P. Couturier, A. Folain et P.
Fournier, Presses universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2007, p.
161-176.
En 1169, dans les Alpes Maritimes, une sentence arbitrale de l’évêque de
Vintimille tranchait le conflit opposant la communauté de Tende à celle de
Saorge, à propos du territoire pastoral de Pratis planis. L’arbitrage confirmait la
proprietas de Tende et définissait celle-ci, à la fois par le pouvoir de juridiction
de la communauté et par les droits d’usage immémoriaux dont elle disposait sur
la montagne1. En réalité, les cas de Tende et de quelques autres vallées
représentent plutôt l’exception que la règle. Dans les Alpes, lorsque les sources
écrites permettent d’y voir clair, c’est-à-dire, selon les régions, entre le XIIe et le
XIVe siècle, « les monts », c’est-à-dire l’espace inculte des finages montagnards,
relèvent, en tant que res publicae, de la seigneurie justicière et même souvent
directement du ban comtal ou épiscopal2. En 1290, un noble de Tarentaise
expliquait que ses hommes tenaient du comte de Savoie, et non de lui, leurs
droits d’usage sur les eaux et les pâturages d’altitude en vertu des regalia et du
ban de justice de celui-ci3. Sur ces espaces, la coutume reconnaissait
ordinairement aux paysans l’exercice de droits d’usage collectifs moyennant le
versement de redevances annuelles4. Seul le transfert parfois massif des droits
aux établissements réguliers, entre la fin du XIe et le début du XIIIe siècle,
pouvait constituer une menace réelle sur l’accès aux monts des populations
montagnardes.
À partir de la fin du XIIIe siècle, ou même du XIIe en Lombardie, les seigneurs
ont, au contraire, multiplié les concessions de forêts et d’alpage en faveur des
collectifs paysans. Chartes de franchises, chartes de concession spécifiques
1 LASSALLE (Juliette), « Terres communes et délimitations de territoires à partir des litiges sur la transhumance
dans la haute vallée de la Roya (XIIe-XVe siècle) », Provence Historique, fasc. 206, 2001, p. 448-450. 2 OURLIAC (Paul), GAZZANIGA (Jean-Louis), Histoire du droit privé français de l’an mil au code civil, Paris,
1985, p. 235. 3 Item, dicit quod homines sui tenent a domino comitis usum suum predictorum, pascuorum, jurum et aquarum
pro quibus debent domino regalia et habat dominum in ipsi que cominunt banna et justicia videlicet in
Tharantasia (Extentes de Tarentaise, Arch. Dept. Savoie, SA 3112, peau 12). 4 Pour le Dauphiné, voir par exemple, VAILLANT (Pierre), Les libertés des communautés dauphinoises (des
origines au 5 janvier 1355), Grenoble, 1951, p.398-400.
(chartes d’albergement comme on dit en Savoie) ou encore véritables statuts
régionaux, comme en Briançonnais ou dans le Tyrol, en constituent les
supports5. La plupart du temps, il ne s’agissait, dans un contexte d’embarras
financiers, que de la confirmation et de la mise par écrit de droit anciens,
précisés et réactualisés. Dans certains secteurs, tel le Briançonnais ou la
Lombardie, on voit des communautés racheter les droits seigneuriaux sur les
monts ; d’autres encore les prennent à ferme6. Même les monastères de
montagne, en proie, à la fois à une baisse de leurs revenus et à la crise financière
du recrutement des convers, doivent concéder aux paysans la majeure partie des
montagnes auparavant exploitées en faire-valoir direct. D’une façon générale, et
malgré des poches de résistance seigneuriales et notamment monastiques, à la
fin du XVe siècle, les communautés sont maîtresses –à des degrés très divers il
est vrai- des alpages et, des forêts qui se trouvent sur leur territoire. Ceci dit, de
quelles communautés s’agissait-il et dans quel cadre territorial agissaient-elles ?
MONTAGNES ASSOCIATIVES
Les montagnes paysannes n’étaient pas toujours aux mains de communautés
d’habitants. Il était fréquent qu’elles relèvent plutôt d’associations, dites le plus
souvent « pareries », « consorteries », réunissant un nombre variable de familles
autour d’une ancienne concession seigneuriale ou des droits d’usage associé à la
possession de parts de mas.
Communautés d’exploitants
En Faucigny, notamment dans les vallées de Chamonix et de Montjoie
étudiées par Nicolas Carrier, les montagnes qui, aux XIIIe-XVe siècles, ne
relevaient pas des communautés de quartiers étaient entre les mains de syndicats
d’éleveurs locaux7. Pour ce que l’on en devine, ces consorteries (ou consortage)
étaient issues soit d’un bail emphytéotique collectif passé avec le seigneur, soit,
moins fréquemment, de la mise en communs de pâturages privés par un certain
nombre d’éleveurs, le plus souvent quelques dizaines. Leurs contours même
pouvaient évoluer en fonction du nombre de consorts et de l’élargissement de
l’activité pastorale : il pouvait ainsi se produire des fusions, ou, au contraire des
5 MOUTHON (Fabrice), « Les communautés alpines et l’Etat Fabrice (milieu XIIIe- début XVIe siècle) », Actes du
XXVe congrès de la SHMES (Chambéry, mai 2003), Paris, 2004, p.151-178. 6 En 1306, la communauté de Termignon, en Haute Maurienne, rachetait les droits des nobles de Lanslevillard
sur la moitié de la montagne de la Rocheure (GROS, 1946, 1, p. 222). Au début du XVe siècle, en Haute-
Tarentaise, les communautés de Landry, Pesey et Aime prenaient à ferme l’auciège de leurs montagnes, c’est-à-
dire la redevance en fromage due pour l’estivage, après du châtelain comtal de Salins pour quelques dizaines de
sous par an (Compte de châtellenie de Salins, Arch. dept. Savoie, SA 16721, peau 18, 1415-1416).
Sur les Alpes maritimes, voir BOYER, 1990, p. 65-78. Sur les Préalpes de Lombardie, voir MENANT, 1993, p.95-
502. 7 CARRIER, La vie montagnarde, op. cit., p.319-323.
scissions de sociétés8. La disposition des droits d’usage tournait autour de deux
systèmes. Soit, ces droits étaient indivis entre tous les consorts qui, dans les
terriers et aveux en faisaient reconnaissance, soit, chaque famille disposait de
parts ou « jura », transmissibles et divisibles dont le nombre déterminait
généralement le nombre de bêtes qu’il lui était possible « d’inalper ». Ce dernier
système, qui paraît s’imposer seulement au XVe siècle, autorise les éleveurs les
plus importants à cumuler les droits jura en profitant des difficultés des autres.
Vers 1370, les habitants d’une trentaine de hameaux des paroisses de Saint-
Gervais, Saint-Nicolas-de-Véroce et Megève fusionnaient les deux alpages
communs couvrant la montagne du Mont d’Arbois. Un siècle plus tard,
transaction après transaction, le Mont d’Arbois était devenu une montagne
indivise, non plus entre tous les habitants de ces hameaux mais entre les 185
détenteurs des 85 parts, détenteurs dont certains étaient même étrangers aux trois
paroisses d’origine9.
La diffusion de ce type de sociétés dans l’arc alpin apparaît finalement assez
limitée. En dehors du Faucigny, elles semblent bien présentes dans le Chablais
où Pierre Duparc a révélé celle dites des Jomarons de Chéravaux, dans la haute
vallée d’Aulps, vraisemblablement née d’un acte d’albergement du XIIIe
siècle10. Une autre communauté de jomarons existait, un peu plus en aval dans la
paroisse du Biot, celle de la vaste montagne de Tres Monterey (tenementariorum
et jomaronorum montis de Tres Monterey). Vers 1518, 40 de ses membres firent
sécession pour fonder la consorterie ou communauté de la montagne de
Belleplagne, composée de « trois ou quatre cent séterées de prés, bois, rives,
communs, pâturages et parcs »11. Les nouveaux jomarons (jomaronii montos de
Belleplagnie), dits aussi condivisores, firent immédiatement reconnaissance à
l’abbaye d’Aulps. Ici les droits des jomarons restaient entre les mains des
premiers albergataires et de leurs héritiers, faisant de ceux-ci un groupe
spécifique au sein même de la communauté d’habitant. Comme le montrent,
pour des vallées voisines, plusieurs exemples plus tardifs (XVIe et XVIIe
siècles), cités par Pierre Duparc, Jomarons semble bien prendre, aux confins du
chablais et du Faucigny, le sens de « consorts »12. Ailleurs en Savoie, on
retrouve ce type de sociétés en Val d’Arly, en Beaufortain ainsi que dans les
massifs des Bornes. En Beaufortain, au milieu du XVe siècle, une part de
montagne se trouvait partagée en 17 lots reconnus par 35 personnes. Les ayant
droits se réclamaient tous d’un unique albergement originel accordé jadis à
8 Ibid., p.325-326. 9 Ibid., p.327. 10 DUPARC (Pierre), “Une communauté pastorale en Savoie. Chéravaux », BPH, 1963, 1, p. 309-329. 11 Reconnaissance à l’abbaye d’Aulps (N. MUDRY, Mémoires et documents publiés par l’Académie
Chablaisienne, tome VIII, Thonon, 1894, doc. IV, p.136-147). 12 DUPARC, « Chéravaux », op . cit, p. 317-318.
plusieurs frères par le comte de Savoie13. En 1475, huit groupes familiaux
faisaient reconnaissance aux chartreux du Reposoir pour les 72 parts de la
montagne d’Auferand, dans le massif des Bornes ; ce, au devoir de douze jours
d’auciège perçue sur la traite des 80 vaches qu’ils avaient l’autorisation
d’inalper. La majorité des consorts venaient du versant nord d’Auferand,
notamment de Nancy, un groupe venant du Grand Bornand, sur le versant sud14.
À chaque groupe, il était interdit de vendre ses parts à des étrangers. Les
consorteries d’alpage étaient également fréquentes en Valais ainsi qu’en Val
d’Aoste où, comme dans la vallée de Chamonix, elles existent encore
aujourd’hui15. À la fin du XVe siècle, les neuf montagnes du mandement de
Sarre, en val d’Aoste, étaient exploitées par autant de consorteries16. En 1493,
leurs procureurs se réunirent, à raison de deux par montagne, pour adopter un
règlement commun touchant le nombre maximum de bêtes à introduire sur
chaque alpage. Il fut également décidé que les gens de Sarre ne disposant pas de
part de ces alpes pourraient néanmoins confier leurs bêtes aux ayant droits dans
les limites du quota d’animaux de ces derniers. Enfin, clause que l’on retrouve
chez les jomarons du Chablais, toute personne désirant vendre ses parts devait
d’abord les proposer aux autres consorts à un prix raisonnable. Dans la foulée,
on décida enfin de l’élection annuelle de quatre prud’hommes chargés de
vérifier le respect des décisions prises. Dans les faits, la réunion aboutissait à
fédérer les huit sociétés autour de règles communes.
En dehors de ce bloc, correspondant aux Alpes Nord-Occidentales, les sociétés
d’exploitants sont beaucoup plus discrètes17. Pour le Vercors, Vital Chomel
signale le cas des chaumes d’Autrans acensés en 1488 par le seigneur de
Sassenage à une fédération de dix pareries composées de familles des principaux
éleveurs des hameaux environnants18. Dans les Alpes centrales et orientales, les
bogge des Grisons méridionaux et les regole du Trentin et des Dolomites
recouvrent, semble t-il, une réalité un peu différente : plus que des sociétés
13 VIALLET (Hélène), Les alpages et la vie d’une communauté montagnarde : Beaufort du Moyen Age au XVIIIe
siècle, Annecy – Grenoble, 1993, p. 87. 14 DUPARC (Pierre), « La montagne d’Auferand. Cinq cent ans de communauté pastorale », Economies et sociétés
dans le Dauphiné médiéval. 108e congrès des sociétés savantes (Grenoble 1983), Paris, CTHS, 1984, p.161-181
Voir aussi, sur ces montagnes des Bornes, le fond du Reposoir aux Arch. Dept. Haute-Savoie, not. les SA 195. 15 En 1455, par exemple, l’alpe de Tribouc ou Chisserella, située dans le val d’Anniviers, en Valais, et
appartenant à l’église paroissiale de Vissoie, était baillé à un cens à consortage de plusieurs dizaines de
membres (Erasme ZUFFEREY, Le passé du Val d’Anniviers. L’époque moderne (1482-1798), ed. Michel
SALAMIN, Sierre, 1973, p.39). Pour le Val d’Aoste, les forêts et alpages de la vallée de Cogne étaient, au XIVe
siècle, à l’usage des paroissiens, sauf la montagne d’Alpisson, tenue du seigneur-évêque par une consorterie (DE
TILLIER (Jean Baptiste), Le franchigie delle comunità del ducato di Aosta. A cura di M.C. DAVISO DI
CHARVENSOD et M.A. BENEDETTO, Turin, 1965, n°XII, p.66, 1331) 16 DE TILLIER, Le Franchigie, op. cit., n°XLI, p. 241-244 (1493). 17 En dehors des sociétés formées par les usagers de canaux d’irrigation et les exploitants d’excavations minières
qui semblent, elles, avoir été largement répandues dans tout l’Arc alpin. 18 CHOMEL (Vital), « La seigneurie rurale en Vercors après la rénovation des terriers de la baronnie de Sassenage
(1488-1489) », Seigneurs et seigneuries au Moyen Age. Actes du 117e congrès des sociétés savantes, (Clermont-
Ferrant, 1992), Paris, CTHS, 1995, p. 120-121.
d’éleveurs, il faut y voir des communautés de villages ou de fractions organisée
et institutionnalisées autour de l’exploitation des monts19. Plus au Sud, par
contre, les Lessini, c’est-à-dire les monts de Vérone, sont exploités par des
associations de propriétaires urbains, somme toute comparables aux consorteries
des Alpes du Nord-Ouest20.
Communautés de mas
En Savoie et en Dauphiné, des portions entières de montagnes pouvaient
également relever de manses ou mas. Il s’agissait de groupements de tenures
dont les titulaires, formés en pareries ou comparsoneries, faisaient
reconnaissance en bloc et restaient solidaires dans le paiement des redevances et
l’accomplissement des services dus au seigneur21. Certains mas se confondaient
avec un hameau et son finage, d’autres n’incluaient aucune maison et
correspondaient plutôt à un quartier de culture d’un seul tenant ; d’autres encore
rassemblaient des parcelles éparses imbriquées avec celles d’autres mas. En
Savoie, des mas et d’autres unités même type mais sans qualificatif précis,
apparaissent dans ces grandes enquêtes comtales des années 1270-1335 que sont
les extentes22. Ils semblent surtout caractériser les massifs et vallées du sud, tels
que les Bauges, la Maurienne et la Tarentaise où les terriers du XVe siècle les
évoquent encore. En Haut Dauphiné plus encore, les mas sont omniprésents
dans sources, depuis le probus des années 1250 jusqu’aux terriers du XVe siècle.
Or, en montagne, il n’était pas rare qu’un mas engobe, si ce n’est de grands
alpages, du moins des bois et des pâturages de versants ainsi que des droits
d‘usage. Au milieu du XIIIe siècle, d’après les enquêtes delphinales, plusieurs
mas du Briançonnais s’étendaient depuis le fond de la vallée jusqu’au sommet
des crêtes23. En Tarentaise, dans la paroisse de Pussy, le manse des Clefs
19 HITZ (Florian), dans Storia dei Grigioni, tome 1 : dalle origini al Medioevo, Coire-Bellinzona, 2000, p. 228..
RICHEBUONO (Giuseppe), Cenni storici sulle regole d’Ampezzo, Cortina d’Ampezzo, 2e ed. 2001. ZANGRANDO
(Fiorello), « La funzione economica de le antiche regole cadorine », DE MARTIN (Gian Candido) (a cura di)
Comunità di villagio e proprietà colletive in Italia e in Europa, Padoue, 1990, p. 127-160. 20 VARANINI (Gian Maria), « Una montagna per la città. Alpaggio et allevamento inei Lessini veronesi nel
Medioevo (secoli X-XV) », dans Li alti pascoli dei Lessini veronesi. Storia, natura, coltura, Vérone, 1991, p.43-
45). 21 Pour le Haut Dauphiné, FALQUE-VERT (Henri), op. cit., p.173-206. Egal. CHOMEL (Vital), « Pareries et
frérèches en Dauphiné, d’après quelques textes inédits (vers 1250-vers 1346) », Cahiers d’Histoire, 11, 1966,
p.309-312. Pour la Savoie, MOUTHON (Fabrice), « Entre familles et communautés d’habitants : les pareries dans
les Alpes savoyardes des XIIIe et XIVe siècles », Les hommes en Europe, Actes du 125e congrès des sociétés
savantes (Lille 2000), Paris, 2002, p. 97-120. 22 CARRIER (Nicolas), MOUTHON (Fabrice), « Extentes et reconnaissances de la principauté savoyarde. Une
source sur les structures agraires des Alpes du Nord (fin XIIIe-fin XVe siècle) », Terriers et plans-terriersp.217-
242. Actes du colloque de Paris (23-25 sept. 1998), Bibliothèque d’Histoire rurale n°5, Mémoire et document de
l’École des Chartes n°62, Paris, 2002. 23 À Césane en 1265 : dicunt quod antiquitus fuerunt tenementa dicte parrochie per mansos ab aquis seu rivulis
in fineis usque ad cacumina montium, ita quod terra et prata et heremi in hoc continentur … Arch. Dept. Isère,
B 3700, fol . 83 v°. Cité par VAILLANT (Pierre), « Les origines d’un libre confédération de vallée : les habitants
des communautés briançonnaises au XIIIe siècle », Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, 1967, 2, p. 336.
Egalement, FALQUE-VERT, L’homme et la montagne, op. cit., p. 186.
(mansum de Clavibus) incuait, en 1290 une partie de la montagne du Cuchet24.
Au cœur du massif des Bauges, les mas qui, au XIIIe et XIVe siècles,
structuraient les finages de paroisses d’Ecole, de Jarzy et d’Arith, partaient eux
aussi du Plan, c’est-à-dire du fond de ces vallées en auge, pour s’enfoncer
franchement dans l’espace inculte, annexant au passage de larges espaces de
bois25. Entre 1273, date de la première enquête sur les Bauges et 1335, date de la
seconde, on note une tendance à l’expansion de ces mas au dépens du saltus,
mais aussi une augmentation du nombre d’ayant droits ainsi qu’un
renouvellement partiel de ceux-ci, y compris au profit de familles extérieures à
la paroisse26. On pressent que l’accès aux monts qu’elles contrôlent est un des
enjeux de la participation aux pareries qui tiennent ces mas.
MONTAGNES COMMUNAUTAIRES
Lorsqu’une montagne relevait d’une collectivité territoriale, il faut se garder
d’en faire immédiatement l’équivalent des biens communaux ou sectionaux
contemporains. La réalité médiévale était passablement plus complexe.
Villages et paroisses
En Savoie, les villages formaient de simples communautés de voisinage ou, si
l’on veut, des consorteries d’habitants, sans institution autre que l’assemblée
générale des chefs de familles. En effet, ce sont les paroisses ou, plus rarement,
les vallées, qui se sont vu accorder des franchises et qui, avec les réformes de
1565, sont devenus le cadre officiel de la commune. Dans le massif des Bauges,
d’après les extentes et les comptes de châtellenie des XIIIe et XIVe siècles, les
bois et les pâturages de mi-pente, de même que la partie du commun qui
s’étendaient en fond de vallée, le long des cours d’eau, relevaient pour la
plupart, soit des mas, soit des villages. La partie supérieure des montagnes était,
quant-à-elle, soit monopolisée par les monastères, soit abandonnée par le comte
de Savoie, principal seigneur laïc ici, à l’usage, non pas des villages, mais des
communautés paroissiales27. En Savoie du Nord, notamment en Chablais et
Faucigny, où l’habitat était et reste très dispersé, quartiers, villages et groupes de
village se partageaient les droits sur les monts. Ainsi le 8 février 1487, le comte
apanagé de Genevois albergeait l’alpe de Rontine, située au-dessus de Samoëns,
en Faucigny, à douze comparsonniers, représentant les hommes et communautés
de six villages ou groupements de fermes appartenant au mandement et à la
paroisse de Samoëns28. Les bénéficiaires, qui disposaient ici depuis longtemps
24 Extente de Tarentaise, Arch. dept. Savoie, SA 3112, peau 8. Le manse est reconnu par 5 chefs de feu. 25 Extente de la châtellenie du Châtelard, 1335, Arch. dept. Savoie, SA 2962, 4. 26 Ibidem. 27 MOUTHON (Fabrice), Bauges médiévale, Chambéry 2009. 28 Comparsoneriis montis predicti Rontine ac procuratoribus hominum et communitatis villagiorum de Vignuni
Villarii, de Secoen, de Martinay, de Verthey, Truchiarum Roseriarum et castelletarum (Auguste DUFOUR,
de droits d’usage, se voyaient confirmer le droit de faire pâturer leurs bêtes, de
prendre du bois, d’édifier des cabanes et, éventuellement, de procéder au partage
et lotissement du territoire. Ils pouvaient désormais édicter des règlements,
nommer des missiliers et imposer des amendes aux contrevenants. La montagne
de Rontine devenait donc la possession non pas de la communauté
institutionnellement reconnue, celle du mandement et de la paroisse de
Samoëns, mais de l’association formée par quelques villages de cette
communauté29. Toujours à Samoëns, le prince garantissait également aux
habitants l’accès aux « sept montagnes » qui fermaient le nord-ouest du
mandement. En réalité, quatre d’entre-elles, après une histoire complexe où les
droits de l’abbaye cistercienne d’Aulps se mêlaient à ceux de plusieurs quartiers,
étaient, depuis un jugement de 1438, ouvertes aux gens du bourg et de tous les
villages, c’est-à-dire, cette fois, à l’ensemble de la communauté paroissiale. Les
trois autres montagnes, par contre, étaient communes aux seuls villages de
Vercland et de Morillon30.
Plus au Sud, en Tarentaise, en Maurienne, en Dauphiné et en Haute Provence,
comme dans le Piémont, la paroisse était, à la fin du Moyen Age, le cadre
presque unique de la communauté comme de la possession et l’exploitation des
monts. Pour autant, quelques cas particuliers suggèrent qu’il n’en avait pas
toujours été ainsi. En 1458, sur la montagne de l’Alpette, dans l’immense
paroisse de Saint-Maurice (aujourd’hui Bourg-Saint-Maurice), André
Tranchand, reconnaissait tenir la moitié de la tierce partie de deux parts du
septième du pâturage, en indivision avec « les hommes de la communauté
d’Alpette et avec tous leurs consorts »31. La communauté dont il est question ici
groupait tous les chefs de feu d’un quartier regroupant plusieurs hameaux du
vaste « versant au soleil », l’adret de Bourg-Saint-Maurice. En Haut-Dauphiné,
l’absence de communaux de villages, signalée par Nadine Viviers à propos des
XVIIIe et XIXe siècles32, est globalement confirmée, pour les XIIIe-XVe siècles,
par les travaux d’André Alix, de Thérèse Sclafert, de Pierre Vaillant et Henri
Falque Vert33. Pourtant, à Ceillac, entre Queyras et Embrunais, encore à la fin du
XVe et dans la première moitié du XVIe siècle, l’accès à certains alpages était lié
à la possession d’une maison dans le hameau ou forest qui se trouvaient au pied
François RABUT, « Deuxième centurie de documents historiques inédits. Chartes municipales des pays soumis à
la Maison de Savoie », Mémoire et documents publiés par la Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie,
tome XXIII, Chambéry, 1885, doc. LXI, p. 409-411). 29 En 1431, le duc Amédée VIII accorde aux hommes et communautés des lieux de tout le mandement de
Samoëns le droit d’élire quatre syndics (DUFOUR et RABUT, op. cit., doc. XLIV, p. 368-369). 30 TAVERNIER (Hyppolite), Histoire de Samoëns, Mémoire et document publié par la Société Savoisienne
d’Histoire et d’Archéologie, tome XXI, 1892, p.67-68. 31 « Pro indivision cum hominibus communitatis Alpete et cum aliis eorum consortibus » (ibid.). 32 VIVIER (Nadine), « Les biens communaux du Briançonnais aux XVIIIe et XIXe siècles », Etudes Rurales, 117,
janvier-mars 1990, p.143. 33 ALIX (André), L’Oisans au Moyen Age. Etude de Géographie historique, Paris, 1929, p. 79-92. SCLAFERT, Le
Haut Dauphiné, op. cit. FALQUE-VERT, L’homme et la montagne, op. cit. Contre-exemple dans VAILLANT, « Les
origines », op. cit, p.313.
de ceux-ci. Jadis habitats permanents, et mentionnés comme tels dans les
enquêtes de 1339, les principaux forests de la vallée ne comptaient plus vers
1500 que quelques familles résidentes. La majorité des maisons qui les
composaient étaient en réalité des « muandes », c’est-à-dire des granges-étables-
fruitières : des bâtiments où l’on stockait le foin, où l’on parquait les bêtes et où
l’on faisait le fromage. Toutes appartenaient aux habitants du village de La
Ville, le chef-lieu paroissial34.
Montagnes communes et indivises
Là où, dans les Alpes occidentales, on trouvait des communautés de vallées,
la gestion des monts n’en dépendait pas moins des échelons inférieurs, c’est-à-
dire le la paroisse ou bien des villages, des mas et autres consorteries. En
Briançonnais, où se forme, entre 1338 et 1343, la fameuse et un peu surfaite
« République des Escartons », aucune montagne ne relevait d’un escarton entier,
c’est-à-dire d’une vallée, encore moins des cinq escartons pris ensemble35. Pour
trouver une véritable organisation « à plusieurs étages », pour reprendre
l’expression de Pierre Charbonnier, il faut se rendre dans les Alpes centrales et
orientales, paradis des communautés de vallée. En val di Fiemme, dans le
Trentin, les alpages supérieurs relevaient de la communauté de vallée tandis que
les pâturages intermédiaires et les bois restaient à la jouissance particulière des
onze regole ou vicinie qui représentaient les communautés de villages. Tous les
ans, ces alpages, divisés en quatre parts, étaient, suivant une procédure que l’on
retrouve ailleurs, tirés au sort et attribués à chacune des quatre fractions
regroupant les vicinie 36. Dans le Nord Tyrol, de l’autre côté du Brenner, on
retrouve ce système d’alpage communs aux communautés de vallées et divisés
en sorts. Dans le Pitztal et le Lechtal, ces pâturages supérieurs ne furent
définitivement attribués aux communes au XIXe siècle, non sans le maintient de
certains droits communs à toute la vallée37. Selon les auteurs italiens et
autrichiens, le territoire de référence est ici, non pas celui du mandement, mais
celui de l’ancienne paroisse matrice ou pieve, cadre d’une ancienne communauté
de vallée fractionnée ensuite en unités plus réduites avec les progrès de la
démographie et de l’occupation du sol.
La maîtrise de ses montagnes par la communauté était aussi bornée par toutes
sortes d’enclaves et de servitudes. En 1237, les marigo des regole de Falzarego
et de Vinigo, dans la vallée d’Ampezzo (Dolomites), procédèrent à un partage et
34 MOUTHON (Fabrice), « L’habitat montagnard à la fin du XVe et au début du XVIe siècle dans la vallée de
Ceillac (Hautes-Alpes) », Le Monde alpin et rhodaniens, 4e trim. 2001, p.56-61. 35 FAUCHE-PRUNELLE (Alexandre), Essai sur les anciennes institutions autonomes ou populaires des Alpes
Cottiennes briançonnaises, Grenoble – Paris, 1856, tome 2. 36 GRASS (Niklaus), “ Die landliche gemeinde in Deutshtirol“, Die Ländliche gemeinde / Il comune rurale. Actes
du Congrès de Bad Ragaz (16-18/10/1985), Bozen, 1988, p.123. 37 Ibid., p. 126.
à une délimitation du Val Travenanzes. L’accord prévoyait qu’en cas de neige,
les brebis de Vinigo puissent redescendre en empruntant le territoire de
Falzarego38. En 1320, une sentence garanti aux habitants de Pertisau, en Tyrol,
l’usage exclusif de deux hautes vallées. Toutefois, en cas de guerre, il était prévu
que ceux de la paroisse de Münster, dans la vallée de l’Inn, puisse fuir avec leurs
bêtes dans ces mêmes vallées. En échange, ceux de Pertisau pouvaient replier
leurs troupeaux jusqu’à l’Inn s’ils étaient surpris par le gel ou la neige39.
Certaines communautés, mal dotées en montagnes ou contrôlées par des
éleveurs dynamiques et conquérants, avaient été également amenées à entrer en
possession d’alpages situés en dehors de leur territoire naturel. En Oisans, lors
des révisions de feux du XVe siècle, les habitants de Vaujany expliquaient aux
commissaires du dauphin qu’une partie des alpages de l’eau d’Olle et du col du
Glandon, pourtant sur le territoire de leur paroisse, appartenaient aux Savoyard
de la vallée des Villard, en Maurienne40. L’existence de ces enclaves était
naturellement génératrice de conflits41. Il en était de même des accords de
compascuité. Ces compromis, qui autorisaient les troupeaux d’une communauté
à pâturer ou à passer sur telle portion du territoire d’une autre, résultaient, soit
d’usages immémoriaux, soit de transactions ayant mis fin à d’anciens conflits.
Ils étaient toujours fragiles et susceptibles d’être remis en question. En
Champsaur, vers 1450, un conflit opposait, d’une part, la communauté Orcières,
particulièrement bien dotée en montagnes (pensons à l’actuelle station de ski
d’Orcières-Merlette), et, d’autre part, ses voisines du mandement du
Montorcier42. Les secondes prétendaient interdire à la première l’introduction
des transhumants sur son territoire au nom d’un ancien droit de compascuité ;
droit dont Orcières niait la réalité. En réalité, dans un contexte d’étiage
démographique, l’arrivée des troupeaux provençaux offrait davantage
d’opportunités à Orcières que le maintien de relations de bon voisinage. On
ignore la conclusion du procès mais les transhumants continuèrent, jusqu’au
XXe siècle, à fréquenter assidûment les alpages d’Orcières.
Les formes d’appropriation des monts par les collectivités paysannes étaient à la
fois souples, diverses et susceptibles d’évoluer. Il en était de même pour
l’étendue de cette appropriation, autrement dits les prérogatives réelles détenus
sur les monts par ces communautés
LA POLICE DES ESTIVES
38 RICHEBUONO, Regole d’Ampezzo, op. cit., p .17. 39 GRASS, Deutshtirol, op. cit., p. 127. 40 Exemple en 1458 (ALIX, L’Oisans, op. cit., annexe 11, p. 206. Egalement, p.15, 16, 87). 41 Pour les vallées piémontaises, voir GUGLIELMOTTI (Paola), « Comunità di villagio e comunità di valle nelle
alpi occidentali », Comunità e territorio. Villagi del Piemonte medievale, Rome, 2001, p.165-180. 42 Arch. dept. Isère, B 20.
Il y a quelques années, lors du colloque de l’association des historiens
modernistes, Anne Zink s’interrogeait sur le fait de savoir si disposer de la
police des estives était bien une caractéristique des sociétés montagnardes43.
Pour les Alpes, il faut envisager la question sous deux aspects distincts : celui du
partage de compétence avec l’autorité judiciaire ordinaire, c’est-à-dire, celle du
seigneur ou celle du prince. Celui du pouvoir réglementaire des communautés
sur les bois et les alpages
Police et justice
En simplifiant un peu, trois cas de figure peuvent être retenus.
1- Les membres de la communauté disposent de droits d’usage mais le
seigneur conserve la police des estives. C’est à lui que la communauté
s’adresse et doit s’adresser pour faire défendre ses droits contre les
troupeaux étrangers. Les monts relevant de mas ou de simples villages
ainsi que la plupart des montagnes associatives relèvent de ce modèle.
Dans les états de Savoie, les litiges forestiers et pastoraux étaient
normalement du ressort des châtelains –les représentants locaux du
prince- et des juges de judicature qui venaient y tenir leurs assises44. Ceci-
dit, ce n’est pas parce que la communauté ne disposait d’aucune capacité
reconnue d’intervention, qu’elle renonçait à défendre elle même ce qu’elle
estimait être ses droits, y compris par la violence physique et les
confiscations de bétail.45.
2- La police des estives est exercée conjointement par la communauté et le
seigneur. Aux Gets, en Faucigny, au début du XVe siècle, la communauté
élit quatre prud’hommes chargés de déterminer la date de montée aux
alpages, celle ci étant ensuite « criée » par les officiers du prieuré de
Contamine, seigneur du lieu 46. À Bessans, en Haute Maurienne, les
franchises de 1319 accordaient aux habitants de requérir l’intervention du
châtelain seigneurial, représentant l’abbaye de Saint-Michel-de-la-Cluse,
pour mettre à l’amende, ceux qui transgresseront les règlements établis
pour les bois communs. Les dénonciations devaient être faites par les
43 ZINK (Anne), « La nature et la culture dans la police des estives », La montagne à l’époque moderne. Acte du
colloque de l’association des Historiens modernistes (Clermont-Ferrand, 1998), Paris, 1998, p. 77-98. 44 MOUTHON (Fabrice), « Le règlement des conflits d’alpage dans les Alpes occidentales (XIIIe-XVIe siècles) »,
Le règlement des conflits au Moyen Age, XXXIe congrès de la S.H.M.E.S (Angers, juin 2000), Paris, 2001, p.271-
272. 45 En 1345, une sentence de la cour de l’archevêque d’Embrun, en Dauphiné, rappelait aux consuls de la
communauté de Châteauroux qu’ils n’avaient pas le droit de « pignorer », c’est à dire de saisir, de leur propre
chef, les troupeaux étrangers qui s’introduiraient sur la montagne de Combolier (FOURNIER (Marcellin), Histoire
des Alpes Maritimes et Cottiennes, tome 3, p. 360-365, pièces XXVI et XVII). 46 TAVERNIER (Hyppolite), Monographie des Gets et de la Côte-d’Arboz, Mémoire et document publié par
l’Académie Salésienne, tome 9, 1886, document n°11, p. 259-263 (transaction de 1421).
champiers au greffier de la communauté en présence des syndics qui
conservent le montant des amendes47.
3- La communauté est maîtresse des monts. Elle édicte librement des
règlements, peut imposer des amendes, dispose d’un personnel de
surveillance, peut mettre certaines partie des monts en défens, voire peut
les louer à des transhumants. Les droits seigneuriaux ont éventuellement
été abolis ou ont été rachetés voire affermés. En 1305, par exemple, la
confirmation du consulat de Selonnet, dans la vallée de la Blanche, en
Haute-Provence, reconnaissait à la communauté le droit de lever
librement des amendes dans les forêts48. Cette liberté dans la gestion des
communs était évidemment le fait des communautés les plus fortement
structurées et institutionnalisées, c’est-à-dire, essentiellement, des
communautés de paroisses et de vallées. La plupart des communautés du
Haut Dauphiné, spécialement celles du Briançonnais, mais aussi celles de
Haute-Provence orientale et de l’arrière-pays niçois étaient dans ce cas. Il
en était de même, avec des nuances, de celles des Alpes centrales et
orientales.
Des règlements pour les monts
Rien ne symbolise mieux le contrôle sur les monts que la capacité d’une
autorité à édicter des règles la concernant à les faire respecter. Liés à la présence
de notaires dans les hautes vallées, ces décisions ne sont guère mises par écrit
avant l’extrême fin XIIIe et surtout du XIVe siècle. Ces règlements peuvent
prendre plusieurs formes.
1. Plusieurs articles concernant les monts inclus dans une charte de franchises
concédée par le seigneur.
2. Les détails d’une charte de concession de montagne accordée par un
seigneur à une collectivité (consorterie, village, groupe de villages, paroisse
ou encore vallée).
3. Une transaction mettant fin à un conflit touchant une montagne entre le
seigneur et la communauté ou entre deux communautés.
Dans ces trois cas, le contenu des articles est évidemment négocié et la
communauté n’en a pas la totale maîtrise.
4. Plusieurs articles concernant les monts dans le statut général adopté par
une communauté ou un groupe de communautés.
5. Un règlement portant spécifiquement sur la gestion de monts adopté,
généralement en assemblée générale, par une communauté, voire, mais c’est
plus rare, par une consorterie.
47 DUFOUR (Auguste), « Les Franchises de Bessans », Travaux de la Société historique et archéologique de
Maurienne, 3, 1875, p. 129-138. 48 ALLIBERT (C.), Histoire de Seyne, de son bailliage et de sa viguerie, Barcelonnette, 1904, tome 2, pièce n°3.
Ici, les règles émanent bien de la communauté. Le seigneur peut avoir son mot à
dire ou pas du tout.
Le contenu de ces règlements est variable. Il concerne le plus souvent :
- l’accès aux bois et aux alpages, réservés ou non aux membres de la
communauté ; ouvert ou non aux bêtes prises en pension ou aux
transhumants.
- les usages qui y sont autorisés et ceux qui sont prohibés.
- Le type et le nombre de bêtes que l’on peut y introduire.
- Les dates d’inalpage.
- Les défens imposés dans certaines parties des communs.
- Les amendes auxquelles s’exposent les délinquants.
En Haute Provence orientale et dans le Haut-Pays niçois, ces documents sont
nombreux à partir des années 1290-130049. Les seigneurs ne paraissent guère
avoir pris part à l’élaboration de leur contenu. Ainsi, pour la fin du XVe siècle,
les statuts de Roquebilière, en Haute Vésubie sont certes promulgués avec
l’autorisation du bayle comtal mais ils émanent des seuls magistrats de la
communauté : syndics, prud’hommes et prieurs de la confrérie du Saint-Esprit50.
Dans les Préalpes du sud en revanche, la police des estives, des bois et de la
« terre gaste » restaient pour l’essentiel du domaine des seigneurs aussi c’est
dans les transactions conclues avec celui-ci que l’on trouve les articles relatifs à
la gestion des montagnes51. En Briançonnais, les inbannamenta, étaient édictés
en toute indépendance par les communautés et ce, pour les plus anciens, dés
avant la grande charte de 134352. À Briançon, en 1322, l’assemblée chargeait
quatre notaires de mettre par écrit un règlement forestier. Celui-ci prévoyait
amendes et même peines de prison pour les délinquants, mettait en place un
bannier pour traquer ces derniers ainsi qu’un conseil de prud’hommes, sorte de
commission forestière, pour la surveillance des bois.
En Savoie, comme en Val d’Aoste, la mise par écrit des usages concernant les
espaces collectifs se faisait surtout dans le cadre des chartes de franchises, au
demeurant assez peu nombreuses, et surtout d’albergements, signe que le
seigneur conservait presque partout la haute main sur la police des estives et des
bois. Aussi, très peu de statuts et règlements communautaires y ont été
conservés. Pour le Val d’Aoste, on a vu celui de la fédération des consorteries
49 SCLAFERT, Culture et déboisement, op. cit. BOYER (Jean-Paul), « Pour une histoire des forêts de Haute
Provence », Provence historique, n°161, 1990, p.276-279. 50 ROYER (Armance), « Un village de l’arrière-pays niçois : Roquebillière à la fin du Moyen Age », Bulletin
Philologique et Historique, 1965, Paris, 1966, pièce justificative, p.171-181. 51 STOUFF (Louis), « Un aspect de la Haute Provence à la fin de la période médiévale : peuplement économie et
société de quelques villages de la montagne de Lure, 1250-1450 », Cahiers du Centre d’Etude des Sociétés
Méditerranéennes, n°1, p. 81-91. 52 SCLAFERT, Le Haut Dauphiné, op. cit., p.654-659.
des montagnes de Sarre, rédigé en 1493 mais approuvé par le vice-châtelain de
Sarre. Pour la Savoie, le ban édicté par la communauté des Allues (en
Tarentaise) est à la fois le plus ancien, il date de 1390, et le plus complet53. Il est
vrai que cette communauté, qui relevait de l’archevêque de Moûtier, se signalait,
cas exceptionnel en Savoie, par une forte autonomie. Le préambule du document
explique que l’ordinamentum est l’œuvre de quatre hommes précédemment élus
dans ce but par l’université des hommes de la paroisse. Ceux-ci le lisent ensuite,
dans l’église des Allues, en langue laïque et à haute et intelligible voix, devant la
population assemblée. Tout cela, sans aucune intervention de l’archevêque ni de
ses agents. Etaient concernés les chemins, les bois, les pâturages communs. On y
traite du ramassage et de la coupe des sapins et des pins, du nombre maximum
de chèvres et de bêtes prises en location que l’on peut introduire dans ces
pâturages, de l’entretien des chalets communs sur les alpages, de l’exclusion des
bêtes malades. On y rappelle les dates d’inalpage et les défens mis sur certains
bois. On y parle du troupeau commun et des forestiers. A chaque fois sont
précisées les amendes auxquelles s’exposaient les délinquants.
Plus à l’Est sur le versant italien, la précoce familiarité des communautés rurales
avec l’écrit ne pouvait qu’encourager leur activité réglementaire. À la fin du
XIVe siècle, les communautés des Alpes Lombardes avaient fait rédiger leurs
statuts à l’invitation des autorités milanaises qui les favorisent aux dépens des
seigneurs locaux. Les articles concernant la gestion des communs, spécialement
des montagnes, y tiennent une grande place : inalpage, transhumance, irrigation,
pêche, essartage sont abondamment évoqués54. En Trentin et dans le Cadore, les
regole des dolomites commencent mettent leurs usages par écrit entre le milieu
du XIIIe et le milieu du XIVe siècle55. Ces laudi ou règlement, révisables par
l’assemblée générale touchent essentiellement à l’exploitation des monts. Les
récalcitrants pouvaient se voir mis à l’amende, voir leur bétail confisqué ou être
expulsé de la regola par les autorités de celles-ci. De même, les gardes ou saltari
étaient autorisés à pignorer le bétail étranger. Pour la forme, les laudi devaient
être approuvés par l’autorité supérieure, par exemple, après 1420, celle du
vicaire du Cadore, pour la République de Venise. En revanche, les statuts
généraux de la confédération du Cadore, compilés du XIVe au XVIe siècle, s’ils
traitent abondamment de l’exploration des bois, sont quasiment muets sur les
montagnes elles-mêmes ; preuve que leur gestion relevait bien des regole mais
en aucun cas de l’ensemble de la vallée56.
53 COLLECTIF, « Ordinamentum communitatis allodiorum. Le régime forestier et pastoral d’une communauté
tarine à la fin du XIVe siècle », Document publié par l’Académie de la Val d’Isère, nlle série, 2, 1922, p. 425-
434. 54 TOUBERT (Pierre), « Les statuts communaux et l’histoire des campagnes lombardes au XIVe siècle », Etudes
sur l’Italie médiévale (IXe-XIVe siècles), Variorum reprints, Londres, 1976.p. 467-486. 55 RICHEBUONO, Regole d’Ampezzo, op. cit. 56 Statuti della communità di Cadore, Venise 1593, Arnaldo Forni editore, Bologne, 1987.
CONCLUSION
La notion de communs ne suffit pas pour résumer les formes prises par la
possession et l’exploitation collective des monts dans les Alpes médiévales.
Parce qu’il faut envisager plusieurs types de communautés, sans compter les
communautés à plusieurs étages. Parce que le Bas Moyen Age est un temps de
recomposition entre ces divers types de communautés. De même, l’étendue des
droits dont dispose la collectivité paysanne peut se borner à de simples usages,
limités dans le temps et l’espace, sous la haute surveillance des agents
seigneuriaux, pour aller jusqu’à la pleine propriété impliquant la mise en place
d’agents communautaires, l’adoption de règles de gestion écrites et le lever
d’amendes sur les contrevenants et ce, sans aucune intervention d’une autorité
supérieure. A un moment donné et dans un lieu donné, la réalité de la possession
et de l’exploitation communautaire résulte toujours d’un compromis entre les
vieilles solidarités héritées du passé, et les rapports de force du moment :
tensions internes à la communauté et entre les différents niveaux de
communauté, relations des unes et des autres avec le seigneur et avec l’Etat
naissant ; relations avec les communautés voisines, enfin.