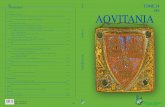Les vases acoustiques dans les églises médiévales : analyse des sources et études de cas
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Les vases acoustiques dans les églises médiévales : analyse des sources et études de cas
- 1 -
Les vases acoustiques dans les églises médiévales : analyse des sources
et études de cas
Pauline Carvalho, Etudiante, Univ. Paris X -NanterreJean-Christophe Valière, LEA, Univ. Poitiers – CNRS
Bénédicte Palazzo-Bertholon, CESCM, Univ. Poitiers – CNRS
IntroductionLe travail de recherche que nous présentons à travers cet article
est une étape de l’étude à long terme menée conjointement par des archéologues et acousticiens sur les vases acoustiques présents dans les édifi ces religieux entre le XIe et le XVIIIe siècle. Jusqu’à présent la plupart des études réalisées sur le sujet étaient mono-disciplinaires, à savoir, les archéologues d’un coté et les acousticiens de l’autre et ne prenaient en compte qu’une dimension de ce qu’il faut bien appeler « un problème scientifi que complexe ». Une des diffi cultés, par exemple, que rencontre l’étude de ces poteries est la diffi culté à appréhender les connaissances scientifi ques acoustiques de l’époque et leur impact sur leur usage. Il est délicat de soutenir par exemple que la conception des édifi ces ait été « pensée acoustiquement », à la manière de celle des ingénieurs d’aujourd’hui. De surcroît, jusqu’à récemment les études à caractère technique des églises, qu’elles soient archéométriques ou archéologiques se sont essentiellement intéressées aux aspects matériels (murs, charpentes, vitraux, enduits …). La question du sens, du rôle et des usages pour ces éléments architecturaux ne se pose pas de manière aussi aiguë. En effet, pour ce qui concerne les pots acoustiques, la problématique ne se limite pas à l’objet matériel « vase » mais aussi à l’objet sonore lui-même (parole, chant) par essence fugace et peu reproductible.
Ainsi, le manque de preuve expérimentale - nous y reviendrons - sur un effet réel des vases au sens de « sciences pour l’ingénieur » a laissé la place à de nombreuses interprétations : assainissement, allègement, joint
- 2 -
Techniques de construction dans les églises et monastères médiévaux
de dilatation, nichoirs .... Pourtant l’hypothèse acoustique est la seule vraiment qui résiste. Nous établirons en effet, dans une première partie consacrée à l’analyse des sources, que l’intention acoustique est très nettement avérée dans les textes. De surcroît et contrairement à certaines idées reçues, les problématiques acoustiques, souvent héritières des connaissances antiques, étaient intégrées en partie dans une réfl exion architecturale et artistique, même si celles-ci peuvent nous paraître empiriques au regard de nos savoirs actuels.
Si donc l’intention initiale de modifi er l’acoustique d’un espace fermé est avérée, il n’en reste pas moins que l’effi cacité l’est beaucoup moins. En effet, de nombreuses questions demeurent à ce jour très ouvertes1.
Les premiers travaux acoustiques2 portant sur les dispositifs de vases avaient pour objectif principal de prouver leur effi cacité avec des moyens expérimentaux. Or, cette preuve n’est pas acquise aujourd’hui essentiellement en raison des diffi cultés inhérentes à ce type d’expérimentation et du nombre élevé de vases inexploitables3.
En première partie, nous présenterons le cas de l’église de Pommiers en Forez, du point de vue de l’archéologue, après avoir montré l’importance des sources textuelles dans la compréhension des pratiques et connaissances acoustiques de nos ancêtres.
Dans la seconde partie, nous tenterons de démontrer l’intention acoustique de ceux qui ont mis en place ces vases dans les maçonneries. Pour ce faire, nous avons réalisé des campagnes de mesures systématiques, afi n de dégager des tendances générales représentatives de leurs choix, tels que le nombre, la position ou la fréquence de résonance des vases. Nous présenterons l’état de cette enquête et confronterons les relevés réalisés en l’église de Pommiers au corpus déjà réalisé.
Les vases acoustiques présents dans les églises médiévales et
1. Pour la présentation de la méthodologie voir l’article « Résonance et correction de la voix parlée et chantée : les dispositifs de vases acoustiques dans les édifi ces médiévaux et modernes. (Proposition d’une approche interdisciplinaire) », Bénédicte Palazzo-Bertholon, Jean-Christophe Valière, PRISMA-MA, Tome XXIV, « la voix dans l’écrit » 1 et 2, n°47-48, Janvier-Décembre 2008.
2. - Floriot René, Contribution à l’étude des vases acoustiques du Moyen-Age, Faculté des sciences de l’Université d’Aix-Marseilles, 1964, 131 p., (thèse de doctorat).
- Fontaine Jean-Marc, Contribution à l’étude des vases acoustiques disposés dans les églises, Paris, 1979, 103 p., (mémoire du CNAM).
3. En effet, de nombreux vases conservés en place sont cassés : ils ne remplissent plus leur rôle acoustique et leur fréquence de résonance ne peut pas être mesurée.
- 3 -
Techniques de construction dans les églises et monastères médiévaux
modernes font, encore aujourd’hui, l’objet de très peu d’études, à tel point, parfois, qu’aucune mention les concernant n’apparaît dans les monographies et études bâties des édifi ces concernés. Un des objectifs de cet article est de présenter ce dispositif acoustique encore méconnu, à travers l’historiographie du sujet et les résultats des études antérieures, mais aussi en présentant la recherche en cours, effectuée au sein de l’Action Incitative4 de l’Université de Poitiers, constituée par Bénédicte Palazzo-Bertholon, archéologue, et Jean-Christophe Valière, acousticien.
A – Les dispositifs de vases acoustiques : pratique et témoignages
I - Historiographie et présentation générale des vases acoustiques
I.1- Historiographie
François Huard5, directeur du musée d’Arles semble être le premier à avoir mentionné, en 1842, l’existence de vases acoustiques dans un rapport archéologique relatif à l’église Saint-Blaise d’Arles. D’après Aîné Didron6, il fallut vingt ans pour que le sujet soit réellement introduit en France, grâce à l’archéologue scandinave M. Mandelgren et deux archéologues russes, MM. Stassoff et Gornastaeff, venus consulter les archéologues français, sur l’existence en France d’églises pourvus de vases acoustiques, comme ils en avaient remarqué chez eux. C’est sous leur impulsion que les recherches, en France furent entreprises activement, par des scientifi ques et érudits comme, l’abbé Cochet7, Vachez8 et Cloquet9, entre autres. Néanmoins, à partir de la fi n du XIXe siècle, les découvertes deviennent plus rares et l’engouement pour le sujet s’essouffl e. Dans la première moitié du XXe siècle on peut mentionner
4. ACI « Revêtements muraux et poteries acoustiques dans les églises médiévales et modernes »
5. Bull. archéologique du Comité historique des arts et monuments, 1842-1843, T. II, p. 440-441.
6. Didron Ainé, Annales archéologiques, 1862, t. XXI, p. 274.
7. Cochet Jean-Benoît-Désiré, Archéologie monumentale, Poteries acoustiques, Bull. de la Soc. des Antiquaires de Normandie, 1er trimestre, t. 2, Paris, Société des Antiquaires de Normandie,1862, p.557-564.
8. Vachez Antoine, Des echea ou vases acoustiques dans les théâtres antiques et les églises du Moyen Age, Le Blanc-Hardel, Caen, 1886, 25 p.
9. Cloquet L., Vases acoustiques, Revue d’Art Chrétien, 1897-1907.
- 4 -
Techniques de construction dans les églises et monastères médiévaux
Marcel Baudoin10, et Jean de Sturler11 qui publia un dernier inventaire en 1957, avant que René Floriot12 ne reprenne le sujet et publie sa thèse en 1969, considérée encore aujourd’hui comme une référence sur le sujet.
René Floriot, contrairement aux précédents chercheurs et érudits cités, n’était pas archéologue, mais acousticien. Il apporta, toutefois de précieuses informations d’ordre archéologiques et architecturales, au même titre que Jean-Marc Fontaine13 et Victor Desarnaulds14, acousticiens eux aussi.
Les publications archéologiques de la deuxième moitié du XXe siècle sont un peu plus rares. On retiendra, par exemple, une contribution du Père Castel15, et l’article de Yves Henigfeld et Maxime Werlé16.
Enfi n, les connaissances les plus récentes ont été apportées par l’ACI de Poitiers, et notamment les travaux de DEA de Solène Moreau17, en 2002 et de Master de Romain Rebeix18, en 2006.
I.2 Présentation générale des vases acoustiques
En défi nitive, ce sont surtout les travaux de René Floriot et de Jean-Marc Fontaine qui ont apporté les premières informations techniques de l’utilisation des vases.
10. Baudouin Marcel, Les vases de résonance dans les églises du Bas-Poitou, H. Potier, La Roche-sur-Yon, 1938, 30 p.
11. Sturler Jean (de), Note sur l’emploi des poteries creuses dans les édifi ces du Moyen Age, Le Moyen Age, Bruxelles, 1957, t. LXIII.
12. Floriot René, Op.cit. à la note 2.
13. Fontaine Jean-Marc, Op.cit. à la note 2.
14. Desarnaulds Victor, De l’acoustique des églises en suisse – une approche pluridisciplinaire, Lausanne, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2002, 315 p, (thèse n°2597).
15. Castel Y.P., Les systèmes de vases acoustiques anciens dans les églises du Finistère (XIVe-XVIIe siècles), Bull. de la Soc. Archéologique du Finistère, 1976, T. CIV.
16. Henigfeld Yves, Werlé Maxime, Sourd comme un pot acoustique ? L’exemple des céramiques engagées dans les maçonneries médiévales à Strasbourg, Archéologie Médiévale, n° 32, 2002, p. 135-156.
17. MOREAU Solène, Les vases acoustiques dans les églises romanes. Eléments d’analyse pour l’archéométrie., LEA et Ecole Sup. d’Ingénieurs de Poitiers, 2002-2003 (Mémoire de DEA).
18. Rebeix Romain, Les vases acoustiques au sein des églises médiévales, Université de Bordeaux 3, 2006, 90 p., (Mémoire de Master 2).
- 5 -
Techniques de construction dans les églises et monastères médiévaux
Ceux-ci sont insérés dans la maçonnerie, la panse étant noyée dans celle-ci, seul le col affl eure à la surface de l’enduit (ill. 1). Jean-Marc Fontaine a comptabilisé quatre modes d’implantation majoritaire19. Les poteries peuvent être noyées dans le blocage en lieu et place d’une pierre de construction, le col restant affl eurant à la surface du parement qui a été préalablement évidé (Saint-Idunet, Trégourez, 29). Elles peuvent être placées dans une niche vide ou remplie de gravats, et maintenues uniquement par le col (Abbaye de Montivilliers (76), (ill. 2). Dans le cas de voûtes en bois, les vases peuvent être sertis de lambris (Eglise de Combrit, 29). Enfi n, un cas de vases insérés dans une pierre de construction, taillée au préalable dans ce but a été signalé dans l’église des Carmes de Famagouste à Chypre20.
La plupart du temps les vases sont en terre cuite, mais ils peuvent parfois être en verre, comme cela semble être le cas à l’Abbaye de la Melleray (44). René Floriot a remarqué que les poteries utilisées dans les églises étaient de facture régionale. Les vases étaient des récipients usuels communs et de tous types (ill. 3), sans correspondre à une production spécifi que destinée à cet usage. Les caractéristiques techniques (type de pâte, traitement de surface, etc.) ne semblent pas être un point déterminant, non plus, dans le choix des récipients utilisés. Malgré ces observations, il convient toutefois de rester prudent, de pousser plus avant les études céramologiques, ce qui n’a pas encore été fait, et la recherche dans les textes, car certains documents font mention de commandes passées auprès de potiers21.
Parfois les vases ont subi des transformations avant leur mise en place, le but étant toujours de retravailler la partie du pot qui sera en contact avec l’intérieur de l’édifi ce (ouverture obturée par un bouchon de liège22, pot retourné dans le mur avec un ou plusieurs trous percés à l’arrière23, etc.)
La taille moyenne des vases inventoriés par René Floriot et Jean-Marc Fontaine est d’environ 25 cm, mais dans quelques cas extrêmes, on peut trouver des vases allant d’une soixantaine de centimètre (Saint-
19. Fontaine, Op. cit. à la note 2, p. 14.
20. Nous citons cet exemple, avec toutefois quelques réserves, puisque ce seul cas connu est mentionné et repris pas plusieurs auteurs sans qu’il ait pu être vérifi é.
21. Voir chapitre B.I.1.
22. Vase à couvercle avec ouverture trifoliée à Bjerresjö, Suède, Floriot 1964, p. 21
23. Ancienne Chartreuse, Pleterjach, Slovénie, Fontaine 1979, p. 30.
- 6 -
Techniques de construction dans les églises et monastères médiévaux
Victor à Marseille) jusqu’à 1,10 m (Catane d’Ossat, Italie). Quant à leur nombre, il varie de 1 à 100, la moyenne tournant autour de 25 pots environ. Ce critère varie beaucoup d’un édifi ce à l’autre, mais la totalité des vases n’est pas toujours visible au moment de l’étude, soit qu’ils ont disparu, soit qu’ils sont recouverts d’enduit.
Les vases sont toujours placés en haut des murs et dans les voûtes. Concernant leur localisation dans l’espace ecclésial, tous les cas de fi gure ont été observés. Certaines tendances peuvent cependant être dégagées, puisque la majorité des vases sont placés dans le chœur, à la croisée du transept ou dans les travées localisées près du chœur. Les dernières recherches24 ont montré que cette option concernait en majorité les édifi ces paroissiaux. En revanche, la présence de vases dans le transept semble concerner uniquement les églises monastiques. Enfi n, certains vases sont situés dans la nef, autour des fenêtres, dans les parois au dessus des stalles et face à la chaire.
Cette présentation recense les facteurs invariants qui ont pu être observés au cours des différentes études. Cependant, qu’il s’agisse du mode d’implantation, de la typologie des vases, ou de leur localisation, chaque édifi ce présente des caractéristiques différentes, ce qui nécessite souvent une étude au cas par cas. Par ailleurs, bien que le sujet de cet article porte sur les églises catholiques, il faut également signaler la présence de vases dans certains édifi ces musulmans et juifs25, à l’instar de quelques édifi ces civils26.
II L’étude des sources textuelles : état d’avancement
L’objectif principal des dernières recherches entreprises est de connaître, et de comprendre, les facteurs qui ont pu motiver l’installation des vases acoustiques, et quels effets en étaient fi nalement attendus. Pour cela, en parallèle aux études archéologiques, il est nécessaire de revenir aux sources textuelles, afi n de recueillir des témoignages directs de l’utilisation des vases et de faire un état des lieux des pratiques générales en acoustique des salles. Jusque là, les chercheurs n’avaient que très peu
24. Rebeix 2006, Carvalho 2009, op. cit., respectivement aux notes 18 et 33.
25. Tel que la mosquée des Plombs à Berat en Albanie, signalée et étudiée par Jean-Dominique Polack et Hadjira Fezoui, et la synagogue de Tomar au Portugal, où une pièce carrée et voûtée en ogive présente un pot à chaque départ de voûte (Avec nos remerciements à Marc Potin pour le signalement de cet exemple).
26. Maisons médiévales à Strasbourg, voir l’article de Henigfeld et Werlé 2002.
- 7 -
Techniques de construction dans les églises et monastères médiévaux
d’informations sur la question d’une possible tradition acoustique en architecture, durant les périodes médiévales et modernes. Or, l’étude de l’usage des vases acoustiques doit être replacée dans le cadre plus large de l’acoustique architecturale en général.
II.1. La tradition en acoustique des salles, de l’Antiquité à la période moderne, dans les traités d’architecture et de musique : état des lieux
Un sondage bibliographique a permis d’évaluer le potentiel de ce type de recherche et de faire un premier état des lieux. Quatre traités d’architecture ont été consultés : le Ve livre du traité de Vitruve, écrit au Ier siècle de notre ère (on sait qu’il fait référence aux questions qui nous intéressent, à travers l’explication du fonctionnement des echea27, auxquels on rattache souvent les vases acoustiques), les traités d’Alberti28, de Philibert de l’Orme29 et celui de Pierre Patte30. Au sujet des notions d’acoustique pure, nous nous sommes référés aux Problèmes d’Aristote31, relatifs aux questions du son, ainsi qu’au traité de musique de Marin Mersenne32. Ce dernier marque le passage d’une conception empirique de l’acoustique héritée de l’Antiquité (d’ailleurs, certaines théories d’Aristote se retrouvent encore chez Mersenne) vers une forme beaucoup plus scientifi que de la question, fondée sur l’expérimentation.
Dans le cadre de cet article, nous n’entrerons pas dans le détail des exemples et des citations, mais l’ensemble de ces données seront
27. Il s’agirait de vases en airain, utilisés dans les théâtres gréco-romains pour faciliter la transmission de la voix des acteurs dans les théâtres. Au XIXe siècle, on rattachait les echea aux vases acoustiques médiévaux, et l’on considérait ces derniers comme les héritiers de la tradition antique énoncée par Vitruve. Or, aucun élément concret ne permet, aujourd’hui, de l’affi rmer.
28. Alberti Leon Battista , L’art d’édifi er, première édition 1485, traduit du latin, présenté et annoté par Pierre Caye et Françoise Choay, Paris, éd. du Seuil, 2004, 598 p.
29. Orme, Philibert (de l’), Traités d’architecture : Nouvelles inventions pour bien bastir et à petits fraiz (1561), Premier tome de l’architecture (1567), présentation par Jean-Marie Pérouse de Montclos, Paris, L. Laget, 1988, 427 p.
30. Patte Pierre, Essai sur l’architecture théâtrale, ou De l’ordonnance la plus avantageuse à une salle de spectacles, relativement aux effets de l’optique et de l’acoustique, Paris, Moutard, 1782, 212 p.
31. Aristote, Problèmes, section XI, texte établi et traduit par Pierre Louis, Paris, Les Belles Lettres, 1993, 285 p.
32. Mersenne Marin, Harmonie universelle, contenant la théorie et la pratique de la musique, Paris, première édition 1636, Paris, édition fac-similé du C.N.R.S., 1975, 3 Vol.
- 8 -
Techniques de construction dans les églises et monastères médiévaux
publiées dans un prochain volume33. En substance, l’étude complète de ces textes démontre que l’on pratique l’acoustique des salles, et que celle-ci s’appuie sur des théories établies dès l’Antiquité, puis reprises et développées à la Renaissance et l’époque classique. Qu’elles soient empiriques ou qu’elles découlent d’un raisonnement scientifi que, tel que nous l’entendons aujourd’hui, ne nous préoccupe pas dans le cadre de notre axe de recherche. L’important est qu’elles révèlent une intention de la part des bâtisseurs, de travailler l’acoustique des édifi ces. Dès l’Antiquité déjà, les architectes étaient capables de reconnaître et de défi nir un lieu où l’acoustique est bonne ou mauvaise. Plus important encore, ils cherchaient à corriger cette acoustique quand elle ne leur convenait pas et usaient pour cela de différents moyens (meilleure disposition de la salle, prise en compte des mécanismes de la voix et de la propagation du son, etc.). Les témoignages sont moins évidents pour la Renaissance, mais il semble que les préoccupations aient été quasiment les mêmes. Bien qu’il ne s’agisse ici que de théorie, et que, pour l’heure, peu d’exemples nous permettent d’observer leur mise en pratique, on ne peut nier que, dès l’Antiquité, et dans toute la théorie architecturale inspirée de Vitruve, les architectes étaient conscients de leur rôle : construire un édifi ce du « début à la fi n », et maîtriser tous les facteurs qui présideront à son bon « fonctionnement », l’acoustique étant l’un d’eux.
II.2. Les témoignages contemporains de la mise en place des vases
Six mentions recensées par Romain Rebeix34 et un texte supplémentaire ajouté récemment, compose le corpus des témoignages directs de l’utilisation des vases acoustiques dans les édifi ces religieux. Pour le présent article, seuls deux textes seront présentés.
Le premier est tiré de l’Apocalypse de Méliton, rédigé en 1662 : « De cinquante choristes que le public entretient dedans telle maison, quelques fois ils ne seront pas six à l’offi ce ; ces choeurs sont
33. Voir Carvalho Pauline, les vases acoustiques dans les églises médiévales et modernes : une étude à travers les sources et les édifi ces de Normandie, Université Paris Ouest – Nanterre La Défense, 2009, 138 p. (Mémoire de Master 2).
34. Palazzo-Bertholon Bénédicte, Valière Jean-Christophe, Les vases dit acoustiques dans les églises médiévales : un programme d’études interdisciplinaire, in Burnouf J. dir., L’Europe en mouvement, Actes du 4e colloque tenu du 3 au 8 septembre 2007, http://medieval-europe-paris-2007.univ-paris1.fr/B.%20Palazzo-Bertholon%20et%20al..pdf.
- 9 -
Techniques de construction dans les églises et monastères médiévaux
accommodés avec des pots dans la voûte, et dans les murailles, en sorte que six voix y feront autant de bruit que quarante ailleurs. C’est le portique d’Athênes appellé heptaphonon, où une voix résonante au septuple, par une forme d’écho, un moins modéré appelleroit ceste industrie, une pieuse fraude.»35
Il s’agit d’un pamphlet contre les abus des ordres monastiques, qui aurait été rédigé par un ex-franciscain36 converti au Protestantisme. Dans le passage qui nous intéresse, l’auteur déplore le trop grand nombre de moines mendiants que les fi dèles entretiennent à chanter au sein des églises. Il va plus loin, en dénonçant l’utilisation de vases acoustiques, véritable supercherie selon lui, que les moines installaient dans les chœurs pour faire croire aux fi dèles que, cachés derrière leur jubé, ils étaient plus nombreux qu’en réalité, bénéfi ciant ainsi de dons plus importants.
Le second texte est tiré du traité de musique de Mersenne37, extrait d’un passage consacré aux echea antiques, et dont l’auteur fait la critique : « [les echea] ne servent tout au plus qu’à la [la voix] réfl échir pour la rendre plus forte, et plus intelligible, comme le corps d’un luth et des autres instruments, faisant plusieurs réfl exions du son, le conservent d’avantage, et le rendent plus fort. C’est pour cette raison que l’on met des pots à moineau, ou d’autres vases creux dans les voûtes, ou sur les voûtes des églises, afi n d’aider les voix des ceux qui chantent, et que la voix, n’est pas si forte dans une campagne et un air libre, que dans un lieu renfermé, dont les murs réfl échissent la voix, et empeschent qu’elle ne se perde. »38
Ces deux textes, datés du XVIIe siècle, ont le mérite de nous donner des renseignements concordants. D’une part, on apprend que les vases étaient utilisés pour amplifi er le volume sonore, même si, comme le souligne René Floriot39, l’auteur du premier texte fait sans doute preuve d’exagération. D’autre part, ils nous renseignent sur le fait que ce dispositif était utilisé pour le chant. Ces deux points essentiels sont également mentionnés dans les autres textes du corpus. Par ailleurs, si l’Apocalypse de Méliton est une diatribe
35. Méliton, Apocalypse de Méliton ou Révélations des mystères cénobitiques, Saint-Léger, 1662, pp. 41-43.
36. L’auteur n’est pas identifi é avec certitude, mais il pourrait s’agir de Claude Pithoys ou de Jean-Pierre Camus.
37. op cit.à la note32.
38. op cit.à la note32, livre De l’utilité de l’harmonie, p. 35.
39. Floriot 1964, p. 32.
- 10 -
Techniques de construction dans les églises et monastères médiévaux
contre le «système» monastique, on peut légitimement penser que l’emploi des vases devait être une pratique relativement courante. Enfi n, le témoignage de Mersenne diffère des autres mentions, en ce sens, qu’il s’agit du témoignage d’un savant familier des théories acoustiques. Cependant, bien qu’étayée par les théories de réfl exion du son, sa présente explication, repose sur très peu d’éléments scientifi ques, comme peuvent l’être d’autres de ces démonstrations. Ce constat nous laisse penser qu’il s’agit, probablement d’un usage traditionnel, fondé sur des considérations acoustiques intuitives et non scientifi ques.
III Etude de cas : l’église de Pommiers
L’église Saint-Pierre-Saint-Paul de Pommiers-en-Forez, construite à partir du XIe siècle, est un établissement prioral, placé sous la règle de Saint-Benoît. C’est un édifi ce à trois vaisseaux, avec transept saillant au nord, l’abside étant fl anquée de deux absidioles. La voûte en berceau plein cintre de la nef centrale daterait de la fi n du XIe siècle. C’est dans celle-ci qu’ont été installés les vases acoustiques (ill. 4).
On dénombre vingt-neuf vases, dont deux ont été retirés, et il semble qu’il s’agisse du nombre d’origine. Comparée aux autres édifi ces inventoriés, l’église de Pommiers se situe dans la moyenne. Les poteries sont situées dans la dernière travée de la nef, en avant de l’autel, qui a priori, se situait alors sous la croisée du transept. Elles sont placées suivant une relative symétrie, organisées en trois lignes superposées, mais l’enduit couvrant la maçonnerie de la voûte ne permet de déterminer si les pots ont été introduits au moment de la construction ou bien s’ils ont été ajoutés postérieurement.
Comme dans la plupart des cas, les vases sont des céramiques à usage domestique, remployés à des fi ns acoustiques, les deux exemplaires étudiés présentent d’ailleurs des traces d’utilisation au feu. Il s’agit de oules, produites en communes grise non-glacurée, datées de la fi n du XIe, début XIIe siècles (ill. 5). La datation proposée par l’analyse céramologique, fait de cet édifi ce un des cas les plus anciens connus40.
Les vases de l’église de Pommiers semblent tous appartenir à la même typologie. D’après les exemplaires retirés et l’observation des
40. Vicard Tommy, Description des deux echea déposés, Pommiers-en-Forez, Lyon, 2000, p. 55.
- 11 -
Techniques de construction dans les églises et monastères médiévaux
ouvertures dans la voûte, deux tailles différentes ont été utilisées, ce que confi rment également, les mesures de fréquence de résonance41. On retrouve le même cas de fi gure à Saint-Blaise d’Arles, où les vases situés sur la ligne inférieure présentent un diamètre de col plus large que les vases situés sur la ligne supérieure, et une fréquence de résonance différente42.
Pour chaque édifi ce, la localisation au sein de l’édifi ce est un facteur important, puisque confrontée aux pratiques liturgiques et aux textes, elle est susceptible de nous renseigner sur la destination d’usage des vases. Le chœur liturgique est divisé en deux parties : le chœur canonial ou monastique, où se trouvent les stalles, est réservé au chant, tandis que le sanctuaire, où se trouve l’autel majeur, est réservé à la prédication et à la célébration de l’Eucharistie.
A Pommiers, les vases se trouvent comme nous l’avons dit dans la dernière travée de la nef, juste devant l’autel majeur (ill. 6). D’après les sources étudiées par Chantal Delomier43 en 2007, il s’agirait du chœur des moines. Leur nombre variait de 5 à 12 religieux, qui se plaçaient face à face à cet endroit. Aujourd’hui, on retrouve cette disposition des moines à l’abbaye bénédictine du Bec-Hellouin (27), par exemple. Leur liturgie communautaire s’appuyant sur le chant des psaumes, la psalmodie est alternée entre deux chœurs : la moitié de la communauté chantant, pendant que l’autre écoute.
Comme dans la plupart des édifi ces monastiques comportant des vases acoustiques (à l’abbaye de Montivilliers (76) ou de la Melleraye (44) par exemple), ceux de Pommiers se situent dans le choeur des religieux.
Ces observations, confrontées aux textes cités précédemment, étayent l’hypothèse d’une utilisation liée au chant, tout du moins, en contexte monastique. Car, pour l’heure, trop peu d’éléments permettent de l’affi rmer catégoriquement. Par ailleurs, d’autres cas de fi gure ont été observés, comme par exemple à Fort-Moville (27), où les vases sont insérés dans les murs du sanctuaire de l’église paroissiale. Sachant que l’offi ciant célébrait la messe le dos tourné à l’assemblée, on peut penser
41. Voir 2ème partie
42. Cf. le lien suivant : http://www.patrimoine.ville-arles.fr/images/document/Saint-Blaise vase acoustiques.pdf
43. Delomier Chantal, Les espaces ecclésiaux et liturgiques à Pommiers-en-Forez, Architecture et pratiques religieuses, VIe biennal de Pommiers, 15 juin 2007, Pommiers, 2008, pp. 47-56.
- 12 -
Techniques de construction dans les églises et monastères médiévaux
que les vases étaient destinés à renvoyer sa voix vers l’espace des fi dèles, en renforçant l’effet réfl ecteur de l’abside, par exemple. Par conséquent, si les vases étaient utilisés pour le chant des moines, comme on l’a vu, on ne peut exclure une autre fonction associée à la voix parlée, dont les témoignages restent, néanmoins, à mettre en évidence.
Suite à la présentation générale des vases et des textes contemporains qui en font mention, voyons maintenant si les analyses acoustiques permettent d’apporter des informations de nature à conforter certains constats précédents.
B Analyse acoustique des vases
I Principe du fonctionnement des vases
Un vase acoustique appartient à la catégorie des résonateurs, dispositifs visant à modifi er l’onde sonore reçue en amplifi ant ou atténuant son amplitude pour certaines fréquences. Les résonateurs acoustiques sont utilisés actuellement pour de nombreuses applications comme la réduction du bruit des conduites de ventilation, le contrôle des résonances dans les cabines de studio, des auditoriums ou dans la coiffe de la fusée ARIANE …
Parmi les résonateurs, les cavités présentant la forme d’un vase, fonctionnent de manière similaire et appartiennent à ce que l’on nomme des résonateurs de Helmholtz, du nom du scientifi que Allemand qui a décrit mathématiquement leur comportement, bien que celui-ci soit connu empiriquement depuis l’Antiquité. Aussi, une cavité dans une grotte, une bouteille ou un vase fonctionnement physiquement comme un résonateur de Helmholtz. L’onde sonore qui arrive sur la surface du col est amplifi ée pour une certaine fréquence dans le vase et l’énergie sonore est en partie absorbée et diffusée (simultanément) dans toutes les directions autour du col. Ainsi un vase inséré dans un mur va, à sa fréquence de résonance, d’une part amplifi er le son à proximité du col (10-20 cm) (effet n°1), d’autre part, absorber légèrement et diffuser44 dans le reste de l’espace (effet n°2).
44. « Absorber » signifi e que l’onde sonore perd une partie de son énergie dans le vase et « diffuser » signifi e que le vase réémet l’onde sonore dans toutes les directions.
- 13 -
Techniques de construction dans les églises et monastères médiévaux
I.1 Méthodologie acoustique
Des deux effets précédemment cités, seuls l’absorption et la diffusion ont tenté d’être démontrés dans les études antérieures,45 car en l’état actuel des connaissances, ils correspondent logiquement aux seuls effets possibles sur l’audience. Il s’agit donc bien d’une approche fonctionnelle que nous avons déjà qualifi ée de « sciences pour l’ingénieur ». Or, et la contradiction n’est pas simplement rhétorique, puisque tous les textes mentionnent l’intention d’amplifi cation du son (parole et chant) et nos études récentes sur la documentation46 renforcent encore cette tendance, les acousticiens d’aujourd’hui savent que cette amplifi cation est très localisée et que sa perception est négligeable au niveau des fi dèles.
Ainsi, que l’effet acoustique sur le public soit effectif ou non, l’intention associée à la mise en place des pots dans les maçonneries apparaît clairement à travers les textes. Par conséquent, il nous a semblé pertinent de démontrer par des mesures acoustiques de fréquences que les vases ont pu être choisies. Cette hypothèse, s’appuie notamment sur des mentions de commande spécifi ques de vases faites à des potiers. 47
Pour réaliser un grand nombre de mesures, il a fallu disposer de moyens expérimentaux simples d’usage et faciles à mettre en œuvre. Que notre hypothèse de départ, à savoir le choix des vases en fonction de leur fréquence, soit confi rmée ou infi rmée, cette étude à grande échelle nous offre de surcroît une meilleure connaissance archéologique des édifi ces, dans la mesure où les vases acoustiques sont rarement étudiés dans le cadre monographique.
Afi n d’exploiter les résultats de nos mesures, nous avons adopté une méthode statistique sur un corpus d’édifi ces le plus large possible visant à recueillir toutes les données physiques signifi catives sur les vases, leurs fréquences de résonance, leur géométrie, leur position, leur nombre, etc.
Dans le cas où notre hypothèse de choix des vases selon leur fréquence s’avérait pertinente au sens acoustique, des mesures globales pourraient être envisagées (à l’instar des études antérieures) dans certains édifi ces où le nombre de vases en état (préalablement mesurés) est suffi sant.
45. Floriot et Fontaine, op.cit à la note 2.
46. Voir le chapitre A.
47. Une mention datée de 1616 et qui provient des comptes du chapitre de Saint-Denis de Vergy (L’Intermédiaire, 1900) le prouve : « Payé 24 sols au tupinier de Belon pour trois douzaines de petits pots pour mettre dans la muraille du chœur, propres à faire résonner la voix ».
- 14 -
Techniques de construction dans les églises et monastères médiévaux
I.2 Principes des mesures choisies
Une étude préliminaire48 a consisté à introduire un microphone dans un vase construit au laboratoire, dont la fréquence de résonance peut être déduite par une formule théorique49. Celui-ci a été positionné en quatre endroits : dans la cavité, dans le col, à l’orifi ce et à 10 cm de celui-ci. Les résultats montrés en fi gure 1, représentent l’amplifi cation à la fréquence de résonance (358 Hz dans le cas présent) de 25 dB dans la cavité du vase à 6 dB à 10 cm de distance du col. Cette amplifi cation qui tend rapidement vers 0 dB au-delà de 10 cm confi rme que cet effet reste très localisé à l’intérieur et à l’ouverture du vase. (ill. 6)
Cette pré étude nous a également permis de constater que la mesure de fréquence des vases in situ à plusieurs mètres de hauteur, nécessitait la fabrication d’un dispositif léger sur lequel nous pourrions insérer un microphone.
Au cours de l’étude suivante,50 un microphone a été fi xé sur une perche en fi bre de carbone permettant d’accéder aux vases situés à plus de 10 m. Ce même dispositif peut aussi accueillir une caméra miniature, en remplacement du microphone, pour observer l’état de conservation du vase à distance. Fort de ce matériel et des études préliminaires, nous avons commencé l’enregistrement systématique de la fréquence de résonance des vases dans les édifi ces où ils étaient conservés et accessibles (< 12 m).
II Résultats et interprétations
II.1 Etude statistique des églises visitées
Nous avons pris pour base d’inventaire les recensements51 précédemment réalisés par différents auteurs français et étrangers. Nous avons alors actualisés ces recensements grâce à une circulaire de signalement, diffusée auprès des services de protection du Patrimoine (Services Régionaux d’Archéologie, Monuments Historiques, Service de l’Inventaire), des architectes des bâtiments de France et des Monuments Historiques, des structures archéologiques de terrain, des universitaires,
48. Solène MOREAU, Op. cit. à la note 17.
49. Seules les connaissances du volume, de la longueur et de la surface du col sont nécessaires.
50. REBEIX Romain : « Les vases acoustiques au sein des églises médiévales ». Mémoire de Master 2, Matériaux du Patrimoine Culturel, Archéomatériaux, CRP2A, Université de Bordeaux 3, juin 2006.
51. Voir la partie A.I.1.
- 15 -
Techniques de construction dans les églises et monastères médiévaux
ainsi que par une recherche sur l’Internet (site des mairies …). En conséquence de quoi, 310 églises ont été recensées en Europe et au Proche-Orient, dont 178 en France. L’ensemble de ces églises ne conserve pas pour autant des vases visibles aujourd’hui, car certains d’entre eux ont été recouverts d’enduits, d’autres ont été retirés de la maçonnerie ou bien simplement bouchés avec du mortier. Ainsi sur une cinquantaine d’édifi ces visités en France (Poitou-Charentes, Bretagne, Pays de Loire, Aquitaine et Auvergne essentiellement52) seuls les vases de 22 églises ont pu être mesurés. Les données recueillies lors de ces visites concernent : le nombre de vases visibles in situ (caméra, microphone), le nombre total de vases estimés, la surface au sol de l’église, la hauteur maximale des voûtes, le volume de l’église, la fréquence de résonance de chaque vase et les données archéologiques disponibles (typologie des vases, type de pâte (composition), date de leur mise en place dans l’architecture, etc.)
L’illustration 7 montre le nombre estimé de vases en fonction du volume de chacun des édifi ces visités faisant apparaître clairement une progression. Cette tendance, déjà remarquée par Floriot53 peut laisser supposer que les bâtisseurs comprenaient fort bien que les effets, quels qu’ils soient, devaient être reliés à la taille de l’édifi ce ce qui peut se comprendre aussi bien pour les deux effets mentionnés dans le paragraphe précédent.
En revanche, un autre résultat de cette étude globale54 montre que les vases sont d’autant plus haut que l’église est élevée; ce qui ne plaide pas pour la recherche d’une amplifi cation (effet n°1). En effet dans ce cas, les vases se situeraient de façon préférentielle à hauteur d’homme et non dans les voûtes ou au plus haut des murs comme on le constate dans le plus grand nombre de cas.
Les fréquences de résonances mesurées sur les 274 vases intacts, toutes églises confondues sont comprises entre 80 Hz et 450 Hz avec une moyenne de 226 Hz, comme le montre l’illustration 8. Ce domaine fréquentiel correspond au maximum sonore de la voix, qu’elle soit parlée ou chantée (fondamental et premières harmoniques). Aussi, ce constat
52. Pauline Carvalho réalise actuellement une étude sur la Normandie.
53. Op. cit. à la note 2.
54. Un résumé des tendances générales fi gure dans le texte du congrès : « Les vases dits « acoustiques » dans les églises médiévales : un programme d’étude interdisciplinaire », Bénédicte PALAZZO-BERTHOLON, Jean-Christophe VALIERE, 4ème Congrès d’Archéologie Médiévale et Moderne, Paris 2007, http://medieval-europe-paris-2007.univ-paris1.fr/Palazzo-Bertholon et al..pdf
- 16 -
Techniques de construction dans les églises et monastères médiévaux
valide t-il notre hypothèse du choix délibéré des vases à usage acoustique (effet n°1).
En outre, et ceci conforte ce résultat, aucune relation n’a pu être établie entre les fréquences de résonance et le volume de l’église,55 ce qui tend à démontrer que le contrôle des résonances de l’édifi ce (effet n° 2) n’était pas au cœur des préoccupations. Aussi, c’est bien l’amplifi cation de la voix qui était recherchée. (ill. 7) (ill. 8)
Aussi, les responsables de la mise en place des vases cherchaient manifestement à amplifi er la voix en hauteur et au niveau des voûtes, mais pas à proximité des fi dèles ni des offi ciants. Nous sommes donc au cœur d’une contradiction apparente entre la localisation des vases et l’effet produit, qu’il nous faudra élucider.
II.2 L’exemple de Pommiers comparé aux autres édifi ces français étudiés
Si ces données générales nous fournissent des informations précieuses, il n’en reste pas moins que chaque église possède des singularités qui ne peuvent en aucun cas être réduites par des graphiques qui globalisent l’ensemble des édifi ces toutes époques, pays, régions ou destinations d’usages (monastiques ou paroissiaux) confondus. Notons tout d’abord que la courbe donnée en illustration 8 présente deux maxima très marqués, l’un autour de 150 Hz et l’autre autour de 325 Hz. Nous avons cherché à savoir si les églises présentaient ce clivage ou si au contraire elles avaient chacune leur homogénéité autour d’une fréquence moyenne.
En réalité, deux profi ls d’églises apparaissent à partir de la fréquence de résonance des vases mesurés dans chacune d’elles. Afi n d’illustrer les deux cas de fi gure, le tableau 1 montre deux églises possédant un ensemble très cohérent de vases avec des écarts de mesure très faibles (4% et 6%) autour de la fréquence de résonance (dans les deux cas assez élevée). Le tableau 2, quant à lui, fait état de trois édifi ces pris en exemple, pour lesquels deux types de vases sont clairement identifi és. La fréquence moyenne de l’ensemble des vases n’est pas signifi cative car les mesures sont trop dispersées (de 14 à 25 %) mais en revanche, deux fréquences prédominent nettement (écart entre 2,5 et 7,5%).
55. Cf. note 12.
- 17 -
Techniques de construction dans les églises et monastères médiévaux
Lieu Région Fréquence moyenne (écart à la moyenne %)
Quinçay Poitou-Charentes 355 (6%)La Melleray Pays-de-Loire 247 (4%)
Tableau 1 : Deux exemples d’églises qui présentent un seul type de vase (et de fréquence de résonance)
Lieu Région Fréquence moyenne
Fréquence 1 (écart en %)
Fréquence 2 (écart en %)
Kergoat Bretagne 135 (25%) 103 (7,5%) 171 (5%)Saint Blaise Provence 272 (22%) 220 (2,5%) 330 (6%) Pommiers Rhône-Alpes 208 (14%) 191 (7%) 248 (3%)
Tableau 2 : Trois exemples d’églises qui présentent nettement 2 types de vases (et de fréquences de résonance)
L’exemple de Pommiers est intéressant comme le montre l’illustration 9 dans la mesure où il semble n’exister que deux types de poteries, dont la fréquence de résonance mesurée avoisine 191 Hz d’une part et 248 Hz d’autre part. Ce fait, constaté à partir des mesures sur les vases encore insérés, est confi rmé par les deux poteries de taille différente, prélevés dans les maçonneries de l’église lors de travaux antérieurs et conservées au musée. Ainsi une analyse fi ne de ces vases a pu être effectuée.
Seul le vase de petite dimension a été reconstitué par les archéologues, comme le montre l’illustration 4. Deux dimensions géométriques ont pu être déterminées avec précision, à savoir, le volume à 3,5 litres et le diamètre du col à 11,5 cm. La longueur du col a été estimé à 0,5 cm ce qui permet de calculer une fréquence théorique de 289 Hz. La fréquence de résonance a pu être mesurée avec une grande précision à 298 Hz56.
Ces valeurs théorique et mesurée sur le vase prélevé donne une fréquence plus élevée que celles constatées sur les vases de petites dimensions insérées dans le plafond (250 Hz). Une observation attentive des fi lms réalisés à l’intérieur de chaque vase montre que sur les 29 poteries, seules 6 d’entre elles semblent parfaitement intactes, les autres étant simplement fêlées, voire cassées. Ces 6 vases présentent une
56. La différence entre les deux (3%) s’explique par l’estimation de la longueur du col toujours diffi cile à estimer.
- 18 -
Techniques de construction dans les églises et monastères médiévaux
fréquence moyenne de 250 Hz pour le petit modèle et de 160 Hz pour le plus grand57.
Outre l’explication des fêlures des vases, il est possible que le col soit rallongé par l’enduit ce qui à pour effet de descendre la fréquence de résonance. (ill. 9) et (ill. 4)
ConclusionLes dispositifs de vases acoustiques dans les églises médiévales ont
donc été étudiés avant nous par les archéologues et les acousticiens de la fi n du XIXe siècle et du XXe siècle, mais de manière distinctes et non transversales. Notre contribution s’inscrit dans la volonté de confronter les différentes sources documentaires connues, soit contemporaines de l’implantation des vases, soit postérieures aux informations archéologiques et acoustiques.
L’étude des traités d’architecture, de musique et d’acoustique datés entre le XVIe et le XVIIIe siècle indiquent clairement l’intention des bâtisseurs d’améliorer l’acoustique des églises et l’implantation des poteries dans le haut des murs et dans les voûtes semble être un des moyens mis en œuvre, pour amplifi er le volume sonore, notamment pour le chant.
A Pommiers, les vases sont implantés, comme nous l’avons vu, dans la voûte du chœur des religieux et servaient certainement à améliorer la réception auditive des chants, mais les poteries situées dans les églises paroissiales servaient sans doute également à la liturgie de la Parole.
Les caractéristiques acoustiques des vases de Pommiers sont en accord avec celles des édifi ces que nous avons pu mesurer sur le territoire français, à savoir : le nombre de vases, leur fréquences de résonance, leur disposition, etc. Par ailleurs, les mesures faites à Pommiers nous ont permis de confronter les mesures expérimentales avec des simulations, grâce aux deux spécimens prélevés dans la maçonnerie et conservés au musée, ce que l’on peut rarement réaliser.
Les mesures systématiques de la fréquence des vases de Pommiers
57. Il semble que la fréquence de 191 Hz indiquée dans le tableau 1, plus élevée que celle estimée plus précisément à 160 Hz ne soit pas due à des grands vases mais à des petits vases fêlés et qui ne fonctionnent pas correctement, mais ceci resterait à confi rmer.
- 19 -
Techniques de construction dans les églises et monastères médiévaux
ont permis de confi rmer une tendance observée au préalable dans un certain nombre d’édifi ces. En effet, deux types de vases de fréquences bien distinctes (160 Hz et 250 Hz) ont été choisis, afi n d’augmenter le son entre 150 et 300 Hz environ, soit au maximum des voix parlées et chantées. On remarque enfi n, que les trois édifi ces mentionnés dans cette étude (Kergoat, Saint Blaise et Pommiers) présentent un rapport entre les deux fréquences compris entre 1,5 et 1,6, soit environ l’écart d’une quinte (1,5), sans que cette observation puisse à ce jour être interprétée.
Aussi, l’église de Pommiers-en-Forez fournit-elle un exemple signifi catif et pertinent de l’intention des bâtisseurs à améliorer l’intelligibilité de la voix. La synthèse de l’ensemble des données textuelles et archéologiques, confrontées aux mesures acoustiques réalisées sur plus de vingt édifi ces devrait permettre de mieux comprendre l’objectif et le fonctionnement de ces dispositifs acoustiques dans les édifi ces médiévaux et modernes58.
Pauline Carvalho,Jean-Christophe Valière,
Bénédicte Palazzo-Bertholon
58. Voir la publication collective « Les dispositifs acoustiques dans les édifi ces anciens », Dir. B. Palazzo-Bertholon et J.Ch. Valière, Bulletin Monumental, à paraître en 2011.
- 20 -
Techniques de construction dans les églises et monastères médiévaux
Illustration 1Vase de l’abbaye Saint-Sauveur de Montivilliers (76) (hauteur inconnue) (cliché du XIXe siècle conservé au Musée départemental des Antiquités de Rouen) et niche dans la voûte du XIIe siècle dont le vase a été retiré (Dessin de l’abbé Cochet, réf. note 7 et cliché de P. Carvalho, 2009).
- 21 -
Techniques de construction dans les églises et monastères médiévaux
Illustration 2 Vase de l’église de Bosc-Bénard-Commin (27) d’une hauteur de 28 cm (1) et vase de l’église de Fiquefl eur-Equainville (27) d’une hauteur de 37 cm (2), clichés Pauline Carvalho, 2009.
- 22 -
Techniques de construction dans les églises et monastères médiévaux
Illustration 3Vases acoustiques dans la voûte de la dernière travée de la nef de l’église de Pommiers-en-Forez. Cliché J.Ch. Valière, 2009.
Illustration 4Oule remployée comme vases acoustique dans l’église de Pommiers-en-Forez et déposée à l’occasion de travaux. Celle-ci mesure 18 cm de haut pour un diamètre à l’ouverture de 14 cm et correspond à la série des petits vases implantés dans la voûte , cliché B. Palazzo-Bertholon, 2009.
- 23 -
Techniques de construction dans les églises et monastères médiévaux
Illustration 5Plan de l’église d’après Caroline Roux : « A propos d’un remploi de colonne dans la priorale de Pommiers-en-Forez ». Architecture et pratiques religieuses, VIe colloque biennal de Pommiers, 15 juin 2007, St-Germain-Laval 2008, p. 57-64, ill. 3.
- 24 -
Techniques de construction dans les églises et monastères médiévaux
Illustration 6à gauche, expérience de mesure de la fréquence d’un vase. A droite, résultat de l’amplifi cation du son en fonction de la position du microphone.
Illustration 7carré bleu : nombre de vase estimé en fonction du volume de chacun des édifi ces.