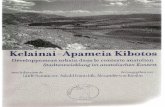Du monstre sacré à la mémoire rationnelle ? Les récits génétiques des Mérovingiens et des...
Transcript of Du monstre sacré à la mémoire rationnelle ? Les récits génétiques des Mérovingiens et des...
37
Du monstre sacré à la mémoire rationnelle ?Les récits génétiques des Mérovingiens et des Capétiens
Julian Führer
Université de Zurich (Suisse) 1
Parmi les questions soulevées par une approche des récits généalogiques comme récits de soi, il convient de réfléchir sur l’identité de la personne évoquée dans l’expression « récit de soi ». Il s’agira ainsi d’examiner plusieurs cas de mémoire généalogique et de récits génétiques qui montreront que le présent respectif obéit toujours, par principe, à un système de réflexion systématique ultérieur. Une histoire génétique d’une famille, d’une dynastie ou d’un royaume devra toujours être adaptée à un cadre changé. Nous avons choisi comme exemple la comparaison de l’histoire de deux familles royales bien connues, les Mérovingiens et les Capétiens.
Généalogies mérovingiennes
Dès le début, un premier constat semble s’imposer : il n’est possible d’avoir recours à un argumentaire fondé sur la généalogie que lorsque la famille en question est d’ores et déjà solidement installée au pouvoir. En effet, il s’agit de légitimer le présent (et le futur) par le passé. Pour cela, il est nécessaire, en général, d’avoir déjà plusieurs rois dans la famille avant d’évoquer ce fait dans les documents. Si quelques idées de cet article doivent beaucoup à Georges Duby 2 et Bernard Guenée 3, nous essayerons néanmoins de mettre l’accent sur d’autres éléments et d’élargir la perspective de cette étude. Il faut
1 Je remercie Marie-Laure Pain d’avoir corrigé mon français.2 Georges Duby, « Remarques sur la littérature généalogique en France aux xie et xiie siècles »,
Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1967, p. 335-345.3 Bernard Guenée, « Les généalogies entre l’histoire et la politique : la fierté d’être Capétien,
en France, au Moyen Âge », Annales ESC, 33 (1978), p. 450-477.
Livre L'incorporation.indb 37 10/10/2016 16:07:35
Julian Führer
38
également tenir compte de l’histoire de la science historique et de la réflexion génétique : ce discours généalogique très vivace au xixe siècle doit beaucoup aux travaux de génétique de la biologie. L’origine et l’ascendance expliquent le présent. Cela valait pour des considérations d’ordre familial et national, mais aussi pour la méthode d’édition des textes médiévaux qui veut alors dégager l’état le plus pur du point de vue génétique d’un texte, non mélangé, en retraçant la filiation des manuscrits. Toute « contamination » a alors une connotation péjorative dont il faut faire abstraction en lisant les réflexions médiévales du récit génétique plutôt comme un récit des origines ancré dans une logique délibérément biologique, et de suite générationnelle.
Faire le récit des origines d’un peuple ou d’une famille semble presque avoir été une nécessité au haut Moyen Âge. D’où vient alors cette « hantise des origines » (Marc Bloch) ? L’étude de ce que la recherche a coutume d’appeler l’origo gentis constitue un sujet de prédilection pour les historiens de cette période 4. Presque tous les peuples qui nous ont transmis des sources historiques écrites en ont abordé la question. Qu’en est-il pour les Mérovingiens ? Ces rois appartenaient au peuple franc qui aurait ses origines en Pannonie, comme nous l’apprend Grégoire de Tours au vie siècle 5. Ce dernier, auteur le plus prolifique pour notre propos, écrivait en tant qu’évêque qui avait des ancêtres romains du centre de la Gaule ; auvergnat d’origine, il était devenu évêque tourangeau 6. Il vivait sous la domination des rois francs de la famille mérovingienne sans toutefois les vénérer particulièrement et sans écrire à leur instigation 7. Grégoire n’en dit pas davantage et se tait complètement sur les origines de la dynastie royale 8. Voici son récit des origines des Francs :
4 Magali Coumert, Origines des peuples : les récits du Haut Moyen Âge occidental (550-850), Paris, 2007 ; Alheydis Plassmann, Origo gentis : Identitäts- und Legitimitätsstiftung in früh- und hochmittelalterlichen Herkunftserzählungen, Berlin, 2006 (Orbis mediaevalis. Vorstellungswelten des Mittelalters 7) ; Herwig Wolfram, Walter Pohl, Ian N. Wood et al., « Origo gentis », Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, vol. 22, Berlin, New York, 2003, p. 174-210.
5 Gregorii episcopi Turonensis Historiarum Libri. X, éd. Bruno Krusch, Wilhelm Levison, Hannover, 21951 (MGH SS rer. Merov. I,1²), II,9, p. 57 : « Hanc nobis notitiam de Francis memorati historici reliquere, regibus non nominatis. Tradunt enim multi, eosdem de Pannonia fuisse degressus ».
6 Meilleure mise au point biographique succinte : Benedikt Konrad Vollmann, « Gregor von Tours », Reallexikon für Antike und Christentum, 12, 1983, p. 895-930.
7 Martin Heinzelmann, Gregor von Tours, “Zehn Bücher Geschichte”. Historiographie und Gesellschaftskonzept im 6. Jahrhundert, dir. Darmstadt 1994. Voir aussi les contributions dans le volume Nancy Gauthier, Henri Galinié, Grégoire de Tours et l’espace gaulois. Actes du congrès international, Tours, 3-5 novembre 1994, Tours, 1997.
8 Voir cependant, à propos de l’attitude présumée de Grégoire de Tours face au récit de l’origine troyenne des Francs, Jonathan Barlow, « Gregory of Tours and the Myth of the Trojan Origins of the Franks », Frühmittelalterliche Studien, 29, 1995, p. 86-95 (pas convaincant à tous les égards).
Livre L'incorporation.indb 38 10/10/2016 16:07:35
Du monstre sacré à la mémoire rationnelle ?
39
Qui a été le premier roi des Francs, beaucoup l’ignorent. En effet, tandis que l’histoire de Sulpice Alexandre raconte sur eux beaucoup de choses, elle ne donne cependant nulle part le nom de leur premier roi, mais dit qu’ils avaient des ducs. […] Les historiens précités nous ont laissé ces renseignements sur les Francs sans donner des noms de rois. Beaucoup rapportent que ceux-ci seraient sortis de la Pannonie et auraient d’abord habité les rives du fleuve du Rhin ; […] et là ils auraient créé au-dessus d’eux dans chaque pays et chaque cité des rois chevelus appartenant à la première et, pour ainsi dire, à la plus noble famille de leur race 9.
Un premier constat est alors de relever que Grégoire écrivait à un moment où personne ne semblait contester le pouvoir de la dynastie mérovingienne, et pourtant le passé de cette famille restait dans l’obscurité. Des rois mérovingiens semblent avoir régné depuis le milieu du ve siècle environ et, plus d’un siècle plus tard, Grégoire, un des écrivains les mieux documentés qui parle d’ailleurs de ses propres ancêtres jusque dans des générations très éloignées, ne semble pas savoir avec qui ni comment a commencé la lignée de ses rois. On peut aussi concevoir que la question de savoir quelles étaient les origines de la dynastie mérovingienne, pour Grégoire de Tours, ne se posait pas ou était sans importance.
L’histoire universelle de Grégoire de Tours fut abrégée et continuée jusqu’au milieu du viie siècle par un auteur à fort mauvaise réputation, le pseudo-Frédégaire, auteur en fait anonyme probablement bourguignon 10. Voilà ce qu’il fit des origines franques :
À propos des rois des Francs d’autrefois, saint Jérôme écrivit ce que raconte déjà l’histoire du poète Virgile : qu’ils avaient Priam comme premier roi ; que, Troie prise par la ruse d’Ulysse, ils étaient partis de là ; que puis ils avaient Friga comme roi 11. [Il est ensuite question de la division des troupes parties de Troie] La part restante qui demeurait sur les rives du Danube se choisit un
9 Grégoire de Tours, Histoire des Francs, trad. Robert Latouche, vol. 1, Paris, 1963, p. 92 et 98. Gregorii episcopi Turonensis Historiarum libri X op. cit., II, 9, p. 52 : « De Francorum vero regibus, quis fuerit primus, a multis ignoratur. Nam cum multa de eis Sulpici Alexandri narret historia, non tamen regem primum eorum ullatinus nominat, sed duces eos habuisse dicit. […] » ; Ibid., p. 57 : « Hanc nobis notitiam de Francis memorati historici reliquere, regibus non nominatis. Tradunt enim multi, eosdem de Pannonia fuisse degressus, et primum quidem litora Rheni amnes incoluisse, […] ibique iuxta pagus vel civitates regis crinitos super se creavisse de prima et, ut ita dicam, nobiliore suorum familia ».
10 Mise au point la plus récente par Roger Collins, Die Fredegar-Chroniken, Hannover, 2007 (MGH Studien und Texte, 44). Pour la technique d’utilisation de Grégoire de Tours par cet auteur (ou ces auteurs), voir Gerald Schwedler, « Lethe and “delete” : discarding the past in the early Middle Ages. The case of Fredegar », in Anja-Silvia Goeing, Anthony Grafton, Paul Michel, dir. Collectors‘ knowledge. Aufbewahren oder wegwerfen – wie Sammler entscheiden : what is kept, what is discarded, Leiden, 2013 (Brill’s Studies in Intellectual History 227), p. 71-96.
11 Bruno Krusch, éd., Fredegarii Chronica, Hannover, 1888 (MGH SS rer. Merov. 2), III, 2, p. 93 : « De Francorum vero regibus beatus Hieronimus […] scripsit, quod prius Virgilii poetae
Livre L'incorporation.indb 39 10/10/2016 16:07:35
Julian Führer
40
roi du nom de Torcoth par lequel on nomme les Turcs ; et par [le roi] Francion les autres furent appelés les Francs 12.
Tout d’abord il convient de signaler une faute assez grossière ; ce n’est pas Jérôme qui relate l’origine troyenne des Francs, c’est bien notre pseudo-Frédégaire qui cite longuement Jérôme et insère lui-même ce passage dans le texte qui ne figure pas dans l’original. Il y a plus à dire ; notre auteur connaît plusieurs textes, dont sans doute Jérôme, Virgile et Grégoire de Tours, et brode quelque peu afin d’expliquer le nom du peuple franc. Cette manière d’expliquer que le nom d’un peuple s’inspire de celui de son roi fondateur est une pratique courante à l’époque, mais jusqu’alors nous n’avons aucune trace d’un tel roi éponyme dans les textes. L’histoire des rois est étroitement liée à celle du peuple ; or en parlant des origines des Mérovingiens il semblerait que notre auteur privilégie un caractère surnaturel de la monarchie :
Cette lignée pratiquait des cultes païens. On raconte qu’en été [le roi] Chlodion était assis avec son épouse près de la côte ; vers midi sa femme allait vers la mer pour se laver, et alors une bête de Neptune aux allures d’un Quinotaure l’aborda. Par la suite elle tombait enceinte ou bien par la bête ou bien par son mari, et elle donna naissance à un fils du nom de Mérovée par lequel les rois des Francs sont depuis appelés les Mérovingiens 13.
Que faire d’un tel extrait ? Le Quinotaure laisse immédiatement penser au Minotaure. Sa présence, de même que celle de Neptune, nous suggère que l’auteur aime afficher son savoir mythologique 14. Que dire alors de cette incroyable histoire – que s’est-il passé ? S’agit-il d’une faute de recopiage ? Cette hypothèse est assez peu vraisemblable, car les manuscrits sont tous d’accord sur le texte par ailleurs écrit dans un latin abscons et très éloigné de la langue latine classique. Néanmoins, il est possible que la faute soit effective et serait alors intervenue à un moment précoce de la tradition textuelle. Notons au passage qu’on pourrait également traduire « elle tombait enceinte par la
narrat storia: Priamum primum habuisse regi ; cum Troia fraude Olexe caperetur, exinde fuissent egressi ; postea Frigam habuissent regem ».
12 Ibid. : « Residua eorum pars, que super litore Danuvii remanserat, elictum a se Torcoth nomen regem, per quem ibique vocati sunt Turchi; et per Francionem hii alii vocati sunt Franci ».
13 Ibid., III,9, p. 95 : « Haec generacio fanaticis usibus culta est. Fertur, super litore maris aestatis tempore Chlodeo cum uxore resedens, meridiae uxor ad mare labandum vadens, bistea Neptuni Quinotauri similis eam adpetisset. Cumque in continuo aut a bistea aut a viro fuisset concepta, peperit filium nomen Meroveum, per co regis Francorum post vocantur Merohingii ».
14 Il est évident que ce passage a beaucoup occupé la recherche, surtout de la part de chercheurs allemands inspirés autant par l’archéologie de l’époque que par l’ethnologie, l’anthropologie et les sciences religieuses comparées. À propos des interprétations possibles du « Quinotaure », cf. : Reinhard Wenskus, « Religion abâtardie. Materialien zum Synkretismus in der vorchristlichen Theologie der Franken », in Hagen Keller, Nikolaus Staubach, dir. Iconologia sacra. Mythos, Bildkunst und Dichtung in der Religions- und Sozialgeschichte Alteuropas. Festschrift für Karl Hauck zum 75. Geburtstag, Münster, 1994 (Arbeiten zur Frühmittelalterforschung 23), p. 179-248, surtout p. 201.
Livre L'incorporation.indb 40 10/10/2016 16:07:35
Du monstre sacré à la mémoire rationnelle ?
41
bête ainsi que par son mari », ce qui ne donne pas plus de sens au texte 15. Il semblerait en tout cas que ce Mérovée dont nous ne savons d’ailleurs rien et qui aurait régné au milieu du ve siècle devrait sa naissance, d’une manière ou d’une autre, à un monstre marin. Ce monstre qui a fait couler beaucoup d’encre apparaît donc assez tardivement dans l’historiographie : au milieu du viie siècle, à un moment où les Mérovingiens règnent comme famille depuis plus d’un siècle et demi. L’auteur malheureusement inconnu de cette œuvre voulait apparemment montrer qu’il en savait long de la mythologie antique 16. En revanche, il est plus que douteux qu’il voulait démontrer le caractère surnaturel de la monarchie des Clovis, Clotaire et Dagobert – il évoque lui-même le caractère incroyable de cette histoire (fertur, on raconte), et en outre le sens véritable de ses assertions demeure plutôt obscur, car plusieurs traductions sont possibles. Cette histoire n’est pas reprise dans d’autres œuvres, et pourtant la chronique du Pseudo-Frédégaire était fortement répandue 17. Même de « faux » récits historiques peuvent constituer de « vrais » récits de fondation générateurs d’identité, mais ce texte, quoique lu, n’était pas imité ou pris comme modèle pour d’autres récits. Souvent, on a voulu voir dans cette histoire la preuve d’un caractère sacré de la monarchie, surtout par l’intermé-diaire de ce monstre, certes marin, mais surtout bovin qu’on retrouverait dans une tête de taureau trouvée dans le tombeau de Childéric (fils de Mérovée) 18, sur le décor de la ceinture de la reine Arégonde inhumée à Saint-Denis 19 et dans le char à bœufs qu’auraient emprunté les rois mérovingiens d’après le récit de
15 Karl Hauck, « Lebensnormen und Kultmythen in germanischen Stammes- und Herrschergenealogien », Saeculum, 6, 1955, p. 186-223, ici p. 197.
16 Le pseudo-Frédégaire se plaît d’une manière générale à citer longuement Jérôme et à se référer à l’antiquité et la mythologie.
17 On dénombre en effet plus de trente témoins médiévaux de ce texte qui était par ailleurs inséré maintes fois comme continuation de Grégoire de Tours dans des compilations historiques par le biais desquelles il constitua une partie d’une histoire assez cohérente du royaume des Francs.
18 Pour une telle interprétation, voir par exemple : Erich Zöllner, Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts, München, 1970, p. 179 ; Joachim Werner, « Neue Analyse des Childerichgrabes von Tournai », Rheinische Vierteljahresblätter, 35, 1971, p. 43-46. Mise au point récente en français : Stéphane Lebecq, « Les deux faces du roi Childéric : histoire, archéologie, historiographie », in Stéphane Lebecq, Hommes, mers et terres du Nord au début du Moyen Âge, vol. 1, Villeneuve d’Ascq, 2011 (Histoire et civilisations), 19-34.
19 Florence André, Gilbert Mangin, « Les bijoux d’Arégonde », Les dossiers d’archéologie, 32, 1979, p. 50-65 ; Michel Fleury, Albert France-Lanord, « La tombe d’Arégonde. Les vêtements d’Arégonde », ibid., p. 27-42. La datation ainsi que l’interprétation de certains objets ont été remis en question par Patrick Périn ; voir le bilan (provisoire) in Véronique Gallien, Patrick Périn, Antoinette Rast-Eicher, Yves Darton, Claude Rücker, « La tombe d’Arégonde à Saint-Denis. Bilan des recherches menées sur les restes organiques humains, animaux et végétaux retrouvés en 2003 », in Armelle Alduc-Le Bagousse, dir., Inhumations de prestige ou prestige de l’inhumation ? Expressions du pouvoir dans l’au-delà (ive – xve siècle), Caen, 2009 (Tables rondes du CRAHM 4), p. 203-226.
Livre L'incorporation.indb 41 10/10/2016 16:07:36
Julian Führer
42
la Vie de Charlemagne par Eginhard 20. Or la Vie de Charlemagne est fortement hostile aux Mérovingiens et dresse un portrait caricatural de ce char à bœufs, et le Pseudo-Frédégaire lui aussi est hostile aux Mérovingiens. Plus d’une fois il traite les rois de son époque et leur dynastie d’incapables 21. Les multiples allusions à la mythologie antique dans la chronique du Pseudo-Frédégaire servaient plutôt l’intérêt personnel de l’auteur que la perspective présumée de la dynastie qui était au centre du chapitre cité, mais pas de l’œuvre toute entière ; pour la reine et la bête, il en sera probablement pareil.
De fait, Grégoire de Tours et le Pseudo-Frédégaire écrivent à l’époque des rois mérovingiens et dans une région soumise à leur domination. Mais il nous manque un témoignage certain de la conscience familiale mérovingienne. Si l’on feuillette les actes royaux des Mérovingiens, aucune référence à la famille, à la dynastie, au long passé royal n’est visible. Quelques confirmations évoquent les prédécesseurs dans la fonction royale, mais ne mentionnent pas l’appartenance à la dynastie 22. Celle-ci était néanmoins déterminante au vu de la succession des porteurs des insignes de la royauté : les Mérovingiens restaient la dynastie régnante depuis la deuxième moitié du ve siècle jusqu’au milieu du viiie siècle avant d’être chassés du pouvoir par les Carolingiens qui hésitent à évincer cette famille même si elle ne semble plus vraiment détenir les rênes du pouvoir 23. Les récits généalogiques dont nous disposons proviennent de sources plutôt distantes voire même hostiles. Une mémoire
20 Éginhard, Vie de Charlemagne. Texte, traduction et notes s.d. Michel Sot, Christiane Veyrard-Cosme, Paris, 2014 (Les Classiques de l’histoire de France au Moyen Âge, 53), ch. 1, p. 2-4. L’« attelage de bœufs » qu’auraient utilisé les derniers rois mérovingiens doit dresser un portrait pitoyable voire ridicule de la souveraineté royale tombée en désuétude ; c’est déjà à cause de cela qu’il faut mettre en garde contre une interprétation trop axée sur les aspects cultuels de la royauté.
21 Ajoutons à cela qu’Alexander Callander Murray refuse toute implication religieuse dans ce récit du pseudo-Frédégaire, cf. Alexander Callander Murray, « Post vocantur Merohingii : Fredegar, Merovech, and‚ Sarnal Kingshi », in Alexander Callander Murray, dir. After Rome’s Fall. Narrators and Sources of Early Medieval History. Essays presented to Walter Goffart, Toronto / Buffalo / London, 1998, p. 121-152. Voir à ce propos également Ian Wood, « Merowech », Reallexikon der germanischen Altertumskunde, vol. 19, Luchs – Metrum, Berlin / New York, 2001, 575 sq. (considérant ce passage comme une parodie des récits d’origine mythiques) et Matthias Becher, Chlodwig I. Der Aufstieg der Merowinger und das Ende der antiken Welt, München, 2011, p. 117 sq.
22 L’exemple le plus ancien semble être le diplôme de Clovis II de 654 portant confirmation d’un privilège en faveur de Saint-Denis et mentionnant la sépulture de ses parents Dagobert et Nanthilde ; cette mention les nomme cependant en tant que parents (genetores) et non en tant que représentants de la royauté ou d’une dynastie, cf. D Mer 85, Die Urkunden der Merowinger, éd. Theo Kölzer, vol. 1, Hannover, 2001, p. 218.
23 Pour l’arrière-plan de ces événements, cf. les articles contenus in Hartmut Atsma, dir., La Neustrie. Les pays au nord de la Loire de 650 à 850. Colloque historique international, 2 vol., Sigmaringen, 1989 (Beihefte der Francia 16) ; Jörg Jarnut, dir., Karl Martell in seiner Zeit, Sigmaringen, 1994 (Beihefte der Francia 37).
Livre L'incorporation.indb 42 10/10/2016 16:07:36
Du monstre sacré à la mémoire rationnelle ?
43
génétique ne semble pas avoir été vivace au sein de cette famille, du moins nous n’en trouvons pas trace pour le moment.
Les Carolingiens, quant à eux, se plaisent à se construire un passé d’un côté moins fantastique et, de l’autre, fortement ancré dans le surnaturel chrétien. En effet, plusieurs ancêtres des Carolingiens ont été vénérés comme saints par les générations futures, dont saint Arnoul de Metz 24. Certaines filiations parentales sont toutefois douteuses ; toujours est-il qu’elles font partie du patrimoine génétique carolingien et qu’elles ont été intégrées dans la mémoire dynastique des rois de France 25. Il importe de noter que le renversement de la dynastie mérovingienne et son remplacement par le roi Pépin en 751 était justifié dans l’historiographie non pas par une légitimité fondée sur la généalogie, mais plutôt sur l’incapacité du roi régnant et l’aptitude de son concurrent à gouverner. L’historiographie carolingienne se donne alors pour objectif de prolonger aussi bien l’incapacité des Mérovingiens que la vaillance des ancêtres carolingiens jusque dans le viie siècle ; notre image des Mérovingiens « rois fainéants » en souffre encore 26. La famille des Carolingiens voulait visiblement faire oublier le passé mérovingien et accumuler un grand nombre d’éléments pouvant légitimer leur pouvoir, comme l’onction (mise en doute pour la date de 751 par la recherche récente 27), l’alliance avec les papes ou encore le couronnement impérial de Noël 800. Ces ressources allaient cependant se ternir, et la généalogie allait également devenir un argument central pour les Carolingiens au moment où ceux-ci avaient un passé suffisamment long au pouvoir.
Généalogies capétiennes
La famille capétienne devait son pouvoir à un coup d’État (987). Il faut y ajouter le hasard biologique qui avait fait mourir à dix-huit ans dans un accident le dernier roi carolingien du royaume franc d’Occident à un moment
24 Otto Gerhard Oexle, « Die Karolinger und die Stadt des heiligen Arnulf », Frühmittelalterliche Studien, 1, 1967, p. 250-364 ; voir aussi les contributions in Mireille Chazan, Gérard Nauroy et alii, dir., Écrire l’histoire à Metz au Moyen Âge. Actes du colloque organisé par l’Université Paul-Verlaine de Metz, 23-25 avril 2009, Berne, 2011 (Recherches en littérature et spiritualité, 20) et en particulier l’article de Gérard Nauroy, « La Vita anonyme de saint Arnoul face à la tradition hagiographique antique », ibid., p. 69-98.
25 Même si l’histoire des Mérovingiens a été davantage intégrée à l’histoire de France qu’à l’histoire de l’Allemagne, l’historiographie allemande n’en a pas moins été hantée par les questions de succession, de légitimité et d’élections de souverains.
26 Paul Fouracre, « The long shadow of the Merovingians », in Joanna Story, dir. Charlemagne. Empire and Society, Manchester, New York 2005, p. 5-21.
27 Matthias Becher, Jörg Jarnut, dir., Der Dynastiewechsel von 751. Vorgeschichte, Legitimationsstrategien und Erinnerung, Münster 2004 ; ce volume réagit aux nouvelles hypothèses émises par Josef Semmler, Der Dynastiewechsel von 751 und die fränkische Königssalbung, Düsseldorf, 2003 (Studia humaniora. Series minor 6).
Livre L'incorporation.indb 43 10/10/2016 16:07:36
Julian Führer
44
où il n’avait pas encore eu de descendance. Cela permettait à plus long terme l’établissement d’une dynastie où chaque roi, autre hasard biologique, avait un fils pouvant lui succéder et profiter en plus d’une certaine longévité. Or la légitimité de ce pouvoir était douteuse et, en plus, contestée. La passation des pouvoirs à Hugues Capet a été racontée avec beaucoup d’imagination et surtout de partis pris par Richer de Reims. L’échange des arguments en faveur et contre Hugues Capet et son rival carolingien Charles de Lorraine est purement fictif, mais met aux prises les éléments principaux du discours légitimateur de l’époque : la légitimité généalogique et les qualités individuelles ainsi que le renvoi à la destitution ou éviction de souverains ou candidats incapables dans le passé. Cela renvoie à l’accession des Carolingiens au pouvoir et met par là en doute la légitimité « naturelle » de leur souveraineté 28. À côté du récit fictif de Richer, on peut citer l’histoire telle que la relate l’Historia Francorum Senonensis, où le frère du roi défunt est considéré comme le roi légitime, renversé suite à une rébellion accompagnée de traitrise au profit du duc Hugues. Devant le succès de ces machinations, le chroniqueur conclut : Hic deficit regnum Karoli Magni – ici prit fin le règne de Charlemagne 29.
Les difficultés visibles que rencontra Hugues Capet à affermir son pouvoir et à se maintenir en place malgré une légitimation déficiente, le poussèrent à assurer dès ses débuts la transmission du pouvoir à son fils. Les Capétiens, à commencer avec Hugues Capet lui-même, usaient du procédé de l’association du fils aîné au règne du vivant du père, et cela de façon très systématique, comme le montre ce tableau 30 :
28 Richer, Histoire de France (888-895), éd. Robert Latouche, Paris 1964 (Les Classiques de l’histoire de France au Moyen Âge 17), IV, 9, p. 154-156 (légitimité dynastique de Charles), IV, 11, p. 160-162 (incapacité personnelle de Charles et prééminence de Hugues, égal de Charles en matière de noblesse).
29 Historia Francorum Senonensis, éd. Georg Waitz, Hannover, 1851 (Monumenta Germaniae Historica, Scriptores 9), p. 367 sq.
30 Julian Führer, « Gegenwart der Vorgänger und genealogisches Bewusstsein bei den Kapetingern (987-1223) », in Hartwin Brandt, Katrin Köhler, Ulrike Siewert, dir., Genealogisches Bewusstsein als Legitimation. Inter- und intragenerationelle Auseinandersetzungen sowie die Bedeutung von Verwandtschaft bei Amtswechseln, Bamberg, 2009 (Bamberger Historische Studien 4), p. 145-166, consultable en ligne (http://www.opus-bayern.de/uni-bamberg/volltexte/2010/223/), p. 149 pour le diagramme repris ici. Dominique Barthélemy, Nouvelle histoire des Capétiens, Paris 2012, p. 64 souligne par contre dans cette stratégie d’association au trône l’intention de réserver la couronne au fils aîné du roi régnant.
Livre L'incorporation.indb 44 10/10/2016 16:07:36
Du monstre sacré à la mémoire rationnelle ?
45
Hugues Capet (987-996) associe Robert (associé en 987)Robert le Pieux (996-1031) associe a) Hugues (*1007, assoc. 1017, † 1026) b) Henri (*1008, assoc. 1027)Henri Ier (1031-1060) associe Philippe (*1052, assoc. 1059)Philippe Ier (1060-1108) désigne Louis (*1081, en 1103 31)Louis VI (1108-1137) associe a) Philippe (*1116, assoc. 1129, † 1131) b) Louis (*1120, assoc. 1131)Louis VII (1137-1180) associe Philippe (*1165, assoc. 1179)
Comme chez les Mérovingiens et bien d’autres familles royales du Moyen Âge, la réflexion généalogique n’intervint que beaucoup plus tard dans les stratégies légitimatrices. Les ancêtres des Mérovingiens avant l’intervention du monstre nous restent inconnus ; or, chez les Capétiens, bien des personnages sont connus depuis le ixe siècle, et pourtant les généalogies ne font recours qu’aux personnages couronnés 32. Si les Capétiens favorisent donc davantage un discours généalogique qui est en fait plutôt dynastique, cela peut être justifié tout d’abord par le hasard biologique. Mais les documents relatifs à ces rois en disent encore davantage. En regardant par exemple les fondations pieuses, on s’aperçoit que Robert le Pieux et Henri Ier disent peu de chose de leurs prédécesseurs. Sous Philippe Ier, quelques ancêtres sont mentionnés. Sous Louis VI, par contre, qui régnait au début du xiie siècle et par conséquent après plus d’un siècle de régime capétien, les références devinrent plus régulières. Ses parents, son père, mais surtout ses ancêtres et prédécesseurs sont les bienfaiteurs de ses donations 33. Un petit bémol méthodologique s’impose néanmoins. Les monastères de fondation mérovingienne ou carolingienne n’étaient pas obligatoirement les destinataires privilégiés des donations de Louis VI. Autrement dit, aussi banal que cela puisse paraître, le fait que Charlemagne ne soit pas mentionné dans un acte pour Cluny n’est pas
31 Le futur Louis VI ne fut pas associé de façon officielle au gouvernement ; la titulature comme rex designatus qu’on trouve dans les quelques actes conservés de lui de cette époque évoque tout de même une distinction devant mener au couronnement le jour venu, cf. Éric Bournazel, Louis VI le Gros, Paris, 2007, p. 53.
32 La recherche moderne a même pu rendre probable tout récemment que les ancêtres des Capétiens étaient déjà des personnages haut placés dans l’entourage des Mérovingiens au viie siècle, cf. Constance Brittain Bouchard, Rewriting Saints and Ancestors. Memory and Forgetting in France, 500-1200, Philadelphia 2015, p. 187-192.
33 Voici un petit croquis établi au moyen de l’édition critique de Jean Dufour, dir., Recueil des actes de Louis VI roi de France, Paris, 1992-1994 (Chartes et Diplômes) en respectant la nomenclature des actes :
Louis VI et ses prédécesseurs (predecessores) 17 Louis VI et ses ancêtres (antecessores) 13 Père, mère et prédécesseurs 12 Philippe Ier 10 Louis VI et ses parents 5
Livre L'incorporation.indb 45 10/10/2016 16:07:37
Julian Führer
46
significatif en soi, puisque Cluny n’existait pas à l’époque de Charlemagne 34. Cela peut influencer un relevé statistique et mener à de fausses conclusions. D’une manière générale, dans les diplômes de Louis VI, les références aux ancêtres et aux prédécesseurs restent limitées aux rois capétiens 35. Mais l’exception qui ne fait pas coutume existe. Dans un diplôme de Louis VI pour Saint-Denis, les représentants les plus réputés des dynasties royales sont énumérés l’un après l’autre :
Particulièrement resplendissant furent les règnes de sieur Dagobert, un roi très-puissant, et de Charles le Chauve, en même temps roi et empereur magnifique, et aussi de notre arrière-grand-père de pieuse mémoire Robert, qui eux tous aimaient l’église de saint Denis et de ses confrères fondée par Dagobert plus que toutes les autres 36.
Voici pour une première fois une ébauche de ce que l’on pourrait appeler une conscience de la succession des dynasties sur le trône de France. Louis VI énumère un Mérovingien, un Carolingien et un Capétien. Mais ce diplôme n’a pas été conçu à la chancellerie royale ; celui qui a établi ce texte fut très probablement Suger, plus tard abbé de Saint-Denis, en tout cas un moine dionysien qui laissait entrevoir l’importance qu’avait ce monastère très ancien, un des rares établissements en effet qui possédaient des documents sur une époque aussi éloignée 37. Il nous semble en tout cas que depuis les alentours de 1100 on commençait ici et là à parler de façon plus assurée de l’histoire capétienne, et cela malgré le – ou peut-être à cause du – fait que la dynastie
34 Le livre de Geoffrey Koziol, The Politics of Memory and Identity in Carolingian Royal Diplomas : the West Frankish Kingdom (840-987), Turnhout 2012 (Utrecht Studies in Medieval Literacy 19) vient de renouveler l’approche des actes de souverains comme articulation du pouvoir. Voir en outre : Marie-José Gasse-Grandjean, Benoît-Michel Tock dir., Les actes comme expression du pouvoir au haut Moyen Âge. Actes de la Table ronde de Nancy, 26-27 novembre 1999, Turnhout, 2003 (ARTEM 5).
35 Julian Führer, Gegenwart der Vorgänger und genealogisches Bewusstsein bei den Kapetingern (987-1223), art. cit. ; cf. aussi Bernd Schneidmüller, « Die Gegenwart der Vorgänger. Geschichtsbewußtsein in den westfränkisch-französischen Herrscherurkunden des Hochmittelalters », in Hans-Werner Goetz dir. Hochmittelalterliches Geschichtsbewußtsein im Spiegel nichthistoriographischer Quellen, Berlin, 1998, p. 217-235.
36 « Precipue claruerunt donnus Dagobertus, rex prevalidus, et Karolus Calvus, eque rex et imperator magnificus, atavus quoque noster pię memorię rex Robertus, qui ęcclesiam Beati Dyonisii sociorumque ejus ab ipso Dagoberto fundatam pre cęteris dilexerunt », cf. Jean Dufour, dir., Recueil des actes de Louis VI roi de France, Paris 1992 (Chartes et Diplômes), no 70, p. 157 (été 1112).
37 L’écriture est pourtant celle d’un notaire du chapitre cathédral de Notre-Dame de Paris ; pour l’acte et son contenu, cf. Julian Führer, König Ludwig VI. von Frankreich und die Kanonikerreform, Europäische Hochschulschriften, III/1049, Frankfurt/Main 2008, p. 221-226, surtout p. 216-218 ; Françoise Gasparri, « Suger de Saint-Denis. Pratiques, formes, langages d’une culture écrite au xiie siècle (à propos d’une charte originale jusqu’ici inconnue : Arch. nat. 2247 n. 3) », Scrittura e civiltà, 20, 1996, p. 111-135, p. 127 ; eadem, « La politique de l’abbé Suger de Saint-Denis à travers ses chartes », Cahiers de civilisation médiévale, 46 (2003), p. 233-245, p. 238.
Livre L'incorporation.indb 46 10/10/2016 16:07:37
Du monstre sacré à la mémoire rationnelle ?
47
avait connu des troubles avec l’excommunication du roi Philippe Ier suite à son remariage et avec l’avènement quelque peu perturbé de Louis VI au trône en 1108 38. Au xie siècle, vu leur puissance réelle, les Capétiens étaient en fait des comtes de Paris au titre prétentieux 39 ; au xiie, la monarchie était solidement assise, mais ce n’est qu’au xiiie siècle que la monarchie française du Moyen Âge allait devenir celle que l’on connaît dans les manuels avec tout l’apparat comme le sacre rémois et le pouvoir thaumaturgique des rois 40.
Un récit de légitimation : des Mérovingiens aux Capétiens
Le xiiie siècle marqua un tournant en matière de discours généalogique et identitaire. Les Capétiens étaient alors la dynastie régnante incontestée, au pouvoir sans interruption depuis plus de deux siècles ; on était fier d’appartenir à cette famille, et au xiiie siècle on parlait beaucoup du passé 41. La seule ombre qui planait alors sur la monarchie était la façon dont les Capétiens s’étaient emparés du pouvoir en 987. De fait, on devait faire oublier qu’Hugues Capet avait pris le pouvoir malgré la présence d’un candidat carolingien à la couronne. Il fallait donc oublier ce Carolingien, Charles de Lorraine, et peut-être même aussi Hugues Capet. Dans une généalogie royale établie au xiiie siècle sont présentés sur trois pages les rois des trois dynasties sous forme de médaillons se succédant dans une représentation vaguement anthropomorphe de cette succession 42. Le mode de présentation n’a en lui rien de particulier 43. Le dernier roi nommé est Louis IX, le graphique aura par conséquent été établi
38 Andrew W. Lewis, Le sang royal. La famille capétienne et l’État, France, xe-xive siècle, Paris, 1986, p. 80-86 ; Dominique Barthélemy, Nouvelle histoire des Capétiens, op. cit., p. 264-272.
39 William Mendel Newman, Le domaine royal sous les premiers Capétiens (987-1180), Paris, 1937 ; Jean-François Lemarignier, Le gouvernement royal aux premiers temps capétiens (987-1108), Paris, 1965.
40 Marc Bloch, Les rois thaumaturges. Étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale, particulièrement en France et en Angleterre, Strasbourg, 1924 (Publications de la Faculté des lettres de l’université de Strasbourg) ; Jacques Le Goff, Le sacre royal à l’époque de Saint Louis d’après le manuscrit latin 1246 de la BnF, Paris, 2001 (Le temps des images).
41 Bernard Guenée, « Les généalogies entre l’histoire et la politique », art. cit. ; Gabrielle M. Spiegel, « The Reditus Regni ad Stirpem Karoli Magni : A New Look », French Historical Studies 7, 1971, p. 145-174 ; Elizabeth A.R. Brown, « Vincent de Beauvais and the Reditus Francorum ad stirpem Caroli imperatoris », in Monique Paulmier-Foucart, Serge Lusignan, Alain Nadereau, dir., Vincent de Beauvais. Intentions et réceptions d’une œuvre encyclopédique au Moyen Âge, Saint-Laurent, 1990, p. 167-196.
42 BN fr. 13565 (« Abregé de l’histoire de France, composé en latin sous le règne de Philippe-Auguste et traduite en françois par l’ordre d’Alphonse, comte de Poictou, et frère du roi St Louis »), ms. du xiiie siècle, p. 201 (Mérovingiens), 202 (Carolingiens) et 203 (Capétiens).
43 Christiane Klapisch-Zuber, L’ombre des ancêtres. Essai sur l’imaginaire médiéval de la parenté, Paris, 2000 (Esprit de la cité) ; Christiane Klapisch-Zuber, L’arbre des familles, Paris, 2003, pour un échantillon des modes de représentation.
Livre L'incorporation.indb 47 10/10/2016 16:07:37
Julian Führer
48
avant la mort de celui-ci en 1270. Pour les Carolingiens, le graphique est très bien informé : Charles Martel n’était pas roi, son fils Pépin par contre était bien roi, et à ses côtés il avait un frère Carloman qui n’a pas gouverné en tant que roi – ce qui est correct. À la fin de la dynastie on trouve successivement les noms des rois Louis (Louis IV d’Outremer), Lothaire et encore Louis (Louis V), avec la mention à côté A cestui roi looýs defailli la lingnee pepin. Or commence la lingnee hue chapet. Puis, sur la page en regard, on aperçoit la dynastie capétienne dans toute sa splendeur commencer avec Robert le Pieux ! L’existence du candidat carolingien ne faisait plus partie de la mémoire mise par écrit. Cependant, il pourrait y avoir une autre explication. Le roi Pépin était le premier Carolingien régnant, Hugues Capet était le premier Capétien. Ces personnages ont agi d’une façon qu’une apologie de la puissance dynastique ne pouvait encourager. On mettait l’accent sur d’autres personnages issus de cette dynastie, mais certainement pas sur celui qui, à un moment donné, avait renversé l’ordre des choses. Et ainsi on commémorait Charlemagne et non pas son père Pépin. En définitive, nous ne savons presque rien d’Hugues Capet 44. La réécriture de l’histoire n’intervenait qu’à plusieurs générations de distance, notamment après la mort de Charlemagne ou celle de Louis VI, de sorte qu’il ne fallait plus tellement parler de l’avènement de la dynastie.
La monarchie capétienne a su créer une sorte de religion royale ; couronné à Reims, le roi pouvait guérir les maladies 45. Après sa mort, le roi était inhumé à Saint-Denis, et c’est là, en présence des sépultures royales, que l’on travaillait sur l’histoire et que surtout on retravaillait l’histoire 46. Au xiiie siècle apparut tout d’un coup le nom d’une femme membre de la dynastie mérovingienne qui aurait épousé au viie siècle un ancêtre de Charlemagne – les deux
44 Les quelques bribes de sources furent réunies par Ferdinand Lot, Études sur le règne de Hugues Capet et la fin du xe siècle, Paris 1903 (Bibliothèque de l’École des hautes études. Sciences historiques et philologiques 147) ; à part la biographie d’Yves Sassier, Hugues Capet. Naissance d’une dynastie, Paris, 1987 (à noter le titre à connotation hautement téléologique), la bibliographie moderne est plutôt éparse, ce qui reflète l’absence de récits médiévaux hors Richer et aussi l’absence d’édition critique des diplômes de ce roi jusqu’à aujourd’hui.
45 Le premier témoignage dû à Guibert de Nogent traduit quelques hésitations : Louis VI aurait pratiqué le toucher des écrouelles, alors que son père Philippe Ier ne l’aurait pas fait pour une raison que l’auteur affirme ignorer, cf. De sanctis et eorum pigneribus, in : Guibert de Nogent, Quo ordine sermo fieri debeat. De bucella Iudae data et de veritate dominici corporis. De sanctis et eorum pigneribus, éd. Robert Burchard Constantijn Huygens, Turnhout, 1993 (Corpus Christianorum. Continuatio mediaeualis 127), p. 79-175, ici p. 90 ; cf. Jacques Le Goff, « La genèse du miracle royal », in Hartmut Atsma, André Burguière, dir., Marc Bloch aujourd’hui. Histoire comparée et sciences sociales, Paris, 1990, p. 147-156, ici p. 149 sq.
46 Pour un aperçu (à refaire) de la production historiographique dionysienne, cf. Gabrielle M. Spiegel, The chronicle tradition of Saint-Denis : a survey, Brookline, 1978 (Medieval classics. Texts and studies 10). Pour une vision plus globale de l’effort représentatif, cf. Mario Kramp, Kirche, Kunst und Königsbild. Zum Zusammenhang von Politik und Kirchenbau im capetingischen Frankreich des 12. Jahrhunderts am Beispiel der drei Abteien Saint-Denis, Saint-Germain-des-Prés und Saint-Remi/Reims, Weimar, 1995.
Livre L'incorporation.indb 48 10/10/2016 16:07:37
Du monstre sacré à la mémoire rationnelle ?
49
anciennes dynasties auraient donc été unies par le lien conjugal à travers cette hypothétique Bilichilde, ce qui en faisait une dynastie tout simplement 47. Les Capétiens, eux, étaient eux aussi liés aux anciens rois. D’après une vision qu’aurait eue Hugues Capet, saint Valéry lui aurait promis en échange d’une faveur (la restitution de ses reliques aux moines de Saint-Valéry sur Somme) que sa famille régnerait pendant sept générations. Ce récit date du milieu du xie siècle environ et peut être considéré comme la prise de position d’un saint qui aurait prédit un terme au pouvoir capétien 48. Ce représentant de la septième génération était Philippe Auguste régnant autour de 1200 qui avait épousé Élisabeth de Hainaut, descendante de Charlemagne 49. Il est vrai que, au bout de quatre siècles, à peu près toute la noblesse de l’Europe pouvait se rattacher à Charlemagne par quelque parent lointain ; l’essentiel est que cet argument prenait de la valeur dans les débats autour de la légitimité d’une dynastie, et, comme l’a remarqué Georges Duby, la chancellerie de Philippe Auguste était assez prolifique en réflexions généalogiques 50. Son fils, le futur Louis VIII, était dans cette perspective un petit Carolingien, ce qui prouvait en même temps la véracité de la prophétie de saint Valéry et la légitimité de la dynastie ; l’argument était alors retourné en faveur des Capétiens ! 51 On ne s’étonnera pas qu’un poète de l’époque, Gilles de Paris, composa un manuel d’histoire en vers à l’usage du dauphin et qui portait le nom de Karolinus, le petit Charles 52. Cette conception d’une union des trois dynasties royales fut poursuivie jusqu’au
47 Voir p. ex. Witger, Genealogia Arnulfi comitis, éd. Ludwig C. Bethmann, MGHSS9 Hannover, 1851, p. 302 ou encore les généalogies de l’époque carolingienne (fin du ixe siècle) mentionnant cette Bilichilde dans ibid., Scriptores 2, Hannover 1839, p. 308 (deux généalogies avec une origine commune) et p. 313 (généalogie en vers). Au sujet de Witger/Vuitgerius, cf. Eckhard Freise, « Die Genealogia comitis‘ des Priesters Witger », Frühmittelalterliche Studien, 23, 1989, p. 203-243 et Georges Duby, « Remarques sur la littérature généalogique », op. cit., p. 336. Au sujet des fictions généalogiques médiévales, cf. Gerd Althoff, « Genealogische und andere Fiktionen in mittelalterlicher Historiographie », in Horst Fuhrmann éd., Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongreß der Monumenta Germaniae Historica, vol. 1 : Kongreßdaten und Festvorträge. Literatur und Fälschung, Hannover 1988 (Monumenta Germaniae Historica. Schriften 33/1), p. 417-441.
48 Dominique Barthélemy, Nouvelle histoire des Capétiens, op. cit., p. 83.49 Carsten Woll, Die Königinnen des hochmittelalterlichen Frankreich 987-1237/38, Stuttgart
2002 (Historische Forschungen 24), p. 252.50 Georges Duby, « Remarques sur la littérature généalogique », op. cit., p. 338.51 Dominique Barthélemy, Nouvelle histoire des Capétiens, op. cit., p. 316.52 Marvin L. Colker, « The “Karolinus” of Egidius Parisiensis », Traditio, 29, 1973,
p. 199-326 ; pour une lecture du texte dans la perspective de la légitimité fondée sur la généalogie, voir Andrew W. Lewis, « Dynastic Structures and Capetian Throneright : The Views of Giles of Paris », Traditio, 33, 1977, p. 225-252 ; Christine Ratkowitsch, « Carolus castus. Zum Charakter Karls des Großen in der Darstellung des Egidius von Paris », in Dorothea Walz éd., Scripturus vitam. Lateinische Biographie von der Antike bis in die Gegenwart, Festgabe für W. Berschin zum 65. Geburtstag, Heidelberg, 2002, p. 369-377 qui montre que l’amplification de l’image de Charlemagne par rapport à Éginhard constitue en fait une critique de Philippe Auguste. C. Woll, op. cit., p. 252 affirme que les Capétiens
Livre L'incorporation.indb 49 10/10/2016 16:07:37
Julian Führer
50
réaménagement des sépultures à Saint-Denis 53. Depuis ce réaménagement du xiiie siècle, il y avait les Mérovingiens et les Carolingiens, ensemble, d’un côté, les Capétiens de l’autre, et au milieu, devant le grand autel, Philippe Auguste et Louis VIII qui avaient créé cette union présumée des familles royales. Les Mérovingiens étaient alors devenus des ancêtres légitimes, et personne ne parlait plus alors de monstres marins. En effet, le roi Pharamond, aussi légendaire que le monstre, avait remplacé celui-ci déjà dans l’historiographie carolingienne précoce 54.
Nous avons donc des textes, des graphiques et des monuments qui rattachaient les Capétiens par le biais de parentés fictives aux Carolingiens et aux Mérovingiens, un concept qui s’est perpétué dans l’imaginaire des trois « races » royales de la France 55. Il faut se demander si le récit d’une vérité généalogique évidente ne puise pas plutôt dans la vérité objective d’une succession dans l’office royal afin d’accorder une plus-value légitimatrice à une famille qui était obligée d’éliminer un nombre considérable de ses membres de la mémoire pour sauvegarder cette pseudo-évidence.
Cette volonté apparente d’honorer tous les rois enterrés à Saint-Denis comme ancêtres de saint Louis eut des conséquences remarquables. À part les rois et les reines des familles des Mérovingiens et des Capétiens, le monastère dionysien renfermait aussi le tombeau de Charles Martel, maire du palais sous ce que l’historiographie allait appeler du ixe au xxe siècle les « rois fainéants ». Charles Martel n’a jamais été roi, ce n’était que son fils Pépin dit le Bref qui allait renverser le dernier roi mérovingien au cours d’une sorte de putsch. Or que faire du tombeau d’un maire du palais ? Eh bien, à Saint-Denis, Charles Martel devint roi couronné, non pas au viiie, mais bien au xiiie siècle par le biais de son gisant faisant partie de la « commande de Saint Louis » le représentant comme tel, et il trouvait son dernier repos à côté de Clovis II, mérovingien du viie siècle 56. Aucune source écrite de valeur n’affirme cependant que Charles Martel aurait effectivement régné comme roi, mais l’historiographie carolingienne s’était appliquée dès le viiie siècle à taire l’existence d’un roi
ne se seraient approprié cet argument que vers le milieu du xiiie siècle, mais ne prend pas en compte le poème cité.
53 Alain Erlande-Brandenburg, Le roi est mort. Étude sur les funérailles, les sépultures et les tombeaux des rois de France jusqu’à la fin du xiiie siècle, Genève, 1975 (Bibliothèque de la Société française d’archéologie 7), p. 82.
54 Première apparition de Pharamond dans le Liber historiae Francorum rédigé vers 727, éd. Bruno Krusch, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Merovingicarum vol. 2 : Fredegarii et aliorum chronica. Vitae sanctorum, Hannover 1888, ch. 4, p. 244.
55 Bernd Schneidmüller, « Constructing the Past by Means of the Present. Historiographical Foundations of Medieval Institutions, Dynasties, Peoples, and Communities », in Gerd Althoff, Johannes Fried, Patrick J. Geary, dir., Medieval Concepts of the Past. Ritual, Memory, Historiography, Cambridge, 2002 (Publications of the German Historical Institute), p. 167-192, ici p. 170.
56 A. Erlande-Brandenburg, Le roi est mort, op. cit., pl. XXXV fig. 132 et pl. XL.
Livre L'incorporation.indb 50 10/10/2016 16:07:38
Du monstre sacré à la mémoire rationnelle ?
51
mérovingien du moins jusqu’en 737, car Charles Martel allait gouverner le royaume des Francs comme maire du palais pendant ses dernières années et jusqu’à sa mort sans nommer de roi. Évidemment il fallait passer plus tard sur tout ce qui pouvait avoir l’air de troubler cette union représentée des lignées royales 57.
Conclusion
Aussi bien dans le cas des Mérovingiens que dans celui des Capétiens, les réflexions sur l’origine de la famille royale n’intervenaient que tardivement, quand les dynasties en question étaient déjà bien installées au pouvoir. Il s’agirait donc d’une légitimité généalogique qui nécessitait non seulement une lignée clairement énumérable sur plusieurs générations, mais aussi une suite de personnalités royales dans le passé avant que l’on ne cherchât à asseoir sa propre légitimité dans le passé et de l’assurer par là pour le futur. Dans le cas des Mérovingiens, plusieurs récits d’origine des Francs s’entrecoupent avec la généalogie familiale qui remonterait à une union charnelle peu claire avec un monstre marin. Afin de pouvoir évaluer cette configuration des principaux acteurs sociaux de l’époque, il convenait de s’interroger sur les structures narratives de tels récits dans leur contexte et de situer leur auteur – hostile à la famille royale, ce qu’on oublie trop souvent – dans le cadre du viie siècle en Gaule.
Une stratégie légitimatrice axée sur la généalogie a ceci d’attrayant qu’elle présente un aspect rationnel, c’est-à-dire une lignée, le plus souvent un pouvoir directement transmis de père en fils, ce qui semble avoir un caractère assez objectif et vérifiable (même si tout lien de parenté a une composante sociale alors que la composante biologique n’est pas obligatoirement présente). Or il est évident que cette lignée est sujette à des modifications dans le futur ; des ancêtres sont éliminés, d’autres sont inventés afin de permettre le rattachement à une autre dynastie. La mémoire et la commémoration ont cela d’innovant qu’elles peuvent changer et que la mémoire peut être ajournée et modernisée par l’ajout ou l’éviction de faits et de personnages. L’anthropologie historique a évoqué le cas d’un récit originaire du Ghana actuel, plus précisément du royaume de Gonja au nord du pays ; il y est question d’un roi fondateur Ndewura Jakpa qui divisa son royaume en sept districts pour ses sept fils. Puis arrivèrent les Anglais qui colonisèrent cette région autour de 1900 et la divisèrent en cinq districts. Un demi-siècle plus tard, le fondateur, dans les récits génétiques transmis par voie orale, avait perdu deux fils, et les cinq fils dont il était
57 La mémoire de Charles Martel était toutefois très gênée par le fait que la postérité le considérait comme un dilapidateur de biens d’Église. Cf. Ulrich Nonn, « Das Bild Karl Martells in den lateinischen Quellen vornehmlich des 8. und 9. Jahrhunderts », Frühmittelalterliche Studien, 4, 1970, p. 70-137 ; Alain Erlande-Brandenburg, Le roi est mort, op. cit., p. 71.
Livre L'incorporation.indb 51 10/10/2016 16:07:38
Julian Führer
52
question alors permettaient de justifier la nouvelle structure administrative du pays par le passé. Ce récit nous est relaté par l’ethnologue Jack Goody qui renvoie à son carnet de notes personnelles des années 1950 – nous ne pouvons donc rien dire de la fiabilité de cette histoire 58. Mais des stratégies narratives semblables nous sont connues pour le Moyen Âge, et l’histoire des Goths nous est relatée par Jordanès suivant un procédé sensiblement pareil. Dans une perspective comparable, les Mérovingiens étaient intégrés dans la mémoire comme ancêtres des Capétiens, mais seulement au moment où on parlait peu des Mérovingiens comme rois fainéants et où, surtout, il n’y avait plus de Mérovingiens comme concurrents éventuels.
On pourrait évoquer bien d’autres centres d’intérêt dont une approche genrée du discours généalogique 59 : alors que des femmes sont invoquées ou même inventées en vue d’établir un lien entre deux dynasties, elles sont néanmoins exclues de toute participation au pouvoir par ce que les légistes français du xive siècle appellent la Loi salique ; en fait, une autre manière de se servir du discours généalogique, or cette fois non pour inclure, mais pour exclure, en l’occurrence le roi d’Angleterre comme candidat au trône de France 60.
En définitive, nous sommes face à un récit que nous suggère l’existence d’une grande famille royale depuis Clovis jusqu’à Charles X qui aurait gardé le pouvoir entre ses mains depuis le ve jusqu’au xixe siècle et dont les descendants gardent les noms prestigieux d’Eudes, de Louis et de Charles jusqu’à aujourd’hui. Nous avons conservé cette habitude de l’Ancien Régime de parler de rois de la première, de la deuxième et de la troisième race en parlant des Mérovingiens, des Carolingiens et des Capétiens en indiquant par là qu’il y aurait une filiation à peu près ininterrompue depuis Hugues Capet jusqu’à la Restauration (et que les ruptures généalogiques survenues aux xive – xvie siècles seraient en fait des accidents négligeables). Ces récits génétiques reflètent un discours généalogique médiéval. Si l’on feuillette des histoires de la France médiévale, on s’apercevra avec étonnement que celles-ci commencent encore de nos jours souvent avec le baptême de Clovis. L’histoire de la France demeure dans cette perspective très axée sur la généalogie, et c’est un discours identitaire admirablement tenace qui nous laisse encore de nos
58 Hanna Vollrath, « Das Mittelalter in der Typik oraler Gesellschaften », Historische Zeitschrift, 233, 1981, p. 571-594, ici p. 574 sq. ; d’une manière plus générale, cette approche a été rendue fructueuse par Johannes Fried, « Die Kunst der Aktualisierung in der oralen Gesellschaft. Die Königserhebung Heinrichs I. als Exempel », Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 44, 1993, p. 493-503.
59 Voir p. ex. Constance Brittain Bouchard, Those of my Blood. Creating Noble Families in Medieval Francia, Philadelphia 2001, surtout chap. 6 : « Patterns of Women’s Names in Royal Lineages », p. 98-118.
60 En Angleterre, le discours généalogique était très répandu également, cf. Olivier de Laborderie, Histoire, mémoire et pouvoir. Les généalogies en rouleau des rois d’Angleterre (1250-1422), Paris, 2013 (Bibliothèque d’histoire médiévale, 7).
Livre L'incorporation.indb 52 10/10/2016 16:07:38
Du monstre sacré à la mémoire rationnelle ?
53
jours diviser les périodes de l’histoire de France en fonction d’une généalogie établie aux xiiie et xive siècles. Les récits généalogiques ont ceci d’attrayant qu’ils suggèrent une légitimité soi-disant objective et qu’ils permettent de prolonger la légitimité d’une position dans le passé. Cette projection permet aussi de faire oublier des moments difficiles ou des actions indésirables. Le travail mémoriel par la généalogie toujours revue à neuf était donc un instrument idéal et une arme puissante, mais seulement pour une dynastie déjà solidement installée.
Livre L'incorporation.indb 53 10/10/2016 16:07:38