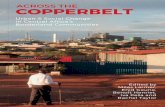Abjects retraités, jeunesse piégée : récits du déclin et d’une temporalité multiple parmi...
-
Upload
maastrichtuniversity -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Abjects retraités, jeunesse piégée : récits du déclin et d’une temporalité multiple parmi...
ABJECTS RETRAITÉS, JEUNESSE PIÉGÉE : RÉCITS DU DÉCLIN ETD'UNE TEMPORALITÉ MULTIPLE PARMI LES GÉNÉRATIONS DE LA« COPPERBELT » CONGOLAISE Timothy Makori et Jean-Nicolas Bach Editions Karthala | Politique africaine 2013/3 - N° 131pages 51 à 73
ISSN 0244-7827
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2013-3-page-51.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Makori Timothy et Bach Jean-Nicolas, « Abjects retraités, jeunesse piégée : récits du déclin et d'une temporalité
multiple parmi les générations de la « Copperbelt » congolaise »,
Politique africaine, 2013/3 N° 131, p. 51-73. DOI : 10.3917/polaf.131.0051
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Editions Karthala.
© Editions Karthala. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ity o
f Tor
onto
-
- 13
8.51
.234
.131
- 3
0/05
/201
4 22
h09.
© E
ditio
ns K
arth
ala
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversity of Toronto - - 138.51.234.131 - 30/05/2014 22h09. ©
Editions K
arthala
Politique africaine n° 131 - octobre 2013
51
Timothy Makori
Abjects retraités, jeunesse piégée : récits du déclin et d’une temporalité multiple parmi les générations de la « Copperbelt » congolaise
Cet article se penche sur les récits du déclin économique que portent deux générations de mineurs au Katanga, en République démocratique du Congo : les retraités du géant industriel minier Gécamines et les jeunes creuseurs artisanaux. Sont analysées les « structures de sentiment » (Raymond Williams) qui caractérisent chacune de ces générations, toutes deux confrontées aux effets matériels et sociaux du déclin industriel et de la libéralisation du secteur minier qui s’en est suivie. Par ces sentiments partagés du déclin contemporain, on voit comment chaque génération vit son positionnement social et son enchevêtrement « dans le temps naissant » (Achille Mbembe). Basé sur les récits des mineurs interrogés quant à leur marginalisation dans ce contexte de libéralisation du secteur, ce travail vient brouiller les périodisations académiques qui privilégient les ruptures au détriment des continuités, entre ères précoloniale, coloniale et postcoloniale.
La libéralisation du secteur minier de la République démocratique du Congo (RDC) en 2002 fut l’aboutissement des privatisations engagées au cours des années 1990 pour répondre au déclin de l’industrie minière nationale1. Réalisée sous l’égide de la Banque mondiale, cette ouverture aux capitaux
1. Les données sur lesquelles se fonde cet article sont issues d’un terrain de recherche ethnogra-phique réalisé en 2009 et en 2011, dans les villes de Likasi et de Kambove. La méthode relève d’une combinaison d’observation participante (dans les carrières proches de Likasi et dans les camps miniers de l’UMHK) et d’entretiens réalisés autour de Likasi (quarante-huit entretiens et discussions auprès de creuseurs, de négociants et de fonctionnaires travaillant dans de petites exploitations minières). Likasi est située dans la province du Katanga de la République démocratique du Congo ; les entretiens furent ainsi intégralement conduits en swahili katangais. Je conserve ici le terme de « copperbelt » en référence à l’importante littérature anthropologique traitant des changements sociaux produits par l’industrie minière dans cette large zone d’extraction du cuivre d’Afrique centrale, dans ses parties zambienne comme congolaise. Cette recherche a été réalisée dans le cadre d’une thèse de doctorat en anthropologie sociale et culturelle à l’Université de Toronto, Canada. Je tiens à remercier les rédacteurs en chef, trois évaluateurs anonymes ainsi que Boris Martin de Politique africaine pour leurs précieuses suggestions. Ce texte n’existerait pas sans le soutien de la famille qui m’a accueilli au Katanga, mais aussi de Donatien Dibwe, Benjamin Rubbers, Aimé Kakudji, olivier Kahola, Pascal Kakudji, Todd Sanders, Janice Boddy, Marieme Lo, Elizabeth Povinelli, Wesley J. oakes, Vivek Freitas, Zuba Wai, Eduardo Quaretta, Anna Kruglova, Chris Little et Janne Dingemans. Toutes les erreurs et omissions sont bien sûr de ma seule responsabilité.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ity o
f Tor
onto
-
- 13
8.51
.234
.131
- 3
0/05
/201
4 22
h09.
© E
ditio
ns K
arth
ala
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversity of Toronto - - 138.51.234.131 - 30/05/2014 22h09. ©
Editions K
arthala
le Dossier
Micropolitiques du boom minier52
étrangers a conduit à la fermeture ou à la cession de plusieurs pans de la compagnie d’État, la Gécamines2. Cet article revient sur ce déclin industriel et plus spécifiquement sur les différentes façons dont deux générations de Katangais ont vécu cette expérience et lui ont donné un sens : d’une part les retraités de la Gécamines et, d’autre part, les jeunes hommes3 travaillant dans les mines en tant que creuseurs ou exploitants artisanaux, dont beaucoup sont les enfants de ces ouvriers de la Gécamines victimes des dégraissages. Placer sur le même plan d’analyse ces deux générations pourtant distinctes se veut une réponse aux injonctions des anthropologues de dépasser les études singulières portant sur des groupes particuliers de même âge – tels que les jeunes, les enfants – pour centrer au contraire l’analyse sur l’âge lui-même, sur les générations, en tant que processus relationnel associé à la reproduction sociale4. Les brusques transformations sociales nées du déclin industriel ont suscité, au sein de certains groupes congolais, des sentiments partagés marquant leur enchevêtrement dans le « temps en train de surgir5 », c’est-à-dire leur vécu du présent comme un mélange d’absences : absences de passés remémorés et absences de futurs espérés qui restent à accomplir. La narration de cet enchevêtrement, autrement dit l’historicité, s’effectue sous la contrainte des idéologies sociales. Elle constitue donc une condition performative ouverte à l’enquête ethnographique et non une donnée objective émanant de descriptions historiques6.
La suite de ce texte répond à un double objectif : dans un premier temps, je reviens sur les idéologies sociales par lesquelles les acteurs ont interprété le déclin industriel et la libéralisation minière, et ce à partir d’une analyse des
2. Générale des Carrières et des Mines. Pour une analyse des conséquences de la libéralisation sur le secteur minier congolais, voir M. Mazalto, « Governance, Human Rights and Mining in the Democratic Republic of Congo », in B. Campbell (dir.), Mining in Africa. Regulation and Development, New York, Pluto Press, 2009, p. 196-197.3. Les creuseurs du Katanga sont majoritairement, voire exclusivement, des hommes. J’ai pu m’en-tretenir, au cours de mes recherches, avec de jeunes hommes travaillant comme creuseurs et dont l’âge allait de 10 ans à 38 ans. Les creuseurs pouvaient travailler de façon relativement indépendante en dehors des concessions minières commerciales, dans des zones définies par l’État comme des exploitations minières artisanales ou de petite taille. Selon certaines estimations, 150 000 hommes et enfants (en deçà de l’âge légal) travailleraient dans les mines katangaises. Voir Global Witness, Digging in Corruption : Fraud, Abuse, and Exploitation in Katanga’s Copper and Cobalt Mines, Global Witness Publishing, 2006, p. 5.4. Sur les générations en anthropologie, voir J. Cole et D. Durham, Generations and Globalization : Youth, Age, and Family in the New World Economy, Bloomington, Indiana University Press, 2007, p. 14 ; E. Alber, S. van der Geest et S. Reynolds Whyte (dir.), Generations in Africa : Connections and Conflicts, Berlin, Lit Verlag, 2008, p. 4-6 ; C. Christiansen, M. Utas et H. Vigh (dir.), Navigating Youth, Generating Adulthood : Social Becoming in an African Context, Uppsala, Nordiska Afrika Institutet, 2006.5. A. Mbembe, On The Postcolony, Berkeley, University of California Press, 2001, p. 16.6. E. Hirsch et C. Stewart, « Introduction : Ethnographies of Historicity », History and Anthropology, vol. 16, n° 3, 2005, p. 262.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ity o
f Tor
onto
-
- 13
8.51
.234
.131
- 3
0/05
/201
4 22
h09.
© E
ditio
ns K
arth
ala
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversity of Toronto - - 138.51.234.131 - 30/05/2014 22h09. ©
Editions K
arthala
Politique africaine
Abjects retraités, jeunesse piégée : récits du déclin et d’une temporalité multiple…53
récits des retraités et des creuseurs katangais. Il s’agit de montrer de quelles façons les changements structurels récents du secteur minier ont généré des « structures de sentiment7 » spécifiques, dans la mesure où chaque génération fait face à sa propre marginalisation dans le nouvel ordre économique. Les deux générations de mineurs partagent l’expérience de l’« abjection » (abjection) – définie par James Ferguson comme l’exclusion de certains groupes d’un imaginaire global8. Cette abjection suscita chez les retraités de la Gécamines une certaine nostalgie pour l’ère coloniale, le sentiment d’une perte, mais leur permit aussi de développer une certaine autonomie (self-reliance). Chez les creuseurs, au contraire, cette même abjection a produit un fort attachement au présent (presentism) : être ici et maintenant, avec une inlassable ardeur, une rugueuse endurance, et la recherche de ce que j’ai appelé « duration » (durating)9. Ainsi, même si les ravages dus à la libéralisation du secteur minier congolais et au déclin du secteur industriel transformèrent profondément la vie des travailleurs, ces bouleversements se répercutèrent différemment au sein des générations successives. Ces expériences propres à chaque génération révèlent la multiplicité du temps ou, selon les mots de Karl Mannheim, la « non-contemporanéité du contemporain10 ».
Cette entrée par la temporalité permet d’interroger les façons dont les sujets pensent, ressentent et donnent sens à leur situation dans ce milieu en restructuration que représente le secteur minier congolais. Pour les retraités de la Gécamines, la libéralisation de l’industrie minière n’était que l’ultime illustration d’une longue série de complots fomentés par l’État et ses élites en vue d’usurper leurs moyens de subsistance et leurs acquis. Mais alors que la libéralisation de l’industrie minière était vue par les retraités comme l’un des nombreux coups portés au mode de vie promu par le paternalisme industriel et l’État-providence, elle représentait pour les creuseurs, à l’inverse, un commencement. La libéralisation minière du Congo a conduit en 2002 à
7. R. Williams, Marxism and Literature, oxford, oxford University Press, 1977, p. 132. Selon cet auteur, les « structures de sentiment » renvoient à des éléments affectifs de la conscience qui demeurent souvent à l’état intime, non reconnu dans leur dimension sociale, mais qui sont susceptibles de présenter, après analyse, un ensemble de caractéristiques dominantes. 8. J. Ferguson, Expectations of Modernity : Myths and Meanings of Urban Life on the Zambian Copperbelt. Berkeley, University of California Press, 1999, p. 236.9. Je remercie Elizabeth Povinelli pour ce néologisme qu’elle m’a suggéré à partir de ce que je lui décrivais. La « duration » n’est pas spécifique aux creuseurs. Elle est un trait que partagent d’autres groupes de l’économie informelle katangaise, et au-delà. Voir P. Petit et G. M. Mutambwa, « “La Crise” : Lexicon and Ethos of the Second Economy », Africa, vol. 75, n° 4, 2005, p. 471-474.10. J. Pilcher, « Mannheim’s Sociology of Generations : An Undervalued Legacy », British Journal of Sociology, vol. 45, n° 3, septembre 1994, p. 486. Voir également K. Mannheim, Essays in the Sociology of Knowledge, Londres, Routledge, 1972 (1ère éd., 1952), p. 276-320.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ity o
f Tor
onto
-
- 13
8.51
.234
.131
- 3
0/05
/201
4 22
h09.
© E
ditio
ns K
arth
ala
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversity of Toronto - - 138.51.234.131 - 30/05/2014 22h09. ©
Editions K
arthala
le Dossier
Micropolitiques du boom minier54
l’adoption par l’État de nouvelles règles destinées aux exploitations minières artisanales, afin de légaliser une pratique qui avait cours depuis près d’une décennie, autrement dit depuis le déclin de la Gécamines et de ses filiales industrielles dans les années 1990. Le fait de placer, dans ce contexte de libé-ralisation en RDC, les retraités de l’Union Minière du Haut Katanga (UMHK) et leurs « enfants » (les creuseurs du Katanga) côte-à-côte dans l’analyse invite à remettre en question certaines approches académiques quant à l’antagonisme entre continuité et rupture11. Cela conduit surtout à nous interroger sur ce qui est réellement « nouveau » dans cette libéralisation récente du secteur minier. Dans une perspective de longue durée, qu’y a-t-il de postcolonial dans le temps présent ? Par ailleurs, que gagne-t-on dans l’analyse des changements du présent en privilégiant l’idée de rupture sur celle de continuité ?
Contextes miniers : entre rupture et continuité ?
L’histoire de la province actuelle du Katanga est étroitement liée à la production du cuivre. Dès les ixe et xe siècles, la production de lingots de cuivre avait fait la renommée des habitants de la savane du Sud de l’actuel Congo. Ces produits seront utilisés comme monnaie d’échange précoloniale jusque dans le royaume Mwene Motapa plus au Sud (dans l’actuel Zimbabwe)12. Ce commerce florissant du cuivre durant la période précoloniale avait suscité par la suite l’intérêt des marchands d’esclaves omani et des Européens au xixe siècle. En 1891, le roi belge Léopold II envoya le capitaine William Stairs en expédition en vue de soumettre le chef yeke, Mwenda Msiri. Ce dernier fut assassiné en raison de son insoumission, et la province du Katanga rattachée à l’État libre du Congo du roi Léopold. L’UMHK vit rapidement le jour, en 1906. Avec la fondation de cette compagnie minière et l’arrivée, quatre ans plus tard, de la ligne de chemin de fer reliant l’Afrique du Sud à Elizabethville (aujourd’hui Lubumbashi), l’industrialisation pouvait commencer.
11. A. Maclintock, « The Angel of Progress : Pitfalls of the Term “Post-Colonialism” », Social Text, n° 31-32, 1992, p. 87 ; A. Mbembe, On The Postcolony…, op. cit., p. 13 ; C. Piot, Nostalgia for the Future : West Africa after the Cold War, Chicago, Chicago University Press, 2010, p. 12-14 ; T. Sanders, « Buses in Bongoland : Seductive Analytics and the occult », Anthropological Theory, vol. 8, n° 2, 2008, p. 107-132.12. Sur le cuivre de la période précoloniale au Katanga, voir E. Herbert, Red Gold of Africa : Copper in Precolonial History and Culture, Madison, University of Wisconsin Press, 1984, p. 49-60 ; M. S. Bisson, « Copper Currency in Central Africa : the Archaeological Evidence », World Archaeology, vol. 6, n° 3, 1975, p. 279-289.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ity o
f Tor
onto
-
- 13
8.51
.234
.131
- 3
0/05
/201
4 22
h09.
© E
ditio
ns K
arth
ala
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversity of Toronto - - 138.51.234.131 - 30/05/2014 22h09. ©
Editions K
arthala
Politique africaine
Abjects retraités, jeunesse piégée : récits du déclin et d’une temporalité multiple…55
Avant la Première Guerre mondiale, les Africains travaillant dans les exploitations minières comme celle d’Elizabethville étaient recrutés de force et placés dans des camps dans lesquels les conditions de vie étaient au mieux « primitives13 ». Afin de dissuader les désertions et d’accroître l’apport de main-d’œuvre, Johannes Fabian mentionne que l’UMHK opta pour une politique paternaliste visant à inciter l’ouvrier noir à « aimer son travail et y rester attaché aussi longtemps que possible »14. Dans chacun des camps de la compagnie, un « chef » tenait un dossier personnel sur tout ouvrier qui y était employé. Il était également en charge de la nourriture et du logement de chacun d’entre eux, payait les salaires, contrôlait les avantages sociaux et engageait des actions disciplinaires au sein même des familles. Le Katanga était ainsi dominé jusqu’à son Indépendance en 1960 par la trinité suivante : des moines bénédictins dispensaient leur formation morale et scolaire aux Africains à l’intérieur des camps15, l’UMHK y assurait tous les besoins de la vie quotidienne et l’administration coloniale belge maintenait l’ordre et la direction des affaires publiques à l’extérieur des camps.
En 1967, le gouvernement du président Mobutu Sese Seko nationalisa l’UMHK, alors rebaptisée Gécamines. L’économie congolaise se dégrada cependant à partir du début des années 1970 en raison des effets conjugués de la crise pétrolière mondiale, de la chute globale du prix des métaux à la fin des années 1980 et du pillage de la rente minière par Mobutu et ses élites. Pour la Gécamines, les répercussions cumulées de telles pressions économiques culminèrent en 1990, avec la faillite de la compagnie minière Kamoto au Katanga16 et la chute subséquente de plus de 93 % de la production de cuivre entre 1987 et 199417. En 2002, l’économie du pays était en ruine, le passif de la Gécamines s’élevant à environ 1,3 milliards de dollars US18. À son arrivée au
13. Voir B. Fetter, The Creation of Elizabethville, 1910-1940, Stanford, Hoover Institute Press, 1976, p. 35.14. J. Fabian, Jamaa. A Charismatic Movement in Katanga, Evanston, Northwestern University Press, 1971, p. 57. J. Fabian reprend ici une formule de L. Motoulle, Politique sociale de L’Union Minière du Haut Katanga pour sa main-d’œuvre indigène et ses résultats au cours de vingt années d’application, Bruxelles, Institut Royal Colonial Belge, 1946, p. 11-12. 15. Selon J. Fabian, Jamaa. A Charismatic Movement…, op. cit., l’Église catholique constituait non seulement le centre de la vie sociale dans les camps de l’Union Minière, mais également l’autorité morale.16. La mine de Kamoto est la plus grande mine à ciel ouvert de RDC, située dans la ville de Kolwezi.17. D. Dibwe Dia Mwembu, Bana Shaba abandonnés par leur père : structures de l’autorité et histoire sociale de la famille ouvrière au Katanga, 1910-1997, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 160.18. Pour une analyse détaillée de l’effondrement de la Gécamines, voir B. Rubbers, « L’effondrement de la Général de Carrières et des Mines », Cahiers d’études africaines, n° 181, 2006, p. 115-133.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ity o
f Tor
onto
-
- 13
8.51
.234
.131
- 3
0/05
/201
4 22
h09.
© E
ditio
ns K
arth
ala
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversity of Toronto - - 138.51.234.131 - 30/05/2014 22h09. ©
Editions K
arthala
le Dossier
Micropolitiques du boom minier56
pouvoir en 2001, le nouveau président Joseph Kabila fut soumis à une très forte pression internationale pour libéraliser le secteur minier. Entre mars 2003 et février 2004, un accord fut négocié avec la Banque mondiale pour le ver-sement de sommes forfaitaires aux ouvriers ayant passé le cap des vingt-cinq ans d’ancienneté à la date du 31 décembre 2002. Les montants étaient les suivants : de 2 000 à 4 000 dollars pour les ouvriers peu qualifiés ; de 8 000 à 15 000 dollars pour les managers ; et de 20 000 à 70 000 dollars pour les directeurs19. Le nom donné à ce plan d’indemnisation soutenu par la Banque mondiale – l’opération Départ Volontaire (oDV) – masquait en réalité le dégraissage de 10 655 ouvriers de la Gécamines. Nombre d’entre eux furent contraints d’accepter leur indemnité de départ en 2003 après trois années passées sans aucun salaire. Entre le début des années 1990, où la compagnie entra dans une crise profonde, et 2003, date à laquelle elle paya ses ouvriers, les familles de ces derniers vivaient du peu qu’elles trouvaient, avec l’espoir que le salaire soit enfin payé par la Gécamines à la fin du mois, ou du mois suivant. Les enfants des ouvriers de la Gécamines souffrirent tout par-ticulièrement de la précarité de leurs parents, si bien que certains jeunes durent s’engager comme creuseurs et ainsi revoir l’avenir qu’ils avaient imaginé, abandonnant les bancs de l’école pour les mines désaffectées de la compagnie.
Comme nous l’écrivions plus haut, ces creuseurs tout autant que ces retraités invitent à repenser l’histoire des événements du Congo conçue comme reposant sur le seul « temps physique20 », selon la formule de Johannes Fabian, c’est-à-dire un temps calendaire insensible aux variations culturelles. Bien qu’en apparence objectif, le temps physique n’est pas, selon Fabian, dépourvu de valeurs, mais bien souvent emprunt de cadres typologiques. Ces typologies organisent les intervalles pertinents entre les événements chargés de sens socioculturel, ce qui permet de parler d’ères « coloniale » et « postcoloniale » ou encore, dans le cas du secteur minier au Congo, d’un « passé industriel » et d’un « présent libéralisé ». Faire ainsi du temps une abstraction n’est pas seulement un moyen heuristique de l’ordonner ; c’est également un moyen de considérer « le nouveau » comme une rupture – indépendamment des continuités et discontinuités configurant les expériences locales du temps. Considérant alors l’histoire tumultueuse qui a vu l’apparition des retraités
19. B. Rubbers, « Claiming Workers’ Rights in the Democratic Republic of Congo : the Case of the Collectif des ex-agents de la Gécamines », Review of African Political Economy, vol. 37, n° 125, 2010, p. 329-344.20. J. Fabian, Le temps et les autres. Comment l’anthropologie construit son objet, Toulouse, Anacharsis, 2006, p. 56-57.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ity o
f Tor
onto
-
- 13
8.51
.234
.131
- 3
0/05
/201
4 22
h09.
© E
ditio
ns K
arth
ala
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversity of Toronto - - 138.51.234.131 - 30/05/2014 22h09. ©
Editions K
arthala
Politique africaine
Abjects retraités, jeunesse piégée : récits du déclin et d’une temporalité multiple…57
et des creuseurs congolais, quel événement précis pourrait figurer cette rupture bouleversant fondamentalement la vie économique du Katanga ? De toute évidence, un événement unique ne peut être générateur de sujets sociaux tels que les retraités et les creuseurs. Peut-on alors, dans une démarche heuristique, « miser sur la rupture » – comme le proposait récemment Charles Piot dans son analyse de l’histoire togolaise21 – dans un pays comme le Congo où les mines continuent fondamentalement à servir des intérêts extérieurs au détriment des Congolais ? Les retraités de la Gécamines et les creuseurs dont je trace ici un portrait ethnographique ne sont que de brefs aperçus de vies bien plus complexes. Néanmoins, plutôt que de situer les récits de mes interlocuteurs dans ce qui serait un cadre clairement délimité de l’histoire congolaise – ères précoloniale, coloniale et postcoloniale –, je m’efforce de montrer comment ils racontent et vivent la vie contemporaine selon des logiques qui confondent souvent de telles périodicités. C’est vers cet emboî-tement des temps que je me tourne désormais, à partir du cas des retraités de la Gécamines.
Nostalgiques laissés-pour-compte : les retraités
de la Gécamines
Les travaux académiques récents sur la « Copperbelt » se sont concentrés sur les causes macro-structurelles et les idéologies pour expliquer le déclin industriel22, la fluctuation des richesses liées à la libéralisation du secteur minier23, les topographies politiques mouvantes en fonction des investissements étrangers24, ou encore les effets des activités minières artisanales sur les
21. C. Piot, Nostalgia for the Future…, op. cit., p. 12-14.22. D. Dibwe Dia Mwembu, Bana Shaba abandonnés par leur père…, op. cit. ; J. Ferguson, Expectations of Modernity…, op. cit. ; B. Rubbers, Le Paternalisme en question. Les anciens ouvriers de la Gécamines face à la libéralisation du secteur minier katangais (RD Congo), Tervuren/Paris, L’Harmattan, 2013.23. A. Fraser et M. Larmer, Zambia, Mining, and Neoliberalism, New York, Palgrave Macmillan, 2010, p. 1-55 ; M. Mazalto, « Governance, Human Rights and Mining… », art. cit., p. 187-230.24. J. Hönke, « Transnational Pockets of Territoriality. Governing the Security of Extraction in Katanga (DRC) », Working Paper Series, n°2, Graduate Centre Humanities and Social Sciences of the Research Academy Leipzig, 2009, <www.uni-leipzig.de/~ral/gchuman/fileadmin/ media/publikationen/Working_Paper_Series/RAL_WP_2_Hoenke_web.pdf> ; J. Jansson, « The Sicomines Agreement : Change and Continuity in the Democratic Republic of Congo’s international relations », Occasional paper, n° 97, South African Institute of International Affairs, 2011 ; C. K. Lee, « Raw Encounters : Chinese Managers, African Workers, and the Politics of Causualization in Africa’s Chinese Enclaves », in A. Fraser et M. Larmer, Zambia, Mining…, op. cit., p. 127-150.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ity o
f Tor
onto
-
- 13
8.51
.234
.131
- 3
0/05
/201
4 22
h09.
© E
ditio
ns K
arth
ala
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversity of Toronto - - 138.51.234.131 - 30/05/2014 22h09. ©
Editions K
arthala
le Dossier
Micropolitiques du boom minier58
dynamiques de genre localisées et les relations familiales25. Les aspirations26 exprimées par les Africains à l’égard du passé colonial industriel n’ont pas été suffisamment prises en compte. Cela s’explique notamment, comme le note William Bissell, par le fait que la nostalgie coloniale est perçue comme une histoire fausse et fictive qui manquerait de distance et d’objectivité27. Comme l’a néanmoins démontré Richard Webner dans ses travaux sur le Zimbabwe, la nostalgie et la mémoire peuvent exercer une influence sur les subjectivités dans les lieux où la commémoration publique du passé a fait l’objet d’une politisation au service d’agendas nationaux, ignorant volon-tairement les identités de certains groupes28. Plutôt que de rejeter cette nos-talgie coloniale, je souhaite éclaircir son « travail » dans des lieux comme le Congo où, pour certains, le contexte postcolonial n’est qualitativement guère meilleur que le colonialisme belge l’ayant précédé. L’étude des récits de retraités permet une telle analyse et montre comment le passé pénètre les luttes ayant cours au Congo.
Lors de mes recherches dans la commune de Panda, dans la ville de Likasi, j’ai pu m’entretenir avec de nombreux anciens ouvriers de la Gécamines29 ayant bénéficié d’une pension ou ayant choisi le « départ volontaire » plutôt que de continuer de travailler pour une compagnie que certains surnommaient le « géant agonisant ». Certaines personnes interrogées, à l’image de Papa David, un retraité de 77 ans ayant travaillé comme chauffeur pour la compagnie,
25. G. Andre et M. Godin, « Child Labour, Agency, and Family Dynamics : the Case of Mining in Katanga (DRC) », Childhood, sous presse en juin 2013, version pré imprimée disponible, <http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/141072> ; J. Cuvelier, Men, Mines, and Masculinities : the Lives and Practices of Artisanal Miners in Lwambo (Katanga Province, DR Congo), thèse de doctorat en anthropologie sociale et culturelle, Université catholique de Louvain, 2011, <https://biblio.ugent.be/input/download?func=downloadFile&recordoId=1863372&fileoId=1863421> ; P. Mususa, « Contesting Illegality : Women in the Informal Copper Business », in A. Fraser et M. Larmer, Zambia, Mining…, op. cit., p. 185-204.26. Une exception est cependant à noter avec l’ouvrage dirigé par R. Werbner, Memory and the Postcolony : African Anthropology and the Critique of Power, Londres/New York, Zed Books, 1998. Voir également B. Rubbers, « The Story of a Tragedy. How People in Haut-Katanga Interpret the Post-Colonial History of Congo », Journal of Modern African Studies, vol. 47, n° 2, 2009, p. 267-289. Pour une approche collective de la mémoire à partir des représentations matérielles, voir J. Fabian, Remembering the Present : Painting and Popular History in Zaire, Berkeley, University of California Press, 1996 et B. Jewsiewicki, « Travail de mémoire et représentations pour un vivre ensemble : expériences de Lubumbashi », in D. de Lame et D. Dibwe Dia Mwembu (dir.), Tout passe : instantanés populaires et traces du passé à Lubumbashi, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 27-40.27. W. C. Bissell, « Engaging Colonial Nostalgia », Cultural Anthropology, vol. 20, n° 2, 2005, p. 224.28. R. Werbner, Memory and the Postcolony…, op. cit., p. 71-100.29. J’ai notamment mené des entretiens semi-directifs, des focus groups, et des observations participantes au domicile de vingt-et-un retraités de la commune de Panda, ville de Likasi, mais aussi de la ville de Kambove, entre mars et octobre 2011 (toujours en swahili du Katanga).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ity o
f Tor
onto
-
- 13
8.51
.234
.131
- 3
0/05
/201
4 22
h09.
© E
ditio
ns K
arth
ala
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversity of Toronto - - 138.51.234.131 - 30/05/2014 22h09. ©
Editions K
arthala
Politique africaine
Abjects retraités, jeunesse piégée : récits du déclin et d’une temporalité multiple…59
se plaignirent de n’avoir reçu leur salaire que de façon très irrégulière à partir des années 1990.
Quand je rendis visite à Papa David, sa maison était dégarnie. La pièce principale était meublée d’un canapé brun en piteux état qui semblait se dédoubler pour permettre à une personne d’y dormir, de deux chaises en bois dépourvues de leur assise, et d’un meuble destiné à héberger une télévision qui manquait. Nous prîmes place un moment dans cette pièce tandis que je me présentai. Mais après quelques minutes, il suggéra que nous poursuivions l’entretien dehors. L’état de sa maison l’embarrassait terriblement, de même que son incapacité à offrir à son invité quelque chose à boire. Nous prîmes alors place sous un arbre dans son petit jardin, à côté de la carcasse évidée d’une voiture rouillée soutenue par des pierres.
Papa David changeait de position sur sa chaise en laissant paraître une certaine inquiétude, puis commença à parler en swahili katangais. Il parlait de façon acerbe, virulente. Il ouvrit pourtant la discussion d’un ton relativement affectueux sur ses quarante-quatre années passées à la Gécamines. Mais il ne put cacher la peine qu’il éprouvait lorsque l’évocation de son passé le renvoyait à sa situation actuelle :
« Nous avons commencé à souffrir en 1998. Nous avions faim en allant nous coucher. Il arrivait que nous ne soyons pas payés pendant quatre mois et nous ne pouvions rien faire, pas même nous plaindre auprès des autorités. Nous avons souffert pendant dix ans. En tant que retraités, nous recevions de la farine de maïs, mais aujourd’hui ce n’est plus le cas. Après avoir travaillé 44 ans, ils m’ont payé 5 000 dollars. La plupart en ont reçu 2 000, mais nous sommes tous pareils. Aucun de nous ne reçoit de la farine de maïs. Nous sommes comme des esclaves. Le colonialisme des Belges était mieux. Regarde les enfants aujourd’hui, ils ne savent pas ce qu’est la viande hachée, les pommes, les ananas ou les bananes. Nous oui. Nous avons grandi en buvant du thé et en mangeant du pain le matin et le bukari [plat à base de maïs] le soir ne nous suffisait pas. À l’époque de l’Union Minière, les enfants allaient à l’école, ils recevaient des uniformes scolaires, des biscuits et du porridge à 10 heures du matin, et leurs parents recevaient de la farine de blé, de la farine de maïs et du poisson [de la compagnie]. […] Je ne supporte pas l’indépendance. Je prends un congé et ils ne me paient pas pendant 4 mois, et je suis indépendant ? Mes arriérés de salaires ne sont pas payés, et je suis indépendant ? Si tu es indépendant tu ne peux pas être d’accord pour travailler trois ou quatre mois sans être payé. Quand tu leur réclames ton argent ils te crient dessus ou te disent : nous te paierons quand la compagnie se réveillera [de la mort]30 ».
30. Entretien avec Papa David, ancien ouvrier de la Gécamines, Likasi, 27 avril 2011. Des pseu-donymes ont été utilisés pour protéger l’identité de mes informateurs.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ity o
f Tor
onto
-
- 13
8.51
.234
.131
- 3
0/05
/201
4 22
h09.
© E
ditio
ns K
arth
ala
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversity of Toronto - - 138.51.234.131 - 30/05/2014 22h09. ©
Editions K
arthala
le Dossier
Micropolitiques du boom minier60
Pendant que je m’entretenais avec Papa David, les habitants de Likasi se préparaient à célébrer le 51e anniversaire de l’Indépendance du Congo, accentuant d’autant plus le sentiment de trahison et de dégradation, le ressentiment et la nostalgie de mon interlocuteur. Papa David comparait sa situation présente à de l’esclavage, reprenant à son compte un discours récurrent chez les personnes âgées du Katanga : « Nous [les Congolais] avons demandé l’Indépendance trop tôt31 ». Le déclin de la Gécamines a contraint certains ouvriers retraités à occuper divers petits emplois à Lubumbashi tels que cireurs de chaussures, gardiens, chauffeurs de taxi, coursiers ou petits vendeurs. Dans des villes plus petites comme Likasi ou Kambove, là où le travail urbain se fait plus rare, nombreux sont les anciens ouvriers de la Gécamines à s’être résignés au travail des champs en zones périurbaines pour se fournir en nourriture32. Les faits avancés par les retraités ou les personnes âgées avec qui j’ai pu m’entretenir semblaient irréfutables : pour la majorité de la classe laborieuse congolaise, la vie s’était considérablement détériorée depuis l’Indépendance en 1960 et ne cessait de se dégrader33. En disant que « le colonialisme belge était mieux », Papa David exprimait une certaine nostalgie de l’ère coloniale dérivant d’une perception commune de la relation entre une période donnée et le déclin de moyens matériels. Nous rejoignons ici l’analyse de Bissell pour qui « une perception linéaire du temps est essen-tielle34 » à l’émergence et au développement d’un sentiment nostalgique : « Le temps doit non seulement être perçu comme inéluctable mais également assimilé à une perte […] de pouvoir et à la dégradation de la situation d’un groupe social donné35 ». Les retraités que j’ai rencontrés se souviennent du kazi (travail salarié) comme déterminant l’organisation de leur vie quotidienne : la capacité de travailler ouvrait l’accès aux camps miniers au sein desquels la compagnie était en mesure de contrôler la vie professionnelle mais aussi privée de ses employés, jusqu’à déterminer quelle église, quelle école et quels espaces de loisirs ces derniers et leur famille devaient fréquenter. Ainsi, la perte de l’emploi salarié de Papa David en 2003, loin d’être perçue par lui
31. Idem.32. Une observation similaire a été faite par B. Rubbers, Le Paternalisme en question…, op. cit., p. 151-159.33. Pour Papa Ngolo, membre actif du collectif des anciens travailleurs et retraités de la Gécamines, sur les 10 655 ouvriers ayant reçu une indemnité de départ en 2003, plus de 4 000 (soit plus de 40 %) seraient depuis décédés suite à des maladies dues à leurs misérables conditions de vie en tant que retraités. Même si je n’ai pas en ma possession de document confirmant ces chiffres, ces déclarations sont néanmoins révélatrices de l’injustice ressentie parmi les retraités à l’égard de cette situation découlant de la libéralisation du secteur minier congolais.34. W. C. Bissell, « Engaging Colonial Nostalgia… », art. cit., p. 221.35. Ibid.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ity o
f Tor
onto
-
- 13
8.51
.234
.131
- 3
0/05
/201
4 22
h09.
© E
ditio
ns K
arth
ala
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversity of Toronto - - 138.51.234.131 - 30/05/2014 22h09. ©
Editions K
arthala
Politique africaine
Abjects retraités, jeunesse piégée : récits du déclin et d’une temporalité multiple…61
comme une libération, fut tout au contraire vécue comme une trahison par laquelle la compagnie reniait son contrat social colonial implicite stipulant son rôle à la fois de « père » et de « mère » des ouvriers36.
Au cours de mes discussions avec les retraités, la nostalgie du passé était souvent marquée d’un discours sur la nourriture, ou son manque. L’angoisse de la faim était un sujet de conversation constant au sein des camps de la Gécamines37. En mentionnant le fait que ses enfants ne connaissaient ni la viande hachée ni les pommes, Papa David exposait de façon très claire sa perception de l’écart entre sa génération (qui avait mangé ces denrées) et celle de ses enfants. Pour Papa David, bien que l’on puisse encore trouver de la viande hachée et des pommes dans les camps, ces produits seraient aujourd’hui devenus inaccessibles pour les plus jeunes essayant quotidiennement de joindre les deux bouts. La compagnie ne fournissant plus de telles denrées aux retraités dans l’incapacité de travailler, ceux-ci ont été contraints de vivre à l’extérieur de la ville afin de cultiver la terre. En moins de trois décennies, les anciens ouvriers de la Gécamines sont ainsi devenus des paysans par nécessité. Certains, comme Papa David et sa femme, admettaient ouver- tement leur aigreur à l’égard de ce travail pénible où manquaient les moyens mécaniques indispensables. Ce n’était guère surprenant de la part de retraités et d’anciens salariés de la Gécamines ayant grandi dans le monde moderne, urbain et métallique des villes. Nombre d’entre eux s’étaient habitués, enfants, aux libertés, aux restrictions et aux rythmes d’une vie urbaine déter minés par leur travail et celui de leurs parents. Les contraintes liées au salariat et à la vie urbaine étaient alors atténuées par la fourniture mensuelle de denrées très appréciées. Ce faisant, l’interruption de ces distributions fut pour certains retraités un marqueur temporel significatif de la chute précipitée de la Gécamines et, par extension, du pays tout entier. La nostalgie coloniale n’était qu’un des aspects d’angoisses bien plus profondes et plus larges, à l’échelle du Congo, des retraités vis-à-vis des anciens contrats sociaux, des attentes partagées entre l’État et ses citoyens, entre les compagnies et leurs employés, mais également entre les parents et leurs enfants.
L’absence de sécurité financière que fournit un travail salarié m’a permis de déceler chez les retraités un profond sentiment d’échec, résultant pour certains de leur incapacité à fournir à leurs enfants un niveau de vie au moins aussi bon que celui dont ils avaient euxmêmes bénéficié à leur âge.
36. Voir D. Dibwe Dia Mwembu, Bana Shaba abandonnés par leur père…, op. cit.37. Pour une analyse plus approfondie des pratiques sociales et des croyances en rapport avec la nourriture au Katanga, voir P. Petit (dir.), Byakula : approche socio-anthropologique de l’alimentation à Lubumbashi. Bruxelles, Académie royale des sciences d’outre-mer, 2004, p. 139-174.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ity o
f Tor
onto
-
- 13
8.51
.234
.131
- 3
0/05
/201
4 22
h09.
© E
ditio
ns K
arth
ala
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversity of Toronto - - 138.51.234.131 - 30/05/2014 22h09. ©
Editions K
arthala
le Dossier
Micropolitiques du boom minier62
D’autres expliquaient cet échec par la fatalité (la volonté de Dieu) ou encore par les lacunes personnelles de leurs enfants. Plus rarement, je rencontrais des retraités voyant dans leur licenciement et leur perte de revenus une oppor-tunité de trouver de nouvelles dispositions pour se conformer à « l’Article 15 », la devise paradigmatique des habitants de Kinshasa qui signifie, en substance : « Débrouillez-vous », ou encore « [qu’importe la façon] allez jusqu’au bout »38. C’était le cas par exemple de Mama Jene, ancienne travailleuse sociale de la Gécamines, qui voyait dans les événements présents l’opportunité d’une évolution personnelle, qu’elle expliquait de la façon suivante :
« Tu dois te battre pour obtenir les choses. Tu dois être indépendant. La Gécamines a fait de nous des gens vraiment fainéants, il nous a tout donné et nous a fait oublier [ignorer] comment lutter. [Aujourd’hui] Tu dois “t’accrocher” si tu veux que tes enfants aient un bon avenir. Mets tes enfants à l’école, et si ça implique que tu doives manger uniquement des légumes parce qu’il n’y a pas de déjeuner, hé bien tu les manges. C’est une vie de rien. Si tu t’assoies et que tu commences à penser à cela, tu meurs… Tu ne dois compter que sur toi-même. Ton enfant a sa propre famille, tu ne peux pas toujours les déranger ; ce serait diriger leur vie39 ».
À l’image des quelques femmes retraitées avec lesquelles j’ai pu m’entretenir, Mama Jene évoque la tension complexe que le déclin postindustriel du pays a instillé dans le contrat générationnel liant les retraités à leurs enfants : t’aides-tu toi-même ou aides-tu tes enfants ? Ces préoccupations n’existaient guère avant le déclin de la compagnie dans la mesure où, il est vrai, cette dernière était tenue de subvenir aux besoins de ceux qu’elle considérait comme ses « enfants ». Mama Jene, comme une poignée d’autres retraitées, vendait depuis sa retraite des vêtements dans un magasin à Likasi et s’enorgueillissait de sa détermination et de son indépendance. En tant qu’ancienne travailleuse de la Gécamines, sa situation était exceptionnelle puisque si elle n’avait eu que quatre enfants, tous étaient allés à l’université et exerçaient un métier dans leur branche d’activité. Son mari avait choisi de partir pour l’Afrique du Sud au milieu des années 1990, ce qui lui avait permis de financer l’affaire de Mama Jene ainsi que les études d’un de ses fils en Inde. Le soutien financier que Mama Jene reçut de sa famille lui permettait de bénéficier d’une assise plus solide que d’autres, comme Papa David, qui avait davantage d’enfants, mais des revenus familiaux plus modestes. Il est difficile de savoir si Mama Jene doit son esprit entrepreneurial et son sens de la réalisation de soi à son
38. Voir P. Petit et G. M. Mutambwa, « “La Crise”… », art. cit., p. 468.39. Entretien avec Mama Jene, ancienne ouvrière de la Gécamines, 29 avril 2011.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ity o
f Tor
onto
-
- 13
8.51
.234
.131
- 3
0/05
/201
4 22
h09.
© E
ditio
ns K
arth
ala
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversity of Toronto - - 138.51.234.131 - 30/05/2014 22h09. ©
Editions K
arthala
Politique africaine
Abjects retraités, jeunesse piégée : récits du déclin et d’une temporalité multiple…63
départ forcé à la retraite ou au soutien de sa famille. Toujours est-il qu’elle a profondément assimilé les idéaux du développement personnel, répondant ainsi aux souhaits de la Banque mondiale et à l’opération Départ Volontaire du gouvernement congolais, et ce plus qu’aucun des autres retraités que j’ai pu rencontrer. En revendiquant son « indépendance », Mama Jene ne voyait le passé ni comme une ressource ni comme une perte envers laquelle elle devait se lamenter ou exprimer une quelconque nostalgie. Le passé était pour elle une invitation au changement.
Mais la question pourtant essentielle des arriérés de salaires non payés aux anciens ouvriers de la Gécamines est éludée dans le discours de Mama Jene. La majorité des retraités avait bien conscience que l’oDV devait servir à se débarrasser de façon sommaire de ces abjects anciens ouvriers du secteur minier au nom de la libéralisation. Dans une déclaration adressée au président de l’Assemblée nationale de la RDC40, le président du Comité des anciens travailleurs de la Gécamines insiste de façon très appropriée sur le sentiment collectif d’injustice ressenti par les retraités :
« Ces hommes et ces femmes qui, en ce vendredi 9 novembre 2007, protestent face à vous, sont des anciens employés de la Gécamines qui ont sacrifiés 30 à 50 ans de leur vie pour un travail pénible, pour le développement de ce pays. Producteur champion de cuivre et de cobalt, ils ont hissé au plus haut les couleurs du drapeau de la République démocratique du Congo dans le monde entier. Ces hommes et ces femmes sont aussi des champions ; ils devraient être cités en modèle quant à la façon dont nous valorisons le travail et recevoir le respect et la reconnaissance qu’ils méritent. Mais ici, en RDC, on les a oubliés, cassés et condamnés à mourir à petit feu, dans l’indifférence la plus totale de ceux qui devraient leur garantir un degré de protection sociale à la hauteur du service qu’ils ont rendu à la nation41 ».
L’image de la mort lente à laquelle succomberaient les anciens ouvriers de la Gécamines illustre bien le déclin industriel du Congo et la paupérisation progressive de ceux qui se perçoivent comme des patriotes. Ce discours est important car il caractérise l’abandon vécu par les anciens ouvriers, comme un effacement de la mémoire (« oubliés »), comme une punition (« cassés »), et finalement comme une annihilation lente et destructrice42. La revendication visant à faire de l’État le garant des vies de ses citoyens devrait être une demande légitime dans un État où la logique de gouvernement se fonde sur
40. La déclaration était un document mettant en avant les effets des licenciements massifs de l’opération Départ Volontaire sur les anciens ouvriers de la Gécamines. 41. Cité dans B. Rubbers, « Claiming Workers’ Rights… », art. cit., p. 335.42. Ibid.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ity o
f Tor
onto
-
- 13
8.51
.234
.131
- 3
0/05
/201
4 22
h09.
© E
ditio
ns K
arth
ala
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversity of Toronto - - 138.51.234.131 - 30/05/2014 22h09. ©
Editions K
arthala
le Dossier
Micropolitiques du boom minier64
la biopolitique43. Selon Foucault, un tel État devrait veiller à garantir les condi-tions de la vie de ses citoyens. Les retraités sollicitent l’État, par l’intermédiaire de ses représentants, en jouant sur ce même registre des soins dus par ces derniers à leurs concitoyens, aux ouvriers, et plus largement à d’autres êtres humains. Il s’agit d’un appel lancé par un citoyen libéral à son souverain : ne me tue pas avec ton indifférence, souviens-toi de mon importance par le passé. L’injonction à agir, à témoigner de la compassion ou de la pitié, est ancrée dans ce qu’Elizabeth Povinelli a nommé une « tension sociale » (social tense) qui suspend le présent et fait appel au passé (ma valeur en tant que citoyen et en tant que travailleur) afin de s’assurer un futur rédempteur44 (la vie plutôt que la mort lente). Mais selon Benjamin Rubbers, même s’il est élaboré de façon à ce qu’il obtienne audience auprès de ceux qui exercent le pouvoir d’État, cet appel à la compassion échoue et les retraités continuent à mourir. Pourquoi cet appel échoue-t-il (et pourquoi d’autres ont-ils échoué avant lui45) et, par conséquent, comment comprendre la mort de sujets qui ne sont pourtant plus invisibles pour le pouvoir en place ?
C’est la « politique de la reconnaissance » – le fait de permettre au sujet libéral de prendre la parole et d’être entendu par le souverain – qui, selon Povinelli, concentre les dommages, de sorte que les revendications éthiques et politiques se dissolvent46. Parce que les « sujets de la reconnaissance [ici les retraités] sont appelés à présenter une différence sous une forme qui res-semble à de la différence, mais qui ne permet pas à une réelle différence de se confronter à un monde normatif47 ». Autrement dit, les retraités peuvent obtenir le droit d’exprimer leurs revendications, mais leurs demandes concrètes ne pourront remettre en cause le statu quo. Au moment où les retraités expriment leurs revendications aux représentants de l’État, leur souffrance présente est mise entre parenthèses ; cette souffrance est soit présentée comme une erreur du passé (« nous avons fait ce que nous pou-vions »), soit complètement ignorée. Dans les deux cas, le temps social de l’altérité – ma souffrance présente – se trouve suspendu ou mis au secret dans un plusqueparfait, afin que l’attention puisse porter sur la sécurisation du
43. M. Foucault, The Birth of Biopolitics. Lectures At The College de France, 1978-1979, New York, Palgrave Macmillan, 2008.44. E. Povinelli, Economies of Abandonment : Social Belonging and Endurance in Late Liberalism, Durham, Duke University Press, 2011. Voir également B. Rubbers, « Claiming Workers’ Rights… », art. cit., p. 335. Plutôt que de souligner l’urgence explicite des revendications collectives, mon intérêt se focalise ici sur la tem poralité de la revendication à la lumière de l’idéologie politique libérale.45. Pour des passages et des résumés des rapports, des notes et des déclarations présentés au Panel d’inspection de la Banque mondiale, voir B. Rubbers, « Claiming Workers’ Rights… », art. cit. 46. E. Povinelli, Economies of Abandonment…, op. cit., p. 30.47. Ibid.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ity o
f Tor
onto
-
- 13
8.51
.234
.131
- 3
0/05
/201
4 22
h09.
© E
ditio
ns K
arth
ala
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversity of Toronto - - 138.51.234.131 - 30/05/2014 22h09. ©
Editions K
arthala
Politique africaine
Abjects retraités, jeunesse piégée : récits du déclin et d’une temporalité multiple…65
futur (« nous verrons ce que nous allons faire »). Plus d’une décennie après le début des plans de licenciements de l’oDV, les anciens ouvriers de la Gécamines n’ont toujours pas été payés de leurs arriérés de salaires et en dépit de leurs fervents appels, ni la Banque mondiale ni l’État n’ont envisagé de solution pour faire face à leurs demandes. Ils sont enchevêtrés dans le temps naissant : le fait de leur présence, leur subjectivité même, rappellent de façon cruelle l’absence de reconnaissance, de respect et de mémoire dont ils souffrent, eux qui ont œuvré si dur pour la nation mais qui, aujourd’hui, sont réduits au statut d’êtres abjects.
Quel futur ? Le temps naissant des creuseurs
Parmi les clichés politiques martelés à l’occasion des élections de 2011, on trouvait : « La jeunesse est l’avenir de demain, donc votez pour Joseph Kabila »48. Ce qui signifiait de façon implicite : « Ne votez pas pour Étienne Tshisekedi, ce vieil homme, relique d’un temps révolu, car s’il est élu, il nous ramènera au temps de l’échec ». De toute évidence, les programmes politiques des deux candidats étant construits sur une opposition ethnique artificielle entre Luba du Katanga et Luba du Kasai (puisqu’il s’agit de la même commu-nauté), il s’agissait de camoufler cette logique en définissant l’affrontement comme un conflit de génération : les jeunes (le futur prometteur) contre les anciens (l’échec du passé). Ici, le temps présent fut mis entre parenthèses en tant que terrain de contestation alors que toute relation entre passé et futur restait voilée. Essayons de lever le voile sur cette génération arrivée à maturité au lendemain du déclin industriel : la génération de jeunes Congolais urbains et périurbains.
Comparée aux autres grandes villes congolaises, Likasi est une ville relativement calme, encastrée à l’intérieur d’une vallée plane et parsemée de surprenantes collines aux pentes abruptes. Mis à part le bruit de l’autoroute à deux voies liant Likasi à Lubumbashi, ce sont les cliquetis et le fracas métallique du site de la Gécamines à Shituru (en périphérie de la ville) qui dominent la vie urbaine du matin jusqu’au soir. Après un mois de terrain passé à Panda, cette commune de Likasi déjà évoquée, je fus surpris lorsque le calme ordinaire du matin fut interrompu par des coups de feu. La famille qui m’hébergeait alors m’assura qu’il ne s’agissait que de tirs de sommation des gardiens de la compagnie envers les voleurs occasionnels venus piller les résidus de ferrailles ou des minerais non transformés à l’usine de la Gécamines.
48. Timothy Makori, notes de terrain, Likasi et Lubumbashi, mars-octobre 2011.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ity o
f Tor
onto
-
- 13
8.51
.234
.131
- 3
0/05
/201
4 22
h09.
© E
ditio
ns K
arth
ala
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversity of Toronto - - 138.51.234.131 - 30/05/2014 22h09. ©
Editions K
arthala
le Dossier
Micropolitiques du boom minier66
J’appris par la suite que les auteurs de ces vols, des jeunes, provenaient de Panda et Shituru. Ils comptaient parmi eux des enfants d’anciens ouvriers de la Gécamines ayant fait de la récupération, du vol, de la revente de métaux et de déchets de minerais une activité à plein temps. Officiellement, ces vol étaient considérés comme des actes criminels, mais à en croire les résidents des camps miniers, les coups de feu ne dissuadaient guère les voleurs, de même qu’il leur paraissait peu probable que les gardiens ne les arrêtent. C’est après plusieurs mois passés à Likasi que je pris conscience de ce qui se disait dans les camps miniers, à savoir que ces vols se produisaient grâce à la « sécurité », plutôt que malgré elle. Ces jeunes avaient fait du chapardage de la compagnie une véritable activité professionnelle. La Gécamines était à son tour considérée comme une ressource, de la même manière qu’elle-même considérait les collines qu’elle creusait et les personnes qu’elle exploitait.
Afin de me familiariser avec le monde de la mine audelà des centres urbains, j’effectuais des visites quotidiennes dans une mine artisanale en banlieue de Likasi. J’y fis la connaissance de nombreux jeunes hommes travaillant comme creuseurs, mais rares furent ceux qui eurent la patience de me confesser les raisons de leur venue à la mine. L’un d’entre eux, âgé de 36 ans et que je nommerai ici Mulenda, accepta de m’accorder un peu de son temps. Il me fut présenté comme le vice-président des creuseurs de la mine de cuivre de Kamatanda, où je faisais de nombreuses visites hebdomadaires. Il vivait avec sa femme et leurs quatre enfants dans un village proche de la mine. Électricien qualifié, Mulenda avait fait ses études à l’école technique dont il était diplômé, mais n’était jamais parvenu à trouver un travail dans son domaine de formation. Son père, retraité, était un ancien contrôleur de billets de la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC). Né à Lubumbashi, Mulenda a vécu l’essentiel de sa vie avec ses sept frères dans le camp de la SNCC. Il était né et avait grandi au milieu de l’extraction de ressources, dans le paysage urbain industriel du Sud Congo.
Quand nous nous sommes rencontrés, Mulenda avait passé les treize années précédentes à travailler comme creuseur. Il était éloquent, très poli et ses compagnons avaient beaucoup de considération pour lui. Ceux-ci l’ayant élu vice-président de l’association des creuseurs de la mine de Kamatanda, ce fait attisa ma curiosité. Je lui demandai ce qui le conduisit à devenir creuseur, ce à quoi il répondit :
« J’ai fait des études pour être électricien, mais il était difficile de trouver un travail. Il faut connaître quelqu’un… La situation à la maison était grave, ce qui m’a contraint à chercher un travail à la mine. Beaucoup d’entre nous ont un diplôme, mais pas de travail. Nous ne tirons pas les bénéfices des études aujourd’hui, mais demain peut-être. Pour moi,
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ity o
f Tor
onto
-
- 13
8.51
.234
.131
- 3
0/05
/201
4 22
h09.
© E
ditio
ns K
arth
ala
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversity of Toronto - - 138.51.234.131 - 30/05/2014 22h09. ©
Editions K
arthala
Politique africaine
Abjects retraités, jeunesse piégée : récits du déclin et d’une temporalité multiple…67
le creusage est une activité risquée et je ne sais pas si je pourrai un jour quitter ce travail. Je me considérais comme ayant un don [pour le creusage], j’ai commencé ce travail et j’y ai consacré un long moment de ma vie, j’y suis habitué. J’attends d’avoir assez d’argent pour acheter une maison et un commerce. Peut-être 15 000 ou 20 000 dollars49 ».
Mulenda expliquait s’être accoutumé à ce travail en raison du salaire mensuel que cela lui procurait. Un jour normal lui permettait de ramener à la maison environ 15 000 francs congolais (FC), soit environ 16 dollars. Le jour de notre rencontre avait été particulièrement mauvais pour lui puisqu’il n’avait gagné que 4 500 FC (5 dollars). Il me confia avoir besoin d’environ 8 dollars par jour pour couvrir les besoins quotidiens de sa famille, la nourriture pour l’essentiel. Mulenda faisait partie des quelques rares creuseurs propriétaires du puits dans lequel il creusait. Il était ainsi tenu de payer ceux qui y travaillaient, de couvrir leurs frais de nourriture ainsi que les équipements nécessaires, soit vingt dollars par jour pour une équipe. Si le matériel utilisé dans les mines artisanales n’était pas cher, il nécessitait un remplacement constant. Les pelles, les seaux, les burins et les lampes s’usent constamment, se cassent ou se perdent. Pour un creuseur, posséder un puits de mine au Katanga implique un investissement personnel et financier considérable sans garantie toutefois que le puits ait une teneur élevée en minerais de cuivre, de cobalt ou d’or et qu’il soit ainsi rentable. Pour la majorité des creuseurs que j’ai rencontrés, creuser était une activité à haut risque et à faible revenu, rendant tout projet familial particulièrement difficile. La femme de Mulenda complétait les revenus du ménage grâce au petit commerce qu’elle tenait juste à côté de leur maison de toile, vendant de l’eau, des cigarettes, du savon, des sucreries, des collations ou encore des sachets de whisky aux autres creuseurs et aux habitants du village.
Le caractère incertain des revenus que pouvait tirer Mulenda en tant que creuseur ne lui permettait pas de se projeter dans l’avenir ni pour lui et son affaire, ni même pour ses enfants. Faciliter l’accès à l’éducation de ses deux enfants, en âge d’aller à l’école, aurait impliqué pour Mulenda et toute sa famille de quitter les carrières, de trouver une autre source de revenus. Et travailler en tant qu’ouvrier minier ailleurs ne permettrait pas non plus à Mulenda de couvrir ses frais et ceux de sa famille. Mulenda me semblait pris au piège des carrières et sa détermination de plus en plus forte pouvait s’expliquer par cet espoir que l’avenir lui offre enfin ces 15 000 dollars – près de mille fois son gain journalier. C’est ce type d’histoire ordinaire que se
49. Entretien avec Mulenda, creuseur dans la mine de Kamatanda, Likasi, 9 mai 2011.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ity o
f Tor
onto
-
- 13
8.51
.234
.131
- 3
0/05
/201
4 22
h09.
© E
ditio
ns K
arth
ala
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversity of Toronto - - 138.51.234.131 - 30/05/2014 22h09. ©
Editions K
arthala
le Dossier
Micropolitiques du boom minier68
racontaient les creuseurs entre eux et sur eux-mêmes. Cette idée selon laquelle « très bientôt nous allons être riches » conduisait beaucoup de jeunes hommes de mines en mines, à la recherche de cette roche insaisissable qui mettrait un terme à leurs souffrances. Mais après plus d’une décennie consacrée à la rechercher, cette roche n’était pas apparue à Mulenda. La précarité de sa vie quotidienne l’avait privé de nombreuses possibilités, l’amenant à tourner ses ambitions vers des futurs imaginaires souvent en contradiction avec les structures historiques produisant sa réalité contemporaine. Miser sur la fortune grâce à la sorcellerie ou à une extraordinaire découverte de minerais était un moyen d’endurer les aléas du quotidien dans les mines.
Rêver était indispensable à qui voulait échapper à cette inertie – ce cycle de vie se répétant jour après jour. Autrement dit, une « structure de sentiment » dominante chez de nombreux jeunes travailleurs de la mine était celle du « rêveur ». Le « rêveur » déplace la pesanteur des conditions matérielles déterminant sa vie vers un horizon futur de tous les possibles. Rompre de façon radicale avec la mine était considéré comme un moyen de « réussir » sa vie. Ainsi, l’ambition consistant à quitter le Congo pour aller vers le sud, c’est-à-dire l’Afrique du Sud, était imaginée comme une étape clé, comme la voie à suivre. J’avais été relativement proche d’une famille vivant dans les camps de la Gécamines et qui, ayant envoyé six de ses neuf fils en Afrique du Sud, était en quelque sorte devenue porte-parole de son quartier. Aucun de ces fils n’était revenu au Congo depuis, pas même pour rendre visite à leur famille. Mais tous les autres, ceux qui n’avaient pu partir, furent condamnés à souffrir, à l’image des nombreux enfants et petits enfants des retraités et anciens ouvriers dont la vie se définissait par la peine endurée dans un lointain périurbain ou dans des enclaves rurales où les maisons sont faites de bâches. on n’y trouve ni électricité, ni eau courante, ni canalisations, et les services sociaux disponibles s’y réduisent aux activités proposées par les restaurants, les bars et les boutiques. Les motos – bajaj – y transportent tout, du matelas aux caisses de bière. Et si une chose ne peut être transportée ainsi, les creuseurs considèrent alors souvent qu’elle « n’est pas nécessaire ». Bintu apa il faut kuwa portable (« Ici, tout doit être transportable »). L’exigence de portabilité des personnes comme des biens renseigne sur la nature éphémère de ces espaces. Les débats dans la littérature classique portaient sur les permanences, sur l’urbanisation ou encore sur l’esprit cosmopolite qui caractérisaient la Copperbelt. Ces débats évoluent aujourd’hui dans le contexte des mines artisanales qui s’y sont multipliées et où règnent le provisoire et une ruralisation croissante.
Particulièrement dans les carrières reculées du Katanga, le travail est guidé par des principes semblables à ceux de la contrebande de diamants des Bana
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ity o
f Tor
onto
-
- 13
8.51
.234
.131
- 3
0/05
/201
4 22
h09.
© E
ditio
ns K
arth
ala
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversity of Toronto - - 138.51.234.131 - 30/05/2014 22h09. ©
Editions K
arthala
Politique africaine
Abjects retraités, jeunesse piégée : récits du déclin et d’une temporalité multiple…69
Lunda pour qui « Le français ne paie pas50 ». En d’autres termes, il n’existe pas de rapport systématique entre l’éducation (exprimée notamment par la maîtrise de la langue française), le statut et la prospérité. Les creuseurs vous en donneront pour preuve leurs collègues : les diplômés ou ceux dont les parents font parties des élites de la société congolaise se mêlent aux anciens enfants soldats et aux officiers militaires venus travailler sans permission. Le mélange des classes sociales dans les carrières est stupéfiant. Comme l’a montré Jeroen Cuvelier, les jeunes hommes laissent derrière eux leur statut social et leurs origines familiales au moment où ils entrent dans la mine51. En y pénétrant, Mulenda et bien d’autres avec lui, physiquement et maté-riellement éloignés de leurs proches restés en ville, n’avaient d’autre issue que la solidarité avec leurs semblables déchus. Leurs espoirs reposaient désormais sur un futur irréalisable, sur cette roche introuvable.
Les qualités de Mulenda ne se limitaient pas à ses vulnérabilités ou à son attachement irréaliste à une richesse à venir. La vie dans les carrières est certes structurée par les carences matérielles, mais ces dernières ont engendré une diversité de comportements et de modes de pensée qui pouvaient parfois précisément entretenir ce manque. Prenons le cas d’olivier, un jeune homme de 21 ans originaire d’une famille de douze enfants. Son père, Papa Kalenga, était mon voisin et travaillait comme modeste ouvrier agricole de la Gécamines à Likasi. Papa Kalenga me présenta à son fils après avoir entendu dire que je conduisais des recherches sur les petites exploitations minières. À peine ren contrai-je olivier que son père précisa qu’il était essentiel pour ce dernier de quitter les carrières. Pour Papa Kalenga, les carrières n’étaient pas un endroit où élever des enfants, et olivier en avait déjà deux, ainsi qu’une femme. Il était donc temps que son fils fasse du bienêtre de sa famille une priorité. Souriant à son père, olivier m’expliqua qu’il n’y avait aucun autre endroit au Congo en dehors des carrières où l’on pouvait espérer gagner 300 dollars par semaine. Cette somme représentait environ le revenu mensuel de Papa Kalenga qui avait travaillé 31 ans au service de la Gécamines. Agacé par l’arrogance de son fils, Papa Kalenga voulut savoir où allait tout cet argent gagné, l’ayant justement surpris la veille à demander de l’argent pour acheter à manger et payer son transport pour retourner aux carrières. Imperturbable, olivier regarda son père et nous dit sans aucune gène qu’il était sans le sou parce qu’il avait dépensé tout son argent à boire, à faire la fête et à payer des prostituées. « Pourquoi ? », demandai-je. Il répondit : « Parce que je sais que
50. F. de Boeck, « Domesticating Diamonds and Dollars : Identity, Expenditure and Sharing in Southwestern Zaire (1984-1997) », Development and Change, vol. 29, n° 4, 1998, p. 803.51. J. Cuvelier, Men, Mines, and Masculinities…, op. cit., p. 298.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ity o
f Tor
onto
-
- 13
8.51
.234
.131
- 3
0/05
/201
4 22
h09.
© E
ditio
ns K
arth
ala
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversity of Toronto - - 138.51.234.131 - 30/05/2014 22h09. ©
Editions K
arthala
le Dossier
Micropolitiques du boom minier70
demain je redescendrai dans la terre et que nous sortirons exactement autant de cobalt que le jour d’avant. Les richesses proviennent de la terre, et elles sont inépuisables52 ».
Paradoxalement, olivier avoua son sentiment selon lequel, quoiqu’intaris-sables, ces richesses lui semblaient maudites, car tout l’argent gagné dans les carrières « disparaissait, tout simplement ; cet argent part toujours tellement vite53 ». J’appris plus tard qu’il avait accepté de s’entretenir avec moi ce jour- là parce qu’il avait justement besoin de 3 000 FC (environ 4 dollars) pour retourner aux carrières. Je lui demandai pourquoi il pensait que ces richesses étaient maudites. Il répondit qu’il avait l’impression que les creuseurs n’avaient pas d’autre choix que de dépenser tout leur revenu sur le site où se trouvait la carrière. Il soupçonnait la présence d’esprits locaux (mizimu) contrôlant les lieux où se trouvent les mines. La nuit, pour être en sécurité dans les pro-fondeurs de la mine, olivier me dit avoir un dawa – un sortilège/fétiche – le protégeant des éboulements. Comme d’autres creuseurs, olivier pouvait travailler à n’importe quel moment du jour ou de la nuit. Sa peur des esprits était fondée sur une économie morale des mines percevant l’accumulation de façon négative, comme une sorte de blocage empêchant toute réciprocité. À partir des travaux de Marcel Mauss sur le don, Filip de Boeck54 note que ces restrictions sont souvent, dans les croyances populaires congolaises, perçues comme un signe de sorcellerie dans la mesure où la réciprocité impliquée par le don se trouve alors enfermée dans une transaction uni directionnelle dont l’accès est restreint. En ce sens, celui qui accumule sans redistribuer peut devenir suspect : il pourrait être un sorcier. Par ailleurs, dépenser était tout autant une façon d’établir des relations entre creuseurs que de les mesurer. Les travailleurs de la mine, ne voulant pas dépenser leur revenu en compagnie de leurs collègues, semblaient engagés dans une forme négative d’accumulation. Il incombait donc à chacun soit de cacher ses richesses, soit de les dépenser sans compter. olivier avait visiblement choisi cette dernière possibilité. S’il était bel et bien possédé, ce fut par l’esprit du « donner ».
Les dépenses coutumières d’olivier contrariaient certes son père, mais elles confirmaient surtout l’idée admise localement que le creusage conduisait à la voyoucratie55 – une sous-culture locale caractérisée par l’indécence,
52. Entretien avec olivier, creuseur dans la mine de Kamwale, Likasi, 17 avril 2011.53. Idem.54. F. de Boeck, « Domesticating Diamonds and Dollars…», art. cit., p. 790.55. Le terme de voyoucratie proposé par Benjamin Rubbers fait référence à une contre-culture au sein de la jeunesse du Katanga. Voir B. Rubbers, Le Paternalisme en question…, op. cit., p. 220. Pour une description des creuseurs comme voyous, voir également J. Cuvelier, Men, Mines, and Masculinities…, op. cit., p. 69.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ity o
f Tor
onto
-
- 13
8.51
.234
.131
- 3
0/05
/201
4 22
h09.
© E
ditio
ns K
arth
ala
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversity of Toronto - - 138.51.234.131 - 30/05/2014 22h09. ©
Editions K
arthala
Politique africaine
Abjects retraités, jeunesse piégée : récits du déclin et d’une temporalité multiple…71
le mépris de l’autorité, la décadence et l’excentricité fondés sur l’autonomie financière tirée des revenus de l’artisanat minier. À propos des creuseurs, Benjamin Rubbers note que le caractère voyou relève d’une forme de façon-nement personnel antagonique aux valeurs sociales, aux conventions et à la hiérarchie, qui étaient les traits du paternalisme colonial de l’ordre social instauré par la Gécamines. Alors que l’image sociale des creuseurs du Katanga s’est surtout construite autour de cette image du voyou, l’activité quotidienne du creusage – son organisation communautaire, ses techniques rudimentaires de l’extraction de minerais et, plus particulièrement, les relations spirituelles que les jeunes hommes entretiennent avec la terre – sont autant de marqueurs essentiels du passé précolonial du Katanga. Il s’agit d’un passé où le travail de la mine était pratiqué par « les mangeurs de cuivre » – une corporation particulière (société secrète) de mineurs précoloniaux du Congo du Centre et du Sud, ayant développé des techniques d’extraction minière, de fonte et de forge56. Plus récemment, le recours à des rituels et des pratiques bien définies afin d’apaiser les esprits de la montagne en colère et pour « libérer » les creuseurs avalés suite à des éboulements révèle en partie l’importance croissante, au sein des exploitations minières artisanales, d’une connaissance spirituelle de la mine vieille de plusieurs siècles. Maintenir ces liens pré-coloniaux est également un moyen concret de revendiquer une autoch- tonie, exprimée également de la façon suivante par les creuseurs et d’autres Katangais : « La terre appartient aux ancêtres » (bulongo ni ya bankambo)57. Ainsi, ceux qui revendiquent un lien ancestral au local disposeraient d’un droit inaliénable sur la terre. C’est ici même que se situe l’enchevêtrement du creusage dans le temps naissant : son économie morale demeure déterminée par des croyances et des prétentions remontant à plusieurs siècles, alors que le creusage en tant que pratique sociale n’apparut qu’au lendemain de l’industrialisation, avec précisément pour ambition de moderniser, de remplacer, voire de renier les pratiques culturelles indigènes de long terme. La résistance et l’expérience de la duration représentent des structures de sentiment chez les creuseurs, liant les futurs et les passés de manière à ce que les rêves de richesses et les trésors introuvables restent imaginables, pour Mulenda, olivier et d’autres, tant que les valeurs sociales communautaires et les relations ancestrales à la terre seront respectées et maintenues.
56. M. de Hemptinne, « Les “Mangeurs de cuivre” du Katanga », Congo, Revue générale de la colonie belge, tome 1, n° 3, mars 1926, p. 371-403, <www.congomines.org/wp-content/uploads/2011/10/DeHemptinne-1926-MangeursDeCuivre.pdf>.57. Sur les appels à l’autochtonie chez les creuseurs, voir J. Cuvelier, « Between Hammer and Anvil : The Predicament of Artisanal Miners in Katanga », in A. Ansoms et S. Marysse (dir.), Natural Resources and Local Livelihoods in the Great Lakes Region, New York, Palgrave MacMillan, 2011, p. 215-234.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ity o
f Tor
onto
-
- 13
8.51
.234
.131
- 3
0/05
/201
4 22
h09.
© E
ditio
ns K
arth
ala
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversity of Toronto - - 138.51.234.131 - 30/05/2014 22h09. ©
Editions K
arthala
le Dossier
Micropolitiques du boom minier72
Il existe un paradoxe dans l’expérience du déclin industriel au Congo. La téléologie d’un temps linéaire, fait de progrès sociaux, téléologie pour laquelle la modernité industrielle coloniale a tant œuvré, a été évidée de deux façons distinctes. La génération de retraités et anciens ouvriers de la Gécamines a tenté de retrouver un temps précédent l’époque postcoloniale, idéalisé et perçu comme une ressource en vue de dédommagements futurs, alors que leurs descendants, les creuseurs, se trouvent fermement ancrés dans l’espace et le temps du présent. Quant à la perspective de l’État, elle peut sembler – du moins en ce qui concerne le secteur minier – ne pas considérer le passé des retraités ni le présent des creuseurs. Mais sa position semble plutôt se situer dans un futur rédempteur. En tant qu’arbitre des différents intérêts, l’État aurait mis entre parenthèses les tensions sociales de sa population, jugées asynchrones avec un futur néolibéral imaginaire dans lequel les intérêts commerciaux privés surpassent les intérêts publics.
L’aliénation spatiale des creuseurs des milieux ruraux reculés, l’éloignement de leurs réseaux de proches, ainsi que leur marginalisation économique liée à la libéralisation du secteur minier congolais représentent le microcosme d’une rupture plus large entre une cohorte de jeunes et leurs « pères », la génération des ouvriers industriels salariés. Le conflit autour du comportement social des jeunes hommes mineurs évoque un écart non seulement physique mais également idéel, dans la mesure où chaque génération s’évertue à ordonner le présent, à lui donner un sens et une cohérence. La nostalgie, l’autonomie et la résistance émergent de l’agonie du présent, comme « structure de sentiment ». Elles dévoilent les façons dont les passés précoloniaux et coloniaux continuent à définir les temps, avec une telle ténacité qu’il devient difficile de parler d’un temps postcolonial dans les enclaves d’extraction de ressources en Afrique n
Timothy Makori
Département d’anthropologie – Université de Toronto
Traduction (anglais) : Jean-Nicolas Bach
AbstractAbject Pensioners and Entrapped Youth: Narratives of Decline and the Multiplicity of Times among Generations in the Congo CopperbeltThis article looks at narratives of economic decline among two generations of
mineworkers in Katanga province, DR Congo: the pensioners of the industrial mining
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ity o
f Tor
onto
-
- 13
8.51
.234
.131
- 3
0/05
/201
4 22
h09.
© E
ditio
ns K
arth
ala
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversity of Toronto - - 138.51.234.131 - 30/05/2014 22h09. ©
Editions K
arthala
Politique africaine
Abjects retraités, jeunesse piégée : récits du déclin et d’une temporalité multiple…73
giant, Gécamines, and creuseurs, young men working as artisanal diggers. The author analyzes the “structures of feeling” informing the lives of individuals in these two generations of mineworkers as each deals with the material and social effects of industrial decline and the subsequent liberalization of the mining sector in Congo. He shows that the shared thoughts and sentiments of contemporary decline reflect how individuals in each mineworker generation experience their social emplacement and “entanglement in time” (Achille Mbembe). Based on his informants’ narratives of marginalization that come in the wake of the liberalization of mining sector, the author argues that social decline in Congo confounds the strict scholarly framings of periodicity that foreground rupture – rather than continuity – between the pre-colonial, colonial, and post-colonial eras.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ity o
f Tor
onto
-
- 13
8.51
.234
.131
- 3
0/05
/201
4 22
h09.
© E
ditio
ns K
arth
ala
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversity of Toronto - - 138.51.234.131 - 30/05/2014 22h09. ©
Editions K
arthala