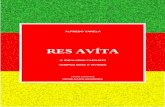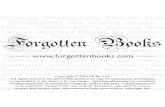La temporalité dans le livre I des Histoires de Tacite
Transcript of La temporalité dans le livre I des Histoires de Tacite
Fabrice Galtier
La temporalité dans le livre I des Histoires de TaciteIn: Vita Latina, N°168, 2003. pp. 38-46.
Citer ce document / Cite this document :
Galtier Fabrice. La temporalité dans le livre I des Histoires de Tacite. In: Vita Latina, N°168, 2003. pp. 38-46.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/vita_0042-7306_2003_num_168_1_1137
La temporalité dans le livre I des
Histoires de Tacite
Dans un article consacré à William Faulkner, Jean-Paul Sartre constatait que tous les grands auteurs du xx* siècle avaient, chacun à leur manière, tenté de mutiler le temps, le privant de l'une ou l'autre de ses composantes (1). Une telle volonté ne peut
pas se manifester dans l'œuvre tacitéenne, dont les enjeux sont liés à un genre - l'historiographie - et à un moment historique - les débuts de l'Empire - tout autres que ceux considérés par Sartre. Il n'en demeure pas moins que les Histoires, œuvre d'un immense écrivain, témoignent d'une vision particulière du temps. Un examen du livre I permet en effet de mettre en valeur la manière dont Tacite joue avec la chronologie des événements et instaure dans son récit, à travers un rythme fait de tensions et de
une temporalité tragique.
I. Histoire et anachronie
Lorsque Cicéron, par la bouche d'Antoine, édicté les lois du genre historiographique, il signale que les faits, pour être intelligibles, doivent être rapportés dans l'ordre
: rerum ratio ordinem temporum desiderat (2). Cette démarche de bon sens, qui correspond d'ailleurs à la logique de la narratio, est-elle suivie par Tacite ?
Une première réponse nous est fournie par la brève phrase qui ouvre la préface : ini- tium mihi operis Seruius Galba iterum, Titus Vinius consules erunt. De nombreux
ont souligné qu'en indiquant comme point de départ de sa chronique le jour des calendes de 69, date de l'entrée en charge des consuls, l'historien affichait
sa volonté de suivre les principes traditionnels de la composition annalistique, même si le titre et le sujet de son œuvre renvoyaient au genre de Yhistoria. Cela implique qu'il s'impose comme règle d'évoquer les événements année par année. Cependant, une fois ce cadre général défini, l'auteur se permet, à plusieurs reprises,
38
d'enfreindre l'ordre chronologique, quitte d'ailleurs à relater parfois des événements qui se situent hors de l'année qu'il est censé évoquer.
Ainsi, les chapitres 4 à 11, qui exposent au lecteur le tableau de la situation à Rome et dans les provinces en janvier 69, rappellent plusieurs faits antérieurs, notamment la fin de Néron et la marche de Galba sur Rome, qui se situent dans la deuxième moitié de l'année 68. Tacite se voit donc contraint de sortir d'emblée du cadre qu'il s'est fixé, du fait même que la structure annalistique lui permet seulement de raconter les deux
semaines du règne de Galba. L'historien développe ensuite un premier épisode, où il concentre toute son attention sur le coup d'état fomenté par Othon et la mort du vieil empereur. Ce n'est qu'au chapitre 51 qu'il entreprend de relater le soulèvement de Vitellius qui a pourtant commencé avant même le coup de force d'Othon, mais dont l'historien a différé le récit (3). Tacite procède donc à un flash-back, afin de développer en un tout cohérent la narration de la révolte des armées stationnées en Germanie. Il remonte jusqu'en novembre 68 et s'arrête en mars 69, au moment de la traversée des Alpes effectuée par les troupes de Caecina. Le chapitre 71 correspond à un nouveau retour en arrière, puisqu'il ramène le lecteur à Rome, peu après la mort de Galba, au milieu du mois de janvier, et les chapitres suivants sont consacrés aux événements qui se déroulent dans V Urbs, jusqu'au départ d'Othon, le 14 mars (4).
Dans une certaine mesure, et d'une manière qui peut sembler paradoxale, c'est la volonté de faire connaître l'enchaînement rationnel des événements ainsi que leur causes (5) qui entraîne Tacite à ne pas respecter l'ordre de déroulement des actions qu'il évoque. Il ne faut pas oublier que la matière du livre I est extrêmement dense : deux mois et demi seulement d'histoire romaine y sont relatés, durant lesquels se
plusieurs événements capitaux, situés parfois durant la même période. Un désir de clarté peut donc déterminer l'historien à rassembler au sein d'un même
récit, les étapes successives d'un fait historique dont il souhaite expliquer le processus et dévoiler l'unité profonde. Ainsi pourrait-on également expliquer le tableau des
21-23, dans lequel il expose les manœuvres d'Othon pour parvenir à l'Empire. Plutarque racontait celles-ci en deux temps ; d'abord les intrigues auprès des soldats et de Vinius au moment où il escorte Galba d'Espagne en Italie, puis le complot, du 10 au 15 janvier 69 (6). Tacite lui, procède tout autrement. Comme l'indique E. Courbaud, il ramasse ces deux séries d'actions pour les présenter en un seul diptyque où
d'abord la réaction d'Othon à l'adoption de Pison et sa décision de procéder à un coup de force, puis le rappel de ses intrigues passées, ce qui met en perspective
ancienne du personnage (7).
Cependant, il faut bien constater que l'historien ne se contente pas de rapporter les événements selon l'ordre qui lui convient. Il lui arrive également de déformer les faits historiques, afin de justifier l'organisation interne de son récit.
Ainsi, Tacite ne mentionne qu'au chapitre 20, après l'adoption de Pison, les mesures financières prises pour renflouer les caisses, alors que celles-ci durent être prises bien plus tôt, dès les premiers jours du règne de Galba, en octobre 68 (8). Mais, placées au moment où il les situent, elles apparaissent comme un motif de la haine croissante
39
envers Galba et ce, quelques jours avant sa mort. Par ailleurs, selon Plutarque et Suétone, c'est le lendemain du 15 janvier à l'aube, qu'Othon aurait effectué les rituels nécessaires à sa prise de fonction, ce qui correspond au processus normal. Or, Tacite montre le nouvel empereur se rendant au Capitole pour y offrir ses actions de grâce le soir même du 15. Cela lui permet de donner à cette journée historique une unité qu'elle n'avait pas dans la réalité, et surtout de souligner le sacrilège que constitue son acte, en le représentant obligé de passer par dessus les tas de cadavres pour aller sacrifier à Jupiter (9). Peu après, lorsqu'il entame le récit du soulèvement de Vitellius au chapitre 50, Tacite souligne que la proclamation de ce dernier ne fut connu à Rome qu'après la mort de Galba. Or, le nom de Vitellius devait être connu avant le 15 janvier. Mais en indiquant ce détail, Tacite justifie le report du récit de la révolte au chapitre 51 (10).
On sent donc bien que le souci de clarté ne peut légitimer à lui seul les de la matière auxquelles se livre l'historien. Ses motivations sont plus complexes.
Quelques années plus tard, dans un passage des Annales, il avouera avoir regroupé en un seul récit des événements qui se sont déroulés sur plusieurs années « pour éviter que, séparés, ils ne laissent un souvenir sans rapport avec leur importance » (11). Tacite ne souhaite pas seulement expliquer l'enchaînement des faits. Il désire les rapporter de manière que leur signification profonde éclate aux yeux du lecteur, donc de la façon la plus suggestive possible. Aussi doit-il véritablement façonner la matière que lui fournit l'histoire, et ce à l'aide de multiples procédés, qui peuvent parfois l'entraîner à mettre au second plan les exigences de l'exactitude chronologique. La mise en perspective de certains événements, traités de manière spécifique, s'obtient ainsi à travers un récit clos sur lui-même ou qui, tout en s 'intégrant à un ensemble, possède sa propre unité. Permettons-nous ici de citer P. Grimai : « Pris entre ses exigences esthétiques
et le cadre général d'un exposé annalistique, Tacite se trouve chaque fois, oserait- on dire, avec un excédent de matière, qu'il ne peut placer à son moment sans
l'équilibre de ses chapitres. Tantôt, il lui faudra revenir en arrière, pour exposer les causes - celles d'une guerre, par exemple - tantôt, il devra repousser jusqu'à une date sensiblement postérieure à leur date réelle la mention d'événements qu'il trouvait dans ses sources et qu'il ne pouvait et ne voulait pas taire » (12).
II. La perception subjective du temps
L'étude de la chronologie dans le livre I des Histoires nous a permis d'aboutir à un premier constat : d'emblée, par sa manière d'aborder le déroulement des faits, Tacite s'éloigne du temps figé, pour ainsi dire objectif, défini par la tradition annalistique. E. Cizek avait d'ailleurs déjà noté que, chez l'historien romain, existait une perception subjective du temps, étroitement liée aux vicissitudes de l'Empire : « Tacite perçoit le temps comme plus bref, voire abrégé, parce que Rome est en train d'atteindre son
(Germ,, 37, 3-5). Au contraire, Tacite se représente la terrible année 68-69 comme « longue bien qu'unique » (Dial., 17, 3). On a affaire dans cet exemple à l'aveu le plus
40
clair des variations subjectives subies par le temps de l'énoncé, ainsi que de son : le statut de Rome » (13). Cette « perception élastique du temps », selon les
termes employés par E. Cizek, se manifeste aussi, au sein même du récit, à travers une écriture profondément dramatisée qui alterne les moments où le temps semble se
avec ceux où l'action s'accélère brusquement, emportant les protagonistes dans le flux des événements.
De tels effets sont produits par toute une série de procédés dont l'épisode consacré à la fin de Galba offre quelques exemples significatifs. Ainsi, lorsque le vieil empereur apprend la sédition d'Othon : Ignarus intérim Galba et sacris intérims fatigabat alieni iam imperii deos, cum adfertur rumor rapi in castra incertum quem senatorem, mox Othonem esse qui raperetur, simul ex tota urbe, ut quisque obuius fuerat, alii formidine augentes, quidam minora uero, ne tum quidem obliti adulationis (14).
Le cum de rupture, dont l'emploi a été analysé par J. P. Chausserie-Laprée (15), introduit bien évidemment un coup de théâtre, mais il marque aussi un brusque
de rythme. Alors que l' imparfait fatigabat indiquait un procès en cours, le présent de narration adfertur, qui suit la conjonction, apporte à l'action une vivacité que
les ellipses nombreuses, l'enchaînement des deux infinitives, et l'emploi des adverbes mox et simul, exprimant ainsi la rapidité avec laquelle les informations se
et se précisent. La narration permet de montrer le déroulement de l'action dans le temps, et donc
d'en faire sentir Féventuelle accélération ; à l'inverse, le tableau, avec ses verbes à l'imparfait, ses nombreuses notations descriptives, peut créer une sorte de suspension dans le récit ; car il ne s'agit plus alors de faire se succéder les différentes phases d'une séquence, mais de s'attarder sur l'une d'entre elles. Le chapitre 40, par lequel débute le dernier acte de la chute de Galba, s'ouvre ainsi sur la vision du vieil empereur ballotté dans sa litière au gré des mouvements de la foule, tandis qu'une partie de la populace s'est massée dans les basiliques et les temples pour contempler la scène. L'historien décrit longuement la multitude qui observe le cortège, consciente qu'un drame va se jouer sous ses yeux. Il rend palpables l'attente, ainsi que la tension qui en résulte, en multipliant les détails évocateurs. Le déroulement des faits ici, est presque interrompu ; le seul mouvement indiqué est celui du balancement de la litière, rendu par le verbe agebatur : l'imparfait passif, renforcé par l'expression hue Mue, semble « engluer » l'action dans la répétition du procès. L'immobilité de la foule stupéfaite, le silence qui la saisit, tout contribue à donner au lecteur l'impression que le temps s'est figé. C'est Othon qui relance brusquement le cours des événements en donnant l'ordre à ses hommes d'intervenir : Oîhoni tamen armari plebem nuntiabatur; ire praecipitis et occupare pericula iubet. L'asyndète et le présent de narration iubet soulignent cette brutale accélération, puis l'arrivée des cavaliers sur le forum et la dispersion de la foule sont rendues en quelques mots seulement, qui traduisent admirablement la rapidité de l'intervention : disiecta plèbe, proculcato senatu, truces armis, rapidi equis forum inrumpunt. Les deux ablatifs absolus abrègent l'énoncé et semblent raccourcir la durée de l'action, chaque procès étant présenté dans son achèvement. L'effet est amplifié par les deux séries de parallélismes qui suggèrent la simultanéité des opérations (16).
41
L'épisode de la mort de Galba est tout entier traversé par ces ruptures de rythme, cette alternance de temps forts et de temps faibles que l'on retrouve dans d'autres pages des Histoires. Certes, Tacite cherche ainsi à rendre le cours fluctuant des événements, mais cette explication se révèle insuffisante quand on sait que, lors de l'assassinat de l'empereur, le peuple s'est probablement réfugié dans les temples et les basiliques au moment de l'attaque du cortège et non avant cette dernière (17). L'historien fait donc en sorte que cette attente existe. Elle matérialise en effet, à ses yeux, la tension qui doit nécessairement précéder le terrible attentat qui va ébranler Rome. Nous retrouvons ici ce lien qu'E. Cizek avait décelé entre la dilatation du temps et les vicissitudes de l'Empire. Grâce au procédé du tableau, le narrateur peut s'abstraire du flux des
afin de porter un regard distancié sur un moment particulier. C'est ce regard qui semble prolonger la scène et lui donner sa durée. Or, si Tacite juge utile de s'attarder sur tel ou tel fait, c'est généralement que celui-ci l'indigne ou l'attriste, parce qu'il va à rencontre des intérêts de Rome et des mores (18). Lorsqu'il décrit les outrages que la soldatesque fait subir aux têtes de Galba et de son entourage, il ne cherche pas à
les détails abjects, comme Suétone ou Plutarque, il préfère saisir les attitudes dans leur répétition et développer la scène : le mouvement des soldats agitant leurs trophées sur des piques est donc prolongé par celui de leurs camarades montrant à l'envi leurs mains ensanglantées et vantant leurs exploits. Les imparfaits gestabantur et iactabant, l'emploi du participe présent à l'ablatif absolu ostentantibus, renforcé par l'adverbe certatim, les deux séries de relatives parallèles, tout concourt à donner l'impression que les gestes et les propos de la troupe se répètent et se démultiplient (19).
Les modulations dans le rythme du récit tacitéen apparaissent étroitement associées à des variations dans la perspective adoptée. Selon que le narrateur plonge son regard au sein de l'action ou l'en détache, selon qu'il raconte ou qu'il décrive, s'offrira à lui la possibilité de donner l'illusion que le temps s'abrège ou, au contraire, se dilate. Cette élasticité du temps est intimement liée à la subjectivité de l'historien, dont la vision
marque sa conception globale de la temporalité.
III. Une temporalité tragique
On peut considérer que, dans le livre I des Histoires comme dans le reste des opéra maiora, Tacite présente une conception du temps qui rejoint celle de la tragédie antique. L'action tragique peut être caractérisée comme une crise brève et continue, dont les origines et les répercussions couvrent un large espace de temps et des
multiples (20). Les protagonistes y perçoivent le temps comme consubstantiel à la notion de changement, d'opposition violente et soudaine entre l'avant et l'après. Cette conception induit une vision angoissée du devenir, compris désormais comme un phénomène porteur de bouleversement. Des éléments similaires se retrouvent dans le livre I des Histoires. Comme dans la tragédie, le passé et l'avenir peuvent s'y
autour d'un moment décisif, durant lequel le destin d'un personnage subit un tour-
42
nant. La dramatisation du récit fait surgir des crises brèves, où l'action se déroule de façon violente et soudaine. A travers de multiples procédés, le récit annonce les drames à venir et laisse ainsi filtrer un sentiment d'angoisse face à un futur synonyme de
et de malheur. Le rappel du passé peut alors permettre de donner une portée plus grande aux épisode qui sont évoqués.
Nous avons indiqué précédemment les manipulations de la chronologie auxquelles se livrait l'historien. Celles-ci peuvent conférer à l'action non seulement son unité mais aussi une impulsion qui revêt un caractère d'urgence. Ainsi, le récit proprement dit débute au moment où Galba décide d'adopter Pison après avoir appris la révolte des légions de Germanie supérieure, alors qu'il méditait ce projet depuis longtemps (21). C'est cette adoption qui pousse Othon à agir, mais Tacite prend soin de signaler qu'il caressait probablement depuis longtemps l'idée de renverser le vieillard (22). Comme dans l'action tragique, on assiste, après une « maturation » progressive, à une brusque accélération du cours des événements. En outre, en établissant une distinction nette entre ce qui prélude au drame et le drame lui-même, l'historien parvient à concentrer celui-ci sur l'action essentielle. Lorsqu'il le peut, il tend à condenser l'action de manière à créer une impression similaire à celle que procure la tragédie, où tout doit se jouer « dans une seule révolution du soleil » (23). On remarquera que le renversement de Galba et la prise de pouvoir d'Othon s'effectuent en une journée (24). Le sacrifice au cours duquel Umbricius annonce un piège à l'empereur a lieu le matin, et Othon prend ses fonctions le soir même (25).
La tragédie grecque décrit, en même temps que le processus qui fait advenir la crise, les signes multiples qui précèdent celle-ci et l'annoncent, de même que l'attente anxieuse ou les interrogations inquiètes qui peuvent en résulter. C'est ainsi qu'Eschyle multiplie les indications diverses dans Les sept contre Thèbes, afin de créer une tension toujours croissante jusqu'au moment crucial. Certes, chez Tacite, tout ne peut
vers un point unique, cristallisant toutes les angoisses, puisque les Histoires et les Annales relatent différents conflits et plusieurs règnes successifs. Cependant, on trouve dans le livre I des Histoires nombre de procédés indiquant la proximité d'une crise ou d'un drame. Ces signaux d'alerte traduisent, eux aussi, une vision angoissée du temps. Dans le monde tacitéen, on redoute toujours des malheurs à venir (26).
Il faut mentionner, en premier lieu, les interventions directes du narrateur et le rôle particulier de la préface. Dans la section qui regroupe les chapitres 2 et 3, Tacite
un diptyque censé résumer son propos. La couleur de l'ensemble est très sombre, marquée par une accumulation de désastres et de malheurs que l'évocation d'actions héroïques permet encore de souligner. Procédant par allusions, l'historien installe une atmosphère pesante qui n'est pas sans rappeler celle que Sénèque crée dans certains de ses prologues tragiques (27). La conclusion du prooemium annonce la mort de Galba et de Titus Vinius au cours de l'année 69. Cette même année est d'ailleurs signalée comme celle qui faillit mettre fin à l'Etat (28).
Tacite use d'un autre procédé d'anticipation, la relation de rumeurs et de propos qui conditionnent le lecteur, en vue de la description d'un conflit ou d'un drame ultérieurs.
43
La déploration du peuple, apprenant le soulèvement de Vitellius peu après la prise du pouvoir par Othon, assume cette fonction (29). Ces propos sont intéressants, dans la mesure où ils ne dévoilent qu'en partie l'avenir, ne révélant que ce que les acteurs du drame peuvent eux-mêmes conjecturer. Le lecteur est ainsi amené à partager leur angoisse.
Nous accorderons une attention particulière aux éléments prophétiques. Une part d'entre eux concerne l'évocation d'éléments divers qui joueront un rôle important dans le destin de l'Empire. Le tableau de la situation à Rome et dans les provinces, au début de l'année 69, permet de mettre en valeur, entre autres, la faiblesse de Galba ou
des armées de Germanie (30). Autres éléments prophétiques, et non des moindres, les crimes liés à la prise du pouvoir. L'entrée de Galba dans la ville de Rome est
d'un mauvais présage : le massacre des marins engagés par Néron. Les meurtriers eux-mêmes, d'après Tacite, en sont épouvantés (31). L'avènement d'Othon provoque à son tour un bain de sang, de mauvais augure pour le règne du nouveau maître de l'Empire, d'ailleurs contesté aussitôt (32). Le phénomène le plus important, de ce point de vue, reste la mention des omina, oracles ou prodiges, annonciateurs de désastres imminents. Les signes du Destin, tout comme les propos des personnages, ne sont pas seulement destinés à alerter le lecteur. Ils manifestent l'inquiétude des Romains en même temps qu'ils contribuent à la tension dramatique. Un violent orage se déclenche le jour où Galba doit annoncer officiellement aux armées l'adoption de Pison (33). L'haruspice Umbricius annonce au vieil empereur que les entrailles des victimes sont de funeste augure, quelques heures avant son assassinat (34). De multiples prodiges, dont le débordement du Tibre, font redouter le pire aux habitants de Rome (35) et de même que Galba avait méprisé les signes envoyés par les dieux, Othon refuse
son départ pour la guerre malgré le fait que les boucliers sacrés n'aient pas encore été remis en place (36).
Détails, petits faits ou grands événements interprétés comme autant de présages, oracles et propos prophétiques, prodiges annonciateurs de désastres : la palette est large. Chacun de ces signes contribue à donner un certain tempo au récit, à créer une tension dramatique qui ne se relâche guère au fil des épisodes. L'ensemble paraît
une conception angoissée de l'avenir, dont on cherche à déchiffrer le contenu dans un contexte menaçant. Dans un tel environnement, le rappel du passé ne peut avoir pour effet que de mettre en relief la gravité du drame qui se joue ou de celui qui s'annonce. Au cours de sa déploration du chapitre 50, la population romaine se rappelle les souvenirs douloureux d'un passé lointain, celui des guerres civiles. La comparaison entre les hommes qui se sont affrontés alors et ceux qui s'apprêtent désormais à se
le pouvoir, plonge les gens du peuple dans l'affliction et la terreur. Il leur semble en effet que les conséquences du conflit à venir seront encore plus terribles que celles des luttes anciennes.
Ainsi, pour paraphraser une formule employée par Jean-Paul Sartre à propos de la temporalité chez Faulkner, nous pourrions dire que le futur de Tacite est catastrophique (37). Certes, le recours à Fanachronie, les modulations du rythme imprimé à la narra-
tion ou les procédés d'anticipation participent de la dramatisation du récit. Mais ils révèlent également que le temps tacitéen est considéré dans sa dimension humaine comme porteur de bouleversement et générateur d'angoisse. De fait, si, dans le livre I des Histoires, la temporalité reflète l'implication profonde de l'auteur dans ses écrits, elle témoigne peut-être aussi de l'inquiétude d'un serviteur de l'Etat face à l'avenir de l'Empire.
Fabrice GAUTIER
Université de Clermont-Ferrand
ADNOTATIONES
1. Jean-Paul Sartre, « La temporalité chez Faulkner », dans Situations I, Paris, 1947, p. 65-75. 2. Cicéron, De oratore, II, 63. 3. La source de Tacite devait avoir conservé l'ordre chronologique : Ph. Fabia, Les sources de
Tacite dans les Histoires et les Annales, Paris, 1893, p. 16. 4. Le livre II s'ouvre sur le voyage avorté de Titus, venu présenter ses devoirs à Galba,
simultanément la mort de celui-ci et la sédition de Vitellius. Cela nous ramène donc au mois de janvier 69, et Tacite utilise cette anecdote pour introduire le parti des Flaviens au cours des chapitres 1 à 7, avant de revenir au déroulement des opérations en Italie.
5. Hist. 1,4,1. 6. Plutarque procédait selon l'ordre chronologique et en deux temps : Plutarque, Galba, 20 ; 23
sqq. 7 . E. Courbaud, Les procédés d'art de Tacite dans les Histoires, Paris, 1918, Paris, 1918,
p. 136 sqq. 8. P. Wuilleumier, H. Le Bonniec et J. Hellegouarc'h, édition et traduction des Histoires, livre
I, Paris 1987, note 1, p. 136. 9. Hist., I, 47, 2 ; Plutarque, Othon, 1, 1 ; Suétone, Othon, 7, 2. Cependant, l'accession au trône
s' étant effectuée dans des conditions exceptionnelles, la version de Tacite n'est pas G. E. F. Chilver, A Historical Commentary on Tacitus' Historiés / and II,
Oxford, 1979, p. 106. 10 . P. Wuilleumier, H. Le Bonniec et J. Hellegouarc'h, op. cit., note 4, p. 185. 11. Ne diuisa haud perinde ad memoriam sui ualerent. (Ann., XII, 41, 5). 12. P. Grimai, Tacite, p. 265. Sur les retours en arrière et les anticipations, dans les Annales en
particulier, Ph. Fabia et P. Wuilleumier, Tacite, l'homme et l'œuvre, Paris, p. 106. 13 . E. Cizek, Histoire et historiens à Rome dans l'antiquité, Lyon, 1995, p. 242-243. 14 . Hist., I, 29, 1. 15. J. P. Chausserie-Laprée, L'expression narrative chez les historiens latins, Paris, 1969, p. 501
sqq. 16 . A ce sujet, lire A. Salvatore, Stile et ritmo in Tacito, Naples, 1950, p. 171 sqq. 17 . E. Courbaud, op. cit., Paris, 1918, p. 89 sqq. 18. Tacite n'a ainsi pas besoin de commenter les actes de ceux qu'il veut flétrir. Il lui suffit de
les représenter. 19. Hist., I, 44, 2. E. Courbaud a comparé ajuste titre l'art du tableau tacitéen à celui du bas-
relief, celui-ci déployant une scène dans l'espace, celui-là dans le temps : « Ce n'est plus l'image du récit qui passe, rapide, sur l'écran, remplacée instantanément par d'autres ; c'est
45
une image qu'on voit naître, grandir et durer, et qui donne en conséquence l'impression de la vie » : E. Courbaud, op. cit., p. 130.
20. J. de Romilly, Le temps dans la tragédie grecque, Paris, 1971, p. 9-33. 21. Hist.,l, 12, 1-2. 22. Hist., I, 21-23. 23. cYndnfav nepfoSov fjXïov ; Aristote, Po., V, 1449 b 12-13. 24. Le dix-huitième jour avant les calendes de février (Hist., I, 27, 1). 25. Hist., I, 27, 1-47, 2. 26. Sur les procédés d'anticipation, O. Devillers, L'art de la persuasion dans les Annales de
Tacite, Bruxelles, 1994, p. 109-117. 27. Comme le souligne A. Malissard, Tacite, s'il semble ainsi détruire tout l'intérêt de son récit,
place en fait le lecteur dans la situation d'un spectateur assistant à une tragédie dont il connaît déjà l'intrigue : A. Malissard, Tacite et le théâtre ou la mort en scène, Theater & Gesellschaft im Imperium Romanum, Tubingen, 1990, p. 215.
28. Hist., I, 11, 3. Plus loin, alors qu'il s'apprête à évoquer une révolte des prétoriens, il annonce, d'une manière emphatique, « une sédition qui mit Rome près de sa perte » (seditio prope Urbi excidio : Hist., I, 80, 1).
29. Hist., I, 50. Par ailleurs, il est clair que la description des réactions de la foule massée dans les temples et les basiliques, sur le passage de Galba, participe de la préparation dramatique de l'attentat (Hist., I, 40, 1).
30 . Hist., I, 6, 1 ; 7,3 ; 8,2. 31. Hist., I, 6, 2. On notera que, de la même manière, le meurtre de Dolabella jette le discrédit
sur le principat de Vitellius, au moment où il ne fait que commencer (Hist., H, 64, 1). 32 . Hist., I, 50, 1. 33 . Hist.,ï, 18, 1. 34. Hist., 1,27, 1. 35 . Hist., I, 86, 1-3. 36 . Hist., I, 89, 3 37 . Dans l'article qu'il consacrait à l'auteur américain, Jean-Paul Sartre écrivait : « le présent de
Faulkner est catastrophique » (Jean-Paul Sartre, op. cit., p. 66).
46