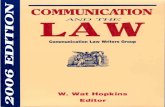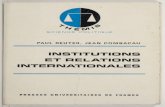Modèles internes opérants de l'attachement et relations d'objet internalisées : l'analyse du...
Transcript of Modèles internes opérants de l'attachement et relations d'objet internalisées : l'analyse du...
IntroductionBien que la théorie de l’attachement ait des racines profondes dans
l’école psychanalytique anglaise des Relations d’objets (Ainsworth, 1969 ;
Bretherton, 1998), les origines psychanalytique de cette théorie ont été
négligées par la littérature, insistant surtout sur les influences étholo-
giques, cognitives et cybernétiques qui furent la base de sa formulation
initiale (Steele et Steele, 1998). D’un autre côté, jusqu’aux années 1990,
la théorie de l’attachement a été considérée comme une sorte de tabou
en psychanalyse (Guedeney et Guedeney, 2004), et quelques-unes des
idées innovatrices de Bowlby furent systématiquement attaquées et dénon-
cées par les milieux officiels psychanalytiques (Ainsworth, 1969).
Cependant, les superpositions théoriques entre les deux courants sont
incontestables. Selon Fonagy (2001), le concept d’attachement de Bowlby
(1981) trouve un écho dans d’autres formulations classiques psychanaly-
tiques, comme l’amour primaire de Balint (1979), la relation avec le Moi
de Winnicott (1975), ou les relations personnelles proposées par Guntrip.
A son tour, le concept de modèles internes dynamiques (MID), si conçus
comme des « règles » de procédure qui régissent les aspects importants
du comportement et qui sont incorporées dans les représentations cogni-
tives-affectives du soi (self), des autres et des interactions entre le soi
145D
eve
nir, vo
lum
e 2
3, n
um
éro
2, 2
01
1, p
p. 1
45
-15
9
1 UIPCDE, ISPA,
Rua Jardim do Tabaco, 34,
Lisbonne (Portugal).
E-mail : apinto ISPA@pt
Recherche
Alexandra Pinto1, Nuno Torres, Manuela Veríssimo, Joana Maia, Marilia Fernandes et Orlando Santos
Modèles internes opérants de l’attachement et relations d’objet internalisées : l’analyse du devenir des relations « attachement par les récits à compléter »Internal working models of attachment and object relations in children : narrative analysis of the attachment story completion task
146D
eve
nir,
vo
lum
e 2
3,
nu
mé
ro 2
, 2
01
1,
pp
. 1
45
-15
9
(self) et les autres (Eagle, 2003), se rapproche des notions de Représen-
tations d’interactions généralisées (RIG) de Stern (1992), de Structures
interactionnelles (interactional structures) de Beebe et Lachmann (1988),
ou d’unités d’affect-self-objet (self-object-affect-units) de Kernberg (2005).
Aussi selon Lilleskov (1992) le concept de MID est analogue à celui
des représentations d’objet et du self de la psychanalyse, étant proche
de la notion de relations d’objet internalisées comme formes émotion-
nelles codées de relation et réponse, correspondant à des modèles et des
schémas qui organisent la personnalité de la personne (Bretherton, Ridge-
way et Cassidy, 1990).
Nous trouvons des positions similaires chez Stern (1992) et Zelnick
et Buchholtz (1990) pour lesquels les deux théories conceptualisent les
représentations mentales comme des schémas cognitives-affectives qui
fournissent des informations émotionnellement chargées sur la personne,
le self et le self en rapport à l’objet, à travers l’internalisation progressive
de mémoires épisodiques.
Par ailleurs, il est à noter que les deux traditions théoriques de l’atta-
chement et des relations d’objet place l’accent sur les facteurs interper-
sonnels et la qualité des soins dispensés à l’enfant dans les premiers
stades du développement, ou il y a une superposition entre la psychana-
lyse en général (y compris non seulement les théories des relations d’objet)
et la théorie de Bowlby (1973, 1980, 1981 et 1988) sur diverses hypothèses
théoriques et épistémologiques (Steele et Steele, 1998 ; Fonagy, 2001),
telles que la distinction entre la réalité actuelle et psychique, considérant
que la perception des expériences sociales est déformée par des repré-
sentations et des modèles mentaux qui travaillent aux niveaux conscient
et inconscient ; l’accent mis sur l’importance du début de la vie, notam-
ment en termes d’expériences émotionnelles des relations pour le déve-
loppement de la personnalité ; le rôle central de la qualité des comporte-
ments des figures parentales sur le développement de l’enfant, traduisible
en concepts tels que la sensibilité maternelle, si, bien que la sensibilité
maternelle soit conceptualisée d’une façon différente, toutes deux pré-
cisent son importance comme facteur causal dans la détermination de la
qualité des relations d’objet et donc du développement psychique ; et
enfin, la motivation de créer des relations tenant compte que la relation
entre l’enfant et le soignant se fonde sur une nécessité autonome et indé-
pendante d’établir des relations affectives proches, apparaît clairement
et directement énoncée dans les travaux d’auteurs psychanalytiques des
relations d’objet, comme Fairbairn ou indirectement par d’autres auteurs
147R
éc
its à c
om
plé
ter
qui suivent la ligne de la psychologie du moi comme Anna Freud
(Ainsworth, 1969).
Jusqu’à présent, les recherches qui ont tenté de lier ces deux grands
paradigmes théoriques sont extrêmement minces (Steele et Steele, 1998).
Nous présentons ci-dessous quelques exceptions notables.
Buelow, McClain et McIntosh (1996) ont présenté une méthodolo-
gie objective qui combine ces deux théories, l’Attachment and object rela-
tions inventory (AORI), défendant que, si bien que les relations d’atta-
chement et les relations d’objet soient indissociables dans la pratique,
ses concepts peuvent être distingués sur le plan théorique. Applicables
aux populations cliniques et non cliniques, l’inventaire AORI évalue
l’attachement d’une façon multifactorielle, produisant des scores globaux
sur la qualité des représentations d’attachement et des relations d’objet.
Cette méthodologie a été utilisée dans divers domaines d’études tels que
l’autonomisation des adolescents (Giles et Maltby, 2004), l’effet des styles
parentaux et les modèles d’attachement de la petite enfance dans les
relations intimes des adultes (Neal et Frick-Horbury, 2001), et aussi les
différences intersexuelles dans les mesures d’attachement, testée sur des
adultes (Ross, 2008).
Goldman et Anderson (2007) ont étudié la qualité des relations
d’objet des patients et de la sécurité de leur attachement comme fac-
teurs prédictifs de l’alliance thérapeutique première. A leur tour, Priel
et Besser (2001) ont conclu que les représentations que les nouvelles
mères ont sur leurs propres mères jouaient un rôle de médiation dans
l’association entre leurs modèles internes dynamiques et les liaisons
psychiques prénatales avec leurs bébés. Une des méthodes les plus utili-
sées pour intégrer ces deux théories a été l’inventaire de Bell, Bell object
relations inventory, appliqué dans les études de patients schizophrènes
(par exemple, Bell et Bruscato, 2002 ; Bell, Lysaker et Milstein, 1992) et
sur les perturbations alimentaires (Heesacker et Neimeyer, 1990). Cepen-
dant, il faudra mettre l’accent sur le fait que ces recherches sont menées
principalement chez les adultes ; une grande lacune empirique concer-
nant l’enfance existe.
Récemment, Ramos (2008) a mené une étude exploratoire avec un
échantillon d’enfants portugais institutionnalisés, victimes d’abus, en uti-
lisant le SCORS et le ASCT. Les résultats suggèrent l’existence d’une
certaine convergence entre la qualité des modèles internes dynamiques
de l’attachement et la tonalité affective des relations d’objet.
148D
eve
nir,
vo
lum
e 2
3,
nu
mé
ro 2
, 2
01
1,
pp
. 1
45
-15
9
Cette étude cherche à analyser les relations entre ces deux théories
et aussi à élargir le champ de recherche à la petite enfance.
ObjectifsDéterminer si les enfants avec un modèle interne dynamique de l’atta-
chement plus sécurisant ont un monde interne objectal plus stable et
positif, caractérisé par l’attente de relations bénignes et bienveillantes
entre les sujets.
Une méthodologie a été choisie pour permettre la comparaison des
résultats obtenus dans l’exploration empirique de chaque théorie : l’Attach-
ment story completion task (ASCT), la tâche d’achèvement d’histoires
développées dans le cadre de la théorie de l’attachement (Bretherton,
Ridgeway et Cassidy, 1990) a été appliquée à un échantillon de 51 enfants
en âges préscolaire et scolaire. Les récits ont été analysés de manière indé-
pendante, sur le ton affectif du monde objectal interne, évalués par une
méthode empirique psychanalytique (Social cognition and object rela-
tions scale (SCORS ; Westen, 1995 ; Westen, Barends, Leigh, Mendel, et
Silbert, 2002 ; Westen, Lohr, Soie, Kerber et Goodrich, 2002 ; Hilsenroth,
Stein et Pinsker, 2004)) et sur la qualité des représentations d’attache-
ment émergentes.
Méthode
Les participantsCinquante et un enfants portugais (25 garçons et 26 filles) d’âges pré-
scolaire et scolaire, âgés entre 65 et 91 mois (M = 76,22 ; SD = 7,84),
élèves d’un établissement d’enseignement privé dans la grande région
de Lisbonne. Tous les enfants fréquentaient l’école privée pendant la jour-
née, vivant avec leurs parents, appartenant à un milieu social moyen-
élevé. Les mères sont âgées entre 30 et 44 ans (M = 36 ; SD = 4) et les
pères entre 30 et 53 ans (M = 38,58 ; SD = 5,732).
Les instrumentsEchelle d’intelligence de Wechsler pour l’âge préscolaire et primaire – Edition révisée (WPPSI-R, Wechsler, 1989) Des échelles ont été appliquées, par deux chercheurs indépendants, l’essai
sous-verbal de la WPPSI-R afin d’analyser les aptitudes verbales des enfants
et des différences possibles dans la capacité lexicale et la compréhension
verbale. La collecte des données a été effectuée individuellement à des
149R
éc
its à c
om
plé
ter
jours différents de la collecte de récits ASCT. Les tests ont été appliqués
suivant l’ordre : preuve de l’information, preuve du vocabulaire, preuve
de l’arithmétique, preuve de similitudes et preuve de compréhension.
Attachment story completion task (ASCT ; Bretherton, Ridgeway et Cassidy, 1990) : batterie d’histoires à compléter sur l’attachementC’est un instrument composé de cinq début d’histoires formulées afin
d’activer les représentations et les sentiments associés aux expériences
d’attachement des enfants : a) « Le jus renversé » : la figure d’attachement
dans un rôle d’autorité ; b) « Le genou blessé » : la douleur comme déclen-
cheur de comportements d’attachement chez l’enfant et de protection
parentale ; c) « Le monstre dans la chambre » : la crainte comme déclen-
cheur de comportements d’attachement chez l’enfant et protection paren-
tale ; d) « Le départ »: l’angoisse de séparation et de la capacité de coping
et e) « Rencontre »: la réaction au retour des parents (Bretherton, Ridgeway
et Cassidy, 1990). On utilise un ensemble de petites figures humaines, pré-
sentées comme appartenant à une même famille (mère, père, deux enfants
du même sexe, mais d’âges différents et une voisine) et un ensemble
d’accessoires simples (bureau, chaises, voiture, etc.) qui complètent et
accompagnent chaque thème de l’histoire. Chaque histoire inachevée,
commencée par l’expérimentateur, doit être complétée par les enfants.
On réalise l’enregistrement audiovisuel de la séance, afin d’assurer un
support avec des informations sur le comportement verbal et non verbal
de l’enfant, essentiel pour l’analyse et le codage ultérieurs des récits.
Méthodologie de codage de l’ASCTSi, lors de la création de l’instrument, les auteurs ont proposé une évalua-
tion catégoriale des récits en histoires sécures et insécures, étant donné les
stratégies d’attachement prédominantes, une des particularités de l’évo-
lution de l’instrument, depuis les années 1990 jusqu’à présent, a été celle
de ne pas forcer l’utilisation d’un système de codage unique, existant la
possibilité de joindre le processus de codage (ainsi que l’inclusion d’his-
toires nouvelles ou l’omission de certaines proposées initialement), aux
objectifs spécifiques de chaque recherche en cours (Bretherton, 2008 ;
Bretherton et Munholland, 2008 ; Murray, 2007 ; Solomon et George,
2008). En effet, plusieurs études ont démontré la pertinence de leur uti-
lisation pour évaluer les domaines du fonctionnement psychique et inter-
psychique aussi divers que le développement moral, l’expression émotion-
nelle, le comportement pro-social, la représentation parentale, l’agressivité,
150D
eve
nir,
vo
lum
e 2
3,
nu
mé
ro 2
, 2
01
1,
pp
. 1
45
-15
9
1 Une résolution est considé-
rée minime si, même que le
problème soit reconnu et
résolu, il existe peu ou aucune
élaboration dans cette réso-
lution. Elle est complète
quand elle ajoute une com-
préhension relationnelle de la
situation, ayant après la
résolution immédiate du pro-
blème, un retour à la norma-
lité. Finalement, l’histoire est
considérée sans résolution si
le problème présenté n’est
pas pris en conte et solu-
tionné, au gré des incitations
spécifiques de l’expérimen-
tateur. Le codage résolution
avec renversement doit être
attribué à des histoires qui
sont résolues (avec ou non
de conclusion spécifique)
mais qui sont suivies d’une
inversion négative, revers
émotionnel ou un événement
bizarre.
le locus de contrôle, le tempérament, la nature des processus de défense,
la régulation émotionnelle, ou les stratégies de résolution de conflits
(Bretherton et Oppenheim, 2003).
Représentations d’attachementEn synthétisant les procédures de codages précédentes, nous avons opté
pour une évaluation dimensionnelle de représentations d’attachement
dans un continuum, privilégiant l’extension où sont ou non présents des
éléments de dimension sécurité-insécurité (Heller, 2000 ; Maia, Ferreira
et Verissimo, 2008).
Deux critères sont analysés, la cohérence et la sécurité, toutes deux
évaluées sur une échelle de huit points. Dans le cas de la cohérence,
celle-ci évalue la congruence dont le sujet est capable ou non de résoudre
le problème présenté et de la complexité de la présente résolution.1
Ainsi, l’échelle varie de très incohérente : (1) histoires incompréhensibles
et bizarres, avec des séquences d’événements violents et dispersés, ou
évitement massif du problème en question – à très cohérent (8) – histoires
logiques, connexes et pertinentes où la personne fait face au problème
de manière constructive et imaginative. Dans les valeurs moyennes, nous
trouvons des histoires modérément cohérentes, où la personne prend en
compte le conflit de l’histoire, étant en mesure de fournir une résolution
minimale même traversée par quelques éléments d’incohérence. Les his-
toires ont tendance à être très courtes et ont besoin d’incitation répétée.
Il y a généralement des écarts ou des contradictions modérés qui, cepen-
dant, ne font pas l’histoire bizarre ou décousue. Le critère de la sécurité
est une mesure plus large que, outre le critère de cohérence et de capa-
cité à résoudre le problème, prend également en compte les paramètres
suivants : le comportement non verbal, émotion générale exprimée, la
connaissance émotionnelle, la représentation parentale, l’investissement
dans la tâche, la fluidité verbale et l’interaction avec l’intervieweur. Elle
a également été évaluée sur une échelle de huit points, allant de Désor-
ganisé (1) à Très sécurisé (8), et où se trouvent les différentes nuances
des comportements d’évitement et d’ambivalence.
Toutes les histoires ont été codées par un chercheur qualifié, indé-
pendant de la collecte de données et ignorant d’autres informations
relatives aux enfants. Pour évaluer la validité des codages, environ 60%
des histoires ont été analysées par un autre chercheur, lui aussi indé-
pendant. L’accord interévaluateurs fut de r = 0,81 pour la cohérence et
r = 0,85 pour la sécurité.
151R
éc
its à c
om
plé
ter
Tonalité affective associée aux relations d’objetDes chercheurs indépendants ont évalué les mêmes histoires en suivant
une méthode empirique psychanalytique, la Social cognition and object
relations scale (SCORS ; Westen, 1995 ; Westen et al., 2002a, 2002b ; Hil-
senroth, Stein et Pinsker, 2004). Développée pour évaluer et analyser le
monde des objets internes, cette échelle est un instrument pour l’éva-
luation clinique, utilisée pour caractériser les représentations interper-
sonnelles du fonctionnement des individus.
La SCORS examine des récits contenant des épisodes des relations
interpersonnelles ayant, dans sa version originale, cinq dimensions, éva-
lués sur une échelle en cinq points :
• la complexité des représentations des gens.
• La tonalité affective du paradigme des relations.
• La capacité d’investissement émotionnel dans les relations et dans les normes morales.
• La capacité d’investissement.
• La compréhension de la causalité sociale.
Dans cette étude, nous avons choisi de n’utiliser que la tonalité affec-tive du paradigme des relations, une dimension qui évalue la qualité des représentations des personnes et des relations, en tenant compte du contenu (positif ou négatif) et de la forme, comment celles-ci décrivent les attentes du sujet envers les autres avec qui il se rapporte. Dans la perspec-tive psychanalytique, cette dimension peut être conceptualisée comme la coloration affective du « monde objectal » (de malveillante à bienfaisante), et qui peut encore être abordée à partir d’une perspective sociocognitive, qui se réfère aux qualités affectives des expectatives interpersonnelles (relations douloureuses et menaçantes ou agréables et enrichissantes).
Prétendant accéder à la mesure dans laquelle la personne s’attend à ce que les relations soient destructives et menaçantes ou, au contraire, sécuri-santes et enrichissantes, les scores possibles varient autour de cinq points :
1. le sujet comprend le monde social comme étant terriblement mena-çant et/ou a une expérience de vie comme massivement capricieuse et douloureuse. A une perspective des autres sujets comme tendanciel-lement abandonniques, abusifs ou destructifs dans les relations inter-personnelles, sans aucune raison, en plus d’une négligence ou de mal-veillance possible, classant souvent les gens comme victimes ou
victimaires. La personne peut se sentir terriblement seule.
152D
eve
nir,
vo
lum
e 2
3,
nu
mé
ro 2
, 2
01
1,
pp
. 1
45
-15
9
2. Le sujet représente le monde social comme hostile, capricieux, vide
ou distant, mais non insupportable. Il peut se sentir seul, tendant à
concevoir les autres en tant que désagréables ou non soignants, mais
non pas comme des menaces à son existence.
3. Le sujet a des représentations/schémas des personnes et des expecta-
tives interpersonnelles chargées d’une variété d’affects, qui ne sont
pas essentiellement positifs. Généralement, il voit les autres comme
capables d’aimer et d’être aimés, de prendre en charge et d’être pris
en charge.
4. Le sujet a des représentations/schémas sur des personnes et des expec-
tatives interpersonnelles caractérisés par une variété d’affects, primai-
rement positifs. En général, il a une perspective des autres sujets comme
étant capables d’aimer et d’être aimés, en appréciant la compagnie des
autres, c’est-à-dire, en valorisant la proximité relationnelle.
5. Le sujet a des représentations/schémas sur les personnes et les expec-
tatives interpersonnelles caractérisés par une variété d’affects. Il s’attend
généralement à ce que les relations soient bénignes et mutuellement
enrichissantes. Il s’attend à l’intimité, appréciation mutuelle et loyauté
dans les relations intimes.
RésultatsLa sécurité et la cohérence des représentations d’attachementLes moyennes de la cohérence pour chaque histoire se situaient entre
5,19 (SD = 1,39) et 5:55 (SD = 1,17). En ce qui concerne la sécurité, les
moyennes se situaient entre 5,26 (SD = 1,38) et 5,58 (SD = 1,31).
Nous avons effectué une analyse de corrélation pour les valeurs de
Cohérence et de la Sécurité entre les cinq narrations. Pour chacun des
paramètres, nous avons trouvé des corrélations positives significatives
dans toutes les histoires, de sorte que, par la moyenne des valeurs de la
cohérence et de la sécurité ont été créées deux nouvelles variables, Cohé-
rence totale (M = 5:38 ; SD = 1,01) et Sécurité totale (M = 5,43 ; SD = 1,11).
Les corrélations entre les valeurs totales de la Cohérence totale et
Sécurité totale ont démontré l’existence d’une corrélation positive et très
significative (r = 99 ; p 0,05), permettant d’agréger ces deux échelles en
une dimension unique que nous appelons de Qualité des représentations
d’attachement.
153R
éc
its à c
om
plé
ter
Relations entre qualité des représentations d’attachement, compétences linguistiques et variables démographiquesIl n’y avait aucune association significative entre la variable Qualité des
représentations d’attachement et le sexe, l’âge et la position dans la fra-
trie de l’enfant, âge, statut matrimonial, le niveau de scolarité et le sta-
tut professionnel des parents. Il n’y avait pas de corrélation significative
entre le QI verbal et la variable Qualité des représentations d’attache-
ment. Cependant, nous avons trouvé des corrélations positives significa-
tives, quoique faibles, entre le QI verbal et la Sécurité (r = 0,26 ; p 0,05)
et la Cohérence (r = 0,8 ; p 0,05), dans le récit du Départ.
Tonalité affective du paradigme des relationsLes moyennes pour la Tonalité affective furent de 2,93 (SD = 0,58) et
3,17 (SD = 0,7 et 0,55). Nous avons effectué une analyse de corrélation
pour les valeurs de Tonalité affective des cinq histoires. Nous avons
vérifié qu’il y eu des valeurs positives significatives dans 80% des corré-
lations bivariées. Les coefficients de corrélation varient entre 0,21 et 0,6.
La Tonalité affective de l’histoire affective de jus renversé n’a pas mon-
tré avoir des corrélations significatives avec l’histoire du Monstre dans
la chambre de réunion.
Relation entre la « tonalité affective », compétences linguistiques et les variables démographiquesNous avons trouvé des corrélations positives et importantes, modérées,
entre l’âge des enfants et les valeurs de Tonalité affective dans toutes
les histoires, sauf pour l’histoire du Monstre dans la chambre (Jus ren-
versé r = 0,32 ; p < 0, 05, Genou blessé r = 0,33 ; p < 0,01 Départ r = 0,37 ;
p < 0,05 et Réunion r = 0,32 ; p < 0,05). Il y avait aussi une corrélation posi-
tive significative, quoique faible, entre le QI verbal et l’histoire de Départ
(r = 0,34 ; p < 0, 05).
Relation entre tonalité affective et qualité des représentations d’attachementLes corrélations entre la tonalité affective du paradigme des relations et
la qualité des représentations d’attachement sont présentées dans le
tableau I.
154D
eve
nir,
vo
lum
e 2
3,
nu
mé
ro 2
, 2
01
1,
pp
. 1
45
-15
9
Résumé
Constituant les deux princi-
paux domaines de la com-
préhension théorique et
scientifique des êtres
humains, la théorie de l’atta-
chement et la psychanalyse
se sont développées de
façon autonome, tout en
maintenant des points de
contact. Cette recherche vise
à les relier de façon empirique
en se concentrant sur les
théories psychanalytiques de
la relation d’objet. L’Attach-
ment story completion task a
été administré à un échantillon
de 51 enfants en âges pré-
scolaire et scolaire. Les nar-
ratives ont été analysées de
manière indépendante, sur le
ton émotionnel du monde
interne objectal, évaluées en
fonction de la dimension de
la Tonalité affective du para-
digme de la Social cognition
DiscussionLes résultats nous mènent dans une direction d’une forte association
positive entre la qualité des représentations d’attachement et de la qua-
lité de la tonalité affective des représentations internes d’objet, à l’excep-
tion du récit du Monstre dans la chambre. Dans quatre des cinq histoires,
les enfants avec des représentations d’attachement plus sécurisées et
cohérentes ont tendance à avoir des tonalités affectives de leurs rela-
tions d’objet plus positives et bienveillantes.
Ainsi, ces résultats révèlent l’existence d’une relation empirique entre
les concepts de la théorie de l’attachement et les concepts de la théorie
de la relation d’objet telle qu’elle est proposée théoriquement par Lilleskov
(1992), Goodman (2002), Fonagy (2001), Steele et Steele (1998) et Eagle
(2003), entre autres, et renforce les résultats obtenus par Neal et Frick-
Horbury (2001) et Giles et Maltby (2004). Les résultats de cette étude sont
consistants avec les résultats obtenus par Ramos (2008), une recherche
semblable à celle-ci, avec un échantillon d’enfants dans les institutions
portugaises, victimes d’abus.
En outre, le QI verbal révèle avoir des associations positives avec la
tonalité affective et avec la cohérence et la sécurité, seulement dans
l’histoire de Départ, renforçant l’idée que la capacité de coping avec des
scénarios de séparation des soignants, thématique classique de la théo-
rie de l’attachement, semble être positivement influencée par le dévelop-
pement verbal, en étant associée à des représentations des relations plus
positives et bienveillantes.
D’un autre côté, les résultats montrent que, si bien qu’elles soient
significativement liées, les représentations d’attachement et les repré-
Tonalité affective des relations d’objet Qualités des représentations d’attachement
R P
Jus renversé 0,57 (**) 0,000
Genou blessé 0,58 (**) 0,000
Monstre dans la chambre 0,16 0,134
Départ 0,45 (**) 0,001
Rencontre 0,45 (**) 0,001
Tableau I. Corrélations entre la tonalité affective des cinq récits et la qualité des représentations d’attachement
** Corrélation significative pour p 0,001 (1-tailed).
155R
éc
its à c
om
plé
ter
and object relations scale et
en fonction de la cohérence
et de la sécurité des repré-
sentations d’attachement
émergentes. Nous avons
également appliqué la
WPPSI-R pour surveiller les
effets potentiels des compé-
tences linguistiques dans la
production de récits. Nous
avons trouvé une corrélation
positive significative entre la
qualité des représentations
d’attachement et de la tona-
lité affective des objets
internes, et les résultats sont
discutés en termes de simili-
tudes et différences entre
ces deux concepts théoriques.
Mots-clés
Attachement.
Les relations d’objets.
Les modèles internes
opérants.
sentations d’objet internalisées sont différentes sur certains aspects et
ont des divergences entre elles, possédant des idiosyncrasies spécifiques.
1. Contrairement à ce qui a été trouvé dans les scores de la qualité des
représentations d’attachement, il n’y avait pas de corrélation biva-
riée significative entre les valeurs de la tonalité affective des cinq his-
toires, ce qui suggère que les questions abordées par les différentes
histoires qui composent la procédure ASCT évoquent des aspects
différenciés en termes de tonalité affective des représentations d’objet.
Nous n’avons pas trouvé de corrélation significative entre l’histoire
du Jus renversé et les histoires du Monstre dans la chambre et de la
Réunion. Ces histoires et leurs thèmes (l’autorité et la peur ; l’auto-
rité et la qualité du regroupement familial après la séparation) sem-
blent donc ne pas évoquer les aspects liés les uns aux autres en termes
de tonalité affective des relations d’objet.
2. Contrairement à la qualité des représentations d’attachement, nous
avons trouvé des associations positives entre la tonalité affective et
l’âge des enfants (sauf dans l’histoire du Monstre dans la chambre),
ce qui suggère qu’un plus grand développement verbal permet une
meilleure gestion de la tonalité affective des thématiques spécifiques
abordées dans ces histoires. Ces résultats sont en ligne avec les
recherches qui ont démontré comment le développement du langage
peut être un élément d’organisation de la psyché humaine (e, g, Streit,
1988 ; Barone, 2006).
L’histoire du Monstre dans la chambreLes résultats trouvés ont montré que cette histoire, avec un thème lié à
la peur, est la seule qui ne présente pas une corrélation significative entre
la tonalité affective des relations d’objet et les représentations d’atta-
chement. Les conceptualisations psychanalytiques sur la peur, l’anxiété
et l’anxiété névrotique sont centrales dans la compréhension des diffé-
rentes structures psychiques que les humains construisent dans leur
développement (Bienenfeld, 2005 ; Kernberg, 2005 ; Kohut, 1977, 1988 ;
Lemma, 2003). Ainsi, il n’est pas surprenant que cette thématique ait
des caractéristiques particulières dans l’analyse de la dimension de la
relation d’objet internalisée, si nous comprenons que la peur du monstre
prend une dimension de détresse intérieure, déterminée par le fantasme
du même, en nous trouvant dans un plan de l’inconscient, où d’autres
156D
eve
nir,
vo
lum
e 2
3,
nu
mé
ro 2
, 2
01
1,
pp
. 1
45
-15
9
Summary
Constituting the two main
domains of the theoretical
and scientific comprehension
of human beings, attachment
theory and psychoanalysis
have developed autono-
mously, maintaining contact
points. This research aims to
link them empirically by focu-
sing on psychoanalytic theo-
ries of object relations. The
Attachment Story Comple-
tion Task was administered
to a sample of 51 children in
preschool and school. The
narratives were analyzed
independently, the emotional
tone of the internal object-
world, measured according
to the size of the affective
tone of relationship para-
digms of social cognition and
aspects susceptibles de traitement moins conscients peuvent influencer
la propre production de ces histoires. Les autres histoires, où nous avons
trouvé une relation significative et positive entre l’attachement et la tona-
lité affective, les enfants sont menés à faire face à des situations réelles
de la vie quotidienne, c’est-à-dire, des scénarios relationnels qui évo-
quent des processus mentaux plus liés au plan conscient.
Nous avons également constaté une différence significative au niveau
du genre de l’enfant et la tonalité affective de l’histoire du Monstre dans
la chambre, où les filles avaient une tonalité affective plus positive que
les garçons. Cette différence est présentée comme une divergence de
plus entre les représentations d’attachement et représentations d’objet
internalisées, puisqu’au niveau de l’attachement le genre n’a pas montré
de différence significative.
Levit (1991) affirme que la théorie psychanalytique classique reporte
l’existence de différences intersexuelles au niveau de la personnalité, ce
qui suggère que les filles ont tendance à avoir une approche plus passive
et les hommes et les garçons un rôle plus actif, ayant des différences
dans leurs schémas défensifs. Les recherches empiriques viennent sou-
tenir l’hypothèse qu’il existe des différences intersexuelles en termes de
schémas défensifs, dont le sexe masculin a tendance à avoir des niveaux
plus élevés de défenses d’extériorisation tels que la projection et l’agres-
sion dirigées vers l’extérieur (déplacement et formes agressives d’acting-
out), alors que le sexe féminin a tendance à utiliser d’avantage de défenses
d’intériorisation, telles que se retourner contre le self (Levit, 1991 ; Cramer,
1983, 1987 ; Gleser & Ihilevich, 1969 ; Massong, Dickson, Ritzier et Layne,
1982). Les résultats des études citées suggèrent que ces différences com-
mencent à émerger dans ce qu’on appelle « l’âge de latence », qui est-à
peu près entre cinq et douze ans (Cramer, 1979) et continue tout au long
de l’adolescence.
Les résultats obtenus au niveau de l’histoire du Monstre dans la
chambre, qui diffèrent en termes de tonalité affective intersexuée, peu-
vent être expliqués par l’existence de différences au niveau des schémas
défensifs, où les filles ont un plus grand profit de cet effet dans la pro-
duction de narratives avec des tonalités affectives plus positives que les
garçons. Il serait nécessaire d’effectuer une analyse plus approfondie au
niveau des narratives produites afin de tester cette hypothèse. Finale-
ment, l’émergence de différences dans l’âge, au niveau de l’échantillon
de cette recherche, suggère que l’apparition de différences dans le schéma
défensif est plus précoce.
157R
éc
its à c
om
plé
ter
object relations and the scale
depending on the consis-
tency and security of the
emerging attachment repre-
sentations. We have also
applied the WPPSI-R to
monitor the potential effects
of language skills in the pro-
duction of narratives. We
found a significant positive
correlation between quality
of attachment representa-
tions and the affective tone
of internal objects, and
results are discussed in
terms of similarities and dif-
ferences between these two
theoretical concepts.
Keywords
Attachment.
Object relations.
Internal working model.
Cette étude a montré que la Théorie de l’attachement, à travers le
concept de Modèles internes opérants et les Théories de la relation
d’objet de la psychanalyse, à travers le concept de Représentations
d’objet internalisées, se trouvent liées les unes aux autres, possédant,
toutefois, quelques spécificités propres à chacune.
Il fut possible de comprendre comment les représentations d’atta-
chement semblent s’établir indépendamment des autres facteurs du
développement et du contexte, comme le genre, l’âge, le QI verbal, l’état
matrimonial des parents ou leurs niveaux d’étude. En ce qui concerne
les représentations d’objet internalisées, nous avons compris que celles-
ci sont plus associées à ces variables, étant liées à certaines d’entre elles
d’après des thématiques différenciées.
Finalement, nous devons souligner les différences trouvées au niveau
des thématiques associées à chaque histoire. Ainsi, les thématiques liées
à la peur semblent avoir une place autre dans la divergence entre les
représentations d’attachement et les représentations internes de l’objet.
RemerciementsLes auteurs tiennent à remercier tous les enfants qui ont accepté de participer à cette
étude, financée en partie par FCT (PTDC/PSI/64149/2006). Les auteurs tiennent éga-
lement à remercier tous les collègues de la Ligne 1, Psychologie Développement, de
l’UIPCDE pour leurs précieux commentaires.
Références
[1] AINSWORTH M. : (1969). « Object Relations, Dependency, and Attachment : A Theoretical
teview of the infant-mother relationship », Child Development, 1969 ; 40 (4) : 969-1025.
[2] BALINT M. : The basic fault : Therapeutic aspects of regression, Routledge, Londres, 1979.
[3] BARONE K. : « On not being torn apart : Coping with separateness », in : Psychodynamic
practice : Individuals, groups and organisations, 2006 ; 12 (4) : 419-434. Consulté le 1er juin 2009
à partir de la base de données Academic Search Complete, ISSN : 1475-3626 (Electronic).
[4] BEEBE B., LACHMANN F. : « The contribution of mother-infant mutual influence to the origins
of self- and object representations », Psychoanalytic Psychology, 1988 ; 5 (4) : 305-337.
[5] BELL M., BRUSCATO W. : « Object relations deficits in schizophrenia : A cross-cultural com-
parison between Brazil and the United States », Journal of Nervous and Mental Disease, 2002 ;
190 (2), pp. 73-79. Abstract consulte le 4 Avril 2009 a partir de la base de données PsycINFO,
ISSN : 1539-736X (Electronic).
[6] BELL M., LYSAKER P., MILSTEIN R. : Object relations deficits in subtypes of schizophrenia.
Journal of Clinical Psychology, 1992 ; 48 (4) : pp. 433-444. Abstract consulté le 4 Avril 2009 à
partir de la base de données PsycINFO, ISSN : 1097-4679 (Electronic).
[7] BIENENFELD D. : « Psychodynamic theory for clinicians », Lippincott Williams & Williams (LWW),
Philadelphia, 2005.
[8] BOWLBY J. : Attachment and Loss : Vol, 2. Separation, anxiety, and anger, Basic Books, New
York, 1973.
158D
eve
nir,
vo
lum
e 2
3,
nu
mé
ro 2
, 2
01
1,
pp
. 1
45
-15
9
[9] BOWLBY J. : Attachment and Loss : Vol. 3. Loss, Basic Books, New York, 1980.
[10] BOWLBY J. : Attachment : Vol. 1. Attachment and loss, Penguin Books, Middlesex, 1981.
[11] BOWLBY J. : A secure base – Clinical applications of attachment theory, Basic Books, New
York, 1988.
[12] BRETHERTON I. : (1998). « Commentary on Steele and Steele : Attachment and psychoa-
nalysis : A reunion in progress », Social Development, 1988 ; 7 (1) : 132-136.
[13] BRETHERTON I. : « Narratives about post-divorce family life by pre-school children and
their mothers : do they reflect the quality of observed relationships ? », in : Communication per-
sonnelle présentée à l’Instituto Superior de Psicologia Aplicada (Lisbonne) en Octobre 2008,
Lisbonne, 2008.
[14] BRETHERTON I., MUNHOLHAND K. : « Internal working models in attachment relationships
– elaborating a central construct in attachment theory », in : CASSIDI J., SHAVER P., (eds), Attach-
ment Handbook – theory, research and clinical applications (2nd edition), Guilford, New York, 2008,
pp. 102-127.
[15] BRETHERTON I., OPPENHEIM D. : « The MacArthur story stem battery : Development,
directions for administration, reliability, validity and reflections about meaning », in : EMDE R.N.,
WOLF D.P., et OPPENHEIM D., (eds), Revealing the inner worlds of young children : The MacAr-
thur Story stem battery and parent child narratives, Oxford University Press, New York, 2003,
pp. 55-80.
[16] BRETHERTON I., RIDGEWAY D., CASSIDY J. : « Assessing internal working models of the
attachment relationship : An attachment story completion task for 3-year-olds », in : GREEBERG M.,
CICCHETTI D., CUMMINGS M., (eds), Attachment in the preschool years : Theory, research and
intervention, University of Chicago Press, Chicago, 1009, pp. 273-308.
[17] BUELOW G., McCLAIN M., McINTOSH I. : « A new measure for an important construct :
The attachment and object relations inventory », Journal of Personality Assessment, 1996 ; 66 (3) :
604-623.
[18] CRAMER P. : « Defense mechanisms in adolescence », DevelopmentalPsychology, 1979 ; 15
(4) : 416-41.
[19] CRAMER P. : « Children’s use of defense mechanisms in reaction to displeasure caused by
others », Journal of Personality, 1983 ; 51 (1) : 79-94.
[20] CRAMER P. : « The development of defense mechanisms », Journal of Personality, 1987 ;
55 (4) : 597-612.
[21] EAGLE M. : « Clinical implications of attachment theory », Psychoanalytic Inquiry, 2003 ; 23 (1) :
27-54.
[22] FONAGY P. : « Attachment theory and psychoanalysis », London, Karnac. Traduction : Théorie
de l’attachement et psychanalyse, Eres, 2004, Ramonville St Agne, 2001.
[23] GILES D., MALTBY J. : « The role of media figures in adolescent development : Relations
between autonomy, attachment, and interest in celebrities », Personality and Individual Diffe-
rences, 2004 ; 36 : 813-822.
[24] GLESER G. C., IHILEVICH D. : (1969). « An objective instrument for measuring defense
mechanisms », Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1969 ; 33 (1) : 51-60.
[25] GOLDMAN G., ANDERSON T. : « Quality of object relations and security of attachment as
predictors of early therapeutic alliance », Journal of Counseling Psychology, 2007 ; 54 (2) : 111-117.
[26] GOODMAN G. :The internal world and attachment, Analytic Press, Hillsdale, 2002.
[27] GUEDENEY N., GUEDENEY A. : L’attachement, concepts et applications cliniques, Elsevier
Masson, Paris, 2004
[28] HEESACKER R., NEIMEYER G. : « Assessing object relations and social cognitive corre-relations and social cognitive corre-
lates of eating disorder », Journal of Counseling Psychology, 1990 ; 37 (4) : 419-426.
[29] HELLER C. : Attachment and social competence in preschool children, Master’s thesis, Unpu-
blished Manuscript, Auburn University, AL, 2000.
[30] HILSENROTH M., STEIN M., PINSKER J. : Social cognition and object relations scale : Global
rating method (SCORS-G), Unpublished manuscript. The Derner Institute of advanced psycho-
logical studies. Adelphi University, Garden City, New York, 2004.
159R
éc
its à c
om
plé
ter
[31] KEMBERG O. : « Object relations theories and technique », in : PERSON E., COOPER A.M.,
GABBARD G.O., (eds). Textbook of psychoanalysis, American Psychiatric Publishing, Inc, Arling-
ton, 2005.
[32] KOHUT H. : Restoration of the self, International University, Madison, 1977.
[33] LEMMA A. : Introduction to the practice of psychoanalytic psychotherapy, John Wiley & Sons,
Ltd, West Sussex, 2003.
[34] LEVIT D. : « Gender differences in ego defenses in adolescence : Sex roles as one way to
understand the differences », Journal of Personality & Social Psychology, 1991 ; 61 (6) : 992-999.
[35] LILLESKOV R. : « Attachment in the Preschool Years : Theory, Research and Intervention »,
GREENBERG M. T., CICCHETTI D., CUMMINGS E.M., (eds), The University of Chicago Press,
Chicago, Londres, 1992.
[36] MAIA J., FERREIRA B., VERISSIMO M. : « Attachment Story Completion Task – manual de
aplicação e cotação : dimensões/parâmetros resolução da história, coerência e segurança », Manual
não publicado. Lisboa : Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Lisbonne, 2008.
[37] MASSONG S., DICKSON A., RITZIER B., LAYNE C. : « A correlational comparison of defense
mechanism measures : The defense mechanism inventory and the blacky defense preference
inventory. Journal of Personality Assessment, 1982 ; 46 (5) : 477-480.
[38] MURRAY L. : « Future directions for doll play narrative research : A commentary », Attach-
ment & Human Development, 2007 ; 9 (3) : 287-293.
[39] NEAL J., FRICK-HORBURY D. : « The effects of parenting styles and childhood attachment
patterns on intimate relationships, Journal of Instructional Psychology, 2001.
[40] PRIEL B., BESSER A. : « Bridging the gap between attachment and object relations theo-
ries : A study of the transition to motherhood », British Journal of Medical Psychology, 2001 ; 74
(Pt1) : 85-100.
[41] RAMOS B. : Qualidade da representação da vinculação e a qualidade afectiva da relação
de objecto em crianças institucionalizadas, Tese de Mestrado Integrado em Psicologia Clínica.
Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Lisboa, 2008.
[42] ROSS L. : « The power of words : Gendered language in attachment measures », Annual
Convention of the Canadian Psychological Association. Halifax, Nova Scotia, 2008.
[43] SOLOMON J., GEORGE C. : « The measurement off attachment security and related constructs
in infancy and early childhood », in : CASSIDY J., SHAVER P., (eds) (2nd edition), Attachment hand-
book : theory, research and clinical applications, Guilford, New York, 2008, pp. 383-415.
[44] STEELE H., STEELE M. : « Attachment and psychoanalysis : Time for a reunion », Social
Development, 1998 ; 7 (1) : 92-119.
[45] STERN D. : O mundo interpessoal do bebé, Artes Médicas, Porto Alegre, 1992.
[46] STREIT N. : « Separation-individuation and speech and language development in the psy-Separation-individuation and speech and language development in the psy-
chotherapy of an atypical chiId. Child and Adolescent Social Work, 1988 ; 5 (2) : 84-101.
[47] WECHSLER D. : WPPSI-R, Wechsler preschool and primary scale of intelligence revised, The
Psychological Corporation, San Antonio, 1989.
[48] WESTEN D : Social cognition and object relations scale : Q-sort for projective stories
(SCORS-Q). Unpublished manuscript. Department of Psychiatry, The Cambridge Hospital and
Harvard Medical School, Cambridge, 1995.
[49] WESTEN D., BARENDS A., LEIGH A., MENDEL M., SILBERT D. : Social cognition and object
relations scale (SCORS), Manual for coding interview data, University of Michigan, Michigan,
2002a.
[50] WESTEN D., LOHR N., SILK K., KERBER K., GOODRICH S. : Social cognition and object
relations scale (SCORS), Manual for coding TAT data, University of Michigan, Michigan, 2001b.
[51] WINNICOTT D. : Jeu et réalité, Gallimard, NRF Paris, 1975.
[52] ZELNICK L., BUCHHOLZ L. : « The concept of mental representations in light of recent
infant research », Psychoanalytic Psychology, 1990 ; 7 : 29-58.