Démarche et déontologie de l'historien de la franc-maçonnerie
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
10 -
download
0
Transcript of Démarche et déontologie de l'historien de la franc-maçonnerie
Déontologie et démarche de l’historien de la franc-maçonnerie
Jean-Bernard Lévy
Avant-propos
Je ne suis pas historien ; en tout cas je n’ai pas reçu laformation universitaire me permettant de prétendre en être un.Mais j’ai appris en faculté, grâce à une formationmultidisciplinaire, ou « sur le tas », un bon nombre detechniques de recherches et d’écritures. Il est vrai aussi quebon nombre de ceux qui se revendiquent historiens de lamaçonnerie sont dans le même cas : Alain Bernheim, le plusréputé sans doute en France, est pianiste ; Roger Dachez estanatomopathologiste (c’est d’ailleurs à ce titre que j’ai faitsa connaissance voici quarante ans), Louis Trébuchet estpolytechnicien, et on pourrait multiplier les exemples1. Monpropos ne sera donc pas de critiquer ces auteurs, pas plus queles « professionnels », comme Pierre Chevallier, qui, lui,n’était pas franc-maçon. Je vais pourtant essayer de vouslivrer quelques réflexions tirées ma triple expérience demaçon, de grand lecteur d’ouvrages, notamment d’histoire de lamaçonnerie et enfin de « petit » auteur d’ouvrages etd’articles maçonniques, portant quelquefois sur l’histoire.
Affirmons-le d’emblée : Bien sûr je me range à l’avis deBernheim et de Dachez : l’histoire « authentique »2 de la1 Il est des exceptions, bien sûr, comme André Combes.2 Alain Bernheim et Roger Dachez utilisent volontiers cette expression« école authentique ». Pour Bernheim (Historiens de l’école authentique, in EtudesMaçonniques – Masonic papers, www.fremasons-freemasonry.com/bernheim1.html)« les historiens allemands furent les premiers à mettre en application lesprincipes de l’école authentique… (avec) les trois volumes de l’Encyclopédiede la Franc-Maçonnerie, rédigée par Lenning et Friedrich Mossdorf… publiés entre1823 et 1828 ». Pour Dachez « c’est d’Angleterre que jaillit l’impulsionqui devait donner naissance à la désormais classique Ecole authentique » :c’est Robert F. Gould avec « l’imposante History of Freemasonry » (1885-1887),
1
maçonnerie est une nécessité, et trop longtemps on a confondu,plus ou moins volontairement, histoire, mythes et légendes. Lesmaçons des temps modernes, depuis l’origine (et mêmeavant !!!), aiment se donner des origines mythiques. Il n’estqu’à relire les Constitutions d’Anderson et les Old Chargesantérieurs qui adorent retracer l’histoire de l’Ordre, C’est lecas en histoire en tout cas qui nous fait remonter à Adam, àl’origine du monde, d’autres en appellent à une « traditionprimordiale ». Et bien des maçons d’aujourd’hui aiment encore àse dire descendants des bâtisseurs de cathédrales, desTempliers, du mouvement Rose-Croix du XVIIe siècle ou de« Supérieurs inconnus ». On a beau répéter que tout cela estfaux, il est tellement bon, même à l’âge adulte, de rêver !
Tout aussi fermement je condamne également ceux qui necherchent pas à vérifier leurs sources, qui recopient sanssourciller les erreurs des autres ; bien plus qui lesamplifient passant de formules conditionnelles (on dit que…, ila été rapporté que…), à des affirmations de plus en plusvéhémentes, assénant comme certitudes ce qui n’étaient que deshypothèses ou simplement des racontars. Bien sûr il faut toutvérifier, corroborer, se méfier d’interprétations ou dedatations hâtives, et il faut croiser ses sources, aller àl’original. Et comme le rappelle Bernheim la parfaiteconnaissance de langues étrangères, anglais et allemand (del’époque !) est plus que nécessaire au bon historien3. Il faut
membre éminent de la plus ancienne loge de recherches du monde, QuatuorCoronati, qui serait à l’origine de l’Ecole (Histoire de la Franc-maçonnerie française,PUF, 2003, p. 7). Une chose est sure : la recherche historique, enmaçonnerie comme dans tous autres domaines, basée sur des faits et non surdes légendes, n’est pas chose nouvelle ! Pas plus d’ailleurs, comme nous leverrons, de se servir de l’histoire pour des buts plus ou moins avouables…3 Je pense que fustiger, voire plus, les erreurs, comme le fait, justementmais avec véhémence, Alain Bernheim, a ses limites. Il en estd’impardonnables, il est des auteurs qu’il faut savoir rayer de sabibliographie. Mais il est des fautes vénielles et, surtout, il faut êtresûr de son fait et ne pas faire d’anachronismes ! Bernheim reproche souventles erreurs de Thory (Claude Antoine Thory : Histoire de la fondation du Grand OrientActa P. Dufart 1812 et Latomorum ou Chronologie de l’histoire de la franc-maçonnerie françaiseet étrangère, Pierre-Elie Dufart 1815, 2 tomes et), mais à ce « petit jeu-là »on peut se faire reprendre. C’est ce que n’a pas manqué de faire Jacques
2
aussi classer ses sources, apprécier leur fiabilité, savoir oùet comment chercher etc.
I – Déontologie : information objective ?
Mais ceci ne suffit pas, à mon sens, pour établir ce quej’appellerai un code de déontologie de l’historien de la franc-maçonnerie. Une première comparaison avec un autre type de« rédacteurs » va me permettre de premières approches : lesjournalistes4. On le sait, même si on l’oublie, il estschématiquement deux types de journalistes, d’une part ceux quidonnent les informations brutes, théoriquement objectives, etd’autre part les journalistes d’opinion qui commententl’actualité en fonction de leurs engagements politiques ouautres. En fait la limite est floue. Fournir l’information,c’est déjà faire une sélection, un choix, donc perdre del’objectivité. Le classement, l’importance donnée à telle outelle information, le traitement qui lui est réservé, diminuentencore l’objectivité. Et, indépendamment de l’engagementpolitique, on connaît les contraintes et motivations de laprofession : avoir des scoops, faire de l’audimat ou du« chiffre », être à l’écoute des sponsors et autres annonceurs,des propriétaires du media, être obligé de traiter au plus vitel’information au détriment de la vérification des sources. Onsait combien piètre est l’opinion des Français sur la presse etles journalistes.
Bien sûr, théoriquement, ceci ne devrait pas concernerl’historien, encore moins l’historien de la franc-maçonnerie.Et si celui-ci a peu de contraintes de temps et il a toutloisir de vérifier ses sources, mais il rencontre, pour lereste, souvent les mêmes obstacles. Bien sûr il se doit, commele premier type de journalistes, de rapporter les faits avecobjectivité. Mais il a peu de chances de pouvoir être exhaustifTuchendler (Thory historien (II) : les lectures modernes et la critique d’Alain Bernheim, inRenaissance Traditionnelle n° 169, janvier 2013, p. 36-67).4 Il serait intéressant de comparer les modes opératoires du journaliste, del’historien et aussi du détective, mais ce n’est pas notre propos ici, mêmesi, on le verra, la recherche des documents, de leur authenticité, faitparfois de l’historien un véritable enquêteur !
3
et il doit trier, classer, et surtout présenter les faits :c’est là la première difficulté. Surtout on note quel’historien maçon, du fait même de son appartenanceobédientielle, a à peu près autant d’objectivité qu’unsupporter de club sportif, voire un journaliste commentant unmatch d’une équipe nationale. Deux exemples : la date de lafondation de la Grande Loge de France (qui a opposé toutrécemment Roger Dachez, président de l’Institut maçonnique, auGrand Maître de la G.L.D.F., Marc Henry5), ou encore lalégitimité de tel ou tel Suprême Conseil du R.E.A.A., après lesConcordat, ruptures, schismes etc.6. Nous ne prendrons bien sûrpas parti ici mais on là de parfaits exemples de la partialitéde ceux qui, selon leur appartenance, écrivent l’histoire.
Il ne faut non plus que les mots cachent les idées(rechercher l’idée derrière le symbole !). Ainsi les maçons, aulieu de réunir ce qui est épars, se battent pour des mots« clivants »7. Il en est aujourd’hui tout particulièrement du
5 Roger Dachez avait écrit dans le numéro hors-série Le Point-Historia defévrier-mars 2013, 100 idées reçues sur la Franc-maçonnerie (et son histoire), 32 articles(sur les 100), dont un intitulé : La Grande Loge de France existe sans discontinuitédepuis 1738 : FAUX. Cet article avait été considéré comme factuellementinexact, et même presqu’injurieux, par le Conseil Fédéral et son GrandMaître, Marc Henry, entrainant les ruptures en cascade que l’on sait.6 L’histoire des premières années du (ou des) Suprême (s) Conseil(s) deFrance est suffisamment embrouillé pour permettre des interprétations pourle moins divergentes. Le schisme de 1964-65 et les mises à l’index duSuprême Conseil pour la France par la Grande Loge de France ont abouti àplusieurs Suprêmes Conseils se voulant tous légitimes. Le problème desreconnaissances internationales (Juridiction Sud des Etats-Unis)n’arrangent rien ! 7 De manière générale, tous les Maçons s'appuient également sur la stabilitéde leurs rites et l'on a là peut-être un motif de la crispation des Frèressur leur pratique rituelle. Le besoin de stabilité du matériau est unpuissant moteur de distinction et de séparation pour garantir le tempsd'assimilation nécessaire à chaque pratiquant. Pour aller profond àl'intérieur, il faut stabiliser l'extérieur. Il n'est pas difficile ici decomprendre l'aspiration profonde des Frères à la paix politique etsociale : le monde doit être stabilisé, notamment dans ses rythmestemporels, pour laisser s'épanouir l'initiation en nous. Il n'est pascompliqué non plus de comprendre ici la tension entre le concept d'Écrituresainte et les multiples formes et traductions qu'elle a pris au cours del'histoire. La stabilisation reste relative à la communauté qui l'appellede ses vœux et qui accepte de recevoir une traduction précise parmi
4
fait du remaniement du « paysage maçonnique » du mot régularitéqu’on oppose au nom de l’histoire à celui de reconnaissanceparfois de façon catégorique, comme aujourd’hui Alain Bernheim8
qui fustige sur ce terrain ces « adversaires », notamment RogerDachez et Alain Bauer. Déjà Albert Lantoine avait tenté dedéfinir la régularité9. Plus récemment Henri Jullien s’étaitlancé dans ce « combat »10 qui alimente les blogs. L’historienparfois ne prend pas le recul nécessaire et, là, tend à serapprocher, par son attitude, du journaliste d’opinion ».
Nous allons prendre quelques exemples où l’objectivité estpour le moins contestable : les premières loges françaises, la« passion écossaise » et la querelle des Ancients et des Moderns.En fait ces exemples se recoupent et, nous le verrons,soulignent les a priori des auteurs.
La « fameuse » loge La Parfaite Egalité du régiment irlandais de Walsh de 1688
Le premier exemple, la date de la première loge française,est classique. Bon nombre d’historiens l’évoquent avec uneobjectivité pour le moins contestable. Il concerne la« fameuse » loge La Parfaite Egalité du régiment irlandais de Walsh,installée à Saint-Germain dans l’entourage des Stuarts en1688, qui serait la première loge installé sur le territoirefrançais11. Lorsque Daniel Kerjan intitule un ouvrage Les débuts
d'autres.8 Alain Bernheim : Régularité Maçonnique, Télétès éditions, 2015.9 Albert Lantoine : De la régularité maçonnique. I, in Symbolisme n° 72 de mars1924,De la régularité maçonnique. II, in Symbolisme n° 73 d'avril 1924,De la régularité maçonnique. III, in Symbolisme n° 74 de mai 1924.10 Henri Jullien : Régularité exotérique et tradition ésotérique en Franc-maçonnerie,Editions du Prisme, 1973.11 Voir Annexe 1. Signalons, entre autres arguments mettant à mal cetteexistence, ce que dit Etienne Gout : « Disons seulement ici, après avoirprocédé aux vérifications les plus approfondies, qu’il n’y a eu de loges derégiment ni en Irlande ni ailleurs avant 1732 : il n’y en avait donc pointà Saint-Germain en 1891 » (in Ordo ab chao n°30 second semestre 1994, Lagenèse de l’Ecossime français, p. 12). Certes les militaires, comme lescommerçants, voyageant, exportent la maçonnerie. Ainsi en France, laG.L.N.F., seule obédience reconnue par la Grande Loge Unie d’Angleterre, abénéficié de l’implantation de l’OTAN après-guerre. Mais ce furent desmilitaires qui vinrent soit fonder, soit renforcer les loges de l’obédience
5
de la franc-maçonnerie française, de la Grande Loge au Grand Orient 1688-179312,l’ajout 1688 13 -1793 est pour le moins tendancieux. C’est laisserentendre non seulement, dès le titre de l’ouvrage, que cetteloge de Saint-Germain existe certainement, et rien n’est moinssûr, et qu’elle a un rôle dans le développement en France de lamaçonnerie, alors que l’on ne connaît aucun lien entre cettesupposée loge et les premières loges françaises qui vont sedévelopper presque 40 ans plus tard, à partir de 1725. On netrouve trace d’aucun maçon français, d’aucune correspondance seréférant à cette loge. Elle n’aurait pas « ensemencé » ! Enfait affirmer l’existence de cette loge n’a d’autre but que deprouver également un fait « tendancieux » que nous verrons plusloin : les premières loges seraient stuardistes, ce qui est,disons-le tout de suite, au moins en partie inexact.
Kerjan, toujours pour accréditer cette thèse, écrit que :« la loge souche ‘Anglaise’ de la Constance (d’Arras) » auraitété érigée en 1687. Le document est apocryphe : il s’agitprobablement de la réécriture ultérieure d’un document disparu.On peut considérer cette datation comme totalement fiable »14.Et il s’appuie sur les travaux d’André Kervella15. Mais celui-ci n’a jamais affirmé cela ! Bien plus Claude Gagne rappelleque Etienne Gout avait montré en 1982 qu’il s’agissait là d’unesupercherie16. Kerjan cite la « confidence de Valentin Bertindu Rocheret » pour étayer son affirmation de l’existence la(cf. Jean Murat : La Grande Loge Nationale Française, PUF, Que sais-je ?, 2006, p.27.-28). Mais ces loges militaires laissent des traces !Louis Trébuchet (in De l’Ecosse à l’Ecossisme Fondements historiques du Rite Ecossais Ancien etAccepté, Tome I, Volume I 1475-1743, 2012, Ubik éd. Coll. Fondations, p. 116-117)parle du Régiment de la Garde Irlandaise du Colonel Lord WilliamsDorrington pour la loge La Parfaite Egalité et du Régiment Ecossais du ColonelDillon pour la loge La Bonne Foi. Il met des conditionnels mais parle « auminimum de fortes présomptions ». Il étaye aussi son argumentation surBertin du Rocheret et sur le vaudeville Les freimaçons, qui aurait été saisien 1705 chez le libraire Huchet. Cette date est plus que contestable (cf.Annexe 1)12 Daniel Kerjan : Les débuts de la franc-maçonnerie française, de la Grande Loge au GrandOrient 1688-1793, Dervy, 2014.13 C’est nous qui soulignons.14 Ibid. p. 3315 André Kervella : La maçonnerie française de l’Ancien Régime, éd. du Rocher, 1999,p. 334-339.
6
loge de Saint-Germain, mais il s’agit d’un manuscrit d’unapprenti qui, 50 ans après, en 1737, rapporte des proposd’agapes sur l’existence de loges stuartdistes en 168917. Quelcrédit donner à ce premier « on dit que » ! Toutefois Kerjanest obligé de conclure : « De 1688 à 1721, soit durant trente-trois ans, on ne recense ainsi aucune activité maçonniqueattestée sur le territoire français, si l’on s’en tient auxseuls critères d’activité ou de création de loge »18. N’allonspas plus loin et essayons de conclure : certains historiens dela maçonnerie, bien que rapportant des faits, bien qu’utilisantle conditionnel, présentent ceux-ci de façon pour le moinsbiaisée par manque d’objectivité, parce qu’ils cherchent àprouver une thèse, ici la « naissance jacobite, stuardiste,écossaise de la franc-maçonnerie en France ». Or même avec cesrudiments d’arguments offerts au lecteur qui peut se laisserabuser, cette thèse reste difficile à affirmer. On va le voir.Ce mode d’écriture me semble déontologiquement critiquable.
Un document de 1705 ?
Il est un texte que citent volontiers les tenants del’existence d’une maçonnerie jacobite implantée en France etantérieure à la maçonnerie hanovrienne. Il s’agit d’unmanuscrit intitulé : Les Freimaçons Vau de Ville sur un air anglois. Ladatation proposée par certains est des plus douteuses. Ce breftexte19 pourrait dater de 1705 environ. Reportons-nous à16 Claude Gagne : Introduction à la genèse de l’Ecossime français, in Ordo ab chao n°30second semestre 1994, p. 12.17 Voir Pierre Chevallier : Histoire de la Franc-maçonnerie française, Tome 1 : LaMaçonnerie : Ecole de l’Egalité 1725-1799, p. 5 : « note mise en bas de page d’unelettre par Bertin du Rocheret… , en 1737, par laquelle il désigne ainsi laFraternité : ‘Société ancienne d’Angleterre introduite en France à la suitedu Roy Jacques II en 1689’ ». On notera que la date du début de laMaçonnerie française retenue dans le titre par Chevallier est 1725 ! André Kervella : La passion écossaise, Dervy, 1999, p..142. (Bibliothèque de Chalons, Manuscrit 125, Lettre au P. Thierrion, p. 240).18 Daniel Kerjan : op. cité p.35.19 Les Freimaçons
Vau de Ville sur un air anglois Nul n’a pénétréLeur signe sacréPartout visible et partout ignoréDe toute êternité
7
l’analyse d’Alain Mothu20. Avant d’analyser ce texte celui-ci,reprenant ce qui vient d’être dit, utilise des conditionnels :« Il n’est pas douteux qu’il a pu exister des Loges parmi lesunités restés fidèles aux Stuarts après la seconde révolution…Mais les preuves manquent et l’historien en est réduit à proposerdes conjectures vraisemblables »21. Mothu reste prudent ! Il publiece texte assez bref et ajoute à sa suite : « On saisitimmédiatement l’intérêt que présente ce document supposé daterdes premières années du XVIIIe siècle. Car l’existence en Franced’une maçonnerie jacobite antérieure à 1725 est suggérée parquelques allusions tardives22 comme on l’a vu, on sait qu’aucundocument d’époque ne venait jusqu’à ce jour l’étayer… »23.Mothu reconnait qu’ « on ne peut cependant le garantirabsolument car le document n’est pas daté »24 ! Pourquoi car ils’agit d’un document classé, ou reclassé, dans les papiers d’undétenu à la Bastille (Huchet) ; or « l’on sait que les archivesde la Bastille subirent bien des vicissitudes au cours de lapériode révolutionnaire (elles furent jetées par les fenêtresde la Bastille au moment de la ‘prise’ de la forteresse) »,ajoute Mothu. Ce qui ne l’empêche pas de conclure : « Endéfinitive, le document paraît fournir un indice sérieux enfaveur de l’existence d’une maçonnerie continentale antérieureà 1725, vraisemblablement d’inspiration jacobite »25 etd’ajouter sans sourire in fine « Il reste qu’un examen approfondide l’histoire de ces archives Huchet reste à faire »26.Retenons que rien dans ce texte ne permet de le classer commejacobite et que rien de rattache Huchet, pourtant incarcérépour « trafic de livres prohibés », ni aux jacobites ni à une
Par nos maçons le monde fut voutéDiscret et fidelleJamais d’une BelleLibre maçon ne s’est vu refuséa-t-il proposéautant de toisé (référence à la mesure, la toise)à nos maçons tout ouvrage est aisé
20 Alain Mothu : A propos du secret des Francs-Maçons – Une référence jacobite (1705 ?) inStudia Latorum & historica, in Mélanges offerts à Daniel Ligou, en collab. avec CharlesPorset, Honoré Champion éd., Paris 1998, p. 327-333.21 Ibid. p. 328.22 Il n’y a eu qu’une, à notre connaissance, celle déjà citée !23 Ibid. p. 332.24 Ibid. p. 332.25 Ibid. p. 332.26 Ibid. p. 333.
8
quelconque pré maçonnerie ! « Voilà comment on écritl’histoire » !
La querelle des Ancients et des Moderns
Depuis quelques années il est un leitmotiv que l’onretrouve chez nombre d’auteurs : le R.E.A.A. est issu de lamaçonnerie des Antients, celle de la Grande Loge de Dermott,alors que le Rite Français descend, lui, de la maçonnerie desModerns, celle d’Anderson. Bien sûr on donne moult arguments,faisant appel au besoin, pour contourner quelques obstacles,aux « antédiluviens », comme le fait notre frère et ami LouisTrébuchet27.
27 Voir par exemple la superbe conférence de Louis Trébuchet : Les Antédiluvienset les Modernes, Académie Maçonnique le 17 mars 2012 in Mémoires del’Académie Maçonnique n°3, Ed. La Hutte 2014, p. 55-74.
9
Pourtant il faut avoir un esprit partisan pour faire detelles assertions. Nul n’ignore que le R.E.A.A., qui a pourancêtre direct le Rite de Perfection, ou pour être plus exactsur le plan terminologique, l’Ordre du Royal Secret, necommence qu’au 4e degré. Or les rituels des Moderns, comme ceuxdes Antients, ne concernent que les trois premiers degrés. Mêmesi la genèse des rituels des Hauts Grades n’est pas connue aveccertitude - et nous n’entrerons pas ici pour l’instant dans cedébat -, il est établi que ces degrés, au-delà de la maîtrise,ont été élaborés de façon prolixe entre les années 1730 (etpeut-être même avant la naissance d’un 3e grade centré sur lalégende d’Hiram) et les années 1760. Ils ont « proliférés » enFrance, mais aussi à Berlin, sans doute aussi à Londres et enGrande-Bretagne. Ce sont ces grades qui ont été regroupés enrites formant des ensembles cohérents. En 1762 Etienne Morin,muni d’une patente, part pour les Antilles où il parvient aprèsun passage en Angleterre. Il finit sans doute peu après sonarrivée, avec Henry Andrew Francken, la mise au point de sonsystème en 25 degrés, déjà fortement élaborés en 176228. Tousces rituels sont connus en France et pratiqués dans différentsorients. C’est à partir de la même base que va s’élaborer leRite Français Moderne, parfaitement codifiés en 178629. Le RiteFrançais en sept degrés qui en découle, qu’on le veuille ounon, reprend pour ses quatre « Ordres Supérieurs » quatregrades bien connus du R.E.A.A. : Elu, Ecossais, Chevalier d’Orient etRose-Croix.
28 Voir Les Constitutions et réglemens rédigés par neuf commissaires nommés ad hoc par leSouverain Grand Conseil Sublime des Sublimes Princes du Royal Secret, etc., etc., etc.,, Orient deParis et Orient de Berlin, dites Constitutions de Bordeaux de 1762.29 Rituels du Rite Français Moderne 1786, Préface de Daniel Ligou et Postface de GuyServal, Champion-Slatkine Paris et Genève, 2 vol. 1991 et 1992,
10
Ces rituels des Hauts Grades ont été élaborés encomplément de la maçonnerie « andersonienne », donc moderne, laseule pratiquée en France ou à Berlin notamment à cette époque.La disposition des « surveillants », tous deux à l’Orient, lanécessité d’une « suite » à la légende d’Hiram sont desexemples de cette filiation évidente Moderns-Hauts Grades. Onne connaissait pas encore en France les subtiles différencesque les Antients ont apportées aux rituels « andersonniens » en1757 avec la création de la Grande Loge des Antients. Il faudraattendre la diffusion de The three distincts knocks en 176030 (Les troiscoups séparés) pour que ces rituels des loges symboliques soientconnus, donc bien après la rédaction de la plupart des HautsGrades. Lorsque Grasse Tilly, qui importa en France leR.E.A.A., écrivit son Thuileur31, il donne pour les rituelssymboliques deux séries, une moderne, une ancienne et ne parledu R.E.A.A. proprement dit qu’à partir du 4e degré, comme lesmanuscrits de Saint-Domingue et les versions du Francken duRite en 25 degrés. Les rituels qui sont censés servir de baseaux degrés symboliques du R.E.A.A. (Guide des Maçons Ecossais32)sont donc postérieurs au R.E.A.A. proprement dit. Certes onsait que les fondateurs américains de ce rite appartenaient en« bleu » à la Grande Loge des Anciens de Caroline du Sud, maisaussi que Grasse Tilly et son beau-père Delahogue les ontrejoints après avoir quitté la loge symbolique qu’ils ont tousdeux présidée et qui était rattachée à la Grande Loge desModernes33. Certes le premier ensemble des Rituels du R.E.A.A. de180534 comporte les rituels des trois premiers degrés, inspirésdes Anciens (2e surveillant au Midi, présence de deux diacres),mais il s’agit là aussi d’une rédaction tardive pour les degrés
30 The Three distinct Knocks, Or the Door of the most ANTIENT FREE-MASONRY, Opening to all Men,Neither Naked nor Cloath'd, Bare-foot nor Shod, &c. (...), (Les trois coups séparés ou la porte de la plusancienne franc-maçonnerie ouverte à tous les hommes etc.), 1ère éd. Londres 1760. VoirPhilippe Langlet Les textes fondateurs de la franc-maçonnerie, Tome II, EditionsDervy, Paris, à paraître.31 Grasse-Tilly : Thuileur Rite Ecossais Ancien et Accepté et Rite Moderne, manuscrit de1813, publié par le Suprême Conseil pour la France, Paris 2004.32 Voir Pierre Noël : Guide des Maçons Ecossais à Edinburg 18.*. – Les grades bleus duR.E.A.A. Genèse et développement, A l’Orient 2006.Laurent Jaunaux : Le rituel des anciens ou éditions 1804 du Guide des Maçons Ecossais, Dervy2004.33 Voir à ce sujet les mise au point d’Alain Bernheim, notamment : Le Rite en33 grades - De Frederick Dalcho à Charles Riandey, Dervy 2011.34 Rituels du R.E.A.A. de 1805, Transcription du u Manuscrit XXVII de laBibliothèque Kloss, Latomia 1993.
11
« bleus ». Il a fallu « tordre » les rituels des Antients,notamment le 3e, pour l’adapter à la suite que constituent lesHauts Grades, notamment sur la fin de la légende d’Hiram etpour la notion de Parole perdue35. Quelques points restentfermement établis : les Hauts Grades, dans leur partiecontenant la fin des « questes hiramique et salomonienne », ontla même origine pour le Rite Français et pour le R.E.A.A, demême la notion de deuxième Temple et le rituel de Rose-Croix ysont traités de façon similaire. Tous ces rituels peuvent êtreà la rigueur qualifiés de « modernes », sûrement pas d’« anciens ». Autre détail, mais non des moindres, pour montrerles difficultés qu’ont les tenants de la théorie rattachant leR.E.A.A aux Antients : il existait (et cela persiste encoreaujourd’hui au moins pour le 3e degré) des rituels symboliquessensiblement différents pour le Suprême Conseil et pour laGrande Loge, ce qui pouvait, on s’en doute, dérouter les plusjeunes maçons, par exemple lorsqu’ils assistaient à la Fête del’Ordre, ouverte au 1er degré par le Suprême Conseil. On a plusou moins pallié ce hiatus, mais sans faire l’indispensable sil’on veut se prétendre, au moins au niveau symbolique se direAntient : réintroduire les diacres36, ce qui existe, on l’a vuplus haut, dans le rituel de 1805 de Latomia37. Enfin commentpeut-on se dire Antient et interdire la cérémonied’Installation du Vénérable Maître !
35 Le rituel des Ancients du 3e degré supprime la nécessité d’une suite« hiramo-salomonienne » : il précise notamment que les assassins ont étéretrouvés et châtiés. La notion de Parole perdue est différemment traitée.Disons pour simplifier : perte de la Parole (rite andersonnien) ounécessité d’être trois pour qu’elle soit « efficiente » (rite Antient).36 Ce qui ne sera pas repris, les diacres sont nommés ; Expert et Maître desCérémonies, ce qui fait moins « confessionnel !37 Op. cité.
12
En fait pourquoi cette querelle ? Pour être « brutal » onpeut dire que puisque le Rite Français est « moderne »,andersonien, pour se démarquer le R.E.A.A. se doit d’être« ancien ». En d’autres termes le G.O. est « moderne » et leS.C.D.F se dit « ancien », même si en pratique cela ne veutrien dire. Ajoutons d’autres connotations : moderne veut dire,pour certains, andersonien, donc pratiquement anticatholique et« presque »athée, alors que les Anciens se veulent catholiques,anglicans sinon romains – bien que Dermott lui-même ait étéprotestant38 !- désireux de redonner une spiritualité auxrites39.
38 Cf. Ric Berman : Schism – The battle that Forged Freemasonry, Sussex Academy Press,2013, p. 22-23.39 Un bémol à cette lecture : la GLAMF : son nouveau Grand Maître, ClaudeBeau, dans un discours prononcé à Tours le 10 janvier 2015 parle de : « uneMaçonnerie dans la lignée des premières Constitutions de 1723 ». Bien plusson prédécesseur, Alain Juillet, issu du R.E.A.A., parlait bien, lui aussi,de Maçonnerie « andersonnienne » : « la Confédération Maçonnique de Francerepose, désormais, sur trois piliers …- ensuite, son ancrage dans le courant de la Maçonnerie « andersonienne »,celle des origines, celle de la quête spirituelle la plus ouverte, dans larigueur des travaux et le respect des rituels, ayant pour objet deperfectionner l'homme pour qu'il puise alors, et alors seulement,intervenir dans la société… » Paris 17 décembre 2014. Cela a du fairegrincer quelques dents !
13
Mais au risque de lasser, il faut montrer que même cesprésupposés sont erronés : dans un travail à paraître40 on acomparé les rituels des trois degrés symboliques des Antients,tels que pratiqués à l’époque (tiré du célèbre The Three DistinctsKnocks41), celui des Moderns (Masonry dissected42), et celui duR.E.A.A. tel que pratiqué en 2000 à la Grande Loge deFrance43 : le rituel du R.E.A.A. est, à l’évidence, beaucoupplus proche de Masonry dissected que de The Three Distinct Knocks ! Biensûr, ces historiens sont tous honnêtes et croient ce qu’ilsécrivent, mais ils oublient parfois, dans leur élan vers leurconception personnelle de la maçonnerie, que la vérité ne collepas toujours exactement avec leur souhait !
40 Philippe Langlet : Les trois coups espacés, traduction et présentation de TheThree Distincts Knocks, 2015, op. cité.41 The Three Distincts Knocks, 1ère edition H. Sergeant Londres 1760.42 Masonry dissected, 1ère edition Londres 1730.43 Rituels des 3 premiers degrés, Grande Loge de France 2000.
14
En guise de transition vers la seconde partie, on peutrappeler quelques exemples tirés de l’Histoire en général. Lepremier est celui de la vision du peuple gaulois : à la fin du XIXe siècle il était de bon ton d’en faire un ramassis deguerriers arriérés et assoiffés de sang que les Romains, sousla conduite de Jules César ont su coloniser, civiliser… Ilssont sortis de leurs huttes pour vivre dans des cités avec delarges voies romaines leur permettant une libre circulationpour un commerce prospère. Bien sûr, le tout était étayé par lecélèbre Commentaires sur la Guerre des Gaules (De bello gallico) rédigé parle vainqueur : ce sont toujours ceux-ci qui écriventl’Histoire. C’était la seule source connue à l’époque (etencore aujourd’hui beaucoup ne se réfèrent qu’à ce livre, quetous les élèves du collège inscrits en latin ont longuementcôtoyé44). Cela, en plus et surtout, servait à justifier lecolonialisme : les Français, descendants des Gaulois (et desRomains !), allaient à leur tour apporter les bienfaits de lacivilisation en Algérie, en Afrique etc. Aujourd’hui lesarchéologues ont montré que les Gaulois vivaient dans desvilles, disposaient d’une culture différente de celle de leursconquérants, mais très élaborée, connaissaient le traitementdes métaux, avaient un sens artistique développé etc.Conclusion : il faut savoir que les découvertes scientifiquesremettent ou peuvent remettre en cause les conceptions les plusprofondément ancrées… à condition de savoir les accepter.
44 Les lettrés qui ont fait du grec se sont, eux, longuement penchés surCyrus, grâce à Xénophon, notamment : c’est comme cela que se gravel’histoire dans nos esprits.
15
Autre exemple : le danger des anachronismes. Il y aquelques années Robert Hossein, génial concepteur de spectaclesaudacieux, proposait une reconstitution de la vie de Marie-Antoinette et demandait à le fin du spectacle de voter pour oucontre la peine de mort pour la reine soupçonnée de hautetrahison ! Comment se prononcer pour celle-ci à une époque où,abolie en France, elle n’est même envisageable pour les pireset les plus abominables criminels. Prenons gare à cecomportement : on ne peut pas juger le passé avec le regardd’aujourd’hui. Aristote, le prince des philosophes pourbeaucoup, encensait l’esclavagisme : l’esclave a autant besoindu maître que l’inverse ; ils forment un couple complémentaire.Et nous serons jugés, nous, comme nous jugeons nos aïeux : sanspitié pour nos erreurs ou nos errements !
Déontologie : c’est ne pas se laisser abuser par seschoix, son idéologie, c’est le plus facile, mais aussi lecontexte social, culturel qui nous entoure. Ecrire l’Histoire,la penser, c’est déjà agir en fonction de la conception quel’on a des valeurs qui sont les nôtres, c’est juger l’Autre àl’aune de notre propre culture. Tzvetan Todorov a bien montrécomme c’était difficile, combien cela menait aux pires desexactions en toute bonne foi45, mais ceci est… une autrehistoire !
II - Démarche : Sciences et paradigmes
Est-ce à dire que l’historien, pour s’en tenir àl’objectivité, à la plus grande neutralité possible, doit secontenter de chercher, de collationner, de relater les faits,rien que les faits, tous les faits, comme l’ont fait, dansd’autres domaines, Aristote, Buffon ou Frazer ? C’estl’objectif de certains, Alain Bernheim par exemple. Cela sembleimpossible : la masse des faits devient vite insurmontable,leur choix, leur tri, leur simple classement, on l’a dit, estdéjà une marque de subjectivité. Mais, de toute façon, il faut
45 Entre autres : Tzvetan Todorov : La Conquête de l'Amérique : La Question de l'autre,Seuil, Paris 1982,Nous et les Autres, Seuil, Paris 1989.Mémoire du mal, tentation du bien - Enquête sur le siècle, Robert Laffont Paris 2001.La peur des barbares : au-delà du choc des civilisations, Le livre de poche Coll. BiblioEssais, Paris 2009.
16
aller plus loin. Si l’Histoire se veut scientifique, elle doitse soumettre aux lois des sciences. Quelles sont ces lois ?Surtout sont-elles toujours applicables à l’Histoire ? On sait,depuis Karl Popper notamment, qu’une science n’est une scienceque parce qu’elle émet des hypothèses, des paradigmes46, quiexpliquent tous les faits recensés et qui sera loi jusqu’à ceque de nouveaux faits la rende caduque et oblige les savants àémettre un nouveau paradigme. Il en est ainsi dans les sciencesphysiques, en biologie. Il est évident que les lois dessciences dites « dures » ne sont pas toutes applicables auxsciences biologiques et, plus encore, aux sciences humaines.Mais celle-ci est, à nos yeux, essentielle et peu appliquée, dumoins de façon consciente et lisible : celle énoncée par KarlPopper47 de falsifiabilité des paradigmes (on parle aussi du« falsificationnisme » poppérien ou plus simplement deréfutabilité). Celui-ci rappelle, à maintes reprises, qu’unescience n’est une science que si elle est « falsifiable ». Ilentend par là que, dans d’autres conditions expérimentales,elle peut devenir fausse et doit être mise à l'épreuve de faitsnouveaux pouvant la corriger, l'améliorer. Toute loi physiqueest un paradigme, modèle qu’il convient en quelque sorte desavoir transgresser. Par exemple la psychanalyse qui refuse lanotion de « fausseté » n’est pas une science pour Popper.Pourquoi n’en serait-il pas de même dans les sciences humaines,en histoire par exemple.
En résumé si on veut faire de l’histoire une science, mêmesimplement une science « humaine », il faut qu’elle obéisse auxlois de toute science, notamment celles si magistralementdonnées par Karl Popper : il faut bâtir une théorie, un
46 Nous entendrons par paradigme une théorie qui tient compte de tous les faits connus établis, n'excluant aucun de ceux que nous connaissons est susceptible, selon les critères de Karl Popper d'être « falsifiable ».47 Karl Popper : Les deux problèmes fondamentaux de la théorie de la connaissance (titreoriginal : Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie, 1930-1933, Hermann.Logique de la découverte scientifique (titre original : Logik der Forschung, Logique dela recherche ; The Logic of Scientific Discovery, 1934Conjectures et réfutations (Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, 1963)La connaissance objective (Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, 1972) ;traduction partielle de l'anglais (trois premiers chapitres), 1977,Éditions Complexe, (ISBN 978-2-87027-020-2) ; traduction complète de Jean-Jacques Rosat, Éditions Aubier, 1991.Toute vie est résolution de problèmes – Questions autour de la connaissance de la nature, trad.Claude Duverney, Acte Sud, Coll. Le génie du philosophe, 1997.
17
paradigme qui tienne compte de tous les faits connus, à unmoment donné, et être prêt à établir une nouvelle thèse, unnouveau paradigme, dès qu’un fait contradictoire est mis enévidence, par exemple en histoire la découverte, j’allais direl’invention, d’un nouveau document, ou parfois un simpleréexamen de ceux-ci. Un excellent exemple récent d’un telchangement de paradigme est illustré par la théorie dite « del’emprunt » qui remplace celle de « la transition »48 : lesfrancs-maçons spéculatifs, obédientiels modernes ne sont pasdes descendants directs des opératifs mais ont emprunté à ceux-ci leurs rites, symboles, lois, règlements etc. ; les logesconstituant en 1717 la Grande Loge de Londres et deWestminster, tout comme celle-ci, ont été des créations de novon’ayant jamais connu de maçons opératifs. Roger Dachez en a étésinon, l’inventeur49, du moins le promoteur. Il résumeparfaitement ce paradigme dans son ouvrage : L’invention de la franc-maçonnerie – Des opératifs aux spéculatifs50. Autre exemple de paradigme,celui de Pierre Noël sur la genèse des grades bleus duR.E.A.A.51
Mais, bien sûr, il faut toujours distinguer les faits et lesinterprétations. Des faits choisis, sélectionnés parmi tant dedocuments, et subtilement analysés, peuvent inciter leschercheurs à ébaucher ou à construire d'autres théories.Aujourd'hui on sait bien qu'en sciences humaines il est vain dechercher la loi unique, la théorie à laquelle tout peut serésoudre. La nomologie n'a plus cours. Le sociologue etl’ethnologue cherchent, à partir de multiples faits établisavec autant de certitude que possible, à bâtir un paradigme età montrer que celui-ci est valable dans des circonstances d'uneépoque et dans un lieu donnés. Et le paradigme n'est, répétons-le, on ne saurait trop insister, que provisoire destiné à êtreremplacé par un autre mieux adapté à de nouveaux faits, à une48 Pour faire court: la théorie de la transition affirmait qu’il y a eu deplus en plus de spéculatifs dans les loges et que ceux-ci ontprogressivement remplacé les opératifs qui ont fini par disparaître. Elle alongtemps été défendu par Henry Carr puis par W. Mc Leod (Why I steel believe inTransition Theory, The Cryptic Scholar , 1991, p. 60-67).49 C’est surtout à E. Ward qu’on doit ce paradigme : The Birth of Freemasonry,AQC 91, 1978, p. 77-116 ;50 Roger Dachez : L’invention de la franc-maçonnerie – Des opératifs aux spéculatifs, Ed. Véga2008.51 Pierre Noël : Guide des Maçons Ecossais à Edinburg 18.*. – Les grades bleus du R.E.A.A.Genèse et développement, A l’Orient 2006.
18
nouvelle interprétation de ceux-ci, plus conforme aux donnéesrécentes de la science et de la recherche.
Karl Popper52 expose le schéma en trois points qui doitcaractériser toute évolution animale, humaine et toute attitudescientifique :
1- poser le problème ;2- essai de solution ;3- élimination.
On reste très près d’une vision darwiniste du comportementdu vivant. Popper ajoute : « Les tentatives inverses, à savoircelles qui visent à préserver une théorie de la falsification,ont aussi leur fonction méthodologique, comme nous l’avons vu.Mais je prétends qu’une semblable attitude dogmatique estessentiellement caractéristique de la pensée préscientifique,tandis que l’attitude critique, la tentative de falsificationconsciente, conduit à la scientificité et domine la méthodescientifique. »53.
Les critiques feront remarquer que le refus de touteholisme chez Popper le conduit à poser, lui aussi, une loiuniverselle. Il est difficile d’échapper à la logique del’autoréférence ! tel le célèbre aphorisme : je suis content dene pas aimer le camembert, car si je l’aimais, j’en mangerai,or je n’aime pas le camembert !
L’histoire de la franc-maçonnerie ne manque de« problèmes » non résolus selon le point n°1. Quelquesexemples :
- de quand date la création d’un 3e degré ? Où ? Avecquelle thématique ? Pourquoi Hiram ?54
52 Karl Popper : Toute vie est résolution de problèmes, Acte Sud, 1977 : tome 1,chap. 1 La doctrine de la science du point de vue évolutionniste et logique.53 Ibid. p. 27.54 Les paradigmes sur la genèse du 3e degré ont été multiples. Citonssimplement deux auteurs :- Goblet d’Alviella : Des origines du grade de Maître, Bulletin du Grand Orient deBelgique 1906, rééd. J. Wève et E. Lonnay Bruxelles 1928, Guy Trédaniel1983.- Roger Dachez : Essai sur les origines du grade de Maitre in Renaissance Traditionnelle91/92 (juillet-octobre 1992) p.218·232 ; 96 (octobre 1993) p.224-237 ;97/98 (janvier-avril 1994) pp, 20-29 et 99 (juillet 94) p.139-165 VI.Approches d’une conclusion.
19
- L’origine du mot Ecossais : pourquoi parle-t-ond’Ecossisme ? Depuis quand ?
- La naissance des Hauts Grades : où ? quand ? comment ?pourquoi ?
On voir déjà qu’il est nécessaire de bien poser leproblème et de savoir, pour mieux le cerner, le découper. Et onva alors voir qu’une réponse possible peut s’appliquersimultanément à plusieurs problèmes. Par exemple en ce quiconcerne le 3e degré, on est à l’évidence obliger de dissocierle thème actuel de l’élévation à la maitrise, la légended’Hiram, de la création du 3e grade. Ainsi pour Jan A.M.Snoek55 : « La thématique du grade de maître dans sa versionpré-Hiramique peut être résumée ainsi. Le temple de Jérusalemest détruit. La prononciation du nom de Dieu est perdue. Pourpouvoir prononcer à nouveau correctement le nom de Dieu, ilfaut retrouver les voyelles et les introduire dans leTétragramme. Elles seront trouvées dans les noms des colonnes‘Jachin’ et ‘Boaz’ et elles seront également conservées dans lemot de substitution ‘Adonaï’. On peut construire tout cela surla base des différents textes d'avant 1720, relatif aux gradesécossais originels et au deuxième grade du système en deuxgrades que nous avons »56.
Retenons aussi l'idée (le paradigme) que les Hauts Gradesne prennent pas forcément naissance après l'adoption de lalégende d'Hiram comme fondement de la cérémonie d'élévation autroisième degré (exemple 3). Ceux-ci naissent probablement enmême temps qu'elle. Le premier élément qui induit la nécessitéde grades au-delà de la maîtrise est la perte de la Parole oude la possibilité de la transmettre. Le deuxième élément est la
Roger Dachez : Hiram et ses frères - Essai sur les origines du grade de Maître, Ed. Véga,2010.
55 Jan A.M. Snoek : Trois phases du développement du grade de Maître, Acta macionica,volume 14 (6004), 2004, Bruxelles p. 9-24.Jan A.M. Snoek : The evolution of Hiramic Legend in England and France, Heredom,Washington 2003, vol.11, 11-5356 Ibid. Acta macionica p.12.
20
destruction du Temple ou, ce qui revient au même, la mortd'Hiram.
Des travaux récents sur ces questions, reposant sur desdécouvertes nouvelles, tentent d’élaborer des paradigmes(essais de solutions, 2e étape du schéma défini par Popper).Citons deux textes très récents : le travail très exhaustif ettrès fouillé de Paul Paoloni, Quatre grades et cinq mots : voyage dans lapremière franc-maçonnerie57 et un article de Pierre Mollier, Le« Maître Ecossais » : sur la piste du plus ancien haut grade58. Ce dernierillustre à merveille la notion de paradigme « falsifiable » ouréfutable. Pierre Mollier montre comment compléter et réviserle paradigme émis précédemment par René Guilly. Il écrit enavant-propos : « Des historiens, comme René Guilly, avaientsouligné combien les plus anciens Hauts Grades – comme le« Royal Arch » (attesté en Irlande en 1743) ou le « MaîtreParfait » et le « Maître Ecossais » (attesté à Paris en 1744) –présentaient des points communs et semblaient répondre àla fixation du « nouveau » grade de Maître en 1730 ». Nousavions nous-mêmes, reprenant les différents travaux antérieurs,tenté de faire une synthèse (paradigme) dans Abrégé d’histoire duR.E.A.A.59. Chaque élément découvert ou plus subtilement analysépermet de progresser et nous proposons de publier prochainementun paradigme plus élaboré, prenant en compte les travaux leplus récents.
Ainsi l’étude des listes successives des loges composantla Grande Loge de Londres, puis les autres Grandes Logesbritanniques du XVIIIe siècle n’avait guère été entreprise. Ondisposait de travaux considérables de recension de ces listes,dans AQC60 et par des ouvrages en anglais comme ceux Robert
57 Paul Paoloni : Quatre grades et cinq mots : voyage dans la première franc-maçonnerie inRenaissance Traditionnelle n° 175, juillet 2014, p. 122-188.58 Pierre Mollier : Le « Maître Ecossais » : sur la piste du plus ancien haut grade, in Franc-Maçonnerie Magazine n° 37 Janvier-février 2015, p. 22-2859 Jean-Bernard Lévy : in Abrégé d’histoire du R.E.A.A., Ed. La Hutte 2012, chapitreIII : Genèses des haurts grades du Rite Ecossais Ancien et Accepté de 1730 à 1760, p.93-126.60 Notamment John Lane : Another new list of lodges A.D. 1732, AQC n° 12, 1899, p. 32-39.
21
Freke Gould61, de A.F. Calvert62 ou encore de John Lane63. Cesouvrages sont en général des recensions et des fac-similés delistes mais ne comportent guère d’analyses synthétiques, saufcelui de Gould, permettant de faire un travail d’historien ausens que nous tentons de définir. Peu d’articles ou d’ouvragesen français s’y référaient. Il semble que leur exploitationsoit aujourd’hui « à la mode » : Louis Trébuchet et PierreMollier se réfèrent à l’une d’elles, celle de 173464. Maisrappelons qu’il y a eu une, voire plus, par an depuis 1722. EtPrichard, dans la 2e édition de Masonry dissected, également de1730, en donne également une65.
W.J. Hughan : A unique engraved list of lodges “ancient” A.D. 1753, AQC 19, 1906, p. 93-95.W.J. Songhust : Engraved list for 1728 in AQC n° 36, 1923, p.141-144.Arthur Heiron: Masters’ lodges, AQC n° 39, 1926, p. 114-41.A.R. Hewitt : The earliest engraved list of lodges in AQC n° 82, 1969, p. 254.61 Robert Freke Gould: The Four Old Lodges founders of Modern Freemasonry and theirdescendants, Barrister-at-Law, 1879.62 A.F. Calvert : Old engraved lists of masonic lodges, Kenning and son, London1920.63 John Lane : Masonic records 1717-1894, fist edition Freemason’Hall, London1887, second edition, Freemason’Hall, London 1895.64 Louis Trébuchet : De l’Ecosse à l’Ecossisme - Fondements historiques du Rite Ecossais Ancienet Accepté, Ubik éditions, Coll. Fondations - Sources et recherches, oct. 2012, Tome1, Vol. 2, 1475-1743, Documents, Liste des loges gravées par Pine 1734, p. 788-799.L’auteur souligne, dans son commentaire sur cette liste, que trois loges,sans date de création sont qualifiées de loges de Maîtres (il s’agit desloges n° 116, Masters Massons Lodge Burcher Row, n° 117 (Masters MassonsLodge Strand) qui disparaitra sur la liste de 1736, et n° 120 MastersMassons Lodge Burcher Row à l’enseigne de Date's Coffee House) et qu’uneest une loge de maçons écossais, Scotts Masons Lodge se réunissant à DevilTemple Bar en alternance les lundis avec la loge n°8 de 1733 à 1736 erdéménagent en même temps pour le Café Daniel dans Temple Bar. Trébuchetrappelle que Lane, dans le premier numéro d’AQC, pensait qu’il y avait defortes présomptions qu’il s’agissait des mêmes membres se réunissant à undegré différent, nomme écossais.Pierre Mollier in Franc-Maçonnerie Magazine n° 37, op. cité.65 Dans cette liste la loge n°8 se réunit à Temple Bar les 2e mardis et ilest précisé qu’elle a été fondée en le 25 avril 1722. Il semble qu’elle seréunissait auparavant les jeudis à l’enseigne de Duke of Chandois's Arms, àEdgworth (liste de 1728). Les loges portaient alors le nom de l’auberge oùelles se réunissaient et n’ont eu de numérotation définitive par ordred’ancienneté qu’à partir de 1729. Ces listes, gravées d’abord par Pine,reprenaient les listes officielles de la Grande Loge. Une étude« serrée » de ces listes permet d’enrichir nos connaissances sur lespremières loges « écossaises » et les premières loges de Maîtres ainsi que
22
Il y a de multiples façons d’élaborer, donc de proposerdes solutions de façon scientifique. En matière d’histoire lesdifférents modes de raisonnement, déductifs, inductifs…, sontutiles, mais à la base il faut des documents et, comme on vientde le voir avec l’exemple des listes de loges, savoir lesexploiter, les « traiter ». Dans le domaine de l’histoire engénéral et plus précisément dans celui de l’histoire de lamaçonnerie, on est confronté à certaines difficultés. Lesdocuments manquent car il s’agit souvent d’une tradition oraleet secrète. Ainsi quand les rituels ont été mis par écrits, ils’agissait de retranscription d’une pratique transmise debouche à oreille, donc soumise à des déformations. C’est ce queMollier dit en conclusion de son article sur le Maître Ecossais :« Cela expliquerait à la fois les profondes similitudes et lesdifférences notables que l’on trouve entre les différentesversions des rituels, ceux-ci n’ayant pas été fixés de la mêmemanière selon les auteurs maçonniques » 66. On sait aussi queles manuscrits ont été copiés et recopiés, souvent avecaltérations. Ainsi les mots de passe et mots sacrés, issus del’hébreu ou même du latin67, deviennent méconnaissables et onse perd ensuite en conjectures sur leur sens véritable ! Sanss’étendre sur le problème des documents, il faut rappeler queles textes, notamment manuscrits, sont difficiles à dater, doncà classer par ordre chronologique. Et l’on sait que lachronologie est l’ossature même de l’histoire. Comment établiune « généalogie » des Hauts Grades sans elle ! Reste aussi leproblème de l’authenticité. En effet les documents impriméssont rares dans la première moitié du XVIIIe siècle et, endehors des Constitutions et Old Charges. Et il s’agit le plussouvent de divulgations. On sait que c’est sans doute le caspour la plus célèbre d’entre elles, Masonry dissected de SamuelPrichard de 173068, qui reste portant une source essentielle dece que nous savons de la pratique maçonnique des débuts. On nesait pas avec certitude dans quelle mesure s’il s’agit d’un
sur les premières loges françaises, constituées sous l’égide de la GrandeLoge de Londres, 66 Pierre Mollier in Franc-Maçonnerie Magazine n° 37, op. cité p. 28.67 Le latin « normal » semble à peu près ignoré des maçons dits « initiés »,pour lesquels le latin des clercs semblait être de l’hébreu… On transcritdonc d’oreille sans comprendre le sens de ces mots inconnus, en fait, desgens de métier. Une fois la graphie établie, ceux qui recopient necomprenant pas davantage, la forme est conservée dans ses déformations68 Samuel Prichard : Masonry dissected , Daily Journal London 20 octobre1730.
23
texte authentique ou d’une mystification, mais on sait que cetexte a été adopté et que les rituels des trois degréssymboliques des Moderns et, par le biais de The Three DistinctsKnocks, des Antients, en sont directement issus. La tâche estrude ! C’est pourquoi on tâtonne encore et qu’une généalogiecertaine de la création successive des degrés est loin d’êtreétabli avec certitude. On sait que les rituels ont foisonné àpartir des années 1730 et ont circulé d’Orient en Orient,classés et reclassés, fusionnés ou réécrits. On comprend laréticence d’Alain Bernheim à « toucher » au domaine, ô combienmouvant, des rituels. Il ne s’y aventure guère69.
Reste alors le 3e point du schéma proposé par Popper :l’élimination. Il faut savoir se débarrasser des hypothèses quise révèlent erronées. On l’a vu, ce n’est pas le plus facilecar il reste des traces souvent indélébiles des précédentsparadigmes. Avant d’écrire un auteur consulte les écritsantérieurs et risque de reprendre un fait inexact. Il estsouvent plus facile d’affirmer l’exactitude d’un fait que soninexactitude (par exemple la fameuse loge de saint-Germain !cf. supra). Un fait n’a pas une seule cause en histoire. Onsait aussi la difficulté qu’il y a à savoir s’il y a diffusiond’une idée, ici par exemple une thématique pour un rituel àpartir d’une source unique, ou s’il y a ce que l’on appelleconvergence, c’est-à-dire l’éclosion simultanée de cette idée.On sait ainsi que vers les années 1740-1750 ont vu l’éclosiond’un nombre impressionnant de rituels ayant pour légende lavengeance d’Hiram, ou la construction-reconstruction d’unédifice sacré. Les rites ont choisi et ordonné ces rituels icipour donner ce qui deviendra le R.E.A.A., là le Rite Français…
Conclusion
Le travail de l’historien maçonnique est difficile. Lesdécouvertes de documents, cahiers d’architecture,correspondance, rituels et manuscrits divers sont fréquentes etl’on sait que les archives des bibliothèques publiques etprivées sont loin d’être toutes exploitées. On peut s’attendreà des trouvailles qui remettent en question ce que nous savons69 Une seule exception : Alain Bernheim : Les deux plus anciens manuscrits des gradessymboliques de la franc-maçonnerie de langue française, Paris Dervy novembre 2013.L’auteur reprend un extrait d’un de ses ouvrages antérieurs, Les débuts de laFranc-Maçonnerie à Genève et en Suisse, Editions Slatkine 1994.
24
déjà. La comparaison, la mise en perspective ou en parallèle deces pièces, apportera sinon des certitudes, du moins desthéories nouvelles. Il faut aussi prendre en compte denouvelles techniques ou essais d’analyse. On se reportera auxtravaux exemplaires de Dominique Jardin sur les tableaux deloge70, aux études de Philippe Langlet71 ou aux publicationscomme les Mémoires de l’Académie maçonnique72 sur les structures (lesrituels maçonniques analysés comme rites de passage ou selonles modèles développés par Claude-Lévi Strauss ou WladimirPropp ou encore Georges Dumézil, Arthur Koestler73, ou encore,comme je viens de l’esquisser, Karl Popper…) et les diversesapproches herméneutiques et philosophiques des rituels. Cestravaux, sans être des travaux historiques, permettent de mieuxcomprendre le contexte dans lequel la franc-maçonnerie modernea éclos et s’est développée. L’analyse des sources des rituelsest à cet égard capitale, la prise en compte de la culture desrédacteurs potentiels de l’époque peut s’avérer fructueuse.Elle peut permettre l’élaboration de nouveaux paradigmes sur lagenèse des rituels, donc sur le développement des rites audébut du XVIIIe siècle. Ne pas voir peur de se tromper, enhistoire comme ailleurs, sinon on ne peut avancer !
Reste l’obstacle majeur, celui sans lequel il n’y a pas descience : l’honnêteté scrupuleuse, l’objectivité la plusabsolue, ce qui revient à dire que n’est historien maçonnique
70 Dominique Jardin : Voyage dans les tableaux de loge, Jean-Cyrille Godefroyseptembre 2011.Le Temple ésotérique des Francs-Maçons, Jean-Cyrille Godefroy août 2012.La tradition des francs-maçons Histoire et transmission initiatiques, Paris Dervy 2014.71 Philippe Langlet : Les sources chrétiennes de la légende d’Hiram, Paris Dervy 2009.Lecture d’images de la Franc-maçonnerie, Paris Dervy 2013.72 Mémoires de l’Académie maçonnique, Editions La Hutte, n° 1 : Avril 2013 : Franc-maçonnerie et structure, n°2 octobre 2013 : Regards sur la philosophie maçonnique I et n°3 Novembre 2014 : Regards sur la philosophie maçonnique II.73 Notamment :Jean-Bernard Lévy : Morphologie, formes et structures des rites et rituels initiatiques ;Roger Bonifasssi : Tri-fonctionnalité indo-européenne et structure de la franc-maçonneriesymbolique ;William Goldblum : Analyse structurale en franc-maçonnerie ;Jean-Bernard Lévy : Une étude des rituels maçonniques du R.E.A.A., selon analyse structuralede Lévi-Strauss ;Philippe Langlet : La légende d’Hiram selon Propp ;Jacques Zurbach : Le holon d’Arthur Koestler. in Mémoires de l’Académie maçonnique, Editions La Hutte, n° 1 : Avril 2013 :Franc-maçonnerie et structure,
25
que celui qui sait reconnaître ses erreurs, aller si besoin àcontre-courant de ses souhaits, de ses convictions quand unfait nouveau, une explication meilleure surgit !
JB Lévy
26
Annexe 1
La ou les loges de Saint-Germain dès 168874
Les preuves historiques de l’existence de loge en Francedès 1688 à Saint-Germain-en-Laye, dans l’entourage desRégiments de Jacques 1er sont pour le moins succinctes maisdepuis Gustave Bord75 les ouvrages qui traitent du sujetrépètent à l’envi qu’il est « évident » ou « logiques » que detelles loges militaires devaient exister, comme dans tous lesrégiments. Bord écrit : « Comme les Stuarts s’étaient réfugiésà Saint-Germain-en-Laye, il est probable que76 cette ville futpendant longtemps le centre de la f.-m. jacobite, et tout porte àcroire que la première loge battant maillet en France fut leBonne Foi des gardes écossaises du roi d’Angleterre (régimentde Dillon)… Le régiment de Walsh avait aussi une loge dont je n’airelevé officiellement le titre : la Parfaite Egalité, qu’à partir de1752 »77. Pierre Chevallier donne une référence à cetteassertion : « C’est à l’Orient de ce régiment (le « RoyalIrlandais », formé en 1661 par Charles II à Saint-Germain-en-Laye) qu’aurait existé la Loge de la Parfaite Egalité. Le 13 mars1777, le Grand-Orient de France admettait, mais cela ne fait paspreuve, que sa constitution primitive datait du 25 mars 1688 etqu’elle avait été renouvelée le 9 octobre 1772 par la Grande-Loge de France. De son côté le régiment de Dillon aurait donnénaissance à la Loge de la Bonne Foi à l’Orient de Saint-Germain,et c’est du reste le titre que porte encore de nos jours leLoge de cette ville. On se trouve donc en présence d’unetradition qui, certes, n’est pas appuyée sur des documents authentiques,mais qui qui au, moins est corroborée par la note mise en basde page d’une lettre par Bertin du Rocheret, président àl’élection d’Epernay en 1737, et par laquelle il désigne ainsila Fraternité : ‘Société ancienne d’Angleterre… introduite enFrance à la suite du roy Jacques II en 1689’ »78. On le voitdans ces deux citations : supposition, conditionnel sont de74 In Jean-Bernard Lévy : Abrégé d’histoire du R.E.A.A., Editions La hutte, 2012, p.129-135.75 Gustave Bord : La Franc-Maçonnerie en France des origines à 1815, Tome 1er : Lesouvriers de l’idée révolutionnaire (1688-1771), Librairie nationale, Paris 1908.76 C’est nous qui soulignons dans les deux citations.77 Ibid. p.117-118. Gustave Bord ne cite jamais ses sources et est considérécomme peu fiable pour les historiens de la maçonnerie.78 Pierre Chevallier : Histoire de la franc-maçonnerie française, Tome 1 : Lamaçonnerie : Ecole de l’Egalité 1725-1799, Fayard, 1ère éd. 1974, p.5.
27
rigueur, et pour seule preuve, on donne une note manuscrite debas de page, écrite près de 50 ans après les faits, donc il n’ya là rien de probant. On est loin de la rigueur supposée animerles tenants de l’école de l’histoire authentique de lamaçonnerie. Aucun document n’étaye encore aujourd’huil’existence de telles loges jacobites entre 1688 et 1725, dateoù des loges apparaissent à Paris (Loge de Saint-Thomas).Pourtant c’est sur ces bases que sont encore écrits encorenombre d’articles ou d’ouvrages traitant de l’origine de lamaçonnerie française.
Albert Lantoine reste circonspect quand il écrit : « et leDr John Robison… la prétend (la franc-maçonnerie) introduitepar les Irlandais de la suite du roi Jacques après laRévolution d’Angleterre de 1688 - mais ici nous manquons depreuves »79. Il l’est un peu moins quand il dit dans le tomesuivant80 : « On a la preuve qu’il existait au moins une logerégimentaire à Saint-Germain, vers 1688, par la reconnaissancede cette date de fondation par le Grand Orient de France lui-même », ce qui ne l’empêche d’écrire ensuite : « On l’appelaalors La Parfaite Egalité ou loge de Walsh, du nom de soncommandant. Comme les régiments jadis prenaient le nom de leurcolonel, il est certain que l’atelier de 1688 ne portait aucunde ces deux titres. Peut-être n’en avait-il pas. On pourraits’étonner de cette date de 1688, car le régiment de WilliamDarlington (plus tard Walsh) ne débarqua en France qu’en 1689.Mais notre opinion est qu’il trouva en arrivant l’armaturetoute prête, et probablement même les restes d’un atelier enactivité ». Cette opinion nous parait pour le moins aléatoireet n’emporte pas la conviction.
Citant encore Bord, Henri-Félix Marcy écrit que « lesrégiments écossais et irlandais qui suivirent Jacques II enFrance débarquèrent avec leurs cadres maçonniques. Or dans sonchapitre (celui de Bord) sur les Loges militaires, on ne trouveaucun fait probant à l’appui de son affirmation ; sans doute,et le contraire serait étonnant, il y avait de nombreux Frèresparmi les émigrés originaires d’Irlande et surtout d’Ecosse ;mais un seul corps, celui des Gardes Irlandaises, débarqué à79 Albert Lantoine : Histoire de la franc-maçonnerie française, tome 1er La franc-maçonnerie chez elle, Emile Nourry, Paris 1925, p. 53.80 Albert Lantoine : Histoire de la franc-maçonnerie française, tome 2 Le Rite EcossaisAncien et Accepté, Emile Nourry, Paris 1930, p.11-12.
28
Brest le 9 octobre 1689 et devenu plus tard le régimentirlandais de Walsh, a eu certainement une Loge : « La ParfaiteEgalité »81.
Jean Baylot est circonspect. Citons-le : « La création dela première Loge en France se situerait entre 1725 – dateplausible – et 1736, date à laquelle des loges existaientcertainement. Les historiens écartent la fondation de 1689, de la Loge jacobitede Saint-Germain-en-Laye. Il n’y avait sur elle que des légendes. MaisChevallier a découvert, sur un document manuscrit daté de173582, une confirmation de l’implantation à la venue desStuart à Saint-Germain-en-Laye, soit vers 1689. Ainsil’existence de cette Loge devient plausible compte-tenu del’importance de la population écossaise émigrée en 1689 à lacour de Saint-Germain-en-Laye. Par contre, jusqu’ici, seule lalégende parle de la fondation en 1687, par Lord Penbrocke,délégué de la M.G.L. d’Angleterre de la Loge La Constance, àArras. Dans une étude aussi savante qu’objective, monsieurEmile Lesueur a fait, à cette légende, un mauvais sort (La F.M.artésienne au XVIIIe siècle, Paris E. Leroux 1914). Pas davantage nousne retiendrons comme certaine la prétendue fondation, en 1721,de la Loge Amitié et Fraternité, sous patente de la Grande Loged’Angleterre, dont les archives sur ce point sont muettes.Chevallier cite des textes qui incitent à croire à une Logemaçonnique parisienne, aux environs de 1710. Ces textes fontétat de rumeurs, non de certitudes. C’est tout de même entre1725 et 1736 qu’il faut rechercher. »83
Passant du conditionnel à l’affirmatif on a pu lire dansPoints de Vue Initiatique, en 1982, l’assertion suivante : « Dès 1689,à Saint-Germain-en-Laye, une Loge jacobite, La Bonne Foi,existait au régiment de Dillon des gardes écossais. Plusieursautres loges stuartistes furent ouvertes en France dès1690 »84.
81 Henri-Félix Marcy : Essai sur l’origine de la franc-maçonnerie et l’histoire du Grand Orientde France, tome 1er Des origines à la fondation du Grand Orient de France, Ed. du FoyerPhilosophique, Paris 1949, p. 60.82 Voir plus haut.83 Jean Baylot : Dossier français de la franc-maçonnerie régulière, éd. Vitiano,Paris 1965, p. 56-57.84 La Franc-Maçonnerie militaire, in Points de Vue Initiatique n° 46, 3e trimestre 1982,p.62. A l’époque les articles n’étaient pas signés.
29
Les plus prudents usent aujourd’hui, à nouveau, decirconvolutions, comme André Kervella : « En premier lieu, iln’est pas improbable que des militaires se soient tôtpréoccupés de former des loges propres à leurs régimentsrespectifs Peut-être le titre donné à celle de Walsh estsurprenant… Cependant il est loisible d’objecter que lareconnaissance rétroactive accepté par le Grand Orient françaisporte moins sur le nom que sur la réalité du regroupementprécoce… »85. Notons que, dans ces écrits antérieurs, le mêmeauteur était plus affirmatif quand il écrit : « Avec plus deconviction que Pierre Chevalier, nous pouvons accepter commeauthentique l’annotation de Philippe-Valentin Bertin du Rocheret,président à l’élection d’Eperney (sic), qui en 1737 écrit sousforme lapidaire que la franc-maçonnerie est ‘introduite en France àla suite du roi Jacques II en 1689’ »86.
D’autres préfèrent le conditionnel comme l’ancien GrandMaître de la Grande Loge de France, Alain Graesel : « Une logesupposée, dite de La Parfaite Egalité, aurait été créée dès le 25mars 1668 au sein du régiment des gardes irlandaises de Walsh-Infanterie. Mais il ne reste aucune trace documentaire de cettemystérieuse loge fondatrice. Il en va de même pour la non moinsmythique loge de La Bonne Foy »87. Alain Bernheim, dont laréputation n’est plus à faire, se contente de dire dans leparagraphe consacré à ce sujet, Les premières loges : St. Germain enLaye ? dans son livre, Une certaine idée de la franc-maçonnerie : « Dupoint de vue documentaire, nous n’avons pas de nouvel élément àapporter sur cette question » et il donne des argumentsindirects (mais non convaincants !) « pour montrer quel’hypothèse traditionnelle d’une loge militaire irlandaiseexistant à St. Germain aux environs de 1690 n’a rien d’absurde ».
85 André Kervella : La Passion Ecossaise, Dervy, 2002 p. 149. Dans la phrase quisuit l’auteur souligne que « les documents officiels de cette obédience (leGrand Orient de France) portent un sceau revendiquant, sous le titre GrandOrient, sa fondation en 1736, alors qu’elle est de 1771-1772, justementdans la période où ses administrateurs veillent à authentifier l’anciennetédes loges aspirant à se placer sous sa férule ». Est-ce à dire que larigueur historique était une règle en 1772 que le G.O. bafoue allègrementaujourd’hui !86 André Kervella : Aux origines de la franc-maçonnerie française (1689-1750) – Exilésbritanniques et gentilshommes bretons, Ed. du Prieuré, 1996, p. 31.87 Alain Graesel : La Grande Loge de France, P.U.F., coll. Que sais-je ? n° LaGrande Loge de France, P.U.F., coll. Que sais-je ? n°791, Paris 2008, p. 3.
30
Une ou plusieurs loges dès 1688, en France, venuesd’Angleterre, on peut l’admettre mais il n’y a aucunecertitude. Un doute reste à lever : que sont-elles devenuesentre cette date et 1725, année de la fondation de la 1ère logeà Paris par « mylord Derwent-Waters, le chevalier Maskelyne, M.d’Heguerty et quelques autres anglais » selon Lalande88. Lemoins que l’on puisse dire c’est que si elles devaient avoir unrôle politique, celui-ci est resté un secret bien gardé. Oubien alors il s’agissait de clubs anodins, de lieux de réunion,somme toute, bien banaux.
Quelques questions doivent légitimement se poser si onadmet l’existence de telles loges jacobites : elles nepouvaient pratiquer qu’un rituel en deux degrés, il n’y avaitpas de Grande Loge « obédientielle », aucune structure derégulation. Leur aspiration était sans doute politique, doncelle ne devait admettre que des jacobites. Or la séparationentre jacobites catholiques d’une part et hanovriens tousprotestants d’autre part est loin d’être évidente, en tous casdès la création de loges à Paris, puis en France.
88 Encyclopédie, Supplément, tome III, p. 134.31


































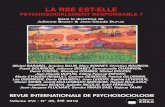



![Orientalisme [et franc-maçonnerie]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633180484e014304030038fc/orientalisme-et-franc-maconnerie.jpg)













