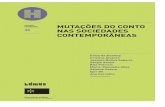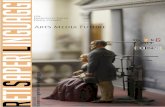Représentation sémantique et discursive de la femme et violence verbale dans les proverbes tswanas
Définir l'hallucination acoustico-verbale comme trouble de la conscience de soi
-
Upload
thechicagoschool -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Définir l'hallucination acoustico-verbale comme trouble de la conscience de soi
Bvol Psychiatr 2000 ; 65 : 311-24 0 2000 editions scientifiques et medicales Elsevier SAS Tous droits rCservCs Halluciner
Dkfinir l’hallucination acoustico-verbale comme trouble de la conscience de soi
J. Naudin *, I. Banovic **, M.A. Schwartz ***, O.P. Wig@,n,s,rf**, A. Mishara *****, G. Stanghellini ******, J.M. Azorin
_, 1
RCsumC - L’hallucination acoustico-ver- bale (HAV). ici definie comme X( compte rendu d’experiences attribuees a une voix &rang&e en rapport direct avec un trouble de la conscience de soi )), est replacee dans son contexte culture1 et scientifique. Une attention particuliirre est accordee aux modeles cognitivistes, conventionnelle- ment repartis suivant le couple d’opposi- tion Tou-Down/Bottom-m. Le reoeraae de I’HAV ‘cornme symptoms’ au se& du dialo- gue clinique ne peut se passer des histoires scientifiques qui determinent la significa- tion empirique du symptome en tant que tel. Dans ce travail, cette signification empirique est rapportee aux structures neurofonctionnelles cerebrales dans la perspective proposee par Damasio [l]. En distinguant le proto-Soi, le Soi-central et le Soi-autobiographique, Damasio suggere que I’hallucination schizophrenique est un trouble du Soi-autobiographique mais n’elimine pas le fait que ce trouble soit lui- m&me accompagne d’anomalies du proto- Soi et du Soi-central. Nous confrontons ce
Summary - Defining the acoustico-verbal hallucination as a self-awareness disorder. The acousticoverbal hallucination, defined here as CC a report of experiences attributed to a foreign voice in direct association with a self-awareness disorder x is re-esta- bhshed in its cultural and scientific context. Detailed attention is given to the cognitive models, conventionally divided according to the opposites Top-Down/Bottom-Up. Identifying the acousticoverbal hallucina- tion as a symptom within the clinical dialo- gue cannot occur from the scientific stories which determine the empirical significance of the symptom as such. In this work, this empirical significance is associated with the cerebral neurofunctional structures from the perspective of Damasio. By distin- guishing the proto-Self, the central-Self and the autobiographical-Self, Damasio suggested that the schizophrenic hallucina- tion is a disorder of the autobiographical- Self, but this fact does not preclude that this disorder itself is accompanied by ano- malies of the proto-Self and of the central-
* Docteur Jean Naudin, praticien hospitalier, service universitaire de psychiatric, CHU Sainte-Mar- guerite, 270, avenue de Sainte-Marguerite, 13008 Marseille, France. Pour toutes correspondance : Dr Jean Naudin,55 bis. boulevard Rodocanachi, 13008 Marseille,France. E-mail : [email protected] ** Ingrid Banovic, UFR de psychologie, UPRES psychologie et psychopathologic cliniques, universite de Provence, 29, avenue Robert-Schuman, 13621 Aix-en-Provence cedex 1, France. *** Michael-Alan Schwartz, department of Psychiatry, Case Wertern Reserve University, Cleveland, Ohio, Stats-Unis. **** Osborne P. Wiggins, department of Medical Ethics, University of Louisville, Kentucky, Etats-Unis. *****Aaron Mishara, department of Psychology, Rutgers University, New Brunswick, New York, Etats-Unis. ****** Ciovani Stanghellini, departement de Sante mentale, universite de Florence, Italic. ******* Docteur Jean-Michel Azorin, service universitaire de psychiatric, CHU Sainte-Marguerite, 270, avenue de Sainte-Marguerite, 13008 Marseille, France.
ReCu le I7 dkemhre 1999 ; ucceptk le 27 janvier 2000
312 J. Naudin et al.
modele a I’Ctude de cas cliniques issue de la phenomenologie. La methode d’analyse de l’experience vive proposee par Dama- sio. enracinte dans la pens& de James (21, n’est. somme toute, pas tres Cloignee de la pratique phenomenologique : on retrouve notamment I’idCe fondatrice d’un clivage du sujet faisant apparaitre le sentiment m&me de soi qui se tient au fondement de la conscience. Toutefois, la methode phe- nomenologique suggere de poursuivre l’analyse des anomalies fonctionnelles du sentiment m&me de soi en direction de la naturalisation du temps V&XI. ce qui fera , l’objet d’un prochain travail. 0 2000 Editions scientitiques et medicales Elscvier SAS
conscience de soi I hallucinations aconstico- verhales I miennit I ph&nomCnologie I schi- zophrbnie I sentiment de soi I structure neurofonctionnelle I voix
Self. We challenge this model with the cli- nical case study resulting from phenome- nology. The method of analysis of the experiment suggested by Damasio. rooted in the reflection of James. is not. alto- gether, very far from the phenomenologic practice: one finds notably the idea of a division of the subject revealing sclf-awa- reness which is at the foundation of cons- cience. However, the phenomenologic method suggests a continuation of the functional anomalies of self-awareness towards the naturalization of lived time, which will be the,subject of a forthcoming work. 0 2000 Editions scientifiques ct medicales Elsevier SAS
acoustico-verbal hallucination I neurofunctional structure I phenomenology I schizophrenia I self-awareness I voice
Le Soi d’un homme est la somme totale de tout ce qu’il peut appeler sien. non seulement son corps et ses pouvoirs psychiques, mais artssi ses ve*tements
et sa maison, sa femme et ses enfants, ses ardtres et ses amis, .sa r6pyrctation et ses travaus, ses terres et ses chevaux, son yacht et son compte hancaire.
W. James [2]
$ hallucination acoustico-verbale (HAV) occupe par sa valeur heuristique une place a part dans la psychiatric contemporaine. Alors que sa frequence
en fait le symptome le plus commun de la schizophrenic [3], sa definition n’est pas encore tranchee, opposant les partisans des troubles du langage a ceux des troubles de la perception, ceux qui s’interrogent sur la fonction de signification propre des voix, et notamment culturelle, et ceux qui ne veulent y voir qu’un trouble du fonctionnement cerebral [4]. Parmi tous les phenomenes qui consti- tuent le corpus semeiologique de la psychiatric, ce sont les voix qui, du fait de leur double ancrage dans le monde mythique et dans le monde de la science, resistent le plus vigoureusement a la reduction au symptomc. Nous avons dans cette meme revue autrefois insist6 sur l’interet d’une perspective narrative [S] qui puisse ne pas nous faire trancher d’emblee quant a l’attribution restrictive du phenomene a l’un de ces deux mondes et le rapporter ainsi a sa situation dialo- gique premiere. Ici, notre preoccupation suit une autre demarche. Sans renier pour autant ce contexte narratif. nous voulons nous poser la question suivante : de quelle facon les voix doivent-elles ttre dcfinies pour que leur reduction a un symptome soit scientifiquement fondle ? Cette question de definition est
Dbfinir I’hallucination acoustico-verbale 313
prealable g toute autre, elle implique une modklisation globale de l’expkrience dont un des aspects, et non le moindre, est de nkcessiter une naturalisation des formes les plus ClaborCes de la vie psychique que sont le VCCU d’appartenance et le v&u du temps, par ailleurs Ctroitement intriquks. Cet article constitue la pre- mike partie d’un travail plus complet portant sur la constitution du temps et du Soi dans l’experience hallucinatoire. Nous proposons ici une dkfinition de l’hallucination et 1’Ctayons sur le travail rCcent de Damasio [l] 2 propos du sen- timent mGme de Soi.
D6finir I’hallucination acoustico-verbale
Comme trouble de la perception
En proposant d’Ctudier des << histoires hallucinkes B plut8t que des HAV isolCes (51, nous faisions les constatations suivantes : 1/ nous n’avons jamais affaire direc- tement au phknomkne hallucinatoire ; 2/ nous ne pouvons le pknktrer qu’au travers de l’histoire que nous raconte le patient ; 3/ aucune histoire ne peut &tre saisie isolkment ; 4/ les histoires hallucinkes ont cela de particulier qu’on ne peut Cchapper B leur charme ; 51 les histoires hallucikes sont comme fermkes par un bout. 11 est ainsi maladroit de faire de l’hallucination une <( perception sans objet )>, une croyance erronCe dans la mesure oti ce qui est perGu n’est comme tel que parce que perqu par un Soi, un Ego. Cet Ego, en dkfendant la validitk de sa croyance, affirme simplement dans le dialogue sa propre position, position Cgologique lkgiti- mement opposable B celle de son interlocuteur. Le rajout par Ey [6] de la propo- sition (c g percevoir )> ne permet g&e mieux de qualifier la position de l’hallucink par rapport 5 la rkalitC dans la mesure oti cette prkcision prksuppose que seul l’interlocuteur, assimilk ?I un observateur extkieur, sait ce qui est 2 percevoir et ce qui ne l’est pas. 11 en va de mCme de la dkfinition proposke par le DSM-IV [7] :
Perception sensorielle qui a le sens d’accomplissement de la rCalitC d’une per- ception vraie mais qui se produit en dehors de la stimulation externe d’un organe sensoriel.
Si le fait que l’hallucination a des caractkres sensoriels bien que se produisant en dehors de la stimulation de l’organe correspondant est un trait caractkristique sur lequel patient et mkdecin peuvent parfois se rCunir, sans que soit accord6 pour autant plus de crkdit g la position de l’un ou I’autre des interlocuteurs, aucun consensus ne peut &tre obtenu d&s lors que l’un des deux interlocuteurs entend prendre position plus fermement sur la logique propre des attributions g la rkalitk. Ce qui pour l’un reste rkalitC dklirante est pour l’autre un enchaine- ment de faits rkels. L’affirmation d’une croyance perceptive manifeste une prise de position de l’ego non seulement sur la rkalitC en tant que rkalitk matkrielle mais aussi quant B la v&it6 de ce qui est dit Ctre perqu. Cette dimension de vkritC fait de l’hallucination un phknomkne culture1 par essence, et ce qui est vrai dans certaines cultures peut gtre d&lark faux dans d’autres [8]. Mais elle se rapporte
314 J. Naudin et al.
egalement au caractere de perspectivite qui rapporte de facon metaphorique toute affirmation biographique d’un point de vzze culture1 a l’orientation primor- diale de notre corps par rapport a l’objet percu.
Le DSM-IV mentionne le relativisme culture1 de I’hallucination sans pour autant I’integrer a sa definition g&r&ale. Liester avance I’idee que le terme hallucination doit etre reserve aux phenomenes pathologiques, la dimension de revelation pro- pre aux voix interieures (dites alors transcendantes) devant etre preservee de toute qualification psychiatrique pour conserver intacte leur dimension de trans- cendance essentielle a la culture. I’histoire des peuples renvoyant le plus souvent a l’experience decisive de quelques inities [9, 101. L’idee d’un continuum entre les phenomenes pathologiques et les phenomenes mystiques permet de rcndrc compte de la dimension transpersonnelle des voix interieures comme revelation d’une verite transcendante. Liester propose dans cette direction de completer la definition du DSM-IV :
Experience sensorielle qui a le sens d’accomplissement de la realit dune percep- tion objective, mais qui se produit sans stimulation exterieure de I’organe sensoriel correspondant ; elle est concomitante de et supposee etre en rapport SW le plan ctiologique avec un trouble physique ou mental : elle n‘est pas couramment vecue ou acceptee par les autres membres du groupe culturel.
Cette definition vise a mieux definir le caractere pathologique des halluci- nations en les separant clairement des experiences d’ordre mystique. comme les voix interieures. En inferant un processus etiologique suppose. elle ne remet pas plus en question que celle du DSM la position de I’observateur en ne proposant aucun critere clinique qui puisse faire distinguer les hallucinations dcs personnes ayant une schizophrenic des phenomenes vecus par les personnes faisant une experience mystique authentique. Le rattachement des phenomenes a la culture du sujet hallucine presuppose leur intelligibilite biographique. C’est la perte de cette intelligibilite qui fait rattacher les phenomenes au processus jaspersien. La definition de Liester propose deux criteres negatifs referant au contexte scienti- fique ou culturel, mais elle manque la nature proprc du malentendu intersubjectif qui fait en lui-m&me evoquer le processus.
Berrios et Denning proposent, dans une direction plus conforme au caractere dia- logique de I’experience clinique, la definition suivante [l l] :
Les hallucinations sont des comptes rendus d’une experience attribuee a la per- ception.
Cette definition a le merite de ne pas prendre a priori position sur ce qui doit etre ou non percu mais plutot sur le caractere narratif de l’experience clinique et la position subjective de celui qui, ayant fait l’experience de I’hallucination.
DBfinir I’hallucination acoustico-verbale 315
rapporte cette expkrience B autrui. Cette dCfinition n’entend pas prkjuger non plus du caractkre pathologique ou non de l’expkrience. Elle n’exclut pas le fait que l’hallucination puisse avoir une signification pour le sujet hallucirk comme pour celui qui l’koute. Toutefois, & son tour, lorsqu’il s’agit de dCfinir plus spkcifique- ment les hallucinations des schizophrknes, cette dCfinition reste excessivement floue si elle n’est pas complCtCe par quelque prkision concernant sa signification m&me. D’une part, une dkfinition par le seul r&it ne distingue en rien l’hallucina- tion du reste de l’expkience psychiatrique, sauf g jeter implicitement un soupqon sur la rCalitC de l’expkrience vCcue en tant que telle : le patient aurait-il done B prouver le caractkre authentiquement v&u de l’expkrience B laquelle il fait rCf& rence dans son discours ? D’autre part, c’est sur le contexte de signification des hallucinations que le schizophrkne hallucink et son interlocuteur ne parviennent pas g s’entendre : le malentendu Porte non pas tant sur le contexte clinique en tant que tel, volontiers accept6 par le patient, que sur la possibilitk de se dktacher du sens commun qui fait que l’un, rattachk comme par un fil Clastique h sa rkalitk de travail, vient B poser un diagnostic, alors que l’autre ne se sent pas pris au skrieux justement parce qu’une rCalitC d’un autre type, mais plus forte encore, l’en Cloi- gne. Seuls le contexte d’apparition des phknomknes au sein d’une rencontre effec- tive et la signification que leur donne l’hallucink permettent au psychiatre d’Ctablir un diagnostic. C’est une modification globale de l’expkrience vkcue par la per- sonne ayant une schizophrknie qui fait la spkificitk du contexte d’apparition des phknomknes. Cette modification g&t&ale de l’expkrience remet en cause la posi- tion de 1’Ego en tant que telle, c’est une vkritable conversion de l’expkrience qui marque par le caractkre vif et impromptu de son surgissement une rupture dans le temps et dans l’espace, situation spkifique inscrite et rep&able au sein du dis- tours par l’analyse des marqueurs linguistiques [ 12, 131. Une difinition approprike de 1’HAV chez le schizophrkne doit se rkfkrer B cette situation, parvenir 5 la nom- mer sans infirer pour autant une quelconque Ctiologie.
me trouble du §@~~~rnen~ m&me de soi
Schneider a pose un jalon dkterminant en rassemblant les troubles schizophrkni- ques sous le nom de c< troubles de la miennitk P [14]. I1 fait ainsi rCfCrence b l’ensemble des troubles qui mettent en cause 1’unitC du monde en tant qu’elle se constitue dans l’appartenance du soi g soi. L’HAV du schizophrkne renvoie dans sa forme et dans son contenu B une dkfaillance basale de la miennit qui condi- tionne son mode de surgissement. La psychologie cognitive regroupe aujourd’hui ces processus d’appropriation du soi par le soi en les rapportant B l’activitk propre de l’agent sous le terme gCnCrique de <( processus d’attribution B Dans une pers- pective schneiderienne, les modkles cognitifs font de I’HAV une dkfaillance des processus d’attribution des Wkements mentaux. Suivant ce type de modkle, les voix apparaissent lorsque le discours intkrieur n’est plus rep&C comme tel ; elles constituent une forme d’autonomisation du discours intkrieur. Renforcks par les Ctudes d’imagerie [15, 161, parfois contradictoires, les plus connus de ces travaux
316 J. Naudin et al.
ont fait de la dkfaillance des processus d’attribution dans I’HAV un trouble de la planification du discours [17], de la mkmoire de travail [ 181, ou bien encore du contr8le moteur [ 191, soit dans ces trois cas un deficit basal des processus hofmnz-
tip. En insistant sur les connexions de signification qui peuvent Ctre Ctablies entre le contenu des voix et le contexte pragmatique de l’action [13]. ou bien encore avec la charge Cmotionnelle des repksentations verbales 120, 211, des Ctudes ten- dent 2 prouver que le contenu des voix est un facteur important des troubles d’attribution, ceux-ci pouvant &re rapport& g des croyances mktacognitives ayant pour but de rkduire la dissonance cognitive [22]. Ce sont alors des processus de type t~&own qui sont mis en valeur pour expliquer comment les HAV mettent en cause la connaissance meme de soi. Suivant ces Ctudes, les HAV surgissent lorsque les sentiments d’internalite, de libre arbitre et de contritle des pendes sont en contradiction avec I’kmergence d’Cmotions ou de pens@es vCcues comme intru- sives car 6loignCes du contexte narratif de la rkalitC perque. Ces rksultats sont peu compatibles avec les ktudes qui impliquent dans la schizophrknie une dkfaillance modulaire de la thkorie de l’esprit [23]. renforqant l’idke que la difficult6 des schi- zophrknes g se rep&enter leurs propres ktats mentaux n’est peut-etrc qu’un kpi- phCnom?ne 1241. Le contenu explicite des voix ne semble parfois gukre diffkrer des commentaires issus de la conscience morale et du dialogue intkrieur [2S]. La difficult@ n’est pas tant de les interprkter en ce qui lcs rattache 2 la vie psychique normale que de tenir compte du fait que les commentaires. volontiers injurieux et impkatifs, tkmoignent le plus souvent d’une faible estime de soi [26]. Tout se passe comme si les voix, en tant que croyance m&acognitive. tentaient de pallier, de motiver ou de rendre compte en des termes triviaux de la dkfaillance du Soi causke par les troubles primaires. Dans la mesure oh le contenu hallucinatoire peut ainsi avoir pour objet les modifications des processus intentionnels causkes par lc processus schizophr6nique primaire, il scmble lkgitime de rapporter lc lrouble des attributions B la question plus gitnkrale exposke par Damasio sous le nom de X< sentiment m&me dc soi >>. Damasio introduit ce concept en rappelant l’importance de (q l’enracinement de la conscience dans le sentir )) :
Nous savons - dit-il - que now Cprouvons uric Cm&on lorsque nous avow Ic scn- timent du Soi sentant.
Le v&u d’appartenance, le <( sentiment mEme de soi )>. est lie g ce que dans le moment mCmc oh nous sentons, nous avons doublement une connaissancc du Soi en tant qu’il est sentant et une connaissance de I’objet senti, qu’il apparaissc dans le monde extkieur ou. comme les kmotions, g la fdis dans le corps et dans la vie psychique. C’est I’enracinement de la conscience dans le sentir qui semblc spCci- fiquement aIt&+ dans I’HAV. Nous suggkrons done que pour mieux cerner la specificit de I’hallucination schizophrknique. son implication dans un trouble de la conscience de soi fasse partie intkgrante de sa definition. Nous proposons de complkter ainsi la dkfinition de Bcrrios :
Les HAV sont des comptes rendus ci’exp6rienccs attribukes 5 une voix ktrangkre en rapport direct avcc un trouhlc de la conscicncc dc soi.
DBfinir I’hallucination acoustico-verbale 317
La conscience de soi dans I’hallucination acoustico-verbale : ._ _~ ._ _._“_ . . __, .._. I ~_, . . _.. .._, ^^,__.-“~._._,._ .._.. .I .” .__ ,.. _ __.“. I,.. __.,I _.._,. _I ..^_ une approche neurofonctionnelle suivant le modale de Damasio _~ . . .,,
Soi neurona~, histoires et cartographic c8r6brale
Le concept de Soi, comme d’ailleurs celui de conscience, est dans la litterature psychiatrique un concept particulierement flou. La neuropsychologie s’interesse aujourd’hui B son substrat cerebral en tentant de rapporter le concept de Soi aux structures anatomofonctionnelles susceptibles de reguler la relation du Soi et de l’objet (i.e. l’intentionnalite) [27]. Nous ferons ici un usage du concept de Soi momentanement restreint aux definitions qu’en donne Damasio dans ce m&me but. S’inspirant du clivage au sein de 1’Ego que James etablit dans sa psychologie en distinguant le Je et le Moi, Damasio propose de distinguer, outre le <( proto- Soi )> qui en est le substrat neuro-anatomophysiologique, un G Soi-central B et un << Soi-autobiographique j>. Resumons brievement sa position. 11 y a un G Soi- neuronal >>, un proto-Soi qu’il convient de decrire prealablement pour comprendre les conditions de l’emergence ulterieure du Soi comme pole subjectif de la connaissance. Ce proto-Soi est la << structure qui regule et a la fois repre- sente les etats internes du corps >j, c’est une structure Cmergente dont nous n’avons pas conscience en elle-meme car elle est une cc collection coherente de configurations neuronales qui, instant apres instant, cartographient l’etat de la structure physique de l’organisme >F ; elle ne contient aucune connaissance mais assure les bases de toute perspective du Soi en juxtaposant au sein de la conscience basale, dite conscience-noyau, les mecanismes de l’emotion, de l’attention et de la regulation des etats du corps. Tandis que le cerveau forme l’image cartographique d’un objet (un visage, une melodic, un ma1 de dents, le souvenir d’un Cvenement) et que les images de cet objet affectent l’etat de l’orga- nisme, d’autres structures cerebrales creent pour leur part un compte rendu rapide et non verbal des evenements ayant lieu dans les diverses regions cerebra- les activees du fait de l’interaction entre l’objet et I’organisme : ce compte rendu rapide et non verbal represente la relation entre l’objet et l’organisme dans des cartes dites (( de second ordre B. Ce r&it non verbal raconte pour ainsi dire l’histoire
de l’organisme pris dans l’acte de rep&enter son propre changement d’etat alors qu’il est sur le point de se rep&enter quelque chose d’autre.
L’objet n’est done jamais enregistre isolement. Les registres que nous tenons des objets et evenements comprennent les ajustements moteurs qui ont orient6 et facilite notre perception aussi bien que les reactions emotionnelles que nous avons alors eues. L’objet est toujours enregistre au sein dune histoire qui rend compte du mouvement intentionnel par lequel il est saisi. A chaque fois qu’un objet se degage dans le champ de la conscience, un r&it saris paroles accompagne et rend compte du mouvement intentionnel, representant pour ainsi dire au
318 J. Naudin et al.
niveau cortical et sous une forme narrative la progression de la conscience en marche. Suivant ce modele, raconter une histoire n’est pas originairement un fait de langage, c’est plutot une condition du langage. C’est a peine si nous sentons parfois ce r&it se formuler cn mots dans un discours interieur lorsque se pose le probleme d’une modification inattendue du mouvement intentionnel. Ce r&it non verbal est virtuellement traduisible et articulable en mats. expressions et phrases plus ou moins construites. Notre conscience est ainsi faite de r-kits mul- tiples [28], articulant, outre des mots, des images. des sons. des odeurs et des gouts. des sensations internes, des pensees, des souvenirs, en href des represen- tations diverses et non pas des mots seuls. associant en arriere-plan de chaque representation une representation correlative du mouvement intentionnel qui la produit. On peut resumer ce modele narratif de la conscience en disant que la possibilite de raconter une histoire correspond. de facon quasi cinematogra- phique, a la capacite qu’a notre cerveau d’enregistrer ce qui arrive ct de le referer a un mouvement intentiormel sous la forme de cartes cerebrales (cartes de second ordre). Si la personne n’a evidemment pas une connaissance directe de cette cartographic du mouvement intentionnel, le sentiment d’une modification des etats mentaux accompagne la saisie de I-objet par la conscience et c’est ce senti- ment m&me d’une modification qui assure la conscience toujours fugitive de Soi.
Damasio rapporte ce sentiment d’une modification des @tats mentaux qui consti- tuent le Soi comme conscience en marche a une structure qu’il nomme le (c Soi- central F>. Le mot central n’est pas a comprendre dans le sens d’une structure ana- tomique mais d’une structure fonctionnelle. II renvoie a cette X( re-representation du proto-Soi non conscient en tours de modification B qui permet a I’acte meme de connaitre, d’acquerir une existence dans l’histoire. Damasio nomme Soi-cen- tral cette << premiere base )> du Soi conscient qui donne, au sein m&me de l’his- toire en train de se creer, le sentiment de Soi dans I’acte de connaitre. Le Soi- central est par essence transitoire, ephemere, toujours renouvele, alors meme que son mecanisme de production. genetiquement determine et faiblement influence par l’environnement. ne subit jamais que des changements mineurs au tours de la vie. Par une procedure complexc d’apprentissage qui nous fait engranger sous forme de souvenirs, inscrits dam une chronologie - soit un pass& un present et un futur - ces moments fugitifs de connaissance, se degage du Soi-central le Soi- autobiographique. La base du Soi-autobiographique est faite des aspects inva- riants de la vie d’un individu, mais cette experience se developpe continuellement avec I’experience vecue et se trouve en partie remodelee pour refleter les expe- riences nouvelles. Les souvenirs reactives se donnent eux-memes comme quclque chose a connaitre et engendrent par la leur (q propre pulsation dc conscience centralc )>. La proposition de Damask permct ainsi de saisir Ic Soi, a la fois commc phenomene permanent (le Soi-autobiographique) et commc phenomene
D6finir I’hallucination acoustico-verbale 319
transitoire (le Soi-central). L’explicitation du Soi-autobiographique requiert le Soi-central, et la formation continue du Soi-autobiographique passe par le rappel incessant du Soi-central. Les configurations qui dkfinissent ensemble le Soi-auto- biographique sont activkes en m2me temps que celles qui definissent l’objet dans ce que Damasio appelle la conscience-&endue. La familiarit de l’expkience et la connaissance de l’objet G baignent ainsi ensemble dans le sentiment de connaitre qui nait alors au sein de la conscience-noyau B. Conscience-&endue et conscience-noyau, Soi-central et Soi-autobiographique sont ainsi des pheno- m&es etroitement intriquks dont la synchronie garantit pour ainsi dire la natu- ralitC de l’expkrience. C’est aussi pourquoi la conscience-&endue ne se confond pas avec la mCmoire de travail, bien que celle-ci y participe nkcessairement. La conscience-&endue garde g l’esprit une multitude de possibilitks ouvertes sous la forme des multiples configurations neuronales qui dkrivent le Soi-autobiogra- phique et sont activees en mCme temps qu’kmerge la constitution d’un objet. La fonction de la mkmoire de travail est beaucoup plus restreinte, essentiellement fermCe sur un but et visant la manipulation intelligente de l’objet. Si son intkgritk est nkessaire au bon fonctionnement de la conscience &endue, du fait de la multiplicitk des reprksentations g tenir 2 l’esprit dans le mCme moment, elle n’est g&e impliquke au niveau de la conscience-noyau essentiellement fugitive.
Les hali~ci~ations acoustico-verbales coupe trouble du Soi-a~tobiogra~hique
Damasio fait lui-mCme l’hypothkse que les HAV, comme l’ensemble des troubles schizophrkniques, s’accompagnent d’une << anomalie du Soi-autobiographique >k. 11 observe que cette anomalie n’est saris doute pas isolCe, car on peut remarquer la chose suivante chez les personnes souffrant de schizophrknie :
Les objets de leur perception, au cows de telles manifestations, sont eux-m&mes anormaux, probablement comme leur proto-Soi et leur conscience-noyau.
S’il rapproche ainsi les troubles schizophrkniques des agnosies, Damasio n’en dit pas plus concernant la schizophrknie et les rapports qu’il conviendrait de faire entre les anomalies du Soi-autobiographique et les anomalies supposkes du proto- Soi et du Soi-central. Est-il possible d’aller plus avant ? Les HAV sont des actes de connaissance d&achCs du sentiment de Soi. Si l’on se tourne vers leur contenu et leur mode de surgissement, les HAV, conformkment & ce que nous avons prk- ckdemment rang6 dans la catkgorie des processus top-down, ont pour objet de connaissance l’expkrience autobiographique de la personne, mais la conception mCme du Soi-autobiographique dCvelopp6e par Damasio suppose de saisir ces phknomknes au sein mCme d’une kgulation en boucle top-down/bottom-up prC- supposant l’activitk des structures fonctionnelles basales regroupkes sous le nom de proto-Soi. La thkmatique des HAV Porte sur les modifications intentionnelles qui, en tant que telles, affectent le sujet dans ses capacitks de contr6le et d’agentivitk impliquant g la fois une anomalie mineure du proto-Soi saisie en tant que
320 J. Naudin et al.
modification du Soi par le Soi-central et une anomalie propre du Soi-autobiogra- phique. Nous pouvons developper l’idee introduite par Damasio en la confrontant a l’intuition clinique : conformement aux etudes phenomenologiques de cas singu- hers impliquant un trouble des syntheses passives et de la constitution du temps [29, 301, c’est la disponibilite immediate des configurations qui permet au Soi-auto- biographique, SW la base de l’activite du proto-Soi, de se degager a partir du Soi- central qui semble en cause ; autrement dit, la capacite d’etre affect6 en tant que Soi-m&me par le tours de la vie et le caractere d’ouverture au monde qui deter- mine l-horizon de la conscience&endue. Ce sont les malades eux-memes qui avan- cent ces hypotheses lorsqu’ils affirment (f ne pas pouvoir exister comme les autres )), t< ne pas avoir de point de vue propre )>, ou bien encore <( avoir a rassem- bler les chases dans leur t&te B comme si cela devait etre fait de facon consciente et deliberee. Meme lorsque le r&it du patient ne Porte pas explicitement sur la nature des modifications intentionnelles. I’HAV vient proposer I’evidence d’une croyance metacognitive qu’un apprentissage repete a rendu immediatement dispo- nible dans le stock des connaissances configurees comme Soi-autobiographique, un peu comme s‘il s’agissait pour I’essentiel de pallier non pas une defaillance simple de la conscience&endue mais plutot son impossibilite a s’harmoniser avec les emotions et rapporter l’experience presente a la pulsation du Soi-central. Les expe- riences subjectives rapportees par les personnes souffrant de schizophrenic font souvent reference a un v&u particulierement froid du temps qui s’ecoule, comme s’ils n’etaient pas touches par l’ecoulement du present, comme si au cam&w immediatement present du rnnintenanr ne faisait echo nulle pulsation rythmique interne. On peut deduire de cette observation que les anomalies fonctionnelles qui entravent la conscience-etendue chez le schizophrene ne renvoient ni a un trouble primaire de la memoire de travail, ou des fonctions du proto-Soi qui, comme la pla- nification de I’action, s’y rattachent. ni a un trouble primaire des structures carto- graphiques ayant en charge le stockage et I’organisation chronologique des souvenirs ou bien encore les traits invariants de personnalite, mais plutot 9 un trou- ble de la constitution intime du present vivant impliquant la synchronie dc rappel du Soi-autobiographique et du Soi-central sur la base fonctionnellc du proto-Soi. Les troubles schizophreniques primaires semblent devoir impliqucr une anomalie des interconnexions qui rendent compossibles I’existence du Soi-autobiographique et les manifestations rythmiques du Soi-central, interconnexions qui permettent I’ouverture et la continuite de I’un au travers de I’emergencc transitoirc de l’autre. assurant ainsi dans le meme temps le sentiment du temps vecu et la continuite de l’experience. Deux questions doivent attirer toute notre attention : I/ Dans quelle mesure la perte du sentiment interne de Soi, telle qu’elle affecte dans Ia schizo- phrenic la continuitl de l’experience, ne peut-elle pas etre rapportee a un defaut momenta& de pulsation du Soi-central ? 21 Dans quelle mesure alors ce defaut de pulsation n’est-il pas a mettre au compte d’une anomalie propre a la constitution temporelle du Soi-autobiographique ? Ces questions valent la peine d’ctre posees si l’on veut resoudre les problemes que nous awns formules precedcmment en termes de processus top-down et de proccssus hottnnz-rip.
D6finir I’hallucination acoustico-verbale 321
Que peut gagner une conception neurofonctionnelle du Soi . ,.. .- ..,_ .II . ̂ ._. __11”̂ ” -.. . __ . ., __ .,., _ r.l._ .._ .*. - . .- ,~.I... ._ . . . . _ . _ ~._ ~I et de I’hallucination acoustico-verbale 8 6tre confrontee ._ _. _ .~ _, . ,_., ,.,. . ..,. . _ . -, .” , - I__ “-. . .._ . 2~ la phenom6nologie ? _” ,, ., .._ .
tfioge du cas singuiier
Les modeles naturalistes de I’HAV reduisent le plus souvent les observations cli- niques a la validation d’echelles ou l’accomplissement d’une tache. La dimension proprement subjective de l’experience n’est pas prise en compte, et les troubles fins que presuppose le modele narratif de Damasio semblent au mieux pouvoir etre cernes par l’analyse phenomenologique detaillee de cas singuliers paradig- matiques conduisant a la realisation de taches specifiques. Les etudes phenome- nologiques de cas singuliers semblent nous parler differemment apres avoir lu Damasio. A l’inverse, lire Damasio en ayant a l’esprit les cas de Binswanger nous fait penser qu’il faudrait completer ce modele de la constitution du Soi par une description plus fine encore de la constitution du temps [31]. Les cas de schizo- phrenic, s’ils se distinguent ainsi plus aisement des voix purement mystiques (dont on peut supposer qu’elles s’appuient sur une structure du proto-Soi intacte), ne peuvent pas beneficier aussi directement que les agnosies de la dis- sociation neurofonctionnelle introduite entre le proto-Soi, le Soi-central et le Soi- autobiographique. I1 nous a fallu tenter de decrire brievement leur compossibilite et presupposer leur synchronie pour mieux comprendre la notion de Soi-autobio- graphique a la lumiere des questions posees par la clinique specifique de la schi- zophrenie. Une question de methode est ainsi affirmee.
int&& d’une neuroph&om&oiogie des hai~ucinations acousiico-verbales
Cette question de methode a CtC bien posee par Varela en introduisant le concept de neurophenomenologie 1321 : il s’agit de proceder par contraintes mutuelles en confrontant les donnees empiriques de la science et les intuitions que developpe la pratique de la phenomenologie. 11 est par exemple tentant de rapprocher le cli- vage introduit par Damasio pour rendre compte du sentiment meme de Soi du clivage introduit par Husserl entre le niveau transcendantal et le niveau empi- rique de l’experience. La reduction phenomenologique, en reduisant le monde a mes appartenances propres, revele au sein de la vie psychique l’activite d’un Ego qui, a proprement parler, constitue le sens de ce qui est a connaitre (Ego dit c< transcendantal >> ou (c constituant >>). Pour autant que mon experience originaire est toujours une experience corporelle, le Soi-central postule par Damasio est ce point zero de l’experience autour duquel se constitue la sphere de mes apparte- nances, point zero constitue par l’experience vecue de mon corps propre, point zero autour duquel gravitent les histoires qui donnent son sens intime a mon autobiographie. Les rapports du Soi-central et du Soi-autobiographique sont du
322 J. Naudin et al.
m&me type que ceux de 1’Ego empirique et de 1’Ego transcendantal dkrits par Husserl : ce sont des rapports de compossibilitk. l’un ne pouvant etre saisi que depuis I’kmergence transitoire, la pulsation de l’autre. Dans l’expkience naturelle qui est celle de la vie quotidienne, si prkoccupks que nous sommes par la conscience que nous avons de l’objet 2 connaitre au moment oti il se dCgage, nous ne nous attachons guttre 21 la conscience que nous pouvons avoir de cette pulsa- tion. 11 nous faut faire en quelque sorte clignofer le sujet pour mieux le faire appa- raitre comme ce sentiment que nous avons de nous-meme en tant qu’&tre affect6 corporellement par le monde au fil de la constitution de nos histoires. Le clivage propok par Damasio entre Soi-central et Soi-autobiographique, m6me s’il ne recouvre pas exactement le dualisme intentionnel propose par Husserl. renvoie A l-intuition fondamentale de deux conceptions toujours concomitantes de la mien- nit6 (i.0. du sentiment de soi) : une conception basale qui fait du Soi le centre anonyme autour duquel gravitent toutes les histoires qui constituent ma vie psy- chique prksente. et une conception plus psychologique qui saisit le Soi en tant qu’il est toujours un Gment mgme de l’histoire dans layuelle il se trouve emp&tre, ce qui fait l’histoire sienne B proprement parler. Le m&-i& du travail de Damasio est de viser une dkfinition Claire des structures fonctionnclles corres- pondant B ces deux conceptions. Mais, ce faisant. il ne dkcouvre pas des fonctions qui seraient superposables terme B terme aux instances dCvoilCes par l’intuition ph6nom6nologique. Le phknomknologue peut se sentir contraint par la dkmarche empirique B l’abandon de structures mythiques (celle de I’Ego transcendantat cn est une). ou tout au moins de renoncer 2 leur dktournement psychopathologique pour revenir de plus prt% 2 l’expkrience scientifique. Mais en renonc;ant $1 ces structures, le psychiatre phknomknologue ne renonce pas pour autant .5 la mkthode qui les a mists au jour. Les intuitions cliniques d’un trouble des syn- thgses passives peuvent chercher un ktayage aup& d’un modkle neurofonc- tionnel et contribuer g l’amkliorer. Nous pensons que ce que Husserl [33] a dkcrit en termes d’<< intentionnalitk d’horizon B pour rendre compte de la logique des faits propre B l’expkrience que nous faisons quotidiennement du monde trouve sa raison scientifique dans une conception telle que celle de Damasio qui suppose l’inscription constamment renouvelke en boucle au niveau des structures neurales du compte rendu non verbal des processus intentionnels. Pour mieux comprendre la schizophrknie et les processus primaires qui lui sont sptkifiques. nous devons nous attaquer B la question des structures neurales qui ont en charge ce que Husserl nomme l’kvidence prksomptive :
Le monde r&l existe seulement dans la prCsomption qui s‘esquisse conslamment, que l’expkrience s’houlera constamment selon le mEme style constitutif [33].
Le modkle de Damasio met Cgalement en relief le caractkre de perspectivitk propre 2 la perception, et par extension 21 tout point de vue individuel. La pers- pectivite de l’expkrience vkue est nkessaire pour que la possession et l’agenti- vit6 soient relatives ?I un corps, dkterminant les chases et les gens comme proches ou lointains, miens ou &rangers. Le sentiment de soi va de pair avec la
D6finir I’hallucination acoustico-verbale 323
perspectivitk dans la formation constamment renouvelke du Soi-central et du Soi- autobiographique. Les intuitions de la psychiatric phknomknologique semblent mettre en cause la structure de rkgulation du proto-Soi lorsqu’elles montrent comment manque ?I l’hallucination le caractkre de perspectivitt? qui est le propre de l’activitk perceptive et plus g6n6ralement de la pen&e. L’HAV est donnCe tout d’un coup, elle ne peut Ctre corrigke par un mouvement propre du sujet en direction de son objet de connaissance. Tout se passe alors comme si un fragment d’histoire surgissait indkpendamment de la logique prksomptive des faits, qui fait 2 la fois le style perspectiviste de la vie mentale, l’agentivitk de l’agent et la per- tinence pragmatique de l’action. Ce fragment d’histoire raconte le c< comment >j de la modification intentionnelle que presuppose l’absence momentanke du sen- timent m&me de soi, comme si en impliquant de faGon causale une croyance mktacognitive, il 6tait la traduction immkdiate en mots d’un compte rendu de second ordre. Nous tenterons dans un prochain travail de rapporter l’ensemble de ces troubles 2 la constitution du prksent immkdiat. Le caractkre temporel du Soi-autobiographique ne se rkume pas B la chronologie du pass& du prksent et de l’avenir, il vaut originairement comme projet de soi et trouve un fondement dans la structure intime du prCsent immkdiat, structure intime dont le Soi-central postulk par Damasio n’est peut-&tre qu’une manifestation.
1 Damasio AR. Le sentiment m&me de Soi. 10 Liester MB. Toward a new Definition of Corps, Cmotions, conscience. Paris : Odile Hallucination. Am J Orthopsy 1998; 68: Jacob ; 1999. 305-12.
2 James W. Principles of Psychology. New York: Holt; 1890.
11 Berrios GE, Dening TR. Pseudohallucina- tions: a conceptual History. Psycho1 Med 1996 ; 26 : 753-63. 3 Slade PD. Bentall RP. Sensory Deception: a
scientific Analysis of Hallucination. Balti- more: Johns Hopkins University Press; 1988.
4 Lanteri-Laura G. Les hallucinations. Paris : Masson ; 1991.
5 Naudin J, Azorin JM, Giudicelli L, Dassa D. Vers une analyse narrative des histoires hal- 1ucinCes. Evol Psychiatr 1996 ; 61,2 : 345-5X.
6 Ey H. Trait& des hallucinations. Paris : Masson ; 1973.
7 American Psychiatric Association. Diagnos- tic and Statistical Manual of Mental Disor- ders, 4th ed. Washington: APA; 1994.
8 Al Issah I. The Illusion of Reality or the Reality of Illusion. Hallucinations and Culture. Br J Psychiatry 1995 ; 166 : 368-73.
9 Liester MB. Inner Voices: distinguishing transcendent and pathological Characteris- tics. J Transpers Psycho1 1996 ; 28 : l-30.
12 Banovic I. DCfinir la situation hallucinatoire g l’aide des marqueurs linguistiques. Ann MCd Psych 1999 : 157 : 640-4.
13 Leudar 1. Thomas P. Johnston M. Self- repair in Dialogues of Schizophrenics: Effects of Hallucinations and Negative Symptoms. Br Language 1992 ; 43 : 487-511.
14 Schneider K. Psychopathologic clinique (trad. fr. J.P. Legrand). Paris: Maloine: 1957.
15 McGuire PK. Shah GMS, Murray RM. Increased Blood Flow in Broca’i Area during auditory Hallucinations in Schi- zophr&ia. La&et 1992 ; 342 : 703-6.
16 Silbersweig DA, Stern E, Frith C. Cahill C, Holmes A, Grootonk S, et al. A functional Neuroanatomy of Hallucinations in Schi- zophrenia. Nature 1995 ; 378 : 176-9.
324
17
18
19
20
21
22
2.1
24
Hoffman RE. Verbal Hallucinations and Language Production Processes in Schi- zophrenia. Behav Br Sci 1986 ; Y : 503-48.
David AS. The Neuropsychological Origin of auditory Hallucinations. In: The Neuro- psycholog; of Schbophrcnia. Hove: Lawrence Erlhaum; 1Y94. p. 46-54.
Frith CD. The positive and negative Symp- toms of Schizophrenia reflect impairments in the Percept&n and Initiation 6f Action. Psycho] Med 1987 : I7 : 631-48.
Baker CA, Morrisson AP. Cognitive Pro- cesses in auditory Hallucinations: attrihu- tional Biases and Metacognitions. Psycho] Med 1 Y98 ; 2X : 199-208.
Close H, Garety P. Cognitive Assessment of Voices: further Developments in understan- ding the emotional impact of Voices. Br J Clin Psycho1 I998 ; 37 : 173-8X.
Morrisson AP. Haddock G. Tarrier N. Intrusive Thoughts and auditory Hallucina- tions. Psycho1 Mcd 1995 ; 23 : 2680.
Frith CD, Corcoran R. Exploring cc Theory of Mind >> in People with Schizophrenia. Psycho] Med 1996 ; 26 : 52 l-30.
Drurv VM. Robinson EJ. Birchwood M. cc Theory of Mind n skills during an acute Episode of Psychosis and follo- wing Recovery. Psycho1 Mcd 199X : 2X : 1101-12.
25
26
27
28
29
30
31
32
33
J. Naudin et al.
Lcudar i, McNally D, Glinski A. What Voices can do with Words: Pragmatics of Verbal Hallucinations. Psycho] Mcd 1997 : 27 : X85-98.
Sopitt RW, Birchwood M. Depression. beliefs, voice content and Toporraphv: a cross-5ectional study of schizophrenic patients with auditorv verbal hallucination\. j Ment Health 1997 :k : 525-32
Brown JW. Neuropsychology and the Self- concept. J Nerv Ment Dis 1999: 187: 131-41.
Dcnnctt D. La concience expliquee. Paris : Odile Jacob : 1994.
Naudin J, Gras-Azorin C. Mishara A. Wiggins OP. Schwartz AM, Azorin JM. The USC of the Husserlian Reduction as a Method of Investigation in Psychiatry. J ConscStudies 1999; 6: 15.5-71.
Wiggins OP. Schwartz MA. Northoff G. Vers une ph&omCnolopie husserlienne,des &tapes initiales de la schizophrenic. Evol Psych 1997 : 62 : 2’)‘).3 13.
Varela FJ. Present-time Consciousness. J Consc Studies I999 ; 6 : 11 l-40.
Varela FJ. Neurophenomenoloev. A methodological Remeby for the h&l Pro- blem. J Consc Studies 1996 ; 3 : 330-49.
Husserl E. Logique formelle et logique transcendantale. Paris : PUF : lYS7.