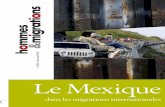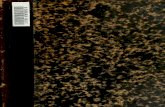“A l’école de Marrou aujourd’hui : un témoignage”, Cahiers Marrou, 2, 2009, p. 75-90.
De l’école à l’emploi au Mexique
Transcript of De l’école à l’emploi au Mexique
1
Titre : La transition de l’école à l’emploi au Mexique. Une analyse comparative multiniveau de trois groupes de générations
Titre court : De l’école à l’emploi au Mexique
Nicolás Brunet [email protected] Doctorant en Sciences Sociales, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México
Pascal Sebille [email protected] Maître de Conférences en Démographie, Centre de Recherche Populations et Sociétés, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, Chercheur associé à l’Institut National d’Etudes Démographiques
RESUME
Si l’accès au premier emploi constitue l’étape initiale de l’entrée sur le marché du travail, elle ne s’inscrit pas moins dans un processus de transition complexe, où fin des études et accès au premier emploi, rivalisent avec d’autres opportunités sociales et familiales.
L’objet de cet article est de porter un regard sur l’évolution au Mexique des conditions de réalisations de cette transition vers l’emploi. Les contextes institutionnels et les caractéristiques sociales et familiales sont souvent présentés comme des composantes majeures de l’entrée sur le marché de travail. Mais, elles sont rarement associées aux dynamiques biographiques propres aux histoires de vie des hommes et des femmes.
Aussi, à partir d’une approche biographique « multiniveau », cet article cherche à mettre en évidence, selon les contextes institutionnels et familiaux, l’existence de modèles de transitions, où les opportunités scolaire, professionnelle et familiale sont diversement mobilisées. Cette étude s’appuie sur deux sources de données distinctes : l’enquête biographique nationale mexicaine (EDER-2011) et les Recensements de Population du Mexique (1960 à 2010).
MOTS CLES
Transition de l’école à l’emploi, Insertion professionnelle, Approche biographie multiniveau, Contexte institutionnel, Origines sociales, Mexique, Amérique latine
2
Title: Transition from education to employment in Mexico. A comparative multi-level analysis of three groups of cohorts
Short title: From education to employment in Mexico
ABSTRACT
While access to first employment is the initial stage of labour market entry, it is just one part of a complex transition process in which completion of education and access to first employment compete with other social and familial opportunities.
This article examines changes in the conditions for achieving this transition to employment in Mexico. Institutional settings and social and familial characteristics are often presented as key components of labour market entry. However, they are rarely analysed in association with the life event dynamics specific to the life histories of men and women.
Applying a "multi-level" event history approach, this article seeks to reveal the existence of transition models in which educational, occupational and familial opportunities are mobilized in varied ways in different institutional and family contexts. Two separate data sources are used: The Mexican National Retrospective Demographic Survey (EDER-2011) and the Mexican population censuses (1960 to 2010).
KEYWORDS
Transition from education to employment, Occupational integration, Multi-level event history approach, Institutional settings, Family background, Mexico, Latin America
3
1. Appréhender l’entrée sur le marché du travail
La transition entre la fin des études et l’emploi est une composante majeure des
biographies individuelles. L’appréhender comme une transition progressive et non
comme le passage d’un statut à un autre, offre l’opportunité d’en étudier les multiples
facettes et la complexité. Le calendrier de fin des études tout d’abord participe à la
définition des trajectoires éducatives et à celle des niveaux de formation acquis,
trajectoires et niveaux ouvrant à des opportunités d’accéder à un emploi plus ou moins
valorisé. Les chances de demeurer à l’école ou en cours d’études, quant à elles, sont
étroitement liées au contexte familial. La famille peut apporter sa contribution
financière et permettre le prolongement d’études, retardant d’autant l’entrée sur le
marché du travail et permettant ainsi d’appréhender au mieux les possibles tensions
liées aux premières étapes de la vie familiale. Les conditions de réalisation de la
transition « études-emploi », enfin, s’inscrivent dans des contextes historiques
changeants, qui répondent à des « situations institutionnelles », sources de défis et
d’opportunités. L’accès aux études et leur poursuite d’une part, l’intégration au marché
du travail d’autre part, peuvent alors relever de logiques sociales diverses ouvrant vers
des parcours différents selon les milieux socioéconomiques1.
Le développement de l’offre éducative et la généralisation de l’entrée des femmes sur le
marché de l’emploi, phénomènes propres aux cinquante dernières années au Mexique
(Parrado et Zenteno, 2004), ont fortement modifié les conditions sociales et
démographiques de cette transition « études-emploi ». Mais, de fortes disparités
demeurent toujours présentes entre les contextes urbains et ruraux, suggérant l’existence
d’inégalités sociales toujours à l’œuvre.
Intégrer à l’analyse des conditions de réalisation de la transition « études-emploi », des
facteurs aux diverses dimensions, individuelle et biographique, familiale et contextuelle,
s’avère pertinent et ouvrent deux champs d’interrogation. Le premier tient à mettre à
l’épreuve la possible hétérogénéité de la transition de l’école vers le marché de l’emploi
entre les hommes et les femmes. Comment affrontent-ils les tensions et les opportunités
1 Nous remercions Patricio Solís, du Centre de Recherche des Etudes Sociologiques du Colegio de Mexico, pour ces suggestions et pour nous avoir offert la possibilité d’utiliser l’indice d’origines sociales dont il est l’auteur.
4
qui leur sont offertes au moment où fin des études, accès à un emploi, vie conjugale et
familiale entrent en résonnance ? Le second champ d’interrogation vise à identifier les
probables déterminants sociaux qui sont à l’œuvre dans la transition des études vers
l’emploi. Quelle place les origines sociales occupent-elles dans les modalités de cette
transition ? Et quel rôle les contextes institutionnels jouent-ils aujourd’hui alors que les
conditions de poursuite des études et d’accès à l’emploi ont fortement changé au cours
de ces cinquante dernières années ?
Comme en témoigne la littérature, ces questions ont été abordées à partir d’angles
d’analyse très différents et rarement associés. Aussi, pour mieux appréhender la
diversité des situations rencontrées au Mexique, il nous est apparu intéressant d’associer
trois approches complémentaires. A celles sociodémographique et sociologique souvent
privilégiées dans la littérature, notre travail souhaite ajouter une approche
« multiniveau ». Cette dernière permet en effet d’intégrer à l’analyse des conditions de
réalisation de cette transition « études-emploi », les différentes dimensions contextuelles
auxquelles les jeunes peuvent être confrontés au fil de leur histoire de vie ; « réalités »
individuelles, familiales ou institutionnelles. Pour cela, nous avons mobilisés deux types
de sources de données quantitatives : d’une part, une enquête biographique nationale
rétrospective réalisée en 2011 auprès de plus de 3000 enquêtés (EDER-2011) ; d’autre
part, les recensements de la population du Mexique pour les années 1960 à 2010.
5
2. La nécessité d’une approche pluridisciplinaire
Qu’est-ce que la transition « études-emploi » ?
Blau et Duncan (1967) furent parmi les premiers à s’interroger sur les définitions
d’études et de premier emploi. Les notions, de présence partielle ou à temps complet
pour les études, celle d’un travail à temps plein ou d’une première activité après la sortie
de l’école pour l’accès à l’emploi, ont été discutées. L’expérience internationale
témoigne de l’importance que jouent, dans les modèles de transition entre la scolarité et
l’emploi, l’organisation des systèmes éducatifs de chaque pays et leur relation avec les
processus d’accès au marché du travail (Müller et Shavit, 1998)2.
Si comme nous l’avons déjà vu, il apparait pertinent d’appréhender le passage des
études à l’emploi comme « un processus, non un événement » (Kerckhoff, 1995), une
telle approche révèle toute la complexité de cette transition. La fin des études ou
l’entrée sur le marché du travail ne sont pas des étapes irréversibles ; le retour à l’école
ou aux études après un premier emploi, les périodes où études et travail se côtoient,
n’étant pas rares. On est alors loin de la vision linéaire présentant souvent la transition
« études-emploi » comme celle d’un unique passage d’une période de scolarité à celle
d’une activité économique. Au contraire, considérer ce moment des histoires de vie
comme celui d’une « période transitionnelle » dynamique (Allmendinger, 1989)
apparaît plus judicieux. La littérature fait apparaître cinq définitions usuelles de la
transition « études-emploi ». Les deux premières placent l’accès au premier emploi
après les études, au cœur de l’analyse ; qu’il survienne après la première sortie des
études (Heath et Cheung, 1998) ou après l’ultime période d’études à temps complet
(Arum et Hout, 1998). Une troisième définition s’appuie plus particulièrement sur
l’investissement consacré aux activités scolaires et professionnelles ; la transition étant
alors considérée comme le passage d’une période d’études à temps complet à celle
d’une activité économique aussi à temps complet (Allmendinger, 1989). La quatrième
définition quant à elle se distingue des précédentes en considérant ce passage des études
à l’emploi, non à partir du franchissement des étapes de sortie de l’école ou de l’entrée
2 L’exemple classique du système « dual » allemand qui institutionnalise les stages professionnels comme partie intégrante de la formation scolaire, avant l’entrée sur le marché du travail, illustre la diversité des situations de transition.
6
sur le marché de l’emploi, mais en fonction de l’âge des individus (Kerckhoff, 1995).
Enfin, la cinquième et dernière définition intègre la possibilité de périodes où études et
emploi se côtoient. La transition est alors appréhender comme le passage d’une
séquence de l’histoire de vie où scolarité et activité professionnelle peuvent être vécues
conjointement, à une nouvelle séquence où l’emploi prime seul. Pour sa richesse et sa
plus grande flexibilité, c’est cette dernière définition que nous avons retenue pour
l’étude de la transition « études-emploi » au Mexique.
La relation entre les études et l’emploi
Bien sûr, les définitions retenues pour décrire le passage des études à l’emploi,
suggèrent de poser les termes de la relation entre études et emploi. Si les systèmes
scolaires et professionnels, les offres et les relations mutuelles qu’ils proposent,
participent activement à la définition des modalités de la transition « études-emploi »,
durant des décennies, les discussions ce sont principalement focalisées sur la réussite
scolaire à travers l’acquisition d’un niveau d’études et l’intégration sur le marché du
travail. Ce n’est que récemment que de nouveaux travaux se sont intéressés à la qualité
des offres des systèmes éducatifs (Mare, 1980; Lucas, 2001), à leur influence sur les
parcours scolaires et à leur implication sur les trajectoires professionnelle, économique
et familiale futures. La qualité des études, la continuité des parcours et leur nature,
permettant d’accéder à des savoirs académiques ou techniques, la disponibilité des
options et le choix des voies offertes par ces systèmes éducatifs, sont apparues comme
autant de composantes participant à la définition d’un futur professionnel et social.
L’étroit lien entre les trajectoires scolaires et la première insertion professionnelle est
évidente. L’acquisition d’un savoir valorisé lors de la sortie du système éducatif,
constitue sans aucun doute un atout pour débuter son parcours professionnel à une
position relativement favorable sur le marché de l’emploi. Mais comme le signale
Kerckhoff (2003), l’étude des caractéristiques propres aux systèmes éducatifs ne suffit
pas à expliquer cette relation étroite entre les trajectoires scolaire et professionnelle.
Aussi pour rendre compte de la dynamique et complexité de cette relation, il suggère
d’analyser les conditions de réalisation de la transition « études-travail » en les
inscrivant dans le cours des histoires de vie des individus.
7
Au Mexique, certains travaux ont étudié avec précision la nature de ces trajectoires
scolaire et professionnelle, mettant en évidence la diversité des transitions et l’existence
de moments biographiques clés (Tuirán, 1999; Mier y Terán, 2004; Solís, 2012). Ces
recherches, inscrites dans le champ des études sur la transition à l’âge adulte, se sont
appuyées sur deux approches distinctes (Mora Salas et Oliveira, 2009). La première
qualifiée de « sociodémographique » appréhende le passage des études à l’emploi
comme le franchissement de deux des cinq étapes majeures de la transition à la vie
adulte : la fin des études et l’accès à l’emploi, venant prendre place au côté de la
décohabitation du foyer parental, de l’entrée en union et de la naissance du premier
enfant. Une telle perspective, bien qu’incomplète pour comprendre les logiques qui sont
à l’œuvre dans les motivations des acteurs, offre la possibilité d’identifier l’intensité et
le calendrier de survenue de ces événements biographiques au fil de l’histoire de vie
(Coubès et Zenteno, 2004; Echarri et Pérez-Amador, 2007; Sebille, 2009). La seconde
approche, identifiée comme sociologique, conçoit ce passage de l’école au marché du
travail comme une pièce maitresse du processus de stratification sociale et éducatif.
Origines sociales et parcours éducatifs et professionnels seraient ainsi étroitement liés,
conduisant alors à l’existence d’une hétérogénéité sociale dans la transition des études
vers l’emploi (Hogan, 1980; Marini, 1984). Si ces deux approches placent la sortie des
études et l’entrée dans l’emploi au cœur de l’analyse, elles peinent à inscrire
conjointement la transition des études vers l’emploi au sein de l’histoire biographique
des individus et des contextes sociaux et familiaux auxquels ils sont confrontés. Aussi,
nous est-il apparu pertinent d’engager notre réflexion autour d’une nouvelle approche
« multiniveau » située au croisement des deux précédentes. Associant points de vue
« micro » et « macro » (Alexander et al., 1987), une telle approche permet de saisir la
spécificité des parcours individuels relevant de trajectoires biographiques propres aux
individus, mais aussi d’inscrire ces derniers dans les logiques sociales qui participent à
la définition des opportunités et des choix éducatifs et professionnels qui sont offerts à
ce moment clé de l’histoire de vie. Les contextes familiaux et économiques, les
situations institutionnelles que proposent les systèmes éducatifs et économiques, sont
autant de composantes des conditions de réalisation de la transition des études vers
l’emploi. Cette transition et les trajectoires biographiques qui y mènent, s’inscrivent
alors dans le temps de l’individu, celui de l’histoire biographique de chacun des acteurs,
8
mais aussi dans le temps de la société, celui révélant les contextes socio-historiques
(Courgeau, 2003) qui s’offrent à eux.
Les composantes explicatives de la transition
Aussi, appréhender la transition des études vers l’emploi suggère d’intégrer à l’analyse
les différents niveaux présentés dans les approches précédemment mentionnées. Cinq
grandes dimensions explicatives peuvent alors s’imposer : la dynamique biographique,
les origines sociales familiales, la dimension « genre », la dimension temporelle
représentée par le temps historique et par les âges, enfin le contexte éducatif et
professionnel institutionnel.
La dynamique biographique, première de ces dimensions, est au centre de la transition
« études-emploi ». Les prises de décision de poursuivre ou de cesser ses études, de
commencer son parcours professionnel, d’entrer en union ou d’avoir des enfants, se
réalisent à des âges et des moments de l’histoire individuelle. Révélateurs de calendriers
« anticipés » ou « retardés », ils sont tous liés à la réalisation d’événements successifs
au sein de trajectoires biographiques diverses, scolaire, professionnelle ou familiale en
interaction (De Sandre, 2004). Cette dimension biographique apparait en filigrane de
nombre de situations. C’est le cas lorsque le coût d’opportunité, associé à la perte de
salaires ou à la disponibilité d’emplois, entre en compétition avec la poursuite ou non
des études (Rosembaum, 1990 ; Raftery et Hout, 1996), ou lorsque l’acquisition de rôles
familiaux, conjugaux ou reproductifs à certains moments de l’histoire de vie, conduit à
l’abandon des études et à l’entrée sur le marché du travail pour subvenir aux besoins
économiques du ménage.
Les origines sociales familiales, seconde dimension introduire dans notre modèle
explicatif, apparaissent elles aussi jouer un rôle majeur dans la transition des études vers
l’emploi. La littérature sur la stratification sociale, l’éducation et l’emploi confirme
l’importance de la classe sociale et du contexte familial sur la transition vers l’emploi
(Buchmann, 2002). Ainsi, des origines sociales privilégiées conduisent plus
fréquemment au retard de la sortie des études et de l’entrée sur le marché du travail
(Giorguli, 2011). Avec de meilleures ressources économiques et culturelles, les familles
peuvent plus aisément financer les coûts éducatifs (Shavit et al, 1990), tout en offrant à
leurs enfants les conditions culturelles de leurs réussites. L’intériorisation des codes
9
dominants de la culture scolaire (Bourdieu, 1977), notamment par l’exposition à la
lecture (De Graaf, 1986), favorisent la réussite des enfants de ces milieux sociaux et
culturels privilégiés, tout en leur transmettant de meilleures aspirations éducatives et
professionnelles (Sewell et Hausser, 1968), mobilisées lorsque la transition des études
vers l’emploi se réalise.
Souvent associées aux origines sociales familiales, la dimension « genre » et le partage
des rôles entre hommes et femmes au sein de la société contribuent aussi à participer à
la définition des conditions de transition des études vers l’emploi. En effet, malgré la
hausse progressive de l’accès des femmes, aussi bien aux études secondaires et
supérieures, qu’au marché de l’emploi, les parcours masculins et féminins au Mexique
demeurent contrastés. Les modèles culturels traditionnels marquent toujours fortement
les rôles et les statuts des femmes à l’intérieur et hors de la famille ; les aspirations à
une entrée précoce en union et l’implication de ces femmes dans l’organisation
domestique familiale priment encore sur les perspectives éducatives et professionnelles
(Silas Casillas, 2008). Cette norme persiste même au-delà des modèles culturels. Ainsi,
quelle que soit l’origine sociale, les femmes mexicaines demeurent toujours moins
nombreuses que les hommes sur le marché du travail, reflet de parcours professionnels
souvent interrompus après l’entrée en union et la naissance d’enfants (Ariza et Oliveira,
2005).
Nouvelle dimension à l’analyse, le temps au travers du concept de « génération » utilisé
en démographie, permet d’associer temps historique et âge des individus. Etudier
conjointement l’ensemble des individus nés une même année ou pendant une même
période (Ryder, 1965) permet d’inscrire ces générations dans un même contexte
historique. Cette dimension prend tout son sens pour des événements spécifiques qui
surviennent à une période donnée de l’histoire de vie des individus et qui ainsi peuvent
être interpréter à l’aune des conditions historiques rencontrées (Alwin et McCammon,
2007). Estimer ainsi le temps dans l’analyse de la transition « études-emploi » permet
de proposer une première approche contextuelle, celle liée à l’histoire sociale et
économique du pays dans lequel cette transition se réalise.
Enfin, le contexte éducatif et professionnel institutionnel constitue la dernière
dimension au modèle d’analyse proposé. Au regard des précédents travaux mentionnés,
10
il est l’un des apports de ce travail, puisqu’il intègre aux dimensions propres aux
individus et à leur famille, celle des contextes institutionnels « macro ». Comme le
précisent Elman et O’Rand (2007, p. 1278), avant d’être individuelle, la réussite scolaire
dépend des opportunités offertes au sein de chaque contexte. Depuis la théorie de
l’industrialisation (Treiman, 1970), l’effet de la modernisation des structures
économiques, par le biais du développement et de la valorisation de l’éducation, s’est
imposé comme une composante explicative de l’offre éducative, favorisant ainsi une
meilleure distribution des ressources sociales. Quoi qu’empirique et peu explicative
(Müller et Karle, 1993), cette approche a cependant confirmé le lien étroit entre
« développement social » et poursuite des études. Ainsi, la diminution du poids
d’activités économiques dites « traditionnelles », comme l’agriculture ou la pêche,
montre que dans de tels contextes, les besoins en main d’œuvre familiale se réduisent et
la demande d’éducation est croissante, les chances de réussite des enfants augmentant
alors.
Loin d’être indépendantes, ces cinq dimensions apparaissent fortement liées les unes
aux autres, nous offrant l’opportunité d’appréhender trois niveaux d’analyse à l’étude de
la transition « études-emploi »: celui de l’individu et de sa trajectoire biographique,
celui de la famille et des conditions socioéconomiques et culturelles d’origine, enfin
celui du contexte institutionnel et historique au sein duquel les études et l’accès au
marché de l’emploi se réalisent. Aussi, notre travail souhaite-t-il vérifier si la transition
« études-emploi » répond à un processus stratifié selon les origines sociales, avec de
fortes différences entre hommes et femmes et entre générations. Il a aussi pour objectif
d’apporter des éléments de réponse à la dynamique qui lie les trajectoires éducative et
professionnelle entre elles, et avec le processus de formation de la famille, dont sa
première étape, l’entrée en union. Enfin, l’enjeu de ce travail est de pouvoir estimer, au
sein des différents territoires du Mexique, le rôle joué par le contexte institutionnel, et
ce au fil du temps.
Une transition complexe
Considérer la transition « études-emploi », comme le passage d’une période où études et
emploi peuvent se côtoyer, à une autre période où seul prime l’emploi, nous permet de
mieux formaliser les différentes étapes qui composent cette transition. On peut
11
distinguer deux phases. La première que l’on peut considérer comme «initiale» de
scolarité ou d’études, débute avec l’entrée à l’école3 et se conclut par la fin des études.
Cette première phase, bien que caractérisée, par l’assistance scolaire, n’exclue pas la
possibilité d’expériences professionnelles. Une telle approche, permet dans l’étude de la
transition vers l’emploi, la prise en compte de situations différentes : une première,
« traditionnelle », où l’accès à l’emploi succèderait à la sortie des études ; une seconde,
où une expérience professionnelle aurait précédé la fin des études, avant l’accès à un
premier emploi hors période de scolarité ou d’études. Appréhender ainsi la transition,
nous offre l’opportunité d’évaluer le rôle d’expériences professionnelles antérieures à la
sortie du système éducatif. Cela nous permet aussi de dépasser l’image « normative »
d’un unique passage de la fin des études vers l’emploi et d’offrir une solution à
l’analyse de situations plus complexes où accès à l’emploi et fin des études se mêlent.
Figure 1 : Diagramme de la transition « études-emploi »
Phases
En cours de scolarisation ou d'études
"Continuité professionnelle" avant et après la sortie de l'école ou des études
100% Expérience scolaireSortie de l'école ou
des études (au moins deux ans)
Niveau d'études atteint Emploi
Expérience professionnelle
Expérience professionnelle avant la sortie des études
Pas d'expérience scolaire
"Iniciale" "Finale"
3 93% des personnes étudiées dans l’enquête EDER-2011 sont entrées dans le système scolaire entre 5 et 7 ans.
12
La seconde phase que l’on considèrera comme « finale », identifie quant à elle toute
nouvelle entrée en emploi après la sortie de l’école. Nous verrons plus loin que la
définition de la sortie de l’école doit elle-même être considérée avec précision et
renvoie à de possibles sorties temporaires du système éducatif. Aussi, pour palier à de
possibles interruptions d’une année, nous conserverons comme critère toute sortie de
l’école ou des études de 2 ans et plus4. Cette phase « finale », dernière étape de la
transition peut bien évidemment révéler des situations transitionnelles durant lesquelles
l’entrée dans un emploi avant la fin des études, se poursuivrait au-delà de la sortie du
système éducatif elle-même. De telles situations où l’activité professionnelle prendrait
définitivement le pas sur le temps dédié aux études et perdurerait, ne seraient pas alors
appréhendées comme une transition des études vers l’emploi, mais comme une période
de « continuité professionnelle », débutée avant la sortie des études. Les assimiler aux
autres situations marquant le passage à un emploi après la fin des études, conduirait à
mêler des processus d’intégration au marché du travail à partir d’expériences éducatives
et professionnelles au combien hétérogènes5. Lorsque de telles situations se présentent,
nombreux sont les cas où l’emploi débuté avant la fin des études cède la place à une
situation professionnelle plus favorable6. La transition vers cette nouvelle activité peut
alors être considérée comme le passage vers un premier emploi après la fin des études,
mais avec l’expérience d’une activité professionnelle antérieure. Si l’analyse que nous
réalisons de la transition des études vers l’emploi, laisse de côté les situations « de
continuité professionnelle » durables, elle n’en permet pas moins d’analyser l’ensemble
des trajectoires qui conduisent à l’entrée dans un premier ou nouvel emploi après la
sortie des études, tout en estimant le poids joué par le niveau éducatif atteint au moment
de la transition vers l’emploi.
4 Après une interruption de plus de 2 années, les personnes peuvent réintégrer des études avec l’objectif de parfaire leur formation ou de valider par l’obtention d’un diplôme des études incomplètes débutées auparavant.
5 L’analyse des trajectoires professionnelles à partir de l’EDER-2011 montre que 90% des trajectoires faisant état d’un emploi avant la fin des études correspondaient à des emplois à temps complet. De même, 60% de répondants déclarant une activité professionnelle avant la fin de leurs études disposaient du même emploi avant et après cette échéance, et 40% avaient changé d’emploi entre ces deux périodes.
6 Parmi les personnes ayant expérimenté un emploi avant la fin de leurs études et ayant changé d’activité professionnelle après la sortie du système éducatif, 74% d’entre eux ont réussi à obtenir une situation professionnelle plus favorable, souvent liée à l’acquisition d’un emploi à temps complet.
13
La complexité d’une telle analyse nécessite donc de préciser les termes relatifs aux
évènements qui caractérisent cette transition des études vers l’emploi. Ainsi, sera
considérée comme sortie de l’école ou des études, toute sortie du système scolaire ou
éducatif d’une durée au moins égale à deux ans consécutifs. Comme nous l’avions
abordé précédemment, cette définition permet d’exclure les courtes interruptions,
parfois liées à une mobilité géographique, à des raisons de santé ou à un investissement
professionnel saisonnier. Elle offre aussi l’avantage de mieux apprécier les situations de
rupture dans les trajectoires scolaires et éducatives, et d’appréhender avec plus de
justesse cette « période transitionnelle » complexe et dynamique que représente la
transition « études-emploi ». L’accès à l’emploi sera quant à lui considéré comme la
première entrée en emploi après la sortie de l’école ou des études, selon les critères
définis auparavant. Afin de saisir les emplois « significatifs » des trajectoires
professionnelles, marqueurs de la transition « études-emploi », seuls ceux conduisant à
une période d’activité continue d’une durée au moins égale à un an sont contemplés,
qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel7.
3. Les sources de données et l'approche multiniveau
Enquête biographique et recensements de la population
L’approche « multiniveau » envisagée dans ce travail nécessite la mobilisation de
sources de données adaptées. Comme nous l’avons présenté en introduction, deux
sources différentes ont été utilisées. La première correspond à l’ « Enquête
Démographique Rétrospective » (EDER-2011)8. Réalisée en 2011 dans les 32 plus
grandes aires métropolitaines du Mexique, cette enquête a permis de recueillir
l’ensemble des biographies résidentielle, scolaire, professionnelle et familiale de près de
3200 hommes et femmes, issus de groupes de générations ayant participé aux mutations
7 Cette définition recoupe celle utilisée dans l’enquête EDER-2011. Aucune précision supplémentaire ne fut apportée aux enquêtés, ceux-ci définissant « subjectivement » les emplois en fonction de leur expérience biographique.
8 Cette enquête réalisée par l’Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) s’inscrit dans un programme international associant, d’une part des institutions mexicaines, dont le Colegio de la Frontera Norte de Tijuana (Colef), porteur du projet, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), le Consejo Nacional de Ciencías y Tecnologías (Conacyt), et d’autre part des institutions françaises dont le CNRS et le Centre de Recherche et de Documentation sur les Amériques (Creda).
14
sociales et économiques des cinquante dernières années (Générations : 1951-53, 1966-
68, 1978-1980). Cette enquête nous permet, pour la seconde fois dans ce pays9,
d’étudier l’évolution de processus de transition, comme ici le passage des études à
l’emploi. En s’appuyant sur les histoires de vie individuelles, elle nous offre la
possibilité d’intégrer à notre analyse les facteurs propres à ces biographies, aux
dynamiques qui les accompagnent et aux contextes familiaux qui les encadrent.
La seconde source de données correspond aux recensements nationaux de la population
du Mexique réalisés en 1960, 1970, 1990, 2000 et 201010. Cette série de données
agrégées à l'échelle locale, permet de disposer d'informations sociales et économiques
contextuelles aux différentes périodes de recensement. Leur intégration à notre
approche permet d'ajouter la dimension « macro » à notre analyse de la transition
« Etudes-emploi ». En associant les lieux de résidence de chaque année de l'histoire de
vie des enquêtés de l'EDER-2011, avec les données contextuelles des recensements de
ces mêmes lieux, on parvient ainsi à caractériser les espaces géographiques,
économiques et sociaux rencontrés par les individus à chaque moment de leur histoire
de vie ; les dimensions « micro », individuelles et familiales, et « macro », contextuelles
et institutionnelles, étant ainsi rassemblées.
L'analyse biographique et les modèles « multiniveau »
Notre modèle « multiniveau » d'analyse de la transition des études vers l'emploi nous
conduit donc à associer plusieurs approches méthodologiques. La première, l'analyse
biographique, s'attache à étudier la transition elle-même, en estimant à partir d'un
ensemble de techniques de régressions multivariées, « la fonction de risque » de vivre
un événement biographique, la survenue du premier emploi, au fil du temps et des
histoires de vie des individus (Allison, 1984 ; Steele et al, 2007). Dans les modèles en
temps discret que nous utilisons dans ce travail, est estimé le risque plus ou moins
rapide de vivre l'entrée en emploi au fil de la biographie. Dans la présentation des
9 Une première enquête biographique nationale de ce type (EDER-1998) a été réalisée à la fin des années 1990 (Coubès et al, 2005).
10 Comme dans de nombreux travaux s'appuyant sur les données des recensements de la population au Mexique, les données issues du recensement de 1980, de mauvaise qualité, n'ont pas été intégrées à notre analyse.
15
résultats, nous avons fait le choix de représenter les coefficients sous la forme
exponentielle, permettant une interprétation plus facile en « rapport de chance » ou
« rapport de risque »11 (Odds ratio). L'apport de tels modèles multivariés est de
permettre d’estimer le rôle de variables individuelles, comme l’origine sociale ou la
génération, et l’influence d’événements et de statuts changeants au fil des
biographiques, comme la situation familiale.
La seconde approche, « multiniveau », visant à intégrer à l'analyse biographique les
spécificités des contextes institutionnels, permet de qualifier chacune des années
d’exposition au risque de vivre l’événement, entrée dans le premier emploi, en fonction
des caractéristiques du « contexte institutionnel ». L’hypothèse sous-jacente est ici que
les probabilités de transition vers l’emploi ne dépendent pas uniquement des situations
et caractéristiques propres à l’individu et à sa biographie, mais aussi du contexte
rencontré à chaque moment de son histoire de vie12. A partir des données des
recensements de la population (1960, 1970, 1990, 2000 et 2010), 64 « contextes
institutionnels » ont été élaborés. S'appuyant sur l' « Entité Fédérative » (Etat du
Mexique) et la nature « rurale » ou « urbaine » de la localité de résidence13, ils
permettent de caractériser le contexte historique et socioéconomique de chaque année
d'observation et année de l'histoire de vie des personnes. La construction de cet
indicateur contextuel « macro », à partir du pourcentage d'actifs dans le secteur de
11 Ces « rapports de chance » sont exprimés comme suit : P(q) / 1-P(q) = eat * eβt1 * eβt2 * … * eβtn . P(q) représente la probabilité de vivre l’événement ; 1-P(q) la probabilité de ne pas le vivre ; l’exponentiel des coefficients eat et eβtn précise l'intercept et estime le risque d'expérimenter l'événement de la transition à chaque année d'observation, à chaque âge t (1, 2,...,n) par rapport à l'année ou l'âge de référence. Ces « rapports de chance » estiment l'effet de chacune des variables explicatives introduites dans le modèle, indépendamment des autres. Entre 0 et 1, la variable réduit les chances de vivre l'événement, et au-dessus de 1, la variable augmente ces chances, et ce par rapport à la situation de référence.
12 Afin d’évaluer les effets de « contexte institutionnel » et de corriger les estimations liées à une analyse s’appuyant sur les années de vie des répondants, l’utilisation d’« intercepts aléatoires » dans la modélisation a été privilégiée (Goldstein, 2007; Rabe-Hesketh, et Skrondal 2012).
13 Nous nous sommes appuyés ici sur les définitions communément utilisées au Mexique, notamment par l'INEGI, des notions de « rural » (moins de 2500 habitants) et d' « urbain » (2500 habitants et plus).
16
l'agriculture et de la pêche14, s'inscrit dans les travaux issus de la théorie de
l'industrialisation précédemment mentionnés.
Aussi, au regard de la complexité du processus de transition des études vers l'emploi
que nous avons exposé précédemment, nous avons souhaité nous concentrer sur
l’analyse des facteurs explicatifs de la première entrée en emploi à partir de 7 ans,
lorsque cette entrée représente l'acquisition d'un travail d'une durée d'au moins un an.
Afin de vérifier nos hypothèses, plusieurs modèles ont été testés. Le modèle le plus
complet est ici présenté. Il intègre les conditions contextuelles, les caractéristiques
sociodémographiques des personnes, leurs origines sociales familiales et les moments
des biographiques scolaires et conjugales. Mais, il fait aussi appel à une interaction
entre les moments des biographies scolaire et familiale et l’origine sociale familiale,
nous permettant ainsi de vérifier, si l’interférence entre, d’une part l’accès à l’emploi, et
d’autre part, la sortie du système éducatif et l’entrée en union, diffère selon les origines
sociales familiales (IOS)15. De même, pour distinguer les mécanismes à l’œuvre dans la
transition vers l’emploi, entre les hommes et les femmes, nous avons réalisé des
modèles séparés16.
4. La transition vers l’emploi en mutation
Un calendrier plus tardif
Avant toute analyse explicative, l’examen des calendriers des deux étapes de la
transition vers l’emploi permet d’avoir un premier regard des changements historiques
qui se sont produits au fil des générations. Le premier résultat est l’allongement attendu
14 A partir des données de recensement issues du projet Integrated Public Use Microdata Series – International (IUPMS), ont été calculées pour chaque période inter-censitaire, les valeurs représentatives des actifs du secteur agricole et de la pêche. Elles ont ensuite été appliquées aux années correspondantes des histoires de vie des personnes (1960-2011).
15 L’Indice d’Origine Sociales – IOS (Solís, 2012) est un indicateur résumé du contexte socioéconomique familial. Inspiré des travaux de Buckman et Hannum (2001), il représente, d’une part le passé professionnel et le niveau d’études des parents, d’autre part les ressources socioéconomiques de la famille lorsque les répondants avaient 15 ans.
16 Les variables explicatives sont : le groupe de générations (1951-53, 1966-68, 1978-80) ; l’indice d’origines sociales, le pourcentage standardisé des actifs dans le secteur agricole et de la pêche ; les moments des biographiques scolaire et conjugale « Pendant » et « Après ». Les variables d’interaction entre l’IOS et les moments des biographiques scolaire et conjugale ont, elles aussi, été introduites.
17
de l’ensemble de la transition. Comme les figures 2 et 3 en témoignent, les calendriers
de la sortie des études et de l’entrée dans le premier emploi17 ont tous deux été retardés,
avec il est vrai des temporalités historiques différentes. Ainsi, le principal changement
du calendrier scolaire est intervenu après les générations du milieu du XXe siècle (1951-
53), au moment où, pour une population de plus en plus urbaine, l’accès à l’éducation se
généralisait. Alors que la moitié des hommes et des femmes de ces générations ont
abandonné les études à 15 et 14 ans, pour les générations qui ont suivi (1966-68, 1978-
1980), l’âge médian à la sortie du système éducatif est apparu respectivement à 16 et 17
ans.
Figure 1 : Calendrier de la première sortie de l'école ou des études par sexe et groupe
de générations. EDER-2011
Le retard du calendrier d’accès au premier emploi quant à lui s’est manifesté un peu
plus tard, et a touché différemment les hommes et les femmes, montrant, comme on
17 Rappelons ici que la sortie des études représente la première période sans scolarisation d’où moins deux années consécutives et que l’entrée dans le premier emploi correspond à la première activité professionnelle d’une durée au moins égale à un an.
18
pouvait s’y attendre, la place distincte de l’emploi dans les biographies masculines et
féminines. L’accès des hommes au marché du travail est demeuré assez précoce pour les
générations 1951-53 et 1966-68. Ce n’est que pour les générations 1978-1980 que l’âge
à l’accès au premier emploi a marqué un net recul. L’allongement des études, conjugué
aux difficultés économiques que le pays a vécu à partir du milieu des années 1980,
explique en partie ce retard. Pour les femmes, le recul du calendrier d’entrée dans le
premier emploi doit être interprété à l’aune de la place que l’activité économique a
représenté au fil des générations dans les biographies féminines. L’entrée en emploi est
apparue rapidement dans l’histoire de vie pour certaines femmes des anciennes
générations (1951-53). Peu nombreuses sur le marché de l’emploi formel, ces femmes
pour beaucoup sortirent précocement de l’école. Ce n’est qu’ensuite, à partir des
générations 1966-68, que la généralisation de l’accès des femmes au marché du travail
est intervenue, à une période de l’histoire économique mexicaine où nombre d’emplois
peu qualifiés du secteur secondaire, comme ceux des usines de production liées au
commerce international, « les maquilladoras », se sont développés.
Figure 2 : Calendrier de l'entrée dans le premier emploi par sexe et groupe de
générations. EDER-2011
19
L’étude des deux calendriers témoigne donc d’un retard généralisé de la transition
« études-emploi », mais peine à montrer les ajustements qui ont pu survenir au sein des
biographies individuelles entre la sortie des études et l’entrée dans l’emploi. Le recul
plus marqué de l’âge à la fin des études suggère l’affirmation d’une plus grande
« continuité » entre les deux étapes de la transition. Si pour les hommes, le passage
rapide entre la sortie du système éducatif et l’entrée sur le marché de l’emploi est une
constante, puisque la moitié d’en eux vivent ces deux événements d’une année sur
l’autre, pour les femmes le temps entre ces deux étapes de la transition a
considérablement diminué. En effet, si 5 ans séparait la fin des études de l’entrée en
emploi pour la moitié des femmes de la génération 1951-53, cet écart s’est réduit à deux
ans pour les générations les plus jeunes (1978-80).
Une transition socialement plus marquée
Cette plus grande « continuité » dans la transition des études vers l’emploi, cache en
réalité, dans nombre de biographies une modification des séquences entre événements.
Si la norme demeure l’entrée dans l’emploi après la fin des études (67%), et si les
hommes sont nombreux à expérimenter un premier emploi avant la sortie du système
éducatif, les changements les plus marquants apparaissent chez les femmes. En effet,
au-delà de leur nombre croissant à entrer sur le marché du travail, elles vivent de plus en
plus leur premier emploi avant la fin des études : 19% dans les anciennes générations
(1951-53), elles sont 28% à l’avoir fait dans les plus jeunes générations (1978-1980).
Tableau1 : Distribution des séquences "Etudes-emploi" par sexe et groupe de
générations. EDER-2011
Séquences % N % N % N % N % N % N % NSE||T 67 1760 60 252 55 252 64 324 81 291 74 310 72 351
T||SE||T 33 859 40 170 45 170 36 179 19 69 26 111 28 139Total 100 2557 100 422 100 422 100 503 100 360 100 421 100 490
1978-80Total Hommes Femmes
1953-55 1966-68 1978-80 1953-55 1966-68
Note: Séquences SE||T = Sortie des études - Travail ; T||SE||T = Travail - Sortie des études - Travail
Si on le voit, l’analyse des séquences de la transition confirment bien des parcours
différents pour les hommes et pour les femmes, elle montre aussi l’importance du rôle
20
joué par les origines sociales. On le constate dans les trajectoires masculines aux
origines les plus favorisées (Haut). L’expérience professionnelle avant la transition
(T||SE||T) y est plus fréquente (44 à 50%). Mais, le principal résultat est sans aucun
doute l’augmentation de cette même séquence transitionnelle dans les histoires
biographiques des femmes issues de familles favorisées. Déjà les plus nombreuses à
vivre une telle séquence dans les anciennes générations (27%), elles le sont toujours
plus dans les générations les plus jeunes (41%).
L’effet de l’inégal allongement des études selon les classes sociales d’origine apparait
ici clairement. Hommes et femmes des familles les plus favorisées ont été plus
nombreux à profiter de la généralisation de l’accès aux études secondaires et
supérieures, ouvrant ainsi la possibilité d’expérimenter une activité économique avant
une sortie tardive du système éducatif. La conciliation des rôles scolaires et
professionnels semblent ici de plus en plus offerte aux hommes, mais aussi et surtout
aux femmes de ces familles favorisées. A l’opposé de l’échelle sociale, l’importance des
séquences de transition des études vers l’emploi sans expérience professionnelle
préalable (SE||T), pour les hommes et les femmes de familles à faible capital social et
économique, semble étroitement liée au calendrier précoce de fin des études. Si ce
constat est d’autant plus vrai pour les générations les plus anciennes (1951-53), la
difficulté de concilier rôles scolaire et professionnel pour les générations qui ont suivi,
semble plus encore s’affirmer. Pour les hommes surtout, le recul de la fin des études et
les difficultés d’insertion dans des secteurs économiques peu qualifiés « en crise » ont
semble-t-il bel et bien contribué à réduire les opportunités d’expérience professionnelle
préalable à la sortie du système éducatif.
Tableau2 : Distribution des séquences "Etudes-emploi" par origines sociales (Indice
IOS: Bas, Moyen, Haut) selon le sexe et le groupes de générations (en%). EDER-
2011
Séquences B M H B M H B M H B M H B M H B M HSE||T 57 68 52 56 59 50 72 67 56 80 90 73 75 79 68 78 78 59
T||SE||T 43 32 48 44 41 50 28 33 44 20 10 27 25 21 32 22 22 41Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1978-80 1953-55 1966-68 1978-801953-55Hommes Femmes1966-68
Note: Séquences SE||T = Sortie des études - Travail ; T||SE||T = Travail - Sortie des études - Travail
21
L’hétérogénéité des transitions selon les origines sociales de la famille semble bien
corrélée à l’inégal bénéfice que ces familles ont tiré de l’allongement des études.
L’étude des parcours en fonction du niveau d’étude atteint au moment de la sortie du
système éducatif, montre en effet que l’expérience professionnelle avant la sortie de
l’école (T||SE||T) est bien moins fréquente pour les hommes et les femmes à plus faible
niveau d’études. Très rare pour les hommes et les femmes ayant atteint un niveau
primaire ou secondaire, l’expérience professionnelle préalable à la sortie des études
devient en revanche bien plus fréquente lorsque des études supérieures sont venues
clore la trajectoire scolaire et éducative. Certes les hommes et les femmes de ces
parcours d’études sont demeurés plus longtemps dans le système éducatif, leur offrant
ainsi le temps d’expérimenter l’exercice d’une activité économique, mais il est fort à
parier qu’au cours de ces années, ces diplômés ont su et ont pu réunir les conditions
sociales et familiales favorables à la conciliation des études et d’un emploi.
Tableau 3 : Distribution des séquences selon le niveau d'études (en %). EDER-2011
Séquences Prim. Sec. Prep Com/Téc Sup Prim. Sec. Prep Com/Téc SupSE||T 74,45 69,08 54,38 52,63 35,76 89,3 82,58 79,01 71,96 44,84
T||SE||T 25,55 30,92 45,62 47,37 64,24 10,7 17,42 20,99 28,04 55,16Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Hommes Femmes
Note: Séquences SE||T = Sortie des études - Travail ; T||SE||T = Travail - Sortie des études - Travail
Cette première analyse des calendriers et des séquences de la transition « Etudes-
emploi » a montré les liens étroits qui unissent l’ensemble des événements de l’histoire
de vie individuelle, événements des trajectoires scolaire et professionnelle, mais aussi
familiale. Les premiers résultats témoignent de la complexité de la transition et de la
forte hétérogénéité sociale qu’elle porte. La généralisation de l’offre éducative et
l’allongement des études, d’une part, l’accès de plus en plus fréquent des femmes sur le
marché de l’emploi, d’autre part, ont eu un effet important sur les modalités de
réalisation de la transition « Etudes-emploi ». On peut y voir l’effet conjoint de
l’hétérogénéité de l’offre d’éducation et de l’inégal capital social et culturel mobilisé
pour s’en accommoder. Selon les contextes institutionnels et les milieux familiaux
d’origine, les opportunités de poursuite des études ne s’offrent pas à l’identique et la
22
conciliation des rôles sociaux définis autour des biographies scolaire, professionnelle et
familiale, diffère. Si pour certains, le prolongement des études peut coïncider avec
l’expérience d’une activité économique, pour d’autres, les modalités d’une telle
transition en conflit avec d’autres alternatives de l’histoire de vie, dont les charges
familiales et reproductives, ne peuvent être envisagées. Cette inégale exposition aux
conditions de réalisation de la transition des études vers l’emploi s’exprime d’autant
plus dans les biographies féminines, où pour les générations les plus jeunes, on observe
dans les familles les plus favorisées, l’émergence de nouvelles opportunités. La
poursuite des études et l’expérimentation d’une activité économique conjointe semble
en effet devenir une alternative à un modèle traditionnel où la formation de la famille
est au cœur des biographies féminines.
Rôle des contextes, des origines sociales et des biographies
Si notre première approche descriptive de la transition « Etudes-emploi » a permis de
mettre en évidence, d’une part l’étroite relation entre les calendriers de fin des études et
d’entrée dans l’emploi, et d’autre part l’importance jouée par les origines sociales
familiales et les contextes, il apparaît pour l’heure difficile d’en démêler le rôle
respectif. La nécessité de modéliser ces facteurs pour en déterminer l’effet propre à
chacun s’impose alors.
Les premiers résultats de l’analyse explicative (Figure 4) permettent tout d’abord de
confirmer, comme cela était observable dans l’étude du calendrier, l’augmentation
graduelle au fil des années de vie du risque d’entrée dans le premier emploi. Dès 15
ans, ce « risque » s’affirme et ce jusqu’à 19-22 ans pour les femmes et 23-26 ans pour
les hommes, âges représentatifs de la plus forte exposition au risque. De même,
l’hypothèse du rôle majeur joué par les conditions historiques offertes aux générations
est confirmée. Si l’effet des générations n’apparait significatif que pour les femmes, les
plus jeunes générations ayant un risque plus élevé de rentrer dans le premier emploi,
l’absence d’effet pour les autres générations des femmes (1966-68) et pour les hommes,
tient à l’introduction dans le modèle explicatif du pourcentage d’actifs dans le secteur
de l’agriculture et de la pêche. En son absence, la composante générationnelle ressort
fortement. Ce résultat montre au combien les inégalités contextuelles, ont exercé et
exercent encore aujourd’hui une influence non négligeable dans l’accès au premier
23
emploi ; les générations nées au début des années 1950 ayant eu des conditions plus
« favorables » à une entrée précoce sur le marché du travail.
Figure 4 : Modélisation de la probabilité de vivre le premier emploi à chaque âge
pour les hommes et les femmes. EDER 2001.
Note: Modèles biographiques multiniveaux (premier emploi d'une durée d'au moins un an). Seuls les effets significatifs sont représentés.
Si la dimension des contextes « institutionnels » joue un rôle important, l’offre
d’opportunités scolaires et éducatives notamment, on constate que l’origine sociale elle
aussi, « toute chose égale par ailleurs », demeure un facteur explicatif de l’entrée rapide
dans le premier emploi. L’augmentation de l’Indice d’Origines Sociales (IOS) d’un
point conduit à lui seul à diminuer de 15% les risques d’entrée rapidement dans
l’emploi pour les hommes et pour les femmes. Le calendrier de la transition vers
l’emploi apparaît bien ici le résultat d’un processus social sélectif au sein duquel les
trajectoires professionnelle, scolaire et familiale sont en interaction. Mais des
mécanismes différents semblent à l’œuvre entre les hommes et les femmes. Pour ces
premiers, le risque d’entrée rapide dans un premier emploi pendant ou après la période
de sortie du système éducatif, apparait plus important que lorsqu’ils demeurent toujours
en cours d’études ; la sortie des études semblant alors constituer un préalable à l’entrée
en emploi. Ce processus de survenue des deux événements de la transition « Etudes-
emploi », bien présent chez les hommes, semble cependant différencié selon l’origine
sociale familiale. Les hommes issus de familles favorisées se distinguent en effet des
24
autres par un risque plus élevé d’entrée dans l’emploi après la fin des études18,
témoignant ainsi de transitions masculines socialement marquées. Le modèle d’entrée
dans l’emploi apparaît donc pour les hommes fortement lié à l’ordre de survenue de ces
deux étapes (« fin des études » et « premier emploi »), et aux opportunités offertes par le
contexte familial. Mais ce modèle d’entrée sur le marché du travail semble aussi révéler
le souhait ou la nécessité pour les hommes de disposer d’une situation économique
stable avant la réalisation du projet de formation de la famille, vérifiant une fois
encore le rôle social de « pourvoyeur économique familial » qu’ils incarnent au
Mexique. La transition des études vers l’emploi semble en effet fortement associée à
l’entrée dans l’histoire conjugale, celle-ci survenant très rapidement, dans les deux ans,
une fois des conditions scolaires et professionnelles favorables remplies. L’une des
particularités de ce processus de transition biographique chez les hommes, est qu’il
apparait survenir selon les mêmes modalités pour l’ensemble des strates sociales, le
risque d’entrer dans l’emploi n’étant pas plus élevé avant, pendant ou après l’union pour
les hommes issues de familles plus favorisées.
Comme pour les hommes, le risque d’entrer dans le premier emploi chez les femmes
survient plus souvent une fois les études terminées, mais à la différence des premiers, la
concomitance de l’entrée dans l’emploi et de la sortie de l’école apparaît plus forte. Là
encore, le passage de la fin des études au premier emploi semble bien répondre à un
processus social, qui conduirait les femmes issues de familles favorisées, à accéder à
l’emploi immédiatement après la fin des études. Inévitablement, on ne peut s’empêcher
de voir ici l’effet d’études plus longues dans ces catégories sociales et l’existence
probable de projets d’insertion professionnelle rapide dans des secteurs qualifiés du
marché économique. Si comme pour les hommes, l’entrée dans l’emploi semble
étroitement liée à la fin des études, elle semble tout aussi inscrite dans le parcours de
formation familiale, mais selon des modalités bien différentes. Contrairement aux
hommes, une fois la première étape de la formation de la famille débutée par l’entrée en
conjugalité, le risque des femmes d’accéder à un emploi diminue fortement, faisant de
18 Un « rapport de risque » supérieur à 1 pour les deux variables d’interaction associant « Biographie scolaire » (Pendant et Après) et l’Indice d’Origines Sociales montre une probabilité plus forte d’entrer dans l’emploi à ces deux moments clés de la sortie de l’école et ce d’autant plus que l’Indice d’Origines Sociales est élevé.
25
l’entrée en union un obstacle à l’entrée sur le marché du travail. On voit ici la difficile
conciliation entre de possibles opportunités d’accès à l’emploi et l’implication dans un
projet familial précoce, l’entrée dans l’emploi étant plus rare une fois l’union réalisée.
On retrouve les marques d’un modèle féminin d’histoires de vie tourné fortement vers le
processus de formation familiale. Mais, ce modèle ne semble pas universel pour toutes
les femmes. En effet, l’origine sociale apparaît déterminante dans cette transition
associant entrée dans l’emploi et début de l’histoire conjugale. Les femmes issues de
milieux plus favorisés, semblent pouvoir concilier plus facilement l’accès à l’emploi
après la survenue du début de formation de la famille. Ce dernier résultat témoigne sans
aucun doute de parcours de transition socialement bien plus marqués pour les femmes
que pour les hommes. Où, le modèle de pourvoyeur économique de la famille, chez les
hommes, semble transversal à l’ensemble des milieux sociaux, celui d’une difficile
conciliation entre vie familiale et professionnelle, fréquent chez les femmes, apparaît lui
moins présent au sein des milieux familiaux les plus favorisés.
5. Une conciliation des rôles « sociaux » toujours à l’épreuve
L’analyse que nous avons réalisée ici montre la diversité des mécanismes explicatifs en
jeu dans la transition vers l’emploi. Les contextes institutionnels, porteurs
d’opportunités scolaires et économiques, et les milieux sociaux d’origine, révèlent des
modèles d’accès à l’emploi différents, notamment entre hommes et femmes. Les rôles
sociaux et familiaux semblent ainsi peser fortement dans les arbitrages qu’hommes et
femmes réalisent au sein de leurs trajectoires scolaire, professionnelle et familiale.
Ces premières conclusions ont été confirmées lors d’une analyse complémentaire, non
présentée ici, que nous avons effectuée de la sortie du système scolaire. Les mêmes
facteurs explicatifs que ceux de l’accès à l’emploi surgissent ; les contextes « macro »,
lorsqu’ils sont peu favorables, et les origines sociales, lorsqu’elles révèlent des
contextes familiaux peu aisés, contribuent tous deux à engendrer une sortie rapide du
système éducatif. Mais, le principal résultat de cette analyse complémentaire a montré,
pour les hommes comme pour les femmes, que la sortie du système éducatif était
d’autant plus fréquente, lorsqu’une expérience professionnelle ou lorsque l’entrée en
union intervenaient avant la fin des études. On notera cependant, comme pour l’étude de
l’accès au premier emploi, que les modalités de réalisation de la fin des études peuvent
26
apparaitre bien différentes selon les origines sociales. Le prolongement des études parmi
les familles les plus favorisées semblent s’inscrire dans un jeu d’opportunités, où la
poursuite de longues études, l’insertion sur le marché du travail et la formation de la
famille peuvent être conciliées à un même moment de l’histoire de vie.
Comme le suggéraient les travaux antérieurs réalisés au Mexique sur ces questions, la
transition des études vers l’emploi apparait donc un processus complexe et hétérogène.
Si le pays a vécu ces cinquante dernières années de profondes transformations sociales
et économiques, la persistance de modèles traditionnels de transition, où la sortie du
système scolaire précède l’accès à l’emploi et le processus de formation de la famille,
semble coexister avec l’émergence de nouveaux processus de transition conciliant
études, emploi et formation de la famille, même si pour l’heure, de tels modèles sont
avant tout l’apanage des familles aisées.
Bibliographie
ALEXANDER J.-C., GIESEN, B., MÜNCH, R., SMELSER, N. [1987], « The Micro-Macro link ». University of California Press, p.400.
ALLISON P. -D. [1984], « Event History Analysis: Regression for Longitudinal Event Data » Sage University Papers Series. Quantitative Applications in the Social Sciences; No. 07-046.
ALLMENDINGER, J. [1989], “Career mobility dynamics. A comparative analysis of the United States, Norway, and West Germany”. Berlin: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung [Studien und Berichte 49].
ALWIN, D., MCCAMMON, R. [2007], “Rethinking Generations”. Research in Human Development, 4 [3-4], p.219-237. ARIZA, M., DE OLIVEIRA, O. [2005], « Unión conyugal e interrupción de la trayectoria laboral de las trabajadoras urbanas en México » in COUBÉS M.-L, ZAVALA DE COSÍO M.-E et ZENTENO R. [coords.], Cambio Demográfico y Social en el México del siglo XX Una perspectiva de historias de vida, Tijuana, BC: El Colegio de la Frontera Norte, 2004 p.429-451. ARUM, R., HOUT, M. [1997], « The Early Returns: Transitions from School to Work in the United States » in MUELLER W., SHAVIT Y. (eds.), Educational Qualifications and Occupational Destinations, Cambridge: Oxford University Press, p. 471-510. BLAU P.-M., OTIS D.-D [1967], « The American Occupational Structure », New York: Wiley.
27
BOURDIEU, P. [1977], « Cultural reproduction and social reproduction », in KARABEL J., HALSEY, A.-H. [eds.], Power and Ideology in Education, New York: Oxford University Press, p. 487–511. BUCHMANN, C [2002], « Measuring family background in international studies of education: Conceptual issues and methodological challenges », in PORTER A.-C., GAMORAN A. [coords.], Methodological advances in cross-national surveys of educational achievement, Washington, DC, USA: National Academy Press, p.150-197. BUCHMANN, C., HANNUM, E. [2001], « Education and stratification in developing countries: A review of theories and research” », Annual Review of Sociology, vol. 27, août, p. 77-102. COUBÉS M.-L., ZENTENO, R. [2004], « Transición a la vida adulta en el contexto mexicano: una discusión a partir del modelo normativo pp. 331-352 » in COUBÉS M. -L, ZAVALA DE COSÍO M.-E et ZENTENO R. [coords.], Cambio Demográfico y Social en el México del siglo XX Una perspectiva de historias de vida, Tijuana, BC: El Colegio de la Frontera Norte, 2004 p.331-352. COURGEAU, D. [2003], « Methodology and Epistemology of Multilevel Analysiss. Approaches from Different Social Sciencies ». Methodos Series. Volume 2. Kluwer Academic Publishers. DE GRAAF, P.-M. [1986], « The impact of financial and cultural resources on educational attainment in the Netherlands, Sociology of Education », vol. 59, p. 237-246. DE SANDRE, P. [2004], « Du cycle de vie aux parcours et aux transitions biographiques », in CASELLI, G., VALLIN, J., WUNSCH, G. (dir.), Démographie: analyse et synthèse, VII. Population et société, Paris: Ined, 2004, p. 249-281. ECHARRI CÁNOVAS, C.-J., PÉREZ AMADOR, J. [2007], “En tránsito hacia la adultez: eventos en el curso de vida de los jóvenes en México”, Estudios Demográficos y Urbanos enero-abril año/vol. 22 número 001. El Colegio de México, AC. Distrito Federal, México, p. 43-77. ELMAN C., O’RAND, A. [2007], “The effects of social origins, life events, and institutional sorting on adults school transitions”, Social Science Research, vol. 36, p. 1276-1299 FILMER, D., PRITCHETT, L.H. [2001], « Estimating Wealth Effect Without Expenditure Data or Tears: An Application to Educational Enrollments in States of India, Demography 38, no. 115-32 [2001]. GIORGULI, S.-E [2011], « Caminos divergentes hacia la adultez en México » in BINSTOCK G., MELO VIEIRA, J. [Coords.], Nupcialidad y familia en la América Latina Actual. Campinhs UNICAMP/ALAS, 2011, p.123-163.
28
GOLDSTEIN, H. [2007], « Becoming familiar with multilevel modeling », Significance, http://www.bristol.ac.uk/cmm/team/hg/full-publications/2007/becoming-familiar-with-multilevel-modelling.pdf (page consultée le 17 décembre 2013).
HEATH, A.-F, CHEUNG, S.-Y. [1998], « Education and Occupation in Britain » in SHAVIT Y., MULLER W. (eds.), From School to Work, Oxford: Clarendon Press. HOGAN, D.-P. [1980], “The Transition to Adulthood as a Career Contingency”, American Sociological Review, Vol. 45, No. 2 [Apr., 1980], p. 261-276. HOUT, M. [2004], « Maximally maintained inequality revisited: Irish educational mobility in comparative perspective in NICGHIOLLA M., PHADRAIG, HILLIARD E., (eds.) Changing Ireland, 1989-2003.
KERCKHOFF A.-C. [1995], “Institutional Arrangements and Stratification Processes in Industrial Societies”, Annual Review of Sociology 15:323-47
KERCKHOFF, A.-C. [2003], « From Student to Worker » in MORTIMER J.-T., J. SHANAHAN, M. (eds.) Handbook of the Life Course. Springer.
LUCAS, S.-R [2001], “Effectively Maintained Inequality: Education Transitions, Track Mobility, and Social Background Effects”, American Journal of Sociology, Vol. 106, No. 6 [May 2001], pp. 1642-1690.
MARE, R.-D [1980], “Social Background and School Continuation Decisions”, Journal of the American Statistical Association 75:295–305. MARINI M.-M. [1984], “Age and Sequencing Norms in the Transition to Adulthood”, Social Forces, Vol. 63, No. 1 (Sep., 1984), pp. 229-244 MIER Y TERÁN M. [2004], “Pobreza y transiciones familiares a la vida adulta en las localidades rurales de la península de Yucatán”, Población y Salud en Mesoamérica, julio-diciembre, año/vol. 2, número 001. Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica MORA SALAS M., DE OLIVEIRA, O. [2009], “Los jóvenes en el inicio de la vida adulta: trayectorias, transiciones y subjetividades”. Revista Estudios Sociológicos, vol. XXVII, núm. 79, enero-abril, 2009, p. 267-289. El Colegio de México. Distrito Federal, México. MÜLLER W., KARLE, W [1993], “Social Selection in Educational Systems in Europe”, European Sociological Review 9 [1], 1993, S. p. 1-22. PARRADO E., ZENTENO, R. [2004], « Medio siglo de incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo: cambio social, reestructuración y crisis económica en México » in COUBÉS M. -L, ZAVALA DE COSÍO M.-E et ZENTENO R. [coords.], Cambio Demográfico y Social en el México del siglo XX Una perspectiva de historias de vida, Tijuana, BC: El Colegio de la Frontera Norte, 2004, p.191-223.
29
RABE-HESKETH S., SKRONDAL, A. [2012], « Multilevel and Longitudinal Modeling Using Stata. Volume II: Categorical Responses, Counts, and Survival ». Third Edition. Stata Press. RAFTERY, A.-E., HOUT, M. [1993], “Maximally Maintained Inequality: Expansion, Reform, and Opportunity in Irish Education, 1921-75”, Sociology of Education, Vol. 66. No. 1 [Jan. 1993], p.41-62. ROSENBAUM J.E.; KARIYA, T.; SETTERSTEN, R., MAIER, T. [1990], “Market and Network Theories of the Transition from High School to Work: Their Application to Industrialized Societies”, Annual Review of Sociology, Vol. 16 [1990], p. 263-299
RYDER, N. [1965], “The Cohort as a Concept in the Study of Social Change”, American Sociological Review, Washington D.C.: American Sociological Association, vol. 30, n.n. o 6, p. 843-861.
SEBILLE P. [2009], « Un passage vers l’âge adulte en mutation ? », in REGNIER-LOILIER A. [dir.], Portraits de Familles. Etude des relations familiales et intergénérationnelle, Coll “Grandes enquêtes”, INED, p.315-340.
SEWELL, W.-H., SHAH, V.-P [1968], “Social Class, Parental Encouragement, and Educational Aspirations”, American Journal of Sociology, Vol. 73, No. 5 [Mar., 1968], p. 559-572
SHAVIT, Y., YAISH. M., BAR-HAIM, E. [1990], “The persistence of persistent inequality”.http://www.ccsr.ac.uk/qmss/seminars/2008crossnat/documents/shavit_new.pdf (page consultée le 17 décembre 2013)
SILAS CASILLAS, J.C. [2008], “¿Por qué Miriam sí va a la escuela? Resiliencia en la educación básica mexicana”, Revista Mexicana de Investigación Educativa octubre-diciembre, año/vol. 13, número 039. Consejo Mexicano de Investigación Educativa, Distrito Federal, México, p.1255-1279.
SOLÍS P; RODRÍGUEZ E., BRUNET N. [2013], “Orígenes sociales, instituciones, y decisiones educativas en la transición a la educación media superior. El caso del Distrito Federal”, Revista Mexicana de Investigación Educativa [RMIE], vol. 18, núm. 59, p. 1103-1136.
SOLÍS P. [2012], “Desigualdad social y transición de la escuela al trabajo en la Ciudad de México”. Revista Estudios Sociológicos. El Colegio de México. Vol. XXX. Núm 90, septiembre-diciembre 2012.
STEELE F., GOLDSTEIN H., BROWNE W. [2007], « A general multilevel multistate competing risks model for event history data, with an application to a study of contraceptive use dynamics. Statistical Modelling 2004; 4: 145–159
TREIMAN D.-J [1970], « Industrialization and Social Stratification », in LAUMAN E,-O. [ed.], Social Stratification, Research and Theory of the 1970’s, Indianapolis, Bobbs-Merril, p. 207-234.