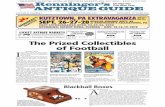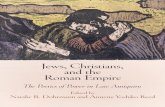« L’enfant et la huppe dans l’Égypte antique », Archéologia 531, pp. 30-35.
cosmogonie méditerranéenne antique
Transcript of cosmogonie méditerranéenne antique
LA COSMOGONIE ETRUSQUE, LIBYQUE ET PUNIQUED’APRÈS L’ICONOGRAPHIQUE FUNÉRAIRE*
Cette modeste contribution constitue une ébauche de réflexion sur cequ’il y de commun entre les civilisations antiques de laméditerranéenne centrale en dehors du dossier politique qu’il soitdes chapitres belliqueux ou pacifiques. Cette note sera axée sur lacosmogonie étrusque, libyque et punique et plus particulièrement lavision de l’univers d’outre tombe, du devenir du mort, du paradis etde l’enfer à travers aussi bien l’iconographie inhérente au contextefunéraire que le mobilier funéraire. Les questions que cetterecherche voudrait se poser portent sur l’existence ou pas d’uneunité entre ces trois grandes cultures de la Méditerranéeoccidentale en matière de vision de l’univers dit de l’au-delà etquels sont les éléments de cette conception du monde.
L’idée de ce travail est née suite à des réserves enregistrées ausujet d’explications avancées par nos prédécesseurs lors de lapublication de documents relatifs à ce dossier. En voici quelquesexemples : une scène de décor dans une tombe étrusque de la cité deTarquinia, à la quelle on trouve aisément des parallèles ailleurscomme à Chypre par exemple, est interprétée comme étant une scène debanquet champêtre du défunt dans sa vie d’ici bas1. Cetteinterprétation est inadéquate d’après nous. C’est ce que nous allonsprouver tout au long de cette note. Également, une peinture d’époquepunique dans une tombe du leu dit de Jbel Mlezza au Cap Bon enTunisie représentant entre autre une cité scindée de fortificationsest décrite comme étant « la cité des âmes »2. Ce terme est nonseulement ambigu mais aussi inapproprié pour la civilisation puniqueà laquelle appartient cette peinture funéraire. Un autre exemplecritique porte sur la civilisation libyque. Il s’agit d’une peinturedans un monument funéraire libyque de type hanout du lieu dit Kef elBlida dans la région de Aïn Draham au Nord ouest tunisienreprésentant une embarcation montée par des personnages avec toutautour deux individus l’un allongé à l’horizontale l’autre entraind’escalader une échelle. Cette figure est décrite comme étant levoyage du mort dans l’au delà3. Nous allons monter que cette scènefunéraire est d’une grande originalité pour le dossier qui nous
1* Adel Njim, Département d’Archéologie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Kairouan / Tunisie : (Mail : [email protected]).? Hermary, Scènes de culte, p. 177, figure 7. 2 Fantar, Eschatologie, p. 37, pl. XXVI. 3 Fantar, Ibid., p. 26 et suivant, pl. XXII.
préoccupe. De plus, les dessins de deux gros poissons affrontés dansun monument funéraire libyque de type hanout de Sidi Mohamed Latrechau Cap Bon est vu comme une allusion à une culture maritime d’oùcette scène est tirée4. Or, les poissons sont d’un grand rapport avecla conception du monde d’outre tombe. Nous allons présenter laraison.
Les interprétations avancées de tous ces documents sont à nos yeuxtrès impertinentes d’où le désir de cette nouvelle lecture au coursde laquelle on va essayer non seulement souligner les limites de cesexplications mais aussi de proposer une vision d’ensemble de cesdifférents documents en montrant qu’ils font partie d’un même puzzleet reflètent une seule et unique vision. Celle-ci fait partie d’uneconception de l’univers chez les trois cultures ciblées par cetteétude.
Cette note comportera deux axes. Le premier sera consacré à montrerle souci du devenir du mort aussi bien chez les Etrusques que chezleur voisins de l’autre rive de la Méditerranée qu’ils soientLibyens ou Puniques. Dans la seconde partie de cette note, on vadémontrer ce que nous qualifions d’obsession pour le paradis chezces trois cultures de la Méditerranée occidentale antique.
Il y a long à dire sur notre façon d’avoir regardé les peuples del’Antiquité ou du moins ceux qui nous ont précédé sur le solafricain et sur ceux de la rive nord de la Méditerranée. Ce regardn’a pas été souvent strictement le fruit des données textuelles oude l’observation et de l’interpellation de leurs legs matériels.Assez souvent il est né d’un amalgame où la part de spéculation estgrande. S’agissant du thème de la mort et de l’univers qui se situeaprès la vie d’ici bas comment les peuples antiques de laMéditerranée centrale voyaient-ils ce monde ?
Sans prétendre venir à bout de ce dossier, nous allons nouscontenter de présenter ici quelques éléments de réponse. Certainsqui sont déjà publiés seront revisités avec un regard nouveau,d’autres sont publiés pour la première fois. Il n y a aucun douteque les peuples Méditerranéens antiques se souciaient du devenir dumort une fois déposé dans la tombe. Ils croient à la résurrection dumort ou du moins à l’entité qui l’anime qui est l’âme. Une peinturefunéraire de la tombe punique de Jbel Mlezza au Cap Bon (en Tunisie)montre une créature similaire à un volatile très proche du coq, quiest une schématisation de l’âme, sortant de la tombe et se dirigeant
4 Ghaky, Les haouanet, p. 51 et figure. 2
vers une cité muraillée où se trouvent de multiples élémentssimilaires aux maisons d’ici bas (Figure 1). Cette peinture étaitétudiée auparavant. La cité muraillée était qualifiée de « cité desâmes ». Ce terme est d’après nous vague et ne correspond pas à laqualification de cette entité. Or, chez les cultures sémitiques dontla culture punique est issue cet élément correspond au paradis.Donc, l’image de la cité fortifiée est sans doute le paradis et lesdemeures sont celles des résidents ayant mérité d’y être admis. Demultiples documents figurés funéraires étrusques nous dévoilent lesouci de la récompense du mort après la fin de sa vie sur terre.Cette récompense sera soit positive sous forme d’accès à desplaisirs similaires à ceux de la vie terrestre ou négative sousforme de supplices physiques. Une peinture funéraire de la tombe deTarquinia montre une scène de banquet où des personnes sontconfortablement installées et d’autres leurs servent à boire et àmanger (Figure 2). Une scène originaire de Chypre reproduit le mêmethème (Figure 3). Ces représentations sont interprétées comme desscènes d’un banquet champêtre de la vie profane. Cependant, quelqueséléments, non négligeables à nos yeux, nous permettent de dire queces figures évoquent plutôt les plaisirs qui attendent le mort auparadis et non pas les souvenirs d’activités sur terre. Lespersonnes allongées sont peintes de deux manières. Les personnes quiservent à boire et à manger sont nues et ont une couleur de peausimilaire à celle de la peau humaine. Alors que les personnesservies ont les visages blancs et portent des vêtements blancs. Ils’agit sans doute des personnes mortes. Cette manière de lesreprésenter montre leur métamorphose une fois au paradis. Egalement,tous les personnages portent des couronnes de feuillages ce qui nousplace dans un contexte autre que celui de la vie profane. Danspresque toutes les scènes funéraires étrusques similaires on trouveen haut de la scène un arbuste gardé par deux félins. Tous ceséléments confirment la spécificité du lieu et nous éloignent del’idée banale d’une scène champêtre. Par ailleurs Quand on examinele reste du répertoire iconographique funéraire étrusque on comprendbien que ces scènes de banquet sont en rapport avec une conceptionentière de la vie dans l’au-delà. En effet, si la scène que nousavons décrit montre ce le mort souhaite après sa mort, une autrescène monte ce que le mort redoute dans sa vie d’outre tombe. Eneffet, une scène funéraire d’une tombe étrusque montre un personnageentrain de subir des supplices physiques et même des vices sexuels(Figure 4). Cette figure représente sans aucun doute le mort ayantmérité un devenir négatif dans sa vie de l’au-delà. Hélas, cettefigure à elle seule ne nous dit pas plus sur les raisons de cedestin. En effet, les deux individus qui sont entrain de torturer la
3
personne qui incarne le mort dans cette scène sont bien bâtisphysiquement. Cette attitude n’est que pour montrer leur natureautre que celle des Humains. Ce sont sûrement les anges chargés dela punition des personnes qui après leur mort auront un destinnégatif. En effet, on trouve des échos de cette conception chez lespeuples sémitiques durant l’Antiquité, comme chez les Chrétiens etles Musulmans. Il est intéressant de découvrir que même chez lesEtrusques cette conception est partagée. Cette question d’accéderaux plaisirs ou aux punitions après la mort n’est qu’une partied’une conception plus large de l’univers qui suit la mort. En effet,d’autres scènes funéraires étrusques attirent notre attention surd’autres épreuves qui attendent le mort dans sa vie d’outre tombe.En effet, le mort sera confronté à franchir une porte flanquée dechaque côté d’un personnage jouant de la musique (Figure 5). Cetteporte est très blindée. Il s’agit sans doute d’une évocation de laporte du paradis. Egalement, le mort doit passer par d’autresépreuves. Une figure étrusque montre une femme qui semble passer parl’épreuve du jugement (Figure 6). Un document sculpté montre unpersonnage allongé au dessus d’un lit étalant avec un grand sourirede satisfaction un rouleau inscrit (Figure 7). Cette imagecorrespond à l’idée du livre des actes que les personnages une foisinterpellées pour le jugement recevront. Le cheminement du mort versun devenir heureux ou funeste sera en fonction du contenu de cedocument. Cette représentation semble reproduire l’idée d’unepersonne satisfaite de sa destinée après sa mort puisque le personnequi y figure est contente et arbore ce document comme pour affichercet accomplissement. Ainsi, à travers toute cette documentation,nous avons pu entrevoir le souci chez les peuples de la Méditerranéeantique, du devenir du mort, leur espoir pour un devenir positif,leur phobie d’un devenir néfaste, leur souci de certaines épreuvescomme celle du questionnement. Mais tous ces peuples ont une réelleobsession pour une destinée positive. Disons-le en clair pouraccéder au paradis. C’est ce que bon nombre de documents nouspermettent de voir.
Il n’y a pas le moindre doute que chez les peuples antiques de laMéditerranée centrale que nous étudions dans le cadre de cette noteà savoir, les Etrusques, les Libyques et les Puniques, le paradisavait constitué un réel souci, si non même une obsession. Un vase enterre cuite du secteur dit d’Ard el Morali de la nécropole deCarthage qui remonte au milieu du quatrième siècle avant J.-C.comporte une scène peinte en noir d’une valeur pour le moinsexceptionnelle pour ce dossier5 (Figure 8). Malgré que ce vase fût
5 Njim, Etude, p. 53, fig. P n° 113, pl. XXVI.4
exhumé il y a longtemps6 et publié depuis des décennies7, aucunchercheur ne s’est intéressé au décor qu’il contient. Au fond de lacuvette de ce vase est nichée une scène de décor qui mérite qu’ons’y arrête (Figure 9). Il s’agit de trois entités qui sont une formestylisée de personnages. Devant eux et légèrement au dessus setrouve une sorte de tubercule suspendu en l’air. Derrière les trois,une silhouette probablement d’un serpent. Tout autour, sur le bordde la cuvette, des rinceaux de feuillage encadrent la scènecentrale. Pour comprendre le sens de cette scène il faut recourir àla Bible. En effet, les éléments qu’on retrouve dans cette œuvretrouvent leur parfaite correspondance dans la Bible. Les troissilhouettes seraient respectivement celle d’Adan, d’Eve et duDiable. Le tubercule serait une allégorie au fruit interdit duparadis et enfin le serpent. Le décor de rinceaux qui encadre lascène est pour évoquer l’endroit où se passe cet évènement à savoirle paradis. Donc, ce décor est une représentation de l’acte dit dupéché originel qui consiste à avoir transgressé l’ordre divin de nepas toucher au fruit de l’arbre du paradis qu’Adan et Eve avaitcommis en compagnie du Diable et du serpent qui était probablementchargé de surveiller aussi bien l’arbre que ses fruits8. La scène dudécor qui occupe ce vase est pour l’instant unique d’où sa grandevaleur. Un document proche de celui-ci provient de Chypre. Il s’agitd’un bol provenant probablement d’une tombe du site de Kandou. Ilremonte à une période située entre le milieu du huitième et la findu septième siècle avant J.-C.. Il comporte un décor peint sur laparoi externe (Figure 10)9. Parmi les figures de ce décor on trouvedeux représentations de femmes associées au palmier. Dans lapremière représentation la femme est entre deux palmiers, elle estentrain de cueillir ses fruits (Figure 11). Dans la deuxième figure,la femme est au dessus de l’arbre, elle semble avoir lancé un régimede datte qui est entrain de tomber. Non loin de ce régime de datteset lui semble accroché un serpent (Figure 12). Une troisième figure,située entre ces deux dernières, représente un homme tenant ce quisemble être un ovidé d’une main et un objet difficile à déterminerde l’autre devant une sorte de poteau ou un arbuste. Nous retrouvonsici l’association de la femme, de l’arbre muni de ses fruits et duserpent. Ces figures représentent vraisemblablement Eve, le palmierqui incarne l’arbre interdit, le régime des dattes qui symbolise lefruit interdit et le serpent qui est le gardien de l’arbre. Cettereprésentation est une interprétation de l’histoire du péché
6 Merlin, Ard el-Morali, p. 16-17, fig. 2. 7 Cintas, Manuel II, p. 339-340, fig. 54. 8 Bible, Livre Genèse, Chapitre La chute, Paragraphe 3. 9 Hermary, Op. Cit., p. 171, figure 1, p. 173, figures 2-4.
5
originel. L’homme accompagné de l’animal représenté Adan quis’apprête à accomplir un sacrifice sanglant soit pour se fairepardonner de Dieu soit pour remercier Dieu de l’avoir pardonné pource que lui et sa femme avaient commit. Contrairement à ce qu’on avoulu dire, ces scènes sont lion d’être de banales représentationsd’activités champêtres10. Les trois points qui encadrent ce décor dechaque côté, les deux bouquets qui y sont incrustés ainsi que ledécor géométrique qui défile en dessous dénote la particularitéaussi bien de l’évènement que de l’endroit où il se déroule. Ils’agit d’une histoire qui avait eu lieu au paradis. L’évocation del’image du paradis est une chose très fréquente dans plusieursreprésentations antiques surtout dans les contextes funéraires. Unvase de Carthage découvert dans un contexte funéraire semblereproduire par son décor l’ambiance du paradis (Figure 13)11. Eneffet, les deux palmiers situés au fond de la cuvette ainsi que lesrinceaux sur le bord de la cuvette semblent évoquer le paradis.Toutes ces représentation veulent traduire chez ces cultures unsouci majeur celui de retourner au paradis après leur vie sur terre.
D’autres documents n’évoquent pas seulement ce simple désir deretourner au paradis mais montrant clairement à quoi les personnesmortes s’attendent à obtenir une fois au paradis c'est-à-dire lesdivers délices que le paradis offre à ceux qui y seront admis. Iln’est pas rare de trouver dans les tombes puniques des fruits enterre cuite12. Ces fruits sont pour évoquer les fruits du paradisauxquels le mort aspire une fois il y est admis. D’autres plaisirsculinaires du paradis sont interpellés de plusieurs façons soit sousforme de représentations soit aussi carrément sous forme d’offrandesdéposées dans la tombe. Parmi ces mets très souhaités figure lepoisson. En effet, plusieurs plats munis de décor de poissons seretrouvent parmi le mobilier funéraire comme par exemple ce platdécouvert dans une tombe de la nécropole punique de Kerkouane(Figure 14). Dans la nécropole libyque de Sid Mohamed Latrech au CapBon en Tunisie, un hanout nous a donné une peinture funérairereprésentant deux cétacés affrontés (Figure 15). Ces figures sontinterprétées comme étant en rapport avec une culture maritimequelconque qui est à l’origine des haouanet. Pour nous, ces poissonsont une signification en rapport étroit avec ce contexte funéraire.Ils symbolisent les plaisirs culinaires du paradis. Egalement, desoffrandes de poissons sont fréquentes dans les tombes libyques etpuniques pour évoquer la nourriture du paradis. Donc, aussi bien les
10 Selon l’opinion de V.Karageorghis. Voir Hermary, Ibid., p. 172. 11 Merlin-Drappier, Ard el-Khéraïb, p. 53-54, fig. 36 ;12 Fantar, Carthage I, figures p. 355.
6
représentations de poissons que les offrandes de poisson déposéesprès du mort jouent un seul et même rôle celui d’évoquer les mets duparadis où le poisson semble avoir joué une place de choix. Lareligion chrétienne perpétue le même souci puisque les figures depoisson abondent dans les monuments funéraires chrétiens. Uneseconde préférence culinaire qui n’est ni moins évoquée ni moinsfréquente dans les tombes de presque toutes les culturesméditerranéennes antiques, c’est les volatiles. Ceux-ci sont soitreprésentés explicitement ou évoqués à traves les œufs. Selon uneétude de synthèse sur le monde funéraire punique de la région duSahel tunisien, région située au centre Est de la Tunisie, lesoffrandes alimentaires dans les nécropoles puniques sont constituéesd’œufs, de poussins, de poules, de coqs et de volatiles13. Un œufd’autruche de la nécropole punique de Gouraya en Algérie va dans cesens (Figure 16). Les décors que comportent certains œufs trouvésdans les tombes ne sont que pour accentuer leur caractèreparticulier de mets paradisiaques. On a beaucoup écrit sur lasymbolique de l’œuf et des volatils dans le milieu funéraire alorsque leur vrai signification est celle d’évoquer les plaisirs de labouche souhaités une fois le mort est au paradis. C’est aussi simpleque cela. Enfin, le paradis constitue plus qu’un souci mais uneréelle obsession et un destin que le mort ne souhaite rater sousaucun prétexte à un point où le mort va essayer de trouver unintermédiaire qui lui permettra d’augmenter sa chance pour entrer auparadis. Pour appuyer cette idée on va analyser une peinturedécouverte dans un hanout de la région de Kef el Blida située nonloin de la ville actuelle de Aïn Draham dans le Nord de la Tunisie.Cette figure rare qualifiée de fresque libyque par certains auteursa fait couler beaucoup d’encre sans être convenablement comprise.Cette peinture représente une barque montée par probablement septindividus. Les six sont munis chacun d’une lance gisent au fond del’embarcation alors que la septième personne est sur la proue. Elleest munie d’une hache et d’un bouclier. Non loin de la barque, unpeu au dessus, une personne allongée semble patauger au fond desflots. Exactement devant la barque, une autre personne sembleescalader une échelle pour gravir un rocher auquel l’échelle estadossée (Figure 17). Cette scène est interprétée comme étant levoyage du mort dans l’au-delà14. Nous pensons que la signification decette représentation est tout autre. Il s’agit de l’évocation d’unévènement majeur de la vie du prophète Noé, celui de déluge. Eneffet, la personne au devant de la barque est Noé qu’on reconnaît àsa hache avec la quelle il a construit l’arche. La personne allongée
13 Ben Younes, Libyphéniciens, p. 340. 14 Fantar, Eschatologie, p. 29 et suivant.
7
est emportée par les flots du déluge. La personne qui escalade uneéchelle est le fils de Noé qui a refusé de monter dans l’arche selonla Bible15. Cette représentation dans ce contexte funéraire un rôlebien précis. Elle évoque le prophète Noé qui a pour rôle de jouerl’intermédiaire en faveur du mort pour qu’il soit admis au paradis.On sait que dans les cultures sémitiques, les personnes accèderontau paradis avec le prophète auquel elles ont cru durant toute leurvie sur terre. Ce qui est très original d’après les données de cettescène, d’où la valeur exceptionnelle de ce document, c’est que nousne savons jusqu’ici que si les Libyens qui ont peint cette figureont un rapport quelconque avec l’Orient et encore moins avec leprophète Noé plus particulièrement, dossier sans doute très vasteque cette représentation pousse à ouvrir mais qui dépasse assurémentle cadre de cette notre. Pour résumer, on peut facilement dire que,d’après cette myriade de documents, nous pouvons affirmer que leparadis avait bien fait l’objet d’un grand souci chez cescivilisations de la Méditerranée antique.
Cette recherche n’est qu’un travail préliminaire, elle ne peut enaucun cas venir à bout de toute la documentation inhérente à cedossier. Par ailleurs, bon nombre de codes funéraires resteinexpliqué et nécessite sûrement plus d’effort à l’avenir pour êtreélucidé. S’ajoute à cela de multiples interprétations impertinentesdont certaines ont étaient reprises avec un regard critique au coursde ce travail au sein de cette nouvelle approche. D’après toutecette documentation, nous pouvons affirmer qu’une réelle unitéexiste en matière de conception de l’au-delà entre les culturesantiques de la Méditerranée centrale essentiellement chez lesEtrusques, les Libyques et les Puniques. Qu’il y a également uneréelle connexion et harmonie avec les idées de la Méditerranéeorientale, chapitre qui pourrait être élargi à l’avenir. Qu’uneunité existe aussi entre la vision de l’au-delà chez les culturesméditerranéennes antiques et les cultures de la fin de l’Antiquitéissues de la Chrétienneté et de l’Islam. Ces vérités aussiintéressantes soient-elles nécessitent sans doute des explicationsmais qui dépassent hélas le cadre de cette note. C’est à nos yeux unmotif suffisant pour approfondir ce dossier.
ABRÉVIATIONS ET BIBLIOGRAPHIE
Ben Younes, Libyphéniciens : H. Ben Younes, Les Libyphéniciens, dansA. Frejaoui (coordination), Carthage et les autochtones de son empire du temps de Zama, Tunis 2010, p. 337-340. 15 Bible, Livre Genèse, Chapitre Déluge.
8
Cintas, Manuel : P. Cintas, Manuel d’archéologie punique I-II, Paris1970-76.
Fantar, Carthage : Mh. H. Fantar, Carthage approche d’une civilisation Tome I-II, Tunis 1994.
Fantar, Eschatologie : Mh. H. Fantar, Eschatologie phénicienne et punique, Tunis 1970.
Ghaky, Les haouanet : Ghaky, Les haouanet de Sidi Mhamed Latrech, Tunis 1999.
Hermary, Scènes de culte : A. Hermary, Scènes de culte originales sur un vase chypriote archaïque, dans Atti del V Congresso Internationale di Studi Fenici e Punici, Volume I, Palermo 2005, p. 171-179.
Merlin, Ard el-Morali : A. Merlin, Communication sur des tombespuniques de Carthage,
Bulletin Archéologique du Comité des Travaux Historiques, Paris1916, p. CLXXV-CLXXXVI.
Merlin-Drappier, Ard el-Khéraïb : A. Merlin - L. Drappier, Lanécrorople d'Ard el-Khéraïb à Carthage, Notes et Documents numéro 3, Paris 1909, p. 1-84.
Njim, Etude : A. Njim, Etude de collections de brûle-parfums et de kernoi puniques en terre cuite des Musées de Carthage et du Bardo (Tunisie), Diplôme d’Etudes Approfondies, Université d’Aix-Marseille I 1996.
LISTE DES FIGURES
9