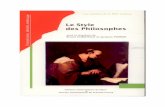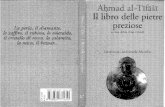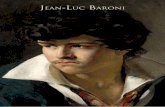Baroni, R. (2013), « Derborence, récit intrigant ou roman commercial ? » in Romans, C.-F. Ramuz,...
Transcript of Baroni, R. (2013), « Derborence, récit intrigant ou roman commercial ? » in Romans, C.-F. Ramuz,...
Derborence, récit intrigant ou roman commercial?
Ce livre pose, à la première lecture, la question de son identité (et une fois résolue cette question préliminaire, une fois qu'on a franchi le seuil et qu'on connaît le lieu où l'on se tient, alors on peut recevoir et réfléchir librement à son interrogation profonde).'
Ce commentaire, rédigé en 1935 par Georges Anex dans les Cahiers de la Renaissance vaudoise, est symptomatique du mystère qui entoure l'une des œuvres les plus célèbres de Ramuz, la seule sur laquelle il ait apposé le label «récit». Mais en réalité, les difficultés relatives à l'identification du genre et à son interprétation traversent l'ensemble des œuvres de !'écrivain, puisque, ainsi que le rappelle Vincent Verselle, deux questions reviennent inlassablement chez les critiques: «Il s'agit d'une part de la question du style et de la langue, et d'autre part de celle de la catégorisation générique. »2 Toutefois, dans le cas de Derborence, ce problème de catégorisation est particulièrement ardu, dans la mesure où la notion de «récit» est elle-même complexe et polysémique. En effet, le récit peut tour à tour désigner un genre historique - au même titre que le roman naturaliste, avec lequel il entre en tension au début du xxe siècle-, mais il peut également se référer à un phénomène plus général, qui engage la question de la « narrativité » du texte, c'est-à-dire ce qui fait que telle représentation apparaît plus «narrative » que telle autre. D'ailleurs, il est probable qu'en associant Derborence à un «récit», Ramuz souhaitait autant se démarquer du roman tel que pouvait l'incarner, par exemple, le modèle naturaliste,
1 Georges Anex, Cahiers de la Renaissance vaudoise, n" 15, 1935, p. 50. 2 Vincent Verselle, «Artisan novateur, tâcheron laborieux ... ou peut-être écrivain? La réception critique des romans de C. F. Ramuz "• DAR_, p. 136.
166
que signaler un parti pris pour une représentation dont le degré de « narrativité » était exacerbé. Or, ce degré de narrativité dépend directement de la saillance de l'intrigue, de la tension dramatique de l'œuvre et de l'intérêt qu'elle est capable de susciter chez le lecteuri.
Ainsi, par cet étiquetage, Ramuz voulait probablement signifier deux choses essentielles: que son livre n'était pas un «roman» au sens usuel du terme; mais également que ce «récit» ne relevait pas d'une esthétique expérimentale dont l'effet serait d'amoindrir la narrativité du texte et de faire obstacle à une lecture dynamique, jouissant du plaisir propre aux intrigues efficaces qui se nouent en tenant en haleine le lecteur, et qui finissent par se dénouer, en apportant des réponses aux questions que l'on se posait. Ce dernier point devra donc nous amener à réfléchir sur les raisons qui motivent la construction d'un récit intrigant 4 dans l'œuvre d'un auteur qui a souvent pratiqué une esthétique radicalement opposée.
Mais une telle analyse est-elle possible? Est-elle seulement légitime pour un écrivain qui se considérait lui-même davantage comme un poète que comme un conteur d'histoires? Ramuz affirme de surcroît, dans un essai de 1939, qu'il est pratiquement dépourvu «d'invention>>, ce talent jugé essentiel pour «nouer une intrigue» et créer un récit «dynamique>>, capable de susciter, de maintenir et de renouveler «l'intérêt ou même fréquemment la simple curiosité du lecteur»:
Je n'ai pas d'invention; je n'ai que de l'imagination. On confond trop souvent ces deux facultés qui n'ont rien de commun et sont même volontairement contradictoires. L'invention tend à l'acte et s'intéresse à l'acte; elle s'entend à en prévoir et à en utiliser les conséquences, les multipliant ainsi par elles-mêmes. L'invention est événement, elle se complaît à l'événement, elle se délecte à nouer une intrigue, à en compliquer, à en diversifier les péripéties et à ne la dénouer qu'après les avoir épuisées. L'invention est «dynamique,, comme on dit; elle réside dans un mouvement constant, organisé de manière à susciter, à maintenir et renouveler l'intérêt ou même fréquemment la simple curiosité du lecteur; l'imagination, au contraire, est
~ Sur ce point, je renvoie notamment à l'approche fonctionnaliste de Meir Sternberg: « Telling in time (II) : Chronology, Teleology, Narralivitp, Poetirs Today, vol. 13, n" 3, 1992, pp. 463-541. ·f Sur la manière de lier la question de l'intrigue avec une dynamique de l'œuvre inLrigante, voir Raphaël Baroni, L'Œ'uvre du temps, Paris, Seuil, 2009, et La Tension narratii,e, Paris, Seuil, 2007.
J)WWOHlcNC/c', RÉCIT 1 NTRH ;ANT 0 lJ ROMAN COMMERCIAL? 167
contemplative. Dans cette longue suite d'événements dont l'invention se plaît à combiner les péripéties, elle en choisit un qu'elle immobilise; là où l'invention accélère, elle, elle fixe et elle retient."
Certes, l'auteur des Signes jmrmi nous (1919) a parfois semblé tourner radicalement le dos à l'intrigue, privilégiant l'esthétique figée du «tableau»". On sait toutefois que cette «éclipse du récit» n'a cours que pendant une période limitée de la production ramuzienne. Michel Raimond note qu'avant la Première Guerre mondiale« Ramuz avait pris le parti de raconter tout bonnement une histoire, fût-elle pénétrée de poésie. C'est après 1914 que ses romans romp[ent] avec l'ordre traditionnel du récit» 7, et il ajoute que «Ramuz devait en revenir, vers 1925, à la narration d'histoires toutes simples, comme celle de La Grande Peur~ de La Beautr sur la terre, de Derborence»H. Même si le degré de narrativité variera tout au long de sa carrière, l'éclipse du récit n'aura ainsi duré qu'une décennie dans l'œuvre foisonnante de !'écrivain.
S'il fallait définir la constante qui traverse ces différentes périodes, on pourrait affirmer que le fil rouge auquel Ramuz est resté fidèle tout au long de sa carrière, c'est surtout le rejet d'une certaine idée du roman tel que l'incarnait, à cette époque, l'esthétique vieillissante du naturalisme. C'est ce qui explique que l'un des «lieux communs de la réception critique est de dénier aux romans de Ramuz l'appartenance au genre romanesque »q. Il est donc possible d'interpréter l'utilisation par Ramuz des catégorisations génériques «récit» ou «tableau» comme des tentalives de différencier ses productions du roman naturaliste, similaires au niveau de la forme niée, mais opposées au niveau du résultat obtenu.
Après avoir exposé les circonstances d'écriture et de réécriture de Derborenre, nous tenterons d'éclairer la question de cette identité problématique d'un «récit», qui s'explique aussi bien, en tant que genre historique, par son opposition au roman naturaliste, que, au
' Dhmt1J1'rle du monde, Er·rits mllo/Jiogm/!hiq11n, OC, XVIII, p. 564. c; Sur cette question, voir Rndolf Mahrer, "Poétique ramn;i;ienne du tableau'» DAR, pp. 265-297. 7 Michel Raimond, La Crise du ro111m1. Des lrndcmains du natumlisnu' aux annres vinf;I, Paris,J. Corti, 1966, p. 237. " !/!id., p. 241. '' Vincenl Verselle, art. rit., DAR, p. 139.
..
lti8 DF.RllORENCE
niveau poet1que, par l'exploitation d'une narrativité exacerbée. Par ailleurs, on défendra l'hypothèse que cette « saillance » du récit trouve en partie son origine dans des préoccupations« mondaines», reflétant les soucis matériels d'un individu gui s'est employé, tant bien que mal, à vivre de sa plume dans une région éloignée de la capitale (et du
capital) des Lettres de langue française.
Genèse et rf.énüit.rf's rlu roman
Dans le cas de Ramuz, il est difficile, et probablement inutile, de séparer le processus de la genèse de l'œuvre de celui de ses réécritures ultérieures, tant l'auteur semble incapable de considérer le moment de l'édition comme un aboutissement. On peut toutefois essayer de déterminer le début du processus, même si cela peut également poser problème.
En l'occurrence, la rédaction de Derborenœ commence par un faux départ. Ramuz se met à travailler au mois de juin 1933 et réalise les premières ébauches du roman à partir de juillet de la même année. On ne trouve pas trace de ce travail dans le fonds manuscrit, ce quis' explique à la lumière de son journal, puisque, vers le mois d'août 1933, Ramuz écrit: «Je brûle un tas de papiers[,] tout le commencement de Derborrmre[.] Fini première version de T'aille de l'homme (à revoir) et puis recommencer Derborenœ » 111
•
Ce qui a été conservé de cette première étape, en revanche, c'est un e série de notes datées du 20 juin, attestant que Ramuz s'est bel et bien inspiré d'un article du Dictionnaire géogmphique de la Suissr., qui relate deux éboulements successifs: le premier, du 23 juin11 1714, ayant provoqué le décès de quatorze personnes, et le second, survenu durant l'été 1749, ayant emporté cinq Bernois. Même si le fait divers qui est au fondement de l'intrigue est présenté dans le Dirtùmnaire géographique
comme un événement réel, une part de légende édifiante s'est greffée sur le récit à partir de la fin du XVIII' siècle. Ainsi que le souligne JeanLouis Pierre, il faut ~jouter que Ramuz n'hésite pas à prendre des
111 Journal, 3, OC, III , p. 274, entrée de mai - aoflt 1933. 11 J ean-Louis Pierre soulig-ne que la date du dictionnaire géographique est erronée et que le premier éhoulement date en réalité du 23 septembre 1714 (Romans, II, p. 1660).
Q
D1mnoREN<Jè, RÉCIT INTRICANT ou ROMAN COMMERCIAL? JfüJ
libertés, aussi bien par rapport à la topographie des lieux que relativement à ses sources:
A partir des données du Dictionnaim giografJ!iiqw!, Ramuz procède à des modifications: dans un désir de dramatisation, il additionne les pertes humaines de 1714 et 1749, modifie l'heure de la catastrophe en passant du jour à la nuit. Mais, par souci de vraisemblance, il corrige les indications sur les vivres dont dispose Antoine. Il connaît assez la vie des montagnards pour juger improbable qu ' un berger, à la fin de juin , disposâL de fromages en quantité suffisante pour survivre si lungtemps. 1 ~
La première ébauche de l'histoire qui ait été conservée (83 feuillets) remonte au 15 aoüt 1933 et est achevée le 5 septembre. A ce stade, Ramuz dresse les contours de la première moitié du récit et envisage de le faire débuter au moment où Antoine Pont parvient à s'extirper du pierrier. Ensuite, une longue « analepse » 1:1 devait revenir sur l'événement de l'éboulement, et le dernier chapitre de cette partie devait ramener le lecteur au moment évoqué dans les premières pages. En mars 1933, Ramuz rédige également 2 feuillets dans lesquels il esquisse la structure de la seconde partie, avec le retour d'Antoine à Derborence et sa rencontre avec Thérèse, qui apparaît comme un personnage central dès le début du projet. Finalement, il opte pour une structure plus chronologique, en déplaçant la scène d'ouverture au début de la deuxième partie, mais le récit restera encore relativement discontinu par le recours à une technique, typiquement ramuzienne, consistant à narrer un même événement (aussi bien l'éboulement que le retour d'Antoine) à partir de différents points de vue .
Ramuz se met à la rédaction de ce qui deviendra le manuscrit définitif de Derbo/'l'ncevers le début du mois de mars 193414. Entre mars et avril, le Journal précise: «Je chemine tout doucement au bord du grotesque: ...... à condition de n'y jamais tomber. ,, i:. La rédaction proprement dite ne dure qu'un mois et s'achève le 16 avril. Après avoir
1" Ibid., p. 1661. 1'1 Dans le répertoire des lechniques narratives développé par Gérard Genette, l'ana
lepse correspond à ce que le cinéma désigne comme un «flashback ». 14 Dans son jonrnnl (3, OC, III , p. 279 , entrée de «Vers le Hi avril 1934 »), Ramuz signale qu ' il a commencé la rédaction «vers le 14 mars », mais les premiers documents manuscriL~ qui ont été conservés sont datés du 10 mars HJ34. 10' .Journal, 3, OC, III, p. 279, en Lrée de janvier - avril 1 ~)~4 .
170 DERBORENC:E
minutieusement révisé son texte du 17 avril au 8 mai, Ramuz remet, le 14 mai, la «première partie de Drrborrnrr corrigé à M"11c F [ avre] pour copie » 11;. La seconde partie suit le 24 du même mois. L'écrivain, qui a en mains le dactylogramme de la première partie au début du mois de juin, entreprend de le réviser17. Après une série de corrections qui s'achèvent en août1K, l'ouvrage est confié à l'imprimeur et paraît en novembre 1934 à l'enseigne d' Aujourd'hui, aux Editions Henry-Louis Mermod. A l'automne 1934, la revue Présence en présente en préoriginaleP' un fragment qui correspond au début du chapitre II de la seconde partie (voir p. 252 et suivantes), dans une version légèrement différente de celle de l'édition originale.
En 1935, la Büchergilde Gutenberg à Zurich publie une traduction allemande due à Werner Johannes Guggenheim, avec des illustrations d'Ignaz Epper, version reprise l'année suivante par la maison munichoise Piper, qui réédite également, en 1935, La Granrir Prur dans la montagne20 • Cette double édition en allemand amènera ainsi la presse germanique à parler de l'œuvre21 . Une traduction en italien, par Valeria Lupo, paraîtra également en 1942 chez l'éditeur milanais Bompiani.
Ramuz confie son roman à Grasset pour une deuxième édition française22. Il établit ce texte à partir d'un exemplaire de l'édition originale, qu'il corrige à l'encre noire, et sur lequel il colle de nouvelles pages manuscrites. Parallèlement, dès juillet 1935, la Büchergilde Gutenberg à Zurich négocie avec Ramuz, puis avec Grasset, la publication d'une
lG f/Jirf. 17 L'exemplaire du clactylogramme ayant servi à l'étahlissement de l'éclilion originale est conservé à la BCU de Lausanne (205 feuillets). " Ainsi qu'en témoigne la lettre de Ramuz à Mermocl du 22 aoùt 1934 (LPtlrts, II, p. 274). 1" Prrsmœ, 2" année, n" 3, 1933-1934, pp. 15-21. '" Ainsi qne l'affirme Anne-Laure Pella clans sa thèse de doctorat sur la réception germanophone de l'œuvre de Ramuz, le fait que le traducteur de Ramuz était j uif semhle avoir nui à la publication d'œuvres originales en Allemagne à partir du clébnt des années 1930; toutefois, cette censnre n'a pas affecté les rééclilions, dans lesquelles "[!]'implication personnelle du traducteur était certainement hien moindre,, (D'nuc
langiw l'nutm: l'frriturr dn C. F Ramuz ri, lmvns Ir prisme de sa 1ùrj1tion f!/'n11anoj1lumr,
Genève, Slatkine, 2012, p. 306). 21 Voir à ce propos Vincent Verselle, art. à t., DAR, p. 159. '' L'éditeur parisien dispose du texte en été 1935, comme le relève Ramuz clans une lettre inédite à Hans Oprecht du 4 septembre 1935 (fonds de la Guilde du livre, BCU, Lausanne).
IJFRRORFNŒ, Rf:CJT INTRIGANT OU ROMAN COMMERCIAL? 171
édition française destinée au club du livre qu'elle entend créer en Suisse romande, et dont Derborence sera le titre de lancement~~. Ce sera la Guilde du livre, dirigée par Albert Mermoud, dont le but est de mettre à disposition d'un public populaire un «choix d'auteurs contemporains » 24 . La Guilde du livre obtient de Grasset de pouvoir tirer 3000 exemplaires destinés aux membres du club en Suisse romande2". L'ouvrage paraît aux Editions Grasset en février 1936 (l'achevé d'imprimer est du 25) et en mars 1936 à la Guilde du livre à Lausanne, avec les illustrations d'Epper créées pour la traduction en allemand (l'achevé d'imprimer est du 30 mars, mais l'ouvrage a été fabriqué au début du mois de févrierF6• Ces deux éditions sont quasi identiques, et ne varient que sur des éléments de détail mis au point sur les épreuves. Leur lancement conjoint n'a d'ailleurs rien de fortuit, comme on peut le déduire de cette lettre de Ramuz à Poulaille du 23 janvier 1936:
Quand paraîtra-t-il? Voilà près de six mois que j'en ai reçu les épreuves et il
doit être depuis longtemps prêt à sortir. Vous savez que cette «Guilde» ne mettra pas ses ex[emplaires] en vente dans les librairies, et il me semble
qu'il ne faudrait pas manquer l'occasion de ventes que la parution du livre
sous une autre forme doit vraisemblablement provoquer. 27
En 1941, Derborence paraît dans le dix-septième tome des Œuvres complètes chez Mermod (!'achevé d'imprimer est du 15 novembre).
2 ~ La première proposition de la Büchergilde Gutenberg date du 24 juillet 1935 et le contrat sera finalement signé le 24 décembre de la même année. A noter que, dans une lettre du 13 janvier 1936, Albert Mermoud s'inquiète de la mention "récit»: «D'un point de vue strictement "vendeur" et étant donné qu'il s'agit en l'occurrence d'une édition de luxe, nous nous demandons si le qualificatif de "récit" n'est pas de nature à nuire en une certaine mesure à la demande» (fonds de la Guilde du livre, BCU, Lausanne). 24 Lettre de Ramuz à Henri Pourrat du 4 février 1936, Lettres, II, p. 283. 2' Contrat du 24 décembre 1935 entre la Guilde du livre représentée par Hans Oprechl et les Editions Grasset (fonds de la Guilde du livre, BCU, Lausanne). 2" Lettre inédite d'Albert Mermoud à C. F. Ramuz du 4 février 1936 (fonds de la Guilde du livre, BCU, Lausanne). A noter que la Guilde du livre réimprime le volume à 3000 exemplaires en novembre 1937 (!'achevé d'imprimer est du 25), et que Grasset procède à un nouveau tirage, cette fois avec un frontispice de Pierre Gandon, eri 1942 (!'achevé d'imprimer est du 8 mai). 27 Lettre de C. F. Ramuz à Henry Poulaille du 23 janvier 1936 (fonds H. Poulaille, BCU, Lausanne).
172 ÜERBORENCE
Pour établir cette édition, Ramuz a corrigé un exemplaire de l'édition originale, conservé à la BCU de Lausanne.
Deux autres éditions paraissent encore du vivant de Ramuz. En 1944, la Guilde du livre et les Editions Mermod donnent une édition conjointe tirée à 5000 exemplaires pour la Guilde et à 1000 exemplaire pour Mermod28 . En 1945 enfin,]. A. Carlotti illustre le texte des Œuvres complètes pour les Editions Bordas à Grenoble; tirée à 860 exemplaires, cette édition de luxe est achevée d'imprimer le 25 janvier 1945.
Dans son Journal, Ramuz a commenté les corrections qu'il a introduites au mois de juin 1934, dans la première partie de son roman, ce qui nous donne une occasion précieuse d'examiner son point de vue sur la nature et les enjeux des transformations qu'il fait subir à ses textes, non seulement lors de la correction, mais également à pratiquement chacune des rééditions:
Je reprends inlassablement la première partie de la copie que j'ai reçue il y a quinze jours déjà et où je ne pensais plus à corriger que des fautes de lecture, mon texte ayant été lui-même minutieusement revu et retouché plusieurs fois de suite, et même récrit en partie avec les collages obligés. Or, le malheur ayant fait que je l'ai constamment sous la main et que la seconde partie n'est pas encore parvenue,je n'arrive plus à m'en détacher à et passer à autre chose.J'y retourne sans cesse, supprimant chaque fois une phrase ou un épithète, modifiant le rythme d'un paragraphe, y introduisant une image, et je ne vois plus du tout quand j'arriverai à m'arrêter. Je ne vois surtout pas si les corrections que j'y apporte ajoutent, comme il conviendrait, à sa vie ou si contrairement elles la diminuent, au seul bénéfice de la propreté, plus exactement du propret qui est bien l'extrême contraire de ce que j'avais ambitionné ... J'ai voulu faire net: ne vaisje pas faire tout simplement plat? Prendre garde à ce glissement général des plans qui s'opère sournoisement et sans catastrophe, mais n'en aboutit pas moins à l'étalement en surface. Ce qui a été le sort de ma montagne~\'.
De ce qui précède, on peut tirer quelques constats que l'on pourrait généraliser à l'ensemble des pratiques de réécriture de l'auteur. Premièrement, pour Ramuz, il semble que la rédaction se situe dans
~A Indiquée comme étant ne varietur sur les volumes imprimés à l'enseigne de la Guilde du livre, cette édition est la dernière version retravaillée par Ramuz. Elle est rééditée par la Guilde en 1947 (5000 exemplaires), en 1953 (3000 exemplaires) et en 1954. 2u Journal, 3, OC, III, p. 280, entrée du commencement de juin 1934.
Dr:JUJOJU,NCF., RÉCIT INTIUGANT OU ROMAN COMMERCIAL? 173
une sorte de mouvement sans clôture, l'envoi du texte à l'éditeur et sa publication ne représentant qu'une étape parmi d'autres dans l'évolution de son texte. Ce qui frappe également, c'est que ]'écrivain, bien qu'engagé, presque malgré lui, dans un mouvement de corrections perpétuelles, demeure incertain du résultat: il craint de faire «propret» et« plat» au lieu de faire «propre» et« net». A l'image de la catastrophe qui s'est abattue sur Derborence, il appréhende le «glissement général des plans " et «l'étalement en surface» de son texte'10
• Il semblerait que s'opposent en lui les visées de faire «net» mais également de faire «vivant ,, : il cherche la concentration sans la perte de l'énergie vitale de l'écriture. Ramuz se trouve donc écartelé entre la poursuite d'une ascèse de l'écriture, le désir d'une épuration du texte, et la mauvaise conscience de celui qui a l'impression irrémédiable de s'éloigner de l'élan qui animait les premiers moments de la conception.
La crainte du« propret» que Ramuz manifeste pendant la rédaction de Derborence semble répondre en partie à un reproche d'artificialité qui lui a souvent été adressé. Pour le dire avec Verselle, «un des grands débats consiste à déterminer si cette simplicité est sincère, naturelle, ou si, au contraire elle n'est qu'affectée, issue d'un maniérisme détestable. [ ... ]Les tenants d'une conception classique de la langue française sont avant tout rebutés par la systématisation de certains "procédés": on comprend donc que c'est leur visibilité qui constitue le véritable problème ,,~ 1 • Il existe ainsi une double contrainte qui conditionne l'écriture de Ramuz et qui détermine les tensions affectant la rédaction et les réécritures de Derborence: d'un côté, une recherche de «naturel'" qui s'oppose en partie aux conventions de la grammaire, de manière à retrouver l'expressivité de la langue dans ses usages quotidiens; de l'autre, le risque de tomber dans des procédés systématiques et artifi
ciels. Ces tensions expliquent probablement pourquoi Ramuz préfère,
lorsqu'il réédite un texte, repartir de l'édition originale, plutôt que de recourir à la dernière version publiée. C'est le cas de Derborence: dans un premier temps, Ramuz modifiera sensiblement le texte original
:io Cette réflexion montre également la corrélation entre la «Vie » du texte et son intensité, que l'on peut associer à l'efficacité de son intrigue, sur laquelle nous reviendrons dans la dernière partie de cette introduction. 31 Vincent Verselle, art. cit., DAR, p. 138.
174 DERBORENCE
paru chez Mermod à l'occasion de l'édition chez Grasset~~; pourtant, au moment de préparer son texte pour les Œuvres complètes de 1941, il revient à l'édition de 1934. Lors de l'édition de 1944 à la Guilde du livre, Ramuz se base sur la version parue à la même enseigne en 1936, pour finalement préférer celle de 1941 au moment de la réédition chez Mermod en 1944. Le processus de réécriture est donc loin d'être linéaire. En contournant certaines éditions déjà retravaillées, Ramuz manifeste non seulement des repentirs, mais également des repentirs de repentirs. Peut-être cherche-t-il ainsi, comme il l'affirme dans son journal, à retrouver l'efficacité originelle d'une écriture qu'une trop longue ascèse éditoriale a pu finir par étouffer.
Les modifications que Ramuz introduit dans ses textes, à l'inverse par exemple de celles d'un Balzac - cas exemplaire d'écriture «en expansion~~», obéissent plutôt à un processus de concentration. Parmi les coupes les plus spectaculaires, il y a notamment celle de la scène dans laquelle Thérèse parvient à convaincre Antoine de revenir au village, qui est supprimée in extremis, remplacée par une ligne de points, dans les dernières corrections juste avant l'édition de 1934. L'exergue renvoyant au Dictionnaire géographique de la Suisse, qui mentionne le fait divers dont Ramuz s'est inspiré, disparaîtra également dans les Œuvres complètes de 1941, avant d'être réintroduite en 1944.
D'autres transformations sont moins voyantes, mais non moins significatives des problèmes que Ramuz cherche à résoudre lorsqu'il procède à une coupe. Si l'on compare l'incipit de 1934 (Mermod) et celui de 1936 (Grasset), on constate par exemple la disparition d'une proposition entière:
Il tenait d'une main une espèce de long bâton noirci du bout qu'il enfonçait par moments dans le feu; l'autre main reposait sur sa cuisse gauche. (Mermod, 1934)
Il tenait de la main droite une espèce de long bâton noirci du bout qu'il enfonçait par moments dans le feu. (Grasset, 1936)
:i2 Notamment la deuxième partie, en particulier le début du premier chapitre et la fin
du chapitre IX (qui devient le chapitre X, étant donné que le chapitre IX est partagé en deux). ·11 David G. Bevan et Peter Michael Wetherill ( dir.), Su r la fiénétique textuelle, Amsterdam et Atlanta, Rodopi, 1990, p. 41.
DERTJOllFNC/o', RÉCIT INTRIGANT OU ROMAN COMMER< :JAL? 175
Entre la version de 1934 et celle de 1941, la proposition élaguée fait son retour (repentir de la suppression de 1936), mais c'est un complément qui est cette fois supprimé:
Il tenait d'une main une espèce de long bâton noirci du bout qu'il enfonçait par moments dans le feu; l'autre main reposait sur sa cuisse gauche.
(Mermod, 1934)
Il tenait une espèce de long bâton noirci du bout qu'il enfonçait par moment dans le feu; l'autre main reposait sur sa cuisse gauche. ( Œnvres
complètes, 1941)
Les réécritures visent la concentration, l'économie des moyens pour arriver au résultat: en l'occurrence, la production d'une« image». Mais Ramuz hésite sur les passages à élaguer. La première réécriture est plus radicale, mais elle a le défaut de faire disparaître une partie de la représentation visuelle, alors que la seconde ne fait qu'éliminer une redondance lexicale, qui peut être aisément suppléée par l'imagination du lecteur - on tient forcément un bâton dans une «main>>, probablement la droite, et ce n'est pas «l'autre» qui repose sur la cuisse gauche: l'image reste complète, alors que l'expression est plus
condensée. S'il élague souvent, Ramuz n'hésite pas pour autant à introduire des
éléments nouveaux (ou à réintroduire des éléments anciens), quand ces derniers contribuent à enrichir la représentation sensorielle ou la valeur dramatique de la scène. Dans le passage suivant, Ramuz opère deux suppressions mineures, mais ajoute deux extensions qui non seulement renforcent la représentation visuelle («Séraphin a levé le bras. On voit sa main ... »), mais accentuent également le caractère menaçant du lieu où se tiennent les personnages («entourés et dominés par l'entassement des montagnes»; «au fond du trou»), d'où une dramatisation de la scène, préfigurant la catastrophe imminente:
C'était une espèce de plaine, mais qui était étroitement fermée, à cause des rochers qu'on voyait de toute part faire leurs superpositions. Car, d'abord tournés vers le sud, les deux hommes ont vu d'où la lune était sortie, c'est-àdire de derrière beaucoup de cornes qui sont là, et eux sont au pied; puis, se tournant vers le couchant, ils voient que les parois y commencent, bien que pas très hautes encore, et se continuent en demi-cercle au nord el à
l'est. Séraphin avait fait quelques pas pour trouver une place d'où la vue fût entièrement dégagée; Séraphin lève le bras. (Mermod, 1934)
176 ÜEIIBORENCE
C'était une espèce de plaine, mais qui était étroitement fermée, à cause des rochers qu'on voyait de toute part faire leurs superpositions. D'abord tournés vers le sud, les deux hommes onL vu d'où la lune était sortie et c'était de derrière beaucoup de cornes qui sont là; puis, se tournant vers le couchant, ils voient que les parois y commencent, bien que pas très hautes encore, et se continuent en demi-cercle à droite et à gauche. De tout côté, ils étaient ainsi entourés et dominés par l'entassement des montagnes, et c'est au fond du trou que Séraphin a levé le bras. On voit sa main dans la nuit claire . ( Œ1wres m111jilètes, 1941)
Quant au «rythme des paragraphes», Ramuz y revient dans son journal, à l'occasion de la publication de ses Œuvres romplètrsde 1941 et de ses discussions avec la «correctrice» au sttjet de toutes ces «irritantes e t, en définitive, insolubles questions de ponctuation , d'orthographe et de grammaire que le courant de la plume [lui] avait permis d'éluder». Au sttjet de la ponctuation, notamment, il affirme que
les points, points-virgules, virgules et deux points[ ... ] sont loin de jouer le même rôle d'une phrase à l'autre. Tout dépend du souffle qu'on a, comme pour le coureur et du rythme de sa respiration. Il importe souvent de marquer un arrêt qui n'est pas " raisonnable ,,; il importe souvent au contraire de ne pas interrompre le flux du discours là où cette même raison raisonnante demanderait qu'il füt suspendu.:14
On trouve un bel exemple de transformation du rythme que Ramuz réalise dans un passage de Derborence au moment de la réécriture pour les Œuvres complètes de 1941. En l'occurrence, il introduit des« arrêts» supplémentaires, multipliant les virgules de façon à obtenir un rythme plus syncopé:
Et devant les maisons il n'y avait personne, mais derrière, dans la ruelle tout le temps du monde allait et venait: des femmes le râteau sur l'épaule, des petites filles avec des seaux d'eau et seulement un ou deux hommes. (Mermod, 1934)
Et, devant les maisons, il n'y avait personne, mais, derrière, dans la ruelle, tout le temps du monde allait et venait: des femmes, le râteau sur l'épaule, des petites filles avec des seaux d'eau et seulement un ou deux hommes. ( Œuvres complètes, 1941)
14 journal, 3, OC, III, pp. 391-392, entrée du 31 octobre 1941.
Dli l/.BOHliNC:F., RÉCIT JNTR!CANT OU ROMAN COMMERCIAL? 177
D'Llne manière générale qn e i au ni eau de lapon ll.lalion de la gnunmair ou d I' nh graphe, Ramuz, san. êtr partisan cc cl la r ' forme >>, plaid p ur un appli ati n ou pl cl · s règles, car " t uLe
dificati n n eslqu'approxima t:iv ~ . Tout el ns mblc de r ' g le dont c'est la~ 1 lion (d'un corr ctricc) de se fair l'inl rprèt n'a pour bu que de. prév ir et r ' soudr d avan d fa on logiqu d 'innom 1 rai les p Li ' problèmes qui n sonl justem nt 1 as d' rdr logiqu : j 'eme11ds ' UX qu n u. pas nl les infinie · combinais n. ù
u· L1v ·ntacc ' derl ·sfait · tl · idées . url 1land l'expression » 11ro . Sur e p int, I' ' rivnio s mble d 'accord av la riûqu quand ell affirme comm l · )ulign Versell , qu «clart ' et xpressivité >> s'opp nt t qu " si 1 styl • ramuzien peut sembl r m.anqu r de la pr mièr qualit', on lui re nnaît en revanche quasi w1animemeot la . e onde ainsi que 1 s ffets qt.Li lui. om as o t • , ' st-à-dire la puissan d' · o arion t la apa ité a transmettre un , m tion ,,~0 .
L'opposition entre le «récit » el le « roman »
Parmi les nombreux~7 critiques qui ont cherché à interpréter le sens de la catégorisation générique «récit» au moment de la parution de Derborence, il en est un qui avance l'idée originale que cette étiquette servirait à souligner le caractère factuel du fait divers à l'origine de l'his-
toire:
Pour marquer que l'histoire de Derborence n'était pas une pure invention,
Ramuz l'a nommée un «récit ,,_<iH
Plus clairvoyants, d'autres commentateurs ont aperçu les liens étroits entre récit et poésie, mettant en avant l'importance de situer le point de vue de l'énonciateur, tant pour définir le lyrisme (qui dépend de «celui qui regarde,,) que pour fonder la narration (qui dépend de «celui qui raconte ,,) . Ainsi, poésie et narration se distinguent d'un
~!) Ibid., p. 391. 1G Vincent Verselle, arl. cil., DAR, p. 137. 11 Dnborenœ a généré plus de deux cent cinquante critiques a1-chivées par Ramuz, ce qui en fait de très loin le roman le plus commenté du vivant de l'auteur (le second étant La Grande Pettr dans la montagne, avec un peu moins de deux cents recensions).
~H Article non signé dans Le Progrrs (Lyon), 3 avril 1936.
•
178 DF.RBORENCE
mode de représentation - propre notamment à l'esth é tique naturaliste -qui viserait au contraire une forme de neutralité e t d'objectivité, et qui effacerait par conséquent toute trace pouvant trahir la présence d 'un narrateur:rn:
Je suis toujours attiré par les livres qui portent en sous-titre le mol "récit», annonciateur de poésie. [ ... ] Oui, Derborenr!' est un poème, la grande épopée que chante " celui qui regarde». Il chante la tragédie d'un alpage englouti sous les pierres des Diablerets. 111
Plusieurs critiques soulignent avec pertine nce qu 'il faut comprendre le «récit » dans son opposition avec le «roman », parfois en faisant valoir l'argument de la «modestie » d'un texte relativement court et pourvu d'une intrigue simple'11 : «Ce récit (c'est ainsi que, modestement, l'auteur désign e son œuvre) évoque le terrible éboulement qui dévasta, voici deux cents ans, la région de Derborence ,, 42 •
Le commentaire suivant élabore davantage le contraste entre roman et récit, auquel il rattach e implicitement les sous-catégories génériques que seraient la légende et la fable:
Derborence, à vrai dire, est un " récit », non pas un roman . Le propre du roman, en effet, c'est l'imbrication du monde extérieur sur le monde intérieur; le roman est intimement li é à la " destinée » d'une vie; son rôle est de nous éclairer sur le drame de la personnalité, qui est une action incessante, une tension entre deux univers, la conquête d'un équilibre. Il faut dire aussi la coloration nuancée de cc livre, son rythme comme sans cesse partagé entre l'allure narrative, le récit proprement dit, et le ch eminement intérieur, lequel participe tout à la fois de la légende, de la fable et du poème. i:i
'1'1 Dans une opposition héritée des catégories plaloniciennes, Genette affirme que
«feindre de montrer, c'est feindre de se taire» el que la m imèsis se définit " par un maximum d'information e t un minimum d'informateur, la diègèsis par le rappon inverse,, (Fignm III, Paris, Seuil, 1972 , p. 187). Dans celle dualité, il esl évident que si Ramuz cherche à produire des images, ce sont des images situées, qui s'inscrivent par conséquence dans une diégèse qui s'assume en tant que telle et qui ne prétend pas à la transparence totale. 40 A . .J., La Libre Belgiq1œ, 30 mars 1936. '11 Il faut insister d'emblée sur le fa il que l'opposition entre intrigue "simple,, (c' est-àdire construite sur un événement unique) et intrigue «complexe» (qui implique un enchevêtre ment de nombre uses aclions) n'a aucun rapport avec l' intensité ou l'efficacité de cette intrigue. ' 1 ~ Article non signé, L'Hdurn.tenr (Lausanne), 7 mars 1936. 4:1 Gilbert Trolliet, La Ri'llltl' (Lausanne), 24 février 1935.
DJo:RliWŒNŒ, RÉCIT INTRIGANT OU ROMAN COMMERCIAL? 179
Philippe Roussin a retracé l'histoire et les enjeux qui sous-tendent l'opposition entre «récit ,, et «roman» à partir de la fin du XIX" siècle et jusque vers le milieu du XX" siècle. Il fait remonter cette rivalité à Baudelaire, lecteur et traducteur de Poe, qui exprimait déjà une «préférence symboliste pour la nouvelle ou le récit, compris comme intrigue, moyen de l' effe t et forme brève » 44
• Roussin mentionne également Marcel Schwob, qui dédie à Stevenson un recueil publié en 1891, Cœur double. Dans la préface de cet ouvrage, Schwob marque sa préférence pour l' esthétique du récit et« déclare vouloir rompre avec le roman réaliste comme avec le roman analytique ,, 4s. Le « récit » semblait alors ouvrir une voie royale devant reconduire au « roman d'aventure», auquel on peut associer «l'ensemble des techniques narratives de présentation et de combinaisons de l'intrigue et des événements permettant d'atteindre l'effet de suspense, de curiosité ou de surprise recherché pour retenir l'attention du lecteur. [ ... ] Comme toujours, le roman ou récit d'aventure définissait le romanesque face à l'univers prosaïque du roman uniquement peuplé de faits et de détails »4ti.
La rupture avec le roman réaliste apparaît également comme l'une des préoccupations de Gide lorsqu 'il donne l'appellation «récit » à Paludes, au Prométhée mal enchainé et à Isabelle. A propos de ce dernier ouvrage, Gide affirme du reste l'avoir intitulé «récit» «simplement parce qu'il ne répond pas à l'idée qu['il se fait] du roman »47 . Roussin souligne ainsi que, durant la première moitié du XX" siècle, l'opposition récit/ roman a fini par s'imposer en France à la réflexion littéraire et à la critique en élevant la variante réaliste du roman« au rang d'absolu de la forme romanesque» , contre quoi le «récit » semblait offrir une alternative, notamment par le retour à une intrigue tendue et, paradoxalement, à une forme de dramatisation « romanesque » 48 que l'évolution
H Philippe Roussin, "Généalogies de la narratologie, dualisme des théories du récit '" dans Narmtologies contemporaines, John Fier et Francis Berthelot (dir.), Paris, Editions des Archives contemporaines, 2010, p. 46. 1' Ibid., p. 47. 4u Ibid. , pp. 50-51. 47 André Gide, " Projet de préface pom· lmbelle», Romans et réâls, 1, Paris, Gallimard, " Bibliothèque de la Pléiade'" 2009, p. 992. 4R Philippe Roussin, " Généalogies de la narratologie , dualisme des théories du réci t », art. rit., p. 49.
180 DERBORENCE
du genre avait fini par étouffer. Roussin met ainsi en évidence certaines caractéristiques du récit tel qu'on peut le définir, au début du XX" siècle, en tant que genre qui s'oppose à la forme romanesque telle qu'elle s'incarne dans le roman naturaliste:
1) [Le récit] est le plus souvent[ ... ] de type homodiégétique [ ... ],en quoi il se distingue de l'impersonnalité et de l'objectivisme du roman réaliste et naturaliste, qui tend à se passer presque totalement d'un narrateur apparaissant comme individu; 2) il est souvent une œuvre de forme brève, à un seul personnage et à point de vue le plus souvent unique; 3) il est un récit poétique, personnel, autobiographique, comme on l'a souvent dit, mais aussi un «psycho-récit» [ ... ]. En d'autres termes, c'est en tant qu'acte narratif, action manifeste et instauratrice, dispositif énonciatif et entreprise de discours guidant le traitement du temps et livrant l'histoire ou la séquence temporelle d'événements que le récit se trouve ici défini et préféré au roman: l'acte narratif est élevé au rang de trait formel décisif du récit.4'J
On peut remarquer comment Derborenœ rejoint en partie cette définition et comment, en même temps, il s'en différencie. Certes, ce n'est pas un récit à la première personne, mais il est évident que la narration y adopte une «perspective» fortement située, un point de vue qui ne réfère pas seulement à l'objet observé, mais qui coréfère également au sujet qui observe cet objet. Le récit est en effet relativement court et comprend peu de personnages, mais le point de vue varie souvent, sans pour autant produire l'illusion de transparence totale propre à l'esthétique naturaliste. Pour le dire autrement, le récit est en focalisation variable, mais il n'adopte pas ce que Genette appellerait la« focalisation zéro», c'est-à-dire un stade où la question du point de vue, à force de se déplacer sans contraintes, finit par ne plus se poser.
Dans leur tentative de périodisation de la production romanesque de Ramuz, Jérôme Berney, Rudolf Mahrer et Vincent Verselle rappellent que, de 1919 à 1923, Ramuz a publié une série de textes (Les Signes parmi nous, Terre du ciel, Présence de la mort, Passage du poète) dans lesquels les actions sont fragmentées et cessent d'être hiérarchisées par leur inscription dans un « superprogramme »511 • De cette période, Ramuz conserve l'idée d'une pluralité «reflétant la fragmentation
4" Ibid., pp. 48-49. '
0 Jérôme Berney, Rudolf Mahrer, Vincent Verselle, «La périodisation des romans de Ramuz», DAR, pp. 189-215, p. 215 pour la citation.
DERB()]IJoNCI•:, Rf:c:IT INTRH;ANT OU ROMAN COMMERCIAL? 181
d'une collectivité »01 , mais dans Derborenœ, l'action reste homogène, et ce ne sont que les points de vues sur les événements qui se multiplient. De ce fait, la dynamique du récit est préservée, et la «narration», en tant que mode du discours, mais aussi en tant que contenu événementiel, devient beaucoup plus saillante que dans une représentation visant l'objectivité. D'ailleurs - à l'exception de La Séparation des races (1923) - dès 1917, Ramuz restera fidèle au mode énonciatif du discours, qui s'oppose au mode de l'histoire (dont le passé simple est le temps pivot), à propos duquel Benveniste affirme qu'il donne l'illusion que «les événements sont posés comme ils se sont produits à mesure qu'ils apparaissent à l'horizon de l'histoire. Personne ne parle ici; les événements semblent se raconter eux-mêmes »"2
•
Mais le point central reste le fait que cette étiquette de «récit» est symptomatique du virage opéré par Ramuz à partir de 1926, qui marque le retour de l'intrigue et de ce que l'on pourrait appeler une certaine forme de «romanesque». Certes, !'écrivain publie encore des œuvres, telles Adam et Eve, qui s'inscrivent dans une veine où la poésie et la réflexion sur la séparation des êtres semblent prendre le pas sur des préoccupations d'ordre strictement dramatique. Toutefois, ainsi que le relève Michel Raimond, dans les textes les plus réussis de cette période (et cela inclut évidemment La Beauté sur la terr/":1
), Ramuz parvient à retrouver «le récit en conservant le tableau», à faire la «synthèses de l'image et de l'action» et ainsi à concilier «l'intérêt romanesque et l'attrait de la poésie ,/' 1
.
Précisons encore que la critique du roman, chez Ramuz, ne s'est pas toujours accompagnée d'un rejet du «romanesque» en tant que tel. Au contraire, tout comme Marcel Schwob, ce qu'il reproche au roman de son époque, c'est précisément son manque de «romanesque», cette
" Ibid., p. 215. '~ Emile Benveniste, «Les relations de temps dans le verhe français», Problhnes rll'
li11g11istiqne ghzémlr 1, Paris, Gallimard, 1966, p. 241. '"1 Michel Raimond souligne que dans La Beaulé mr la tn-r1•, l'intérêt romanesque est préservé car: <( rn usqu'à la fin, le lecteur est tenu en haleine: car aux trois projets de faite qui lui ont été soumis, la jeune fille a également acquiescé. Ramuz retrouvait un des thèmes romanesques les plus simples et les plus efficaces du roman rustique: avec qui s'enfuira la plus helle fille du village? Cette attente de ce qui aura lieu est un effet proprement romanesque; c'est au sein de cette attente que la poésie se déploie,, (Michel Raimond, La Crise du rmnan, ojJ. cit., p. 242). '' 1 Ibid., p. 241.
182 DERilORENCE
négation du récit qui s'opère sous la contrainte de la vraisemblance et de la visée analytique ou didactique du discours. C'est du moins la position qu'il défend encore en 1915, dans Lrs Grands Moments de l'art français au XIX' sièdr.:
Il faut voir en effet que le mot de «roman» comporte au moins deux sens. Le roman (au vieux sens du mot, d'où dérive " romanesque ,,), le roman tel que le Moyen Age l'a connu et le XVII" siècle et comme l'époque contemporaine le connaît encore ne prétend en effet à intéresser le lecteur qu'en piquant sa curiosité. Le roman en ce sens consiste en une combinaison d'événements présentés de telle sorte que ce soient les événements euxmêmes qui en constituent l'essentiel. ';,
Ce roman «romanesque», Ramuz l'oppose au roman «analytique ou didactique ou "à thèse"». L'appellation «récit» devient alors, paradoxalement, une étiquette qui permet de revenir au «romanesque» véritable:
[S'] il fallait absolument décider entre eux ce serait bien au «romanesque» qu'il conviendrail de donner raison. Qu'est-ce qu 'en effet que le roman[,] défini dans son sens le plus large[?] c'est un rhit. L'erreur de certain.~ romans modernes, et de ceux de Zola lui-même[,] c'est qu'ils ont voulu jJrouvn: Ils se sont mis à combiner les faits non pour le seul j1laiûr qui pouvait résulter de leur combinaison, mais en vue d'une ro11clusion â imposer au lecteur. Or aucune preuve ne peut ressortir que de la réalité m ême - et ici les t~léments ne dépendent plus, si réels qu'ils puissent être, que du bon plaisir de !'écrivain. Il faut donc tenir le genre pour faux, c'est-à-dire pour non viable: et en revenir à l'idée de récit, et à l'idée non d'enseignement, mais de plaisir.'";
A partir de ce constat, Ramuz peut mentionner «les formes infinies que le genre ainsi compris peut revêtir'" notant en particulier que «le choix de la prose ou du vers ne constitue pas à lui seul une classification ,/>7. On distingue ainsi, à l'enseigne du récit, la possibilité d'un rapprochement entre poésie et intrigue romanesque, qui deviendra l'un des traits marquants de l'esthétique ramuzienne à partir de 1926:
Maintenant que le vers se meurt (à moins qu'il ne soit d~jà mort) sans doute que c'est dans le roman que va se réfugier la poésie [ ... ] la seule condition
ri:i Ltç Grandç J\1.omenls (/,~ l'A·ttfrançais au Xt>., sièrle, Essais, l, (JC, XV, pp. 494-4Y5. :ir; Ihid., p. 4Yfl.
"7 Ibid.
J)J•:RJJ()RJ\NU!, RÉC IT INTRICJ\NT ou ROMAN COM rvn :RCTA!.? 18'.l
essenlielle étant qu'elle comporte un récit (mais on sait qu'il y a le récit épique, le récit lyrique, le récit dramatique)[,] qu 'elle comporte ensuite chez l'auteur, disons le poète, l'espèce particulière de plaisir neuf et spontané que l'enfanl prend aux espèces de spectacle des choses et des êtres. Peut-êlre alors serions-nous plus près en effet, j'y reviens, du roman dit romanesque ou du roman populaire ou du roman-feuilleton que de certains romans dits sérieux qui passent cependant pour le type du genre. ''"
On voit donc qu'il serait réducteur d'opposer chez Ramuz une visée lyrique, idéalement désintéressée, uniquement animée par des préoccupations stylistiques, à une forme de dramatisation de l'histoire, ne renonçant pas à user des ficelles éprouvées du " roman populaire » ou du «roman-feuilleton"· Au contraire, les ambitions esthétiques de Ramuz semblent passer par la recherche d'une fusion entre « romanesque» et« poétique'" débouchant sur une forme de récit« épique», «dramatique » ou «lyrique ». Car intrigue et poésie visent au fond un même but: engendrer un «plaisir neuf et spontané », et cet o~jectif rejette avant tout l'esthétique naturaliste, qui tentait au contraire d'imposer un enseignement ou une morale.
Certes, Ramuz a également développé ce que l'on pourrait appeler une «réflexion sur le monde », rattachable à une métaphysique qui insiste sur la séparation essentielle des êtres et des choses. Mais cette ambition intellectuelle de !'écrivain, que ses œuvres portent à des degrés divers, n'est pas nécessairement en contradiction avec ses visées proprement esthétiques, qu'elles s'incarnent dans certain lyrisme"\1 ou dans une narration intrigante, qui dynamise la lecture en tenant en haleine le lecteur. Ainsi, l'ancrage dans un point de vue limité peut servir un triple dessein, intellectuel, lyrique et narratif. C'est ce que l'on peut observer dans une scène à la fois lyrique et poignante de Derborenœ, lorsqu'Antoine s'approche du village et que le point de vue limité de Thérèse, qui ne parvient pas à reconnaître son mari, l'empêche de renouer le lien fragile qui l'unit à l'apparition:
C'était venu on ne sait d'où, puis ça se montre. C'était comme suspendu en l'air, parce que juslement les branchages en cachaient la partie d'en bas . Elle cherchait à se raisonner ; elle se disait: «Qu'est-ce que c'est?» elle se disait:
r-.R lhirl., p. 4Y6. 09 L'em:adn::ment du récit est en effet de caractère nettement lyrique.
" C'est un voisin ,, ; mais un voisin a de.s souliers ~1 clons qui fonL du bruit; or, la forme là-bas étaÎL parfaiLement silencieuse . Elle glisse de côté, c'est tout ; ça bouge, à prèsenL c'est immobile. C'était comme le haut d ' un de ces bonshommes, faits de quatre branches cl d'nne vieille chem i.se, qn'on met dans les jardin.s pour faire penr aux moineanx. Senkment cette chose blanche continuait ~1 se déplacer, faisant de temps en temps un mouvement de bas en haut. Et voilà que peu ù peu l'étonnement faisait place chez Thérèse à l'inquiétude et l'inquiétude à la peur, parce qu'en même temps qu 'elle regardait, il lui semblait sentir qu 'elle était rq~ardée; c'est un sentiment qu' e lle avait el qui a pris de plus en plus de force; alors elle a làché le manche de son fossoir, qui tombe parmi les mottes. (p. 262)
U11 ro11wn rnmm1'1âal ? CirnmstmJ,(t'S matùùdlr's et Hioj1tion r:ritique
Se demander si Dahorenre peut être considéré comme un roman « commercial » n'est pas une question oiseuse, dans la mesure où elle pcrmel de formuler des hypothèses relatives aux choix thématiques et stylistiques de Ramuz. En effet, s'il est Ltcile d'affirmer que le livre a connu inconlestablement un succès critique et de vente, on postulera clans la foulée que cette réussite a bien été l'un des principaux objectifs de l'auteur an moment de la rédaction, et donc que cette intention a posé des contraintes décisives sur l 'écriture. Toutefois, une telle hypothèse implique inévitablemenl la question subsidiaire de la valeur du texte el de sa place dans l'œuvre ramuzicnne, tant l'opposition entre l'art et l'argent a été naturalisée dans le champ de la critique littérairé".
Ce qui est certain , c'est qu 'au moment où il s 'attelle à Derborenœ,
Ramuz a besoin d'argent. Vers l'été 1933, il évoque dans son journal les problèmes financiers qui l'assaillent:
Le commencem ent de toutes les difficultés a été ces !)() 000 francs qui m'avaient faé promis. Si je n'avais pas cru pouvoir compter sur eux, je n'aurais jamais acheté la maison" 1• Ils faisaient partie de la somme qui m'avaiL été assurée cl que.j'avais con.~acrée tout entière d'avance à ceL achat. Patatras, .. Que faire? Revendre la maison? J'ai reculé devant les complications, l' énorme perle de temps , les dérangements de toute espèce ... .Je me
"" Sur celle queslion, nous renvoyons nalurellemeut ;l l'ceuvre de Pie rre Bourdie11 (Ln R1'r;ln d1' l'art, Paris, Seuil, l ~IS12); voir égalemenL Claude Lafarge, J,rt Va/rnr li1t1;
r11ire. Figw '(f.iirm lillùairr' l'i //Jogn .rnrùiux 1Li·1· fh tùm 1·, Paris, Fayard, 198'.t ' ;
1 Ramuz fait alhtsion ;\l'achat del.a Muetle e t au Prix Romand qui lui a été déccrnt'. .
/)t·JUJ()]:h'NU:, R~:cn I NTRI<;ANT Oli ROMAN COMMER<:J1ll.?
snis Liré d'affaire comme j'ai pu, a.ssumanl Ulle t~norme dette ... Et n-dess11s csl survenue la ,, crise ,, - d'où la diminution catastrophique des quelques valeurs que j'avais en banque; la vente de livres presque arrêtée, les occasions de gains de pins en plus rares''~.
Le souci "commercial " de Ramuz s'exprime de manière encore plus explicite dans une lettre à Jean Paulhan envoyée alors qu 'il est en pleine rédaction de Da/Jomnœ. Il y évoque de mauvaises critiques lues dans la presse, sans doute relatives à la publication récente d'Adam et
fü1e chez Grasset:
Quant à cette question de la critique (ou des cril"iq11cs) , vous devinez corn bien je suis touché de votre témoignage, qui m'importe beaucoup plus que Lous ces articles, de sorte qu 'ils n'auraient aucun inconvénient pour moi s'ils ne contribuaient malheureusement à me ridiculiser davantage auprès clt: lenrs lecteurs à qui on n'offre ainsi de ma pauvre personne qu'une lamentable cariGllure et à me discréditer auprès cle mon éditeur, cc qui es t beaucoup plns grave: carje ne suis préoccupé que de mon avenir m'lll'/ll!'f1iaL'";
Il est dès lors vraisemblable que Ramuz, échaudé par les critiques dont Adam et Erw a été !'objet, ait visé avec la rédaction de son nouveau roman à reproduire le succès commercial acquis avec / ,a Gmnrle Pmr dans la
nwntag111', dont Drrborenœ récupère l'essentiel: une intr igue simple mais tendue, le cadre montagnard, l'atmosphère inquiétante frôlant le surnaturel, la personnification de la nature comme puissance destructrice. Rappelons que, en termes de réception critique, {,a Orrmde Peur dans la
montagnr' représente alors un sommet dans l'œuvre de Ramuz:
Au vu du nombre d 'articles générés, [Ln Gm111Ü' Pn1:rr/.rm s la 11111ntng111'] a une importance déterminante clans le cadre de la d'.ccption. Ainsi, la critique,~[ la suite de H. Poulaille, perçoit cc nouveau roman comme le r{·sultal excellent du mélange entre réalisme strict et sens du mystère ou du fantastique qui apparaîL comme la marque de fabrique de l' écriva in. De m(•me on reconnaît de façon quasi unanime la puissance descriptive de !'écrivain , ses dons d 'évocation, qui se réalisent peut-ê lre à travers une " nouveauté " de l'expression. Cela est moins remarquable que cet attire constat, là aussi partagé par la majorité de la critique, relatif ;[ la «science cle la mi.se e n place », au sens dramatique de l'écrivain.'"
';" .frmrnal, 3, OC, III, p. 273, enlrée de mai - aoÙL 19'.l'.\. «.1 Lcllre de Ramuz ù Paulh;m du 31 janvier Hl34 , publiée dans PPS, pp. 7ll-71. <; i Vincent Verse lle, arl. rit., !JAi?, pp. l!lfi-157.
lHfi DEIIBORENCE
Jérôme Berney relève pour sa part que ce roman avait apporté à Ramuz «une audience élargie et[ ... ] une sécurité matérielle accrue», et rappelle que l'auteur avait décrit ce livre, dans sa correspondance, comme «un petit roman feuilleton» 1i\ précisant qu'il voulait dire par là que c'était «Un récit et qu'il y avait une "intrigue"». Les critiques sont presque unanimes à affirmer qu'ils retrouvent ce «sens de la mise en place» et cette puissance «dramatique» dans De:rborence, ainsi qu'en témoignent les commentaires suivants:
Le récit contient peu d'événements; mais l'auteur lui donne immédiatement l'allure d'une épopée et l'élève à la hauteur d'un beau drameYli
De la poésie pure, tantôt légère et délicate, tantôt dramatique et puissante comme le souffle qui anime les grandes épopées et c'est bien une épopée que Dl'rboren œ.1;7
La narration des vicissitudes de celui qui, par deux fois, fut perdu, est liée intimement au récit empoignant, bouleversant, de la catastrophe naturelle. Le récit simple et fort de cette œuvre spécifiquement suisse avance, jusqu'à son dénouement, du pas pesant et prudent du paysan montagnardY"
La seule différence entre les deux œuvres, c'est que le succès critique de Derborence sera encore plus éclatant (générant près du double de critiques pour un pourcentage identique de commentaires favorables, culminant à 91 % ) . Par ailleurs, Ramuz semble avoir mis toutes les chances de son côté en atténuant les régionalismes et !'oralité de son style, qui avaient suscité tant de polémiques en France. Ainsi parvient-il à retourner certains de ses détracteurs les plus acharnés:
Se serait-onjamais attendu à voir M. C. F. Ramuz parler de la sorte? On nous l'a changé vous dis:je: le voilà qui donne dans le beau langageY1
On peut donc dresser l'inventaire des options choisies par Ramuz qui peuvent s'interpréter comme autant de tentatives pour reproduire
"' Jérôme Berney, "Un tournant éditorial et romanesque'" R0111an s, 8, ()C, XXVI, p. ;) et p. fi. 1''' Armand Pittet, La Li/Jertâ (Fribourg), 21 décembre EJ'.H.
(>7 Maurice Zermatten, <<Sur quatre romans», Nrn1a rt Vr)tera,juin 1935, p. 196.
'" Article non signé dans I~i! Sillon romand (Lausanne), 8 mai 19;)6, w Pierre Loewel, L'Ordn~ (Paris), 15juin 193fi.
• [)mmomc'NCE, RÉCIT INTRH;ANT ou ROMAN COMMERCIAL? 187
le succès cnt1que et commercial de La Grande Peur dans la rnontagnr.: une intrigue tendue; un cadre montagnard qui, d'une part, répond aux attentes d'un public le classant le plus souvent parmi les auteurs «régionalistes», et qui, d'autre part, lui permet d'installer une atmosphère mystérieuse propre à la littérature fantastique, aux contes ou aux légendes; enfin, un style dans lequel les expérimentations avec la langue orale et l'usage des tournures régionales sont bridés, pour éviter de fâcher les puristes. Le but semble atteint, lorsqu'on lit les propos que Jean-Pierre Maxence tient en mars 1936:
Jamais peut-être l'œuvre du romancier épique n'avait fourni occasion plus propice que Daborence. Est-ce le meilleur de ses récits? C'est du moins le plus lumineux, le plus accessible, le plus serré. Argument, atmosphère, accent, poésie, tout devrait contribuer à en faire un très grand succès. 70
La même année, on peut encore lire ce commentaire:
On a fait à Ramuz la réputation cl' être un auteur difficile. A lire Derborence, on se demande bien sur quoi repose un tel avis; car ce roman se lit d'une traite, avec un intérêt, une émotion croissante.71
Le succès de vente sera bien au rendez-vous, même si, en l'absence de documents précis, il reste difficile à chiffrer. Dans une lettre à Paulhan datée du 31 octobre 1935, Ramuz signale que la première édition parue chez Mermod a été tirée à 1000 exemplaires« qui ont été vendus en quelquesjours»n. Par ailleurs, le 27 mars 1936, il reçoit une lettre de Grasset dans laquelle Pierre Tisné lui annonce ceci:
Si vous suivez la presse parisienne, vous y verrez que Derborenre y obtient un accueil splendide. Aujourd'hui encore, c'est un grand article deJ.-P. Maxence dans Gringoirn après beaucoup d'autres. La vente est bonne, je suis très content. 73
Pour l'édition à la Guilde du livre, Ramuz finit par obtenir 8 000 francs pour un tirage de 3000 exemplaires. Et cette fois encore, le livre se vend bien, ainsi qu'en témoigne le fait qu'il sera réédité cinq
7" Jean-Pierre Maxence, Gringoire, 27 mars 193fi. 71 Article non signé clans Antoine Dow111cnt (Paris), hiver l 93fi. 7 ~ Lettre publiée clans PPS, p. 77. 7.> Lettre de Pierre Tisné à C. F. Ramuz du 27 mars 1936 (archives C. F. Ramuz, Pully) .
188 DERI\OREN< E
fois jusqu'en 1954. A ces succès dans les régions francophones, il faut 3:iouter celui des traductions en allemand et en ilalien.
Si Derbornu:e est un roman que l'on peut juger plus «commercial» que, par exemple, Prt'snu·e de la mort ou Les Signes jmnni nous, il ne faudrait pas en tirer la conclusion hfüive que sa valeur serait nécessairement moindre sur une échelle absolue, voire même aux yeux de son auteur ou de ses contemporains. Bien que l'art de construire un récit accessible et une intrigue palpitante soit rentable, cela n'implique nullement que ce soit un art facile, vulgaire ou même contraire à l'esthétique, et l'on peut affirmer cela même si, à de nombreuses occasions, Ramuz aura préfëré explorer une veine plus intimiste et dénarrativisée, se rapprochant par ce biais des œuvres les plus avant-gardistes de son temps.
Pas besoin ici d'invoquer, par un anachronisme déplacé, une esth(~tique post-moderniste réhabilitant les codes de la littérature populaire et célébrant les «retrouvailles avec l'intrigue et l'amabilité »74• Comme le rappelle Stéphane Pétermann, en dépit de ses concessions aux lois du marché, Derborenre représente bien «un des chefs-d' œuvre de cette période vue comme celle de la maturité, comme un des points culminants de l'ensemble de la production fictionnelle de l'écrivain. [ ... ]Et il faut bien reconnaître que Derbormœ est, avec La Grande Peur dans la mon.Lagne et Aline, un des romans les plus connus de Ramuz, un des plus étudiés dans les écoles et un des mieux diffusés »75 • N'oublions pas non plus que, bien qu'il ait prétendu être un auteur «dénué d'invention», Ramuz n'en plaçait pas moins son idéal du côté d'un équilibre entre le créateur d'image et l'inventeur d'intrigue: «Le parfait romancier», écrit-il, «serait un homme qui aurait à la fois de l'invention et de l'imagination et on sait quel' espèce en est singulièrement rare» 71 '.
Ajoutons qu'aucun des commentateurs contemporains de l'œuvre (entre 1934 et 1937, on dénombre plus de deux cents comptes rendus) n'adresse à Derborenre le reproche d'être un roman «commercial», même si la grande majorité des critiques met en évidence le caractère
71 Umberto Eco, Aj1ostilll' ail Nom de la Rose, Paris, Grassel, 1985, p. 74. r. SLéphane Pétermann, postface à !Jrr/Jorn1ce, Lausanne, Plaisir de Lire, 200fi, p. 179. Michel Raimond n'hésilc pas, pour sa part, à parler" de belle réussile" dans laquelle "l'équilibre [est] conservé entre l<:> roman et la poésie» (La Crisl' du roman, 0)1. rit., p. 241). 7'' IN1.01wn te rlu mmrrll', E1rils rrntobiogm/Jhiqw•1, OC, XVIII, p. 564.
j)Jc'/W(J/llc'Nl:I•:, Rf·.crr IN'J1U<;;\NT Ol! ROMAN COMMERCIAL? 189
plus «facile>, de l'œuvre, l'efficacité de son intrigue et sa puissance dramatique, ces traits étant toujours considérés comme des qualités esthétiques et non comme des défauts. C'est surtout la théorie littéraire moderne, à partir des années 1950-1960, qui a généralisé la condamnation de l'intrigue, interprétée comme une forme «d'illusion affective» et comme un moyen visant à asservir le lecteur en le soumettant à impératif commercial77.
La réception de Derborenœ permet pourtant de constater que la critique met clairement en évidence les qualités d'une intrigue efficace, capable cl' engendrer un intense effet de suspense et de ménager des surprises. En effet, lorsqu'ils résument l'histoire, surtout la portion narrée dans la deuxième partie, de nombreux lecteurs s'arrêtent sur les incertitudes qui se nouent après qu'Antoine s'est dégagé du pierrier:
[Des] angoisses diverses [ ... ] nous assaillenL cl ne cessent de nous tenir
vibrants jusqu'à la fin, car si l'on sait qu'Antoine rcs.-;ortira de la montagne,
sait-on jamais avec un homme qui connaît combien imprévisible est la vie,
où sera la fin véritable, et où le tragique dernier, plus inLéricur ?7'
Antoine a été écrasé dans la tourmente; cependant, un jour, il reparaîtra.
Mais sous quelle forme? Est-ce un corps? Est-cc une âme ?7''
Guérira+il jamais de sa terrible émotion? Il est comme un automate qui
vacille, il !'St 111nu; du dedm1.1· jiar ses smwenir:~.K'.1
Cc revenant n'est-il qu'un fantôme? telle esl la question que se posenL les villageois.RI
Es-tu un homme? es-tu un chrétien? es-tu un être véritable?[ ... ] cette scène
particulièrement pathétique et qui constitue un des sommets du réciL, met fin - provisoirement du moins [ ... ] - au doute qui subsistaiL sur l'authen
ticité d'Antoine Pont[ ... ]. Mais le drame va rebondir. 8'
77 Voir par exemple les commentaires de Roland Banhes sur le suspense, considéré comme une forme de perversion el de "strip-lease,, narralii; dans S//'., Paris, Seuil, 1 ~l70 el Lr Plrii\ir du li's:lr, Paris, Seuil, 1973. 78 Eric de Montmollin, I~'uille cl'ntmle dr l'.nfingue,janvicr 1935, p. 230. 7'' Jean Vignaud, Lr Pttit Pari.1in1, 21 avril l 9'.l6. eu Camille Gandilhon Gens d'Armes, L'A1wag1rnt de Paris, 13 juin 19'.l6. 81 "Bonnes feuilles" parues dans L1' Pojmlairl' (Nan les), 10 mai l 93fi. se Anicle non signé de la Gazrtll' d1~ Liège du 17 juin 19%.
190 Dc:RBORENc:E
On hésite à le recevoir. Ne serait-il pas un fantôme?[ ... ] Sous les blocs accu-mulés, n'a-t-il pas laissé son compagnon, son parent?[ ... ] Etions-nous si sûrs qu'il ait été vivant, l'homme de cet extraordinaire retour ?H 1
Le simple fait que l'intrigue soit si souvent résumée dans les commentaires met en évidence l'importance de l'histoire racontée et le haut degré de "narrativité » du texte. Preuve également de la manière dont le récit s'emploie à souligner les virtualités de l'intrigue et, parfois, à déjouer les pronostics du lecteur, certains articles perçoivent le dénouement comme une «péripétie inattendue» et comme une «concession à l'optimisme des romanciers » 84 • Un autre critique va jusqu'à proposer un dénouement alternatif:
Mais c'est l'amour qui vainc la tentation de la mort et l'on voit redescendre de la montagne le couple retrouvé. Epilogue heureux mais auquel on ne saurait empêcher la pensée de substituer l'image plus vaste, plus dramatique, plus mystérieuse du couple qui se serait au contraire perdu dans sa poursuite insensée. Mais gardons-nous du ridicule de refaire un livre: je ne veux signaler dans sa fin qu'une tendance un peu généreuse à la trop bien finir. Il suffit qu'il soit ce qu'il est: surprenant d'émotion, d'ampleur et d'une sorte de sérénité tragique.R'>
A plusieurs reprises, on rencontre de faux résumés de l'histoire, affirmant par exemple qu'Antoine et sa femme «repartent pour Derborence, à la recherche des disparus; une nouvelle avalanche les recouvrira pour toLtjours. Une tragédie » 81
;. Si l'on admet que la force de l'intrigue tient à sa capacité à inscrire le cours des événements dans un écheveau d'histoires alternatives potentielles, on peut expliquer cette méprise. Dans le but de renforcer la tension narrative, qui atteint son rlimaxjuste avant le dénouement, Ramuz est peut-être allé trop loin dans ses efforts visant à induire l'hypothèse que l'histoire pourrait s'achever mal. Au-delà de la négligence de certains lecteurs trop pressés, cette erreur souligne peut-être que, pour un lecteur intrigué, l'issue heureuse (qui surviendra effectivement) a autant d'importance que l'issue malheureuse (qui n'est que virtuelle, mais qui est parfois préférée à son
•1 Les Dix, Mh11orial de la Loirr (SainL-Etienne), 17 octobre 1936.
H•• André Thérive dans Le Tt•mj;s du 21 mai 1936, cité par [Valentin] G[ranqjean] dans V PmjJ/e genruois du 6.juin 1936. •·· Pierre Loewel, art. rit., 15 juin 1936. ,% Jean-Germain Tricot, L'Ind1ij;1mdant, 14 mars 1936.
J)J:IWORl,1W:I·.", RÉCIT lNTRH;ANT Oll ROMAN COMMERCIAL? 191
alternative). En vue de la publication chez Grasset en 1936, Ramuz a du reste réécrit en partie la fin de l'avant-dernier chapitre. Dans ce passage essentiel, !'écrivain rend le retournement final encore plus explicite en renforçant le contraste entre une histoire qui aurait pu mal finir (et qui est résumée), et le récit de la victoire d'une «faible femme» qui «ramène ce qui est vivant du milieu de ce qui est mort» :
C'est l'histoire d'un berger qui a disparu pendant deux mois, et il a reparu, mais il disparaît de nouveau; et, cette fois, c'est encore plus grave, parce
qu'il y en a une qu'il entraîne avec lui.[ ... ] Les cinq hommes avaient en face d'eux la montagne avec ses murailles et ses tours immenses, et elle est méchante, elle est toute-puissante; - mais voilà qu'une faible femme s'est levée contre elle et qu'elle l'a vaincue, parce qu'elle aimait, parce qu'elle a osé. Ayant la vie, elle a été là où était encore la vie et ramène ce qui est vivant du milieu de ce qui est mort. (Grasset, 1936)
Outre le détail de ces charnières essentielles de l'intrigue, on peut également offrir un florilège de commentaires relevan~ l'intérêt globa! du récit, sa capacité à engendrer une tension narrative efficace et a tenir en haleine le lecteur jusqu'à la dernière page:
[C'est un] drame poignant écrit dans un style elliptique qui laisse à chaque page une incertitude de plus en plus pesante jusqu'aux dernières lignes.87
DrrborenO' qui paraît ces jours-ci, est d'un pathétique intense et déconcertant. Il prend tout de suite le lecteur, mais pour le dérouter, et ne pas le laisser se reprendre, tant que le roman n'est pas fini . ~8
Et d'emblée l'atmosphère qui doit être là est là; on pressent qu'un malheur
menace. C'est superbement« amené » .8
"
Ce livre est poignant, il atteint presque la grandeur dans les sentiments exprimés. En le lisant, j'ai senti passer en moi les frissons de l'angoisse et la
fraîcheur des prés alpestresY0
De cette très simple histoire, M. C. F. Ramuz fait une espèce de conte fantas
tique et mystérieux d'où l'on ne peut se détacher.'1 1
«7 Article non signé dans le Hull1!lin PL.M., septemhre 1936. "" Article non signé , L 'F,uroj1rl'll , 20 mars 1936. "" [Maurice] P[ orta], Fmille d'nvis de J,m1srwnr, 21 décemhre 1934. •Hl Elie-Michel Boury, Bugiste (Belley), 11 avril 1936. no Georges Poupet, L1!]01t1; 13 avril 1936.
192
Il y a de la grandeur et du pathétique clans Drilmrrni·e.!'2
Il y a l<'L une angoisse sourde, qui se transmet clans celle atmosphère singulière de cataclysme, vécu par ces êtres simples, avec une sorte de nudité.''"
Il est prenant, ce récit - comme est intitulé le livre - d'un cataclysme de la rnontagne.1
''1
Un critique mentionne également la fragmentation du reclt, qui n'est pas sans rappeler une technique propre au roman-feuilleton:
Celui qui lit Dcrbormu: est immédiatement frappé par la discontinuité de l'action et par la régulière cassure qui intervient à la fin de chacun des courts chapitres où elle est enfermée. La destinée d'aucun des hommes qui apparaissent clans ces pages n'est suivie avec le souci de la conduire jusqu'à un tenne. !,-,
En multipliant les points de vues, Ramuz ne parvient pas simplement à rompre la linéarité du retour d'Antoine, mais il dynamise le récit, engendrant un suspense efficace par des relances successives. L'histoire de ce retour se dilate el, à chaque interruption de l'action, Ramuz rappelle qu'une épée de Damoclès est suspendue au-dessus de la tête du protagoniste: nous sommes d'abord informés de la légende colportée par le vieux Plan, nous assistons ensuite au jeu des apparences qui abusent les personnages et les conduisent, les uns après les autres, à confondre Antoine avec une âme errante, jusqu'au coup de fusil de Rebord. Cette discontinuité est également une forme de ralentissement de l'action, mais il s'agit d'une temporisation qm ne débouche pas sur un enlisement du récit, mais au contraire sur son intensification, comme le constate cet autre critique:
Le récit esl très lent, si vous le chronométrez selon les règles ordinaires. Mais justement, c'est le film au ralenti qui, ici, nous intéresse et nous tient en haleine.%
DPrborenœ apparaît ainsi comme le cas exemplaire d'un récit dont le caractère populaire et la dynamique de l'intrigue, pourtant évidents à
''" Auteur non idenlifié, L1:.1 M(lr!!/1. avril 1936. ''-' Auteur non idcntifi(!, f,I' NouvmuJonmal rie Stn11'/wn1;i.;; 11 mai J 936. 9 l Article non sig-né, Livrcsjimu:rlis, mai 1936. ~Fi (;eorges Anex, Cahiers dt la Rn1aissance z1audoi~-,,, art. rit., p. flO. % Camille Melloy, La Ri'llW' drs rmteun et des /forn (Louvain), avril 10'.lfi.
/)!·J!!WRFNŒ, tü:c:IT INTRTCANT Ol! ROMAN COMMERCIAL?
]'époque de sa parution, courent le risque d'être occultés du fait de sa canonisation ultérieure. Partant d'une distinction trop nette entre romans populaires et chefa-cl'œuvre de la littérature, la critique savante a trop souvent tendance à mépriser les questions relatives au contexte économique el aux effets concrets des textes canonisés sur des lecteurs ordinairesm. Heureusement, on observe at~ourd'hui un regain d'intérêt marqué pour des approches réinscrivant l'œuvre dans son contexte matériel - qui est aussi bien commercial que culturel -, et pour l'étude des procédés narratifs dont la fonction est d'intéresser des lecteurs-consommateurs, pour lesquels il n'y a pas de raison de mépriser le plaisir de la tension narrative, et de juger cette «qualité» comme inférieure à celle qui repose sur des considérations d'ordre poétique ou intellectuel.
Si l'on sort de l'opposition naturalisée entre l'art et l'argent, on peut ainsi affirmer que l'étude de la genèse de Derborenœ, de son intrigue et de sa réception nous conduisent à postuler que Ramuz a vraisemblablement cherché à publier un récit à la fois poétique et populaire, conjuguant imagination et invention, lyrisme et intrigue palpitante, tragédie de la condition humaine et dénouement heureux (ce dernier point étant probablement le plus problématique). Derborenœ aurait ainsi été conçu pour plaire à un large public et pour sortir son auteur d'une ornière financière; mais il ne faut pas nécessairement en conclure que Ramuz aurait sacrifié ses idéaux esthétiques et intellectuels sur l'autel de ses besoins matériels, car il semble être parvenu à faire converger dans son récit ces différentes contraintes, comme il avait déjà réussi à le faire, auparavant, dans La Grande Pmr dans la montagne. D'ailleurs, le public et la critique ne lui ont pas tenu rigueur du succès commercial de son livre, puisqu'il est encore perçu comme l'un des sommets de sa production.
Raphaël Baroni
~ 17 Cette lectnre concrète que J érfüne David a baptisée «Le premier degré de la lillératme », LH'L; n" 9, dossier publié le l" février 2012, URL: hup:/ /www.falmla.m·g/lht/9/index.php?i<l=304.
X
suppression, remplacement, déplacement). Le résultat de ce marqua e est livré par une interface élaborée par Yannick Saraillon, de socie~eecran media, qui offre à la lecture aussi bien qu'à la comparaison les romans et leur réécriture.
Chaque volume de la série «Romans» est ainsi accompagné d'un disque numérique où figurent toutes les versions publiées des romans concernés, ainsi que plusieurs confrontations de ces versions entre elles. Parmi l'ensemble des comparaisons possibles, ont été retenues celles qui permettent de retracer l'histoire effective de la variation du roman; les paires présentées à la lecture sont donc constituées d'une part de la version du roman que Ramuz utilise comme base de réécriture, et d'autre part de la réédition résultant de cette révision. Font partiellement exception, dans ce volume, les cas d'Adam et EvP- et du Garçon savoyard. Pour le premier de ces romans, la comparaison entre l'édition originale (1932, chez Mermod) et celle parue en 1933 chez Grasset donne à voir des états de texte différents, mais pas des opérations de transformation, Ramuz ayant préparé l'édition de 1933 à partir d'un exemplaire de la copie dactylographiée du manuscrit. Il en va de même pour Le Garçon savoyard, dans la comparaison entre l'édition préoriginale et l'édition originale (1936, chez Mermod et à la Guilde du livre), ainsi que dans celle entre l'édition originale et la réédition Grasset (1937), !'écrivain étant à chaque fois reparti d'un exemplaire de la copie dactylographiée du manuscrit.
Ce neuvième volume de romans (OC, XXVII) comprend Adam et Eve, publié aux Editions Mermod en 1932, Derborence, paru à la même enseigne en 1934, Le Garçon savo_cyard, publié simultanément aux Editions Mermod et à la Guilde du livre en 1936, enfin Si le soleil ne revenait pas, sorti chez Mermod en 193 7. En complément d'Adam et Eve sont donnés en Documents deux fragments que Ramuz a insérés, sous ce même titre, dans la revue Aujourd'hui, en décembre 1929 et en mai 1930. L'établissement des textes, les notices introductives et les notes de bas de page sont dus à Daniel Maggetti, Raphaël Baroni, Vincent Verselle et Stéphane Pétermann.
Sur le disque figurent les quatre versions d'Adam et Eve (préoriginale dans La NR.1'~ 1932, 1933, 1941), les cinq versions de Derborence (1934, 1936 - chez Grasset et à la Guilde du livre-, 1941, 1944), les quatre versions du Garçon savoyard (préoriginale dans Vendredi, 1936, 1937, 1941) et les cinq versions de Si le soleil ne rnvenait pas (1937, 1938, 1939, 1940, 1941).
Liste des abréviations
Editions de référence
OC C. F. Ramuz, Œuvres complètes, Genève, Slatkine, 2005 -,
29 volumes. Romans, I et II C. F. Ramuz, Romans, Paris, Gallimard, «Bibliothèque de
la Pléiade'" 2005, 2 volumes.
Correspondances
Lettres, II PPS
C. F. Ramuz, Lettres 1919-1947, Etoy, Les Chantres, 1959. Jean Paulhan, C. F. Ramuz et Gustave Roud, Le Patron, le pauvre hmnrne, le solitaire. Lettres, articles et documents,
Genève, Slatkine, 2007.
Références linguistiques
Dm"
DSR
Godefroy
GPSR
Pierre Rézeau ( dir.), Dictionnaire des régionalismes de
France, Bruxelles, De Boeck/Duculot, 2001. André Thibault et Pierre Knecht, Dictionnaire suisse
romand, Genève, Zoé, 1997. Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IX' au XV' siècle, Paris, Librairie des sciences et des arts, 1937-1938, 10 volumes. Louis Gauchat, Jules Jeanjaquet et Ernest Tappolet (dir.), Glossaire des patois de la Suisse romande, Neuchâtel/ Paris, Victor Attinger, puis Genève, Librairie Droz, 1924 -, 8 volumes pour le moment (lettre G).
XII ROMANS
Littré Emile Littré, Dictionnaire de la langue française, Paris, Jean:Jacques Pauvert éditeur, puis Gallimard et Hachette, 1956-1958, 7 volumes.
Pierrehumbert William Pierrehumbert, Dictionnaire du parler neuchâtelois et suisse romand, Neuchâtel, Victor Attinger, 1926.
Tl_F Trésor de la langue française (disponible en ligne: http://atilf.atilf.fr/tlfV3.htm).
Autres références
DAR Etudes de lettres (Lausanne), 2003, n° 1-2: Dans l'atelier de Ramuz, édité par Jérôme Berney et DorisJakubec.
' ADAM ET EVE