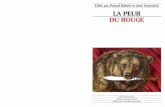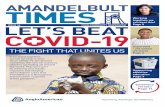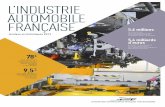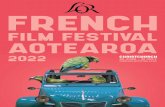Bakhtine et la postmodernité : le dialogisme dans la sémiologie française et les cultural studies...
Transcript of Bakhtine et la postmodernité : le dialogisme dans la sémiologie française et les cultural studies...
« Bakthine et la postmodernité : le dialogisme
dans la sémiologie française et les cultural stu-
dies anglo-américaines »1
Christophe Den Tandt
Université Libre de Bruxelles (ULB) 2014
1. La trace de Bakhtine Comme l’a très justement remarqué Paul Aron lors du colloque qui a
donné lieu au présent numéro thématique, les chercheurs s’appuyant
sur les apports de Mikhail Bakhtine en sont souvent réduits à n’être que
des « utilisateurs » de l’œuvre du théoricien soviétique.2 Plus que pour
toute autre source théorique, il est téméraire de prétendre à une maîtrise
totale du corpus bakhtinien : les emprunts que l’on peut y puiser parais-
sent toujours arrachés à une œuvre au contour mal connu. Les incerti-
tudes pesant sur ce corpus sont bien sûr dues en premier lieu à la bar-
rière de la langue. Dans un monde académique idéal, il devrait s’agir là
d’un obstacle négligeable. Cependant, l’histoire de la réception de la
théorie littéraire russe dans les pays de langues française et anglaise
montre à quel point les frontières linguistiques restreignent la dissémi-
nation de la recherche. Dans le cas présent, les difficultés causées par
l’absence de traductions ou leur manque de fiabilité se conjuguent avec
les circonstances spécifiques du parcours biographique de Bakhtine : ce
dernier a vécu en marge des institutions culturelles de l’Union Sovié-
tique et a parfois été relégué à un statut proche de la dissidence ; nom-
bre de ses essais ont connu une publication parcellaire et tardive.3 De
manière plus problématique encore, les auteurs s’inspirant de Bakhtine
1 Cet article est le manuscript d’un texte qui sera publié dans un numéro thématique
de la revue de théorie des art graphiques La part de l’Oeil. 2 Paul Aron, « Le chronotope, un concept pour les études littéraires », Communica-
tion non publiée, Colloque Mikhail Baktine et les arts, Bruxelles, Académie Royale
des Beaux-Arts de Bruxelles, 5 mai 2013. 3 Voir Tzvetan Todorov, Mikhail Bakthine, le principe dialogique, suivi de Ecrits du
Cercle de Bakhtine, Paris, Seuil, 1981, pp. 7-25 ; David K. Danow, The Thought of
Mikhail Bakhtin : From Word to Culture, New York: St. Martin’s Press, 1981, p. 4.
Christophe Den Tandt 2
doivent tenir compte de l’hypothèse crédible mais difficilement vérifia-
ble selon laquelle le théoricien serait l’inspirateur ou même le véritable
auteur d’œuvres majeures publiées sous le nom des membres de son
cercle intellectuel. Valentin Volochinov et Pavel Medvedev, en par-
ticulier, ne seraient que des prête-noms pour Bakhtine lui-même, ce qui
incite certains commentateurs à recourir à des termes composés—
« Volochinov/Bakhtine » ou « Medvedev/Bakthine »—quand ils citent
le corpus bakhtinien.4
Le présent essai vise à explorer certains aspects de cette dissém-
ination indirecte et parcellaire. Son objet, comme le titre de la présente
section le suggère, pourrait métaphoriquement s’intituler la trace (ou
même l’ombre) de Bakhtine—l’influence exercée par un penseur qui,
au contraire d’autres grands noms de la théorie de la culture, n’a jamais
pu être une présence vivante ou même visible pour les théoriciens
ouest-européens qui s’en sont inspirés. En particulier, je désire indiquer
comment certains sémiologues post-structuralistes français et certains
théoriciens anglo-américains travaillant dans le domaine des cultural
studies (l’étude interdisciplinaire de la culture populaire) se sont tour-
nés vers la figure diffuse de Bakhtine afin de compléter leur propre
approche théorique, ou même afin de trouver des concepts qui pallient
certaines apories auxquelles font face leurs propres modèles. Nous
verrons donc d’une part comment le dialogisme bakhtinien, même
repris au terme d’une appropriation indirecte, a permis d’étoffer les
apports de la sémiologie saussurienne : il offre un modèle simple pour
la représentation du champ intertextuel de la culture et permet de
réintroduire dans la sémiologie une thématisation du sujet par le biais
d’une réflexion sur l’altérité. D’autre part, nous verrons que les
théoriciens des cultural studies ont trouvé chez Bakhtine plusieurs
principes légitimant une approche de la culture populaire qui réponde
aux exigences théoriques du marxisme ou du multiculturalisme sans
pour cela s’en tenir à un rejet inconditionnel de la culture de masse. Le
dialogisme rend par exemple possible l’analyse des textes générique-
ment hybrides qui foisonnent en culture populaire ou dans les marges
de la culture canonique. Plus fondamentalement, il permet de reformu-
ler la préoccupation centrale des cultural studies—l’analyse des luttes
sociales (classe, genre, ethnicité) au sein même du discours—par le
4 Tzvetan Todorov, p. 24; voir aussi Michael Holquist, “Introduction,” in Mikhail
Bakhtin, The Dialogic Imagination: Four Essays by M.M. Bakhtin, ed. Michael
Holquist, tr. Caryl Emerson and Michael Holquist, Austin, University of Texas
Press, 1981, p. xviii ; David K. Danow, pp. 5-7.
Bakhtine et la postmodernité 3
biais d’une approche qui tient compte du rôle du public dans les pro-
cessus culturels. Enfin, le legs de Bakhtine a permis aux théoriciens du
postcolonialisme et du multiculturalisme d’imaginer un espace social et
culturel planétaire régi par la dynamique du dialogisme.
2. Dialogisme, champ culturel et intertextualité
Je me limiterai à de brèves remarques concernant l’impact de Bakhtine
sur la sémiologie française car cet aspect de la question est probable-
ment déjà bien connu dans le domaine francophone. En résumé, le
dialogisme bakthinien a permis à la sémiologie d’évoluer au-delà du
modèle atomiste du structuralisme classique. On trouve bien dans les
textes de Ferdinand de Saussure et de Claude Lévi-Strauss le postulat
selon lequel les systèmes de signes recouvrent l’ensemble du champ
culturel. Cependant, cette notion reste chez eux une possibilité ab-
straite, illustrée par des exemples qui ne font interagir qu’un nombre
limité de signes (les paires minimales de l’hypothèse phonologique, les
matrices narratologiques de Lévi Strauss). Au contraire, comme le
suggère Julia Kristeva dans un des premiers textes consacré à Bakhtine
dans le domaine francophone, le théoricien soviétique offre la possibil-
ité d’imaginer d’emblée le champ culturel comme l’ « espace di-
alogique des textes ».5 De même, Tzvetan Todorov, dans un ouvrage
influent portant sur l’ensemble de l’œuvre de Bakthine, discerne dans le
dialogisme la capacité de chaque discours à entrer « en dialogue avec
les discours antérieurs tenus sur le même objet, ainsi qu’avec les dis-
cours à venir, dont il pressent et prévient les réactions ».6 Cette formule
montre à quel point les concepts bakhtiniens permettent une appréhen-
sion concrète de phénomènes d’interactions textuels et culturels qui
jusqu’alors n’étaient esquissés que de manière floue et axiomatique.
De plus, mieux que les modèles structuralistes initiaux, l’image
d’un champ culturel dialogique répond aux besoins de théoriciens dont
l’objet spécifique est le texte littéraire ou l’œuvre artistique. Malgré
l’insistance placée par Saussure sur le caractère conventionnel (et donc
en principe altérable) de la signification, l’impératif de scientificité du
structuralisme classique donne lieu à un modèle de la production du
sens qui, selon la terminologie bakhtinienne, reste monologique et donc
figé : dans les exemples proposés par le Cours de linguistique générale
de Ferdinand de Saussure, chaque signifiant renvoie à son unique
5 Julia Kristeva, “Le mot, le dialogue et le roman,” 1966, Sémèiotikè: Recherches
pour une sémanalyse, Paris, Seuil-Points, 1969, p. 85. 6 Tzvetan Todorov, op. cit. p. 8.
Christophe Den Tandt 4
signifié.7 Le dialogisme bakhtinien, comme l’indique Julia Kristeva,
ébranle ce monologisme. Il permet de passer d’un « texte comme un
corpus d’atomes » au « texte fait de relations, dans lequel les mots
fonctionnent comme quanta ».8 Dans une perspective dialogique, « le
mot littéraire n’est pas un point (un sens fixe), mais un croisement de
plusieurs surfaces textuelles, un dialogue de plusieurs écritures ».9 En
bref, grâce à Bakhtine, « [l]e mot est mis en espace »10
: il participe
toujours déjà au dynamisme pluriel de ce que Kristeva appelle
« l’intertextualité ».11
Dans la sémiologie française de la fin des années
1960, une des formulations les plus célèbres de cette conception di-
alogique du texte et du champ culturel apparaît dans S/Z de Roland
Barthes. De manière symptomatique, S/Z ne cite à aucun moment le
nom de Bakthine. On peut donc imaginer que l’influence du théoricien
soviétique a atteint Barthes indirectement à travers les travaux de
Kristeva et du groupe Tel Quel. Néanmoins, le concept du texte
« scriptible » défini dans cet ouvrage—le texte voué à être retravaillé et
recontextualisé au fil de chacune de ses (re)lectures—est de nature
clairement dialogique.12
Le modèle de la production textuelle ainsi
défini permet à Barthes d’envisager l’ensemble du champ culturel
comme « un réseau à mille entrées ».13
La culture est donc un champ
dialogique dont les maillons sont des textes scriptibles reliés entre eux
par l’action conjointe des auteurs et des lecteurs (ou, plus précisément,
par des auteurs/lecteurs) lors d’actes d’énonciation réitérés à l’infini.
Simultanément, le dialogisme bakhtinien a aidé les sémiologues
français à gérer le scepticisme suscité par un des points les plus contro-
versés de leurs recherches—le statut du sujet dans le discours. La
sémiologie française à partir de la fin des années 1960 (donc, selon la
terminologie anglo-américaine, le post-structuralisme) a propagé le
principe contre-intuitif selon lequel les processus culturels ne seraient
pas l’œuvre de sujets autonomes, conscients de leur rôle dans la pro-
duction du discours. Des textes tels que « La mort de l’auteur de
l’auteur » de Roland Barthes, « Qu’est-ce qu’un auteur » de Michel
7 Voir Ferdinand de Saussure, Ferdinand, Cours de Linguistique générale, 1916, eds.
Charles Bally, Albert Sechehaye, Albert Riedlinger et Tullio de Mauro, Paris, Payot,
1986, pp. 99, 104. 8 Julia Kristeva, op. cit., p. 111. 9 Julia Kristeva, op. cit., p. 83, italiques dans l’original. 10 Julia Kristeva, op. cit., p. 83. 11 Julia Kristeva, op. cit., p. 85. 12 Roland Barthes, S/Z, Paris, Seuil-Points, 1970, p. 10. 13 Roland Barthes, S/Z, p. 19.
Bakhtine et la postmodernité 5
Foucault, ainsi que les écrits de Jacques Lacan décrivent le sujet
comme une entité qui, comme le dit Lacan, n’est pas une plénitude
psychologique mais seulement un « effet de langage »—une instance
qui se laisse construire par les appareils socio-discursifs.14
On ne trouve
pas dans le corpus bakhtinien une affirmation aussi franche de
l’effacement du sujet : les textes de jeunesse font abondamment réfé-
rence aux auteurs, locuteurs, ou autres sujets de l’énonciation, et reven-
diquent même pour l’auteur romanesque un statut de maîtrise—
d’ « exotopie »—par rapport à ses fictions.15
Les textes dans lesquels se
déploient pleinement les concepts du dialogisme—La poétique de
Dostoïevski, en particulier—esquissent en revanche la notion d’un sujet
décentré mais cependant moins évanescent que la subjectivité rési-
duelle évoquée dans la sémiologie française. A ce stade de sa pensée, le
théoricien soviétique affirme de manière insistante qu’il n’y a pas de
rapport au monde possible sans la médiation d’un discours : le dialo-
gisme implique que tout locuteur, dans tout acte d’énonciation, se
trouve toujours déjà confronté à des discours qui portent la marque des
autres locuteurs.16
Il n’y a donc aucun terrain d’ancrage hors du dis-
cours social qui permettrait à une subjectivité supposément autonome
de se maintenir. Au contraire, dans une perspective dialogique, le sujet
est redéfini comme un rapport à l’altérité. « [L]e dialogue » bakhtinien,
écrit Kristeva, « est une écriture où on lit l’autre ».17
Todorov souligne
que cette redéfinition dialogique du sujet aligne Bakhtine sur les dé-
veloppements de la psychanalyse post-freudienne.18
Elle offre d’autre
part aux sémiologues post-structuralistes un outil qui permet
d’exprimer l’agencéité dans le discours sans nécessairement prononcer
la disparition irrévocable d’une subjectivité signifiante. Le champ
dialogique de la culture—le « réseau à mille entrées » de Roland
Barthes19
—est sans cesse refaçonné par le dynamisme intertextuel du
rapport à autrui—un processus qui génère les textes scriptibles. Dans la
14 Jacques Lacan, « Position de l’inconscient », 1960, 1964, Ecrits II, Paris, Seuil,
1971, p. 200 ; voir aussi Roland Barthes, « La mort de l’auteur », 1968, Œuvres
complètes, Tome II : 1966-1973, ed. Eric Marty, Paris, Seuil, 1994, pp. 491-95.;
Michel Foucault, “Qu’est-ce qu’un auteur?” Dits et Ecrits, 1954-1988 , Vol. I :
1954-1969, eds. Daniel Defert, François Ewald et Jacques Lagrange, Paris: Galli-
mard, 1994, pp. 789-821. 15 Tzvetan Todorov, op. cit., p. 155. 16 Voir Tzvetan Todorov, op. cit., p. 82. 17 Julia Kristeva, p. 88 ; italiques dans l’original. 18 Voir Tzvetan Todorov, p. 51-55. 19 Roland Barthes, S/Z, p. 19.
Christophe Den Tandt 6
terminologie de Julia Kristeva, on parle en la matière de « production »
signifiante ou de « signifiance ».20
Cette dissolution du sujet dans le
dialogisme présente l’avantage d’être modulable et même en partie
réversible : reprise par des auteurs que ne rebute pas l’image d’une
subjectivité signifiante, elle permet ce que l’on pourrait appeler une
réhumanisation du post-structuralisme.
3. Culture populaire, genres du discours et hybridité
Dans le domaine anglo-américain, l’impact de Bakhtine s’est fait sentir
en grande partie par le canal des « cultural studies ». Cette discipline
académique se donne comme objet la culture populaire ou, dans une
perspective plus large, l’ensemble du champ de la culture pour autant
que ce dernier soit compris comme un terrain de lutte idéologique et de
rapports de pouvoir. 21
Les cultural studies se sont développées ini-
tialement en Grande Bretagne, notamment dans les recherches des
membres du Center for the Study of Contemporary Culture de Bir-
mingham, fondé par le sociologue marxiste de la culture Raymond
Williams et longtemps dirigé par Stuart Hall. La méthodologie des
cultural studies était au départ une variante culturaliste du marxisme—
souvent appelée néo-marxisme—s’appuyant d’une part sur des auteurs
tels que Antonio Gramsci, Theodor Adorno, et Louis Althusser et,
d’autre part, sur la sémiologie (Saussure, Barthes). Cette base théorique
s’élargit plus tard à l’œuvre de Michel Foucault, à la déconstruction, au
féminisme, au multiculturalisme et, bien sûr, au dialogisme bakhtinien.
Jusqu’au début des années 1980, les théoriciens des cultural studies
avaient accès aux concepts bakhtiniens principalement par la lecture du
Marxisme et la philosophie du langage de Volochinov, traduit en
anglais depuis 1973. En dehors du domaine de la culture populaire, la
trace de Bakhtine se retrouve également dans les écrits du critique
marxiste Fredric Jameson qui, par sa formation de romaniste, avait
accès aux traductions françaises du théoricien soviétique. Enfin, à partir
des années 1980, les traductions de Bakhtine dirigées par Michael
Holquist—notamment les quatre essais recueillis dans The Dialogic
Imagination—permirent aux lecteurs anglophones de se familiariser
avec la conception bakhtinienne du roman.
20 Julia Kristeva, op. cit., pp. 31, 11. 21 Pour un aperçu des enjeux des cultural studies anglo-américaines, voir Christophe
Den Tandt et Mireille Tabah, « La culture de l’Autre / l’Autre dans la culture :
approches théoriques de l’altérité », Altérités : nouvelles approches de la culture, de
la représentation et de la différence, Degrés no. 131-32 (hiver 2007), pp. a5-13.
Bakhtine et la postmodernité 7
Nous verrons ci-dessous que l’apport le plus important de Bakh-
tine aux cultural studies porte sur la conceptualisation des rapports de
pouvoir au sein de la culture. Cependant, afin de respecter la chronolo-
gie de la dissémination des idées du théoricien soviétique dans le
domaine anglo-américain, je préfère aborder en premier lieu un point
dont la portée peut paraître moindre, mais qui a grandement réorienté
l’étude des genres populaires : la réévaluation de l’hybridité et de
l’hétérogénéité des genres littéraires et culturels à la lumière du dialo-
gisme. La théorie du roman développée par Bakhtine—basée sur les
concepts de polyphonie ou, selon la traduction de Todorov,
d’ « hétérologie »22
—mène en effet à une évaluation positive de
l’hétérogénéité discursive du texte romanesque. Dans « Du discours
romanesque » et La poétique de Dostoïevski, Bakhtine fait dépendre les
qualités littéraires du roman à sa capacité d’intégrer des registres dis-
cursifs et des visions du monde multiples.23
Même si une telle célébra-
tion de l’hétérogénéité discursive n’était pas absolument nouvelle—
Todorov indique qu’elle est modelée sur l’esthétique romantique de
Friedrich Schlegel24
—elle avait, dans le contexte de la critique anglo-
américaine des années 1970, un pouvoir libérateur : elle permettait de
marquer une rupture avec le New Criticism, le courant qui avait dominé
la critique anglophone du vingtième siècle. Ce mouvement formaliste
prônait une méthode d’analyse de texte qui se voulait à l’écoute des
complexités et des ambiguïtés de la poésie et du roman moderniste.
Cependant, le New Criticism restait fondamentalement monologique :
le but de toute bonne lecture consiste selon lui en la capacité d’unifier
les dissonances apparentes du texte.25
De manière symptomatique, les
New Critics utilisaient ce monologisme comme critère de canonicité :
comme beaucoup d’autres théoriciens littéraires avant eux, ils considé-
raient que seule la littérature sérieuse est capable d’atteindre un niveau
idéal d’harmonie esthétique. Dans ce contexte, le dialogisme bakhti-
nien, renforcé par la déconstruction post-structuraliste, a permis aux
théoriciens anglo-américains des années 1980 de se façonner une
22 Tzvetan Todorov, p. 88. 23 Voir Mikhaïl Bakthine, « Du discours romanesque », in Esthétique et Théorie du
Roman, Paris, Gallimard-Tel, 1978, p. 119 ; Mikhaïl Bakthine, La poétique de
Dostoïeski, 1929, trad. Isabelle Kolitcheff, Paris: Seuil-Points, 1970, préface de Julia
Kristeva, p. 163. 24 Voir Tzvetan Todorov, op. cit., p. 133. 25 Voir Art Berman, From the New Criticism to Deconstruction : The Reception of
Structuralism and Post-Structuralism, Urbana, University of Illinois Press, 1988,
pp. 48-49.
Christophe Den Tandt 8
approche neutre ou bienveillante de textes et de genres qui n’ont pas la
possibilité ou même l’ambition de prendre la forme de monument
esthétiques parfaitement homogènes.
La nécessité de prendre au sérieux les textes hybrides est le thème
de « Magical Narratives », un des chapitres de The Political Uncon-
scious de Fredric Jameson. Le critique américain, sur base des écrits de
Northrop Frye, y développe une lecture néo-marxiste de ce que les
critiques de langue anglaise appellent la « romance »—la fiction ro-
mantique qui mélange plusieurs modes fictionnels, du réalisme au
surnaturel.26
D’un point de vue marxiste, l’impact social de telles
œuvres est manifestement conditionné par leur hétérogénéité textuelle.
La théorie des genres susceptible de leur rendre justice doit donc
« d’une manière ou d’une autre rendre compte de la coexistence ou de
la tension existant entre plusieurs modes ou composantes géné-
riques ».27
Pour ce faire, Jameson adopte une grille de lecture qui
s’appuie à la fois sur les théories d’Althusser et, de manière plus dis-
crète, sur Bakthine. Du premier, Jameson retient l’idée qu’un texte
littéraire ne peut représenter un champ social de manière complète et
unifiée : les contradictions historiques et sociales donnent inévitable-
ment lieu à des tensions textuelles, condamnant l’œuvre à
l’inachèvement. Du deuxième, il retient qu’un texte est un tissu
polyphonique composé de voix émanant de formations sociales distinc-
tes : si le texte apparaît comme « une unité synchronique d’éléments, de
schèmes génériques et de discours contradictoires ou hétérogènes »,
c’est qu’il est traversé par « un conflit entre une structure plus ancienne
et les matériaux contemporains dans lesquels celle-ci cherche à
s’inscrire et se perpétuer ».28
Dans le cas de la romance, les voix qui
entrent en conflit sont celles de l’ancien monde féodal dont la culture
célèbre les relations sociales basées sur les rapports charismatiques et la
magie et, d’autre part, l’univers rationalisé de la bourgeoisie.29
Même si les réflexions développées dans « Magical Narratives »
ne concernent pas directement la culture populaire, elles mettent en
œuvre une méthodologie permettant d’approcher cette dernière sans
26 Fredric Jameson, « Magical Narratives: On the Dialectical Use of Genre Criti-
cism », The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act, Berkeley,
California University Press, 1981, p. 104. 27 Fredric Jameson, « Magical », 141 ; toutes les citations d’ouvrages en langue
anglaise ont été traduites par Christophe Den Tandt. 28 Fredric Jameson, « Magical », p. 141. 29 Fredric Jameson, « Magical », p. 134.
Bakhtine et la postmodernité 9
condescendance. En la matière, Jameson avait déjà utilisé un modèle
implicitement dialogique dans « Reification and Utopia », un article de
1979 qui a profondément refaçonné l’attitude des chercheurs anglo-
américains vis-à-vis de la culture de masse. Se penchant sur un corpus
de films hollywoodiens, Jameson y essaie de déterminer comment il
serait possible de lire les textes de la culture de masse sans se ranger
aux conclusions pessimistes de Theodor Adorno et Jean Baudrillard.
Ces derniers considèrent en effet que la massification de la culture sert
inéluctablement les besoins du mode de production capitaliste :
l’industrie de la culture, dans leur optique, exacerbe la réification. Afin
de nuancer ce présupposé négatif, Jameson indique qu’il faut prendre
acte du fait que la culture de masse, à l’inverse de ce que le label lui-
même implique, ne parle pas d’une seule voix : elle est toujours di-
alogique. Ce qui brise le monologisme de la culture de masse, c’est est,
selon Jameson, principalement la voix du public : les créateurs de la
culture de masse se doivent de tenir compte des attentes de ceux qui
consomment leur produit. Or, se basant sur les théories du philosophe
marxiste Ernst Bloch, Jameson prétend—avec des accents humanistes
peut-être exagérément optimistes—que cette voix est toujours porteuse
d’utopie : ce que le public recherche dans la culture, y compris dans les
divertissement de masse, c’est la promesse d’une collectivité humaine
émancipée. Cependant, comme la culture de masse reste un media
industriel à visée idéologique, la voix de l’émancipation est inévitable-
ment contrecarrée par des « structures symboliques d’endiguement » ou
de cooptation.30
Nous reviendrons plus bas sur le rôle dialogique du
public dans les rapports de pouvoir instaurés par la culture populaire. A
ce stade, je tiens seulement à souligner à quel point ce modèle de
lecture dialogique, bien que fort simple, rend possible une lecture fine
des textes de culture populaires. Il permet à Jameson de discerner dans
The Godfather de Francis Ford Coppola non seulement un film qui
condamne le gangstérisme au nom de la loi et de l’ordre mais, dans un
retour dialogique, un récit qui fait du crime organisé une métaphore du
grand capital. Simultanément, à travers la saga d’une famille issue de
l’immigration, le film fait miroiter la possibilité d’une collectivité
solidaire. De manière symptomatique, la polyphonie idéologique ainsi
mise en lumière correspond à un dialogisme des genres discursifs. En
filigrane de la formule du film de gangster, dont l’orientation tragique
requiert la mort du héros, Jameson fait ressortir un récit épique— 30 Fredric Jameson, « Reification and Utopia in Mass Culture », 1979, in Signatures
of the Visible, New York, Routledge, 1992, p. 25.
Christophe Den Tandt 10
comparable aux « chansons de geste ». Ce récit caché glorifie les
exploits des mafieux.31
Ainsi, le récit familial du clan Corleone se
double des accents d’un récit politique d’émancipation.
4. Les luttes sociales au sein du discours
Dans une perspective sociologique, l’œuvre de Bakhtine a aidé les
théoriciens des cultural studies à apporter de nouvelles contributions à
la théorie marxiste de la superstructure. Les néomarxistes anglo-
américains étaient en effet confrontés au problème qui a parasité les
critiques marxistes tout au long du vingtième siècle : le statut sec-
ondaire que réserve aux phénomènes culturels la lecture étroitement
économiste de l’œuvre de Marx. Les marxistes orthodoxes ne con-
sidèrent la culture que comme le reflet inessentiel de la base
économique. Dans un article du début des années 1980, Stuart Hall
essaie de renverser ce présupposé : il insiste sur le fait qu’il est indis-
pensable de tenir compte de l’existence d’une « lutte des classes » non
seulement dans l’économie mais aussi « dans le langage ».32
Afin
d’aborder ce phénomène, Hall indique qu’il est nécessaire de mettre en
dialogue les théoriciens marxistes—Marx, Gramsci—et les sémi-
oticiens structuralistes—en particulier de Saussure, Claude Lévi-
Strauss et Barthes. Selon Hall, Mythologies de Barthes est la meilleure
expression d’une telle fusion théorique : l’ouvrage du théoricien fran-
çais constitue un des meilleurs outils d’analyse de l’idéologie à la
lumière de la sémiologie structuraliste.33
Cependant, cette sémiologie
politisée s’avère trop rigide dans sa modélisation des relations de
pouvoir : elle est capable de décrire comment un message peut tenter
d’imposer à ses destinataires une vision du monde idéologiquement
connotée, mais elle ne peut décrire la capacité que possèdent ces der-
niers de se positionner en décalage par rapport au même message, voire
d’y résister. En bref, elle n’est pas dialogique : elle ne rend pas compte
du fait que « [l]a signification, dès qu’elle mise en question, doit être le
résultat non d’une reproduction fonctionnelle du monde au moyen du
langage mais d’une lutte sociale—une lutte pour l’hégémonie discur-
31 Fredric Jameson, « Reification and Utopia in Mass Culture », p. 31 ; italiques dans
l’original. 32 Stuart Hall, « The Rediscovery of ‘Ideology’: Return of the Repressed in Media
Studies », Culture, Society and the Media, eds. M. Gurevitch et al., London, Me-
thuen, 1982, p. 76. 33 Voir Stuart, Hall, « The Work of Representation », in Representation: Cultural
Representations and Signifying Practices, ed. Stuart Hall, 1997, London, Sage
Publications, 1999, p. 39.
Bakhtine et la postmodernité 11
sive—dont l’enjeu est de déterminer quelle accentuation est vouée à
s’imposer comme la plus crédible ».34
Bakthine, sous le masque de
Volochinov, promet au contraire un modèle de lecture qui rend justice à
de telles interactions.
Le point particulier des théories de Volochinov/Bakhtine qui a re-
tenu l’attention des néomarxistes anglo-américains est la notion de
multiaccentualité. Ce concept va leur permettre de réagir aux nouvelles
conceptualisations des rapports de pouvoir émanant de penseurs de la
postmodernité tels que Michel Foucault et Jean Baudrillard. Ces der-
niers décrivent le champ du pouvoir sous le trait d’un système total—
un espace discursif qui ne permet pas de poser un geste de révolte
intégralement autonome par rapport au pouvoir lui-même.35
Au début
des années 1980, Jameson prend acte de cette vision pessimiste dans
des réflexions qui mettent l’accent sur le fait que la postmodernité se
déploie sous la forme d’une société de l’information au développement
exponentiel. Cette métamorphose technologique du champ de la culture
crée une situation qui ne semble plus permettre d’imaginer qu’une
résistance politique puisse se développer à partir d’un espace opposi-
tionnel entièrement distinct des institutions que cette même résistance
essaie de mettre en échec.36
En bref, la postmodernité semble neutralis-
er tout sujet oppositionnel. Si ce présupposé s’avère exact, il reste
cependant possible de recourir à la stratégie déjà esquissée par Jameson
lui-même dans « Reification and Utopia » : développer une forme de
résistance culturelle sur base de la polyphonie discursive. Jameson écrit
donc qu’« en accord avec Bakhtine, » il faut considérer que « le dis-
cours de classe—les catégories selon lesquelles des textes spécifiques
et des phénomènes culturels se retrouvent encodés—adopte une struc-
ture essentiellement dialogique ».37
Un même discours, même s’il est
partagé par l’ensemble du corps social, peut recevoir des intonations ou
des accents divers et être donc l’objet d’inflexions et d’appropriations
divergentes.
34 Stuart Hall, « The Rediscovery of ‘Ideology’ », p. 76. 35 Voir Jean Baudrillard, Simulacres et simulation, Paris, Galilée, 1981, pp. 30-36;
Michel Foucault, Histoire de la sexualité, 1 : La volonté de savoir, Paris : Gallimard,
1976, pp. 129-30. 36 Fredric Jameson, « Reification and Utopia in Mass Culture », p. 23 ; Fredric
Jameson, Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism, Durham, Duke
University Press, 1991, pp. 37-38. 37 Fredric Jameson, « On Interpretation », The Political Unconscious: Narrative as a
Socially Symbolic Act, p. 84 ; italiques dans l’original.
Christophe Den Tandt 12
C’est aussi la conclusion vers laquelle s’achemine Stuart Hall
dans l’article cité ci-dessus : dans le système total de la société de
l’information, écrit Hall, « la lutte se manifeste sous forme d’une
différence dans l’accentuation d’un même terme ».38
Même dans cette
configuration de pouvoir défavorable, la valeur idéologique d’un terme
ou d’un discours ne peut être entièrement prescrite : « [l]es significa-
tions qui ont été très intimement associées » par le processus de conno-
tation idéologique décrite par Barthes dans Mythologies « peuvent aussi
être dissociées ».39
Dans cette version postmoderne du conflit social,
« la ‘lutte au sein du discours’ consiste précisément en ce processus
d’articulation et de désarticulation ».40
5. Multiaccentualité et subversion culturelle
Le concept de multiaccentualité n’a pas uniquement une valeur descrip-
tive dans les cultural studies anglo-américaines. En plus d’être un outil
théorique qui permet de rendre compte des mécanismes de pouvoir au
sein du discours, il joue un rôle prescriptif dans l’évaluation des pra-
tiques culturelles. Dans le champ de la culture populaire et de la culture
de masse, les théoriciens anglo-américains des années 1980 favorisent
en effet les œuvres et genres qui utilisent ce que l’on peut appeler des
stratégies de subversion postmodernes. En termes bakhtiniens, il s’agit
d’œuvres qui utilisent le dialogisme dans un but politique. Ce choix
politico-esthétique tient compte du présupposé, souvent rappelé dans
l’œuvre de Bakthine, selon lequel le discours du pouvoir réprime le
dialogisme. Stuart Hall, paraphrasant Volochinov/Bakhtine, affirme
que « [d]ans le discours dominant, les signes “multiaccentuels” sont
réduits à l’”uniaccentualité ».41
Le pouvoir se veut monologique ou
uniaccentuels. De manière plus nuancée, il conviendrait d’écrire que les
prétentions à l’uniaccentualité affichées par le discours du pouvoir ne
peuvent jamais être pleinement satisfaites. Ce dernier en est donc réduit
à camoufler sa propre multiaccentualité afin de cultiver l’apparence
d’un monologisme accompli. C’est ce que Jacques Derrida, dans une
terminologie différente, appelle le « logocentrisme ».42
Or, si le pouvoir
exige ce simulacre d’homogénéité, l’intégrité des pratiques culturelles
38 Stuart Hall, « The Rediscovery of ‘Ideology’ », p. 77. 39 Stuart Hall, « The Rediscovery of ‘Ideology’ », p. 77. 40 Stuart Hall, « The Rediscovery of ‘Ideology’ », p. 77. 41 Stuart Hall, « The Rediscovery of ‘Ideology’ », p. 77. 42 Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1967, p.
117.
Bakhtine et la postmodernité 13
doit se mesurer à leur capacité à ne pas se laisser tenter par le monolo-
gisme : elles doivent se prêter d’emblée à des appropriations multiac-
centuelles. Pour reprendre la terminologie de Barthes et de Derrida, ces
pratiques doivent s’engager dans l’esthétique du « scriptible » et de la
« différance ».43
Elles doivent favoriser ce que Kristeva appelle la
« signifiance »—la production discursive—et se prêter aux gestes
typiques de l’art postmoderne tels que la réappropriation, l’inflexion, la
recontextualisation, ou l’hybridité délibérée.44
Les cultural studies ont apporté leur contribution à ce point de la
politique culturelle du postmodernisme en soulignant que l’élaboration
de pratiques ouvertement dialogiques n’est pas l’apanage de mouve-
ments d’avant-garde élitistes : ces phénomènes peuvent apparaître dans
les genres populaires, contredisant donc le préjugé qui voit nécessaire-
ment en ces derniers des vecteurs du conservatisme et de la réification.
Parmi les auteurs qui ont le plus clairement mis en évidence la multiac-
centualité de la culture populaire, on peut citer Dick Hebdige, Henry
Louis Gates, Jr. Et Paul Gilroy . En 1979, Hebdige publia une des
premières études académiques consacrées à l’esthétique du punk rock.
La méthodologie de cet ouvrage fait la jonction entre les apports de
Volochinov/Bakthine et les théories post-structuralistes de la produc-
tion signifiante, établissant par là-même l’idée d’une affinité naturelle
entre certains développements récents de la culture populaire et
l’esthétique de la postmodernité. Hebdige discerne dans le punk un
mouvement qui ne se satisfait plus des stratégies utilisées par les sous-
cultures prolétariennes apparues en Angleterre depuis les années 1950.
Au lieu de revendiquer une authenticité prolétarienne stable comme
l’ont fait d’autres groupes tels que les Teddy Boys et les Skinheads, les
punks affichent une esthétique de rupture qui refuse de projeter une
identité claire et se contente de recycler et d’infléchir de manière
ironique les signifiants des styles pré-existants.45
Par exemple, au grand
dam des fans de rock plus âgés, les punks se composent un style ves-
timentaire mélangeant les symboles anciens (coiffures des années
1950) et des éléments jusqu’alors marginaux dans la culture rock
(attirail fétichiste et sado-masochiste tiré des sex shops). Selon Hebdi-
ge, ce geste, perçu par de nombreux fans comme une désacralisation,
43 Roland Barthes, S/Z, p. 10 ; Jacques Derrida, La voix et le phénomène: Introduc-
tion au problème du signe dans la phénoménologie de Husserl, Paris, Presses
Universitaires de France, 1967, p. 92. 44 Julia Kristeva, op. cit., p. 11. 45 Dick Hebdige, Subculture: The Meaning of Style, London, Methuen, 1979, p. 121.
Christophe Den Tandt 14
ne marque pas un simple changement de contenu ; il n’est pas compa-
rable, par exemple, à la différence entre le style des rockers des années
1950 et celui des hippies de la fin des années 1960. Il s’agit au contraire
d’une métamorphose structurelle menant à la création d’une stratégie
de signification inédite: l’esthétique punk renonce aux revendications
d’authenticité des sous-cultures plus anciennes et adopte des pratiques
« kinétiques » et « transitives » valorisant « l’acte de transformation »
sémiotique.46
Ces gestes sont donc en parfait accord avec les processus
de « signifiance »47
décrits par Kristeva ou avec la théorie des signes
aux « accents » multiples prônée par Volochinov/Bakthine.48
Henry Louis Gates, Jr. et Paul Gilroy appliquent une méthodolo-
gie similaire à l’étude des cultures afro-américaine et afro-britannique,
indiquant ainsi comment le mélange de principes poststructuralistes et
dialogiques peut servir à élaborer une « critique noire du signe ».49
Les
cultures métissées d’origine africaine se prêtent particulièrement bien
au dialogisme car elles sont constituées de pratiques signifiantes qui se
sont développées en contact constant avec une norme dominante—la
culture eurocentrique—ou même dans les interstices de celle-ci. Une
telle configuration a nécessairement amené les acteurs culturels des
communautés d’origine africaine à s’approprier des éléments de la
culture dominante, à les recontextualiser et à les infléchir selon leur
propre besoins. C’est par ce processus, suggère Gates, que « [l]es
noirs » ont « colonisé » ce qui était au départ « un signe blanc ».50
Dans
The Signifying Monkey, Gates indique que les jeux de langage visant à
l’appropriation et la réaccentuation du discours d’un interlocuteur tirent
leur origine des personnages de tricksters du folklore africain.51
Ces
interactions discursives, de valeur ironique ou subversive, ont servi de
canevas à la culture orale afro-américaine, qui a elle-même alimenté la
littérature et la musique (jazz, blues, hip-hop). Cette culture de l’oralité
se structure autour de pratiques bien identifiées—« sounding », « signi-
fying »—dont les mécanismes semblent avoir anticipé les jeux de
46 Voir Dick Hebdige, Subculture: The Meaning of Style, p. 124. 47 Dick Hebdige, Subculture: The Meaning of Style, p. 124. 48 Dick Hebdige, Subculture: The Meaning of Style, p. 121 49 Henry Louis, Gates, Jr., The Signifying Monkey: A Theory of Afro-American
Criticism, New York, Oxford University Press, 1988, p. 48. 50 Henry Louis, Gates, Jr., The Signifying Monkey: A Theory of Afro-American
Criticism, p. 47. 51 Voir Henry Louis, Gates, Jr., The Signifying Monkey: A Theory of Afro-American
Criticism, p. 5-22.
Bakhtine et la postmodernité 15
langage des avant-gardes postmodernes.52
Dans les échanges verbaux
du « signifying », le signifié ou le contenu propositionnel du discours
du pouvoir—ce que Gates appelle la « signification »—importe
beaucoup moins que le travail du locuteur (« Signification » ou « signi-
fyin’ »), qui refaçonne le matériau emprunté en un acte de langage
inédit.53
Il en résulte un processus qui met en œuvre la multi-
accentualité bakhtinienne:
Le processus d’appropriation sémantique qui se manifeste
dans le rapport entre Signification et signification a été décrit
très justement par Mikhail Bakthine comme étant le fait d’un
mot à double voix, c’est-à-dire un mot ou un énoncé qui,
dans ce contexte, a été décolonisé selon les intérêts des noirs
« en insérant une nouvelle orientation sémantique dans un
mot qui possèdait déjà—et qui d’ailleurs conserve—sa
propre orientation »54
Une telle pratique dialogique correspond à une variante pragmatiste du
post-structuralisme, mettant en œuvre la dynamique des actes de lan-
gage. Gates souligne d’ailleurs la continuité terminologique entre
signifying et signifiance. Cette ressemblance, qu’il serait mal avisé de
traiter comme une pure coïncidence, met en lumière les affinités entre
culture afro-américaine et déconstruction.
Selon Paul Gilroy, des stratégies comparables au signifying décrit
par Gates structurent les musiques afro-américaine et afro-britannique.
L’argument au sein duquel Gilroy développe cette thèse suggère que la
culture populaire des communautés d’origine africaine essaie de contrer
les structures de pouvoir capitalistes au moyen d’une résistance de type
dialogique. La cible principale de cette résistance est l’organisation
capitaliste du temps et de l’espace.55
Pour les populations noires,
l’espace et le temps capitalistes sont des sources d’oppression non
seulement en raison de leurs caractéristiques intrinsèques, mais plus
encore par le fait que les noirs en sont souvent exclus.56
Dans ce con-
texte, les communautés d’origine africaine produisent une culture dans
laquelle le plaisir lui-même sert de stratégie de résistance. Ce plaisir
s’exprime notamment par le développement de pratiques participatives
52 Henry Louis, Gates, Jr., The Signifying Monkey, p. 81 ; italiques dans l’original. 53 Henry Louis, Gates, Jr., The Signifying Monkey, p. 50. 54 Henry Louis, Gates, Jr., The Signifying Monkey, p. 50. 55 Voir Paul Gilroy, There Ain’t No Black in the Union Jack: The Cultural Politics
of Race and Nation, 1987, London, Routledge, 1992, p. 284. 56 Voir Paul Gilroy, There Ain’t No Black in the Union Jack, p. 286.
Christophe Den Tandt 16
qui s’emparent des produits de l’idéologie blanche et de l’industrie de
la culture et qui—comme l’écrit Gilroy, citant Bakhtine—les « car-
navalisent ».57
Cette réappropriation carnavalesque se remarque par
exemple dans la pratique des DJs afro-britanniques des années 1980,
invitant le public à des gestes de réappropriation subversive :
Des échanges hautement ritualisés entre les DJs et le public
[…] visaient à corrompre systématiquement des mots an-
glais sans valeur marquée, créant ainsi de nouvelles formes
de discours public. De manière ludique, [ces mots] étaient
dotés de significations sans rapport avec celles dont ils
étaient investis dans le discours hégémonique.58
Dans une logique très bakhtinienne, Gilroy insiste sur le fait que cette
dialogisation carnavalesque agit particulièrement par le biais des élé-
ments non-verbaux de la musique—rythme, mélodie, cris inarticulés
des chanteurs et de leur public.59
Il confirme ainsi les remarques du
théoricien soviétique concernant l’importance du paralinguistique—en
particulier le jeu de l’intonation—dans l’accentuation dialogique.60
6. Le public comme acteur dialogique
Les remarques précédentes indiquent que les pratiques dialogiques en
culture populaire prennent souvent la forme d’un droit de réponse ou
d’une participation active du public vis-à-vis du matériau qui lui est
proposé. Cet aspect du dialogisme est devenu l’objet d’une branche
spécifique des cultural studies. John Fiske, un théoricien des médias
spécialisé dans l’étude des fictions télévisuelles, en est le représentant
le plus connu. L’approche développée par Fiske est souvent qualifiée
de populisme culturel. Ce terme rend justice au fait que, contrairement
à d’autres théoriciens (y compris de nombreux néo-marxistes), Fiske
fait entièrement confiance au principe selon lequel le « peuple » n’est
pas nécessairement « dupé » par l’offre culturelle.61
Au contraire, il
affirme que « [l]e pouvoir des différents publics dans l’économie
culturelle est considérable ».62
Ce credo s’appuie sur plusieurs principes
annexes. Si l’offre de la culture de masse est dialogiquement renégo-
57 Paul Gilroy, There Ain’t No Black in the Union Jack, p. 274. 58 Paul Gilroy, There Ain’t No Black in the Union Jack, p. 261. 59 Voir Paul Gilroy, There Ain’t No Black in the Union Jack, p. 290. 60 Voir Tzvetan Todorov, op. cit., p. 193. 61 John Fiske, « The Popular Economy », 1987, in Cultural Theory and Popular
Culture: A Reader, ed. John Storey, New York, Harvester Wheatsheaf, 1994, p. 495. 62 John Fiske, « The Popular Economy », p. 499.
Bakhtine et la postmodernité 17
ciable par son public, il faut considérer que l’encodage culturel—le
pouvoir de créer des messages censés contraindre le comportement des
destinataires—a un impact moindre que ne le craignent de nombreux
critiques, qu’ils soient conservateurs ou progressistes. Donc, loin d’être
des vecteurs d’endoctrinement idéologique, « [l]es biens culturels n’ont
pas de valeur d’usage clairement définie ».63
Dans la mesure où ils
offrent un espace de liberté herméneutique, ils permettent l’apparition
de « significations et [de] plaisirs de résistance ».64
De manière prévisi-
ble, les thèses de Fiske sont souvent perçues comme l’expression d’un
optimisme aveugle : comme l’écrit le théoricien de la culture rock
Lawrence Grossberg, elles tendent à désarmer l’esprit critique et à faire
de l’expérience quotidienne le terrain d’une illusoire « rédemption
politique ».65
Fiske ne fait cependant qu’aller au bout de la logique de
la multi-accentualité : l’inflexion dialogique chez Bakthine est bien une
prérogative de liberté. Les appropriations multi-accentuelles qui en
résultent ne peuvent qu’entraîner un affaiblissement de la valeur
sémantique supposément inaliénable (ou idéologiquement manipula-
trice) de chaque énoncé. Les partisans post-structuralistes de la per-
formativité discursive—une théorie qui, nous l’avons vu, rejoint sou-
vent le dialogisme—atteignent des conclusions semblables quand ils
privilégient la force illocutoire ou perlocutoire d’un énoncé par rapport
à son contenu propositionnel. Fiske est donc fidèle à l’inspiration
bakhtinienne des cultural studies quand il place au centre même de
« l’aire […] de la représentation » le « pouvoir de construire des signi-
fications, des plaisirs et des identités sociales qui diffèrent de ce qui est
proposé par les structures dominantes ».66
L’optimisme populiste de Fiske l’amène également à privilégier
des segments de la culture de masse méprisés par beaucoup d’autres
commentateurs. Nous avons vu plus haut que les cultural studies ont
très logiquement marqué leur prédilection pour la subversion di-
alogique. Ces théoriciens ont donc encensé soit des mouvements af-
fichant des valeurs oppositionnelles explicites—sous-cultures liées à la
musique rock, mouvements féministes et queer—, soit des œuvres se
prêtant aux appropriations multi-accentuelles par le biais de la subver-
sion ironique—films noirs hollywoodien (The Big Sleep de Howard
63 John Fiske, « The Popular Economy », p. 497. 64 John Fiske, « The Popular Economy », p. 500. 65 Lawrence Grossberg, We Gotta Get Out of This Place: Popular Conservatism and
Postmodern Culture, New York, Routledge, 1992, p. 94. 66 John Fiske, « The Popular Economy », p. 502.
Christophe Den Tandt 18
Hawks [1946], Gilda de Charles Vidor [1946], The Manchurian Can-
didate de John Frankenheimer [1962]) ou films d’action postmodernes
(Terminator de James Cameron [1984], Repo Man d’Alex Cox [1984],
Robocop de Paul Verhoeven [1987],). Fiske, au contraire, s’empare de
produits qui ne semblent laisser aucune ouverture à la subversion—les
séries télévisées telles que Dallas, légitimement soupçonnées de
propager les valeurs du capitalisme américain.67
Ce choix excentrique
se justifie, selon Fiske, par le fait que de tels textes permettent paradox-
alement un degré maximal de multi-accentualité : au contraire des
productions des sous-cultures ouvertement subversives, dont le public
est par définition limité, les grands feuilletons commerciaux jouissent
d’une audience planétaire. Ils offrent donc à des publics très hété-
rogènes la possibilité d’infléchir le texte selon la logique de traditions et
de situations très diverses.68
Il n’y a donc pas, dans cette optique, de
récit-maître de Dallas, seulement un canevas renégociable dialogique-
ment. Les publics américains et européens percevront sans doute la
série comme une glorification des politiques de Ronald Reagan (et ils
l’apprécieront ou la détesteront sur cette base), tandis que les publics
des pays arabes y verront un récit interprétable selon la logique de leurs
propres normes concernant les réseaux de parenté.69
6. Le dialogisme planétaire: le postcolonialisme bakthinien
La perspective de voir une même œuvre renégociée selon un dialo-
gisme sans frontière permet une transition vers le dernier type
d’appropriation des principes de Bakhtine dont je m’entretiendrai ici—
l’élaboration d’un dialogisme planétaire—, un modèle proposé par
certains théoriciens du postcolonialisme. La personnalité qui retiendra
notre attention en la matière sera le théoricien d’origine indienne Homi
K. Bhabha. Ce dernier est l’auteur de concepts tels que le Tiers Espace,
l’hybridité, ainsi que la subversion par la mimique et l’action du présent
de l’énonciation. Il nous paraît utile de démontrer que ces termes, tous
cruciaux pour la théorie postcoloniale, sont au minimum compatible
avec le dialogisme bakhtinien, ou parfois même directement inspirés de
ce dernier.
Bhabha prend comme point de départ les changements socio-
géographiques qui ont affecté les populations depuis la Deuxième
Guerre Mondiale. La disparition des grands empire coloniaux, les flux
67 Voir John Fiske, « The Popular Economy », p. 505. 68 Voir John Fiske, « The Popular Economy », p. 505. 69 Voir John Fiske, « The Popular Economy », p. 505.
Bakhtine et la postmodernité 19
migratoires qui en ont résulté, ainsi que le développement des médias
électroniques ont jeté les bases de ce que Bhabha appelle « [l]e
‘ nouvel ’ internationalisme »:70
les cultures du présent postcolonial ne
peuvent plus s’élaborer selon une logique nationale ou continentale ;
elles émanent au contraire directement de la recomposition dé-
mographique qui caractérise la postcolonialité :
Alors qu’autrefois la transmission de traditions nationales
était le thème majeur de la littérature mondiale, nous pou-
vons peut-être suggérer que les histoires transnationales des
migrants, des colonisés ou des réfugiés politiques—ces posi-
tions liminales et interstitielles—pourraient devenir le terrain
de la littérature mondiale.71
La culture planétaire se trouve donc dans une situation de dialogisme
objectif : à l’inverse de ce qu’ont pu croire certain créateurs du passé, il
n’est plus possible d’ignorer que chaque œuvre, chaque système de
pensée, ou chaque pratique signifiante entre nécessairement en dialogue
avec des voix divergentes. Ces dernières ne s’expriment pas d’une
position d’extériorité lointaine : l’hybridisation des populations due aux
flux migratoires contemporains leur permet d’émerger en tous points—
du cœur même des sociétés qui, par le passé, pouvaient se croire cul-
turellement homogènes.
Selon Bhabha, l’ouverture au dialogisme rendu possible par ce
nouvel internationalisme postcolonial n’est pas le fruit d’une pure
coïncidence historique—la caractéristique contingente d’une seule
époque. Invoquant des raisonnements ancrés à la fois dans le poststruc-
turalisme et le dialogisme. Bhabha affirme que la conjoncture soci-
opolitique de la fin du vingtième siècle n’a fait que mettre en lumière
un mécanisme fondamental de la communication : le fait que toute
négociation culturelle implique le glissement du sujet vers l’altérité et
l’hybridisation. Selon Bhabha, la communication et l’interprétation
arrachent le locuteur et l’interlocuteur à leur illusion d’identité et les
projettent dans un « Tiers Espace » de négociation discursive :72
Le pacte d’interprétation n’est jamais simplement un acte de
communication entre le Je et le Tu désignés dans l’énoncé.
La production de la signification requiert que ces deux
espaces soient mobilisés dans le passage à travers un Tiers
Espace qui représente à la fois les conditions générales du
70 Homi K. Bhabha, The Location of Culture, London, Routledge, 1994, p. 8. 71 Homi K. Bhabha, The Location of Culture, p. 17. 72 Bhabha Homi K. Bhabha, The Location of Culture, p. 53.
Christophe Den Tandt 20
langage et l’action spécifique de l’énoncé au sein d’une stra-
tégie performative et institutionnelle de laquelle cet énoncé
ne peut être conscient « en lui-même ».73
La force qui anime cet arrachement vers le « Tiers Espace » est, selon
Bhabha, le dynamisme du « présent de l’énonciation »,74
c’est-à-dire le
devenir tel qu’il s’exprime à travers le discours dialogisé. Comme
beaucoup de théoriciens postmodernes, et comme Bakthine lui-même,
Bhabha estime de manière axiomatique que ce mouvement du discours
et de l’expérience est porteur d’une promesse d’émancipation : le
processus qui s’accomplit à travers les confrontations discursives, aussi
complexe et indéterminé soit-il, est une source d’espoir par le fait
même qu’il alimente un changement perpétuel.75
L’accession au Tiers
Espace par le procès de l’énonciation entraîne donc inévitablement des
pratiques de subversion :
L’énonciatif est un processus dialogique qui se manifeste par
des déplacements et des réalignements qui sont les effets
d’antagonismes et d’articulations culturels. Il subvertit ainsi
les fondements du moment hégémonique et redéploie des
sites de négotiations alternatifs hybrides.76
Dans cette optique, toute incursion dans le dialogisme pose un risque
pour le discours hégémonique. Le mécanisme de subversion du dis-
cours colonial analysé par Bhabha—la « mimique » ([mimicry])—en
offre un excellent exemple.77
Bhabha indique que les efforts accomplis
par les sujets colonisés afin d’imiter les normes culturelles des colo-
nisateurs produisent inévitablement des pratiques subversives. La
mimique, qui se voudrait copie parfaite, est emportée par le dynamisme
dialogique du présent énonciatif et devient une réplique déplacée,
moqueuse. Pour reprendre le vocabulaire de la multiaccentualité, la
mimique constitue ce que Stuart Hall, paraphrasant Volochi-
nov/Bakthine, appelle « une accentuation différente d’un terme iden-
tique », et elle amorce par là-même un mouvement de résistance.78
73 Homi K. Bhabha, The Location of Culture, p. 53. 74 Homi K. Bhabha, The Location of Culture, p. 266. 75 Voir Homi K. Bhabha, The Location of Culture, p. 38-39. 76 Homi K. Bhabha, The Location of Culture, p. 255. 77 Homi K. Bhabha, The Location of Culture, p. 121. 78 Stuart Hall, « The Rediscovery of ‘Ideology’ », p. 77.
Bakhtine et la postmodernité 21
7. Conclusion
A titre d’hypothèse, on pourrait essayer d’imaginer ce que seraient
devenues la sémiologie et les cultural studies si l’œuvre de Bakhtine
n’avait jamais été découverte en Europe de l’ouest et aux Etats-Unis. Il
en serait certainement résulté un vide théorique qui aurait dû être
comblé par d’autres systèmes conceptuels. La réévaluation de
l’hybridité des genres littéraires et culturels aurait pu se faire unique-
ment sur base des théories de la différance. De même, il est probable
que les théories de la performativité et des actes de langages auraient
été les seuls moyens disponibles pour modéliser les interactions social-
es au sein du discours. C’est d’ailleurs de cette manière que, dans
l’histoire réelle de la théorie de la fin du vingtième siècle, ces théories
ont été utilisées par des auteurs tels que Foucault et Judith Butler. Ce
qui aurait cependant manqué—et ce qui constitue donc la spécificité de
l’œuvre de Bakhtine—, ç’aurait été la dimension inéluctablement
sociale que confèrent aux échanges dialogique les analyses du
théoricien soviétique. Sans s’appesantir sur la question complexe des
liens entre Bakhtine et le marxisme (les accents marxistes de certains
de ses textes sont-ils de pures concessions à la censure ? Sont-ils la
marque spécifique de Volochinov ou Medvedev ?), il faut rendre
justice au fait que la terminologie de base des écrits bakhtiniens permet
une modélisation des échanges discursifs plus concrète que ce que
n’auraient permis les théories du discours disponibles hors de son
œuvre. Julia Kristeva a fait la remarque très juste que les choix lexicaux
de Bakthine—sa prédilection pour des termes concrets, mais manquant
souvent de spécificité—est paradoxalement un atout méthodologique :
cette « démarche naïve » donne un contour perceptible à des processus
qui auraient paru incompréhensibles dans une terminologie plus af-
finée.79
Cette remarque s’applique en particulier à l’utilisation bakhti-
nienne du terme « voix ».80
Ce mot suggère à la fois une capacité
transposable à travers les échanges dialogiques, mais aussi l’ancrage du
discours dans des personnes et des groupes sociaux. Cette double
attention à l’autonomie du discours et à son inscription sociale est sans
doute le legs le plus précieux de Bakhtine à la théorie de la culture de la
fin du vingtième siècle.
79 Julia Kristeva, p. 111. 80 Mikhaïl Bakthine, La poétique de Dostoïeski, p. 256.