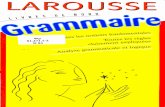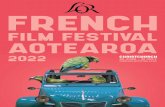Expression française et ouverture sur le monde - Fortrainjobs
« L'École française d'Athènes et la Délégation archéologique française en Afghanistan :...
Transcript of « L'École française d'Athènes et la Délégation archéologique française en Afghanistan :...
H 1 s T o 1 R
Sous la direction deCorinne BONNET, Véronique KRINGS et Catherine VALENTI
E
Connaître l'AntiquitéIndîviâus, réseaux, stratégies
du XVIIIe aUXXIe siècle
PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES
·CÉcole française d'Athènes et la Délégationarchéologique française en Afghanistan:
hellénistes et indianistes unis pour une même cause(1922-1924)
Annick FENET
13 mars 1922: l'indianiste Alfred Foucher, accompagné de son épouse,franchit la frontière perso-afghane où il est accueilli par une délégation del'émir Amamùlah. Six mois plus tard, il signe à Kaboul pour le gouverne-ment français une convention archéologique qu'il a lui-même négociée,accordant à la France l'exclusivité des fouilles en Mghanistan pour unedurée de 30 ans. Entre temps, le 28 avril, les deux pays ont égalementconclu un accord de représentation diplomatique réciproque, aboutissantà l'installation de la première légation française dans la capitale afghane le16 septembre 1923, encore aidée par le savant avanfson départ longtempsretardé pour le site de Bactres qu'il va explorer jusqu'à l'été 1925.
Cette période de 1922-1923 voit ainsi naitre, intimement mêlés, à lafois des accords privilégiés entre Paris et Kaboul et une mission archéolo-gique française, bientôt désignée, à l'instar de son modèle perse, commeDélégation archéologique française en Afghanistan (DAFA). Si l'impulsionen avait été donnée par Philippe Berthelot, secrétaire général du ministèredes .A:ffairesétrangères en mars 1921, la concrétisation de ces projets s'estfaite après sa mise à l'écart des affaires politiques en fin décembre de lamême année. Or, l'examen détaillé des circonstances qui ont entouré cesrelations franco-afghanes révèle la part prise par des hommes de science,impliqués dans leur siècle: des orientalistes bien sûr - au premier chefÉmile Senart, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, india-niste et mentor de Foucher, qui a soutenu activement à Paris les actions deson disciple avec lequel il menait une correspondance régulière -, mais aussides hellénistes, anciens membres ou directeurs de l'École française d'Athènes:Victor Bérard, Gaston Deschamps, Gustave Fougères, Théophile Homolle,Bernard Haussoullier. C'est cet aspect que nous souhaitons développer ici,
12l
A/I'II'lCK FE/I'ET
de façon à éclairer les liens unissant ces individus les uns aux autres et leursmotivations profondes dans le soutien d'un tel projetl.
Des actions pour une même cause
rentrée d'Alfred Foucher en Afghanistan résulte d'une conjonctureparticulière ayant permis à Ph. Berthelot d'envoyer dans le nouvel Étatindépendant, sous le couvert d'une mission scientifique, son ami de jeu-nesse qui se trouvait alors en Inde, mission que celui-ci a acceptée d'autantplus volontiers qu'il était désireux de mener des recherches en Bactriane.À son arrivée à Kaboul, l'émissaire français doit d'abord servir de conseilleren matière d'enseignement et de patrimoine avant de pouvoir se consacrerentièrement à ses recherches sur le terrain. En attendant la validation de laconvention archéologique, Foucher et Senatt se ptéoccupent de lui donnetdes assises concrètes: à la fois par l'envoi d'un premier collaborateur - ils'agit de trouver un architecte, capable d'effectuer des relevés et des plansarchéologiques, ayant une expérience de l'Orient -, l'assurance de soutiensscientifiques et politiques officiels, et de financements adaptés2• C'est dansces différents registres qu'interviennent nos cinq ,< Athéniens".
Le premier, Théophile Homolle ne ménage pas sa peine pour dénicherl'architecte susceptible de partir pour l'Afghanistan, comme en témoignent
1. Cet article fait suite à notre érude détaillée de la mission d'Alfred Fouçher en Afghanistan, corn·prenant l'édition commentée de plus de 300 lettres croisées: A. FniET, Documents d'archéologiemilitante. Lil mission d'Alfred Foucher en Afghanistan (J922-1925) (Mémoires de l'Académie desinscriptions el belles-Ierues 42), Paris, 2010; pour un aperçu général, voir J'«Avanc·propos * deP.BERKARD,ibid., p. 7·28. Nous renvoyons le lecteur à cet ouvr"@'pourdescommentaireserréfé.-rences approfondis Sur le contexte et les personnages. Ce complément d'émde sur les relations enUeles orientalisœs et les hellénistes s'appuie notamment sur l'examen de nouveaux fonds d'arcllives:à J'École française d'Athènes - où je tiens à remercier vivement Mm' Pottet·De Boe!, conservateur,et son assistant YaIllI Logelin pour m'avoir laissé toute liberté de consulter ces ensembles de docu·mentS en septembre 2009 -, au ministère des Affaires éuangères, après la réouverture de la salle delecture à l'automne 2009 (désormais à La Courneuve), et à la bibliothèque de l'Institut de France.Ces archives seront abrégées ci·après: EFA: MAE: BIF. La cotrespondance entre Fouçher et Senanesr conservée à la Socib:é asiatique de Paris, fonds Alfred Foucher; sur ces documents épistolaires,voir A. FENET,«les archives Alfred Fouçher (l865·1952) de la Société asiatique (Paris}», Anabase>7 (2008), p. 163·192; * Lettre(s) d'Ajanta ... et d'ailleurs: les çorrespondances d'Alfred Foucher.,in P.·S. FrnlOZAl", J. LOCL\ ..:'fT (éd.), Bouddhismes d'Asie. Monuments et littimtures. Journée d'étudeen hommage àAlfred Foucher (1865·1952) riunie Ü 14 décembre 2007 à l'Académie des inscriptionset beUes·lettres (pa!.ais de I1mtitut de France), Paris, 2009, p. 73·99; FB~BT,Mission Foucher, passim.Dam les extrairs de lettres retransçrits infra, les motS ou passage, suivis d'un point d'interrogationentre crochetS droits indiquent des lectures incertaines, et ceux enUe crochets droits nos restitutionsou commentaires.
2 .• I:alfaire Foucher se poursuit. Il ne manque, je crois, qu'une autorisarion télégraphique deM. Poincaré qill Oui sera?], j'espère, expédiée sous peu, pour lui pennenre de parapher une conven-tion archéologique qu'il a élaborée à Caboul et qui nous assurera le privilège de fouiller à Balch. Maisle diable est d'obtenir qu'on crouve J'argent indispensable et le çoUaboraœur idoine pour lui envoyetsans retard les moyens d'appliquer nos droits théoriques. Je crois que les Affaires Étrangères saisiromsous peu l'Académie d'une demande de concours financier. Laissez..moi compter tout particulière.ment [... ] pour [... ] obtenir dela Commission [Benoît] Garnier une aide assezlarge que possible.Nous n'avons pas eu [iU·lle temps d'aller frapper à beaucoup de portes. Là ptopos n'est pas moinsimportant que la libéralité.» lerne de Senan à Cordier datée La Pelice 2 août 1922: BIF, fondsHenri Cordier, Ms 5480, pièce 213. Balkh (ou Balch) est le nom moderne de Barues.
122
Lï!COLE FRANÇAISE D'AmÈNES_
deux lettres adressées à un ami de Senart, le sinologue Henri Cordier, enseptembre 1922. Dans la première, l'helléniste raconre:
«Mon cher confrère, J'ai été voir M. Pillet, comme je vous l'avaispromis3: je l'ai, suivant mes cpintes et à mon grand regret, trouvé en pleinspréparatifs de départ pour l'Egypte. Il a avec M. Lacau4 des engagementsfermes et à Karnak des travaux de longue haleine qui ont déjà donné desrésultats de grande importance et promettent plus encote. En dehors dugrand intérêt qu'i! y prend et de la [promesse?] qui le tient, il peut d'autantmoins quitter la place que, dans la situation présente, elle serait sans douteperdue pout la France. A son défaut, je pense à M. Viollet, architecte- c'est, si je m'en souviens bien, un des fils de notre confrère 5 - qui a faiten Perse [une mission?] archéologique et nous en a [exposé ?]les résultatsintéressants, avant la guette. Il a de l'allant, J'expérience des pays d'Orientet des voyages, l'habileté technique et [iIl.]. S'il était disposé, je crois qu'ilest tout à fait capable de donner satisfaction. Je n'ai pas ici les informationsnécessaires pour retrouver son adresse; mais la chose vous sera facile à Paris.J'ai eu occasion de le voir au moment de la précédente mission, et j'ai gardéde lui un souvenir très favorablé.})
Presque deux semaines plus tard, il précise ses informations:
«J'ai pu repérer, non sans peine, l'adresse actuelle de M. H. Violletet je viens de la communiquer à M. Senart. Ma visite a manqué, car ilétait absent de Paris jusqu'à mercredi; mais je lui ai laissé ma carte et l'aiavisé par une lettte en termes discrets de la mission qu'on désirerait luiconfier, en lui annonçant des informations plus explicites de la part deM. Senart [... F. ))
La formulation de ces deux missives montre également qu'Homolle étaitconscient du caractère opportuniste et politique des missions archéolo-giques à l'étranger, qu'elles portent sur Karnak ou l'Asie centrale. Sa «discré-tion) et l'absence de toute mention des noms d'Afghanistan ou de Foucherindiquent son degré d'implication dans un secret gardé le plus longtempspossible sur le but de la mission en cours. De fait, à cette date, le texte dela convention n'a pas encore été communiqué publiquement et les pre-miers articles de presse française ou étrangère sur la présence française enAfghanistan ne paraissent qu'au cours du premier semestre 19238• Moinsd'un mois plus tard, le problème de l'architecte est en cours de résolution,
3, En premier lieu, c'est le nom de l'archiœcte Maurice Pillet (1881-1964) qui avait été suggéré par,Homolle et Haussoullier. Cf. lerne de Senart à [Bargeton] du 23 aout 1922: MAE. Afghanistan30; lerne du même à Foucher du 29 septembre 1922, FENET, Mi;sion row:her, n" 69.
4. Pierre Lacau (1873-1963) dirige alors le Service des amiquités d·Égypte depuis 1914 O. LECU"'"(dir.]. In,titutde Franu. le stcond siècle[J895-1995), 3 t., Paris, 1999·2005: II, p_ 796).
5. Le médiéviste Paul Viollet (1840-1914), chartiste de formation. élu à I"Académie des inscriptionset belles-lettres en 1887 (ibid., II, p_ 1419)_
6. Hemi Viollet (1880-1955) a en effet déjà travaillé en 1912 en Perse sur les antiquiœs islamiques sousl"égide de la Commission de Perse, qui lui confia un an plus tard une mission devant le conduire deBagdad il Samarkand (N. CHllVALlER, La recherche archéologique franfllise au Moyen-Orient 1842-1947. Paris. 2002, p. 195 et 200·20l).
7. Lernes datées Gargenville 5 e[ 18 septembre 1922: BIF. fonds Henri Cordier, Ms 5460, pièce 157·158.
8_ h-';ET, Mission Foucher, p.122-125.
123
A.VA7CK PENET
et ce grâce encore à Homolle, si l'on en croit le mot de Senart à Cordier luidemandant de se rendre au ministère des Affaires étrangères pour obtenirdes informations à ce sujet: "D'après les nouvelles de Homolle tout semble-rait arrangé pour Foucher, et il n'y aurait plus qu'à faire partir l'architecte.Je n'ai pas cependant reçu de Viollet confirmation de la chose, et j'aime-rais savoir ce qui est réellement et désormais assuré9.») C'est finalementl'associé d'Henri Viollet, André Godard -le futur directeur du Servicedes Antiquités iraniennes - qui se rend en Afghanistan avec son épouse enjanvier 192310•
Parallèlement, Senart s'active auprès des ministères et de l'Académiepour faire reconnaître la mission archéologique et lui accorder un avenir, àla manière de celles menées dans d'autres régions de la Méditerranéell. Ilobtient satisfaction à la fin de décembre 1922, ce dont se félicite Gaston deBar, chef du bureau à la Direction de l'enseignement supérietu:
«Je reçois à l'instant une lettre du 26 [de l'académie] des Inscriptions[et belles-lettres]qui nous transmet un rapport Pdliot fajt au nom de laCom[missi]onquevoussavezet dom l'acad[émliea adopté lesconclusions.Ellea décidé à l'unanimité d'accepter en principe d'assumer la Directionscientifique de la mission permanente projetée et propose au choix duMinistre pour fairepartie de la Com[missi]onadm[inistrati]vequi seraitinstituée au M[inist]èreMM. Senart, HaussouHier,Cordier et Pelliot12.»
Outre Bernard Haussoullier, un second helléniste intègre la Commissiond'Afghanistan, dont la première réunion se tient le 8 mars 1923: GustaveFougères 13. Par ailletus, dès le 8 juillet 1922, un projet de loi visant à lacréation d'une légation française à Kaboul est déposé à la Chambre desdéputés. Il est appuyé fermement par un premier rapport de l'anthropolo-gue et homme politique Louis Marin (1871-1960) 14, avant de recevoir lesoutien affirmé du député Gaston Deschamps, rapportetu de la commis-sion des Affaires Étrangères (infra, doc. 1). Soumis ensuite à l'approbationdu Sénat, le projet de loi suscite encore une intervention enflammée deVictor Bérard le 23 février 1923, à la suite de laquelle il est voté à l'unani-mité (infra, doc. 2). Si, dans les trois cas, la mission Foucher est clairementévoquée, Gaston Deschamps et Victor Bérard la placent pour ainsi dire au
9. Lettre de Senart ilCordier datée La Pdice 10 octobre 1922: BIF. fonds Henri Cordier. Ms 5480.pièce 219. À rapprocher des lettres de Senan à Foucher des 29 septembre et 30 octobre 1922(FENET,Mission Foucher. n" 69·70).
JO. Sur A. Godard, voir! LECLAKT,Second Siècle. III. p. 295; t:. GRk,<-AYMERlCa. Dictionnaire bio-graphiqlU d'archéolOgie 1798·l945, Paris, 2001, p. 303-306; A. PARROT,.And,é Godard (1881-1965) >. Syria 43 (1966). p. 157-158.
11. Sur les commissions archéologiques: CHEVALIER, &cherche M.-O., p. 450-452.12. Leme à Foucher du 26 décembre 1922. corroborant la version écrite la veille par Senart (FENET.
Misrion Foucher. respec!. n~ 80 et 79).13. Lettre de Senart à Foucher du 8 mars 1923 (ibid" n° 93).14. LEClANT, Second Siècle. lI. p. 953-954 e, FENET.Mission Foucher. p. 69-72 et n° 72, avec
bibliographies.
124
L'ÉCOLE FRANÇAISE D'ATHtNES.,.
cœur du projet, comme si c'est d'elle dont on débattait dans les Chambresplutôt que d'une nouvelle représentation diplomatique 15.
Foucher et Senart s'efforcent de trouver à Paris des fonds pour les pros-pections et les fouilles du site de Bactres, où l'indianiste s'installe dansles premiers jours de 1924. Les 25000 francs accordés par l'Académie enaoût 192216 marquent les débuts d'un financement composite, où l'on sol-licite ministères, institutions, sociétés savantes et personnes privées.
La première réunion de la Commission d'Afghanistan a été suivie, dansla même journée, d'une séance de la Commission des voyages et missionsscientifiques et littéraires, dépendant du ministère de l'Instruction publique.Celle-ci décide, avec le soutien de son président Homolle et sur proposi-tion d'Alfred Coville, directeur de l'Enseignement supérieur, d'octroyer25000 francs à la mission Foucher. Ce financement extraordinaire est prissur les crédits accordés aux {(travaux d'Asie occidentale \7», c'est-à-dire àceux dont aurait dû bénéficier l'École française d'Athènes pour des recher-ches en Turquie, notamment à Notion 18. Lors d'une nouvelle séance tenuele 17 octobte 1923, la Commission des voyages vote un financement sup-plémentaire de Il 000 francs pour la mission afghane, décision appuyée parCoville, Haussoullier et Homolle 19.
Ernest Babelon (1854-1924)2°, président de la Société française desfouilles archéologiques, offre par ailleurs 20000 francs à la Mission archéo-logique en Afghanistan21, somme portée à 30000 francs quelques moisplus tard alors que T. Homolle vient de succéder au numismate à la têtede la compagniel2. Senart ne manque pas de faire part de ces nouvelles auprincipal intéressé; « Il y en aura de tristes, notamment la mort du pauvreBabelon. Il a été remplacé à la tête de la Société des Fouilles par Homollequi se montre pour votre entreprise plein du zèle le plus empressé et le plusraisonnable. Je n'ai pas d'appui plus actif B.» De même, aux obsèques de
15. Celle-ci ne deviem effeçriye qu'en seprembre 1923, aveç l'arrivée du minime Maurice Fouchetà Kaboul, accompagné des autres membres de la légation. Cette installation tardive explique enpartie le déparr sans cesse repoussé de Foucher pour la Bactriane.
16. Lettres de Senart e[ de R. Cagnat des 26 août 1922 et 11 avril 1923 (ibid., n'" 59, 99); Archivesde l'Acad&nie des lBL, Fondation Benoit Garnier, dossier IJ6. mission Foucher 1922».
17. FnŒT, Mùsion Foucher, n° 94. On notera également que Haussou!!ier, membre de la Commission,assistai! à çette séance où fut« adopt[œ], sanS observation, la proposition».
18. Au printemps 1922, la commi,sion avait anribué à Charles Picard, directeur de l'EFA. 15000 Fpour effectuer des sondages à Phocée et 20 000 F pour mener des recherche, à Notion (EFA,A. S. 1- 1907-1927, dossier •Correspondance 1914-1922), !cmes de Homolle et de CoviHe àPicard des 28 et 30 mars 1922; Archives nationales, F1l7fln43. Malgré ses efforts, ce dernier
, n'obtint pas les autorisadons de /Ouilles escomptées, C VALE"""TI, L'École frllnçllise d'Athènes, Paris,2006, p. 107.
19. fJJ)<ET, Mission Faucher, n° 129.
20. Également directeur du Cabine[ des médailles el membre de l'Açadémie des inscriptions et belles-lettres (LEÇLANT,Second siècle, l, p. 51-52).
21. Bulletin de la Sociitéfomçaise tk fou;lks archéahgiquts V; 1923-1924, p. 36 (séance du 20 novembre1923) et VI, 1924-1925, p. 45; fJJNET, Mission Foucher, n° 134.
22. Lors de la ,êançe du 18 mars 1924 (Bulletin de la sodfté jran(aise de,fouilles a,.,:héoWgiques6 (1924-1925], p. 51). E. Babelon décède le 3 janvier 1924; Homolle est élu pré,idenr Je 29 janvier etdécède à son tour le 13 juin 1925. En remerciement, Foucher écrit une lettte-tappon a ce dernier,publiée dans le Bulletin de la Société (ibid., p. 65-66 et 71-80).
23. fJJIŒT, Mission Faucher, n° 166.
125
ANJ\.7CK FENET
ce dernier, Jules Toutain, secrétaire général du club, revient sur son impli-cation: « Si courte, hélas! qu'ait été pour nous sa présidence, elle resteramarquée dans l'histoire de notre Société par le concours que nous avonsdonné, sous son inspiration, à l'exploration archéologique de l'Albanie, dela Syrie, de l'Afghanistan.»
C'est ainsi que dans sa lettre du 6 février 1924, Senart peut se réjouirauprès de Foucher: "Il vous fera plaisir de savoir que parmi les plus [empres-sés~] pour votre œuvre (je peux vous signaler?] Homolle, Haussoullier,Fougères à l'Académie, Marx aux Affaires étrangères, Marin à la Chambreet, je pense, Doumer, et [ill.] 24 au Sénat ... Ce n'est pas un dénombrementexhaustif, croyez-le. Coville est lui aussi très bien Z,.),
Réseaux scientifiques
Cette implication des hellénistes en faveur de la mission Foucher s'ins-crit dans des réseaux de sociabilité croisés. Du côté d'Émile Senart (1847-1928), sanskritiste et spécialiste du bouddhisme, elle relève essentiellementde t'Académie, à laquelle il appartient depuis 1882 - soit une quarantained'années - et dont il cannait tous les membres et tous les rouages. Il a ainsidéjà promu devant l'institution l'École française d'Extrême-Orient depuissa création (1898, 1901), la mission de Paul Pelliot en Asie centrale (1906-1908) ou encore le premier voyage de Foucher en Inde (1895-1897)26.Son expérience lui permet de donner ce conseil à son disciple: "Il va sansdire qu'une des préoccupations doit être d'entretenir la bonne volonté del'Académie qui, sur la proposition du ministre, a accepté le patronage scien-tifique de votre entreprise, et particulièrement de Ratter la [passion~) del'archéologie hellénique qui est un élément puissant sur lequel nous avonsbesoin d'appuyer la faiblesse congénitale de l'orientalisme27.»
Son cadet d'un an, Théophile Homolle (1848-1925), confrère académi-cien depuis 189228, représente sans nul doute pour lui une vieille connais-sance. Ils ont travaillé ensemble à l'Union académique internationale, crééeen 1919 par les Français afin d'établir des liens entre les savants des Étatsalliés29• Il fait partie des convives présents au cliner organisé par Senart chez
24. Jean Marx (J884-1972), chartiste et ancien membre de l'École française de Rome, travaille auService des œuvres au minisrère des Affaires étrangères depuis 1920, cf. E BAR,.Jean Marx (1884·1972)", EPHE V' section. Annuaire lXXX·LXXXI, 2, 1972·73 et 1973·74, p. 45·46. L'anciengouverneur de l'Indochine Paul Doumer (l857·1932), furur président de la République, occupealors un siège de sénateur depuis 1912, cf. J. JOUY (dir.), Dictionnaire de,parlementaires français.Notices biogMphique, rur les ministres, ,énatcurs et députés français de 1889à 1940, Paris, 8 voL,1%0·1977, IV, p. 1473-1476. Pour le dernier nom, il s'agit peu,·être d' [Albert] Lebrun (1871-1950), président fOndateur de l'Académie des sdençes coloniales, sénateur et ancien ministre desColonies.
25. FENET, Mission Foucher, n° 144.26. Sur Senarr, voir LECUNT, Second Siècle, II, p. 1308·1309 e[ FENET,Misswn Foucher, spéc. p. 52·54
e[ 62·82, aveç bibliographie.27. Ibid., n° 93 (avec commentaire SUt les proportions des académiciens par spécialité).28. LECLA-'IT, Second Siick, l, p. 667·668; GRA-,,·AYMEIUCH, Dictionnaire, p. 347·348.29. R. C'LGNAT, ,Notice sur la vie et les trawlIX de M. Théophile Homolle., CRAf 1927, p_ 2%·313:
p.311·312.
126
LÉCOLE FRANÇAISE D'ATH.ENE5.
lui le 6 mars 1923 en l'honneur du ministre afghan à ParisMahmoud Tarzi30•Directeur de l'École française d'Athènes de 1890-1903 et de 1912-1913,responsable des grandes fouilles de Delphes3! dont il a obtenu la concessionet à l'origine de 1'«extension du périmètre des voyages})des Athéniens3z,Homolle ne peut être qu'intéressé par les promesses du mythique site deBactres. Bernard Haussoullier (1853-1926), Athénien de 1876 à 1880,membre de l'Académie depuis 190533, y c6toie en particulier Senart ausein de diverses commissions34. Les deux hommes appartiennent égalementen 1922 à la Commission de Syrie et Palestine, auprès du ministère del'Instruction publique35• Ils partagent de SlUCIOÎtune même amitié pOlUleurconfrère Henri Cotdier (1849-1925) 36, spécialiste de la Chine ancienne. Lacorrespondance de celui-ci atteste ainsi de l'intérêt des trois septuagénairespOlUla mission Foucher: dans une lettre datée du 12 mai 1923, l'helléniste,qui résume la séance de l'Académie de la veille à laquelle le sinologue n'a puassister,précise qu'elle a offert «deux lectures forr intéressantes, [la première]de Senart sur l'œuvre de Foucher en Afghanistan 37». En revanche l'indianistene connaît peut-être Gustave Fougères (1863-1927) que depuis une daterécente, puisque celui-ci vient d'être élu le 12 mai 1922 au fauteuil de LéonHeuzey38. L'ancien fouilleur de Mantinée apprécie du moins la valeur duJournal asiatique, la revue de la Société asiatique que Senart préside depuis1908, puisqu'à la fin de la guerre, il en réclame les volumes manquants àla bibliothèque de l'École39• On notera enfin que les quatre académicienspartagent la même passion de l'épigraphie.
La manière dont Senart évoque ces personnages dans sa correspon-dance avec Foucher semble indiquer que ce dernier les connaît également.En effet, celui-ci, âgé de 57 ans en 1922, tient si l'on peut dire sa placeparmi le cercle académique et scientifique parisien. D'origine bretonne,il intègre le lycée Henri-IV en 1881 - où il se lie d'amitié avec le jeunePh. Berthelot - puis l'École normale supérieure en 1885. Après des étudesde sanskrit à l'École pratique des hautes-études, il y enseigne à la V"section
30. FL"!El',Mi«im' Fouche~, n° 93.31. D. MULLlEZ, "Delphi, the es:cavation of the great oracular centre (1892)>>,;n Grellt nwment< in
greek archaeofogy, Athènes, 2007. p. 134-157; Collectif, La redécouverte de Delphes, Paris, 1992.32. G. RADEr, L'hirtaire et l'œmore de ttcok fiançaise d'Athènes, Paris, 1901, p. 228-229 et 489.33. LECLA~J, Second Siècle, l, p. 642-643.34. Notamment la Commissioo Benoit Garoier en 1919, qui voit Une bourse octroyée à Foucher en
Inde (GRAf1918, p. 504 et 1919, p. 43), ou encore la Commission des travauxllttéraires en 1923(GRAf 1922, p. 437).
35. CaEVALlER, Recherche M.-O., p. 454.36. Henri Cordier, ditecteur·fondateur de la rc>"UeT'oung Pao et ameur d'une considérable bibüogra-
phie, professeur à l'École des langues orientales, a éré élu à l'Académie en 1908 (LECLANT,SecondSiècle, l, p. 319; É. SENART,Journal asiatique 206 [1925], p. 377-378).
37. BIE fonds Henri Cordier, Ms 5459, pièce 177. Lors de celle séance, Senart a donné lecture durapport de Foucher sur Bâmiyân, déjà commencée lors de la séance du 27 avril; voir GRAf 1923,p. 187 et 196·197. La. seule lettre çonservée de Cordier à Foucher dans le fonds de la Soci':téasiatique, datée du2 mars 1919, indique par ailleurs que des liens d'amitié existaient égaIemententre eux.
38. bCLANT, Second Siècle, I, p. 516; GRAN-AYMERICH,Dictionnaire, p. 272-273.39. EFA, fonds Ch. Picard 2, 5; copies de lerues de Fougères 1913-1919, f. 311 (Ieure du 4 mars 1918
au ministère de l'InSttuction publique).
127
ANNICK FENET
l'histoire des religions de l'Inde à partÎr de 1895 et y est nommé directeurd'études en 1914; parallèlement, il enseigne à la Sorbonne depuis 1907 les«langues et littératures de l'Inde» en tant que chargé de cours puis profes-seur adjoint. De sa première mission en Inde en 1895-1897, il a ramenédes manuscrits, des monnaies et des sculptures, déposés à la Bibliothèquenationale et au Louvre, et le matériau de sa thèse de doctorat, L'art gréco-bouddhique du Gandhâra, reconnu dès sa publication comme un ouvrage deréférence40• C'est lors de ce voyage qu'il localise près de Peshawar le stupadit de Kanishka, fouillé ensuite par l'Archaeological Survey oflndia, celuiqu'évoque précisément V. Bératd lors de son intervention au Sénat commele «tombeau du Bouddha41 >1. Il a également contribué au développementde la jeune École française d'Extrême-Orient, comme directeur suppléanten 1901, puis directeur entre 1905 et 1907. Depuis un quart de siècle, sestravaux, relayéspar Senart, sont communiqués à l'Académié2: rien d'éton-nant dès lors qu'Homolle, de surcroît directeur des musées nationaux de1904 à 1911 puis administtateurdela BN depuis 1913, ne veuille favorisersa mission en Mghanistan. Haussoullier, collègue de Foucher à l'EPHE(N< section), compte comme lui parmi les trente membres fondateurs ducomité central de la Société française des fouilles archéologiques de 190443- comité auquel Homolle est venu s'agréger quelques années plus tard 44.
Les liens de Foucher avec Fougères sont plus difficiles à définit: le premierest entré à l'ENS au moment oùIe second intégrait l'École d'Athènes, etles deux hommes ne semblent pas fréquenter les mêmes sociétés savantes;de même, l'helléniste n'est arrivé à la Sorbonne qu'en 1919, succédant àMaxime Collignon à la chaire d'archéologie grecque, quand l'indianiste setrouvait déjà en Asie. On peut supposer cependant que les liens existantentre lesAthéniens eux-mêmes aient joué un certain rôle. En effet, Fougèresenttetient des relations privilégiées avec Homolle, qui est à l'origine de sanomination à la direction de l'EFA en 1913 et avec lequel il en discutelonguement avant d'accepter45; en 1902, ils ont organisé ensemble la croi-sière de 1902 de la Revue générale des sciences en Grèce46. Pat ailleurs, en1922, Haussoullier propose, pour- sa succession au sein de la commissionde Delphes, le nom de son «confrère et ami})Fougères 47. Gmplication de
40. A. FE~ET, ,[œuvre écrite d'AlfTed Foucheret d'Eugénie Bazin·Foucher. Bibliographies inédites elcommentées., in FILLlOMT,LECLANT,jOU,."ieEimch.:r,p. II-56; "Alfred Foucher (1865-1952)",ibid., p. 57·62 (chronologie). A. FOUOH'R. L'arr gréco-bouddhique du GandhJm. Étude sur lesorigines de l'influence dmsique dam l'art bouddhique de I1nde et de {'Extrême· Orient (Publicationsde l'EFEO V-VI), 2 vol. (4 fuse), Paris, 1905-1951.
41. Bulletin de la Commùsion archéologique de I1ndochine 1910, p. 8-9; Archives nationales,Hl7I17l57, dossier «Correspondance 1908-1913»; hNET, Missjon Faucher, p. 86.
42. Ibid., p. 52·54.43. BSFFA 1, 1904, p. 9-10.44. Il figure ainsi en Inl dans la liste des 29 membres du comité, avec Foucher et Haussoullier
(BSFFA IV; 1914-1922, p. 7-8).45. EFA, fonds Ch. Picard 2, 2: carnel noir [de Fougères] 10 avrû 1913·25 juin 1913.46. H. YLŒüt,,"MIS, 1.Roy, La Grèce. La croisière des savOflts 1896-1912, Athènes-Paris, 1998, p. 18·19.47. EFA. fonds Ch. Picard 3, 4: correspondance de POIrier 1919-1923, cane de Haussoullier du
17 décembre 1922.
128
l'ÉCOLE FRANÇAiSE D'ATHÈNES ...
ses deux aînés académiciens a pu ainsi influer sur le soutien manifesté parFougères à la mission afghane, de la même façon que ce dernier a pu enga-ger ses amis Athéniens Deschamps et Bérard à agir à leur niveau politique.C'est que Fougères et Deschamps appartiennent à la même promotion1885 de l'EFA48; leur attachement se manifeste par exemple en 1913 lors-que, avant son départ pour la Grèce, le nouveau directeur dîne chez soncamarade qu'il a encore la joie d'accueillir à Athènes un mois plus tardpour un séjour de presque deux semaines 49. Victor Bérard (1864-1931)les a fréquentés à l'École en 1887-1888; il a en particulier, de concert avecFougères, fouillé à Mantinée en 1888 et au printemps 1889 accompli unvoyage archéologique en Carie, Lycie et Pisidie occidentale 50. De son côté,il connaît vraisemblablement Foucher, son cadet d'un an à l'ENS, qui estdepuis devenu son collègue à l'EPHE51, sans compter qu'ils ont pour amicommun Philippe-Ernest Legrand, Athénien de la promotion 1889.
Toutes ces liaisons sociales ne doivent pas occulter le fait que les quarreplus jeunes hellénistes qui soutiennent la mission afghane sont scienti-fiquement intéressés pat les études orientales. Ils ont parcouru eux-mê-mes l'Asie Mineure durant leurs années de membres de l'EFA, y ontmené des prospections ou des fouilles 52 - tel Haussoullier à Didymes(1895-1896) 53 -, pratiquant l'archéologie de terrain, «militante» ou d'ex-ploration comme aiment à le désigner Senart et Foucher54• Pour sa partGaston Deschamps (1861-1931)55, en tournée sur le littoral carien en 1886,y découvre la «(lettrede Darius56». Leurs travaux et publications témoignentde leur attrait pour le Proche-Orient et mettent en évidence les liens entrel'antiquité classique et l'orientalisme: ainsi Fougères au détour d'un guidede la Grèce57 ou au moyen d'une synthèse historique 58, Deschamps par ses
48. RAm'T, Hi;-wire, p. 247, 453.49. EFA, fonds Ch. Picard 2, 2: carnet noir (de Fougères], aux dales des 7 [mai] et 5-18 juin 1913.50. RADET,Histoire, p. 290-291 et 367-368.51. P JAMOT,"Bérard (Vktor) ", Annuaire tk l'Associdtùm amicale de ,ecou"de,ancienr élèves tk l'ENS,
1931, p. 54-57; JOLY,Dictionnaire, IIp. 545. Il enseigne la géographie ancienne à la IV' section.On notera qu'en 1919, il a présenté en vain Sa candidarure à lasucœssion de Fougères au poste dedirecteur de l'EFA (EFA, fonds Ch. Picard 2, 3, ensemble" Cavenir de l'École d'Athènes _).
52. Énumérarion détaillée dam RAnET,Hiswire, p. 351-372.53. CHEVALIER,Recherche M.-O., p. 91-92; C. LE RoY,« CEFAet l'Asie Mineure>;-,BCH 120 (19%)
(n' spécial cent-cinquantenaire), p. 373-387: 376.54. FE-"ŒT,Mùwn Foucher, p. 107,234 et 385.55. Normalien de la promotion 1882, Gaston Deschamps se trouve au début des années 1920 pro-
fesseur au Collège de France, député des Deux-Sèvres (1919-1924), écrivain et publiciste reconuuen France et à l'éuanger GOLY,DictionlUlire, IV; p. 1404-1405; P.]A."1:0T,«Deschamps [Gaston] >,
Anmwire de l'Association amicale de ,ecours de, ancien; i/ève, de l'École normale supirieure 1933,p.49-53).
56. RADET,Histoire, p. 211 et 365; G. DESCa.•..."1:PS,Sur les routes tk l'Asie, Paris, 1894.57. G. FOUGÈRES,Grèce, Paris, 2' éd. revue, 1911, p. XLVII-LV(mention del'«expédltion d'A1exandte dans
leslndes,); p. LlQHes conquêtes d'Alexandre provoquent la diffusion de l'hellénisme en Orient. [... ]À l'époque romaine, extension de l'art grec en Italie et dans le monde romain, en Extrême-Orient,jusqu'en Chine et au Japon par le lhihet, jusqu'à Sumatra par l'Inde et le Cambodge.}.
58. [ouvrage co-signé par G. FOUGÈRES,G. CONTENAU,R. GROUSSET,P. JOUQUET,J. LESQUlER,Le, premières civilisations (coll. Peuples et chilisations. Histoire générale n, 1926,2' éd. revue1929, traire aimi de l'Égypte, de la Mésopotamie, la Grèce et le Proche-Orient depuis les tempspréhislOdques jusqu'au "T siède av.].-c.
129
ANNICK pn,TT
collaborations avec Jacques de Morgan 59, ou Haussoullier par ses étudesdes inscriptions de Sardes et de Syriéo.
Pour en terminer sur les rapports des principaux promoteurs pari-siens de la mission afghane, on notera que l'octroi à celle-ci par Covilledes crédits prévus originellement pour l'EFA s'explique peut-être aussien partie par les relations difficiles qui semblent s'être instaurées entre cedernier et Charles Picard, le nouveau directeur de l'EFA. Le directeur del'Enseignement supérieur juge ainsi l'helléniste ({toujours craintif»: «Aumoindre retard du budget, il crie qu'on l'abandonne et qu'on le dépouille.Je voudrais bien pouvoir l'inviter à suivre les débats parlementaires»);bref, «ce jeune directeur est terriblement fonctionnaire61». De son côté,l'Athénien n'a pas gardé bonne impression de leur première rencontre: <1Le19 fév. 19, reçu par M. Coville [... ] qui me dit: "Nous n'avons pas besoind'archéologues." Dans la même séance j'apprends la formation d'un comité[sic] d'As[ie] Min[eure] (où l'on a mis M. Senart, président [du Comité] del'Asie fIrançai]se, Cagnat, et Sartiaux comme secrétaire]. Ni le D[irecreu]rde l'École, ni Foucart, Haussoullier et les hellénistes de l'Ac[adémie] n'ensont, ni même n'ont été consultés. [... ] M. C. incompétent, nouveau, nepouvait pas faire autre chose: il n'a pas voulu être conseillé [... ]6].» On auracompris que Coville, en revanche, entretient d'excellentes relations avecSenart et Foucher, avec lesquels il collabore depuis plusieurs années63.
Hellénisme et inHuence franfaise
Au-delà des réseaux et de l'intérêt pour l'archéologie orientale, d'autresmotifs expliquent l'engagement des hellénistes en faveur d'une missionfrançaise en Mghanistan. Dans un contexte de l'après Première Guertemondiale, ce projet s'insère à la fois dans une revendication de la sciencefrançaise, notamment face à la concurrence allemande, et dans une visioncivilisatrice et humaniste revendiquant les valeurs classiques. Dans l'espritde ces Athéniens, il participe ainsi de leur vision de l'hellénismé4 et del'influence que la France se doit d'étendre à l'étranger. Leurs propres expé-rience et implication des trois dernières décennies les conduisent tout natu-rellement à se montrer favorables à l'œuvre de Foucher en Asie centrale, qui
59. Mémoires de la Délégaüon archéologique en Perse VII, 1905, où son nom apparalt parmi lesauteurs comme "professeur à !'EPHE».
60. GRAl<-AYMERlCH,Diction",,;re, p. 330.61. EFA. fonds Ch. Picard 3, 4: correspondance de Ponier 1919-1923, lettre de Covîlle du 27 février
1921.62. EFA. fonds Ch. Picard 2, 3, ensemble. ravenit de l'École d'Athènes".63. Sur Coville, la commission d'Asie l\.1ineure et le Comité de l'Asie française, voit FEl<ET,Miss;an
Foucher, passim.64. Cf. les tex,es de Homo!le, Deschamps et Fougères, dans La Grèce. Confirence,faires SOUf Us auspices
de la Ligue française pour la défense des droits de l'hdlinisme, Paris, 1908, respect.« Pow:quoi nousaimons la Grèce., "rheUénisme en Tw:quie d'Asie. et" la Grè<:epittoresque: le pal" et le peuple.,p. 9-41, 79-117 e[ 121-158.
130
licou FJlAJVÇAISED'ATHÈNES ...
prépare la création d'un collège franco-afghan et d'une délégation archéo-logique française.
Homolle, directeur jusqu'au printemps 1904, estime ainsi en 1897 quel'EFA a sa part à prendre dans la «propagande nationale»; elle est depuisplusieurs décennies «une école scientifique et une école française. Nousavions trouvé notre devise complète: Pour la science, pour la patrie; à notrehistoire de montrer comment nous l'avons justifiée et nous en sommesrendus dignes65 ». C'est pourquoi il souhaite célébrer, avec le cinquante-naire de l'École, le prestige scientifique français66; de la même manière, en1922, son contemporain Senart commémore avec faste le centenaire de laSociété asiatique, glorifiant la part prise par la France dans le développe-ment de l'orientalisme internationa167• Si Homolle a, sans nul doute, avecHaussoullier, souffert d'avoir « perdu» les fouilles de Didymes en 1904 par"imprudence », au profit des Allemands, il garde cependant l'espoir de voirs'ouvrir d'autres chantiers pour les Français en Asie Mineure6S• Au terme dela guerre, Fougères revendique également les droits de l'École et de la Francesur les sites à l'Est de la mer Égée, ainsi qu'il l' écrit à Coville:
«D'autre part, je me suis occupé des questions d'après-guerre qui intéres-sent plus particulièrement l'École d'archéologie. Je vous enverrai prochai-nement un rapport sur nos droits archéologiques en Asie Mineure, sur lesconcessions de fouilles qui devraient nous être réservées et figurer dansles conventions relatives à la Turquie. L'École d'Athènes avait, autrefois,commencé sur une vaste échelle l'exploration de l'Asie Mineure. À la suitedes massacres d'Arménie, elle dut restreindre son activité dans ce sens, etse replier sur ses grands chantiers de Delphes et de Délos. Mais dès 1913,j'avais pu conclure une convention avec lesTurcs, nous accordant une parti-cipation aux fouilles ottomanes [... J 69. »
Lextension des recherches archéologiques ftançaises vers l'Est, versl'Asie centrale et l'Extrême-Orient trouve ici sa légitimité: elle n'est quele prolongement de la recherche de l'hellénisme, commencée en terre hel-lade par les Athéniens et poursuivie de l'autre côté de la mer Égée; avecl'avènement du monde moderne, il convient de suivre ses traces jusqu'enChine. Telle est la conviction profonde exprimée par Fougères quelquesannées plus tard dans la Revue des deux mondes (infra, doc. 3). Pour Bérard(doc. 2), cette quête, commencée awc l'expédition de Morée, s'est poursui-vie en Orient (Égypte, Mésopotamie et Perse). Dans les deux cas, hellénismeet orientalisme sont intimement liés, et c'est à la France qu'il revient, en tantque nation civilisée, de les avoir fait naître et de les voir continuer à vivre.
65. T. Hm.<OLLE,.rÉcole française d'Athènes», Revue de l'art ancien et moderne 1 (\897), p. 1-18 :17 et 18.
66_ V,ALEN:rI,L'HA, p. 74-77.67. Sur le centenaire: Société asiatique, Le livre du centenaire (1822-1922), Patis, 1922; Le>fltes du
Centenaire (1922), Paris, 1923; FJlNJl1',Mission Foucher, p. 61-71 et n" 46 et 47.68. EFA,A. S. 1- 1837-1904, dossier 4 (Didymes, Th. Wiegand), lettre de [HomoUeJ au millime de
l'Illstruçtion publique du 24 avril 1904 ; CHEV,ALlJlR,RechercheM.-O., p. 92-97.69. La lettre, datée Athènes 16 décembre 1918, eS! adressée à« Monsieur el cher DireneuI> (EFA,
fonds Ch. Picard 2, 5: copies de lellfes de Fougères 1913-1919, f. 357-358).
131
ANNICK FENET
La défense de l'influence française est revendiquée par ces cinq hellé-nistes, qui ont tous agi dans ce sens. C'est Homolle qui est à l'origine del'école Giffard (décret de juillet 1907), rebaptisée en 1915 "Institut d'étudesfrançaises 70,,; Deschamps participe quant à lui à l'œuvre de l'Alliance fran-çaise. Pendant la guerre, Fougères s'est particulièrement distingué en menanten Grèce des actions concertées destinées à défendre la position de la Francedans le pays et la francophonie71• Dans les rapports écrits alors, il préconiseen terme de" propagande intellecruelle et pédagogique» les créations d'écolesfrançaises (de langue, techniques, sciences ... ), d'une bibliothèque française,d'un Institut Pasteur 72. Sans parvenir à de tels résultats, il téussit cependantà promouvoir l'image de la France et la langue de Molière à Athènes etThessalonique. Comme il l'explique au ministre de France en Grèce:
« C'est au début de 1915 que j'obtins de faire reconnaître à Paris la néces-sité d'organiser en Grèce une Propagande en vue de combattre celle de nosadversaires, de renforcer les liens traditionnels d'amitié franco-helléniques,de fonder enfin des œuvres durables destinées à survivre à la guerre et àentretenir le développement de notre influence sur les divers terrains derapprochement intellectuel, moral et économique. Réduit pendant un an àtravailler dans ce sens avec des moyens [très?J limités, sans personnel, sansappui, au milieu des soucis administrarifs que l'état de guerre, et l'absencede tour collaborateur rendaient de plus en plus absorbants, je pus obtenir lepatronage de la Maison de la Presse, des subsides mensuels, la liaison avecla Légation de France [... J73.»
La Maison de la presse 74 est une structure créée par Philippe Berthelot,ami de Foucher et qui est rappelons-le à l'origine de sa mission enAfghanistan. Fougères a rencontré le diplomate en 191575 et lui a écritau moins une lettre officielle et une autre {(personnelle », dans lesquelles ille" remercie très vivement des subventions régulièrement allouées à [son]service et que la Légation [lui] transmet au début de chaque mois)l ainsique "d'avoir précisé [ses] attributions et octroyé à [son] action un carac-tère officiel 76 ". Si Fougères a vu ses intentions contrecarrées en matière depropagande, il ne nous semble pas cependant que l'opposition soit venue
70. G. M)J..w:.x. "rInstirut français d'Athènes, fils spirituel de l'École française», BCH 120 (1996).p. 69·82: 70-72.
71. J.-c. MON:r&""T."Aspects de la propagande française en Grèce pendant la Première Guerre mon-diale,., in La France et la Grècedan, la Grande Guerre. AcU"<du colloque tenu en novembre 1989 illhe<fIlWniq,œ. Thessalonique, 1992. p. 61-88: 63-66.
72. M. STAVR!~OU. «Gustave Fougères, I"EFA et la propagande en Grèce durant les années 1917-1918 >, BCH 120 (1996). p. 83·99: 91-95.
73. EFi\, fùnds Ch. Picard 2, 5: copies de lettres de Fougères 1913-1919, f. 385-386 (lettre du 2 mars1919).
74. installée rue François 1"',elle était divisée en quatre sections: diplomatique, militaire. traductionet analyse de la presse éttangère, propagande. J. BAILLOU (dir.). Les Affaires étrangères et le corp,diplomatique français, Paris. 1984,2 vol.: II. 1870-1980, p. 55 $q.
75. En témoignent une Carte de visite de Fougères ainsr que des nOIes autogmphes de Berthelot sem-ble·t-i1 prises à cette occasion - parmi lesquelles apparaît d'ailleurs le nom de G. Deschamps- (M-\E. Papiers de Ph. Berthelot [pA-AP 10]. dossier 8:. Propagande Grèce Bulgarie janv. 1915-nov. 1916,., f. 13-15).
76. Leme, datées Athènes 8 avril et 6 mai 1916: ibid.,f. 36-39.
132
LÉCOLE FRANÇAJSED'ATHtNES ..
de Philippe Berthe1ot'7. Rien ne permet d'établir s'il y a eu des échanges audébut des années 1920 entre les deux hommes à propos de l'Afghanisran,mais il convient d'insister sur l'importance accordée par Fougères commepat Foucher à l'idée de propagande et d'influence française. Par ailleurs,Fougères ne pouvait qu'adhérer en 1922 au projet d'une mission à la foisarchéologique, éducative et propagandiste menée sous la houlette d'un seulhomme, appartenant à l'élite intellectuelle: c'est ainsi qu'il définissait lui-même pour la Grèce en 1915-19161e chef idéal capable de pallier
"l'absence complète de méthode rationnelle et d'organisation. On multiplielesmissions qui opèrent sans liaison et se contre-carrent et s'ignorent. Là oùil faudrait une tête bien choisie, avec pleins pouvoirs d'agît au mieux desintérêts nationaux dans un milieu dont elle connait à fond, par une longueexpérience, les habitudes et les aspirations et les individus, il y a 3, 4 têtes:c'est un hydre, donc une chose monstrueuse. Il n'y a de vraiment efficaceet sûr que l'action persistante, adaptée au milieu avec des moyens au moinssuffisants [... ]. Mais les à-coups, les missions occasionnelles, qu'elles soientretentissantes ou occultes, font plus de mal que de bien. Il faut un chef, unseul, d'une sûreté absolue, d'une compétence indiscutable dans les chosesgrecques, et d'une indépendance d'action admise Wle fois pour toutes, avec,naturellement, obligation de justifications rigoureuses de l'emploi de sesressources. Tout autre système sera peut-être avantageux à des points de vued'intérêt privés: il sera désastreux pOUtla cause nationale78".
En guise de conclusion, nous terminerons sur ce qui pourrait constituerun autre témoignage de l'adhésion athénienne à la mission de Foucher: l'ab-sence de manifestation de dépit ou de critique de la part de Charles Picard,face à l'utilisation afghane du budget qui aurait dû lui revenir. S'il déplorede ne pas l'obrenir79, aucune mention ou allusion à ce sujet n'apparait dansles archives conservées à l'EFA relatives à cette période. Ceci s'expliquepeut-être par les positions du jeune directeur, collaborateur et conti-nuateur de l'œuvre de Fougères80, défenseur de l'"influence française»à l'étranger - face notamment à la concurrence allemande ou anglo-saxonne - et désireux d'élargir le champ d'investigation de l'hellénisme surun vaste territoire. Dans une lettre du 9 octobre 1922 au consul général deSmyrne, il écrir ainsi que
,,[ ... ] les récents événements militaires ont arrêté l'exécution du programmequi [nous?] avait été fixé de France. Le 15 mai 1922 [... ] la commission desfouilles en Asie occidentale et la commission des voyages et missions scien-
77. Analyse confuse dans MOl<~"T, Pr{}pagontu Grèce, p. 68-69, qui rejerœ laresponsahillté de la divÎ"sion sur Ph. BenhelOl. Mais les documents peuvent aussi se comprendre dam le sens de divergencesentre Briand et Berthelot, ou dans une opposition entre le MAE eI le ministère de la Guerre.
78. Lemeà FournoJ, datée Athènes 2 janvier 1916: MAE, Papiers de Ph. Berthelot (pA-Ar 10), dossier8" Propagande Grèce Bulgarie janv. 1915-nov. 1916., f. 16-19.
79. EFA, fonds Ch. Picard 3, 4: correspondance de Pottier 1919-1923, lettre de Picard du 2 avril1922.
80. Picard a occupé le premier posre de secretaire général en 1913, sous la direction de Fougères. Dansles archives, les dossiers cités sup", du fonds Picard contiennenr des documents des deux hommes,Pkard ayanr réutilisé des documenrs de son prédécesseur. Sur la continuité des deux directions,voir \C\l.El-<'TI,l'EFA, p. 105-109.
133
ANNICK FEl'ŒT
tifiques et littéraires nous avaient chargés de pratiquer, [îll.] des recherchesarchéologiques à Phocée et Notion, sur les deux chantiers qui nous furentd'ailleurs libéralement accordés par la Turquie dès 1913, et où nos travauxne doivent former qu'une suite à ceux d'avant guerre. [... ] Vous connais-sez comme moi, monsieur le consul général, l'importance qui s'attache ànos missions [iU.], il est vrai, d'ordre scientifique, mais l'intérêt français ytrouve son compte, et le développement qu'elles peuvent prendre [îll.] plusou moins exactement la part réservée à ceue influence. Avant la guerre,l'Asie mineure était devenue un chantier archéologique allemand. Depuisla guerre, l'effort anglais 81, l'effort américain, soutenus par d'importantscrédits, avaient préparé le terrain dans un autre sens, avec l'appui de la Grèce.Il est essentiel que la France marque aussi et conserve sa place82 ».
Dans l'esprit de ces hellénistes, à défaut de la Turquie, la France pouvaitainsi prendre sa revanche en Afghanistan où on lui accordait l'exclusivitéarchéologique, au nez et à la barbe des autres nations.
Choix de documents
1
Rapport de G. Deschamps présenté à la séancede la Chambre des députés le 30 novembre 1922
Messieurs,Votre Commission des affairesétrangères confirme, par un avis très favo-
rable, les propositions de votre Commission des finances sur le projet de loiportant ouverture au Ministre des Affaires étrangères des crédits nécessairesà la création d'une légation de la République en Afghanistan.
Il importe que l'Afghanistan, dont les relations extérieures avecl'Europe étaient, jusqu'ici, uniquement concentrées à la légation de laGrande-Bretagne, entretienne désormais des relations diplomatiques avecles grandes nations occidentales, notamment avec la France, amie et alliéede l'Empire britannique.
Ces relations diplomatiques seront la suite logique des excellents rap-ports qui se sont établis entre la République française et l'Afghanistan.
En effet, une tradition, aujourd'hui continuée avec un heureux succèspar M. Foucher, directeur adjoint à l'École pratique des Hautes Études, asouvent dirigé vers l'Afghanistan la sympathique curiosité de nos orienta-listes. Notre Société asiatique, association d'érudits que préside avec une
81. ÀAthènes. témoin des .concurrences éuangères., il estime même que.1a concurrence anglaise estactueUement plus dangereuse pour nous que la concurrence allemande (EFA, fonds Ch. Picard 3, 4:correspondance de Pottla: 1919-12923, lettre de Picard du 6 fénier 1921).
82. EFA, IOnds Ch. Picard 3, 1: correspondance administrarive, direçtlon Picard 1921-1925. f. 157-158; autre copie dans A S_ 1- 1907-1927. dossier ~Correspondance 1914-1922 •.
134
L'ÉCOLE FRAJllÇAlSE D'ATHÈNES .. _
grande autorité M. Senart, membre de l'Institut, a contribué, avec une rareméthode, à la connaissance de cette partie de l'Asie centrale. Le gouverne-ment afghan nous a donné un précieux témoignage de ses dispositions par-tictÙièrement amicales en autorisant M. Foucher à entreprendre des recher-ches sur l'art gréco-bouddhique, parmi les ruines de l'ancienne Bactriane,où subsistent encore de nombreuses traces du passage d'Alexandre le Grandet des princes de la dynastie macédonienne des Séleucides.
Une convention scientifique et artistique, qui est en quelque sorte leprélude des traités par où sera scellée une amitié fondée sur une croissanteréciprocité de bons offices, concède à la France, pour trente ans, le droit dechoisir ses terrains de fouilles archéologiques en Afghanistan. M. Fouchera été chargé de l'organisation de l'enseignement supérieur en Afghanistanet placé, par décision spéciale de l'émir, à la tête de l'université de Kaboul.Le gouvernement afghan manifeste le désir de voir la langue française serépandre sur tout le territoire qu'il administre, et devenir la langue adoptéepour toutes les relations internationales du pays.
Il est donc naturel que les relations amicales de l'Afghanistan avec laFrance soient consolidées par l'établissement d'une légation permanente quisera le centre de coordination de tous les efforts tentés par nos nationauxpour entrer en rapports suivis avec les populations de ce pays fertile enressources de toutes sortes, et qui sera en même temps le point d'aboutisse-ment d'une tradition de mutuelle sympathie qui déjà remonte à des tempstrès anciens. La fondation d'une Maison de France, à Kaboul répondra auxvoeux de SaMajesté Aman-Oullah- Khan, émir d'Afghanistan. La Grande-Bretagne, en nous précédant sur ce point par la création d'une légationanglaise, nous a donné un exemple qu'il faut suivre, dans l'intérêt de notrepolitique orientale et pour la propagation de notre influence dans les paysd'Orient. Une nation de 6 millions d'habitants, occupant 558000 kilo-mètres carrés, possédant des villes florissantes telles que Kaboul, Kandahar,Hérat, en rapports réguliers avec l'Inde et la Russie par un mouvementconsidérable d'importations et d'exportations, forte d'une armée perma-nente de 60000 hommes, s'ajoure ainsi à l'élite des peuples épris de civili-sation, avec lesquels la République française entretient des relations diplo-matiques. C'est pourquoi votre Commission des affairesétrangères s'associeaux conclusions de votre Commission des finances83•
83. Document parlementaire n° 5171: .Chambre des dépurés. Session de 1922. Annexe au procès-verbal de la 2' séançe du 30 novembre 1922. Avis présenté au nom de la CotlJJlJ.ission des AffiliresÉtrangères sur le projet de loi portant ouverture au Ministre des Affaires Érrangères des créditsnécessaires à lacréation d'une légation de la République enAfghanisran, par M. Gaston Deschamps(Deux-Sèvres), Député> (rapport de 3 pages). Un exemplaire de ce document est wnservé auxarchives iVL'\E(Mghanistan 5).
135
ANNICK EENET
II
Compte rendu de la séance du Sénatdu 23 février 1923 (extraits)84
Sénat - séance du 23 février 1923[...]9. - Adoption d'un projet de loi portant créant une légation en
Mghanistan.M. le président. La commission des affaires étrangères et de politique
générale des colonies et protectotats demande que soit appelée maintenant,[... lIa discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés,portant ouverture au ministre des affaires étrangètes, des crédits nécessairesà la création d'une légation de la République en Mghanistan. (... ]
Je rappelle que le projet de loi avait été renvoyé, pour avis, à la commis-sion des affairesétrangères. La commission est-elle en état de faire connaîtreses conclusions Ul
M. Reynald, rapporteur. Je demande la parole.[...]M. le président. Veuillez donner lecture de votre avis.M.le rapporteur. Messieurs, votre commission des affaires étrangères
donne à la création d'une légation en Mghanistan un avis nettement fàvo-rable. Toutes les fois qu'un État libre et indépendant tend la main à laFrance, la France a intérêt à faire le même geste et à étendre ainsi le rayonde ses relations diplomatiques. En ce qui concerne l'Afghanistan, à ce motifd'ordre général viennent se joindre des motifs particuliers d'ordre politiqueet d'ordre économique.
[...]M. Lucien Hubert, rappOrieur de la commission desfinances. La commis-
sion des finances est d'accord avec la commission des affaires étrangères surl'utilité du crédit, et elle prie le Sénat de vouloir bien l'adopter.
M Victor Bérard, prisident de la commission de l'enseignement. Jedemande la parole.
M.le président. La parole est à M. le ptésident de la commission del'enseignement dans la discussion générale.
M.le président de la commission de l'enseignement. Messieurs, vouspermettrez à votre commission de l'enseignement de recommander à votrevote le crédit que viennent vous demander votre commission des financeset votre commission des affaires étrangères.
84. Dibats parlementaire>. Sinat 1923, p. 381-382 (séance) et 384 (scrutin); aucun exemplaire de cedocument ne figure dam le, fond, d'archives relatifs aux affaires d'Afghanismn ou à la mis,ionFoucher. Le [U,e eSt reproduit ici pour information; pour des commentaires détaillés, voir fENET,MissionFoumer. n° 92.
136
LtCOLE FRANÇAISE D'ATHÈNES ...
Le rôle de la France, depuis un siècle, a toujours été d'ouvrir par cesmissions archéologiques et scientifiques les champs nouveaux que le reculde la barbarie venait offrir à la science universelle.
C'est par notre mission d'Égypte que nous avons fondé, nous français,l'égyptologie; c'est par notre mission du Péloponnèse que nous avons rou-vert les vrais chemins de l'antiquité grecque; c'est par notre mission deChaldée que nous avons fondé les sciences et lettres cunéiformes, et je n'aipas besoin de dire dans cette enceinte ce qu'a été tout à la fois la gloire et leprofit, pour la France, de notre mission de Perse. (Très bien! très bien!)
On vient de vous assurer aujourd'hui le monopole des fouilles afghanes.Parmi ces fouilles s'ouvrent celles de Bactres, et vous savezcomment, aprèsla conquête d'Alexandre, Bactres a été tout à la fois le grand marché et, onpeut dire, la grande université hellénique, par où les sciences et les arts dela Grèce se sont répandus, avec les produits de son industrie, jusqu'au plusprofond de l'Extrême-Orient.
À la tête de cette mission archéologique va se trouver l'homme que leconsensus universel, et de nos amis et de nos ennemis, considère comme lespécialiste en cesmatières, M. Foucher (Très bien! très bien!), l'homme qui,ayant trouvé le tombeau de Bouddha, a démontré que tout l'art bouddhi-que, c'est-à-dire tout l'art de l'Inde, de la Chine et même du Japon avait étéle disciple de l'un des héritiers de l'art grec. Il n'est pas douteux que, par lesfoumes de Bactres, nous arriverons à démontrer comment la vieille Europea eu jadis, sur l'Extrême-Orient le plus lointain, le même rôle de civilisationet d'adoucissement que celui que nous voulons revendiquer aujourd'hui.
Mais je vous en prie, mes chers collègues, en accordant ces crédits auGouvernement, recommandez-lui de donner à vos ouvriers scientifiques unpeu de l'argent qu'il prodigue peut-être sur d'autres chapitres. (Très bien!)
Notre mission de Perse a fait entrer au Louvre des trésors inestimables.Si nous avions à chiffrer - puisqu'il faut considérer quelquefois les cho-ses sous cet angle -les merveilles archéologiques que les Dieulafoy, les deMorgan, les Scheill [sic]et leurs successeurs ont fait entrer au Louvre, c'estpar millions et dizaines de millions que nous solderions nos bénéfices surnos frais. Il faut donc que notre mission afghane ait l'argent nécessaire, ilfaut que, dès maintenant, l'on assure à M. Foucher les crédits qui lui per-mettront d'ouvrir ces fouilles de Bactres, pour le plus grand service de lascience, mais aussi pour le plus grand renom et pour la grande utilité de laFrance dans tout l'Extrême-Orient. (Vifs applaudissements.)
[Pas d'autre intervention; vote]Nombre de votants 286Majorité absolue 144Pour 286Le Sénat a adopté.
137
ANNICK FENET
III
Le bilan de l'hellénisme dressépar G. Fougères en 1927 (extraits)85
L'École d'Athènes et J'humanisme modenu
Les humanismes commencent par la littérature et se continuent parl'archéologie. [... ] Chaque renaissance a besoin d'un passé qui soit enquelque sorte d'aujourd'hui, c'est-à-dire emprunté aux plus récentes révé-lations de l'archéologie. [... ]
Ce qui est vrai pour le temps l'est aussi pour l'espace. I..:exotismen'est pasun auxiliaire moins actif de régénération. La Grèce l'a connu de très bonneheure: elle a égyptisé, orientalisé; en art, comme en religion, elle a connuses crises de mysticisme cabirique, orphique, mithriaque; elle a éprouvé latentation de donner congé à la raison pour s'abîmer dans les révélationsd'un yoghisme éperdu. En revanche, partout où il s'est diffusé, l'hellénismea marqué son empreinte sur les confins les plus lointains. Même au-delà,en des pays où les Grecs ne pénétraient pas, l'hellénisme s'est introduit partransmissions. Nous ne sommes plus surpris de le retrouver jusqu'au pieddu Pamir dans les Bouddhas drapés à la mode ionienne, dans les bronzesde la Mongolie et de la Chine inspirés de l'art gréco-parthe et indo-scythede la Bactriane, pas plus que nous ne nous étonnons de le voir revivre enExtrême-Occident dans les poteries et la statuaire de l'Ibéries6•
De ces rapports lointains, l'humanisme compréhensif d'aujourd'hui tirela conclusion que tout ce monde antique, dans son ensemble, était régi parles mêmes lois que le monde moderne. Il n'est plus possible de s'enfermerdans le culte exclusif d'un idéal, d'un temps, d'un milieu isolé, et d'échap-per à cette impression de solidarité cosmopolite. Sans doute, dans cettecomplexité, le milieu méditerranéen nous intéresse de plus près, puisqu'ilest le berceau de notre propre civilisation. C'est à lui que l'École d'Athènesa la mission particulière de consacrer son activité essentielle [... J.
I..:Écoled'Athènes est le plus ancien de ces observatoires historiques pla-cés au centre du monde méditerranéen par la noble curiosité des conscien-ces tributaires de l'hellénisme. Mais à mesure que s'élargissait le champdes observations jusqu'aux confins extrêmes de l'hellénisme et au delà, laFrance n'a pas manqué de compléter en conséquence ses organes d'infor-mation scientifique. Successivement, l'École de Rome, filialedirecte de celled'Athènes, l'Institut du Caire, celui de Madrid, les services archéologiques
85. «Nos grandes écoles. XlI. r:École d'Athèoes ", Revue des deux montks 41 (sept.-oct. 1927),p. 543-574, p. 572-574.
86. Dans les notes préparatoires de ce passage d'abord intitulé« Les leçons de l'archéologie», Fougèresavait indiqué: «Connallre le passé n'est pas une pure satisfaction de curiosité rétrospective. Profitsactuels: 1) Lois d'évolution des styles. (... ) InSuences [il!.]: heUénisme des confins, orientalisant,égyptisant, thracisant, asianisme, ;bétisant, etc. [... ]2) Nécessité pratique des fouilles e[ des décou-vertes> (EFA, fonds Picard 2, 3, ensemble de documents .r:Êco!e d'Athènes.).
138
L'lCOlE FRANÇAISE D'ATHtNES ...
de l'Mrique du Nord (Tunisie, Algérie, Maroc), les missions et institutsde Beyrouth, de Jérusalem, de Perse, d'Afghanistan, et, jusqu'en Extrême-Orient, celui de Hanoï, ont été chargés d'étendre sm toutes les civilisationshistoriques du vieux monde l'enquête longtemps restreinte au bassin médi-terranéen. Loin d'être jalouse de ces émules et de les traiter en rivales, lamission athénienne voit, au contraire, en elles la plus éclatante justificationde sa propre utilité. Elle serait la première à souhaiter que l'encerclement duglobe par l'archéologie française fût achevée par l'installation de laboratoiresdu même genre au milieu des vieilles civilisations du Nouveau-Monde, àBuenos-Ayres ou La Plata, à Lima, à Mexico.
Le temps n'est plus où les routines combinées d'un irréalisme livresqueet d'un utilitarisme borné excluaient de la culture générale, comme autantde futilités, les révélations de l'archéologie. La connaissance approfondie dupassé se traduit par un enrichissement de la conscience moderne, et touteconquête faite en Grèce sur l'inconnu apporte une suggestion féconde à lacivilisation du présent.
139
H. 1 s ·T o 1 R
••Sous la direction de
Corinne BONNET,Véronique KruNGS et Catherine VALE~'Il
Connaître l'AntiquitéIndividus, réseaux, stratégies du XVl[le au XXIe siècle
A··.vomdes ~s, c'est avoir"du pouvoir », écrivait Hobbes en 1651. Le-tissage des liensjoue en efTetun rôle clé dans l'évolution de la vie intellectuelle et culturelle. Maisen quels tenues défmir ce rôle? Et sous quelles formes se manifeste~t-il ? Pour
l'éclairer et le comprendre; les Sciences de l'Antiquité en Europe, depuis les Lumièresjusqu'à.l'ère de l'internàute, nous offrent un observatoire privilégié.
Les travaux sur la sociabilité savante etles outils de la sociologie des réseaux permettentd'explorer les stratégies de connecti-rlté, individt,telles et collectives, personnelles et institu-tionnelles. nen ressort que le réseau tantôt capte,tant6tJdtre ;ici il propulse, là il entrave; il està la fois SOlU'ce'de prestige, d'aliénation ou de marginalisation.À travers lui, le mouvement,l'échange, le partage-des connaissances -ou, à l'inverse, le repli et le protectiounisme-lll\'estissent le champ de la_recherche scientifique. Appréhendés à tra,vers les couespou~dances, les publications, les journaux ou les polémiques, les réseaux relatifs à l'Antiquitéstructurent la production des savoÜ's et là définition de champs disciplinaires, transmet-tent des héritages et des .filiations, témoignent de ruptures et d'innovations.
Les dossiers proposés mettent en avant des pratiques professionnelles, des stratégieséditoriales ou académiques, des entreprises scientifiques, des modalités de communica-tion à l'œuvre dans les Sciences de l'Antiquité. Usfont également émerger divers individus,protagonistes d'aventuresinteUectuelles réussies ou avortées, Entre idéalisation, émula-tion, appropriation et détournement, les réseaux d'hommes et d'institutions, toujoursfaçonnés par les contextes qui les v(lient naître, fonctionner et dépérir, participent, touten promouvant la connaissance du_passé, à la construction d'ml espace intellectueleuropéen. Ce sont les contours de celui-ci que dessinent lës contributions de ce qvre.
Corinne BONl'iET estproftsseur d'histoire grecque. Véronique KRf1\'GS est maître de conférences d'his-toire romaine. Catherine' VALENTf est maître de conférences d'histoire contemporaine. A l'universÎté deToulouse ([.ITM), toûtes trois font partie de l'équipe.de nxherchePLH-ER4SME et dil secrétariat derédaction de la révue Ana~ases. Traditions et Réceptions de l'Antiquité.
Eu couverture: L'Académie de Platon, mosaïque trouvée à PomPéi,1ers. apr. l-C. (musêe archéologique national,Naples)
Publié avec le soutiende PLH-ERASME~. lI!seiU des UniY~~I!s
'" OUEST HTLHMTII)UE~'I'-v.',pur"editions-.fr
ISBN 978·2·7555·1195·418 €
_-f
j