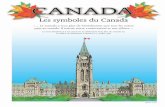Les conséquences obstétricales maternelles et néonatales du ...
Ard V., Sergent F. (2014) - Détecter les structures en creux dans les terrains calcaires du nord du...
Transcript of Ard V., Sergent F. (2014) - Détecter les structures en creux dans les terrains calcaires du nord du...
MÉTHODOLOGIE DES RECHERCHES DE TERRAIN SUR LA PRÉHISTOIRE RÉCENTE EN FRANCENOUVEAUX ACQUIS, NOUVEAUX OUTILS, 1987-2012
2014
ACTES DES PREMIÈRES RENCONTRES NORD/SUD DE PRÉHISTOIRE RÉCENTE
SOUS LA DIRECTION DE
IngrId SÉnÉPArT, CyrIlle BIllArd, FrAnçoISe BoSTyn, IvAn PrAUd, ÉrIC THIrAUlT
RENCONTRES MÉRIDIONALES DE PRÉHISTOIRE RÉCENTE INTERNÉO MARSEILLE – MAI 2012
2014
Le premier colloque de Préhistoire récente Nord/Sud intitulé Méthodologie des recherches de terrain de la Préhistoire récente en France. Nouveaux acquis, nouveaux outils, 1987-2012 s’est tenu à Marseille en mai 2012 à l’initiative des associations «Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente» et «InterNéo». Il réunissait pour la première fois une large communauté de néolithiciens du Nord et du Sud venus confronter leurs expériences de terrain et débattre de leurs pratiques.
En effet, en France, les vingt-cinq dernières années constituent, une période de bouleversement considérable pour les méthodes de recherche sur la Préhistoire récente. La mise en place des procédures d’Archéologie préventive permet aujourd’hui d’aborder la fouille des sites avec des moyens inégalés, qui conduisent à poser de nouvelles problématiques, grâce notamment à une exploitation des données sur des surfaces plus importantes et à la mise en oeuvre de nouveaux outils d’analyse.
Cette période a également été celle d’une néces-saire forme de normalisation des méthodes de fouille et surtout des méthodes de détection des sites. Pourtant, les pratiques de prospection, de recherche et d’analyse restent souvent hété-rogènes, parfois à juste titre, parfois par simple tradition régionale, parfois par méconnaissance d’expériences s’étant déroulées dans d’autres contextes géographiques. Enfin cette période est celle de la construction du dispositif complet de l’archéologie préventive, tant sur le plan admi-nistratif et juridique que sur le plan des structures opérationnelles.
Il s’agissait donc d’effectuer un « retour sur expérience » sur cette période où les occasions ont manqué de porter un regard critique sur nos pratiques de recherche, autant dans leurs succès que dans leurs échecs.
The first colloquium of Late Prehistory North/South, entitled Field Research Methods applied to Late Prehistory in France. New Knowledge, New tools, 1987-2012 took place in Marseille in May 2012 under the initiative of the associations “Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente” and “InterNéo”. For the first time, it brought together a large community of specialists of the Neolithic in the North and South to compare their experiences and debate their practices.
In France, over the last twenty-five years the field methods used in research on Late Prehistory have indeed undergone significant changes. The development of rescue archaeology procedures now enable site excavations to be carried out with previously unavailable resources, leading to the formulation of new research questions based in large part on the study of data collected over larger surface area, and the development of new analysis tools.
During this period, a necessary standardization of excavation methods and, especially, site detection methods also occurred. Nevertheless, survey, research and analysis procedures often remain heterogeneous, sometimes justifiably, sometimes according to regional traditions, and sometimes due poor knowledge of advances made in other geographic contexts. Finally, the foundations of rescue archaeology were completely during this time, both in the domains of administration and jurisdiction, and in the operational structures.
The aim of this meeting was thus to “learn from our experience” during this period when opportunities to critically assess our research practices were lacking, taking into account both their successes and their failures.
Mét
hodo
logi
e de
s rec
herc
hes d
e te
rrain
sur l
a Pr
éhist
oire
réce
nte
en Fr
ance
: nou
veau
x ac
quis,
nou
veau
x ou
tils,
1987
-201
2
Ac
tes d
es p
rem
ière
s ren
con
tres
no
rd/s
ud
/ re
nco
ntr
es m
érid
ion
Ale
s de p
réh
isto
ire r
écen
te –
inte
rnéo
/ m
Ars
eill
e – m
Ai 2
012
couv-tranche 25.indd 1 11/12/2014 09:33
1
ACTES DES PREMIÈRES RENCONTRES NORD/SUD DE PRÉHISTOIRE RÉCENTE
SOUS LA DIRECTION DE
INGRID SÉNÉPART, CYRILLE BILLARD, FRANÇOISE BOSTYN, IVAN PRAUD, ÉRIC THIRAULT
MÉTHODOLOGIE DES RECHERCHES DE TERRAIN SUR LA PRÉHISTOIRE RÉCENTE EN FRANCENOUVEAUX ACQUIS, NOUVEAUX OUTILS, 1987-2012
RENCONTRES MÉRIDIONALES DE PRÉHISTOIRE RÉCENTE INTERNÉO MARSEILLE – MAI 2012
2
Référencement conseillé de l’ouvrage :
SÉNÉPART I., BILLARD C., BOSTYN F., PRAUD I., THIRAULT É.2014 : Méthodologie des recherches de terrain sur la Préhistoire récente en France, Nouveaux acquis, nouveaux outils, 1987-2012, Actes des premières Rencontres Nord/Sud de Préhistoire récente, Marseille 23-25 mai 2012, Toulouse, Éditions Archives d’Écologie Préhistorique , 484 p.
Réalisation de la couverture et mise en page :
DANIEL BEUCHER - www.archeograph.fr
Photo de la couverture :
C. MONCHABLON, Inrap. (Carvin «La Gare d’Eau» (62).
MÉTHODOLOGIE DES RECHERCHES DE TERRAIN SUR LA PRÉHISTOIRE RÉCENTE EN FRANCENOUVEAUX ACQUIS, NOUVEAUX OUTILS, 1987-2012
ACTES DES PREMIÈRES RENCONTRES NORD/SUD DE PRÉHISTOIRE RÉCENTE
RENCONTRES MÉRIDIONALES DE PRÉHISTOIRE RÉCENTE / INTERNÉOMARSEILLE – MAI 2012
Sous la direction de :
INGRID SÉNÉPART, CYRILLE BILLARD, FRANÇOISE BOSTYN, IVAN PRAUD, ÉRIC THIRAULT
Ouvrage publié avec le concours :
Du Ministère de la Culture et de la CommunicationDe l’Institut national de recherches archéologiques préventivesDes Archives d’Écologie PréhistoriqueDes Rencontres Méridionales de Préhistoire RécenteDe l’Association InterNéo
ARCHIVES D’ÉCOLOGIE PRÉHISTORIQUE 2014
Méthodologie des recherches de terrain de la Préhistoire récente en France nouveaux acquis, nouveaux outils, 1987-2012
251
À partir de deux exemples de fouilles récentes, Bellevue à Chenommet (Charente) et Malabry à Saintes (Charente-Maritime), nous exposons les problèmes de détection des structures pré- et protohistoriques dans les terrains calcaires du nord du Bassin aquitain. L’insuffisance du seul décapage mécanique pour mettre en évidence des structures en creux dans ce type de substrat est un handicap majeur et largement sous-estimé, alors même que l’on doit optimiser la détection des structures au cours des diagnostics archéologiques.
À partir des années soixante-dix, les fouilles programmées extensives de sites d’habitat néolithiques ou protohistoriques ont pourtant montré qu’un décapage manuel du substrat, succédant au décapage mécanique, est le seul moyen efficace de détection des structures de petites dimensions comme des trous de poteaux ou des tranchées de palissade.
Sur le site néolithique de Bellevue, des décapages manuels extensifs ont permis de révéler une densité de structures insoupçonnées dans l’espace interne de l’enceinte, alors que cette zone est généralement réputée pauvre voire exempte d’aménagements conservés. L’expérience innovante d’un balayage automatisé, menée sur le site à occupations multiples de Malabry, apparaît comme une solution méthodologique facile à mettre en œuvre pour optimiser la détection des structures, tout en palliant les contraintes des décapages manuels, fastidieux et mobilisant des effectifs très importants. Ce balayage mécanisé apparaît comme un outil désormais incontournable pour les fouilles sur ce type de terrains calcaires, en particulier dans le cadre préventif.
Mots-clés : Néolithique, Protohistoire, décapage, détection, structures en creux, calcaire, fossés, trous de poteaux.
On the basis of two examples of recent excavations ; Bellevue at Chenommet (Charente) and Malabry at Saintes (Charente-Maritime), we will examine the problems of the detection of pre and protohistoric structures in the limestone terrains of the northern Aquitaine basin. The insufficient nature of a single mechanical stripping operation in revealing hollow structures in this type of substrate is a major handicap and significantly underestimated, while we must optimise the detection of structures during the process of archaeological evaluation.
From the 1970s onwards, extensive planned excavations of Neolithic or protohistoric habitation sites have, however, demonstrated that following the mechanical stripping with manual stripping of the substrate is the only efficient means of detecting small-scale structures such as postholes or palisade trenches.
On the Neolithic site of Bellevue, extensive manual stripping operations have revealed a density of structures previously unsuspected in the internal space of the enclosure, while this area is generally considered to be poor if not entirely lacking preserved indications. The innovative experiment of automated scanning carried out on the multiple occupation site of Malabry appears to be an easily-implemented methodological solution for optimising the detection of structures, while compensating for the constraints of manual stripping operations, which consume major resources in terms of both time and labour. This mechanised scanning appears to be a tool that will henceforth be essential in excavations on this type of limestone terrain, in particular in the preventive context.
Keywords : Neolithic, Protohistory, Stripping, Detection, Hollow Structures, Limestone, Ditches, Postholes.
DÉTECTER LES STRUCTURES EN CREUX DANS LES TERRAINS CALCAIRES DU NORD DU BASSIN AQUITAIN PROBLÈMES ET SOLUTIONS MÉTHODOLOGIQUES
vincent ard, Frédéric sergent
Livre 2.indb 251 20/11/2014 17:22
252
Vincent Ard, Frédéric Sergent
Les structures en creux – fosses, fossés, trous de poteaux ou encore tranchées de palissade – constituent l’un des types de structures les plus couramment découverts dans les sites d’habitat néolithiques et protohistoriques d’Europe occidentale. Dans les régions soumises à une intense érosion et aux labours profonds, à l’image de la majorité des contextes de l’Ouest de la France, ce sont généralement les seules structures conservées, les niveaux de sols préhistoriques et les structures en élévation ayant disparu au cours des millénaires. Ces creusements d’ampleur variable sont le plus souvent détectés lors du décapage à la pelle mécanique, notamment au cours des diagnostics. Il apparaît donc primordial et nécessaire de s’interroger, pour chaque type de contexte géologique, sur la qualité et la pertinence de ce décapage mécanique pour tendre vers une détection exhaustive des structures en creux conservées sur un site arasé.
Le Centre-Ouest de la France, et plus particuliè-rement les terrains calcaires de la frange septentrionale du Bassin aquitain, permettent d’aborder cette question d’ordre méthodologique, au cœur de la thématique du colloque. Nous savons, grâce aux prospections aériennes, que cette région recèle de nombreux sites néolithiques et protohistoriques. Leurs structures, creusées dans le substratum calcaire, sont en effet parfaitement lisibles depuis le ciel dans les champs cultivés du bassin de la Charente ou du pourtour du Marais poitevin. Aussi, considère-t-on traditionnellement que la détection au sol de ces structures lors du décapage est relativement aisée, du fait des contrastes supposés très marqués entre le comblement sédimentaire des structures archéologiques et le substrat calcaire, le plus souvent blanc, dans lequel elles sont creusées. En raclant la surface du substrat calcaire, la pelle mécanique devrait donc nécessairement révéler l’ensemble de ces aménagements et permettre, par exemple, de justifier la mise en œuvre ou non d’une fouille préventive suite au diagnostic.
À partir de deux exemples de fouilles récentes, l’une programmée – Bellevue à Chenommet (Charente) – et l’autre préventive – Malabry à Saintes (Charente-Maritime) – nous souhaitons, à l’instar d’autres collègues, attirer l’attention sur les problèmes de détection des structures dans ce type de substrat calcaire qui rendent bien souvent le seul décapage à la pelle mécanique très insuffisant pour mettre au jour l’ensemble des structures en creux d’un site.
Dès les années soixante-dix, des fouilles programmées extensives de sites d’habitat néolithiques ou protohistoriques, tels Champ-Durand à Nieul-sur-l’Autise en Vendée (Joussaume, 1981, 2012) et les Coteaux de Montigné à Coulon dans les Deux-Sèvres (Pautreau, 1978, 1995), ont montré qu’un décapage manuel du substrat est un moyen efficace de détection de structures de petites dimensions, comme des trous de poteaux ou des tranchées de palissade, invisibles lors du décapage mécanique préalable. Plus récemment, des constats analogues ont été faits lors de fouilles
d’enceintes néolithiques notamment (e. g. Fouéré et al., 1996 ; Burnez et Fouéré, 1999 ; Kerouanton, 2009).
Dans le cadre des fouilles programmées de l’enceinte fossoyée de Bellevue, entre 2008 et 2011 (Ard et al., 2009, 2012a, 2012b), des décapages manuels extensifs ont permis de révéler une densité de structures insoupçonnées dans l’espace interne de l’enceinte, alors que cette zone est généralement réputée pauvre voire exempte d’aménagements anthropiques conservés.
Dans le cadre du projet de mise à deux fois deux voies de la Nationale 150 entre Saujon et Saintes, une expérience innovante a été menée en 2006 sur le site à occupations multiples de Malabry (Sergent et al., 2007). Un balayage mécanisé du substrat, qui succéda au décapage de la terre végétale à la pelle mécanique, a permis d’optimiser la détection des structures tout en palliant les contraintes de temps et d’effectif inhérentes aux opérations d’archéologie préventive.
En exposant un problème bien connu des archéologues familiers de ces contextes, nous souhaitons à travers cette contribution faire part de nos expériences et observations de terrain tout en proposant des solutions méthodologiques pour parfaire la détection des structures en creux dans ce type de terrains calcaires.
DE LA PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE AU DÉCAPAGE MÉCANIQUE AU SOL : OÙ SONT PASSÉES LES STRUCTURES ?Pour l’enceinte néolithique de Bellevue, tout comme
pour le site Malabry dans une moindre mesure, des photographies aériennes préalables permettaient d’avoir une idée des structures susceptibles d’êtres rencontrées à la fouille, à savoir des fosses et fossés formant des structures rectilignes, curvilignes ou circulaires (fig. 1). Comme on l’observe régulièrement sur ces substrats calcaires en plaquettes, la détection des structures au décapage mécanique s’est révélée beaucoup plus complexe que prévu.
Des substrats hétérogènes
Dans les deux cas, les difficultés de détection des structures s’expliquent par l’hétérogénéité des couches superficielles des substrats locaux, rencontrées sous seulement 20 à 30 cm de terre végétale. À Malabry, le substrat est constitué de calcaires crayeux du Santonien, friables et gélifs, qui présentent une interface entre la terre végétale et le calcaire « sain », constituée de plaquettes calcaires et d’une fine couche de sédiment (rendosol). À Bellevue, les couches superficielles du substrat local (Callovien) se présentent sous forme d’un empilement de plaquettes disposées horizontalement, sous forme d’un pavage irrégulier, montrant de longues fissures tectoniques, fines et parallèles, d’orientation sud-est/nord-ouest (fig. 2).
Livre 2.indb 252 20/11/2014 17:22
253
Détecter les structures en creux Dans les terrains calcaires Du norD Du Bassin aquitain ProBlèmes et solutions méthoDologiques
Figure 1 - Localisation et vues aériennes des deux sites étudiés : l’enceinte fossoyée néolithique de Bellevue à Chenommet,
en Charente, et le site à occupations multiples de Malabry à Saintes, en Charente-Maritime (DAO V. Ard).
Figure 2 - Chenommet, Bellevue (Charente) : vues de détail après nettoyage manuel du substrat calcaire local en plaquettes du Callovien montrant son hétérogénéité sur la petite surface étudiée. a : fissures tectoniques parallèles ; b : plaquettes passant d’une position verticale
à une position horizontale (clichés V. Ard).
a
b
Livre 2.indb 253 20/11/2014 17:22
254
Vincent Ard, Frédéric Sergent
Lors du décapage, en raclant la surface de ces substrats hétérogènes, la pelle mécanique déplace les plaquettes calcaires superficielles qui viennent s’étaler sur l’ensemble de la surface du décapage, masquant les petites structures en creux de type fosses ou trous de poteau (fig. 3a). Notons en outre qu’il est important d’orienter le décapage en fonction de la configuration des veines calcaires pour éviter de peler le substrat calcaire en arrachant les plaquettes au fur et à mesure, ce qui a pour conséquence de faire disparaître à jamais les creusements très peu profonds. L’effet des labours profonds dans la couche de terre végétale, très peu épaisse dans ces terrains, est exactement le même et participe à la désorganisation des couches superficielles du substrat.
À Bellevue comme à Malabry, à l’issue du décapage mécanique, il était donc presque impossible de repérer les structures en creux, la surface ouverte présentant sur l’ensemble de l’emprise un aspect marbré, alternant zones calcaires blanchâtres et zones brunes plus terreuses (fig. 3b).
Des structures peu lisibles voire invisiblesL’un des objectifs majeurs des fouilles de l’enceinte
de Bellevue était la recherche de structures internes à l’espace enclos par les fossés visibles sur les clichés aériens. Les décapages ont donc été pratiqués depuis les fossés les plus externes vers l’intérieur de l’enceinte, en direction de l’abrupt dominant la Charente. Au total, près de 7000 m² de ce site, d’une surface totale d’environ 2,5 ha, ont été décapés au cours de quatre campagnes estivales successives. En 2010, l’emprise des fouilles, d’une surface d’environ 2000 m², couvrait un secteur d’entrée complexe montrant sur le cliché aérien des dispositifs en « pinces de crabe » (fig. 1).
Au cours du décapage mécanique, alors que les fossés d’enceinte étaient plus ou moins visibles, notamment grâce à la présence de quelques vestiges en surface, aucune structure n’était détectable dans l’espace interne (fig. 3b). Conscient des difficultés de lecture du terrain, nous ne pouvions nous contenter de ce constat trop incertain, c’est pourquoi nous avons engagé le nettoyage manuel systématique des surfaces décapées. Une même entreprise a été menée à Malabry sur une portion de l’emprise de 2,3 ha (1000 m² environ) dans le but de mettre en évidence la présence d’éventuelles petites structures en creux, totalement invisibles au décapage.
Ces décapages manuels ont très vite révélé un grand nombre de structures de petites dimensions, voire des fossés supplémentaires, totalement invisibles aussi bien sur les clichés aériens que lors du décapage mécanique.
À LA MAIN OU AU TRACTEUR L’APPORT DE LA BROSSE POUR LA DÉTECTION DES STRUCTURES EN CREUXUne fois le décapage mécanique des terres stériles
archéologiquement effectué, il est donc nécessaire de procéder à un balayage soigné de la surface du substrat, qui permet de retirer les éléments calcaires et les sédiments déplacés par les travaux agricoles et la pelle mécanique, dans le but de faire apparaître le contour des structures archéologiques. Ce balayage, qui constitue en réalité un second décapage, peut se faire manuellement ou de manière mécanisée.
Le décapage manuel
À Bellevue, le décapage manuel de la surface du substrat, sur une superficie totale de près de 7000 m² en quatre campagnes, a été effectué en deux étapes (fig. 4a). La première a consisté à balayer l’intégralité des tranchées au balai rigide de chantier afin d’éliminer la pellicule superficielle de terre et les blocs laissés par le passage de la pelle mécanique, ce qui représente un volume important de sédiments qui doit être ensuite
Figure 3 - Chenommet, Bellevue (Charente) : décapage du substrat calcaire à la pelle mécanique au niveau d’un secteur d’interruption
de fossés fouillé en 2010 (cf. fig. 1). Les structures observables sur la photographie aérienne sont invisibles (cliché V. Ard).
a
b
Livre 2.indb 254 20/11/2014 17:22
255
Détecter les structures en creux Dans les terrains calcaires Du norD Du Bassin aquitain ProBlèmes et solutions méthoDologiques
ramassé à la pelle à main. Ensuite, un second décapage du substrat a été effectué minutieusement à la truelle et la balayette de manière à dégager finement les irrégularités susceptibles de correspondre à des structures. C’est généralement au cours de ce second nettoyage qu’apparaissent la majorité des petits creusements de type trous de poteau (fig. 4b et c). On soulignera tout de même les difficultés pour distinguer, même en milieu calcaire, un creusement anthropique d’anomalies liées à l’arrachement de plaquettes par la pelle mécanique ou la charrue, à des anfractuosités naturelles, à des irrégularités engendrées par des effondrements karstiques souterrains ou des déracinements d’arbres (chablis) par exemple. Un décapage manuel de ce type nous a demandé des effectifs très importants, de l’ordre d’une trentaine de fouilleurs, pour décaper une surface
de 2000 m² en deux semaines environ. À Malabry, au cours d’une journée de décapage analogue, 120 à 150 m² ont été nettoyés par une équipe de 6 personnes.
Cette méthode, extrêmement payante en termes de détection de structures, nécessite donc des équipes importantes et représente un travail considérable, long et particulièrement fatiguant. Il est indiscutablement plus difficile de mobiliser des effectifs aussi importants dans le cadre d’opérations préventives que sur des opérations programmées comme Bellevue où le recrutement des bénévoles est fonction du travail à accomplir. En outre, un tel nettoyage peut représenter une proportion non négligeable des jours de terrain d’une opération, amputant d’autant le temps de fouille, alors même que les délais pour conduire des opérations de fouilles préventives se réduisent d’année en année.
Figure 4 - Chenommet, Bellevue (Charente) : balayage manuel du substrat après décapage mécanique. Les structures complexes, fossés et trous de poteaux, apparaissent au fur et à mesure. a et b : en cours de décapage ; c : une fois le décapage manuel achevé (clichés V. Ard).
a
c
b
Livre 2.indb 255 20/11/2014 17:22
256
Vincent Ard, Frédéric Sergent
Le balayage mécaniséPour pallier les contraintes du décapage manuel, tout
en recherchant à détecter un maximum de structures invisibles au décapage mécanique, une expérimentation innovante de balayage mécanisé a été menée dans le cadre de l’opération préventive du site de Malabry sur 5000 m² environ de l’emprise.
Cette expérimentation a permis de tester l’utilisation d’une brosse rotative montée à l’avant d’un des tracteurs utilisés pour évacuer les déblais (fig. 5). La brosse employée avait une longueur de 1,40 m et sa vitesse de rotation et sa pression sur le sol ont été réglées de manière à préserver au maximum les niveaux superficiels. La brosse était orientée légèrement en biais, afin de repousser les déblais sur un seul côté. Deux personnes étaient mobilisées pour suivre le tracteur et évacuer les andains à la pelle à main et à la brouette. Cette méthode a permis de nettoyer beaucoup plus rapidement l’emprise des fouilles, avec un rendement de l’ordre de 1000 m² en moyenne par jour !
Ce balayage mécanisé, pour lequel on peut imaginer bien d’autres combinaisons (brosses rotatives montées sur un camion, balayeuse professionnelle…), présente l’avantage d’être beaucoup plus rapide que le décapage manuel. En effet, sur le site de Malabry, la surface nettoyée à l’aide de ce dispositif a été multipliée par sept par rapport à celle d’un décapage manuel par une équipe de six personnes.
L’utilisation optimale de cette méthode nécessite néanmoins plusieurs conditions. Le substrat doit être sec, de manière à ne pas « beurrer » la surface du décapage, relativement plan et sans trop d’irrégularités afin que le nettoyage soit efficace. Dans la mesure du possible, le mieux est d’engager ce nettoyage dès la fin du décapage à la pelle mécanique, voire directement derrière la pelle ce qui est encore plus souhaitable.
Cette mécanisation du décapage permet de libérer la majeure partie de l’équipe de fouille de cette tâche énergivore et fastidieuse, pour se concentrer plus rapidement sur la fouille et le relevé des structures mises au jour. D’ailleurs, il faut souligner que cette mécanisation en milieu calcaire, peu utilisée malgré son efficacité démontrée, est peu onéreuse comparée à ce que représente la main d’œuvre humaine mobilisée pour le même travail…
LE DÉCAPAGE À LA BROSSE DÉSORMAIS INCONTOURNABLE DES FOSSES ET… DES TROUS DE POTEAUX !Sur substrat calcaire hétérogène, il est désormais
incontournable de procéder à ce type de décapage, manuel ou mécanique, seul à même de nous révéler les structures de plus petites dimensions tels que les trous de poteaux. Alors même que se pose la question
Figure 5 - Saintes, Malabry (Charente-Maritime) : balayage mécanisé du substrat à l’aide d’une brosse rotative montée
à l’avant d’un tracteur. a : dispositif en cours d’utilisation ; b et c : vues de détail de la brosse rotative qui peut être réglée en hauteur et puissance de balayage (clichés F. Sergent, INRAP).
a
b
c
de la fonction des grands enclos ou enceintes fossoyées néolithiques et protohistoriques, la mise en évidence de ces structures, lorsqu’elles existent, est primordiale et permet de renouveler sensiblement nos connaissances.
Livre 2.indb 256 20/11/2014 17:22
257
Détecter les structures en creux Dans les terrains calcaires Du norD Du Bassin aquitain ProBlèmes et solutions méthoDologiques
Détection de petites structures insoupçonnéesConsidérés généralement comme vierges de
structures d’habitat conservées, les espaces internes des enceintes fossoyées néolithiques du Centre-Ouest avaient pourtant rarement fait l’objet de recherches approfondies. Parfois seule une unique tranchée, traversant intégralement le camp, a permis de conclure à la quasi absence de structures comme sur l’enceinte de Chez Reine à Sémussac, en Charente-Maritime (Mohen et Bergougnan, 1984). Forts de plusieurs exemples régionaux montrant la présence de trous de poteaux dans ces espaces (Boujot et L’Helgouac’h, 1987 ; Fouéré et al., 1996 ; Kerouanton, 2009), les décapages manuels extensifs menés à l’intérieur de l’enceinte de Bellevue ont permis de mettre en évidence la présence de nombreux trous de poteaux et d’une tranchée de palissade dans cet espace (fig. 4c et 7). Ces trous de poteaux permettent d’envisager l’existence de petits bâtiments accolés au talus bordant le fossé interne de l’enceinte et de mettre en évidence des dispositifs complexes barrant les
interruptions de fossés. Pour la période protohistorique, des décapages analogues ont révélé des structures à l’intérieur et l’extérieur d’enclos comme aux Coteaux de Montigné et au Camp Allaric à Aslonnes (Pautreau et Maitay, 2007), dans la Vienne, par exemple.
En mécanisant ce balayage et en le systématisant à l’ensemble des fouilles dans ce type de contexte, il est évident que le nombre de structures détectées devrait être être démultiplié permettant ainsi de renouveler sensiblement notre perception de ces occupations (fig. 6).
Une méthode non destructrice
Enfin, il convient de souligner que le balayage mécanisé, tel qu’il a été mené à Malabry, n’entraîne pas de destructions dommageables d’informations archéologiques contenues dans les niveaux supérieurs des structures archéologiques. En réglant les balayeuses en hauteur et puissance de frottement, la machine décape uniquement la surface, sans creuser ni altérer les structures anthropiques. Seuls, les éventuels vestiges
Figure 6 - Saintes, Malabry (Charente-Maritime) : plan général et vue aérienne des structures mises au jour (cliché et DAO F. Sergent, INRAP).
Livre 2.indb 257 20/11/2014 17:22
258
Vincent Ard, Frédéric Sergent
conservés en surface des structures peuvent être emportés, de la même manière que lors du décapage à la pelle mécanique. Dans ces contextes où les niveaux de sol ont disparu, il ne reste de toute manière aucune stratigraphie en surface du substrat, où des structures de périodes très différentes s’ouvrent au même niveau. Ces
vestiges de surface, résiduels et en position bien souvent secondaire, n’ont donc que très peu de valeur informative pour la datation des structures et la caractérisation des occupations. Comparé à l’apport majeur de ce balayage mécanisé pour la connaissance des sites, la perte éventuelle de ces vestiges est donc mineure.
Figure 7 - Chenommet, Bellevue (Charente) : plan général et vue aérienne des structures mises au jour. Le secteur d’interruption des fossés apparaît beaucoup plus structuré sur la vue aérienne avant fouille.
Des trous de poteaux ont également été découverts à l’intérieur de l’enceinte (DAO V. Ard et cliché A. Devis).
Livre 2.indb 258 20/11/2014 17:22
259
Détecter les structures en creux Dans les terrains calcaires Du norD Du Bassin aquitain ProBlèmes et solutions méthoDologiques
CONCLUSIONSÀ travers cette contribution, nous avons souhaité
mettre en exergue les problèmes de détection des structures en creux dans ces substrats calcaires hétérogènes considérés à tort comme des contextes favorables à une reconnaissance rapide et aisée des creusements anthropiques. Il faut aujourd’hui se rendre à l’évidence, dans de nombreux cas, comme à Bellevue et Malabry, le seul décapage mécanique pour détecter les structures destinées à être fouillées est insuffisant et nous prive d’une quantité importante et essentielle de données. Ce problème se pose surtout dans le cadre des diagnostics en archéologie préventive où l’emprise est étroite et les temps d’intervention très réduits.
Dès lors, lorsque les caractéristiques du substrat le permettent, il faut prévoir un balayage systématique à la suite du décapage mécanique. En mettant en évidence rapidement les structures conservées, l’équipe de fouille peut ensuite se consacrer rapidement à leur fouille.
Enfin, comme nous l’avons montré pour l’enceinte de Bellevue, il ne faut pas négliger l’apport parfois considérable des prospections géophysiques, en particulier des cartographies magnétiques qui livrent d’excellents résultats en terrains calcaires (Mathé et al., 2012). Effectuées en amont des fouilles, ces prospections peuvent alors guider le choix des secteurs ouverts et, une fois la fouille terminée, elles peuvent utilement documenter les structures se poursuivant hors de l’emprise du décapage.
BIBLIOGRAPHIEArd V. avec la collaboration de Dufraisse A., Fouéré P., Frémondeau D., Liard M., Maingaud A., Maitay C. 2009 : Enfin des traces d’habitat à l’intérieur d’une enceinte du Néolithique récent du Centre-Ouest de la France : premiers résultats et perspectives des fouilles du site de Bellevue (Chenommet, Charente), Bulletin de la Société préhistorique française, t. 106, n° 3, p. 597-601.
Ard V., Bouchet E., Bréhard S., Donnart K., Fouéré P., Papon J. 2012a : Une enceinte à fossés interrompus de la culture Matignons sur le haut cours de la Charente : Bellevue à Chenommet (Charente), Objectifs, stratégie et premiers résultats des campagnes 2008 à 2010, in Perrin T., Sénépart I., Cauliez J., Thirault E. et Bonnardin S. (dir.), Dynamique et rythmes évolutifs des sociétés de la préhistoire récente, Actualités de la recherche, Actes des IXe Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente, Saint-Georges-de-Didonne (17), 8-9 octobre 2010, Toulouse, Éditons Archives d’Écologie Préhistorique, p. 117-134.
Ard V., Bourgueil B., Bréhard S., Camus A., Dufraisse A., Donnart K., Lévêque F., Manin A., Mathé V., Onfray M., Papon J., Pillot L. 2012b : Chenommet, Bellevue “Les Grands Champs” (Charente) : une enceinte du Néolithique récent, Fouille programmée tri-annuelle 2009-2011, Rapport final 2011, DRAC - SRA Poitou-Charentes, 171 p. et 129 pl. (inédit)
Boujot C., L’Helgouac’h J. 1987 : Le site néolithique à fossés interrompus des Prises à Machecoul (Loire-Atlantique), Études sur le secteur oriental, Préhistoire de Poitou-Charentes, problèmes actuels, Actes du 111e Congrès national des Sociétés savantes, Poitiers, 1986, Paris, éditions du CTHS, p. 255-269.
Burnez C. et Fouéré P. (dir.) 1999 : Les enceintes néolithiques de Diconche à Saintes (Charente-Maritime), une périodisation de l’Artenac, Mémoires de la Société Préhistorique Française 25 et Mémoires de l’Association des Publications Chauvinoises, t. 15, 2 vol., 829 p., 99 fig., 58 photos.
Fouéré P., Braguier S., Burnez C., Ferrier C., Gruet Y. 1996 : L’enceinte du Rocher à Villedoux (Charente-Maritime), Internéo 1, Journée d’information du 23 novembre 1996, Paris, Éditions Internéo et SPF, p. 191-205.
Joussaume R. 1981 : Le Néolithique et le Chalcolithique de l’Aunis et du Poitou occidental dans son cadre atlantique, Travaux du laboratoire d’Anthropologie, Préhistoire, Protohistoire et Quaternaire Armoricains, Rennes, Éditions Université Rennes I, 625 p.
Joussaume R. (dir.) 2012 : L’enceinte néolithique de Champ-Durand à Nieul-sur-l’Autise (Vendée), Chauvigny, Mémoire 44, Association des Publications Chauvinoises, 685 p.
Kerouanton I. 2009 : L’enceinte néolithique à double fossé interrompu du Coteau du Breuil, à François (Deux-Sèvres), Bulletin de Liaison et d’Information de l’Association des Archéologues du Poitou-Charentes, t. 38, p. 21-32.
Mathé V., Lévêque F., Druez M., Ard V. 2012 : Qu’apporte la prospection géophysique à l’étude d’un camp néolithique ? L’exemple du site de Bellevue à Chenommet (Charente), in Perrin T., Sénépart I., Cauliez J., Thirault E. et Bonnardin S. (dir.), Dynamique et rythmes évolutifs des sociétés de la Préhistoire récente, Actualités de la recherche, Actes des IXe Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente, Saint-Georges-de-Didonne (17), 8-9 octobre 2010, Toulouse, Éditions Archives d’Écologie Préhistorique, p. 135-140.
Mohen J.-P., Bergougnan D. 1984 : Le camp néolithique de Chez-Reine (Charente-Maritime), I. Étude archéologique, Gallia Préhistoire, t. 27, n° I, p. 7-40.
Pautreau J.-P. 1978 : L’habitat protohistorique du Coteau de Montigné, à Coulon (Deux-Sèvres), Travaux 1978, Bulletin de la Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres, t. 13, n° 2-3, p. 189-226.
Pautreau J.-P. 1995 : 1036 avant J.-C. Coulon, La Ronde, Parc naturel régional du Marais Poitevin, 71 p.
Livre 2.indb 259 20/11/2014 17:22
260
Vincent Ard, Frédéric Sergent
Pautreau J.-P., Maitay C. 2007 : L’éperon barré du Camp Allaric, Aslonnes (Vienne). Trente années de recherches, in Evin J. (dir.), Un siècle de construction du discours scientifique en Préhistoire : XXVIe Congrès préhistorique de France, Congrès du Centenaire de la Société Préhistorique Française, Avignon-Bonnieux, 21-25 septembre 2004, Paris, Éditions de la Société Préhistorique Française, p. 359-369.
Sergent F., Benquet L., Bourdais-Ehkirch A., Durand F., Forré P., Fouéré P., Gé T., Leroy L., Martin H., Martin S., Mille P., Rousseau J. 2007 : Saintes “Malabry” (Charente-Maritime), 2x2 voies Saujon-Saintes - Rapport final d’opération, INRAP GSO, DRAC-SRA Poitou-Charentes, 2 vol. : vol. 1 : études générales ; vol. 2 : inventaires, (inédit)
Livre 2.indb 260 20/11/2014 17:22
477
Avant-Propos
i. sénéPart, c. Billard, F. Bostyn, i. Praud, é. thirault Méthodologie des recherches de terrain de la Préhistoire récente en France. Nouveaux acquis, nouveaux outils, 1987-2012 ..........................................7
I -Terrains en exploration
1 - n. Buchez, M. talon
Bilan des méthodes et approches des diagnostics archéologiques sur les grands tracés linéaires dans le Nord de la France. ...............................15
2 - c. riche , d. aoustin, i. Beguier, c. chaussé, s. granai, c. leroyer , e. ravon
Approches paléoenvironnementales au stade du diagnostic : une étude de cas à Porte-Joie (Eure) ............................................................................25
3 - J. durand, s. durand, Kai Fechner, c. MonchaBlon avec la collaBoration de Medhi Belardi et Pascal rayMond Une méthode et un outil cartographique pour faciliter le diagnostic des sites néolithique sur les plateaux d’Île-de-France .................................43
4 - x. Margarit, F. Mocci, s. tzortis, K. Walsh, c. voyez avec la collaBoration de claudia deFrasne et Brigitte talon
Une décennie de modifications des approches d’archéologie programmée et préventive en Préhistoire récente : dans le département des Hautes-Alpes (1998-2012)) ................................................................................................................................................................57
5 - P.-J. rey, c. Bathine-vallet, J. colloMBet, c. delhon, l. Martin, B. Moulin, c. oBerlin, J. Poulenard, v. roBin, s. thieBault, J.-M. treFFort
Approche d’un territoire de montagne : occupations humaines et contexte pédo-sédimentaire des versants du col du Petit-Saint-Bernard, de la Préhistoire à l’Antiquité ...........................................................................................................................................................................................................73
6 - y. Billaud Préhistoire récente en immersion (1) : de l’eau douce … ..........................................................................................................................................................91
7 - c. Billard c., F. leroy Préhistoire récente en immersion (2) : … à l’eau salée ........................................................................................................................................................... 103
II - Nouveaux outils
8 - g. hulin
Évolution des méthodes géophysiques pour l’étude des sites du Néolithique .................................................................................................................. 115
9 - F.-x. siMon
L’apport des analyses géophysiques à l’épreuve de l’Archéologie préventive : quelques études de cas sur des sites néolithiques. ..................... 125
10 - M.-F. dietsch-sellaMi Des nouvelles attentions portées aux semences sur les sites néolithiques de la moitié nord de la France aux nouvelles problématiques qu’elles documentent ....................................................................................................................................................................................... 135
11 - F. soula L’apport des outils SIG à l’application de la méthode « systémico-analytique » : l’exemple du phénomène des pierres dressées de la Corse ......................................................................................................................................................................................................................... 143
12 - s. cassen, c. BouJot, s. Blanchet, c. dardignac, n. FroMont, v. griMaud, s. hinguant, J-M. large, t. lescoP, t. lorho Méthodes d’investigations des ouvrages de stèles dans l’Ouest de la France (1987-2012) .......................................................................................... 155
13 - l. laPorte, i. Parron, F. cousseau Nouvelle approche du mégalithisme à l’épreuve de l’archéologie du bâti ........................................................................................................................ 169
III - Donner du relief au creux
14 - F. Bostyn, h. collet, e. ghesquiere, a. hauzeur, P. -a. de laBriFFe, c. Marcigny Vingt-cinq ans de fouilles de minières à silex : retour sur expériences ................................................................................................................................ 187
15 - c. MonchaBlon, F. Bostyn, i. Praud Question de méthodes et problématique dans les fouilles des enceintes du Néolithique moyen II : exemples dans le Nord de la France. ....... 203
16 - l. Jallot, i. sénéPart Fosses et fossés des sites fonbuxiens des plaines littorales de Languedoc : 20 ans d’approche méthodologique ................................................... 217
17 - é. thirault, M. reMicourt avec la collaBoration de dorcas vannieuWenhuyse Les puits à eau néolithiques dans le Sud de la France : une question à creuser… ........................................................................................................... 231
18 - v. ard, F. sergent Détecter les structures en creux dans les terrains calcaires du nord du Bassin aquitain : problèmes et solutions méthodologiques ............... 251
19 - t. haMon, s. Weisser, M.-a. rodot, M. onFray Les trous de poteaux monumentaux du bâtiment Néolithique final des Vaux à Moulins sur Céphons (Indre), une première approche .......... 261
20 - K. Meunier, F. Bostyn, n. cayol, c. haMon De la fosse à la culture : acquis et perspectives de recherches sur l’habitat néolithique ancien dans le Bassin parisien ....................................... 273
TABLE DES MATIÈRES
478
IV - Faire « parler » les sols
21 - i. sénéPart La fouille des sols d’habitat de plein air dans le Sud de la France : retour sur expérience .............................................................................................. 287
22 - M. laBille, c. gilaBert, M. onFray Approches techno-morphologiques des architectures néolithiques en torchis en France : de la fouille à l’analyse de l’espace construit ............................................................................................................................................................................. 305
23 - J. Wattez, M onFray La question des sols d’occupation néolithiques : apports de la géoarchéologie à leur identification et à leur interprétation ............................. 317
24 - t. haMon, M. -F. creusillet, M. onFray Sours « Les Hauts de Flotville » (Eure et Loir), mise en évidence de sols néolithiques et protohistoriques en plaine de Beauce, approche et limite de terrain et d’étude ..................................................................................................................................................................................... 349
25 - é. Martial, a. aMPosta, F. Broes, K. Fechner, g. hulin, i. Praud, a. salavert
Approche pluridisciplinaire (dosage du phosphore, géophysique, paléoenvironnement et architecture) appliquée aux sites d’habitat du Néolithique final dans le Nord de la France : exemple à Sauchy-Lestrée (Pas-de-Calais) ................................. 355
26 - M. Besse, a. Winiger, P. chiquet, e. Wyser
Des stratigraphies (Yverdon, Auvernier, 1970) et chronotypologies (Twann 1980) aux analyses spatiales (Concise 2000) : l’apport des SIG et des problématiques ethnologiques dans l’étude des palafittes de Suisse occidentale ................................................................ 361
V - Bilans et acquis
27 - é. thirault Trois décennies de terrain en Préhistoire récente dans les Alpes françaises : pratiques, acteurs, perspectives ......................................................... 377
28 - c. verJux, M.-F. creusillet, F. duPont, t. haMon, r. irriBaria, c. landreau, d. leroy Les recherches sur le Néolithique en région Centre (1985-2010). ......................................................................................................................................... 395
30 - l. vallin
La place du Néolithique dans l’archéologie préventive depuis 1986 : évolutions et conséquences des politiques et des pratiques en Nord– Pas-de-Calais .................................................................................................................................................................................................................. 407
30 - c. laurelut, g. Blancquaert, v. Blouet, t. Klag, F. Malrain, c. Marcigny, v. riquier, W. tegel, J. vanMoerKerKe Vingt-cinq ans de recherche préventive protohistorique en France du Nord : évolution des pratiques et changements de perspectives, de l’accumulation à la synthèse des données ........................................................................................................................................................................... 419
31 - l. BonnaBel, s. culot, s. desBrosse-degoBertière, c. Paresys, i. richard, B. vauquelin Archéologie funéraire néolithique en Champagne-Ardenne : aspects méthodologiques et renouvellement des connaissances ..................... 457
32 - J-P. deMoule Programmations, prescriptions et contrôles scientifiques en archéologie : comparaisons européennes ................................................................. 469
Archives d’Écologie PréhistoriqueAssociation loi 1901 - SIRET : 428 249 973 00028
Bureau : Jean Guilaine (président), Jean Vaquer (vice-président),Claire Manen (secrétaire), Thomas Perrin (trésorier)
EHESSMaison de la Recherche5, allée Antonio-MachadoF-31058 Toulouse cedex 9
[email protected]://www.archeoaep.fr
MÉTHODOLOGIE DES RECHERCHES DE TERRAIN SUR LA PRÉHISTOIRE RÉCENTE EN FRANCENOUVEAUX ACQUIS, NOUVEAUX OUTILS, 1987-2012
2014
ACTES DES PREMIÈRES RENCONTRES NORD/SUD DE PRÉHISTOIRE RÉCENTE
SOUS LA DIRECTION DE
IngrId SÉnÉPArT, CyrIlle BIllArd, FrAnçoISe BoSTyn, IvAn PrAUd, ÉrIC THIrAUlT
RENCONTRES MÉRIDIONALES DE PRÉHISTOIRE RÉCENTE INTERNÉO MARSEILLE – MAI 2012
2014
Le premier colloque de Préhistoire récente Nord/Sud intitulé Méthodologie des recherches de terrain de la Préhistoire récente en France. Nouveaux acquis, nouveaux outils, 1987-2012 s’est tenu à Marseille en mai 2012 à l’initiative des associations «Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente» et «InterNéo». Il réunissait pour la première fois une large communauté de néolithiciens du Nord et du Sud venus confronter leurs expériences de terrain et débattre de leurs pratiques.
En effet, en France, les vingt-cinq dernières années constituent, une période de bouleversement considérable pour les méthodes de recherche sur la Préhistoire récente. La mise en place des procédures d’Archéologie préventive permet aujourd’hui d’aborder la fouille des sites avec des moyens inégalés, qui conduisent à poser de nouvelles problématiques, grâce notamment à une exploitation des données sur des surfaces plus importantes et à la mise en oeuvre de nouveaux outils d’analyse.
Cette période a également été celle d’une néces-saire forme de normalisation des méthodes de fouille et surtout des méthodes de détection des sites. Pourtant, les pratiques de prospection, de recherche et d’analyse restent souvent hété-rogènes, parfois à juste titre, parfois par simple tradition régionale, parfois par méconnaissance d’expériences s’étant déroulées dans d’autres contextes géographiques. Enfin cette période est celle de la construction du dispositif complet de l’archéologie préventive, tant sur le plan admi-nistratif et juridique que sur le plan des structures opérationnelles.
Il s’agissait donc d’effectuer un « retour sur expérience » sur cette période où les occasions ont manqué de porter un regard critique sur nos pratiques de recherche, autant dans leurs succès que dans leurs échecs.
The first colloquium of Late Prehistory North/South, entitled Field Research Methods applied to Late Prehistory in France. New Knowledge, New tools, 1987-2012 took place in Marseille in May 2012 under the initiative of the associations “Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente” and “InterNéo”. For the first time, it brought together a large community of specialists of the Neolithic in the North and South to compare their experiences and debate their practices.
In France, over the last twenty-five years the field methods used in research on Late Prehistory have indeed undergone significant changes. The development of rescue archaeology procedures now enable site excavations to be carried out with previously unavailable resources, leading to the formulation of new research questions based in large part on the study of data collected over larger surface area, and the development of new analysis tools.
During this period, a necessary standardization of excavation methods and, especially, site detection methods also occurred. Nevertheless, survey, research and analysis procedures often remain heterogeneous, sometimes justifiably, sometimes according to regional traditions, and sometimes due poor knowledge of advances made in other geographic contexts. Finally, the foundations of rescue archaeology were completely during this time, both in the domains of administration and jurisdiction, and in the operational structures.
The aim of this meeting was thus to “learn from our experience” during this period when opportunities to critically assess our research practices were lacking, taking into account both their successes and their failures.
Mét
hodo
logi
e de
s rec
herc
hes d
e te
rrain
sur l
a Pr
éhist
oire
réce
nte
en Fr
ance
: nou
veau
x ac
quis,
nou
veau
x ou
tils,
1987
-201
2
Ac
tes d
es p
rem
ière
s ren
con
tres
no
rd/s
ud
/ re
nco
ntr
es m
érid
ion
Ale
s de p
réh
isto
ire r
écen
te –
inte
rnéo
/ m
Ars
eill
e – m
Ai 2
012
couv-tranche 25.indd 1 11/12/2014 09:33