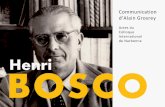L'empreinte du ciel. Henri Bosco et saint Bernard de Clairvaux
Arc-en-ciel, apparition et couronnement - À propos du signe N28 - Millions of Jubilees : Studies in...
Transcript of Arc-en-ciel, apparition et couronnement - À propos du signe N28 - Millions of Jubilees : Studies in...
61
Arc-en-ciel, apparition et couronnementÀ propos du signe N 28
Nathalie BeauxChercheur associé
Collège de France et IFAO
Le signe N28 est généralement décrit comme « une colline éclairée des rayons du soleil levant » ou « le soleil se levant derrière une colline»1. Pour d’autres, il s’agirait des couleurs
lumineuses des premiers rayons du soleil levant2.À la lumière des textes et de la paléographie du signe, nous aimerions reprendre cette iden-
tification et en proposer une nouvelle.
Analyse paléographique du signeDans une tombe de l’Ancien Empire, le signe présente à la base un rectangle sur lequel
reposent des arcs semi-circulaires (fig. 1a)3. Mais ce rectangle ne semble pas conservé par la suite.
Le signe est constitué d’une série d’arcs concentriques de nombre variable pouvant aller de trois à sept (fig. 1ab). En général, dans sa forme complète, il en comporte cinq (fig. 1cd).
Couronnant la majeure partie de cet ensemble, une crête de rayons perpendiculaires est figurée. Cette crête est plus ou moins large et ne couvre jamais la totalité de l’arc, elle est même réduite à une sorte de touffe à l’époque tardive4.
On observe pour les arcs et dans les exemples peints attestés la succession de couleurs suiv-antes (en partant du bas) : bleu, vert, rouge, vert, bleu (fig. 1e)5. La crête est de couleur verte avec de petits traits bleus.
Registre lexical du signeUne seule lecture du signe est attestée : xa. Le mot renvoie au concept d’apparition (solaire,
divine, royale), « apparaître, se lever, briller », et à celui de couronnement6.Deux textes de l’Ancien Empire permettent de cerner l’identification du signe dans la mesure
où le signe apparaît accompagné du trait vertical signifiant son emploi pour ce qu’il figure.
62
B e a u x
Pyr. 333, §542a-b7
Wab-n & Hr xa pw n tA wab-n Ra Hr=fd=f Hb saHa=f mAo.t « Téti s’est lavé sur cette Apparition de terre, sur laquelle Rê s’est lavé,il disposera des échelons, il élèvera l’échelle... ».
Pyr. 484, §1022a8
P pn pw xa n tA Hr(y)-ib WAD-wr...« Ce Pépi est l’Apparition de terre au coeur de la Très-verte... »De ces deux textes, on peut relever l’expression xa n tA, « Apparition de terre ».
a b
c d
e
Fig. 1 a,b: Signes N28 dans la tombe de Khafkhufu I (Ancien Empire) (dessin N. Beaux). c,d: Signes N28 dans la chapelle de Sésostris Ier à Karnak (Moyen Empire) (cliché A. Chéné). e: Signe N28 dans le Temple d’Hatchepsout à Deir-el-Bahari (Nouvel Empire) (cliché N. Beaux).
63
A r c - e n - c i e l , a p p a r i t i o n e t c o u r o n n e m e n t
Dans les deux cas, elle est associée à un milieu aqueux dans la mesure où le roi se lave, se purifie sur elle (premier texte) et où elle est au coeur de la Très-verte (deuxième texte).
Cette expression ne peut désigner le soleil lui-même puisque dans le premier texte, Rê se lave sur elle. Mais elle peut se référer métaphoriquement au roi puisque le deuxième texte fait l’équation roi- xa n tA.
Il s’agit de l’ascension royale céleste qui suit cette purification (mise en place d’échelle dans le premier texte).
Précédentes interprétations
Colline éclairée des rayons du soleil levant?Cette interprétation a été développée par A. De Buck9 et elle est généralement admise. Elle
s’appuie sur les deux textes des pyramides qui mentionnent une xa n tA qui est alors traduite « colline de terre ». Le signe N28 y est accompagné du trait vertical indiquant qu’il est bien question de ce qui est figuré. Mais qu’est-ce qui est figuré ? Les détails paléographiques du signe, en particulier la succession de couleurs des arcs, ne trouvent pas d’explication si l’on suit l’interprétation du signe comme une colline de terre.
Halo lumineux du soleil levant?D’après N. Groff10, il s’agit en fait d’un phénomène de réfraction de la lumière qui fait que
l’oeil perçoit d’abord du bleu-vert, puis du rouge au lever du soleil, et l’inverse au couchant. Cette interprétation est reprise par D. Meeks qui explique qu’il s’agirait du « halo du soleil, peu avant qu’il n’apparaisse au-dessus de l’horizon et dont les différentes colorations résultent de la diffraction de la lumière dans l’atmosphère. C’est ce que représente la partie semi-circulaire du signe. La partie supérieure, en éventail, rend de façon stylisée les rayons diffusant au-dessus du halo »11.
Cette interprétation prend en considération les couleurs du signe, mais elle ne le fait qu’approximativement. Car il s’agit bien, le plus souvent, d’une succession d’arcs bleu, vert, rouge, et ensuite vert, bleu, ce qui ne peut correspondre au soleil levant et à sa couronne.
De plus, cette interprétation ne tient pas compte de l’expression attestée de xa n tA et du fait qu’il ne peut s’agir du soleil lui-même, puisque, d’après le premier texte, celui-ci se lave sur le xa n tA.
Vers une autre interprétation
Hypothèse de l’arc-en-ciel doubleF. Ll. Griffith avait effleuré tout en la rejetant l’hypothèse d’un arc-en-ciel12.Nous proposons pourtant de voir dans le signe xa l’« Apparition », celle-ci ayant une majus-
cule car il s’agirait d’un phénomène remarquable, l’apparition d’un arc-en-ciel (fig. 2a) et plus précisément d’un arc-en-ciel double (fig. 2b,c).
En effet, l’arc-en-ciel présente plusieurs couleurs, le rouge étant la couleur de l’arc très large-ment visible dans la partie supérieure, le vert puis le bleu apparaissant clairement dans la partie inférieure (intérieure). Quand un deuxième arc-en-ciel paraît, il est placé au-dessus de l’arc-en-ciel précédent, avec des couleurs inversées, donc rouge à l’intérieur et bleu à l’extérieur.
Cette séquence de couleurs de l’arc-en-ciel double correspond exactement à celle que les Égyptiens figurent dans le signe N28.
64
B e a u x
Fig. 2a: Arc-en-ciel (cliché N. Grimal).
Fig. 2c: Arc-en-ciel secondaire.
Fig. 2b: Arc-en-ciel double.
65
A r c - e n - c i e l , a p p a r i t i o n e t c o u r o n n e m e n t
Il faut cependant observer une certaine schématisation : les deux arcs sont en réalité séparés par un espace non coloré, alors que le signe les représente comme un seul arc-en-ciel se dédou-blant en inversant ses couleurs, sans espace entre les deux arcs.
Cet arc-en-ciel dessine un arc, certes, mais dans la mesure où il semble toucher la terre, on peut concevoir qu’il apparaisse comme « reposant » sur terre en un large demi-cercle (et non plus seulement un arc). D’où la figuration d’une bande de terre à la base du signe à l’Ancien Empire (fig. 1a), indiquant qu’il s’agit, en quelque sorte, pour les Égyptiens, d’un phénomène terrestre.
La succession des couleurs dans le signe serait donc l’exact reflet de la réalité, mais leur répartition dans l’espace du demi-cercle serait « grossie », disproportionnée, un peu comme si l’on voulait mettre en évidence ce trait distinctif remarquable, l’arc-en-ciel double aux couleurs merveilleuses, et gommer l’espace non coloré entre les deux arcs et sous (à l’intérieur) de l’arc. C’est d’ailleurs une façon de procéder typiquement égyptienne : le trait pertinent est toujours mis en valeur, parfois grossi par rapport au reste de la figure pour être bien repérable, et certains détails réalistes se trouvent gommés car considérés comme non pertinents.
Reste à expliquer la représentation de la couronne verte à petits traits bleus, perpendiculai-res à l’arc, dans le signe. Elle renvoie sans doute à l’éclat de la lumière de l’arc qui, à son bord supérieur, est plutôt bleu-vert.
Signification de l’arc-en-ciel doubleLe phénomène optique complexe de l’arc-en-ciel résulte de réfractions multiples de la
lumière solaire dans des gouttelettes d’eau. Chaque goutte d’eau réalise une diffraction qui réfléchit la lumière blanche du soleil en déviant ses différentes composantes suivant des angles différents. Apparaissent ainsi jusqu’à sept couleurs. Dans le cas d’un second arc-en-ciel visible au-dessus de l’arc-en-ciel primaire, on assiste à une deuxième réflexion des rayons du soleil à l’intérieur des gouttes. Comme la lumière est réfléchie deux fois, les couleurs sont inversées par rapport à l’arc-en-ciel primaire.
Pour qu’un observateur puisse observer un arc-en-ciel, il faut que le soleil soit dans son dos. Il ne peut donc pas le voir en même temps que l’arc-en-ciel, mais il est évident que c’est sa présence conjuguée à celle de la pluie qui permet l’observation de ce phénomène.
Pour les Égyptiens, la pluie est un fléau. L’apparition du soleil, à la fin ou lors de la pluie, est « fêtée » par celle d’un arc-en-ciel, qui marque ou annonce la fin du fléau. Il la marque de façon grandiose, à la fois par ses couleurs et par sa taille. Il devient donc un symbole de l’Apparition par excellence. Une apparition extraordinaire liée à celle du soleil et à laquelle le roi peut être égalé.
Si l’on reprend maintenant les deux textes présentés, on comprend mieux l’image du roi et du soleil qui se purifient, se lavent sur l’Apparition13. La purification suggère la pluie dont le double arc-en-ciel semble sortir, avec la venue du soleil. L’Apparition repose sur la terre, semble même surgie de terre dans le ciel. En ce sens le double arc-en-ciel paraît sans doute comme une gigantesque butte terrestre. Un tertre à partir duquel le roi peut poser une échelle et monter au ciel, les échelons de l’échelle étant peut-être autant d’arcs-en-ciel qu’il gravit, passant de couleur en couleur?
L’assimilation du roi à cette apparition exceptionnelle, remarquable, permet d’évoquer le souverain dans des dimensions cosmiques non négligeables, mais aussi mythiques : l’image de l’émergence de la butte primordiale est sans doute « surimposée » à l’évocation de l’arc-en-ciel double dans le deuxième texte. D’ailleurs le terme xay.t « butte primordiale » est attesté à époque tardive14. Le roi est en même temps l’arc-en-ciel qui triomphe de la pluie et le bien qui triomphe
66
B e a u x
du mal, la butte de terre primordiale émergeant de l’eau et la vie montant vers le ciel depuis la terre, dans un mouvement irrésistible (le texte poursuit en précisant qu’aucun être terrestre ne peut le retenir dans cette ascension).
C’est là qu’on saisit toute la saveur de la métaphore du double arc-en-ciel comme couron-nement. Le double arc-en-ciel est l’Apparition par excellence. Celle-ci est inoubliable, grandiose et rare au point qu’elle peut sembler unique. Ainsi en était-il pour tout roi de son couron-nement, évènement essentiel, central de sa vie et de la vie du pays tout entier. Par l’alliance du double arc-en-ciel que figure le signe au contenu sémantique d’« apparition » du mot xa, le registre lexical xaj, « apparaître (au combat) », « être couronné » ainsi que xaw « apparition, couronnement, couronne » prend une autre dimension. Par la métaphore du double arc-en-ciel, l’apparition royale lors de son couronnement, comme celle que le roi faisait au combat, mettait mythiquement en scène l’Instant où tout se noue, la victoire du soleil sur la pluie et de la vie sur la mort, victoire bien réelle, bien tangible, xa n tA, « Apparition de terre », comme en ce tout premier temps mythique lointain où la vie surgit d’une butte qui venait d’émerger...
Notes:1 A. De Buck, De Egyptische Voorstellingen Betreffende den Oerheuvel (Leide, 1922), 63-71 ; G. Lefebvre, Grammaire
de l’Égyptien classique, Bibliothèque d’étude 12 (Le Caire, 1955), 406, N28 ; A.H. Gardiner, Egyptian Grammar, (3rd ed.) (Oxford, 1979), 489, N28 ; H. G. Fischer, Ancient Egyptian Calligraphy, (3rd ed.) (New York, 1988), 36 : « sun rising behind hill... the outer curve defines the rays of the sun ».
2 N. Groff, ‘Le soleil levant – les couleurs du soleil,’ Oeuvres égyptologiques de N. Groff publiées par sa soeur (Paris, 1908), 248-272.
3 Ce trait paléographique est largement attesté dans la tombe de Khafkhufu I (W. K. Simpson, The Mastabas of Kawab, Khafkhufu I and II, Giza Mastabas 3 (Boston, 1978), mais je n’en connais pas d’autre exemple.
4 D. Meeks, Les architraves du temple d’Esna – Paléographie, Paléographie hiéroglyphique 1 (Le Caire, 2004), 130-1, §350.
5 W. S. Smith (A History of Egyptian Sculpture and Painting in the Old Kingdom (New York, 1978), 379) mentionne pour l’Ancien Empire des traces de rouge et de bleu dans les arcs concentriques pour la tombe de Ptahshepses. Pour un exemple provenant du temple solaire de Sahourê, il cite les couleurs bleu, vert, bleu, ou bien vert, brun, vert (le brun étant très vraisemblablement un rouge).
6 Wb III, 239, 4-242, 2.7 K. Sethe, Die altägyptischen Pyramidentexte I, (Leipzig, 1908), 277, sp. 333, §542a-b.8 K. Sethe, Die altägyptischen Pyramidentexte II, (Leipzig, 1910), 74, §1022a.9 De Buck, De Egyptische Voorstellingen Betreffende, 63-71.10 Groff, ‘Le soleil levant’, 248-272.11 Meeks, Les architraves du temple d’Esna, 130-1, §350.12 F. Ll. Griffith (A Collection of Hieroglyphs: a Contribution to the History of Egyptian Writing, Archaeological Survey of
Egypt 6 (London, 1898), 30) écrit : the sign « seems to represent pictorially the effulgence of the sun at the point where he rests on earth. (Though the « kha‘ of earth » as a place for the sun-god’s purification by ablution may suggest it, nothing else bears out the idea that (the sign) may be intended for a rainbow.) ». Les couleurs du double arc-en-ciel permettent pourtant d’appuyer cette hypothèse comme on va le développer.
13 C’est précisément le seul argument que considérait F. Ll. Griffith dans son allusion à l’identification du signe comme un arc-en-ciel (A Collection of Hieroglyphs, 30).
14 Wb. III, 239, 2-3 ; P. Wilson, A Ptolemaic Lexikon – A Lexicographical Study of the Texts in the Temple of Edfu, Orien-talia Lovaniensia Analecta 78 (Leuven, 1997), 709.
67
A r c - e n - c i e l , a p p a r i t i o n e t c o u r o n n e m e n t
References Cited:A. De Buck, A. De Egyptische Voorstellingen Betreffende den Oerheuvel (Leide, 1922).H.G. Fischer, Ancient Egyptian Calligraphy, (3rd ed.) (New York, 1988).A. H. Gardiner, Egyptian Grammar, (3rd ed.) (Oxford, 1979).F. Ll. Griffith, A Collection of Hieroglyphs: a Contribution to the History of Egyptian Writing, Archaeological Survey of Egypt
6 (London, 1898).N. Groff, ‘Le soleil levant – les couleurs du soleil,’ Oeuvres égyptologiques de N. Groff publiées par sa soeur, (Paris, 1908),
248-272.G. Lefebvre, Grammaire de l’Égyptien classique, Bibliothèque d’étude 12, (Le Caire, 1955).D. Meeks, Les architraves du temple d’Esna – Paléographie, Paléographie hiéroglyphique 1 (Le Caire, 2004).K. Sethe, Die altägyptischen Pyramidentexte I-II (Leipzig, 1908-1910).W. K. Simpson, The Mastabas of Kawab, Khafkhufu I and II, Giza mastabas 3 (Boston, 1978).W. S. Smith, A History of Egyptian Sculpture and Painting in the Old Kingdom (New York, 1978)P. Wilson, A Ptolemaic Lexikon – A Lexicographical Study of the Texts in the Temple of Edfu, Orientalia Lovaniensia Analecta
78 (Leuven, 1997).