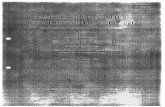Lipid residues in pottery from the Indus Civilisation in ...
Andreina CONTESSA Nouvelles observations sur la Bible de Roda, Cahiers de Civilisation Médiévale...
-
Upload
beniculturali -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Andreina CONTESSA Nouvelles observations sur la Bible de Roda, Cahiers de Civilisation Médiévale...
Andreina CONTESSA
Nouvelles observations sur la Bible de Roda
RÉSUMÉ
Le but de cette brève note est de reconsidérer l’origine, l’attribution et la datation du quatrième volumede la Bible de Roda (BnF, ms. lat. 6). Si les trois premiers volumes de cette importante bible romane sontassurément liés à la Bible de Ripoll (ms. Vat. lat. 6) et attribués au scriptorium catalan de Ripoll et àl’époque de l’abbé Oliba (1008-1046), les illustrations du volume IV ont en revanche été ajoutées plus tardi-vement dans un lieu que les chercheurs ont identifié comme le monastère de Roda. Je propose de réexa-miner cette notion, en tenant compte du contexte culturel de ces deux bibles encyclopédiques et en faisantobserver les nombreux éléments stylistiques communs : l’écriture, le caractère inachevé des illustrations duNouveau Testament et, surtout, la similarité remarquable entre certaines illustrations du volume IV de laBible de Roda et celle de la figure de Luc dans la Bible de Ripoll. Dans ces deux bibles, les illustrationsont été ajoutées par le même artiste dans la seconde moitié du XIe s., très probablement à Ripoll. Cettehypothèse se trouve confirmée par l’examen approfondi des détails des illustrations et par une comparaisonstylistique avec d’autres manuscrits ripolliens de la même époque, ce qui porte à reconsidérer le rôle de cescriptorium et de sa production dans la seconde moitié du XIe s.
ABSTRACT
This short paper suggests a reconsideration of the origin, attribution and dating of the fourth volume ofthe Roda Bible (BNF, MS. lat. 6). While the first three volumes of this important early Romanesque Bibleare securely linked to the Ripoll Bible (MS. Vat. Lat. 5729), and ascribed to the Catalan scriptorium ofRipoll at the time of abbot Oliba (1008-1046), the fourth volume’s illustrations were certainly added later,in a place that many scholars have identified as the Roda monastery. I propose several reasons for re-evaluating this notion, taking into account the cultural context in which these two encyclopedic Bibles weredesigned, and observing the many shared stylistic elements: the script, the unfinished character of the NewTestament in both Bibles, and especially the remarkable similarity between some illustrations of the Rodafourth volume and the figure of Luke in the Ripoll Bible. Both were added by the same artist in thesecond half of the eleventh century, most probably at Ripoll. This is confirmed by a careful examination ofthe details of the illustrations, and by a stylistic comparison with other Ripoll manuscripts of the sameperiod, leading to a reconsideration of the role of this scriptorium and its production in the second half ofthe century.
Je voudrais dans cette brève note rouvrir la question de l’attribution, de l’origine et de la datationdu quatrième volume de la Bible de Roda (Bibliothèque nationale de France, ms. lat. 6, vol. IV),un codex latin monumental et richement illustré datant de la première moitié du XIe s. et provenantde Catalogne1. L’attribution de la Bible de Roda au scriptorium de Ripoll est acceptée depuis
1. Le codex, qui formait à l’origine un seul volume, a été subdivisé en quatre grands tomes lorsqu’il est devenu lapropriété de la Bibliothèque royale et, par la suite, de la Bibliothèque nationale de France. Sur la Bible de Roda, voir :F. AVRIL, J.-P. ANIEL, M. MENTRÉ et Y. ZALUSKA, Manuscrits enluminés de la Péninsule ibérique, Paris 1983, p. 31-43 ;— P. K. KLEIN « Der Apokalypse-Zyklus der Roda-Bibel und seine Stellung in der ikonographischen Tradition », Archivo
Cahiers de civilisation médiévale, 51, 2008, p. 329-342.
longtemps par tous les spécialistes en raison de sa ressemblance textuelle, codicologique, paléo-graphique, iconographique et stylistique avec la Bible de Ripoll (Biblioteca Apostolica Vaticana,ms. lat. 5729), écrite et illustrée peu auparavant dans le scriptorium de Ripoll2. L’identificationdu lieu de réalisation de l’actuel volume IV reste toutefois objet de discussion. L’écriture plustardive qui apparaît dans ce tome, le style tardif des illustrations de l’Apocalypse et l’inexistencede ce cycle dans la Bible de Ripoll ont amené certains chercheurs, qui supposaient l’absenced’illustrations de l’Apocalypse dans ce monastère, à émettre l’hypothèse que le volume IV avaitété achevé ailleurs qu’à Ripoll. La présence d’une bulle d’Innocent II, relative au monastère deRoda, datant de 1130 et transcrite sur une page blanche du troisième volume (f. 39) de cettemême bible à une date ultérieure, a amené divers spécialistes à considérer Roda comme le lieuauquel le codex était destiné. La bible aurait alors été terminée à Roda où auraient été ajoutéesles illustrations de l’Apocalypse dans le quatrième volume.
Wilhelm Neuss fut le premier à présenter la question en ces termes dans un article de 1951, oùil révisait sa précédente attribution de la Bible de Roda au scriptorium de Ripoll. Sa thèse futreprise et développée par Peter Klein dans un important essai, publié en 1972, qui résumait l’étatde la recherche jusqu’à cette date ; depuis lors, elle a été suivie par la grande majorité deschercheurs3. En fixant vers la fin du XIe s. la réalisation du quatrième volume de la bible parisienne,cette hypothèse permettait d’expliquer de manière parfaitement logique quelques problèmes : lestyle tardif des illustrations et la présence d’un cycle apocalyptique – absent du codex du Vatican– qui se caractérise par des images strictement associées au texte et non regroupées en registresou en pleine page, comme dans la plus grande partie des illustrations des deux codices.
D’après moi toutefois, cette hypothèse ne tient pas compte d’une série d’éléments importantsrelatifs aux deux manuscrits, parmi lesquels les plus significatifs sont les traits stylistiques communset en particulier l’inachèvement du Nouveau Testament dans l’une et l’autre bible. Ce qui mepousse à rouvrir ici ce dossier est la récente identification d’une des mains qui illustrèrent l’Apo-calypse [fig. 1] avec celle qui ajouta la figure de saint Luc au folio 388 dans la bible vaticane[fig. 2]. Cet élément nouveau permet, selon moi, de prendre en considération la possibilité d’une
330 CAHIERS DE CIVILISATION MÉDIÉVALE, 51, 2008 ANDREINA CONTESSA
Español de Arqueologia, 45-47, 1972-1974, p. 267-311. Sur les bibles catalanes de Ripoll et Roda, cf. les monographies :W. NEUSS, Die Katalanische Bibelillustration um die Wende des ersten Jahrtausends und die altspanische Buchmalerei,Bonn/Leipzig, K. Schroeder, 1922 ; — A. CONTESSA, The Ripoll and the Roda Bibles. A comparative study of the illustra-tions of the two manuscripts and an iconographical study of the book of Genesis, thèse de doctorat, 2 vol. dactyl., TheHebrew University of Jerusalem, 2002 ; — A. M. MUNDÓ, Les Biblies de Ripoll, Estudi del Mss. Vaticà, lat. 5729 i Parìs,Bibliothèque Nationale de France, lat. 6, Cité du Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2002 (Studi e testi, 408) ; —cf. aussi les études de P. BOHIGAS, La ilustración del libro manuscrito en Cataluña, periodo románico, Barcelone, Asociaciónde Bibliófilos, 1960, p. 39-79 ; — J. DOMÍNGUEZ BORDONA, Spanish Illumination, New York, Hacker Art Books, 1969, vol.I, p. 29-31 ; — R. ALCOY, « “Bíblia de Rodes” et “Bíblia de Ripoll” », dans Catalunya Romànica, X, El Ripolles, Barcelone,Fundació Enciclopèdia Catalana, 1987, p. 292-305 ; — M. E. IBARBURU ASURMENDI, De capitibus et aliis figuris, Barcelone,Universitat Autònoma de Barcelona, 1999, p. 49-150 ; — P. K. KLEIN « The Romanesque in Catalonia » dans The Art ofMedieval Spain. a. D. 500-1200, New York, The Metropolitan Museum of Art, 1993, p. 306-309.
2. Sur l’attribution de la Bible à Ripoll, cf. J. PIJOÁN, « Les miniatures de l’Octateuch y les Biblies romániquescatalanes », Anuari de l’Institut d’Estudios catalans, 1911-1912, p. 475-507. Sur la Bible de Ripoll, cf. n. 1.
3. W. NEUSS, « Die Katalanische Bibel aus Sant Pere de Roda und Dürers Apokalypse », dans Miscellània Puig iCadafalch, Recull d’Estudis d’Arqueologia, d’Història de l’Art i d’Història offerts a Josep Puig i Cadafalch per la SocietatCatalana d’Estudis Històrics, Barcelone, Institut d’estudis catalans, 1947–1951, vol. I, p. 261–267 ; — P. K. KLEIN, « Dateet scriptorium de la Bible de Roda. État des recherches », Cahiers de Saint-Michel de Cuxa (CSMC), 3, 1972, p. 91-102 ;— dans une étude ultérieure, Klein parle de la fin du XIe s. : « The Romanesque… » (art. cit. n. 1) ; — cf. aussi M. DELCOR,« Le scriptorium de Ripoll et son rayonnement culturel. État de la question », CSMC, 5, 1974, p. 45-64 ; — Bohigas fixele volume IV après la fin du XIe s. : P. BOHIGAS, La ilustración… (op. cit. n. 1), p. 74 ; — ID., « La miniatura a l’èpocaromànica », Lambard. Estudis d’art medieval, 1, 1985, p. 105-113 ; — R. ALCOY, « “Biblia de Rodes”… » (art. cit. n. 1),p. 295, propose la date de 1100 ; — de même M. E. IBARBURU ASURMENDI, De capitibus… (op. cit. n. 1), p. 207-240 ; —Zaluska hésite sur l’origine du quatrième volume de Roda et propose le second tiers du XIe s. pour les trois premiersvolumes et la seconde moitié pour le quatrième volume : F. AVRIL, J.-P. ANIEL, M. MENTRÉ et Y. ZALUSKA, Manuscritsenluminés… (op. cit. n. 1), p. 42. Proposent en revanche le XIIe s. pour le quatrième volume : I. LORÉS, El monestir deSant Pere de Rodes, Barcelone, Universitat Autònoma de Barcelona, 2002 (Memoria Artium, 1), p. 215-218 ; — C. MANCHO,« La peinture dans le cloître : l’exemple de Sant Pere de Rodes », CSMC, 34, 2003, p. 115-133.
proximité des deux manuscrits à une époque postérieure à celle où ils furent produits, et deréexaminer la discussion sur l’origine et la datation des images ajoutées dans le Nouveau Testamentdes deux bibles4.
Avant de procéder à l’analyse des illustrations, il est nécessaire de résumer brièvement le contextecritique et l’état actuel du débat sur ce sujet.
NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LA BIBLE DE RODA 331
4. Dans des études précédentes, j’ai suggéré l’hypothèse qu’il s’agissait du même illustrateur ; je n’ai toutefois querécemment eu l’occasion de réétudier de près le codex parisien et de le confronter à une bonne version numérisée del’illustration de la bible vaticane. Yolanta Zaluska (Centre national de la recherche scientifique) et Marie-Thérèse Gousset(Bibliothèque nationale de France) ont contribué à cette enquête minutieuse ; je tiens à les remercier pour leur disponi-bilité, leur patience et leurs précieuses observations. La récente étude a été rendue possible grâce à l’invitation de Marie-Joseph Pierre à la section des Sciences religieuses de l’École pratique des hautes études, à laquelle va ma profondereconnaissance. Pour une analyse de toutes les mains qui opérèrent dans les deux bibles et dans d’autres codices d’originecatalane et sur les méthodes de production libraire dans le scriptorium, cf. A. CONTESSA, « Revealing pages : The Productionof manuscripts at the Catalan Scriptorium of Abbot Oliba of Ripoll (1008-1046) », Avista newsletter, 2005, p. 47-48 ; —ID., « The Scriptorium of Ripoll. State of the Question Revisited » (à paraître dans A. CONTESSA, The Scriptorium ofAbbot Oliba. The Catalan Bibles and the production of manuscripts in eleventh century Ripoll – en préparation pourHarvey Miller/Brepols).
Fig. 1. — Bible de Roda, BnF,lat. 6, vol. IV, f. 103v.
(Cliché Bibliothèque nationale de France.)
Fig. 2. — Bible de Ripoll, Bibl. Apost. Vat.,lat. 5729, f. 388.
(Cliché Biblioteca Apostolica Vaticana.)
L’écriture tardive
Un des arguments servant à confirmer l’exécution tardive et ailleurs qu’à Ripoll du volume IVde la Bible de Roda est la présence d’une écriture grande, arrondie, à l’encre noire – différentede la brune utilisée normalement –, qui dénote une main plus tardive que celles qui sont respon-sables des deux bibles. Les caractéristiques de cette écriture ont souvent été attribuées à l’ensembledu volume, mais il faut rappeler que le changement d’écriture survient au soixante-neuvièmecahier d’origine, correspondant à la Première Épître de Paul aux Corinthiens (15,43)5. Une grandepartie du volume a été effectuée par l’un des copistes principaux, celui qui est le plus prochedu scribe de la bible vaticane et qui, selon l’analyse soignée de Yolanta Zaluska, est responsabled’une bonne partie des volumes II et III, ainsi que des corrections apportées au volume I. Lechangement d’écriture est dû à un événement inattendu, puisque le texte s’interrompt brusquementau milieu d’une phrase ; le travail fut achevé par un autre scribe qui, un peu plus tard, terminales Épîtres et l’Apocalypse. Ce scribe est en outre responsable du livre de Job situé dans levolume III. Par ailleurs, on ne peut repousser la date de cette écriture trop en avant, car elleparaît plus proche de celle des codices de Ripoll datés de la moitié du siècle, tels les manus-crits BnF lat. 5302 et lat. 53046, que de celle d’autres manuscrits remontant à la fin du XIe s. ouà plus tard, tels le Vat. lat. 5730 et les codices BnF lat. 5923 et lat. 51327.
Le cycle du Nouveau Testament
La recherche n’a pas suffisamment pris en considération que, dans les deux manuscrits, le NouveauTestament est resté inachevé et parsemé d’interventions postérieures. Pour une raison que nousignorons, les deux bibles ne furent pas terminées, alors même qu’elles avaient été conçues pourêtre entièrement illustrées. C’est la raison pour laquelle elles furent reprises à des moments diverset successifs, afin d’être au moins partiellement complétées avec des dessins ou de la couleur.Dans la Bible de Roda, on avait probablement planifié d’illustrer non seulement l’Apocalypsemais aussi les Évangiles. En effet, des espaces vides s’intercalent au texte : ils étaient prévus pourles illustrations de l’Apocalypse ainsi que pour les portraits des apôtres (f. 8) – en correspon-dance avec le prologue de l’Évangile – et des évangélistes (f. 9v-10). La plupart de ces portraitsn’ont jamais été exécutés, alors que le copiste de Ripoll lui-même les avait prévus puisque, dansce but, il avait laissé un espace blanc. La même chose se passa pour les illustrations de l’Apo-calypse qui ne furent réalisées que plus tard, et encore seulement partiellement.
Dans la bible vaticane, seule la figure de l’évangéliste Luc manquait et a été ajoutée ultérieu-rement (f. 388). En même temps, une autre figure (f. 181v) a été colorée dans des tons au colorisdélicat et avec de savants lumina qui relèvent d’un style inconnu à Ripoll dans la première moitiédu siècle. Aucune des huit pages de la Bible de Ripoll contenant en registres le vaste cycle desÉvangiles n’est complétée par la couleur et le contour final comme c’est, en revanche, le casdans les illustrations de l’Ancien Testament. Dans certains cas, les scènes ne présentent qu’uneesquisse à l’encre claire ; dans d’autres, le dessin est terminé, mais la couleur n’a été ajoutéequ’en partie, ou bien alors c’est le contour qui manque.
L’inachèvement des deux manuscrits fait qu’on ne saurait exclure l’hypothèse qu’un cycle del’Apocalypse était aussi prévu pour la Bible de Ripoll, mais n’a jamais été réalisé : les imagesauraient pu être regroupées sur des folios à part, insérés ensuite à leur juste place, comme c’est
332 CAHIERS DE CIVILISATION MÉDIÉVALE, 51, 2008 ANDREINA CONTESSA
5. La composition d’origine du volume unique regroupait soixante-quatorze cahiers (cf. n. 1).6. BnF, ms. lat. 5302, Lectionarius officii (pars hiemalis), daté du milieu ou du troisième quart du XIe s. ; — Lectio-
narius officii (pars hiemalis), BnF, ms. lat. 5304, daté du milieu du XIe s. ; — cf. F. AVRIL, J.-P. ANIEL, M. MENTRÉ etY. ZALUSKA, Manuscrits enluminés… (op. cit. n. 1) p. 30-31, pl. XIII et p. 44-45, pl. XXII-XXIII.
7. GRÉGOIRE DE TOURS, Historia Francorum, BnF, ms. lat. 5932, daté de la fin du XIe ou du début du XIIe s. Cf.F. AVRIL, J.-P. ANIEL, M. MENTRÉ et Y. ZALUSKA, Manuscrits enluminés… (op. cit. n. 1), p. 43-44, pl. D ; — ATHANASIUS,Altercatio fidei catholica, BnF, ms. lat. 5132, daté de la première moitié du XIIe s. F. AVRIL, J.-P. ANIEL, M. MENTRÉ etY. ZALUSKA, Manuscrits enluminés… (op. cit. n. 1), p. 54-55, pl. XXVII.
le cas pour le cycle de l’Exode (f. 82) ou celui de Job (f. 161) qui ont été, l’un et l’autre, ajoutésau fascicule correspondant. En outre, l’absence du cycle de l’Apocalypse dans la Bible de Ripollne constitue pas une preuve de l’inexistence d’un tel codex illustré dans le scriptorium de Ripoll,qui devait d’ailleurs être un des plus fournis de la région. En effet, d’autres cycles, sûrementprésents à Ripoll, ne se trouvent pas dans la Bible de Roda, comme, par exemple, celui del’Exode dont on connaissait à Ripoll au moins deux versions, toutes deux insérées dans le codexdu Vatican, l’une au f. 82 et l’autre au f. 18.
Le maître de Luc et l’Apocalypse
Dans la Bible de Roda, le cycle de l’Apocalypse a été illustré par diverses mains, tout en restantfinalement inachevé. La première main a réalisé les illustrations contenues entre le f. 103v (visiondes sept candélabres) et le f. 105v, en insérant les images dans les espaces précédemment laissésen blanc par le copiste [fig. 3-4]. La même main a exécuté ensuite une partie du f. 106 (certai-nement les deux premiers cavaliers et une partie du quatrième), mais est intervenue ici uneseconde main qui a repassé le contour avec une autre encre et a peut-être couvert le dessinoriginal du premier illustrateur. On peut dire la même chose du f. 106v où le dessin original àl’encre claire est encore visible sous celle, plus foncée, utilisée par la seconde main. Cela concordeparfaitement avec la manière de travailler des illustrateurs de Ripoll au temps de l’abbé Oliba,dont je me suis occupée dans un autre travail : une image pouvait être dessinée, colorée etpourvue finalement d’un contour par trois mains différentes, selon un processus qui rend difficileles attributions et fait apparaître dans le scriptorium un travail en chaîne totalement indifférent
NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LA BIBLE DE RODA 333
8. Cette dernière, peut-être légèrement plus tardive, se fonde sur le modèle qui est aussi à la base des sculpturesdu portail du XIIe s.
� F. 105v.� F. 104.
Fig. 3 et 4. — Bible de Roda, BnF, lat. 6, vol. IV.
(Clichés Bibliothèque nationale de France.)
au concept d’auteur9. Une autre main – proche de celle qui commence les portraits des évangé-listes au f. 8v – travaille ensuite au f. 107, une autre enfin au f. 107v.
Si l’on observe les figures exécutées par la première main et le saint Luc de la bible vaticane,on distingue nettement des éléments communs [fig. 1-2]. Bien qu’il soit difficile de comparer unsimple dessin à une image colorée et pourvue d’un contour, on remarque aisément que les figuressont larges et massives, caractérisées par des pieds courts et une grande tête aux oreilles lobées,émergeant d’une chevelure légère à larges boucles, dont les ondulations sont remplies à l’inté-rieur de petits traits ; le drapement des vêtements tend en outre à regrouper les plis sur un côtéà la manière d’un éventail, et à les montrer comme vus d’en bas. Les traits du visage, des yeux,des mains et des pieds sont un indice particulièrement significatif du style de l’illustrateur. Il fautpar exemple comparer la figure de Luc à la figure divine barbue représentée au f. 105v [pl. 1].Les yeux sont formés d’une série de lignes courbes au centre desquelles se détache une grandepupille. La bouche est constituée d’un long trait horizontal, fermé aux extrémités par deux courtssegments et relié au nez par une courte ligne verticale ; sous le trait horizontal un autre, parallèle,est dessiné au centre et sous celui-ci, un petit trait courbe relie la bouche à la barbe. Les nezsont identiques, sauf la ligne qui relie le nez à l’œil gauche de Luc et non à l’œil droit commedans la figure divine. Cela dépend de la position de mi-profil de Luc, semblable à celle desfigures en adoration situées dans le dernier registre à droite du clipeus avec l’agneau (f. 105v) :leur nez et leurs yeux sont parfaitement comparables à ceux du saint Luc.
On retrouve cette ressemblance dans la facture des mains [pl. 2], caractérisées par les phalangesen relief (la main gauche de saint Luc et f. 104v et 105), par une ou deux lignes courbes surle dos et par l’évocation maladroite du muscle de l’avant-bras (main droite de Luc, premier angedu f. 104 et Jean, f. 105). Les particularités de la main droite de Luc, avec le pouce et le médiusallongés et ouverts en « V », l’annulaire et l’auriculaire pliés, se retrouvent dans presque toutesles mains des anges (f. 104-104v, 105-105v). Les pieds courts et potelés de saint Luc sont parfai-tement semblables à ceux de nombreuses figures en pied qu’on retrouve dans l’Apocalypse : lepied droit de saint Luc, avec son pouce protubérant et une ligne tracée sur la partie supérieuredu pied en parallèle avec la ligne du doigt, rappelle celui des figures en adoration mentionnéesci-dessus, ou des anges des f. 104v et 105 [pl. 3]. Le profil du pied gauche de Luc [pl. 3b], avecses doigts protubérants, peut se comparer à celui du pied droit de l’ange portant la mandorleen forme de 8 du f. 103v [pl. 3a], dont la malléole protubérante est indiquée par un signe rondmuni de deux petites queues, exécuté en traits extrêmement légers, presque un gribouillis, quiconstitue de fait un signe propre à l’illustrateur, une sorte de signature. Ce détail importantapparaît également dans la cheville du saint Luc de Ripoll.
L’illustration du saint Luc et celles de l’Apocalypse aux f. 103v-105v du volume IV de la Biblede Roda ont donc certainement été réalisées par la même main, probablement peu après lamoitié du XIe s., c’est-à-dire quelques dizaines d’années après la production des deux bibles. Dece fait se repose la question du lieu où se trouvait la Bible de Roda lorsque les illustrationsfurent ajoutées. Si elle était déjà à Roda, nous devrions supposer que la Bible monumentale deRipoll a été amenée à Roda pour la seule adjonction de l’évangéliste Luc. Cela étant tout à faitimprobable, seules deux hypothèses restent plausibles : ou bien les circonstances ont conduit unmême artiste itinérant à compléter les deux bibles, l’une située à Ripoll et l’autre à Roda ; oubien, ce qui est probablement plus raisonnable, nous devons supposer que les deux manuscritsse trouvaient encore à Ripoll lorsque les figures furent ajoutées.
Ces derniers éléments, qui permettent d’attribuer également au scriptorium de Ripoll le derniervolume de la Bible de Roda, sont parfaitement cohérents avec ce que révèle l’examen attentifdes volumes précédents, où l’on a reconnu une autre main commune aux deux bibles, et laressemblance des scribes, décorateurs et illustrateurs10.
334 CAHIERS DE CIVILISATION MÉDIÉVALE, 51, 2008 ANDREINA CONTESSA
9. A. CONTESSA, « Revealing pages… » (art. cit. n. 4) ; — ID., « The Scriptorium of Ripoll… » (art. cit. n. 4).10. Ibid.
NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LA BIBLE DE RODA 335
a. Bibl. Apost. Vat., lat. 5729, f. 388, détail.
(Cliché Biblioteca Apostolica Vaticana.)
b. BnF, lat. 6, vol. IV, f. 103v, détail.
(Cliché Bibliothèque nationale de France.)
� d. BnF, lat. 6, vol. IV, f. 103v, détail.� c. BnF, lat. 6, vol. IV, f. 105v, détail.
(Clichés Bibliothèque nationale de France.)
Pl. I.
336 CAHIERS DE CIVILISATION MÉDIÉVALE, 51, 2008 ANDREINA CONTESSA
a. Bibl. Apost. Vat., lat. 5729, f. 388, détail. (Cliché Biblioteca Apostolica Vaticana.)
b. BnF, lat. 6, vol. IV, f. 104v, détail ; c. BnF, lat. 6, vol. IV, f. 103v, détail ; d. BnF, lat. 6, vol. IV, f. 103v, détail ;e. BnF, lat. 6, vol. IV, f. 103v, détail ; f. BnF, lat. 6, vol. IV, f. 104v, détail.
(Clichés Bibliothèque nationale de France.)
Pl. II.
a
d
e f
b
c
Le style du maître de Luc et de l’Apocalypse
La comparaison du style de cet illustrateur avec celui des autres mains à l’œuvre dans d’autresmanuscrits de Ripoll permet de confirmer que son travail s’inscrit clairement dans la continuitéet dans le développement du style de ce scriptorium. En observant, par exemple, le style desmaîtres qui exécutèrent la vision d’Ézéchiel et le songe de Jacob dans la bible vaticane (f. 3v),on relève que tous deux présentent des figures massives et basses aux proportions moins allongéesque celles des grands maîtres des Bibles catalanes : visages larges et un peu carrés quand ilssont vus de face, ou bien caractérisés par des profils aigus, comme on en trouve dans les illus-trations de l’Apocalypse (f. 104v, 105v, 106), et, bien que rarement, dans les tables canoniques dela bible vaticane. Des figures trapues à grosse tête se retrouvent aussi dans l’Évangéliaire de Vichque l’on attribue au milieu du XIe s.11, et, plus tardivement, dans un autre codex provenant deRipoll, le Vat. lat. 5730, qui date de la fin du siècle, où sont largement représentés des visages
NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LA BIBLE DE RODA 337
11. Textus quattuor evangeliorum, Vich, Biblioteca Episcopal, ms. 15, f. 8v, cf. J. GUDIOL, Catàleg dels Llibres manus-crits anteriors al segle XVIII del Museu Episcopal de Vic, Barcelone, Casa de la Caritat, 1934, p. 34-36.
a
b c
a. BnF, lat. 6, vol. IV, f. 103v, détail. (Cliché Bibliothèque nationale de France.)
b. Bibl. Apost. Vat., lat. 5729, f. 388, détail. (Cliché Biblioteca Apostolica Vaticana.)
c. BnF, lat. 6, vol. IV, f. 104v, détail. (Cliché Bibliothèque nationale de France.)
Pl. III.
aigus et prononcés semblables à ceux relevés dans les imagesde l’Apocalypse12 [fig. 5]. L’analyse de ces manuscrits révèleque dans la seconde moitié du siècle, à Ripoll, les illustra-tions comme l’écriture se font plus grandes, la colorationsoignée est exécutée dans des tons vifs, en couleurs denseset recouvrantes, finement illuminée par lumina, tandis queles traits des figures et des visages se font plus largesjusqu’à adopter parfois une certaine rigidité.
Les caractéristiques relevées dans les manuscrits de Ripollannoncent celles de l’illustrateur plus tardif du Beatus deTurin13 et se retrouvent en partie dans des manuscrits telsque l’Évangéliaire de Perpignan, provenant peut-être deCuxa, datable de la fin du XIe s. ou du début du XIIe s.14.Pour cette raison, certains chercheurs ont inscrit le volume IVde la Bible de Roda à l’intérieur d’une tendance régionale,dont ils suggèrent alternativement pour lieu d’origine lesscriptoria de Roda, de Gérone ou de Cuxa15. On voitpourtant mal comment exclure Ripoll de cette tendance« catalane », d’autant plus que Ripoll était de loin le scrip-torium le plus important de la région au XIe s. Rappelonsque François Avril et John Williams ont récemment proposéd’attribuer le Beatus de Turin au scriptorium ou aux illus-trateurs de Ripoll, en l’absence d’un corpus de manuscrits
de Gérone permettant d’attester les capacités du scriptorium de Gérone de mener à terme uneœuvre semblable16. Nous ne savons rien de la présence dès le XIe s. d’un scriptorium à Rodaauquel ne sont attribués que des manuscrits plus tardifs17. Nous savons en revanche du scrip-
338 CAHIERS DE CIVILISATION MÉDIÉVALE, 51, 2008 ANDREINA CONTESSA
12. Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. lat. 5730. Cf. A. ALBAREDA, « Els manuscrits de la Biblioteca VaticanaReg. lat. 123, Vat. lat. 5730 i el scriptorium de Santa Maria de Ripoll », Catalonia Monastica. Recull de documents i estudisreferents a monestirs catalans, 1, p. 23-96, ici p. 70 et ss. ; — P. BOHIGAS, La ilustración… (op. cit. n. 1), p. 60. Le textede ce commentaire, que l’on attribuait jadis à Augustin, a été restitué à Flore de Lyon ou à Pierre de Tripoli parJ. LEMARIÉ, « Le bréviaire de Ripoll. Paris, B.N. lat. 742. Étude sur sa composition et ses textes inédits », Studia etdocumenta, 14, 1965, p. 28-30. A. ORRIOLS I ALSINA, « Les illustracions del manuscrit Vat. Lat. 5730 i la seva relació ambaltres produccions catalanes de l’entorn del 1100 », Anuario de Estudios Medievales, 24, 1994, p. 943-966.
13. Turin, Biblioteca Nazionale, ms I.II.1. Cf. J. WILLIAMS, The Illustrated Beatus. A Corpus of the Illustrations of theCommentary on the Apocalypse, t. IV, The Eleventh and Twelfth Centuries, Londres, Harvey Miller, 2002, p. 26-30.
14. Perpignan, Bibliothèque municipale, ms. 1, f. 1, 2v, 3, 14v. Cf. P. BOHIGAS, La ilustración… (op. cit. n. 1), p. 66-67, 74, 81 et ss. ; — J. AINAUD DE LASARTE, Catalan Painting. The Fascination of the Romanesque, Genève, Rizzoli Inter-national Publications,1990, t. I, p. 45-46 ; — W. CAHN, Romanesque Manuscripts. The Twelfth Century, 2 vol., Londres,Harvey Miller, 1996 (A Survey of Manuscripts Illuminated in France), t. II, p. 61-62 ; — A. ORRIOLS I ALSINA, « Lesimatges preliminars dels evangelis de Cuixà », Locus Amoenus, 2, 1996, p. 31-46.
15. P. K. KLEIN, « Date et Scriptorium… » (art. cit. n. 3), p. 91-102 ; — M. E. IBARBURU ASURMENDI, De capitibus…(op. cit. n. 1), p. 232 et ss., tout en n’écartant pas l’hypothèse que le cycle de l’Apocalypse de la Bible de Roda ait étéexécuté à Ripoll, propose un déplacement d’axe vers Gérone, Cuxa et Roda sur la base d’une comparaison stylistiqueavec l’Apocaypse catalane actuellement conservée à Turin ; — cf. aussi A. ORRIOLS I ALSINA, « Les illustracions… » (art.cit. n. 11). Les deux chercheuses fondent leurs propositions sur les comparaisons stylistiques avec l’Apocalypse de Turinque toutes deux attribuent sans doute aucun au scriptorium de Gérone.
16. F. AVRIL, X. BARRAL I ALTET, D. GABORIT-CHOPIN, Le Monde roman, 1060-1220, t. II : Les royaumes d’occident,Paris, Gallimard, 1982-1983 (L’Univers des formes), p. 244 ; — A. ORRIOLS I ALSINA, « El Beatus de Torí i les imatgesprofanes », Lambard. Estudis d’art medieval, 13, 2001, p. 125-162 ; — J. WILLIAMS, The Illustrated Beatus (op. cit. n. 13),p. 26 et ss.
17. Klein se réfère à Villanueva qui, toutefois, parle de la bibliothèque et non du scriptorium, sans indiquer à quellepériode il fait référence. Sur les manuscrits de Roda, cf. M. J. ARNALL, « El pergamins de San Pere de Rodes a l’Arxiude la Corona d’Aragòn (segles XIII-XIV) », Lambards, Estudis d’art medieval, 2, 1986, p. 31-63 ; — M. D. MATEU IBARS,« Un inventari de la Biblioteca de San Pere de Rodes », ibid., p. 65-66 ; — X. BARRAL I ALTET, « El monastir de SanPere de Rodes objecte d’estudi fora de Catalunya : les etapes historiogràfiques », ibid., p. 66-77 ; — M. D. MATEU IBARS,« Un inventari de la llibreria del monastir de San Pere de Rodes », Studia Monastica, 31, 1989, p. 321-405 ; — J. ALTURO,« Un manuscrit du scriptorium de Sant Pere de Rodes (Catalogne) : le Tractatus in Iohannem de saint Augustin », Revue
Fig. 5. — Bibl. Apost. Vat., lat. 5730,f. 175v.
(Cliché Biblioteca Apostolica Vaticana.)
torium de Ripoll qu’il était en mesure de produire des œuvres de longue haleine accompagnéesd’un vaste et complexe appareil illustratif, même après la mort de l’abbé Oliba, survenue en 1046.De cette période nous est resté en effet un luxueux codex encyclopédique, le Vat. Reg. lat. 12318,daté avec certitude des années 1055-1058 par la main du scribe qui ajouta dans le cyclus decen-novenalis, à côté de la ligne correspondante à ces années, les paroles suivantes : eodem annofactus est liber iste [fig. 6-7]. Il s’agit d’un codex de mélanges à caractère scientifique, superbementillustré, contenant entre autres deux lettres du moine Oliba, dont une adressée à l’abbé Oliba(f. 126-126v)19. La mise en page et le style du manuscrit sont liés à la production du scriptoriumde Ripoll à l’époque d’Oliba, même si les illustrations de l’Aratée furent réélaborées et recoloréesen deux phases successives, probablement quand le codex se trouvait déjà à Saint-Victor deMarseille20. Ce codex permet de saisir l’évolution du style dans le scriptorium de Ripoll après le
NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LA BIBLE DE RODA 339
des études augustiniennes, 39, 1993, p. 155-160. I. Lorés fait l’hypothèse d’un scriptorium à Roda au XIIe s. dans El monestirde Sant Pere de Rodes (op. cit. n. 3), p. 214-228.
18. Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Reg. lat. 123. Cf. D. A. WILMART, Bibliothecae Apostolicae Vaticanaecodices manu scripti recensiti. Codices Reginensis Latini, 2 vol., Cité du Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1937-1945,t. I, p. 289 et ss. ; — A. ALBAREDA, « Els manuscrits… » (art. cit. n. 11). Sur les phases successives de la coloration, cf.A. CONTESSA, « The Scriptorium of Ripoll… » (art. cit. n. 4).
19. Epistola Olive monachi ad dominum Oliva episcopum de feria diei nativitate Christi. L’autre lettre fut écrite pourle moine Dalmatius : Epistola Olivae monachi ad Dalmacium monachum de feria diei nativitatis Christi. J. VILLANUEVA,Viage literario a las iglesias de España, t. VII, Valence, impr. de Oliveres, 1821, p. 222 et ss. ; — Diplomatari i escritsliteraris de l’abat i bisbe Oliba, éd. E. JUNYENT I SUBIRA, Barcelone, Institut d’estudis catalans, 1992 (Memories de laSeccio historico-arqueologica, 44), p. 336 et ss., p. 414. Le moine Oliba est considéré comme l’auteur des tables de comput,du Chronicon et du De Pasquali cyclo par J. PIJOAN, « Miniaturas españolas en manuscritos de la Biblioteca Vaticana.I. El manuscrito 123 Regina Lat. », Cuadernos de travajos de la Escuela Española de Arqueologia en Roma, 1, 1912,p. 1-10.
20. J. H. ALBANÉS, « La Chronique de Saint-Victor de Marseille », Mélanges d’archéologie et d’histoire, 6, 1886, p. 64-90 ; — A. ALBAREDA, « Els manuscrits… » (art. cit. n. 11). M. E. IBARBURU ASURMENDI, « La pervivencia de illustra-ciones sobre temas astronómicos del mundo clásico en manuscritos románicos a través del MS Vat. Reg. 123 », dans De
F. 170. �F. 201v. �
Fig. 6 et 7. — Bibl. Apost. Vat., Reg. lat. 123.
(Clichés Biblioteca Apostolica Vaticana.)
milieu du XIe s. et de situer le Maître de Luc et de l’Apocalypse après celui-ci, mais avant ladécadence du monastère qui, en 1069, fut incorporé à Saint-Victor de Marseille dont il resta sujetjusqu’en 1124.
Le programme illustratif
Le problème de la comparaison des cycles illustrés dans les deux bibles recoupe la question dela conception de leur programme textuel et iconographique : nous ne savons en effet ni pourquoini par qui furent initiés, presque en même temps, ces deux gigantesques et coûteux manuscrits,à la fois si semblables et pourtant si différents. La problématique s’élargit si nous envisageonsl’existence possible d’autres bibles, aujourd’hui perdues, ayant les mêmes mesures et les mêmescaractéristiques que les Bibles catalanes, comme pourraient en témoigner les fragments de la biblede Fluvià, Montserrat et Banyoles reconnus par Mundó21.
L’analyse du texte et des illustrations révèle qu’un énorme travail de recherche des sources etdes modèles a été accompli afin de produire ces bibles qui répondaient au projet de recueilliren un seul volume non seulement tous les livres de la Bible, mais aussi un riche appareil detextes extra-bibliques (apocryphes, deutérocanoniques, commentaires) et d’illustrations. Le textedes Bibles catalanes est une édition hybride de la Vulgate, riche en éléments provenant de laVetus Latina, interpolés au texte, ajoutés en gloses marginales, ou encore introduits en versiondouble de certains livres. Il est évident que ces deux bibles reflètent la même recension ; etpourtant les nombreuses différences – dans les capitula, les préfaces et l’ordre des livres – fontpenser qu’elles ont été intentionnellement composées pour être à la fois semblables et différentes.Leur caractère encyclopédique laisse supposer, à mon avis, qu’elles étaient destinées à l’étude età l’enseignement, plutôt qu’à la liturgie22.
La conception du projet iconographique des Bibles catalanes reflète une mentalité semblable àcelle qui présida à l’organisation du texte. Authentiques florilèges visuels de l’iconographie bibliquemédiévale, les Bibles catalanes conservent un grand nombre de scènes, rapprochées les unes desautres avec ce goût encyclopédique hérité de la culture isidorienne, mais souvent au détrimentde l’unité et de la cohérence de l’ensemble : des scènes peuvent être omises, répétées plusieursfois, placées hors de leur contexte, ou encore variées avec une extrême liberté de la part del’illustrateur23. Le caractère éclectique et encyclopédique des deux bibles est de toute évidence undes aspects spécifiques de la culture de l’époque d’Oliba et des productions de son scriptorium.
340 CAHIERS DE CIVILISATION MÉDIÉVALE, 51, 2008 ANDREINA CONTESSA
capitibus (op. cit. n. 1), p. 33-48 ; — M. A. CASTIÑERAS GONZÁLEZ, « La ilustración de manuscritos en Cataluña y su relacióncon el centros europeos » dans Cataluñia en la época carolingia. Arte y cultura antes del románico (siglos IX y X), Barcelone,Museo Nacional d’Art de Catalunya, 2000, p. 249-253, ici p. 251 et ss. ; — ID., « Las fuentes antiguas en el Menologiomedieval hispano : la pervivencia literaria e iconográfica de las Etymologías de Isidoro y del Calendario de Filócalo »,Bolletin del Museo Arqueológico Nacional, 12/1-2, 1994, p. 77-100 ; — ID., « Ripoll y les relacions culturals i artístiquesde la Catalunya altmedieval », dans Del Roma al Romànic. História, Art i Cultura de la Tarraconense mediterrània entreels segles IV i X, Barcelone, Enciclopèdia Catalana, 1999, p. 435-443 ; — ID., El Calendario Medieval Hispano. Textos eimágenes (siglos XI-XIV) Valladolid, Junta de Castilla y León, 1996, p. 25-38 ; — G. PUIGVERT I PLANAGUMÀ, « El manus-crito Vat. Reg. 123 y su posible adscripciòn al scriptorium de Santa Maria de Ripoll », dans Roma, magistra mundi. Itine-raria culturae medievalis. Parvi flores. Mélanges offerts au Père L. E. BOYLE à l’occasion de son 75e anniversaire, éd.J. HAMESSE, Louvain-la-Neuve, Fédération internationale des instituts d’études médiévales, 1998 (Textes et études du MoyenÂge, 10), p. 285-316.
21. Barcelone, Archivo de la Coruna de Aragón, ms frag. 322 ; — Montserrat, Biblioteca de Montserrat, ms frag.821-IV ; — Banyoles, Arxiu Históric Comarcal, frag. 1. Cf. A. M. MUNDÓ, « La cultura artìstica escrita », dans CatalunyaRomànica I, Introduciò a l’estudi de l’art romànic català, Barcelone, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1994, p. 133-162, icip. 154-155.
22. A. CONTESSA, « Le Bibbie dell’abate Oliba di Ripoll. Testo biblico e rinascita spirituale nella Catalogna dell’XI
secolo », Estudios Bíblicos, 61/1, 2003, p. 27-6423. Sur l’utilisation de sources iconographiques, voir : A. CONTESSA, « L’attesa dell’ariete. Il ciclo di Isacco nelle
Bibbie di Ripoll e di Roda », Storia della Miniatura, 6-7, 2001-2002, p. 17-28 ; — ID., « Le Bibbie catalane di Ripoll e diRoda e gli antichi cicli biblici lombardi della Genesi », Arte Lombarda, n.s., 140, 2004, p. 5-24 ; — ID., « Noah’s Ark onthe two mountains of Ararat : The iconography of the cycle of Noah in the Ripoll and Roda Bibles », Word & Image,20, fasc. 4, 2004, p. 257-270.
Au vu de ce qui a survécu de la production artistique catalane médiévale, le grand effort derécolte de matériel visuel accompli pour confectionner ces deux bibles monumentales est demeuréinfructueux : les deux codices ne furent pas achevés et, apparemment, ne furent jamais copiéspar la suite. Nous n’avons en effet aucune notice relative à une quelconque influence de leurpart sur l’iconographie d’autres manuscrits ou d’autres œuvres monumentales exécutées en Catalogneou ailleurs. La raison d’un tel échec nous est inconnue, tout comme d’ailleurs celle de l’impos-sibilité de trouver les forces capables d’achever dignement ces deux grands manuscrits. Peut-êtrejustement ce caractère excessivement éclectique et peu maniable ou bien l’iconographie insolite,peu claire et empruntée à des sources extra-bibliques, rendirent en peu de temps ces deux ouvragesobsolètes24.
Dans le grand projet de l’abbé Oliba, ils répondaient probablement à l’intention de faire renaîtrel’étude de la Bible en Catalogne, comme aux temps de Cassiodore et d’Alcuin, dans le but deformer et d’éduquer les moines de Ripoll, et peut-être des monastères « affiliés ». En cela, cesdeux bibles se distinguent des grandes bibles en un volume qui domineront la seconde moitiédu XIe et le XIIe s. et seront conçues pour l’usage choral monastique, comme, par exemple, lesBibles atlantiques. Mais Ripoll ne devint jamais pour la Catalogne ce que fut Cluny pour laFrance et pour l’Europe, et peut-être justement la diffusion de nouveaux ordres bénédictins enCatalogne contribua au déclin de ces bibles. Elles conservèrent toutefois un rôle significatif dansle monastère de Ripoll, comme on peut le déduire des tentatives de terminer les illustrationseffectuées à quelques années de distance par une nouvelle génération d’illustrateurs, élèves etsuccesseurs des maîtres des bibles ripolliennes.
Andreina CONTESSA
The Hebrew University of JerusalemFaculty of Humanities
Institute of Arts and LettersMt. Scopus
JERUSALEM 91905ISRAËL
NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LA BIBLE DE RODA 341
24. Sur l’iconographie inhabituelle des cycles des bibles catalanes, cf. A. CONTESSA, « Immagini del Paradiso nelleBibbie catalane di Ripoll e di Roda », Kronos, 7/1, 2004, p. 3-32 ; — ID., « Facta sunt coelum, maria [et] terrae. La creazionenelle Bibbie Catalane di Ripoll e Roda », Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae, 2005/1, p. 83-156 ; — ID., « BetweenArt, Faith and Science. The concept of Creation in the Ripoll and Roda Romanesque Bibles », Iconographica, 6, 2007,p. 19-43 ; — ID., « Imaging the Invisible God : Theophanies and Prophetic visions in the Ripoll and Roda Bibles »(à paraître en 2009 dans les Cahiers archéologiques).