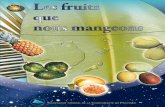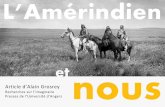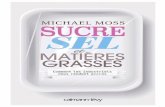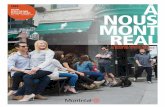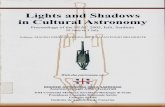Acquisition de la variation socio-stylistique dans l’interlangue d’apprenants hibernophones de...
Transcript of Acquisition de la variation socio-stylistique dans l’interlangue d’apprenants hibernophones de...
Acquisition de la variation socio-stylistique dansl’interlangue d’apprenants hibernophones de français L2 :
le cas de on et nousIsabelle LEMEE, University College Dublin,Marges Linguistiques, Novembre 2002, 4 :56-67.
1. IntroductionLes recherches en sociolinguistique sur la première langue (L1)ont montré que la variation linguistique constituait une dimensioncruciale de la compétence discursive. Elle affecte tous lescomposants de la langue, elle a beaucoup de récurrence dans lediscours oral et elle est contrainte à la fois par des facteurslinguistiques et sociolinguistiques. Jusqu’à aujourd’hui, lesétudes en Acquisition de Langue Seconde (SLA) se concentraientprincipalement sur les processus d’acquisition de morphèmesgrammaticaux invariants. De récentes recherches (Bayley, 1996 ;Regan, 1995, 1996, 1997 ; Young, 1991) ont pourtant pris uneperspective sociolinguistique et ont commencé à enquêter surl’apprentissage de cas spécifiques de la variation de la L1. Cesrecherches ont suggéré que les apprenants qui avaient réussi àmaîtriser avec succès la langue seconde (L2) non seulementutilisaient toutes les variantes des locuteurs natifs de la languecible, mais semblaient également produire la même compétencesociolinguistique – à savoir suivre les mêmes contraintessociolinguistiques – que les locuteurs natifs pour utiliser lesvariantes en question. Notre étude s’inscrit dans ce nouveaucourant.Le présent article va porter sur l’acquisition de la variationsocio-stylistique par des apprenants hibernophones de françaislangue seconde. De nombreuses études ont montré la difficulté queles apprenants avaient à acquérir la compétence sociolinguistiquedans la langue seconde et à utiliser de façon appropriée lesvariantes natives dans un contexte formel. Notre analysevariationniste va plus particulièrement se concentrer sur l’usagevariable des pronoms clitiques sujets on / nous pour désigner ungroupe de personnes incluant le locuteur (we en anglais), tel quedans l’exemple ci-dessous :
« en fait nous n’avons pas vraiment meublé euh on a utilisé des cartons vides et on amis du papier. » (Apprenant N, ligne 107/108)
Cette variation est commune à de nombreuses variétés de françaiscontemporain parlé. L’objectif de la présente étude est dedéterminer s’il existe une variation stylistique pour l’usage de onet nous chez les apprenants hibernophones de français L2 et si oui,quels sont les facteurs linguistiques et extralinguistiques quiinfluencent leur utilisation ?
1
2. Précédentes recherches sur la variation stylistique en françaisL2 : on/nous
De nombreuses études portant sur des corpus de françaiscontemporain de la métropole, et du Canada, ont enquêté surl’utilisation en alternance des pronoms clitiques sujets on et nous(Laberge, 1977 ; Boutet, 1986 ; Coveney, 2000 ; Fonseca-Greber etWaugh, 2002).Les études variationnistes ont depuis les deux dernières décenniescontribué de façon significative à une meilleure compréhension decertains aspects de l’acquisition des langues secondes, etnotamment l’acquisition de la variation socio-stylistique par lesapprenants L2. Il s’est souvent avéré que le choix des variantespar les apprenants L2 coïncidait avec le choix des locuteursnatifs de la langue cible. Un grand nombre d’études ont été menées sur l’utilisation de nouspar rapport à on dans l’interlangue d’étudiants canadiens enprogramme d’immersion en français. Swain et Lapkin (1990) ontrapporté que les apprenants étudiés vers la fin du programmed’immersion faisaient usage de on beaucoup plus fréquemment que lesapprenants en début de programme. Harley (1992) a également étudiéles effets de l’exposition à la langue cible sur le discours orald’apprenants participant à des programmes immersifs. Elle aensuite comparé ses corpus d’interlangue avec celui de locuteursnatifs du Québec. Les résultats ont montré que les locuteursnatifs utilisaient on exclusivement dans un contexte de premièrepersonne du pluriel. Les étudiants en début de programme immersiffaisaient usage de nous dans ce contexte, tandis que les apprenantsen fin de programme employaient on beaucoup plus fréquemment queles premiers.Plus récemment, Rehner, Mougeon et Nadasdi (2001) ont analysé laproportion de nous par rapport à on dans trois corpus : (i) uncorpus de discours oral de 41 apprenants anglophones de françaisL2 en immersion issus des classes moyenne et supérieure del’Ontario ; (ii) un corpus du discours de sept enseignants defrançais en immersion enregistrés durant la classe ; (iii) dumatériel écrit – à savoir deux séries de livres de classe –utilisé par les étudiants durant leur programme d’immersion.Rehner, Mougeon et Nadasdi (2001) ont souligné le fait que lesapprenants n’utilisent pas plus la variante nous que on, comme ilsl’avaient supposé, bien au contraire (44% contre 56%). Ils ontégalement été étonnés de la faible proportion de la varianteformelle dans le corpus oral des enseignants : 17% de nous contre
2
83% de on. Dans les matériels de classe, les livres des étudiantsont révélé 52% de nous contre 48% de on, tandis que dans lesouvrages contenant des textes journalistiques et littéraires, ilsont comptabilisé 83% de nous contre 17% de on. Une analyse des facteurs extralinguistiques influençantl’utilisation de on a montré que plus les apprenants étaientexposés à la langue cible en dehors de la classe et grâce auxmédia, plus ils utilisaient on. A l’inverse, les apprenants lesmoins exposés ont montré une plus faible proportion d’utilisationdu on. Ceci confirme l’impact positif des contacts avec les natifsde la langue cible en dehors de la classe sur l’apprentissaged’une variante informelle telle que le pronom on, celui-ci étantlargement utilisé par les locuteurs natifs en français québécois.De nombreuses recherches ont déjà rendu compte d’un effetsimilaire chez d’autres apprenants de français L2 (Blondeau et al,1995 ; Regan, 1996), ainsi que les apprenants d’autres languessecondes (Bayley, 1996).La recherche de Rehner, Mougeon et Nadasdi (2001) a montré quepour les corrélations sociales, le sexe et la classe sociale desapprenants ont produit l’effet escompté. Ainsi les femmes issuesde la classe aisée ont plus tendance à utiliser nous. Ce résultatrejoint celui de Blondeau et Nagy (1998) pour les apprenantsanglophones de français L2 à Montréal. Ces résultats semblentrefléter le fait que les apprenants ont inféré que le pronomclitique nous était une forme plus standard que on. Rehner, Mougeon et Nadasdi (2001) ont également mis en évidenceque les référents à la fois non-spécifiques et non-restreintsfavorisaient largement l’utilisation de on, tandis que les sujetsspécifiques et restreints favorisaient le pronom nous. Ce casprécis de variation reflète une maîtrise des contrainteslinguistiques observées par les locuteurs natifs de françaiscanadien. Dans leur étude, Rehner et al. avaient des apprenantsparlant espagnol ou italien dans leur foyer. Ces étudiants ontfavorisé le pronom nous, qui reflète la présence de noi et nosotrosdans ces langues, et l’absence de variantes identiques au pronomon. Les auteurs ont spéculé que les apprenants anglophones ontpréféré on en raison de la présence du pronom sujet one en anglais,lequel est similaire au niveau morphologique et phonétique, etsémantiquement lié au pronom on du français. Ils ont également émisune autre hypothèse, à savoir que ces apprenants anglophonesn’avaient tout simplement pas d’autre variante L1 pouvant lesmener vers le pronom nous.
3
Sax (2001) a enquêté pour découvrir si les productions langagièresde trente apprenants de français L2, de sexe féminin, à troisniveaux universitaires aux Etats-Unis, reflétaient le comportementdes locuteurs natifs dans leur utilisation de on et nous dans dessituations formelle et informelle. La situation formelleconsistait en un entretien d’embauche, et la situation informelleétait une conversation avec une nouvelle colocataire française.Elle a trouvé que les participantes des trois groupes ont employéon à des degrés différents : la proportion la plus basse (M=4%) aété trouvée dans le groupe des étudiantes en deuxième année,lesquelles n’avaient fait aucun séjour en France ou dans un paysfrancophone ; la proportion intermédiaire (M=57%) a été trouvéedans le groupe des apprenants de quatrième, dont la moitié avaitdéjà séjourné dans le pays de la langue cible, séjours allant dequelques semaines à un an ; la plus haute proportion (M=81%) a ététrouvée dans le groupe des ‘graduates’, qui avaient toutesséjourné entre un et quatre ans en France ou dans un paysfrancophone. Dans une étude précédente, Sax (1999) a souligné queles apprenants qui avaient séjourné dans le pays de la languecible pendant un an utilisaient le pronom on considérablement plusque celles qui y avaient passé moins de seize semaines. L’attitudeenvers la langue française a également été soulignée comme facteurd’importance, tout comme l’informalité dans l’entrevue qui ainfluencé l’utilisation du pronom on. Le contexte d’acquisition a été un facteur essentiel. Les troisgroupes de participantes ont plus fréquemment utilisé on durant laconversation informelle. Ceci nous amène à suggérer qu’il existeune certaine prise de conscience de la variation stylistique, mêmeavant que les étudiantes ne saisissent l’étendue de sonutilisation dans le discours des locuteurs natifs. La spécificitéet la non-restriction du pronom on ont favorisé l’utilisation de cepronom1, ainsi que le niveau de scolarité. La variation stylistiqueétait plus importante dans le groupe des étudiantes de quatrièmeannée (le pronom on étant utilisé à 46% dans la situation formellecontre 64% dans la situation informelle), puis de niveauintermédiaire dans le groupe des étudiantes de deuxième année (de1% à 6%), et finalement la plus faible variation stylistique a ététrouvée dans le discours des ‘graduates’ (avec 79% contre 82%). Enconséquence, Sax (2001) affirme que le temps passé à l’étrangerest en corrélation avec l’emploi de on.Dewaele (2002) a étudié l’utilisation des pronoms personnelssujets on et nous dans l’interlangue orale et écrite de trente-deux
1 Ce résultat diffère légèrement de ce que Rehner & al. (2001) ont trouvé.
4
Belges apprenant le français à un niveau avancé. Tous lesparticipants avaient été exposés au français vernaculaire par lebiais de chansons françaises, de bandes dessinées ou d’extraits defilms durant leur cursus universitaire. Toutefois, Dewaelesouligne que ces apprenants avaient peu l’occasion d’utiliser undiscours de style vernaculaire en communication authentique enraison du contexte monolingue offert par l’université danslaquelle ils étaient inscrits en Belgique.Une analyse quantitative du corpus oral a révélé que la quantitéd’interaction authentique dans la langue cible – mais pas laquantité d’instruction formelle – est liée de façon significativeau choix du pronom on (79,4% d’utilisation de on contre 20,6% denous). Son utilisation est en corrélation avec des taux deprécision morpho-lexicale, un plus haut débit discursif,l’omission de ne dans les structures négatives et un usage devocabulaire familier. Une analyse similaire du corpus écrit, constitué à partir d’untravail exécuté dans des conditions d’examen, a révélé desproportions identiques de on (78,1% contre 21,9% de nous), ce quisuggère que, en tant que groupe, les apprenants de l’étuden’avaient pas encore acquis complètement les contraintes socio-stylistiques associées à cette variable. Dewaele suggère que « the decision to use a certain speech style in a certainsituation is guided by the speaker’s interpretation of Grice’s maxim2. Speakers will only usea more formal, explicit style, if they deem it necessary to be unambiguously understood. »(2002 : p. 218)Par ailleurs, les apprenants avec une large proportion de nous dansle corpus écrit se sont avérés être les moins avancésgrammaticalement. Dewaele (2002) déclare que la présence de nousdans son corpus écrit semble indiquer le début de développement del’interlangue du participant plutôt que l’acquisition toutenouvelle de la compétence socio-stylistique.Les résultats de Dewaele (2002) ont corroboré avec ceux de Rehner& al. (2001) et Sax (2001) qui ont trouvé que la duréed’exposition à la langue cible est un facteur crucial dansl’utilisation de on. Toutefois, à la différence de l’étude deRehner et al. (2001), Dewaele (2002) n’a pas trouvé que le sexe etla classe sociale jouaient un rôle majeur dans l’emploi de on.A la lumière de ces recherches, présentons maintenant la nôtre.
2 Dewaele, 1995 ; 1996a ; 2001a.
5
3. Description de l’étudeCette étude va se concentrer sur l’acquisition de la langueseconde et la variation dans l’acquisition et l’utilisation despronoms clitiques on et nous dans le discours d’apprenantshibernophones de français L2. Les questions posées pour cetteétude sont les suivantes :1) les apprenants de français L2 à quatre niveaux d’apprentissagedifférents vont-ils montrer une variation socio-stylistique ence qui concerne l’utilisation des pronoms on / nous ?
2) quels sont les facteurs sociaux qui vont influer surl’acquisition de la variation stylistique par les apprenants defrançais L2 ?
3.1. Les intervenantsNous avons procédé à une étude quantitative pour recueillir desdonnées reflétant la variation linguistique dans l’usage despronoms au cours de l’acquisition chez 48 apprenants hibernophonesavancés. Notre étude est basée sur le discours spontané.Les participants à cette étude sont tous de nationalitéirlandaise, et au moment de l’étude, ils étudiaient tous lefrançais comme langue seconde. Ils ont tous participévolontairement à l’étude. La seule condition de sélection étaitleur capacité à maintenir une conversation pendant au moinsquarante minutes. Ceci a été un facteur important notamment pourles participants du premier groupe, que nous avons appelé‘intermédiaire’, dans la mesure où ce sont des apprenants quin’ont étudié le français L2 qu’à l’école secondaire, et pas encoreà un niveau universitaire.Les trois autres groupes de participants à l’étude ont un profillinguistique et extralinguistique similaire à ceux des apprenantsavancés identifiés par Bartning (1997), à savoir qu’ils ont étudiéla langue cible en tant que langue étrangère à l’école, souventdans un pays autre que celui de la langue cible, et ont continuéensuite à l’étudier à l’université. Il s’agit d’apprenants qui ontsuivi un apprentissage guidé et ayant des connaissancesmétalinguistiques de la langue cible. Leur apprentissage estparfois complété par des stages et des séjours à l’étranger. Présentons désormais nos groupes d’intervenants :1) Le premier groupe est constitué de sept femmes et sept hommes,âgés de 16 à 18 ans, se préparant au moment de l’entrevue àl’examen du Leaving Certificate, l’équivalent du baccalauréat.
6
Ils ont au préalable suivi cinq ou six ans de français au lycée.Ces femmes et hommes sont issus de familles relativement aisées,et la majorité d’entre eux ont fait des séjours réguliersannuels en France, ou dans un pays francophone, pendant deux outrois semaines, soit en vacances, soit en séjour linguistiquedans une famille française ou francophone.
2) Le second groupe est constitué de sept femmes et sept hommes,de 2é année à l’université. âgés de 18 à 22 ans, spécialistes dufrançais et d’une autre matière. Ils ont tous suivi au moins unan d’étude universitaire, et certains d’entre eux ont fait decourts séjours en France, entre deux semaines et trois mois,mais aucun n’y a séjourné pour une période allant au delà deseize semaines. Le contact avec la langue cible estessentiellement limitée à la salle de classe.
3) Le troisième groupe de huit apprenants avancés participant àl’étude est constitué de six femmes et deux hommes, âgés de 21 à23 ans et spécialistes du français et d’une autre matière. Ilsont déjà passé deux ans à étudier le français à l’université etsont dans leur dernière année d’étude. Nous l’avons appelé ‘legroupe de contrôle’, car les participants ne sont jamais partisplus de deux mois en France et sont rejoints par les étudiantsrevenant terminer leur diplôme après avoir passé un an enFrance. Ce groupe nous permettra de faire une comparaison trèsimportante entre ceux qui ont passé un an à l’étranger et ceuxqui ont décidé de continuer leur programme de langue sans partirquant à l’évolution de leur utilisation de la variante on3. Parmices étudiants, certains ont passé un an dans le pays de lalangue qu’ils étudient en parallèle du français, c’est-à-dire enEspagne ou en Allemagne, comme étudiants Erasmus.
4) Notre quatrième groupe est constitué de douze apprenantsavancés, six femmes et six hommes, âgés de 20 à 29 ans etspécialistes du français et d’une autre matière. Ils avaientdéjà passé deux ans à étudier le français à l’université avantde partir en France. Ils ont été sélectionnés pour participer au
3 Une comparaison véritablement idéale aurait été d’utiliser des étudiants pour le groupe de contrôle de niveau identique à celui des étudiants revenant de France, mais le petit nombre d’étudiants n’ayant jamais séjourné en France plus de seize semaines ne nous l’a pas permis. Nous avons tout de même essayé autant que possible d’avoir les mêmes niveaux de compétence dans ce groupe et le quatrième groupe. Le même problème s’est posé concernant le facteur du sexe. Afin de mener une analyse comparative de l’utilisation de on et nous dans le discours des locuteurs de sexe féminin et masculin, l’idéal aurait été d’avoir un nombre identique pour les deux sexes, mais, d’une part peu de hommes étudiaient le français et d’autre part, la majorité d’entre eux avaient passé plus de seize semaines en France ou dans un pays francophone.
7
programme Erasmus de séjour à l’étranger en raison de leur trèsforte motivation mesurée par des notes et des évaluations.D’autres sont partis comme au pair ou comme assistant de langueanglaise dans les collèges et lycées. Pendant leur séjour enFrance, les étudiants Erasmus ont suivi un enseignement (delangue et/ou de spécialité dans la langue cible) à l’universitéou dans une école de commerce et ont obtenu des équivalencesdans ce cadre. Ces mêmes étudiants ont aussi vécu soit enrésidence universitaire, soit en appartement avec des étrangersou des francophones. La plupart d’entre eux avaient lapossibilité de rendre visite à des familles françaises. Lescontacts avec les natifs français furent variés selon lesindividus, se caractérisant pour certains par leur inscription àdes clubs sportifs (le rugby, le football, le golf, legymnase…).
3.2. MéthodologieLes données ont été recueillies selon les modalités de l’enquêtesociolinguistique classique par entretiens enregistrés dans latradition développée par Labov (1966, 1994). Les techniques ontété adaptées à la spécificité de la recherche en SLA4. Une entrevuede 30 à 45 minutes a été menée par le chercheur en personne avecchaque intervenant. Ces entretiens avaient pour but d’enregistrerun discours aussi naturel que pouvait le permettre le contexte“semi-guidé”, en tête-à-tête, et dans les locaux de l’école ou del’université. Le chercheur a commencé par poser des questionsgénérales concernant l’apprenant, qui il/elle était, des questionsouvertes couvrant des thèmes tels que ses activités, sa maison, safamille, ses expériences personnelles en France ou dans un autrepays étranger, un souvenir particulier, le tout pour générer etmaintenir un échange verbal aussi spontané que possible. Un grandnombre de questions ont été générées par ce que disait leparticipant. Il n’y avait pas une série fixe de questions, maisnous avons essayé de déclencher des récits, et chaque questionétait posée spontanément. Des thèmes plus formels ont été abordés,tels que le sida, la drogue, l’importance du sport, l’Europe,l’environnement. L’ambiance se voulait aussi décontractée etinformelle que possible, et l’informalité de la situation s’estmanifestée par des rires et un débit rapide. Il n’y avait pas delimite de temps. On peut présumer avoir enregistré le discours le
4 Pour plus de détails, voir Adamson et Regan (1991), Dickerson (1975), Young etBayley, 1996.
8
plus spontané possible et le moins influencé par la présence del’observateur.Les entrevues ont été transcrites en orthographe standard selonles conseils de Blanche-Benveniste et Jeanjean (1986) et toutesles occurrences des pronoms on et nous ont été répertoriées. Notrebase de données est actuellement constituée de 1716 occurrences deces pronoms on et nous. Nous avons choisi d’utiliser le programme GoldVarb 2001 (Robinson,Lawrence & Tagliamonte, 2001), version PC du Goldvarbrul 2.0 pourMacintosh, lui-même ayant pour origine le Varbrul (Pintzuk, 1987 ;Rousseau & Sankoff, 1978 ; Rand & Sankoff, 1990), car ce programmeinformatique est conçu pour analyser des données linguistiques etpour manipuler et afficher ces données de diverses façons. Ceprogramme est tout particulièrement approprié quand les valeurs dela variable sont, dans les termes de Labov, « plusieurs façons de dire lamême chose ». Ce logiciel permet d’obtenir le calcul des fréquencesd’utilisation des variantes et d’identifier les facteurslinguistiques et extralinguistiques dans l’étude qui ont unecorrélation importante pour le choix des variantes en question.Nous avons exclu de notre analyse des occurrences telles que ‘ondit que’, ‘comment on dit’, toutes les répétitions consécutives despronoms on et nous n’étant pas suivi d’un verbe, les citations, tousles pronoms nous n’ayant pas la fonction sujet.
3.3. Les facteursNotre étude comporte une analyse de quinze facteurs linguistiqueset extralinguistiques. Pour cet article, nous avons souhaité n’enprésenter que cinq. Le premier facteur est le niveau despécificité et de restriction du groupe. Nous avons divisé cettecatégorie en trois groupes distincts suivant les considérations deBoutet (1986) : Spécifique et restreint (un groupe limité de gensque le locuteur peut compter et nommer, ex membres de safamille) ; (ii) Spécifique et non-restreint (un groupe dont lesindividus ne peuvent pas tous être identifiés, ex les personnesdans l’école du locuteur) ; (iii) Non-spécifique et non-restreint(l’humanité, les gens en général).Spécifique etrestreint
Ma sœur et moi, nous aimons les mêmes choses (#X, Groupe 1)
Avec mon équipe, on a gagné beaucoup de matches(# M, Groupe 4)
Spécifique et non Durant l’année de transition, nous avons fait
9
restreint un opéra (# e, Groupe 1) A l’université, on doit acheter beaucoup delivres (# A, Groupe 2)
Non-spécifique, nonrestreint
La vie que nous avons c’est vraiment différent(# T, Groupe 2)
Au Canada, on ne peut plus nager dans ce lac(# C, Groupe 4)
Nous avons souhaité présenter le sexe, la durée de résidence enFrance, les effets de la formalité des thèmes de discussion, laredondance communicative et le niveau de scolarité. Pour cedernier facteur, nous avons stratifié les participants en fonctionde la classe dans laquelle ils se trouvent au moment del’entrevue.3.4. Les hypothèses
1. Trois groupes sur 4 participant à l’étude n’ont pas eu decontacts prolongés avec des francophones en dehors de laclasse, nous supposons que, tout comme de précédentes étudessur la fréquence des variantes (Sax, 2001 ; Rehner, Mougeon,Nadasdi, 1999) l’ont montré, les apprenants ayant étudié leurL2 en contexte formel sont plus favorables à l’utilisation devariantes formelles que ceux exposés à des locuteurs natifsfrançais. Ainsi, nos participants des groupes 1, 2, et 3devraient plus favoriser nous plus que les participants dugroupe 4.
2. Nous émettons l’hypothèse que les apprenants ayant passébeaucoup de temps en contact avec des locuteurs natifsproduiront un grand nombre de on en raison d’une plus grandeexposition au registre informel de français parlé (Mougeon,Rehner, Nadasdi, 1999). En conséquence, nous pensons que lesétudiants revenus d’un an en France utiliseront le pronom onplus que les participants des autres groupes. Ceci devraitégalement être en corrélation avec la croyance que lesétudiants passant du temps dans le pays de la langue cibleacquièrent une L2 qui se rapproche de celle utilisée par lesnatifs, qui font largement usage de on.
3. Concernant le facteur du sexe des locuteurs, nous nousattendons à ce que le pronom nous soit favorisé par leslocutrices, ainsi corrélant avec les conclusions que nous estune variante standard et prestigieuse souvent associée auregistre formel. Fondé sur cette inférence, nous pensons queles locutrices favoriseront nous plus que les locuteurs, de lamême façon que dans les recherches en L1, il a été conclu que
10
les femmes favorisaient les variantes standard. Une autremotivation pour cette hypothèse est que nous est marqué auniveau stylistique, et les apprenants ayant passé du temps enFrance recevraient la confirmation de la valeur socio-stylistique inférée grâce au traitement des variantes encontexte de classe.
4. Les entrevues que nous avons fait passer étaient sensées êtredes conversations informelles, et les thèmes de discussiontraités étaient à la fois formel et informel. Nous supposonspar conséquent que les thèmes de discussion formels5 vontamener une plus grande utilisation de la variante nous.
5. Concernant les effets des facteurs linguistiques, nous avonslimité notre étude à la distinction de spécificité et du degréde restriction. Le fait que le pronom on soit fréquemmentutilisé pour faire référence à des sujets indéfinis nous amèneà attendre une relation linéaire dans laquelle une fréquencede on serait la plus haute dans les phrases où les sujetsseraient à la fois non-spécifiques et non-restreints, tandisque la fréquence serait au plus bas lorsque la référenceserait spécifique et restreinte.
4. Analyse et résultatsDans les quatre groupes, les premiers résultats ont montré unegrande variabilité dans l’utilisation des pronoms on et nous. Nosétudiants ont utilisé on plus souvent que nous (69% contre 31%). Cerésultat réfute la première hypothèse que nos étudiants fontpreuve d’un usage fréquent de nous. Ces résultats soulignent ladifférence qui existe entre les apprenants de français L2 et leslocuteurs natifs, car, comme les recherches de Laberge (1977) etCoveney (2000) l’ont souligné, les francophones n’utilisent quetrès rarement le pronom nous à l’oral (1,6% de nous dans l’étude deLaberge ; 4% de nous dans l’étude de Coveney).Concernant l’influence du temps passé en France, le tableau 1révèle que les apprenants qui sont revenus d’un séjour prolongé enFrance utilisent le pronom on plus abondamment que les apprenantsdes autres groupes.Groupe de facteurs % .p # (total = 1716)1 an3 - 8 semaines7 - 20 jours1 - 6 joursJamais
6975635063
.493
.570
.426
.302
.433
525/233403/131176/1025/5
87/495 Nous signifions par thèmes formels de discussion ceux ce rapportant à des thèmes tels que le Sida, la situation de l’Europe, le clonage, etc.
11
Input: .699Log likelihood = -1043,737Significance = .002Tableau 1 : Utilisation de on – Temps passé en FranceL’année à l’étranger et les contacts avec les locuteurs natifssemblent constituer un effet positif sur l’acquisition de lavariation socio-stylistique, mêmes si les variantes en questionsont moins utilisées par les apprenants que par les natifs6. Il estintéressant de constater que les apprenants partis un an utilisentmoins la variante informelle on que ceux ayant fait des séjoursentre trois et huit semaines.Les résultats montrent que les apprenants n’étant pas du toutpartis ou ayant fait de petits séjours en France ont eu tendance àplus utiliser nous, variante formelle souvent étudiée dans lecontexte de la classe. Ceci semble confirmer ce qui a été noté parMougeon, Rehner et Nadasdi (2002), à savoir que le contexte formelne contribue pas à l’apprentissage d’un répertoire de variantesnatives, tout simplement parce que ce contexte ne propose pas auxapprenants une grande variété de situations, mais également parceque de telles variantes sont évitées, ou sous-utilisées par lesenseignants et les auteurs de manuels.Le tableau 2 montre que le niveau de scolarité a un effetimportant sur l’utilisation du pronom on. Les résultats montrentque les apprenants du secondaire semblent sur-utiliser la varianteon et moins la variante nous. Alors que les participants du groupe4 semblent se partager la part égale avec les participants dugroupe 2, seul le groupe 3 se distingue avec un résultat moindre.Groupe de facteurs % .p # (total = 1716)Secondaire Deuxième annéeTroisième année Quatrième année
Input: .697Log likelihood = -1051,156Significance = .416
72696669
.537
.498
.464
.495
270/101238/104163/82525/233
6 Voir à ce sujet les travaux de Dewaele, 1992 ; Regan, 1996 ; Rehner et Mougeon, 1999 qui ont trouvé que les apprenants L2 font l’élision de la particule ne à un taux en dessous des locuteurs natifs.
12
Tableau 2 : Utilisation de on – Niveau de scolaritéEn ce qui concerne le facteur du sexe des apprenants, les hommesutilisent très largement la variante informelle, contrairement auxfemmes. Les étudiantes ont favorisé nous beaucoup plus que on, lepronom nous étant une variante plus typique de l’usage standard dufrançais7. Il existe un grand nombre de recherches sur la premièrelangue qui établissent que les locuteurs de sexe féminin et issusde la classe moyenne montrent une préférence pour les variantesstandard (Labov, 1990). Il est par conséquent possible que nosapprenantes soient prédisposées à transférer vers leur L2 l’usagede nous en fonction des informations qu’elles infèrent du traitementdes variantes dans la classe.Groupe de facteurs % .p # (total = 1716)FemmesHommes
Input: .697Log likelihood = -1050,403Significance = .039
6771
.473
.527555/270641/250
Tableau 3 : Utilisation de on – SexeLe quatrième tableau présente les résultats concernant le facteurde la formalité et in formalité des thèmes discursifs. De façonsurprenante, les apprenants ont eu une nette préférence pourl’utilisation de on lorsque des thèmes de discussion formels sontabordés (p = .681). On pourrait se poser la question de savoir sil’interlocuteur natif a une influence sur le discours del’apprenant afin de justifier le résultat obtenu par lesstatistiques concernant la formalité des thèmes de discussion. Eneffet, si l’on regarde les résultats concernant le déclenchementpar le locuteur natif de l’utilisation de on, il semble qu’il y aitici un lien entre les deux facteurs. Groupe de facteurs % .p # (total = 1716)FormalitéInformalité
Input: .715Log likelihood = -984,721Significance = .000
8458
.681
.363580/985616/731
7 Rappelons à cet effet le principe I de Labov (1972), selon lequel les femmes avaient plus tendance que les hommes à utiliser des formes prestigieuses. « For stable sociolinguistic variables, men use a higher frequency of non-standard forms than women. » (1990 : 210). Labov (1972) énonce également le ‘Principe II’ qui souligne que : « In change from below, women are most often the innovators. » (1990 : 215)
13
Tableau 4 : Utilisation de on – Formalité et in formalitéGroupe de facteurs % .p # (total = 1716)Le locuteur déclenche onLe locuteur ne déclenche pas
Input: .731Log likelihood = -1003,754Significance = .000
9866
.950
.4251038/1555157/160
Tableau 5 : Utilisation de on – Redondance communicativeLe dernier tableau montre l’influence de la spécificité et dudegré de restriction sur l’emploi de on. Comme les résultats lemontrent, une relation linéaire a été trouvée, avec une largepréférence pour on lorsque la référence est à la fois non-spécifique et non-restreinte, et inversement, plus la référence vaêtre spécifique et restreinte, plus les locuteurs vont avoirtendance à utiliser nous. Groupe de facteurs % .p # (total = 1716)Spécifique et restrictifSpécifique et non-restrictifNon-spécifique / non-restrictif
Input:.790Log likelihood = -718,128Significance = .000
308598
.102
.617
.939
169/394735/121292/5
Tableau 6 : Utilisation de on – Spécificité et restriction5. Discussion et conclusionDans cet article, notre tâche était de déterminer s’il existaitune variabilité dans le discours des apprenants à quatre niveauxde développement quant à l’utilisation des pronoms on/nous. Noussouhaitions également déterminer les contraintes ayant un effetsur l’utilisation de ces pronoms.Le schéma de variation trouvé dans le discours était significatif.Il existe une variation évidente dans l’utilisation de la variableon/nous par nos apprenants hibernophones, cela peu importe leurniveau d’instruction formelle ou leur quantité de contact avec deslocuteurs natifs. Ceci vient donc réfuter notre première hypothèseselon laquelle les apprenants L2 instruits formellement devraientsurtout utiliser la variante formelle nous. Dans notre cas, il y aeu une utilisation importante des deux variantes, voire même unesur-utilisation de la variante informelle. Le développement del’acquisition joue par conséquent un facteur important. En effet,
14
les apprenants du secondaire montrent une forte utilisation de onpar rapport à nous, ce qui réfuterait l’hypothèse énoncée plus hautselon laquelle, si il y a apprentissage en contexte formel, alorsil y a une plus haute fréquence de l’utilisation de nous. L’emploiimportant de on par les participants du secondaire peut sejustifier par le processus d’acquisition qui est toujours encours, mais également par un transfert de la L1 à la L2, le one enanglais. Par ailleurs, il faut signaler que ces participants ontsouvent eu l’opportunité de passer trois ou quatre semaines enFrance durant l’année de transition, ceci étant une possibilitéofferte par leur école.L’exposition à la langue cible dans la classe stimule avant toutla variante formelle nous avant le on. Mais au fur et à mesure dudéveloppement de la compétence linguistique de l’apprenant, celui-ci recherchera des interactions plus authentiques et ainsi seraamené à utiliser la variante informelle on. Les participants dequatrième année ont ainsi montré une utilisation du pronom on quisouligne l’existence d’une nette relation entre la fréquenced’utilisation de on et la compétence sociolinguistique, le niveaude précision grammaticale et la fluidité du discours. Lesapprenants utilisant on étaient d’un niveau plus avancé.L’analyse du corpus oral a révélé que le choix de la varianteinformelle on plutôt que la variante formelle nous était lié autemps passé à l’étranger. Notre deuxième hypothèse est confirmée.Ceux qui sont partis entre trois semaines et un an ont un taux deprobabilité plus élevé que les autres. Toutefois, il estintéressant de constater que ceux partis entre trois et huitsemaines ont une probabilité confirmant l’utilisation de on, tandisque ceux étant partis un an, ont une probabilité juste en dessousde la confirmation d’utilisation. Ces résultats peuvent êtrejustifiés dans le premier cas par une prise de conscience de lapart des apprenants de l’existence de la variante informelle et deson utilisation par les locuteurs natifs. Il en résulte ainsi queles apprenants n’étant pas partis pour un long séjour nemaîtrisent pas encore tout à fait la compétence sociolinguistiqueassociée à l’utilisation appropriée de cette variante informelleet se retrouvent dans une situation de sur-utilisation du pronom.Ceci reflète la compétence sociolinguistique des apprenants deniveau avancé et du manque de compétence grammaticale de ceuxn’étant pas partis plus de seize semaines8.Nos résultats concernant le facteur du sexe viennent confirmernotre troisième hypothèse et semblent corroborés les conclusions8 Sax, 1999 ; Regan, 1997.
15
de Rehner et al. (2001). Les femmes semblent s’en être tenues à lavariante formelle nous, tandis que les hommes ont plutôt choisis lavariante non standard. Ceci vient confirmer les nombreuses étudesfaites dans lesquelles il a été trouvé que les femmes utilisentles variantes informelles moins souvent que les hommes (Blondeauet Nagy, 1998)9. Pour ce qui est de notre quatrième hypothèse, elle a été réfutée.Le niveau de formalité et d’informalité est étonnant. Il ne semblepas y avoir de corrélation dans le choix entre le pronom et lestyle discursif. Il est possible que les apprenants n’aient pasencore totalement compris la valeur stylistique de la variableon/nous (Dewaele, 2002). L’autre explication possible est que lelocuteur natif a déclenché l’utilisation du on à la fois dans sescommentaires ou dans ses questions. Les apprenants sontgénéralement formés à l’écoute de la structure de la questionposée afin de répondre avec le temps et le mode approprié. Il estfort probable que les apprenants aient souhaité refléter lediscours du locuteur natif en copiant la syntaxe utilisée parcelui-ci.La dernière hypothèse a été confirmée. En effet, plus la référenceest spécifique et restreinte, plus il sera probable que leparticipant utilisera nous et inversement pour l’utilisation de on.Boutet (1986) a étudié de façon systématique le degré despécificité dans la référence à on et nous. Dans une récente étude,Mougeon et al. (2002) ont testé cette hypothèse sur un corpus oralde français d’immersion de l’Ontario et a trouvé des preuvesvenant soutenir l’hypothèse de Boutet.En conclusion, notre analyse de la variable on/nous a apporté desréponses claires à nos questions initiales. Nos apprenants à tousles niveaux étudiés montrent une variabilité dans l’utilisation dela variante on, mais à un degré moindre que les locuteurs natifs.Par ailleurs, notre étude a établi que le contact avec leslocuteurs natifs était un facteur important. Il a montré qu’ilavait un effet positif sur l’acquisition de cette variante. Nosrésultats soutiennent largement la revendication que plus lesapprenants de français L2 auront de contacts avec les locuteursnatifs, plus ils utiliseront et acquerront les variantesvernaculaires natives. Par ailleurs, il semblerait qu’une hauteproportion de on par rapport à nous dans l’interlangue française
9 Toutefois dans le cas de variation où la variante non-standard n’est pas stigmatisée en fonction de la classe sociale ou du style, il a été trouvé que lesexe n’était pas un facteur déterminant (Dewaele et Regan 2002, en rapport avec la rétention de ne ).
16
semble être une caractéristique d’apprenants possédant un niveauélevé de compétences sociolinguistique et grammaticale. Nouspouvons ainsi suggérer que l’utilisation des variantes socio-stylistiques que représentent on/nous suivent le schéma dedéveloppement allant de la non-utilisation et pour finir uneutilisation appropriée pour le pronom on. L’instruction formelle nesemble pas avoir un impact important sur l’utilisation de on.La raison d’une telle recherche est également pédagogique. Ilexiste une variété neutre de la langue pour des raisonspédagogiques basées sur les points suivants : (i) l’idéalisationdes locuteurs natifs concernant la norme linguistique ; (ii) lesattentes des locuteurs natifs pour l’usage approprié de leurlangue par des étrangers ; (iii) les points d’apprentissage.Le type de recherches dans lequel s’inscrit la présente étude aurades répercussions importantes quant à l’enseignement des languessecondes. Les résultats obtenus récemment montrent uneincontestable nécessité d’intégrer des activités dans la classequi permettraient aux apprenants d’être prêts à interagir avec deslocuteurs natifs dans un style informel lors de séjours dans lepays de la langue cible, grâce à l’utilisation de variantesvernaculaires. Cuq (1994), Critchley (1994) et Offord (1994) ontdéjà recommandé un développement de matériel pour l’enseignementde la variation stylistique en français L2, tout comme Mougeon etal. (2002) l’ont fait pour le français d’immersion au Canada.Par cette recherche, nous espérons que (i) le véritable usage deslocuteurs natifs sera mis en avant et respecté dans les manuels ;(ii) on sera introduit dans les manuels aux côtés de nous. Ilpourrait être proposé d’utiliser on à l’oral, tandis que nous seraitréservé pour l’écrit ; (iii) il y aura une acceptabilitésociolinguistique, et que l’usage de on sera rendu moinsstigmatisé ; (iv) qu’il y aura un développement de matériel pourl’enseignement de la variation stylistique en français L2.
BibliographieAdamson, H.D. & V. Regan. (1991). ‘The acquisition of community speechnorms by Asian immigrants learning English as a second language’,Studies in Second Language Acquisition, 13 : 1-22.Bartning, I. (1997). ‘L’apprenant dit avancé et son acquisition d’unelangue étrangère. Tour d’horizon et esquisse d’une caractérisation dela variété avancée’, dans I. Bartning (ed.), Acquisition et Interaction enLangue Etrangère (AILE) : Les Apprenants Avancés, Paris, Encrages, 9 : 9-50.
17
Bayley, R. (1996). ‘Competing constraints on variation in the speechof adult Chinese learners of English’, in R. Bayley & D. Preston(eds.), Second Language Acquisition and Linguistic Variation. Philadelphia : JohnBenjamins, 97-120.Blanche-Benveniste, C. & C. Jean-Jean. (1986). Le Français parlé : transcriptionet édition, Didier Erudition.Blondeau, H. & al. (1995). ‘Aspects of L2 competence in a bilingualsetting’, Paper presented to the 24th Conference of NWAV, Philadelphia:University of Pennsylvania, October 14-18.Blondeau, H. & N. Nagy. (1998). ‘Double marquage du sujet dans lefrançais parlé par les jeunes anglo-montréalais’, in J. Jensen & G.Van Herk (eds.), Actes du congrès annuel de l’Association canadienne de linguistique,59-70, Ottawa : Cahiers Linguistiques d’Ottawa.Boutet, Josiane. (1986). ‘La référence à la personne en français parlé: le cas de ON’, Langage et Société, N°38, 19-50.Coveney, A. (2000). ‘Vestiges of NOUS and the 1st person plural verb ininformal spoken French’, Language Sciences, 22 : 447-481.Critchley, S. (1994). ‘Discourse variety in contemporary Frenchlanguage’, dans Coleman, J.A. & R. Crawshaw (eds.), Discourse variety incontemporary French : Descriptive and pedagogical approaches, London : Associationfor French Language Studies and Centre for Information on LanguageTeaching, 203-236.Cuq, J.-P. (1994). ‘Cadre théorique et modalités d’insertion de lavariété linguistique dans l’enseignement du français langue étrangèreet seconde’, dans Coleman, J.A. & R. Crawshaw (eds.), Discourse variety incontemporary French : Descriptive and pedagogical approaches, London : Associationfor French Language Studies and Centre for Information on LanguageTeaching, 19-34.Dewaele, J.M. (1992). ‘L’omission du ne dans deux styles orauxd’interlangue française’, Journal of Applied Linguistics, 7 : 3-17.Dewaele, J.-M. (1995). ‘Style-shifting in oral interlanguage :Quantification and definition’, dans L. Eubank, L. Selinker & M.Sharwood-Smith (eds.), The Current State of Interlanguage, Amsterdam, New-York:John Benjamins, 231-238.Dewaele, J.-M. (1996). ‘Variation dans la composition lexicale destyles oraux’, I.R.AL., International Review of Applied Linguistics, XXXIV, 4 : 261-282.Dewaele, J.-M. (2001a). ‘Interpreting Grice’s maxim of quantity:Interindividual and situational variation in discourse styles of non-native speakers’, dans E. Németh (ed.), Cognition in Language Use: Selected
18
Papers from the 7th International Pragmatics Conference, Vol. 1, Antwerp:International Pragmatics Association, 85-99.Dewaele, J.-M. (2002). ‘Using sociostylistic variants in advancedFrench interlanguage’, dans Foster-Cohen, S. et A. Nizegorodcew (eds.)EUROSLA Yearbook 2001, Amsterdam – Philadelphia: Benjamins, 205-226.Dewaele, J.M. & V. Regan. (2002). ‘Maîtriser la normesociolinguistique en interlangue française : le cas de l’omissionvariable de ne’, Journal of French Language Studies.Dickerson, L. (1975). ‘The learner’s interlanguage as a system ofvariable rules’, TESOL Quarterly, 9 : 401-07.Fonseca-Greber, B. & L. Waugh. (2002). ‘The subject clitics ofEuropean conversational French: Morphologization Grammatical Change,Semantic Change in Progress’, dans Nùñez-Cedeño, R., L. López, & R.Cameron (eds.), Proceedings of the 31st Symposium in the Romance Languages,Amsterdam: John Benjamins.Harley, B. (1992a). ‘Patterns of Second Language Development in FrenchImmersion’, Journal of French Language Studies 2 : 159-185.Harley, B. (1992b). ‘Aspects of the oral second language proficiencyof early immersion, later immersion, and extended French students atgrade 10’, dans Courchêne, R.J., J.I. Glidden, J.St. John et C.Thérien (eds.), Comprehension-based Second Language Teaching, Ottawa: OttawaUniversity Press, 371-388.Laberge, S. (1977). Etude de la variation des pronoms définis et indéfinis dans lefrançais parlé à Montréal, PhD dissertation, Université de Montréal.Labov, W. (1966). ‘The Social Stratification of (r) in New York CityDepartment Stores’, Arlongton, VA : Center for Applied Linguistics, pp43-69.Labov, W. (1972). Sociolinguistic patterns, Philadelphia : University ofPennsylvania Press.Labov, W. (1990). ‘The intersection of sex and social class in thecourse of linguistic change’, Language Variation and Change (2), 205-254.Labov, W. (1994). Principles of Linguistic Change: Internal Factors, Oxford:Blackwell.Mougeon, R., T. Nadasdi & K. Rehner. (2002). ‘Acquisition de lavariation du français par les élèves d’immersion en Ontario’, Acquisitionet Interaction en Langue Etrangère, 7-50.Offord, M. (1994). ‘Teaching varieties and register’, dans Coleman,J.A. & R. Crawshaw (eds.), Discourse variety in contemporary French : Descriptive and
19
pedagogical approaches, London : Association for French Language Studiesand Centre for Information on Language Teaching, 185-202.Pintzuk, S. (1987). Varbrul programs for the IBM personal computer and for the VAX[Computer programs], Philadelphia, PA: University of Pennsylvania,Department of Linguistics.Rand, D. & D. Sankoff. (1990). GoldVarb: a variable rule application for theMacintosh, Montréal : Centre de Recherches Mathématiques, Université deMontréal.Regan, V. (1995). ‘The acquisition of sociolinguistic native speechnorms : effects of a year abroad on L2 learners of French’, in BarbaraFreed (ed.), Second Language Acquisition in a study abroad context.Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Co., 245-67.Regan, V. (1996). ‘Variation in French Interlanguage: A LongitudinalStudy of Sociolinguistic Competence’, in Robert Bayley & Dennis R.Preston (eds.), Second Language Acquisition and Linguistic Variation, Philadelphia:Benjamins, 177-201.Regan, V. (1997). ‘Les apprenants avancés, la lexicalisation etl’acquisition de la compétence sociolinguistique : une approchevariationniste’, Acquisition et Interaction en Langue Etrangère, Paris,l’Association ENCRAGES, 193-210.Rehner, K. & R. Mougeon. (1999). ‘Variation in the Spoken French ofImmersion Students : to ne or not to ne, that is the sociolinguisticquestion’, The Canadian Modern Language Review, Vol. 56, N°1 : 124-151.Rehner, K., T. Nadasdi, & R. Mougeon. (2003). ‘The learning ofsociostylistic variation: the case of on and nous in immersionFrench’, Studies in Second Language Acquisition.Robinson, J.S., H. Lawrence & S. Tagliamonte. (2001). ‘Goldvarbrul2001’,Paper presented at the 30th NWAV Conference, Raleigh (NC),October 11-14.Rousseau, P. & D. Sankoff. (1978). ‘Advances in variable rulemethodology’, dans Sankoff, D. (ed.), Linguistic variation: Models and methods,New York: Academic, 57-69.Sax, K. (1999). ‘Acquisition of stylistic variation by Americanlearners of French: the case of ne deletion’, Communication faite à la28ème Conférence NWAV, Toronto, 14-18 Octobre.Sax, K. (2001). ‘Stylistically Speaking: Variable Use of Nous versus Onin American Learners’ French’, Communication faite à la 30ème ConférenceNWAV, Raleigh (NC), 11-14 Octobre.Swain, M. & S. Lapkin, S. (1990). ‘Aspects of the sociolinguisticperformance of early and later French immersion students’, dans
20
Scarcella, R.C., E.S. Anderson & S.D. Krashen (eds.), Developingcommunicative competence in a second language, New York: Newbury House, 41-54.Young, R. (1991). Variation in Interlanguage Morphology, New York : PeterLang.Young, R. (1999). ‘Sociolinguistic Approaches to SLA’, Annual Review ofApplied Linguistics, 19 : 105-132.Young, R. & R. Bayley. (1996). ‘VARBRUL Analysis for Second LanguageAcquisition Research’, in Bayley, R. & D; Preston (eds.), SecondLanguage Acquisition Linguistic Variation, Studies in Bilingualism 10, 253-306.
21