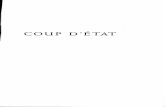Mechanism of Coup and Contrecoup Injuries Induced ... - MDPI
7. Le Plan Solo, anatomie d'un "coup d'état" ?
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of 7. Le Plan Solo, anatomie d'un "coup d'état" ?
Parlement[s] 67
Le « Plan Solo » : anatomie d’un « coup d’État »1 Alessandro Giacone Maître de conférences à l’Université Stendhal Grenoble 3 Groupe d’études et recherches sur la culture italienne (EA 611) alessandrogiacone arobase hotmail.com
Le 14 mai 1967, l’hebdomadaire L’Espresso publie le premier d’une série d’articles2 faisant état d’un « complot au Quirinal » qui aurait été ourdi, au cours de l’été 1964, par le président de la République italienne Antonio Segni et le commandant général des Carabiniers, le général De Lorenzo. Cela relance les rumeurs qui, trois ans auparavant, avaient déjà circulé au sujet d’une prétendue tentative de « coup d’État ». Les articles de L’Espresso seront à l’origine d’une longue série de
1 Cet article approfondit les recherches que j’ai menées dans le cadre d’une thèse de doctorat sur « La fonction présidentielle en Italie (1946-1964) ». Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à Mimmo Franzinelli, qui a mis à ma disposition les archives du général De Lorenzo et les épreuves du livre Servizi segreti e Piano Solo, dont la publication est prévue en 2010 aux éditions Mondadori. 2 L’Espresso des 14 et 21 mai, du 16 juillet, du 24 septembre et du 1er octobre 1967.
[Recherche]
Parlement[s] 68
procédures3. Aujourd’hui encore, le « Plan Solo » alimente le filon des livres consacrés aux « mystères d’Italie » et se trouve régulièrement au centre de polémiques journalistiques4 : le plan secret dont les enquêtes ont révélé l’existence était-il légitime ? Doit-il être considéré comme une tentative de coup d’État contre les institutions républicaines ou, pour le moins, comme un instrument de pression contre le gouvernement de centre-gauche ? Dans les pages suivantes, nous proposerons une reconstruction des événements de l’année 1964, sur la base des éléments issus des enquêtes et d’une série d’archives peu ou jamais exploitées.
Le président Segni pense s’appuyer sur les carabiniers en cas de coup de force communiste
Le changement d’alliance de la Démocratie chrétienne porte Segni au pouvoir. Depuis la fin de la coalition centriste (1953), l’Italie vit une période d’instabilité politique et de fortes tensions sociales. En juillet 1960, une série de grandes manifestations, organisées par les partis de gauche, a provoqué la démission du cabinet Tambroni, soutenu par une coalition réunissant la Démocratie chrétienne (DC) et les néo-fascistes du MSI. Les multiples affrontements qui ont opposé les manifestants à la police (on dénombre une dizaine de morts à travers le pays) sont à l’origine d’un traumatisme durable et de mémoires conflictuelles : à gauche, on assiste à un réveil de l’antifascisme ; à droite, on craint que le gouvernement ne puisse à nouveau être renversé par la rue5. La chute de Tambroni ouvre progressivement la voie à une
3 Sur le plan judiciaire, il s’agit d’abord d’un procès qui opposera De Lorenzo aux journalistes Eugenio Scalfari et Lino Jannuzzi. Viendront ensuite trois enquêtes internes au sein des Carabiniers et du ministère de la Défense (commissions Manes, Ciglieri et Lombardi), puis une commission parlementaire d’enquête, qui rendra ses conclusions en 1970. Les actes de ces trois commissions, partiellement couverts par le secret-défense jusqu’en 1990, ont donné lieu à une publication en cinq tomes : Relazione sulla documentazione, concernente gli «omissis» dell’inchiesta SIFAR, Rome, Senato della Repubblica – Camera dei deputati, X Legislatura, Doc. XXIII, n. 25, 1991. Les conclusions de la commission d’enquête parlementaire consistent en textes différents : le premier (Relazione Alessi) présenté par la majorité, les quatre autres (Relazioni Terracini, Biondi, Covelli, Franza) par les différents partis d’opposition. Commissione parlamentare d’inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964, Relazioni (2 vol.), Rome, Camera-Senato, 1971. 4 Voir par exemple les articles publiés par Paolo Mieli dans Il Corriere della Sera des 17, 19, 20 et 29 janvier 2004 et la réponse d’Eugenio Scalfari dans La Repubblica du 31 janvier 2004. 5 Giovanni De Luna, « I fatti di luglio 1960 » dans Mario Isnenghi (dir.), I Luoghi della memoria, personaggi e date dell’Italia unita, Rome-Bari, Laterza, 1997, pp.371-361.
[Recherche]
Parlement[s] 69
coalition de centre-gauche. Cette perspective a longtemps inquiété les modérés de la Démocratie chrétienne, en particulier le courant des dorothéens6. Lors du congrès de Naples (janvier 1962), ceux-ci ont fini par se rallier à une alliance avec les socialistes, tout en exigeant des garanties. Leur leader, Antonio Segni7, a ainsi été élu à la présidence de la République en mai 1962, afin de servir de contrepoids aux éventuels « débordements » du centre-gauche. En novembre 1963, après une première tentative infructueuse, le secrétaire de la DC Aldo Moro est parvenu à former un gouvernement de centre-gauche. Plusieurs représentants du parti socialiste (PSI), dont le leader du parti, Pietro Nenni, y participent pour la première fois depuis 1947.
Le chef des carabiniers : De Lorenzo. Avec Segni, Moro et
Nenni, Giovanni De Lorenzo est le quatrième grand protagoniste des événements de l’été 1964. Né en 1907, il participe à la Résistance, fait rare pour un officier de carrière, ce qui lui vaut la sympathie des communistes et des socialistes. En 1956, il est nommé à la tête du Service secret italien (le SIFAR8), où il gagne la confiance du président Gronchi et de Moro. Pendant cette période, il accroît notablement l’activité d’espionnage interne : en 1967, on découvrira l’existence d’environ 60 000 fascicules, où figurent toutes les grandes personnalités politiques. Grâce à ses amitiés politiques à droite et à gauche, mais aussi à son pouvoir de nuisance, De Lorenzo gravit rapidement les échelons. En 1961, il devient commandant général des carabiniers, tout en gardant des liens étroits avec le SIFAR. À la tête des carabiniers, De Lorenzo fait œuvre de modernisateur. L’exemple le plus marquant en est la naissance d’une Brigade mécanisée, qui défile pour la première fois le 4 novembre 19639, à la veille de la naissance du gouvernement Moro. Le nombre de blindés déployés étonne les observateurs, tel que l’ambassadeur français Bérard10.
6 Les dorothéens (ou dorothéistes) sont le courant issu d’une réunion dans un couvent du Janicule (appartenant aux sœurs dorothéennes, d’où le nom). Outre Segni et Moro, ses représentants les plus connus sont Mariano Rumor, Emilio Colombo et Francesco Cossiga. 7 Originaire d’une famille de grands propriétaires de Sardaigne, Antonio Segni (1891-1972) est le principal auteur de la réforme agraire de 1950. Dans les années suivantes, il est à deux reprises président du Conseil (1955-1957 et 1959-1960) et l’un des grands artisans des traités de Rome, signés au Capitole le 25 mars 1957. 8 SIFAR : Servizio d’informazione delle forze armate (Service de renseignement des forces armées). 9 Le 4 novembre, anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, correspond à la fête des armées. 10 Bérard au Quai d’Orsay (réservé), le 4 novembre 1963, MAE, Série Europe, Italie, dossier 329.
[Recherche]
Parlement[s] 70
Segni craint la rue et le coup de force. Depuis plusieurs années,
Antonio Segni redoute que, dans une situation comparable à celle de juillet 1960, la « rue » ne reprenne le pouvoir. Au moment de la deuxième crise de Berlin (été 1961), alors qu’il est ministre des Affaires étrangères, Segni écrit une lettre au ministre de la Défense pour l’inviter à prendre des mesures extraordinaires : « Il faudra, écrit-il à Giulio Andreotti, que tu veilles à ce que les carabiniers puissent maintenir l’ordre derrière nos forces armées, en apprêtant les plans qui seraient nécessaires. »11 Après son élection au Quirinal, Segni ne cache pas ses craintes d’un coup de force communiste, qui s’accentuent encore après le bon résultat du PCI aux élections du mois de mai et les grèves de l’été 1963. Il confie ainsi à l’ambassadeur Brosio que « l’Italie se rapproche d’un régime de type yougoslave »12. Reçu par le chancelier Adenauer, il critique violemment la politique de détente inspirée par Kennedy et Jean XXIII13. Nenni note à son tour que le président « voit les Cosaques dans la place Saint-Pierre »14.
Comment expliquer l’angoisse de Segni ? Pendant l’année 1963, après les fastes des années du « miracle économique » italien, les taux de croissance se sont effondrés et l’arrivée au pouvoir du centre-gauche n’est pas à même de rassurer les milieux industriels. Hostiles à l’égard de Moro, les conseillers présidentiels agitent le spectre d’un million de chômeurs dans les mois à venir15. Plus encore, le chef de l’État montre les premiers signes d’un état de santé défaillant et la situation s’aggrave au début de l’année 1964.
La genèse du « Plan Solo »
L’influence française et de De Lorenzo. C’est dans ce contexte qu’il faut situer la genèse du « Plan Solo ». En février 1964, Segni se rend en France pour un voyage d’État de quatre jours, qui le marque de manière profonde et qui permet probablement d’expliquer la suite
11 Lettre de Segni à Andreotti, le 23 août 1961, Archivio storico Istituto Luigi Sturzo (ASILS), Archives Giulio Andreotti, Carte presidente Segni, 61/8. Nous soulignons en italique les éléments les plus significatifs. 12 Fondazione Einaudi Torino (TFE), Diari di Brosio, vol. XV, 27 mai 1963. 13 Entretiens Segni-Adenauer (1er août 1963), Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1963 (Band II), Munich, R. Oldenbourg Verlag, 1994, pp. 874-881. 14 Pietro Nenni, Gli anni del centro-sinistra. Diari 1957-1966, Milano, Sugarco, 1982, p. 275. 15 Aldo Moro (éd. Sergio Flamigni), op. cit., p. 224.
[Recherche]
Parlement[s] 71
des événements. Comme l’écrira dans ses mémoires Paolo Emilio Taviani, à l’époque ministre de l’Intérieur,
« Mes réserves et, disons-le, mes différends avec [Segni] ont surgi dans la dernière année de sa vie politique et ont une date précise : le 22 février 1964, jour où [il] est rentré de son voyage en France. Je n’ai jamais compris ce qui lui est arrivé. Il fut très impressionné par l’organisation antistalinienne des Français. On lui avait dit que, si une guerre avait éclaté en 1962, tous les cadres communistes, officiels ou clandestins, auraient été transférés en quelques jours en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie. Lors de notre première rencontre, il me demanda ce que nous avions prévu dans le cas d’une insurrection armée communiste. Je lui répondis que – depuis la défaite interne des proches de Secchia – ni moi ni Vicari (le chef de la Police) n’avions des préoccupations de ce genre.
“Si l’on continue ainsi, me répondit-il sèchement, dans un an je serai obligé de confier le mandat du gouvernement aux staliniens.”
À partir du 22 février, Segni ne reçut plus Vicari. Il reçut seulement le général De Lorenzo, le commandant des Carabiniers. Peu à peu, il écarta de lui aussi Cossiga. Il les considérait trop à gauche. »16
Nous sommes bien renseignés sur le rôle de De Lorenzo qui, depuis longtemps, a su gagner la confiance du chef de l’État. Au cours de l’été 1963, Segni lui avait déjà demandé de faire circuler des rumeurs sur le danger d’un coup d’état communiste en Italie afin de lancer un avertissement au PCI17. Au retour de son voyage à Paris, le président le reçoit plusieurs fois au Quirinal. De Lorenzo partage son pessimisme sur la situation politique de l’Italie et commence à envisager des mesures d’exception. Au début du mois de mars, il s’en ouvre à des représentants de l’ambassade américaine à Rome :
« En admettant au préalable qu’il n’était pas question d’un coup d’État, De Lorenzo s’est empressé d’ajouter qu’il était grand temps que les responsables politiques du pays prennent des décisions responsables. Le gouvernement Moro […] ne pouvait pas continuer dans la même voie car le pays deviendrait communiste par défaut […]. “Le temps est
16 Paolo Emilio Taviani, Politica a memoria d’uomo, Bologne, Il Mulino, 2001, p. 372-373. 17 Télégramme IN68498 envoyé par l’ambassade des États-Unis de Rome, le 26 juin 1963, cité par Maurizio Molinari et Paolo Mastrolilli, « A che golpe giochiamo ? » dans La Stampa du 29 janvier 2004.
[Recherche]
Parlement[s] 72
venu de montrer notre fermeté, tant que les forces de l’ordre – en particulier les Carabiniers – sont toujours capables de contrôler la situation. S’il devait y avoir des manifestations dans la rue, il faudrait les affronter avec fermeté, même si de telles actions devaient faire des victimes [casualties]”.
Selon De Lorenzo, l’actuel gouvernement Moro devait être remplacé par un exécutif dirigé par Giovanni Leone (ancien président du Conseil), par Cesare Merzagora (président du Sénat), par Paolo Emilio Taviani (ministre de l’Intérieur), par un « gouvernement d’urgence » ou même par un nouveau gouvernement Moro qui ait du courage et une ligne d’action bien définie. Mais il devait être clair pour Moro et pour les autres leaders qu’il était temps d’agir. Dans ce but, a dit De Lorenzo, il avait un rendez-vous le […]18 avec Antonio Segni, le président italien, auquel il avait l’intention de parler dans ces mêmes termes. […]
De Lorenzo a poursuivi en se décrivant comme un homme qui d’habitude était patient, mais dont la patience était sur le point de s’épuiser. Il avait eu récemment de nombreux contacts avec plusieurs interlocuteurs […] et il avait trouvé beaucoup de soutiens à son point de vue »19.
L’acte de naissance du « Plan Solo ». Cet acte de naissance peut
être fixé au 25 mars 1964, date à laquelle De Lorenzo convoque une réunion secrète au siège de Rome, en présence du vice-commandant (le général Manes) et de tout l’état-major des Carabiniers. De Lorenzo demande aux commandants des trois divisions (les généraux Markert, Cento et Celi) de mettre au point un plan qui permette de faire face à d’éventuelles perturbations de l’ordre public. Comme les autres corps armés risquent d’être infiltrés par les communistes, les Carabiniers ne devront compter que sur leurs propres forces et, le cas échéant, agir « seuls » (d’où peut-être le nom de « Plan Solo »). Dans les jours suivants, les généraux Markert, Cento et Celi chargent leurs subordonnés d’apprêter un schéma sur les effectifs mobilisables dans les trois secteurs qui sont de leur ressort20. Le colonel Bittoni prépare rapidement un projet relatif à la ville de Rome, tout en précisant qu’il serait inapplicable en raison de la faiblesse des effectifs présents dans
18 La date de ce rendez-vous avec Segni n’a pas été déclassifiée par les autorités américaines. 19 Foreign Relations of the United States (FRUS) (1964-1968), vol. XII, p. 187. 20 Les généraux Markert, Cento et Celi dirigent respectivement les divisions de Milan, de Rome et de Naples.
[Recherche]
Parlement[s] 73
la capitale21. Des plans analogues sont rédigés pour les villes de Milan et de Naples.
Le contenu du plan. Le 10 mai, le « Plan Solo » est prêt. Il s’agit
en réalité de trois textes différents22. Le premier porte sur les « aires vitales » de l’Italie du nord (les villes de Milan, Turin et Gênes). Entre autres mesures, il prévoit l’occupation des sièges de trois partis de gauche (le PCI, le PSI et le PSIUP) et du journal communiste L’Unità. Le deuxième envisage l’intervention des Carabiniers dans les centres stratégiques de la ville de Rome. Il est complété par deux autres plans pour la défense de la télévision italienne et du Quirinal. Le troisième texte concerne l’Italie méridionale, en particulier les villes de Naples, Bari et Palerme.
L’aspect le plus controversé du « Plan Solo » concerne la liste les personnes à déplacer (enucleandi) en cas d’émeute. Au mois d’avril, De Lorenzo a demandé au SIFAR de lui adresser les inventaires des subversifs (la rubrique « E »), disponibles dans toutes les préfectures de police, qui n’ont cependant pas été mis à jour depuis 1956. On parvient ainsi à une liste de 731 personnes, transmise le 13 avril aux trois commandants de division. Une fois arrêtés, les enucleandi seraient transférés, par avion et par bateau, dans la localité de Capo Marrargiu (Sardaigne), où se trouve une base de l’organisation secrète anticommuniste Gladio/Stay Behind23. Tout semble indiquer que De Lorenzo a pris de manière autonome cette décision, sans prévenir les alliés de l’OTAN24. Quels sont les noms qui figuraient dans l’inventaire des enucleandi ? En croisant les répertoires des préfectures de police, l’historien Mimmo Franzinelli est parvenu à reconstituer une partie de la liste présentée au mois d’avril, soit 345 noms sur 731. On trouve parmi eux des parlementaires du PCI et du PSI25, le service de sécurité de PCI (ce que l’on appellera la « Gladio Rouge26 ») et
21 Commissione parlamentare, Relazione di minoranza, pp. 81-85. 22 Longtemps couverts par le secret-défense, les documents originaux du Plan Solo ont été publiés en 1991 dans Relazione sulla documentazione, concernente gli «omissis» dell’inchiesta SIFAR, op. cit., vol I, pp. 18-126. 23 Comme l’on sait, l’existence de Stay Behind (Gladio en italien) ne sera révélée qu’en 1990. 24 Dans ses mémoires, Taviani qualifiera ainsi de « grave imprudence » la décision de De Lorenzo, car elle aurait risqué de dévoiler l’existence de Gladio. Paolo Emilio Taviani, op. cit., p. 375. 25 Parmi lesquels Arrigo Boldrini, Giacomo Brodolini, Armando Cossutta, Luciano Lama, Luigi Longo, Mario Scoccimarro, Giancarlo Pajetta, Velio Spano et Giusto Tolloy. 26 Gianni Donno, La Gladio Rossa del PCI (1945-1967), Rubbettino Editore, 2001.
[Recherche]
Parlement[s] 74
même des intellectuels tels que Pier Paolo Pasolini et Gillo Pontecorvo, le réalisateur de La Bataille d’Alger.
Un remaniement ministériel pour écarter la gauche
Dorothéens contre socialistes au sein du gouvernement. Depuis plusieurs mois, le premier gouvernement de centre-gauche se trouve dans l’impasse, en raison des désaccords entre les socialistes, qui prônent une politique de réformes, et le courant des dorothéens, partisans d’une politique de rigueur. Le 15 mai, le ministre du Trésor Emilio Colombo envoie une longue lettre à Moro pour dénoncer la dégradation de la conjoncture et présenter les mesures qu’il juge nécessaires. Le président du Conseil ne juge pas opportun d’en dévoiler la teneur. Le 27 mai, des extraits de cette lettre paraîtront toutefois dans Il Messaggero. Le ministre du budget, le socialiste Giolitti, déclare que si Colombo maintenait ces opinions, les ministres socialistes en tireraient toutes les conséquences en quittant le gouvernement. Même si la polémique est close lors du Conseil des ministres du 6 juin27, cette affaire a montré la fragilité du gouvernement.
Dans les semaines suivantes, Segni reçoit du président du Sénat Merzagora plusieurs notes qui reflètent l’inquiétude des milieux industriels28. Le vice-président de la Commission européenne, Robert Marjolin, se rend à Rome (19-20 juin 1964) pour suggérer aux autorités italiennes d’adopter de rigoureuses mesures anti-inflationnistes29. Les tensions au sein du gouvernement se font de plus en plus vives : les socialistes refusent de voter un chapitre de la loi de finances qui accorde des subventions à l’école privée et le gouvernement est mis en minorité. Le 26 juin, Moro réunit le Conseil des ministres et, après avoir pris acte de la fracture existant au sein de la majorité, il se rend au Quirinal pour remettre sa démission. Il n’échappe pas aux observateurs que Moro a saisi cette occasion pour mettre au pied du mur les minorités réticentes de la DC et du PSI et être reconduit au poste de président du Conseil30. La solution de cette crise politique s’annonce cependant compliquée en
27 Présidenza del Consiglio dei ministri (PCM), Verbali del Consiglio dei ministri, busta 71, 6 juin 1964. 28 Nicola De Ianni, Paolo Varvaro, Cesare Merzagora, il presidente scomodo, Naples, Prismi, 2004, p. 101n. 29 Dans son « mémoire », Aldo Moro évoquera les « interférences » de Robert Marjolin. En général, l’historiographie italienne a relayé la thèse des « pressions » de la Commission européenne. Au vu de la personnalité et des idées politiques de Marjolin, cette hypothèse semble peu probable. 30 Bérard au Quai d’Orsay, le 27 juin 1964, MAE, Série Europe, Italie, dossier 330.
[Recherche]
Parlement[s] 75
raison des désaccords à l’intérieur de la majorité et, surtout, de l’attitude du chef de l’État.
Segni prépare l’éviction du président du Conseil. Antonio Segni
entame aussitôt ses consultations qui, en raison d’une chaleur accablante, se déroulent dans le bureau du secrétaire général31. Il voudrait tourner la page du centre-gauche et former soit un gouvernement de techniciens sous la direction du président de l’une des deux assemblées (Leone ou Merzagora), soit un exécutif « monocolore » présidé par une personnalité de la droite démocrate-chrétienne (Pella ou Scelba). Le 27 juin, il s’entretient notamment avec le président du Sénat qui, en sortant du Quirinal, déclare qu’il serait nécessaire de donner naissance « à un gouvernement d’urgence qui s’appuierait sur une large base32 ». Merzagora se pose donc en recours et se déclare disponible pour prendre la tête de cet exécutif et commence à en envisager la composition33. Le 30 juin, Segni reçoit les anciens présidents du Conseil Parri, Pella, Fanfani et Scelba. En 1969, Parri dira à la Commission parlementaire avoir vu un chef de l’État perturbé : « il était évident que pour lui, il y avait des choses qu’il fallait à tout prix éviter34. » Le récit des mémoires de Scelba est encore plus significatif, car l’ancien président du Conseil ne peut être soupçonné d’aucune sympathie à l’égard du centre-gauche :
« Segni m’expliqua les raisons qui justifiaient, selon lui, la fin de l’expérience de centre-gauche et de la présidence Moro. Je rappelai à Segni qu’il avait été un partisan du centre-gauche, tandis que j’y avais été opposé. Le jugement que j’étais sur le point d’exprimer avait donc une valeur particulière [...]. Je lui expliquai que le centre-gauche était en place depuis peu de temps et qu’il n’avait pas pu aller jusqu’au bout de son expérience. Dans ces conditions, liquider Moro pouvait être interprété comme une tentative réactionnaire […]. Je conseillai donc à Segni de laisser continuer à la fois Moro et le centre-gauche.
31 Ces entretiens ont été enregistrés par le SIFAR, qui avait installé des microphones au Quirinal, mais leurs transcriptions ne seront jamais retrouvées. Commissione parlamentare, Relazione di minoranza, pp. 167-172. 32 Nicola De Ianni, Paolo Varvaro, op. cit., p. 101. 33 Dans ses archives, on trouve une liste, plusieurs fois corrigée, d’une vingtaine de « ministrables » appartenant à tous les partis politiques, y compris le PCI et le MSI. Archives Cesare Merzagora, liste sans date (été 1964). 34 Déposition de Ferruccio Parri, Commissione parlamentare, Relazione di maggioranza, p. 391.
[Recherche]
Parlement[s] 76
Cependant le chef de l’État, insistant sur sa thèse, me demanda de me tenir prêt avec Pella, dans notre qualité d’anciens présidents du Conseil, à être éventuellement appelés à constituer un nouveau gouvernement. Je me déclarai opposé à cette solution, mais comme Segni insistait sur l’idée de remplacer le cabinet Moro par un exécutif présidentiel confié à Pella ou à moi, je lui demandai s’il avait un programme pour faire face aux manifestations que la formation d’un tel gouvernement aurait sûrement provoquées.
Segni me répondit qu’il n’avait élaboré aucun programme, mais qu’il comptait sur les Carabiniers. Je lui dis d’être prudent avec les Carabiniers, car ils étaient dirigés par un officier auquel, en tant que ministre de l’Intérieur, j’avais […] par deux fois opposé mon veto à sa nomination au poste de commandant général. »35
Vers la mise en demeure des partisans de Moro. Le projet du
chef de l’État est assez clair : il sait que la mise à l’écart de Moro et du centre-gauche risque de soulever un tollé ; afin de maintenir l’ordre public, il compte sur les Carabiniers et, le cas échéant, sur la mise en œuvre du « Plan Solo ». Dès le 27 juin, De Lorenzo a convoqué à Rome les chefs d’état-major des trois divisions (les généraux Mingarelli, Bittoni et Dalla Chiesa) et divers hauts responsables des Carabiniers36. Quelques heures plus tard, le SIFAR remet au commandement général des Carabiniers les listes des enucleandi, qui doivent être mises à jour. Le 28 juin, De Lorenzo rencontre le président Segni37. Ce même jour, les commandants des trois divisions (les généraux Markert, Cento et Celi) organisent des réunions aux sièges de Milan, de Rome et de Naples pour définir les modalités du déplacement des « subversifs » et de l’occupation des centres stratégiques, y compris les préfectures38. À Milan, certains généraux expriment des réserves : « Mais alors, nous devons faire un coup d’État ? ». Le général Aurigo objecte : « Crois-tu, cher Markert, que le préfet de police de Milan, qui dispose de 3 000 hommes, restera à sa fenêtre, les mains dans les poches, pendant que nous occupons la préfecture ? »39
35 Mario Scelba, Per l’Italia e per l’Europa, Rome, Edizioni Cinque Lune, 1990, pp. 139-140. 36 Outre les trois chefs d’état-major, les militaires qui participent à cette réunion sont le général Picchiotti, chef d’état-major du commandement général, le colonel Bianchi du SIFAR et le colonel Tuccari. 37 Archives De Lorenzo, Agendas de l’année 1964. 38 Commissione parlamentare, Relazione di minoranza, pp. 128-134. 39 Déposition du général Aurigo, Relazione sulla documentazione SIFAR, op. cit., vol. III,
[Recherche]
Parlement[s] 77
Entre le 1er et le 3 juillet, le chef de l’État consulte les représentants des partis politiques. Les partis de la majorité sont parvenus à rapprocher leurs positions et présentent de manière unanime la candidature de Moro, tandis que le parti communiste organise une grande manifestation place San Giovanni40. De son côté, Segni s’accorde une journée de réflexion. Après le refus de Scelba et de Pella, il a envisagé de confier à Merzagora la tâche de former le gouvernement, mais se rend compte que cette hypothèse ne peut être envisagée qu’en dernier recours. Le soir du 3 juillet, devant la volonté réitérée de la DC, il se résigne à désigner Moro, qui entame de laborieuses négociations avec les partis alliés. Pendant ce temps, le « Plan Solo » devient opérationnel. Le 6 juillet, les chefs d’état-major se réunissent à Rome pour recevoir les listes des enucleandi, qui ont été actualisées par le SIFAR41. Le lendemain, le général Celi organise une autre réunion pour les remettre aux commandants de légion et leur impartir des directives42. Le 8 juillet, l’agenda de De Lorenzo signale une rencontre avec le président Segni43. Le lendemain, le commandant général des Carabiniers s’entretient avec Taviani, le ministre de l’Intérieur, et le chef de la police, Vicari44. Il envoie ensuite la lettre suivante à l’état-major de l’armée : « Des événements de caractère exceptionnel peuvent entraîner la nécessité d’augmenter les forces des Carabiniers en rappelant des réservistes. […] L’ordre de mise en œuvre de cette mesure, qui pourra être partielle ou totale, sera imparti par moi, avec l’accord de l’état-major de l’armée45. » Ces préparatifs ne sont pas passés inaperçus. La nuit du 9 juillet, des mains anonymes inscrivent sur les murs du district militaire de Turin et dans le quartier romain des Parioli : « Les militaires au gouvernement », « De Lorenzo au gouvernement », « Tout le monde avec Pacciardi » et « Nouvelle République ». Ces graffitis font référence à un meeting46 qui a réuni l’ancien ministre Pacciardi et le prince Sforza Ruspoli47, tous deux
p. 218. 40 Archives De Lorenzo, « 3 luglio 1964, Comizio dell’on. Amendola in piazza S. Giovanni » (note non signée). 41 Ces listes ne correspondent donc pas exactement à celles qui avaient été distribuées au mois d’avril. Il est probable que les parlementaires socialistes (désormais dans la majorité parlementaire) en aient été exclus. 42 Commissione parlamentare, Relazione di minoranza (Terracini), pp. 180-181. 43 Archives De Lorenzo, Agendas de l’année 1964. 44 Ibid. 45 Commissione parlamentare, Relazione di minoranza (Terracini), pp. 180-181. 46 Le meeting a lieu au théâtre Piccinni de Bari, le 5 juillet 1964. 47 Le prince Sforza Ruspoli est le leader d’un mouvement de propriétaires agraires de droite.
[Recherche]
Parlement[s] 78
partisans d’un régime fort, mais qui ne sont nullement associés aux projets du général De Lorenzo.
Le double jeu de Segni vis-à-vis de Moro
Moro est chargé de former un gouvernement. Les négociations entre les partis de la majorité entrent alors dans leur phase décisive48. Segni espère toujours l’échec de ces tractations et, à partir du 11 juillet, garde une chronique de ces événements49. Il envisage d’abord de dissoudre le Parlement, mais le Vatican donne un avis défavorable : le centre-gauche devient ainsi « une formule que l’on accepte par nécessité »50. Le lendemain, le président reçoit Moro et lui propose de constituer un exécutif « monocolore » démocrate-chrétien, mais celui-ci refuse51. Le soir du 13, il s’entretient avec Merzagora, ce qui est interprété comme le signe annonciateur d’un « gouvernement d’urgence ». En réalité, le président du Sénat reconnaît que « la situation est inéluctable » et se résigne lui aussi au retour de Moro52, alors même que les quatre partis interrompent leurs pourparlers. Le matin du 14 juillet, De Lorenzo rencontre l’un des collaborateurs de Moro, Sereno Freato, chargé des rapports avec les services secrets53. C’est peut-être à la suite de cette entrevue que Moro apprend l’existence du « Plan Solo »54 : les témoignages des jours suivants 48 Pietro Nenni a laissé des notes très détaillées sur ces négociations, qui se déroulent à Rome (Villa Madama) entre le 7 et le 17 juillet 1964. Archives de la Fondation Nenni (AFN), busta 126. 49 Ces notes ont été publiées en 2004 par Sette, le supplément hebdomadaire du Corriere della Sera. On trouve une copie de ces notes dans ASILS, Archivio Giulio Andreotti, Carte presidente Segni, 61/8. 50 « 11/7 : Le matin, je parle à Rumor et je lui fais un peu peur. Plus tard, je lui dis au téléphone que monseigneur Dell’Acqua (sans donner son nom) voit la possibilité d’une dissolution imminente, [suivie] d’élections. Je demande que l’on fasse des sondages plus en haut, ce qu’il fera dimanche. 12 heures 30, Bonomelli : [le] S[aint] S[iège] dit qu’il est désormais trop tard (après trop de discussions) pour rompre pour les élections, mais il exclut que le centre-gauche soit la meilleure formule ; c’est une formule que l’on accepte par nécessité. » Notes manuscrites du président Segni, Ibid. 51 « 12 matin : Je vois Moro et lui pose la question du gouvernement monocolore programmatique, avec d’éventuelles élections. Je mets en avant la nécessité de revenir au texte antérieur à la suppression de l’article 88 (la froideur de M[oro] commence à me faire penser que la défaite du 25 [juin] n’a peut-être pas été involontaire) ; et l’impossibilité du retour de Giolitti. Le soir, je lui confirme cela par une lettre (qui [lui] est cependant remise le matin du 13). » Ibid. 52 « Le soir du 13, je vois Merzagora qui, tout en reconnaissant que la situation est inéluctable, critique avec décision la procédure qui a été adoptée. » Ibid. 53 Archives De Lorenzo, Agendas de l’année 1964. 54 À moins que Moro n’en ait été prévenu lors de la réunion du 16 juillet, dont il sera question plus loin.
[Recherche]
Parlement[s] 79
nous renverront ainsi l’image d’un homme épuisé et accablé par ses responsabilités.
Les délégations des quatre partis se réunissent à nouveau le matin du 14 juillet. Le socialiste De Martino rappelle les trois points sur lesquels son parti ne cédera pas : la loi sur l’urbanisme, l’école et la mise en place des régions. Moro explique que le chef de l’État refuserait de signer la loi sur l’urbanisme si la majorité ne renonçait pas au principe de l’expropriation des sols. Les quatre délégations se quittent dans l’après-midi en constatant leurs désaccords. Nenni écrit ainsi dans son journal : « Nous sommes enfin au pied du mur et probablement à la rupture. »55
Segni met Moro dans une situation délicate. Commence alors la
phase la plus controversée de la crise. À peine informé des désaccords au sein de la majorité, Segni entame une série d’entretiens avec les responsables des forces armées pour les consulter sur la situation de l’ordre public56. Le général Aldo Rossi, chef d’État-major de la Défense, témoignera en ces termes devant la commission parlementaire :
« Un soir57, le président de la République me convoqua ; […] juste à la fin, il me demanda : “Rossi, vous qui avez votre SIFAR, quel est votre sentiment sur la situation interne, sur l’ordre public ? […]” Je suis certain d’avoir donné textuellement cette réponse : “Monsieur le président, en ce qui concerne le chef d’état-major, il n’y a rien de particulier à signaler. S’il s’agit cependant de problèmes d’ordre public, je crois que le chef de la police ou le commandant général des Carabiniers pourront donner davantage d’informations.” »58
Le général Aloja, alors chef d’état-major de l’Armée, déclarera devant la même commission :
« Un matin59, le président Segni, qui suivait attentivement la situation, me demanda si l’ordre public était sous contrôle. Je l’ai rassuré, en lui disant qu’il ne devait avoir aucune crainte car, selon moi, le président Segni ne redoutait qu’un mouvement de la rue. Dans un entretien successif qui eut lieu à la présidence de
55 Pietro Nenni, op. cit., p. 378. 56 La chronologie de ces journées reste incertaine : Segni ne les évoque pas dans ses notes ; les quotidiens italiens sont en grève du 16 au 20 juillet ; plus encore, le Journal historique (Diario Storico) du Quirinal présente une lacune - qui n’est certainement pas le fruit du hasard - pour la période entre le 11 et le 15 juillet 1964. 57 À partir de ce témoignage, il semblerait que cet entretien a eu lieu le soir du 14 juillet. 58 Déposition du général Aldo Rossi, Commissione parlamentare, Relazione di maggioranza, p. 394. 59 Selon toute vraisemblance, il s’agit du matin du 15 juillet.
[Recherche]
Parlement[s] 80
la République, le président Segni me posa la même question. Je le rassurai de la manière la plus complète. »60
Le 16 juillet61, le président de la République reçoit le général De Lorenzo qui, par la suite, revendiquera toujours le mérite d’avoir apaisé les inquiétudes de Segni :
« Le chef de l’État, préoccupé par la crise de gouvernement qui se poursuivait depuis vingt jours, me demanda des nouvelles de la situation de l’ordre public, que je décrivis comme calme. Il me demanda aussi si, dans le cas d’une agitation dans la rue, les Carabiniers pouvaient garantir l’ordre. Je le rassurai car je savais que la situation était tranquille et je lui dis que les Carabiniers pouvaient faire face à d’éventuels troubles de l’ordre public, sauf dans le cas de désordres imposants et exceptionnels ; mais, je répète, rien ne laissait prévoir cela. Les troubles étaient plutôt dans les milieux politiques que dans la rue. »62
Cette audience se distingue cependant des deux précédentes, car elle est suivie d’un communiqué officiel du Quirinal qui suscite une vive inquiétude. Comme l’écrira Moro dans son « mémoire » de 1978, la convocation de De Lorenzo et le communiqué présidentiel avaient donné « l’impression d’une intervention prémonitoire »63. Après avoir vérifié qu’il n’existe aucun risque d’émeute en cas de changement de majorité, Segni annonce à De Lorenzo une prochaine rencontre avec Moro. Peu de temps après, l’homme de confiance du président, l’amiral Emanuele Cossetto, se présente chez De Lorenzo et l’accompagne au domicile de l’avocat Tommaso Morlino64. Le chef des Carabiniers y trouve Moro, Rumor et les présidents des deux groupes parlementaires de la DC, Gava et Zaccagnini65. La « réunion chez Morlino » a donné lieu à un grand nombre d’interprétations. Les quatre personnalités politiques en donneront un témoignage presque identique : De Lorenzo se serait borné à répéter que la
60 Déposition du général Giuseppe Aloja, Ibid., pp. 394-395. 61 Dans tous les actes sur le « Plan Solo », on évoque généralement les dates du 14 ou du 15 juillet. La date correcte, celle du 16 juillet, se trouve dans l’agenda du général De Lorenzo, avec la mention « Segni, Albanese, Moro & co ». Ce détail n’est pas anodin, dans la mesure où l’audience au Quirinal précède de quelques heures la réunion « chez Morlino » (Moro & co). Archives de Lorenzo, Agendas de l’année 1964. 62 Roberto Martinelli, “SIFAR”, Gli atti del processo De Lorenzo - L’Espresso, Milan, Mursia, 1968, p. 85. 63 Aldo Moro (éd. Sergio Flamigni), op. cit., p. 221. 64 Tommaso Morlino (futur sénateur et président du Sénat) est un ami proche de Moro et lui prête souvent son domicile pour des réunions confidentielles. Le rôle joué par Cossetto indique cependant que Segni est, dans une certaine mesure, à l’origine de cette réunion. 65 On remarque en revanche l’absence des ministres de l’Intérieur et de la Défense, Taviani et Andreotti.
[Recherche]
Parlement[s] 81
situation était parfaitement tranquille. Après le départ du commandant général des Carabiniers, les quatre dirigeants démocrates-chrétiens s’entretiennent avec le chef de la police, Vicari, qui explique que tout était sous le contrôle des forces de l’ordre66. Sur le pas de la porte, celui-ci murmure cependant à l’oreille de Moro qu’il ferait mieux de renoncer à la désignation67. En début d’après-midi, le chef de l’État consulte les présidents des deux assemblées, qui conseillent de « laisser continuer Moro », puis le gouverneur de la Banque d’Italie, Guido Carli, qui ne cache pas son pessimisme et parie sur un retrait de Moro68. Le président désigné retourne chez Segni, qui résume ainsi leur entretien :
« 16 heures : je vois longuement (plus d’une heure) Moro : il est très abattu et dit ne pas vouloir continuer (je ne le crois pas). Je lui expose la situation, il craint les élections et la rupture avec la gauche du PSI et du PSDI. Je comprends qu’il fera de son mieux pour réussir. Je fais remarquer que la DC ne peut pas céder sur l’école, pour laquelle elle a ouvert la crise ; et que si les élections n’ont pas lieu aujourd’hui, je crains qu’elles n’aient lieu au cours de l’hiver, dans une situation peut-être pire ; et que la solution de la crise ne peut venir que d’un retour de la confiance. […] Moro demande pourquoi on ne fait pas confiance à son gouvernement, qui a pourtant promis de ne pas faire de nationalisation. Je lui explique que ce gouvernement promet […] des réformes structurelles, une programmation dirigiste, la nationalisation des sols etc. Quelle confiance peuvent lui faire les entrepreneurs ? Mais il ne semble pas du tout effleuré par ces idées – et il s’en va. » 69
Dans la soirée, les quatre partis de la majorité se retrouvent à Villa Madama. La séance a lieu dans une atmosphère dramatique. Visiblement
66 Voir les dépositions de Moro, Zaccagnini, Gava et Rumor dans Commissione parlamentare, Relazione di maggioranza, pp. 417-426. Cf. aussi Mariano Rumor, Memorie (1943-1970), Vicenza, Neri Pozza, 1991, p. 301. Le général De Lorenzo donnera un témoignage légèrement différent devant la Commission Lombardi. Relazione e documentazione SIFAR, vol. V, pp. 445-46. En revanche, Moro ne mentionnera pas cet épisode dans le « mémoire » donné aux Brigades rouges. 67 Corrado Guerzoni, Aldo Moro, Palerme, Sellerio, 2008, pp. 84-85. 68 « 16/7 : 12 heures. Je reçois les présidents du Sénat et de la Chambre ; Pendant la matinée, Piccioni m’avait dit la même chose. […] En sortant, Merzagora me dit qu’il n’y a aucune autre solution que de laisser faire Moro […] 15 heures 30 : entretien avec Carli, très pessimiste en ce qui concerne les résultats que l’on peut obtenir par les mesures anti-conjoncturelles qui ont été proposées. Il n’a pas caché […] son scepticisme à ceux qui ont mené les consultations […] Moro est en dehors du système libéral ; c’est un paternaliste. Il prévoit que Moro n’acceptera pas – je réponds que je n’en suis pas sûr ». Notes manuscrites du président Segni, art. cit. 69 Ibid.
[Recherche]
Parlement[s] 82
inquiet, Rumor demande aux socialistes de renoncer à leurs revendications sur l’école et sur la loi sur l’urbanisme, avant de glisser à l’oreille de Nenni : « Aidez-nous, nous sommes à la limite de la désagrégation, après laquelle il n’y aura de place que pour un affrontement direct entre les droites et les communistes. »70 Après deux heures de réunion, Moro est au bout de ses forces et s’évanouit, ce qui met un terme à la réunion. En fin de journée, Nenni note dans son journal : « On sait que pendant la direction de la DC Moro a été durement attaqué de tous les côtés. Au cours de cette journée, Segni a exercé des pressions sur lui afin qu’il se retire et, dit-on, Vicari aussi, mais je n’y crois pas. Moro était manifestement anéanti. »71
Segni gagne son combat politique face à Moro. Les événements de
la journée montrent bien la stratégie de Segni : après s’être assuré du maintien de l’ordre public, le chef de l’État menace à demi-mot d’une solution alternative au centre-gauche ou d’une dissolution des chambres. En rendant publique l’audience avec De Lorenzo, puis en co-organisant la réunion « chez Morlino », il espère provoquer le retrait du président désigné ou, pour le moins, un infléchissement du programme gouvernemental dans un sens plus modéré. Moro comprend qu’en cas d’échec de sa tentative, Segni n’hésiterait pas à dissoudre le Parlement, d’autant plus que la situation de l’ordre public ne suscite pas d’inquiétude. Moro prévient aussitôt Nenni des pressions indirectes qui ont été exercées par le chef de la police72 et, sans doute, de l’existence du « Plan Solo »73 : le leader socialiste saura en tenir compte pour la suite des négociations.
Le vendredi 17 juillet, Segni lance une sorte d’ultimatum au président désigné pour le presser de trouver un accord avec ses alliés. Dans ses notes, il décrit ainsi cette rencontre :
« 16 heures 15 : entretien de 50 minutes avec Moro : il est très fatigué et déprimé. Je lui dis : urgence de décider ; qu’il mette les autres devant leurs responsabilités – surtout en ce qui concerne la question scolaire, parce que la DC ne peut pas accepter […] d’avoir ouvert la crise pour accepter la défaite. Je dis aussi que je crains la situation de l’hiver, et qu’une reprise économique ne dépend pas tant du crédit que de la confiance –
70 Pietro Nenni, op. cit., p. 380. 71 Ibid. 72 Il va de soi que c’est Moro lui-même qui a relaté à Nenni les mots prononcés par Vicari. Quant à la réaction du leader du PSI (« Je n’y crois pas »), elle doit être comprise comme « Je ne veux pas y croire ». 73 On ne sait pas précisément à quel moment Nenni a appris lui-même l’existence du « Plan Solo ». En 1977, il racontera toutefois qu’il disposait d’une « source d’information qui remontait au Quirinal ». Pietro Nenni (avec Giuseppe Tamburrano), Intervista sul socialismo, Bari, Laterza, 1977.
[Recherche]
Parlement[s] 83
et que si ce type de gouvernement reste en place la méfiance grandit. Il reconnaît le bien-fondé de mes préoccupations […]. Je lui montre certains télégrammes de protestation contre le PSI et le PSDI : il est nécessaire de les mettre énergiquement devant leurs responsabilités – puis je ne me prononce pas sur la situation et me borne à répéter que l’opinion publique DC n’accepterait pas une défaite sur l’école […]. »74
Réunis à Villa Madama, les quatre partis de centre-gauche négocient avec acharnement pendant toute la nuit. Après une intervention « pathétique » de Moro, l’accord est signé dans les premières heures du 18 juillet75. Il est décidé que l’État affectera toutes les recettes supplémentaires à la couverture du déficit. Le principe de l’expropriation des sols constructibles est de nouveau proclamé, mais son application fortement encadrée. Enfin, la programmation économique devient « indicative » et non plus « obligatoire » comme le prévoyait le programme de 196376. Le soir du 18 juillet, Segni dira à Moro qu’il n’a pas « à se plaindre de lui » et qu’il lui assurerait son soutien « dans les limites de la constitution77 ». Il apparaît toutefois que son intervention a été décisive. Rien ne saurait être plus explicite que la petite note rédigée par Nenni au terme des négociations de Villa Madama :
« 16 juillet – Pressions de Segni (et, dit-on, de Vicari) sur Moro pour qu’il se retire.
17 juillet – Accord conclu à trois heures du matin [du 18 juillet]. »78
Quelques jours plus tard, le secrétaire du PSI publie dans le quotidien de son parti un article sans signature, expliquant ainsi la reddition des socialistes :
« [Les droites] savaient ce qu’elles voulaient et elles ont été à un pas de l’obtenir. Si le centre-gauche avait jeté l’éponge sur le ring, le gouvernement de la Confindustria et de la Confagricoltura était prêt à être constitué. Il avait son chef, même s’il n’est pas certain que celui-ci aurait été le premier à l’arrivée sans être devancé par quelque notable démocrate-chrétien. Il avait derrière lui la plus vaste concentration de presse quotidienne et hebdomadaire de l’histoire italienne. Il avait de solides points d’appui dans toutes les parties du pays. Il avait un dessein stratégique : l’humiliation du Parlement, des partis et des
74 Notes manuscrites du président Segni, art. cit. 75 Pietro Nenni, op. cit., p. 380. 76 Bérard au Quai d’Orsay, le 22 août 1964, MAE, Série Europe, Italie, dossier 330. 77 Notes manuscrites du président Segni, art. cit. 78 AFN, busta 126.
[Recherche]
Parlement[s] 84
organisations syndicales et ce dessein était renforcé par la menace, purement tactique, des élections [anticipées]. »79
Le gouvernement qui prête serment le 23 juillet 1964 est presque identique au précédent80, mais le rapport de force entre réformistes et dorothéens a été profondément modifié. S’il sort victorieux de l’épreuve de force, Segni est très affaibli sur le plan physique. Le 7 août, après un violent différend avec Saragat et Moro81, il est victime d’une attaque d’apoplexie : après une longue période d’incertitude, il signe sa démission le 6 décembre 196482.
La postérité du « Plan Solo ». L’infirmité de Segni a une influence
décisive sur les procédures judiciaires qui commencent en 1967. Lors du procès qui les oppose à De Lorenzo, Scalfari et Jannuzzi rétractent leurs accusations à l’encontre de l’ancien président. De même, les conclusions de la Commission parlementaire font « porter le chapeau » au Commandant général des Carabiniers, accusé d’avoir conçu de manière autonome le « Plan Solo ». L’image publique de De Lorenzo connaît ainsi une profonde évolution. En 1966, il est encore l’ancien résistant apprécié par la gauche : le parti socialiste favorise ainsi sa nomination à la tête de l’état-major des forces armées. À partir de 1967, De Lorenzo incarne désormais l’archétype du général putschiste83. Les documents d’archives et les témoignages ultérieurs renversent cependant cette perspective. Il apparaît en effet que Segni a lui-même sollicité l’élaboration d’un « plan d’urgence » pour contrer d’éventuelles menaces subversives. Le chef de l’État connaissait au moins certains aspects opérationnels du Plan, tel que l’existence des listes des enucleandi84, et a lui-même approuvé le plan de défense du Quirinal85. Enfin, d’après le « mémoire » de Moro, il aurait donné lui-même l’ordre d’annuler
79 « Volevano il governo della Confindustria », L’Avanti! du 22 juillet 1964, cité par Giuseppe Tamburrano, Storia e cronaca del centro-sinistra, op. cit. p. 305. 80 La différence la plus importante étant le remplacement de Giolitti par Pieraccini au ministère du Budget. 81 Ce différend porte sur la nomination d’un ambassadeur. Selon d’autres sources, toujours démenties par l’intéressé, Saragat aurait évoqué également les événements du mois de juillet. 82 Segni survivra pendant huit ans à cette attaque, mais ne retrouvera plus jamais l’usage de la parole. 83 Il est d’ailleurs significatif que les articles de L’Espresso soient sortis quelques semaines après le putsch des colonels en Grèce (avril 1967). 84 Déposition du général De Lorenzo à la Commission Lombardi, dans Commissione parlamentare, Relazione di minoranza, p. 276. 85 Interrogé par la commission parlementaire, De Lorenzo déclarera lui avoir personnellement remis ce plan, « puisqu’il s’agissait de faire entrer un certain nombre d’hommes dans les jardins du palais ». Ibid., p. 95.
[Recherche]
Parlement[s] 85
les dispositifs militaires86. On voit donc que le général De Lorenzo n’a rien d’un « Pinochet à l’italienne » : il semble davantage poussé par des ambitions de carrière que par d’improbables velléités de putschiste. S’il met au point le « Plan Solo » pour gagner les bonnes grâces de Segni, en secondant son obsession anticommuniste, il est certainement trop avisé pour envisager de conquérir (et de garder) le pouvoir à l’aide du seul corps des Carabiniers. Au moment crucial de la crise politique, il tend ainsi à apaiser les craintes du président de la République, tout en prévenant Moro des dangers qui pèsent sur la coalition de centre-gauche.
Le Plan Solo peut-il être considéré comme une tentative de coup d’État ? Comme nous l’avons dit, les craintes du « coup d’État » sont extrêmement répandues dans l’Italie de cette époque et, par la fréquence de son emploi, l’expression a elle même perdu une partie de sa valeur87. Les partisans de cette thèse tendent en effet à superposer plusieurs épisodes qui n’ont pas un rapport direct entre eux : la mobilisation des forces armées et des Carabiniers (2-14 juin) ; l’agitation dont font preuve les mouvements liés à Pacciardi et aux agrariens de la Confagricoltura (mi-juin, début juillet) ; enfin, la convocation au Quirinal des responsables militaires et la réunion « chez Morlino » (14-16 juillet). Si l’on examine la chronologie des événements, il apparaît que le « Plan Solo » a été conçu au printemps 1964 dans une optique défensive plutôt que dans le but de « renverser le pouvoir existant par la violence ou par d’autres moyens illégaux »88. Pour reprendre les mots prononcés par De Lorenzo devant la commission parlementaire, « on parle ici d’un coup d’État ; or il est impossible qu’un chef de l’État fasse un coup d’État contre lui-même »89. Même dans les affres de la maladie, il est improbable qu’un démocrate comme Segni ait songé à établir un pouvoir autoritaire, alors qu’il s’était prononcé, un an plus tôt, pour le non-renouvellement du septennat présidentiel. D’autres acteurs mettent en évidence les insuffisances du dispositif militaire. Le futur président Francesco Cossiga, proche à la fois de Segni et de De Lorenzo, estime ainsi que « le Plan Solo » n’aurait pas permis de « faire face à une révolte d’élèves de l’école primaire »90. Sans abonder dans ce sens, on peut cependant
86 Aldo Moro (éd. Sergio Flamigni), op. cit., p. 222. 87 Sergio Flamigni estime ainsi que le débat récurrent (annosa diatriba) sur la définition du « Plan Solo » en tant que coup d’État est stérile. Préface à Dossier “Piano Solo”, Rome, Kaos edizioni, 2005, p. 26n. 88 Si l’on reprend la définition la plus restrictive et la plus habituelle de l’expression « coup d’État ». 89 Déposition du général De Lorenzo, Commissione parlamentare, Relazione di maggioranza, p. 601. 90 Francesco Cossiga (avec Piero Testoni), La passione e la politica, Milano, Rizzoli, 2000,
[Recherche]
Parlement[s] 86
estimer qu’une tentative de « putsch autonome » de la part des Carabiniers n’aurait eu aucune chance de réussite, ne serait-ce que par l’opposition des autres corps armés et, surtout, de l’administration américaine91.
Dès lors, le « Plan Solo » doit-il être considéré comme un simple plan de sûreté publique, comme il en existait en France et, sans doute, dans les autres pays du monde92 ? Cette approche tendrait à gommer le caractère manifestement anticonstitutionnel de certaines dispositions, en particulier la présence de nombreux parlementaires parmi les enucleandi93. Plus encore, il existe un lien explicite entre le début de la crise de gouvernement (26 juin) et la mise à jour des listes et des aspects opérationnels du plan (27 juin – 8 juillet). Après la désignation de Moro, sa mise en œuvre n’est plus d’actualité. Il n’en reste pas moins que, par sa simple existence, le « Plan Solo » a été jusqu’au bout une épée de Damoclès suspendue sur le sort du centre-gauche. Moro et Nenni finiront par céder aux pressions, en infléchissant le programme du nouveau gouvernement. « Le président Segni parvint, comme il le souhaitait, à freiner le cours du centre-gauche et à mettre en place une politique largement dépourvue d’éléments de nouveauté ». Pour reprendre les mots du « mémoire » d’Aldo Moro, ce centre-gauche édulcoré « se réduisait à une mise à jour du centrisme »94.
pp. 236-237. 91 Contrairement à une légende tenace, les services secrets américains n’ont guère participé à l’élaboration du Plan Solo. Bien au contraire, les administrations Kennedy et Johnson n’ont cessé de soutenir le centre-gauche. Sur ces aspects, cf. Leopoldo Gli Stati Uniti e l’apertura a sinistra, Rome-Bari, Laterza, 1999, pp. 662-665. 92 Voici le point de vue du ministre de l’Intérieur de l’époque : « Le plan Solo ne représentait pas, en soi, un acte illégitime. Il s’agissait d’un plan préventif devant l’organisation des communistes, prêts à soutenir les envahisseurs soviétiques de Hongrie dans le cas d’une guerre européenne. Les dirigeants français avaient parlé à Segni, à l’occasion de son voyage en février à Paris, d’autres plans bien plus approfondis. En revanche, ce fut un acte arbitraire que de réunir les commandements des Carabiniers pour discuter d’un plan en vue d’une situation internationale exceptionnelle qui n’existait pas en 1964. » Paolo Emilio Taviani, op. cit., p. 375. 93 Contrairement aux autres “subversifs”, les députés et les sénateurs étaient en effet couverts par l’immunité parlementaire ; leur éventuelle mise en cause judiciaire aurait dû être validée par un vote de l’assemblée. 94 Aldo Moro (éd. Sergio Flamigni), op. cit., p. 222 et p. 226.



























![Konsekwencje przewrotu majowego w polskiej służbie konsularnej [The consequences of the May coup 1926 in Polish consular service]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63142ed5b033aaa8b2106e47/konsekwencje-przewrotu-majowego-w-polskiej-sluzbie-konsularnej-the-consequences.jpg)