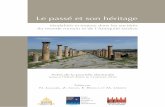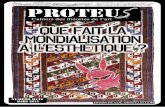L'Art francais de la guerre : la guerre revolutionnaire au Bresil 1958-1974
1995 - Bovins montés et chevaux, puis chevaux montés dans l'art rupestre de l'Adrar des Iforas...
Transcript of 1995 - Bovins montés et chevaux, puis chevaux montés dans l'art rupestre de l'Adrar des Iforas...
CAVALIERI DELL'AFRICA CENTRO STUDI ARCHEOLOGIA AFRICANA - MILANO 1995
Christian Dupuy
BOVINS MONTES ET CHEVAIJX,PUIS CHEYAUXMONTESDANS UART RUPESTRE DE UADRARDES IFORAS (MALI)
L'utilisation de bovins en Afrique deI'Ouest comme monture pour aller à la guer-re est relatée, âu début du XVIème siècle,par le voyageur portugais Valentim Fer-nandès qui rapporte que le Roi des Man-dinka, dans la région du Haut Niger, partcombattre à califourchon sur un boeuf (Mo-nod & al. L95I: 39). On sait par ailleurs,de sources écrites arabes, QUe d'importantescavaleries s'étaient constituées au servicede royautés voisines depuis au moins le XI-Vème siècle (Mauny L96I: 286). A partirde quand et dans quels contextes bovins etchevaux sont-ils devenus les montures desgueniers de 1'Ouest-africain? Par sa richesseiconographique, l'art rupestre de I'Adrardes Iforas apporte des éléments de répon-se.
L'Adrar des lforas est un massif semi-désertique situé au sud du Sah ara en terri-toire malien. Les gravures rupestres s'ycomptent par milliers. La plupart se répar-t issent aux sommets d'éperons rocheuxs'élevant parfois à plus de 40 mètres d'al-titude par rapport au niveau des vallées avoi-sinantes. Les autres apparaissent sur desboules de granit disposées à même le soldes vallées. Seules les gravures d'àge pro-tohistorique vont retenir notre attention.Celles-ci s'intègrent dans deux phases dis-
tinctes d'afirupestre (Dupuy 1990 &" 1992).La plus ancienne de ces phases comprendsurtout des représentations de bovins, d'au-truches et de girafes, et, en nombre beau-coup plus restreint, celles d'autres animauxparmi lesquelles de rares chevaux. Ces gra-vures d'animaux sont parfois associées surdes parois communes à des personnages, àdes chars ou à des signes abstraits. Certainsdes bovins sont représentés montés et (ou)tenus en longe par des guerriers armés delance (fig. 1). Les chevauX, eux, ne sont nimontés ni guidés mais simplement touchéspar des porteurs de lance d'un style iden-tique à ceux étroitement liés à des bovins(fig. 2). Ce n'est qu'au cours de la phased' art rupestre suivante que les représenta-tions de chevaux seront prédominantes etque ces animaux apparaîtront montés auxcôtés de dromadaires par des guerriers par-fois armés de plusieurs javelots (fig. 3 etfig. 4).
Les relations iconographiques qui s'éta-blissent entre bovins montés et chevaux nonmontés, puis entre dromadaires et chevauxmontés, sont riches d'une histoire millé-naire à laquelle est liée celle du cheval. Del'époque de son introduction dans le suddu Sahara à celle de son utilisation commemonture, plusieurs siècles se sont écoulés
105
Fig. 1 - a): Boeufs à robe triangulée précédésd'un oiseau, vraisemblablement un ibis. Celuide tête est monté par un homme armé d'une lan-ce. L'homme guide sa monture avec une laissequ'il tient de sa main droite (Adarmolen). b):Porteur de lance, jambes pliées, tenant en lais-se un bovin (Issamadanen).
au cours desquels des guerriers armés delance utilisèrent comme monture des bo-vins. Afin de fixer les cadres chronologiquesrelatifs à ces divers faits, plusieurs détourss'imposent. Les premiers de ces détoursnous sont imposés par la présence dansl'Adrar des lforas, aux sommets d'éperondrocheux, de signes abstraits qui parfois fu-rent réalisés aux côtés de chars dételés à ti-mon simple et roues à rayons. De tels signesse retrouvent gravés dans des régions voi-sines jusqu'en Afrique du Nord pré-saha-rienne.
Les premières peinturesde cheYaux attelésdu Sahara central
Deux spirales développées en entrelacsapparaissent dans l'Adrar des lforas, le longde la vallée d'Afara, sur des dalles hori-zontales entourées de nombreuses'gravuresde bovins. L'une est située en surplombd'une composition animalière montrantdeux chars déteIés (fig. 5). Quatre spiralesdéveloppées de manière semblable ont étérelevées au Sahara central (Blaise L956,Kunz L974 & 1982, Lhote 1953 & 1985).Alors que deux sont gravées sur rochers deplein air, les deux autres sont peintes au pla-fond d'abris sous-roche du Tassili-n-Ajjer.Un motif à entrelacs similaire à ceux sou-dés aux spirales du Sahara central et deI'Adrar des lforas est gravé plus au norddans l'Atlas sud-oranais d'Al gérie sur lastation de Brézina (Roubet 1967). Parmices signes, celui peint au Tassili sous I'au-vent de Weiresen attire surtoutl'attention;il est associé à des rubans ondulés et deschars attelés qui constituent autant de mo-tifs que l'on retrouve gravés en champlevésur trois stèles funéraires des tombes à fos-se du cercle A de Mvcènes datant du XVIè-
a détall
106
FiS. 2 - Chevaux à l'arrêt entourés de person-nages. Les têtes des animaux volumineuses etportées basses ajoutent à la lourdeur des corps.Le cheval du niveau inférieur est touché à labouche par un guerrier armé d'une lance àhampe courte (Iss amadanen).
me siècle avant notre ère (fig. 6). Ces stèlesmontrent des chars attelés à des chevauxentourés de rubans ondulés et de spiralesliées. Les analogies se jouent par consé-quent à deux niveaux: à un niveau non fi-guratif avec les signes en rubans et en spi-rales développés et à un niveau figuratifavec les attelages. Certes, les attelages peintssous l'auvent de'Weiresen ne sont pas lesrépliques de ceux gravés sur les stèles my-céniennes. Outre les conventions de dessindistinctes auxquelles sont soumises leursreprésentations respectives, les conceptionsayant présidé à leur É,alisation sont, ellesaussi, différentes. Pour ne prendre quel'exemple de la plateforme: celle des charsmycéniens est posée en équilibre sur I'es-sieu alors que celle des chars sahariens estplacée en avant de l'essieu et lui est atte-nante par sa partie arcière. Du fait de cesdifférences, plusieurs auteurs ont écarté1' hypothèse d' interférences culturelles entrel'Egée et le Sahara. Celle-ci me semblepourtant mériter considération au vu desfaits suivants.
Les Crétois étaient en relations suiviesavec l'Egypte du Moyen Empire (Vercout-ter L956). Ces relations perdureront, peut-être même se renforceront, durant la pé-riode des Rois hyksos (Janosi1992). Deuxfacteurs naturels y aidaient: vents étésienset courants marins de Méditenanée orien-tale qui poussaient et portaient les naviresde l'Egée vers les côtes de Cyrénaïque(Kemp & al. 1980: 270). Aussi ces côtesdevaient-elles être familières aux Crétoisvers lesquelles ils dirigeaient sans difficul-té leurs navires. De 1à, en longeant le lito-ral, il pouvaient gagner les contrées afri-caines voisines, à l'est, le Delta du Nil, maispeut-être aussi parfois, à l'ouest, le Magh-reb oriental, comme donnent à le penser lesaffinités qui s'établissent entre les décors
Fig. 3 - Chevaux à silhouette levrettée (Delad'jou).
Fig. 4 - Chasse à courre à l' antilope (Imeden).
L07
ô o,t l-f-;--Fr---.--:--ï{
Fig. 5 - Composition animalière montrant detmchars dételés (Asenkafa) en surplomb delaquelleest située une spirale développée en entrelass.
intérieurs de sépultures en falaise de Tuni-sie et ceux intégrés à I'architecture pala-tiale ê,géenne de l'Age du bronze) bien gue,dans ce dernier cas, un cheminement pluscomplexe par les îles et péninsules de Mé-diterranée centrale soit aussi envisageable(Camps 1987: 54-55).
A partir du XVIème siècle, un bascule-ment s'opère en Egée. La Royautê, mycê,-nienne s'affirme... Au XVème siècle, lesMycéniens triomphent des Crétois. Simul-tanément, Thoutmosis III ordonne Ia réali-sation du réseau "des forteresses de la mer"pour prévenir toute menace à I'ouest duDelta. Deux siècles plus tard, Ramsès II faitprolonger ce système défensif sur près de300 kilomètres en direction du désert li-byque. A la fin du XIIIème siècle survientdans cette région sinon en effervescence dumoins guère souriante depuis plusieurs gé-nérations à l'égard des Egyptiens du Nou-vel Empire, une première bataille que Me-renptah remporte face à une coalition deLibyens et "d'habitants des pays de la mer",mieux connue sous celle transcription ap-proximative de "Peuples de la met" (Gran-det 1990). A f issue des combats, douzepaires de chevaux appartenant à la tribu desRibou de Cyrénaïque commandée par unchef libyen dénommé Meryouy sont rame-nés dans la Vallée du Nil. Une générations'écoule... Puis la menace à nouveau se pré-cise. Deux coalitions successives, liant Li-byens et pirates de Méditerranée, affron-tent l'armée de Ramsès III en I'an 5 puisen l'an 1"1 de son règne. Les combats consa-
108
F;g. 6 - a): Composition deWeiresen (relevé de.î. Kunz 1982). b): Stèles provenant des tombesà fosse du cercle A de Mycènes.
I
I\
:1
S'rt i
F*"
crent à deux reprises le triomphe du Pha-raon. A I'issue de la deuxième bataille, outrede nombreuses épées d'origine mycénien-ne, une centaine de chars attelés à des che-vaux sont pris comme butin de guerre. Duhaut de I'un d'eux, avait combattu Mésher,fils du roi vaincu de la tribu libyenne desMashouash qui nomadisait à l'ouest de laCyrénaique, .
Ces événements, tout dernièrement re-latés dans le détail par P. Grandet (1993),sont importants pour notre propos. Ils té-moignent d'abord de rapports cordiaux entreLibyens et Egéens dont les menaces àI'ouest de la Vallée du Nil se firent pres-santes à partir du XVème siècle avant notreère. Mais ils révèlent aussi des Libyensmieux organisés sur le plan politique qu'iln'y paraît en première lecture des chro-niques égyptiennes. Ceux-ci, en effet, étaientdirigés par des chefs suffisamment puis-sants et influents pour nouer alliance avecdes peuples belliqueux de Méditerranée etles liguer contre les Egyptiens du NouvelEmpire. La nature guerrière des coalitionsdevait motiver la fabrication de chars tant
I
b-
e
109
ffiI
l ., : ' . :a ' ' ) : : . l ta: : t ) : : :a: l : : : : . : : : : . : : ' : , : : : . ' : : :a,
,.......,..,..........,. ;:-.i..'..i
Fig. 7 - Char associé à deux objets coudés àlames longues, fines et légèrement arquées,
fixées orthogonalement aux manches. On no-tera la présence de crochets opposés aux lameset tournés vers le bas des manches (Tirist).
en Cyrénaïque qu'à Mycènes et qu'en Egyp-te où la présence de chevaux et de chars lé-gers est sans équivoque à partir du XVIè-me siècle av. J.C. (Braunstein-SilvestreL982:39). Aussi divers prototypes pûrent-ils être réalisés quasi-simultanément dansces trois régions dès le XVIème siècle avantnotre ère pour servir au prestige d'aristo-craties et, au premier chef, à leurs dirigeants.Une fois conçus et adaptês par les tribus deCyrénaïque qui étaientpréparées à recevoirune telle innovation, ces engins roulants,attelés à des chevaux et conduits par desguerriers libyens animés d'un esprit deconquête ou d'une volonté de domination,pénétrèrent au Sah ata où ils furent repré-sentés en peinture aux plafonds d'abris sous-roche, parfois aux côtés de signes com-plexes apparentés à ceux du répertoire my-cénien , parce que vraisemblablement réa-lisés vers le milieu du IIème millénaire avantnotre ère par des artistes peintres qui étaienTsensibles aux décors prisés de longue datepar les Egéens et encore prisés paî euxlorsque furent &igées, au-dessus des tombesà fosse de Mycènes, des stèles représentantpour la première fois en Péloponnèse desguerriers sur des chars.
Les premières graYures de charsdétetés du Sahara méridional
Si des peintres du Sahara central furentsensibles aux décors égéens à base de spi-rales développées, des graveurs du Saharacentral, de l'Adrar des Iforas et de I'Atlas,le furent également. Cependant aucune desspirales complexes qu'ils réalisèrent, à ladifférence de celles peintes sous les auventsdu Tassili central, f'apparaît à côté de che-vaux, seulement parfois aux côtés de bo-vins et de chars dételés comme dans l'Adrardes lforas. Par leur complexité,1'homogé-neité de leur forme et leur rarcté, celles-cisupposent pourtant un phénomène rapidede diffusion et, en conséquence, une proxi-mité chronologique entre art gravé et aftpeint de l'époque des premières représen-tations de chars, rendant énigmatique l'ab-sence du cheval en gravure. Pour avancerdans la résolution de cette énigffie, il estimportant, dans un premier temps, de mieuxargumenter, données iconographiques et a?chéologiques à l'appui, I'idée selon laquellele temps écoulé entre les réalisations despremières peintures de chevaux attelés duSahara central et celles des premières gra-vures de chars dételés du Sahara méridio-nal fut bref ou, tout du moins, suffisam-ment court pour pouvoir être aujourd'huisaisi de manière objective.
La récente découverte en Mauritanied'une gravure de char dételé aux côtés depiquetages en méandre sous un muret d'unvillage du Dhar Oualatane dément pas cet-te idée. Lfne datation sur céramique contem-poraine du village a donné comme âge:2740 + 160 BP (LV 3334), soit après cali-bration I34B-479 av.J.C. (Amblard & OuldKhattar L993). La probabilité que laréali-sation de la gravure de char remonte au IIè-me millénaire plutôt qu'au premier millé-
110
Fig. B - a) et b): Chars dételés représentés auxcôtés de signes à base de cercles (Issamada-nen).
naire avant notre ère I'emporte, si l'on tientcompte du fait que les plus anciennes datesrelatives à l'occupation des villages enpierres sèches du Dhar Tichitt voisin se ran-gent dans la première moitié du IIème mil-lénaire et que ces villages atteindront leurdéveloppement maximum à l'aube du Iermil}énaire avant notre ère (Munson 1968& L97L).
Cette présomption de date haute est ren-forcée par les contextes d'apparition de cer-tains chars gravés dans l'Adrar des lforas.A l'un d'eux est associé sur une paroi com-mune deux objets coudés (fig. 7) aux pro-fils évoquant ceux de hallebardes proto-historiques gravées dans le Haut Atlas ma-rocain (Malhomme L959|I96I). DansI'Adrar des lforas toujours, deux chars dé-telés, ici encore à timon simple et roues àrayons, sont gravés aux côtés de signes abs-traits (fig. 8) épousant des formes diverses:
oï, t&;bç
cercles simples, cercles pointés en leurcentre de piquetages, cercles tangents ouconcentriques, spirales simples, lignes on-dulées, méandres, alvéoles et plus rarement
LLT
croix inscrites à l'intérieur de lignes enve-loppes. Un grand nombre de ces signes seretrouvent incisés sur des rochers de pleinair du Sud-marocain et de Mauritanie dansdes ccntextes animaliers souvent riches enbovins. Des signes équivalents sont pré-sents dans le Haut-Atlas marocain aux cô-tés de hallebardes.
Comme le montre R. Chénorkian (1988),deux des trois types de hallebardes figurésdans le Haut Atlas marocain représententles prototypes d'affnes qui étaient produitesdans la Péninsule ibérique durant le IIèmemillénaire avant notre ère: le type d'El Ar-gar et le type de Carrapatas. Qui plus est,les signes de forme élémentaire dont il vientd'être question montrent des aftinités avecceux du répertoire abstrait de I'aft rupestreibérique du Chalcolithique et de I'Age dubronze dont cercles, lignes ondulées et cru-cifcrmes constituent les motifs de base(Abelanet 1986). Mais tandis que les signesd'Afrique nord-occidentale apparaissentpour la plupart dans des contextes anima-liers riches en bovins, ceux de la Péninsu-le ibérique sont I'essence même d'un artabstrait datable de la deuxième moitié duIIIème millénaire et du IIème millénaireavant notre ère. Le problème est alors desavoir si leur génèse le long de la façadeatlantique et de part et d'autre de la Médi-terranée occidentale fut liée ou non. Plu-sieurs données, dont certaines enregistréestout récemment, engagent à répondre parI'affirmative.
Les découvertes de céramiques campa-niformes et d'armes en cuivre ou en bron-ze le long et à proximité des côtes nord-africaines, la présence d'ivoire d'éléphantet de coquilles d'oeufs d'autruche sur dessites de la civilisation argarique du sud deI'Espagtre, attestent d'un négoce à l'aubeet au début du IIème millénaire avant notre
ère entre le Maroc, l'Algérie occidentale etla Péninsule ibérique. Ces échanges se dou-blaient d'une diffusion de courants de pen-sée qui n'allèrent pas sans influencer lesrites religieux et les pratiques funérairescomme en témoignent I'apparentement desépultures de part et d'autre du Détroit deGilbraltar et les découvertes le long de lafaçade atlantigue, du Maroc au Portugal,de statuettes en pierre de forme triangulai-re ainsi que de monolithes portant des dé-cors incisés à base de lignes ondulées etd'arc de cercles (Boube 1983 11984, Camps196I & 1992, Souville 1973 &. I992).Llin-térieur des terres fut tou ché, ou tout dumoins influen cé par ce qui se passait plusau nord comme le révèlent les gravures dehallebardes et de signes abstraits dans leHaut Atlas, lesquelles apparuissent en cer-tains endroits aux côtés de motifs à aftini-tés sahariennes, témoignant simultanémentd'une ouverture vers le sud. Dans un telcontexte, les vestiges de travail du cuivreet de métallurgie du fer, récemment mis aujour au Niger septentrional sur des sites da-tés de la première moitié du IIème millé-naire avant notre ère, retiennent tout parti-culièrement I'attention (Paris & aI. L992).Bien que sensiblement un millénaire plushautes que celles qui jusque là situaientI'apparition de la métallurgie dans le suddu Sah ara, les dates obtenues ne sont pastotalement pour surprendre à supposer queles signes abstraits de l'Adrar des Iforas etplus largement ceux répartis sur le quartnord-ouest du continent africain, aient ser-vi de supports à I'expression de croyancesou de concepts nouveaux liés à la divulga-tion rapide sur de longues distances d'uneinnovation majeure,la métallurgie, à I'au-be ou au début du IIème millénaire avantnotre ère. Si I'on accepte ces rapproche-ments,la réalisation dans l'Adrar des lfo-
1,12
ras des gravures de chars dételés aux côtésde ces signes peut être estimée contempo-raine du IIème millénaire avant notre èreet donc dater sensiblement de Ia mêmeépoque que les premières peintures de che-vaux attelés du Sahara central. Reste alorsà comprendre pourquoi, en ces temps re-culés, les graveurs de I'Adrar des Iforas nereprésentèrent pas de chevaux contraire-ment aux peintres du Sahara central qui,eux, se plaisaient à les figurer en extension,attelés par paire à des chars légers à timonsimple et roues à rayons.
Uélevage du cheval: une activitéincompatible avec la pratiquedu nomadisme pastoral souspluies de mousson
Les aires de représentations des signesdont il vient d'être question su{prennent parleur étendue. Les similitudes qui s'établis-sent entre eux sont nombreuses, trop nom-breuses pour pouvoir s'expliquer par desconvergences iconographiques rêpétées se-lon des échelles régionales. Leur vaste ré-partition géographique suppose ou une com-munauté de traditions et de croyances chezdes groupes à faible mobilité ayant occupéou s'étant déployés sur de vastes territoiresou bien une mobilité plus grande de la partde groupes moins nombreux qui, cheminfaisant, exprimaient par la gravure certainesde leurs préoccupations. Plusieurs donnéesjouent en faveur de la seconde hypothèse.En premier lieu, les contextes figuratifsriches en bovins au sein desquels appa-raissent ces signes, laissent supposer leursauteurs portés sur l'élevage. Or, il est au-jourd'hui acquis que le Sahara méridionalentra dans une phase d'ariditication rapideà I'aube ou au début du IIème millénaireavant notre ère (Maley 1981, Petit-Maire
&" al. 1983, Servant L973). Les groupesd'éleveurs de bovins du IIème millénairedûrent, etr conséquence, étendre leur airede nomadisation et vraisemblablement pra-tiquer, àu gré des rythmes saisonniers, latranshumance en direction de vallées oùI'effet d'impluvium palliaient mieux qu'enrégions de plaine aux conséquences néfastesd'une baisse de la pluviosité sur la forma-tion des pâturages. Laprésence dans I'Adrardes Iforas de gravures d'objets coudés, auxprofils apparentés à ceux de hallebardesprotohistoriques gravées dans le Haut At-las marocain, poun ait témoigner des dé-placements de groupes d'éleveurs selon unedirection gén érale nord-ouest/sud-est. Cel-le de chars aux côtés de ces mêmes objetspourrait rendre compte d'une autre alter-native en réponse à la détérioration du cli-mat: la pratique de la transhumance en di-rection des massifs centraux sahariens oc-cupés depuis peu par une population d'ori-gine septentrionale possédant des chars etdes chevaux. On pourrait ainsi multiplierles exemples de gravures semblables, pré-sentes tant le long des vallées des massifscentraux sahariens que le long de celles desmassifs d'Afrique du Nord pré-saharienneou bien de celles de l'Adrar des Iforas (D,t-puy I99aa).Lapratique clu nomadisme pas-toral fournit une explication à ces trou-blantes répétitions.
En effet, cette pratique conduit desgroupes d'horizons culturels diftérents à serencontrer et à communiquer. Les traditionset les croyances des uns ne sont pas alorssans influencer celles des autres, les biensvalorisés des uns non sans attirer la convoi-tise des autres. Tânt et si bien que des idées,des concepts, des objets, des armes, s'ac-quièrent, se transmettent rapidement, cir-culent sur de longues distances du fait dela mobilité des éleveurs impliqués dans ces
It3
relations (Féblot-Augustins & Perlès 1992).La mobilité de pasteurs, qui avaient pourtradition d'exprimer par la gravure certainesde leurs préoccupations sur les rochers desrégions qu'ils parcouraient, fournit doncune explication aux affinités qui s'établis-sent entre des gravures rupestres parfoiséloignées de plus d'un millier de kilomètres.Les distances mises en jeu ne doivent passurprendre. L'exemple actuel des Peuls wo-daabe, pasteurs nomades et éleveurs de bo-vins d'Afrique de I'Ouest, à cet égard, estfort instructif. Scindés en petits groupes,ceux du Nord-camerounais et de I'Ouest-centrafricain suivent leurs bovins sur desdistances dépassant certaines années lescinq cents kilomètres (Boutrais 1988: 48).Confronté à des situations défavorables ré-pétées, ur groupe peut ainsi parcourir sixmille kilomètres en douze ans, soit pourprendre une image, le continent africaindans sa plus grande largerlr...
La quasi-absence des silhouettes gravéesde femmes est un autre élément en faveurde I'hypothèse de la pratique d'un noma-disme pastoral. En effet, chez les groupesde pasteurs nomades, ce sont les hommesqui guident le bétail vers les points d'eauet les bons pâturages et, simultanément, leprotègent des dangers de la brousse; res-ponsabilités dont les femmes sont déchar-gées parce que souvent moins mobiles dufait de leur devoir de maternité (Dupire1960). Aussi est-ce par les hommes et nonpar les femmes que se transmettent les re-cettes magiques de fertilité du bétail, lescroyances sur la faune sauvage-. qui sontautant de préoccupations masculines tour-nées vers un monde extérieur aux campe-ments. En admettant que des pasteurs no-mades et éleveurs de bovins, furent les au-teurs des premières gravures de chars deI'Adrar des lforas, tout comme celles des
régions voisines, on comprend mieux pour-quoi les signes et les motifs que ceux-ci in-cisaient sur les rochers des régions qu'ilsparcouraient, apparaissent aux côtés ou ausein de compositions animalières riches enbovins et, du même coup, pourquoi les sil-houettes gravées de personnages fémininssont quasi-absentes et leurs activités cou-tumières omises.
A partir du milieu du IIème millénaireavant notre ère, certains pasteurs nomadesvirent évoluer à I'occasion des transhu-mances qui, en saison sèche, les amenaientle long des vallées des massifs centraux sa-hariens, des engins défiant l'imagination:des chars attelés à des chevaux. L'élémentroulant des attelages, Ie char, retint surtoutleur attention. Par la somme considerabledes savoir et savoir faire à la fois révolu-tionnaires et inaccessibles à beaucoup quesous-tendaient leur réalisation, ces chars duSahara central exercerent une fascinationtelle dans I'esprit des éleveurs qui en dé-couvraient I'existence, que ceux-ci en in-tégrèrent les representations sinon fantai-sistes, du moins approximative, dans leurrépertoire iconographique du IIème millé-naire avant notre ère. Qu'à cette époque,ces pasteurs nomades aient seulement pos-sédé des chars par suite d'échanges avec lapopulation à charrerie du Sah ara central,est difficile à concevoir. Comment en effetimaginer qu'un corps de métier ait pu, nonpas construire, mais seulement entretenirune charrerie au sein de groupes à forte mo-bilité ? Et au profit de qui I'aurait-il fait,I'art rupestre de l'Adrar des Iforas datablede cette époque ne témoignant d'aucunestratification sociale? Lamode allait au portd'objets coudés. Les rares personnages quibrandissent ces objets épousent sur les ro-chers des silhouettes miniatures de dimen-sion inférieure ou sensiblement égale à cel-
1,14
4:9. 9 - Porteur d'obiet coudé associé à troisbovins et à trois objets coudés non tenus (Issa-madanen).
le des objets portés (fig. 9). Aussi ces re-présentations humaines doivent-elles plusêtre vues sous I'angle de porteurs d'objetssacralisés que comme ayant étê objet de sa-cralisation de la part des graveurs.
Ce statut supposé de pasteur nomade desgraveurs permet en outre d'expliquer l'ab-sence des représentations gravées de che-vaux. Elever des chevaux en zone tropica-le est délicat. A la différence du taurin (ra-ce de bovins sans bosse de petite taille en-core élevée aujourd'hui au sud du Sahataet qui fut la race surtout représentée par lesgraveurs), le cheval est très vulnérable auxparasites et aux trypanosomes qui prolifè-rent durant la saison des pluies de mous-son. C'est vraisemblablement pour limiterles risques d'êpizooties que les Marbas,agriculteurs sédentaires vivant au sud dulac Tchad, enferment leurs chevaux pen-dant les trois mois que dure la saison despluies dans des écuries intégrées à I'habi-
tat (Seignobos & al. L987: 49-53). Cet amê-nagement particulier de l'habitat tend àmontrer que le cheval ne peut s'accomoderd'une vie itinérante à longueur d'année enrégion tropicale. Le fait qu'aucun desgroupes nomades peuls wodaabe évoluantaujourdhui dans l'Ouest-africain n'élève dechevaux à I'inverse des groupes peuls sé-dentaires, abonde dans ce sens. Par laconstruction des abris qu'il nécessite et lessoins réguliers dont il a besoin, le chevalest source fréquente d'immobilité. En cesens, élever cet animal constitue un frein àla pratique du nomadisme pastoral. Comp-te tenu de ces observations, oil peut sup-poser que les pasteurs nomades à traditionde gravure rupestre qui, il y a plus de troismille ans, suivaient leurs bovins sur la fran-ge méridionale du Sahara encore soumiseau régime des pluies de mousson, n'ado-ptèrent ni ne représentèrent, dans I'Adrardes Iforas et dans les régions voisines, de
115
Fig. 10 - a): Girafe et porteur d'objet coudé(hauteur du personnage: h - 0,15 m Issama-danen). b): Girafes et porteur de lance (h =
0,40 m - Adarmolen). c): Bovins et porteur d'ob'jet coudé (h = 0,26 m - Issamadanen). d): Bo-vin et porteur de lance (h = 0,40 m - Adarmo-len).
chevaux parce que ces animaux remettaienten cause la pratique ancestrale du noma-disme pastorale, et par voie de conséquen-ce, le fonctionnement même de leur socié-té.
Plus au nord, en altitude et à l'abri destsé-tsé du fait des températures basses d'hi-ver létales pour les glossines, ces animauxétaient élevés par un groupe qui possédaitdes chars que des peintres se plaisaient àreprésenter aux plafonds d'abris sous-roche.La fid élité des transcriptions est telle que
J. Spruytte (1"986), après avoir construit,grandeur nature, divers types de charsd'après des représentations peintes du Ths-sili-n-Ajj eî, apu démontrer I'existence d'unmode d'attelage à "barre de traction" ori-ginal au Sahara central et son efficacité pourle dressage des chevaux à I'attelage. A re-prendre l' argumentation développée ci-des-sus, on peut supposer, à la suite de G. Camps(1993), QUe ce groupe était en position so-ciale dominante, mais aussi qu'il était sé-dentaire ou semi-sédentaire et non pas no-
LT6
IiS. 11 - Char gravé entre deux chevaux à cri-nières épaisses et croupes déclives du style deceux, apparaissant sur la fig. 2. Les représen'tations de deux portewrs de lance, d'un boeuf,de deom autruches et d'une lance complètent la
composition. Il y a tout lieu de penser que cesgravures qui présentent la même patine et qui
furent réalisées selon la même technique, soientcontempor aine s (As enkafo) .
"r,, , "
made, comme 1'étaient les groupes d'éle-veurs de bovins peu ou pas hiérarchisés quiévoluaient plus au sud. Aux côtés et peut-être au service de cette classe aristocratique,devaient figurer des artisans parmi lesquelsdes charrons dévolus à la fabrication, à I'en-tretien et au renouvellement d'une charre-rie.
L'introduction du chevaldans le Sud du Sahara
Aux rare et discrètes silhouettes de por-teurs d'objets coudés vont succéder sur lesrochers de l'Adrar des lforas, celles plusimposantes et plus nombreuses d'hommessouvent fortement sexués, habillés, paréset armés d'une lance dans un art qui gardeson caractère animalier (fig. 10). C'est auxcôtés de ces représentations de porteurs delance qu'appaïaissent les premières sil-houettes de chevaux. La situation: est sem-blable dans 1'Aïr. Quelques chars toutefoisy sont figurés attelés à des chevaux etconduits par des porteurs de lance (RosetL97L & 1993) alors que le char qu'il nous
a êtê donné de découvrir dans l'Adrar desIforas aux côtés de porteurs de lance et dechevaux, est dêtelé (fig. 11). Mais cette dif-férence importe peu ) car l'êLêment socio-culturel le ptut significatif me semble te-nir non pas à la figuration d'attelages quel'on peut certes désormais lier à leur pré'sence effective dans le sud du Sahata, maisà 1'apparition concomitante du cheval et duport de lance.
Cette association marque un tournantdans l'histoire des groupes de pasteurs duSahara méridional à tradition de gravurerupestre; elle sanctionne l'abandon pro-gressif d'un mode d'économie ancestral, lenomadisme pastoral, au profit d'un pasto-ralisme à vocation guerrière croissante etsimultanément moins sujet à mobilité, ren-dant pat là même possible l'élevage du che-val et l'acquisition d'une charrerie. I-es don-nées archéologiques enregistrées ces vingtdernières années dans le sud du Saharu etau Sahel permettent de saisir en partie lesraisons sus-jacentes à cette évolution et si-multanément d'en fixer le cadre chronolo-gique. Ce cadre, comme nous allons le voir,
TT7
Fig. 12 - Répartition géographique des gra-vures de porteurs de lance apparaissant dansdes contextes animaliers riches en représenta-tions sQlisées de bovins. 7): Dupuy 1991 (Adar-molen),2): Lhote 1987,3): Roset 1988,4): Vé-
dy 1962, 5): Monod 1947,6): Staewen&Stried-,ter 1987, 7): Dupuy 1994b (d'après diapo J.Courtin), 8): Huard 1963.
*--.-'i olp'"
,&9" o.i ' "(
04"| {.lFonÂs
\ \- '-J'
ADRAR DES IFORAS m DJADO TIsBSMT ENNNDT
* ffi
Æ
se raccorde à celui élaboré plus-haut à par-tir de l'étude des signes abstraits et en va-lide ainsi en retour I'antiquité supposée.
J.-P. Roset (1988) a découvert au nordde I'Aïr, sur le site d'Iwelen, trois pointesde lance en cuivre dans un gisement ar-chéologique datê du Ier millénaire avantnotre ère. Les armatures mises au jour sontidentiques à celles des lances qui sont re-présentées sur des rochers avoisinants dansdes contextes animaliers riches en bovins.Ces lances sont tenues par des personnagesdu style des porteurs de lance de l'Adrardes lforas, mais aussi du style de ceuX re-levés plus à I'est dans le Tibesti, au Bor-
kou et en Ennedi, dans des contextes figu-ratifs semblables en de nombreux points àceux de I'Aïr (fig. L2). On est ainsi conduità penser que le port de la lance se gén &a-lisa chez des groupes d'éleveurs de bovinsqui évoluaient dans le sud du Sah ara du-rant le premier millénaire avant notre ère.La détérioration du climat qui s'était amor-cée à l'aube du IIème millénaire,culmine-ra sous ces latitudes autour des débuts del'ère chrétienne (Maley 1992). Elle est sansaucun doute la cause principale des faitssuivants révélés par I'archéologie.
Iæs recherches menées par M. Raimbaultet O. Dutour (1990) dans le Saharamalien
118
d'abord, puis sur le site de Kobadi plus mé-ridional, mettent en évidence un repli pro-gressif de populations sahariennes confron-tés à la détérioration du biotope à I'Holo-cène récent. Les villages en pierres sèchesdu Dhar Tichitt et du Dhar Oualata, quiavaient atteint leur développement maxi-mum à I'aube du premier millénaire avantnotre ère, se fortifient puis sont abandon-nés aux alentours du IVème siècle avantnotre ère par suite, semble-t-il, d'un épui-sement des ressources en eau. Simultané-ment et sensiblement sous la même latitu-de, la Boucle du Niger est colonisée (McIntosh R.J. & Mc Intosh S.K. 1980). Il ennaîtra au début de l'ère chrétienne la pre-mière civilisation proto-urbaine de I'Ouest-africain. Quelques siècles auparavant,avaient été construits des dizaines de gre-niers dans une grotte de hauteur de la fa-laise de Bandiagara toute proche (BedauxL972). Uaridité fut à tel point marquée danslarê,gion du Haut Sénégal qu'elle entrainal'abandon d'un village de hauteur qui s'étaitdéployé sur un vaste esp ace durant le Iermillenaire avant notre ère (Dupuy & al.L994c). Ces données, bien qu'éparses, sous-tendent un resserrement du peuplement dansle sud du Sahara et,par endroit,lanaissanced'une insécurité à une époque où le déve-loppement de la métallurgie, grandeconsommatrice de bois, dût accéIérer la dé-sertification de certaines régions.
Or, qu'advient-il du nomadisme pasto-ral lorsque le biotope se dégrade et le peu-plement se resserre? Un constat d'ordre gé-néralvient en réponse à cette question: plusforte est la densité du peuplement dans unefégion donnée, plus difficile est I'exercicedu nomadisme pastoral. Le fait qu'à partirdu premier millénaire avant notre ère despasteurs de bovins se soient représentés surles rochers armés d'une lance à large ar-
mature dont I'aptitude à percer et à fairecouler le sang est avérée, tend à démontrerqu'à partir de cette époque, des litiges ter-ritoriaux furent résolus, armes à la main etpeut-être parfois du haut de bovins spécia-lement dressés aux combats comme le sug-gèrent, dans l'Adrar des lforas, les repré-sentations de bovins montés par des por-teurs de lance (fig. 1). La lance était l'ar-me qui dissuadait I'adversaire de s'oppo-ser. Imposant ainsi leur autorité sur les airesde nomadisation qu'ils voulaient sauve-garder, les éleveurs à tradition de gravurerupestre représentèrent sur les rochers desrégions de plus en plus perçues par euxcomme leur territoire, les images viriles deporteurs de lance, vraisemblablement leurssilhouettes magnifiées avec parfois à leurscôtés des chars, engins fortement valorisés,et celles d'animaux prestigieux au rang des-quels finit par figurer le cheval. IJn chevalélevé par eux et probablement abrité despluies de mousson devenues plus spora-diques, âu sein de campements à l'archi-tecture désormais en partie conçue pour ac-cueillir ce nouveau compagnon de voyage.
A un moment donné, la population àcharrerie du Sahara central s'anëta de fa-briquer des chars et, simultanément, d'enreprésenter aux plafonds d'abris sous-roche.
De leurs côtés,sous l'effet de l'ariditémarquée des débuts de l'ère chrétienne, lespasteurs guerriers du Saharaméridional ac-compagnés de leurs bovins et de quelqueschevaux se replièrent vers les bassins desfleuves Niger et Sénégal, voire plus loinvers des régions de la frange soudanienne,délaissant par là même leur tradition d'artrupestre ancestrale. Dans un Sahel qui futpeut-ôtre coupé de l'Afrique du Nord letemps que dura l'épisode aride des débutsde notre ère, se développèrent des élevagesde chevaux qui, sélection orientée par
IT9
Fig. 13 - Représentations d'aristocrates ber-bères, ancêtres des Tbuaregs, associés à un che-val à silhouette levrettée et entourés de lignesd'écritures orientées de bas en haut dont plu-sieurs commencent par le présentatif fl€k =moi (Tamaradant).
Fig. 14 - Répartition géographique des gra-vures de porteurs de javelots (la photo mçntreun porteur de javelots de l'Adrar des lforas,station de Deladjou) identique à celle des gra-vures et des peintures de chevaux à silhouettelevrettée du sQle de ceux représentés dansI'Adrar des lforas et donnés ici pour exemple.
I'homme aidant, engendrèrent en quelquessiècles une souche naine. Ce nanisme, eilquelque sorte insulaire, retiendra à plusieursreprises l'attention des lettrés arabes. AlBakri en fut le premier surpris. Ainsi note-ra-t-il, en 1068, que "le roi de Ghana se faitaccompagner de chevaux de très petite taillecanpaçonnés d'or à I'occasion des au-diences publiques qu'il accorde pour Épa-rer les injustices" (Cuoq L973: 69-7I). Lesdescendants de ces chevaux, nommés "po-neys", évoluent encore aujourd'hui danscertaines régions du Sahel et de la frangesoudanienne (Mauny 1961 et Seignobos &al. 1987).
Les premières représentationsde chevaux montés
Les données de l'afi rupestre de I'Adrardes Iforas comparées à celles enregistréesdans des régions voisines permettent doncde situer l'arcivée du cheval au sud du Sa-
qi.:.,.Ijp,
hara dans le premier millénaire avant notreère, à une époque où des porteurs de lanceutilisaient des bovins comme monture. Apartir de quand les chevaux servirent-ils àleur tour de montures aux guerriers del'Ouest-africain? Al ldrisi nous apprendque le Roi du Ghana, au milieu du XIIèmesiècle, tout comme son voisin le Roi deKawkaw (Guo), montent à cheval (CuoqL973: LL4-LI7). Cette tradition équestreétait-elle d'origine autochtone ou fut-elleinfluencée de I'extérieur? Il est difficile dese prononcer. Les représentations de che-vaux montés de l'Adrar des Iforas fournis-sent toutefois quelques repères. Leurs pre-mières représentations sont datables du Vè-me siècle de notre ère. Elles furent l'oeuvred' aristocrates berbères originaires d' Afriquedu Nord qui pratiquaient l'équitation et laméharêe. Certains se représentèrent sur lesrochers vêtus de leurs plus beaux atours(tig. 13) et représentèrent à leurs côtés deschevaux et des dromadaires, parfois asso-
L20
1),: Aïr: Dupuy 1987 & 1988, Lhote 1972, 1979& 19 7,'Roset 1971 & 1993; 2) - Adrar des Ifo-ras: Calegari 1989, Dupuy 1991 ; 3) - Blaka:Dupuy inédits; 4) - Tassili-n-Ajjer: Graziosi1942, Kunz 1977 &1979; 5) - Ahaggar et Tas-sili-ouan-Ahaggar : Blanguernon 195 5, C amps-Fabrer 1963, Ckasseloup-Laubat 1938, Hugot
1974, Lhote 1953, Maitre 1971, Soleilhavoup1988, Trost 1981;6) -Ahnet: Monod 1932, So-Ieilhavoup 1990; 7) - Atlas (stèles peintes etgravées de Djorf Tbrba): Camps 1984 & 1986,Lihoreau 1993+ + + + + +.' Iimite du domaine touareg.
(
I
aaoaaaaaaaa.
aaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaraaa
ataoaaaa.aaa
aaaôaaaaaaaa
a.aaaaaaaaaa
aaraaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaa
aaaolaaaaaaa
raaaaaaaaaaa
aaaaraaaatao
ataaoaataaaa
aaaaaotrr lo j
ataaaaoaaaa
aaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaa
aaaaaaa.aa.a
aoaaraaaaaaa
alaaaaaaoatWm
daoaal
aaaa
aaaa
aaal
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
ataa
aaaa
aa aa
a a l t a a t a taa af a a la a t t a a ta aa a a aaa a o t
a t a a a a aa a t a a a a t t a a a a t a a a la o a t aa I t a
a a a ta a t a aa aa a o a to a!a a a a a a a l a a a a a a.
a a a a a t a a t a a aa a a aa a a aa a l a o a a a a a a a a a
a t a t a I t a a a o a t a a aa aaa o a I o l a a o a l a a a a
a t a at o t a a a a at a a aa a a aa a a aoaa l a l aa a a
a. a a a a a a aa a aa a a ao a a ot a a a a aa t a a a a a a
a a a a a a a a a a aa a a a al l oaa a a l aa a aa a a a aa
a a a a a a a a a r a t a a a t a a t aa a a aa a a l a a a aaa
aaaaaaaaaa. , . . . . . r . . DEITADJOU : : : :
: : : : : : : : : i d 'après C. Dupuy tggt i i i ia a a l a a a a a a a a ! a a r I t t a a a a aa a a a t a a a a l
:::::!i4i--.--'t..-.'t::. . . . . , . l . - : . } r \ , . . .
: : : : : i. i. (( .::: l/ i i i iaaaaaaaaataaaraaa.aaa'
taaaataaaaaa .aaaaatt
aaaaaaaaaaa È-. .aa.
. . . . rar . .aa
l
aaaaaaaaaaal
aataaaaaatat
oaraaaaaaaaoa
oaaaraaaataoa
aatataaaaaaaa
T2T
ciés sur des parois communes à des ani-maux sauvages - autruches, antilopes, gi-rafes - dans des scènes de chasse à courre(fig. 3 et fig. 4).Les silhouettes levrettéesde ces chevaux different de celles des rareschevaux qui avaient été figurés lors de laphase de gravure rupestre précédente (fig.2 et fig. 11). Elles renvoient par contre àcelles des chevaux représentés en peintureet en gravure dans des régions plus sep-tentrionales, sur une aire gé,ographique re-couvrant la majeure partie du domaine toua-reg actuel (fig. I4).
Des représentations semblables furentaussi peintes et gravées sur des stèles fu-néraires exhumées de tumulus à chapellede la région de Djorf Torba dans l'Atlassud-oranais d'Algérie (Espérandieu 1953& Lihoreau 1993). L'encadrement géomé-trique de certaines de ces stèles a conduitG. Camps (1984) à les considérer commecontemporaines des derniers siècles de l'oc-cupation romaine. Ces données, alliées àd'autres que j'ai déjà eu l'occasion de pré-senter (Dupuy 1992: LL5-I23), font envi-sager le scénario suivant: forts de leur maî-trise à élever des chevaux et des droma-daires et à les dresser pour le combat, despasteurs guerriers qui ê,taient originairesd'Afrique du Nord, se rendirent maîtres auxalentours du Vème siècle de notre ère, deterritoires sahariens et sud-sahariens dontils gravèrent et peignirent certains rochers,y imposant simultanément des manièresnouvelles de vivre, aujourd'hui spécitiquesaux Touaregs.
Ces pasteurs guerriers, ancêtres de cer-tains groupes touaregs, ont pû introduire,aux alentours du Vème siècle de notre ère,la tradition du cheval monté dans I'Ouest-africain. Cette tradition est attestée bien an-térieurement en Afrique du Nord par la dé-couverte dans la nécropole de Douïmes,
d'un médaillon en argile cuite représentantun cavalier accompagné d'un chien. Ce mé-daillon est daté, des alentours du VIèmesiècle avant J.C. (Decret 1977:2I7). Fortsde cette tradit ion équestre,les Numidess'il lustreront lors des guerres puniques.l,eurs prouesses à monter à cru des chevauxet à les conduire à I'aide d'un collier freinou d'une baguette, retiendront I'attentiondes premiers auteurs nord-africains (GsellL928) qui, en rapportant les exploits, ferontentrer les cavaliers numides dans l'Histoi-re à partir du IIIème siècle av. J.C.
Pour revenir à notre point de départ, Va-lentim Fernandès ne pouvait se douter, envoyant, au début du XVIème siècle, le Roides Mandinka partir combattre à califour-chon sur un boeuf, qu'il était le témoind'une tradition de monte des bovins par desguerriers de l'Ouest-africain vieille de plusde deux mille ans. IJne tradition que lesdonnées de l'aftrupestre de l'Adrar des Ifo-ras font supposer d'origine sud-saharienneet aussi ancienne, si ce n'est plus ancien-oe, que la naissance d'une équitation enAfrique du Nord et sensiblement contem-poraine de l'introduction du cheval dans lesud du Sah ata.(Milano 72.4.1994)
122
Bibliographie:
Aegr-ANET J., Signes sans paroles, cent sièclesd'art rupestre en Europe occidentale, Edit. Ha-chette, Paris 1986 (345 p.).
AN{eI-enp S. et Oulu KHATTAR M., "Nou-veaux chars rupestres sur le Dhar Oualata (Mau-ritanie sud-orientale)", Dossiers et recherchessur l'Afriqu€,fo 1, Meudon L993,pp.143-155.
Beoeux R.M.A., "Tellem, reconnaissancearchéologique d'une culture de l'Ouest africainau Moyen-Age: recherches architecturales",JSA, n" 42, 1972, pp. 103-185.
BratsB J., "Peintures et gravures rupestresdans le Serkout et l'Anahef (Ahaggar oriental)",Libyca, T. IV Alger 1956, pp. I25-I34.
BI-nNcuERNoN C.,Le Hoggar, Edit. Arthaud,Paris 1955 (229 p.).
Bousn J., "LIne idole néolithique à Chellàh",Bull. d'Archéol. maroc., T.XV L98311984, pp.125-130.
Botrrnets J., Des Peuls en savanes humides -Développement pastoral dans I'Ouest centra-fricain, Edit. ORSTOM, Paris 1988 (383 p.).
BneuNsrBm-STLVESTRB F., "Coup d'oeil surle cheval et le char dans I'Egypte du NouvelEmpire", in Les chars préhistoriques du Saha-ra - Archéologie et technique d'attela7€, Edit.sous la direction de G. Camps et M. Gast, I AP-MO, Université de Provence, Aix-en-Proven-ce 1982 (200 p.).
CeIBcARI G., "Le incisioni rupestri diTaouardei (Gao, Mal). Problematica genera-Ie e repertorio iconografico",Mem. Soc. It. Sc.Nat. e Museo Civ. St. Nat. di Milano, T. XXVno 1, Milano 1989 (L4 p.).
Caups G.,Aux origines de la Berbérie - Mo-numents et rites funéraires protohistoriEtes )A.M.G., Paris I96L (628 p.).
Cnups G., "Les tumulus à chapelle du Sa-hara protohistorique. Tombes-sanctuaires desGétules", Annales Litt. Univ. Besançon,Hom-mages à J.-P. Millotte, t984, pp. 56I-572.
Ceups G., "Funerary monuments with atta-ched chapels from the northern Sahara", TheAfr. Archaeol. Rev., no 4, 1986, pp. 151-164.
Carrnps G., "Protohistoire de l'Afrique du
Nord - Question de terminologie et de chrono-logie", REPPAL,T.3, L987, pp. 43-70.
Caups G., "Bronze (Age du)", in Encyclo-pédie Berbère, T. XI, sous la dir. de G. Camps,Edisud, Aix-en-Provence 1992, pp. 1614-L626.
Cevps G., "Chars (art rupestre)", in CampsG. (ed.), Encyclopédie Berbère, T. XII, Edisud,Aix-en-Provence 1.993, pp. 1877 -1,892.
Cevps-FÂsnnR H., "Dalle gravée de I'Asse-krem (Hoggar)",Libyca, T. XI, Alger I963,pp.15 1- 168.
Crnssnroup-l,nuBAl F.,Art rupestre au Hog-gar (Haut Mertoutek), Paris 1938.
CTmNoRKTAN R., Les armes métalliques dansI' art protohistorique de I' Occident méditerra-néen, CNRS, Marseille 1988 (a1a p.).
Cuoo J., Recueil des Sources Arabes concer-nant Ie Bilad al-Sudan depuis le VIIIème sièclejusqu'au WIème siècle, Thèse, Paris I, 1973(s3a p.).
DBcnsr F., Carthage ou I'empire de la mer,Edit. du Seuil, Paris 1977 (252 p.).
DupInB M., "Situation de la femme dans unesociété pastorale (Peuls wodaabe, nomades duNiger)", in Paulme D. (ed.), Femmes d'Afriquenoire, Mouton & Co, La Haye 1960, pp. 51,-92.
Dupuv C., "Evolution stylistique et théma-tique des gravures de trois stations de l'Aïr mé-ridional (Niget)", Trav. du LAPMO, Aix-en-Provence L987, pp. 125-135.
Dupuv C., "Evolution iconographique detrois stations de I'Aïr méridional (Niger)", Ca-hiers ORSTOM,24,2, Paris L988, pp. 303-315.
Dupw C., "Réalisation et perception des gra-vures stylisées de I'Adrar des Iforas (Mali)",Trav. du APMO, Aix-en-Provence 1990, pp.93-109.
Dupuv C., Les gravures rupestres de l'Adrardes lforas (Mal) dans le contexte de l'art sa-harien: une contribution à l'histoire du peu-plement pastoral en Afrique septentrionale duNéolithique à nos jours, Thèse de l'Universitéde Provence, 2 tomes, Aix-en-Provence I99I,(404 p.).
Dupuv C.,"Ttois mille ans d'histoire pasto-rale au sud du Sahata", PAM, n" 1, LAPMO,Aix-en-Provence 1992, pp. 105 -126.
r23
Dupuv C., "Signes gravés au Sahara encontexte animalier et les débuts de la métallur-gie ouest-africaine", PAM, ûo 3, LAPMO, Aix-en-Provence I994a (sous-presse).
Dupuv C., "Pîimauté du masculin dans lesarts gravés du Sah ara - Nomadisme pastoral etsociétés", h L' homme méditerranéen, Melangesofferts à G. Camps, LAPMO, Université de Pro-vence, Aix-en-Provence L994b (sous-presse).
Dupuv C., RtsBn J. et StssoKo F., "Y aban-don du site protohistorique de Dialaka à l'Ho-locene supérieur (Mali)", Quaternaire, ParisI994c (sous-presse).
EspEneNDIEU G., "Remarques au sujet de fi-gurations d'animaux domestiques provenant deDjorf Torba (Sud-Oranais) et conservées au Mu-sée du Bardo (Alger)", Libyca,T.I, Alger 1953,pp. 181,-197 .
Fgglor-AucusrlNs J. et PBnI-gs C., "Pers-pectives ethnoarchéologiques sur les échangesà longue distan Çe" , in Ethnoarchéologie, justi-
fication, problèmes, limites. Actes des XIIèmerencontres internationales d' archéol. et d' hist.,Edit. APDCA, Juan-les-Pins I992,pp. L95 -2I0.
GnaNnET P., "La migration des Peuples dela mer", L'Histoire, n" I32, 1990, pp. 16-24
GnamoET P., Ramsès III, Histoire d'un règne,Edit. Pygmalion, Paris 1993 (4L9 p.).
Gnezost P., L'arte rupestre della Libia,2vol., Napoli 1942 (326 p.).
Gssrl Sr., Histoire ancienne de l'Afrique duNord, Hachette, Paris L928 (6 tomes).
Huenn P., "A propos des bucrânes à cornedéformée de Faras", Kush,XI, Khartoum 1963,pp. 63-81.
Hucor H.-J., Le Sahara avant le désert,Edit.des Hespérides, Toulouse 1974 (343 p.).
JaNost P", "Recent excavations of the Aus-trian Archaeological Institute at the village of' F.zbet HelmiÆbll el- Qi r qafa near Tell el D ab' a",in VI Congresso Internazionale di E gittologia,T. I, Torino L992 (684 p.).
Keup B. J., Mr,nTLLEES R. S. ET Eoel E.,"Minoen Pottery in Second Millennium Egypt",D eutches Archaolo gisches Instituf, Kairo 1 980(340 p.).
KuNz J., "Neue Sahara-Felsmalereien", An-
tike Welt, Feldmeilen 1974, pp. 1.9-26.
KuNz J., "Neue Felsbildfunde in den west-lichen Tassili-n-Ajjer (Algerien)", Paideme, no23, 1977, pp. I-I7 .
KuNz J., "Felsbilder der westlichen Tassili-n-Ajjer (Algerien)", Beitrrige zur allgemeinenund vergleichenden archriologi€, fro t, L979,pp.20I-240.
Kuxz J., "Contribution à l'étude des charsrupestres du Tassil i-n-Ajjer occidental", inCamps G. et Gast M. (eds.), Ies chars préhis-toriques du Sahara - Archéologie et techniqued'attelag€, LAPMO, Université de Provence,Aix-en-Provence 1982 (200 p.).
LHorp H.,"Le cheval et le chameau dans lespeintures et gravures rupestres du Sah aîa" , BI-FAN, T. XV 3, Dakar L953, pp. 1138-1228.
LHore H.,Les gravures dunord-ouest de l'Aïr,Art et métiers graphiques, Paris 1972 (205 p.).
LHorB H,, Les gravures de l'Oued Mamma-net (Ir{ord-Ouest du massif de l'Aïr), Les Nou-velles Editions Africaines, Dakar 1979 (a31 p.).
LHorn H., "Spirales et entrelacs du Sahata",Le Saharien, n" 92, Paris L985, pp. 17-19.
LuorB H., Les gravures du pourtour occi-dental et du centre de I'Aïr, Edit. Rech. sur lescivilisations, 70,Paris 1987 (281 p.).
LtHonseu M., Djorf Torba, nécropole saha-rienne antéislamique,Edit. Karthala, Paris L993(135 p.).
MarunE J.-P., Contribution à la Préhistoirede l'Ahaggar. I - Tefedest centrale,Mém. CRA-PE n"XV[, AMG, Paris I97I (225 p.).
MeI-Bv J., Etudes palynologiques dans lebassin du Tchad et Paléoclimatologie del'Afrique nord tropicale de 30.000 ans àl'époque actuelle, Travaux et Docurnents deI'OR.STOM, ûo I29, Paris 1981 (586 p.).
Marnv J., "Mise en évidence d'une péjora-tion climatique entre ca. 2500 et 2000 BP enAfrique tropicale humide", Bull. Soc. géol. Fr.,tro 3, Paris L992, pp. 363-365.
MaTHoMME J., Corpus des gravures rupestresdu Grand Atlas, Publications du Service desAntiquités du Maroc, Rab at 1959|196I (156 p.l164 p.).
MauNv R., "Tableau géographique de
r24
I'Ouest africain au Moyen Age d'après lessources écrites, la tradition et l'Archéologie",Mémoires de I'I.F.A.N., no 6L, Swets & Zeit-linger N.V., Amsterdam 196L (587 p.).
Mc INrosH S.K. et R.J., " Prehistoric Inves-tigations in the Region of Jenne, MaIi: a Studyin the Development of Urbanism in the Sahel.Part l: Archaeological and Historical Back-ground and the Excavations at Jenne-Jeno. PartII: The Regional Survey and Conclusions",Cambridge Monographs in African Archaeo-logy, no2, BAR, Oxford 1980 (54L p.).
MoNoo Tu. , "U Adrar Ahnet. Contributionà l'étude archéologique d'un district saharien",Trav. et Mém. de I'Institut d'Ethnologie, XIX,Paris 1932.
MoNoo TI{., "Sur quelques gravures rupestresde la région d'Aozou (Tibesti)", Rivista di Scien-ze preistoriche,Il, I, L947, pp. 30-47 .
MoNop TH., TBrxerRA DA More A. et Mau-Nv R., "Description de la Côte occidentaled'Afrique (Sénégal au Cap de Monte Archipels)par V Fernandes (1506-1510)", Centro de es-tuda Guiné port., Mémoires n" L1, Bissau 195L(22s p.).
MuNsoN P.J., "Recent archeological resear-ch in the Dhar Tichitt region of South-centralMaurit ania" , West African Archaeol. Newslet-ter, n" 1-0, 1968, pp. 6-13.
MuxsoN P.J., The Tichitt Tradition: a LataPrehistoric Occupation of the South-westernSahara, Thèse, Univ. Urbana Champaign of llli-nois l97l (393 p.).
PanIs F., PrnsoN A., QuEcHoN G. et Serte-ce J.-F., "Les débuts de la métallurgie au Nigerseptentrional" , JSA, 62 (2), 1.992, pp. 55-68.
Pnur-MATRE N., RIsen J. et al., Sahara ouSahel. Quaternaire récent du Bassin de Taou-denni (Mali), Lab. de Géol. du Quatern. duCNRS, 1983 (an p.).
RanN{eAUUr M. et Duroun O., "Découvertede populations mechtoïdes dans le Néolithiquedu Sahel malien (gisement lacustre de Koba-di); implications paléoclimatiques et paléan-thropologiques", C. R. Acad. Sci., T. III, no 31-0,Paris L990, pp. 631-638.
Rosnr J.-P., "Art rupestre en Aïr", Archeo-logia, 39, 1971, pp. 24-3I.
Roset J.-P., "Iwelen, un site archéologiquede l'époque des chars, dans l'Aïr septentrional,au Nig er" , in Histoire générale de I'Afrique.Etudes et documents UNESCO,II, Presses Uni-versitaires de France,Pais 1988, pp. 121-lJJ.
Rosnr J.-P. ,"Lapériode des chars et les sé-ries de gravures ultérieures dans l'Aïr, âu Ni-gar" , in Cale gari G. (ed.), L'arte e l'ambientedel Sahara preistorico: dati e interpretazioni,Mem. del Museo di Storia Naturale di Milano,Vol. XXVI, fasc. II, 1993 (556 p.).
RousBr F.-E., "I-l extension septentrionale etméridionale de la zone à gravures rupestres duSud Oranais (Atlas saharien)", in 6ème CongrèsPanafricain de Préhistoire, Dakar 1967, PP.244-266.
SBrcNoBos C., TouRNEUX H., HeNTIC A. etPTaNcHENAUH D., "Le poney du Logone",Etudes et Synthèses de I'EMVT, n"23, ParisIe87 (213 p.).
SnnveNT P., Séquences continentales et va-riations climatiques et évolution du bassin duTchad au Cénozoïque supérieur, Mém. ORS-TOM, n' L59, Paris 1973 (573 p.).
SorBu-HAVoup F., "Dêcouvertes archéolo-giques exceptionnelles au sud de l'Ahagg&t",Sahara, I, 1988, pp. 49-72.
SolslrHAvoup F., "Nouvelles stations ru-pestres à I'ouest de I'Ahag Etf" , Sahara,3, 1990,pp.7I-82.
Souvtrle G. , Atlas préhistorique du Maroc- 1. Le Maroc atlantieu€, CNRS, Paris 1'973(368 p.).
SouvnLE G., "Campaniforme (céramique)",in Camps G. (ed.), Encyclopédie Berbère, T.XI, Edisud, Aix-en-Provence 1,992, pp. 1725-1728.
Spnrrrrre J., "Figurations rupestres sahariennesde chars à chevaux, recherches expérimentales surles véhicules à timons multiples",Antiquités afri-caines, n. 22, Paris '1,986, pp. 29-55.
SrepwnN C., SrnmpTER K.H., Gonoa, Edit.Franz Steiner Verlag Wiesbaden GMBH, Stutt-gart 1987 (325 p.).
Tnosr F.,Die Felsbilder des ZentralenAhag-gar (Algerische Sahara), Akademische Druck-u, Verlagsanstalt, Graz 198I (251 p.).
r25