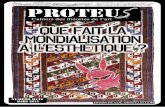1999 - L'art rupestre à gravures naturalistes de l'Adrar des Iforas (Mali)
Transcript of 1999 - L'art rupestre à gravures naturalistes de l'Adrar des Iforas (Mali)
Uart rupestre à gravures naturalistesde l'Adrar des lforas (Mali)
Christian Dupuy*
Summary
Contextual study of opproximately40 rtaturalist roclz engrauings in theI{orth West of the Adrar des lforasregion. These, together utith a fnnother stylised engrauings associatedutith them, are shown to be the old-est artistic manifestations in the re-gion. Roclz engrauirugs similar instyle and themes are present in a ge-ographic region extending ouer theIarger part of the Central artdSouthern Sahara. If we lzeep inmind the themes depicted on theroclzs, the data from the archaeologi-cal digs and those recorded inH olocene p alaeo - enu ironment s, indi-cate that this Saharan rock art utithnaturalist erugrauings can be situat-ed between the 6th millenrtium andthe end of the 4th millenn ium B.C.During this period, the Sahara wasexposed to different rainfalls, de-peruding on the latitude. The pre-dominantly animal nature of thisroch e,rt, together utith its densityuarying with the latitude, leads tothe conclusion that this art was theproduct of a lr{eolithic pastoral soci-ety composed of mobile shepherdgroups. Some of these peoplereached the Î{orth West of the Adrardes lforas, uthere they producedaround 40 roclz engrauings similarto those found on the rochs of morenortherly regions.
Riassunto
Studio contestuale di circa 40 inci-sioni in stile naturalistico nella zo-na nord-occidentale dell'Adrar desIforas. Llarticolo dimostra che que-ste incisioni, insieme ad alcune al-tre associate ad esse, sono le mani-festazioni artistiche più antichedella regione. Incisioni rupestri distile e soggetti analoghi sono pre-senti in una regione geografîca chesi estende su gran parte del Saharacentrale e meridionale. Le informa-zioni ottenute dagli scavi archeolo-gici e i dati raccolti sui paleoam-bienti olocenici, se si tiene conto deitemi trattati dall'arte rupestre, con-sentono di situare queste incisioninaturalistiche in un arco di tempoche si estende tra il W millennio ela fine del IV millennio a.C. In que-sto periodo il Sahara era esposto aprecipitazioni di diversa intensità aseconda delle latitudini. I soggettidell'arte rupestre sono principal-mente animali e la densità delleopere varia con Ia latitudine: duecircost artze che inducono a conclu-dere che l'arte rupestre fosse il pro-dotto di una società neolitica pasto-rale composta da gruppi di pastorimobili. Alcune di queste popolazioniraggiunsero la parte nord-occiden-tale dell'Adrar des Iforas, dove ese-guirono una quarantina di incisionirupestri simili a quelle che si trova-no sulla rocce delle regioni più set-tentrionali.
Résumé
Étnde contextuelle d'une quaran tai-ne de gravures rupestres de stylenaturaliste réalisées au nord-ouestde I'Adyar des lforas. Ces æuvres etquelques gravures stylisées asso-ciées, sont les plus anciennes mani-festations artistiques de la région.Des gravures rupestres apparentéessur les plans des thèmes et desstyles sont présentes dans une airegéographique recouvrant la majeu-re partie du Sahara central et méri-dional. Les données issues desfouilles archéologiques alliées àcelles enregistrées sur les paléomi-lieux holocènes en regard desthèmes traités sur les rochers, per-mettent de situer l'âge d'expressionde cet art rupestre du Sah ara à gra-vures naturalistes entre le VIU mil-lénaire et la fin du IV' millénaireav. J.-C.. À cette époque, le Saharaétait soumis à des régimes de préci-pitations différenciées dépendantde la latitude. Le caractère anima-Iier prédominant des æuvres et leurdensité variable suivant la latitude,conduisent à en attribuer les réali-sations à une société pastorale quiétait composée de groupes d'éle-veurs mobiles. Certains de ces éle-veurs atteignirent Ie nord-ouest del'Adrar des Iforas où ils réalisèrentune quarantaine de gravures ru-pestres semblables à celles que l'onretrouve sur les rochers des régionsplus septentrionales.
En L952, le style élaboré d'une gravure d'éléphant photographiéequelques années plus tôt par le Capitaine Gerin-Jean à In Frit (Flg. 1),en bordure du Tilemsi, retient I'attention d'H. Lhote: I'animal est figuréen course dans une attitude dynamique qui l'individualise des repré-seqjationl ggbématiquçgrde la région. Cette gravure, unique en son gen-t"(@tpassansévoqueicellesd'éléphantsréaliiées
*UPR 806 du CIr{RS
"Métallurgies et Culttr.res))74, rue Pierre CorneilleF-69006 Lyon (France)dans le-TâÀsili-ruffir et au Fezzan méridional. Aucune manifestation
naturaliste n'étant connue à l'époque entre ces régions que plus de mil-
SAHARA 1111999 Dupuy 69
FiS . 1. Répartition des gravures ru-pestres de style naturaliste au nord-ouest de l'Adrar des lforas.
le kilomètres séparent, H. Lhote, par prudence, renonce à intégrer lagravure d'In Frit dans le même horizon chrono-culturel que celles duSahara central. En 1967, H. Lhote et R. Tomasson (p. 235) publient uneseconde gravure d'éléphant se faisant, elle aussi, le reflet d'une réalitéanimée. Liæuvre se situe une cinquantaine de kilomètres au nord d'InFrit, à Ti-n-Sala Adjarak. Les auteurs relèvent sur une paroi voisineune autruche en marche chassée par un archer au corps vu de profil (p.235). Uarc étant alors considéré comme une arme caractéristique deséleveurs de bovins à tradition de gravure rupestre du Sahara central,l'hypothèse de réalisations d'âge pastoral est avancée non sans réserve.En L986, nous découvrons sur le versant nord-occidental de I'Adrar desfforas, en bordure de l'oued Afara et de l'oued Egharghagh (Fig. 1), deuxaffluents de rive gauche du Tilemsi, quarante six représentations ani-males et humaines, identiques à quelques détails près sur le plan desstyles à celles d'In Frit et de Ti-n-Sala Adjarak. Des stations d'art ru-pestre comprenant d'autres æuvres naturalistes restent peut-être à dé-couvrir dans les secteurs que nous n'avons pas prospectés. En atten-dant, la question de savoir à quelle(s) époque(s) et par quelle(s) socié-
70 SA-IIARA 11/1999 Dupuv
té(s) furent réalisées ces gravures mérite d'être reposée en regard deI'inventaire actuel et de l'avancée des connaissances enregistrées depuisIes années 1960 dans les domaines de la nréhistoire et de la paléoécolo-gie sahariennes.
Les premiers graueurs de I'Adrq,r des lforas
Quarante des quarante-six gravures de style naturaliste découvertesen 1986, se trouvent réunies sur la station d'Issamadanen (Fig. 2 à 15).Les six restantes se répartissent à leur entour dans un rayon d'unevingtaine de kilomètres. Issamadanen est le massif de bordure de val-Iée le plus imposant du versant nord-occidental de I'Adrar des lforas. Ilest constitué de plusieurs éperons rocheux parallèles s'élevant en di-vers endroits à plus de quarante mètres de hauteur par rapport au ni-veau de la vallée d'Egharghagh avoisinante. Les granitoïdes se déIi-tent, ici, par thermoclastie, en bancs de grandes surfaces. Ailleurs lesblocs répartis sur les crêtes sont plus morcelés. Les parois sur les-quelles se trouvent les gravures naturalistes n'ont pas d'orientationprivilégiée. De plus, les distances et les hauteurs entre leurs positionset la vallée sont très variables. Etant donné I'exiguïté des lieux où nousavons relevé certaines d'entre elles, le nombre d'acteurs ayant partici-pé à leur réalisation, à supposer qu'il y en eut plusieurs, ne pouvait dé-passer Ia dizaine.
Ces manifestations naturalistes de I'Adrar des Iforas comprennentnon seulement des animaux sauvages mais aussi des bovins et deuxpersonnages. La faune sauvage est représentée par onze éléphants, septgirafes, deux lionnes, deux cynocéphales, deux autruches, un rhinocérosblanc précédé de son petit, un rhinocéros noir et un guib. Les seize bo-vins inventoriés se retrouvent gravés à Issamadanen. Il s'agit danstous les cas d'individus sans bosse de la variété des taurins. Leurscornes sont variées. Deux sujets en sont dépourvus. Certains corps cloi-sonnés traduisent I'existence de robes bigarrées. Quelques colliers etpendeloques sous-jugulaires nous laissent entrevoir les rapports étroitsqui liaient le pasteur à ses animaux. Deux personnages en marche s'in-tègrent dans cet ensemble. Le premier, entièrement vu de profil, accom-pagne à larges emjambées une antilope guib (Tragelaphus scriptus).Lesecond, au buste vu de face, est masqué; il se déplace avec deux girafesà son contact, l'une maintenue contre son ventre, I'autre posée sur sesépaules. Les forces surnaturelles qu'il développe permettent de I'identi-fier à un être mythique ou à une divinité.
La plupart des gravures naturalistes étaient obtenues par piqueta-ge et (ou) polissage. Les largeurs et profondeurs des traits sont régu-Iières et rarement supérieures au centimètre. La frnesse des incisionsayant présidé à la réalisation de deux girafes et d'un bovin impliquentI'utilisation d'une pointe fine ou d'un outil à tranchant effilé. Les pa-tines sont identiques aux roches supports ou bien plus claires. Les tonsles plus foncés s'observent sur les parois soumises aux ruissellements,en particulier là où les traits gravés retiennent I'eau des pluies. Les re-présentations épousent des échelles variées. A type d'exemple, les sil-houettes gravées des girafes suivent des hauteurs comprises entre qua-rante centimètres et un mètre vingt. Indépendamment des réductionsqu'adoptaient les graveurs, le caractère naturaliste de leurs æuvres seperçoit surtout à la manière dont les membres sont traités. Ils sont bienproportionnés et leurs positions correctement transcrites. De plus, lestracés des avant-bras et des cuisses de second plan s'arrêtent le plussouvent à l'endroit où, conformément à Ia réalité, ceux de premier planles masquent. Mais il arrive aussi parfois que les tracés d'arrière planse noient dans l'épaisseur de ceux de premier plan. Les graveurscréaient par ce biais I'illusion d'une profondeur de champ qui rend pos-sible l'identification des membres antérieurs et postérieurs droits etgauches des animaux, et de la même manière, celles des bras et jambesdroits et gauches du personnage représenté à Issamadanen en priseavec un guib. Ce rendu du relief se retrouve parfois appliqué aux ni-veaux des organes appariés. Ainsi, et toujours en conformité avec Iaréa-lité, les tracés des cornes, des oreilles ou des défenses se recouvrent to-talement en profil absolu ou se fondent partiellement dans les cas deprofiIs légèrement biaisés. Cette aptitude des graveurs à donner du re-
SAHARA 1111999 Dupuy 7I
Figures 2 ù 75. Exemples de grauuresnaturalistes réalisées sur la montagned'Issamadanen au nord-ouest deI'Adrar des lforas (Mali)
Fig. 2. Personnage masqué au brasgauche orné d'un bracelet, en marcheavec deux girafes à son contact (hau-teur = 0,7 m).
lief à leurs æuvres s'observe également au niveau des compositions as-sociant des animaux par paire: les parties de l'animal d'arrière planmasqué par le corps de l'individu de premier plan n'étaient pas figuréspar transparence. Les yeux sont traités en amende ou bien rendus pardes cupules groupées par paire sur des têtes de profil. De trois bovinÀ etde trois girafes ne furent représentés que le hau-t du corps.
Aux côtés de ces æuwes d'essence naturaliste apparaissent sur cer-taines parois des gravures au naturalisme mal affirmé: l'enlacementdes tracés en partie haute des avant-bras et des cuisses entrainent desreprésentations en plan indifférencié. Malgré leur différence de style,ces gravtffes suivent les mêmes thèmes, relèvent des mêmes techniqueset montrent des tons de patine identiques. Leur agencement en compo-sition témoigne de leur contemporanéïté. Preuve nous est ainsi fournieque le critère des styles est à lui seul insuffisant pour ordonner les ma-nifestations artistiques régionales en chronologie relative. Aussiconvient-il de parler à propos de l'art développé sur les rochqrs par cetensemble de gravures, d'un art rupestre à gravures naturalistes plutôtque d'un art naturaliste.
Les auteurs des æuwes naturalistes avaient parfaitement enregistréla marche en quatre phases des mammiÊres: d'abord lancé d'un membrepostérieur suivi de l'antérieur correspondant, les droits par exemple. Lemême mouvement est répété à gauche: postérieur puis antérieur et ainside suite. Le temps de latence entre ces quatres pàs successifs ainsi queleurs amplitudes sont variables d'une espèce à une autre et fonction descinétiques de déplacement. Sur les représentations, Cest tantôt une jam-be, tantôt une autre qui est en progression si bien que nos relevés, rame-nés à une échelle commune, montés en série sur un film puis visionnés,donneraient lieu à un dessin animé de belle facture. Tandis que les bo-vins avanceraient à allure paisible, des girafes et des éléphants apparaî-traient en course. Liinquiétude d'autres pachydermes et de rhinocéros enmarche serait décelable à leur queue en position horizontale ou verticale.Il est difficile de concevoir que des attitudes si fidèlement transcrites al-liées à des conventions graphiques si homogènes, aient pu naître sponta-nément, au hasard du temps, de la main de quelques marginaux douésde potentialités artistiques hors du commun. Aussi paraît-il plus logiqued'identifier les auteurs de ces représentations à des individus quiavaient été initiés à l'art dlnciser les rochers.
Aucun bovin n'est associé sur une paroi commune à un animal sau-vage. Toutefois leur réunion sur la station Issamadanen conjuguée àleur parenté de style (rendu du reliefaux niveaux des organes appariés,
72 SAIIARA,1V1999 Ilupuy
figurations des yeux en amende, règle de non transparence des corps)engagent à les rattacher à une même séquence culturelle. Le fait quesix silhouettes gravées de bovins et onze d'animaux sauvages apparais-sent sous-jacentes à des gravures se référant à d'autres thèmes et àd'autres conventions, le fait encore que les unes et les autres présententdes tons de patines plus foncés que ceux des gravures qui les recou-vrent, confortent cette hypothèse. Ces observations imposent mêmeI'idée selon laquelle les auteurs des æuvres naturalistes étaient animésde préoccupations différentes de celles des graveurs qui, à des époquesplus récentes, se remirent à inciser les rochers de lâdrar des lforas.
Ainsi, l'étude conjuguée des répartitions spatiales, des styles, desthèmes et des superpositions apparaissant sur certaines gravures, per-met d'avancer la thèse que les gravures naturalistes du nord-ouest deI'Adrar des Iforas et quelques gravures stylisées associées, furentl'æuvre d'initiés, membres d'une société pastorale à tradition d'élevagede bovins et premiers graveurs à s'être exprimés sous ces latitudes àune époque qu'il importe désormais de préciser.
Les repères chronologiques régionauxLes groupes d'éleveurs ont, à tout moment, la possibilité de creuser despuits et (ou) de se déplacer vers des régions plus favorisées par l'hydro-graphie et Ie climat lorsqu'ils doivent s'affranchir des déficiences en eauet en fourrage d'une région. Il est diffrcile dans ces conditions d'établirune relation directe de cause à effet entre les besoins en eau et en nour-riture des bovins et le climat qui régnait dans lAdrar des Iforas àl'époque où s'exprime I'art rupestre à gravures naturalistes. Le compor-tement des espèces de la grande faune sauvage est, lui, par contre, di-rectement fonction du biotope. Ces espèces évoluent en des lieux oùelles trouvent à satisfaire leur besoin en eau et en nourriture. Confron-tées à une raréfaction des points d'eau ou à une détérioration progressi-ve du couvert végétal, elles migrent vers des horizons plus propices àleur survie. Certaines sont plus sensibles que d'autres à ces modifica-tions du milieu naturel. Reste à savoir lesquelles, parmi celles qui fu-rent représentées de manière naturaliste dans lAdrar des Iforas, don-nent au préhistorien les meilleures indications paléoécologiques.
Lhabitat des éléphants est vaste. Cette espèce peut se contenter deboire tous les deux bu trois jours. À type d'exempie, les éléphants duGourma parcourent aujourd'hui annuellement 800 kilomètres de part
FiS.3. Composition en deux registres.Dans la partie haute, une représenta-tion naturaliste d'éléphant est sous-jacente à une gravure de bovin et àune de girafe. Dans la partie inférieu-re, un personnage guide, à larges en-jambées, une antilope guib (Tlagela-phus scriptus) à l'aide d'une laisse.Cette dernière semble avoir été en-roulée autour du mufle et du genouantérieur droit et croisait le ventre del'animal sans contrarier pour autantsa démarche naturelle (hauteur dupersonnage = 0,25 m).
SAHARA 7117999 Dupuy 73
et d'autre de Ia frontière du Mali et du Burkina-Faso. Ils atteignent ex-ceptionnellement ltsohyète 150 mm lors de leurs déplacements. La gira-fe est en mesure de s'abreuver irrégulièrement. De fait, cette espèce estcapable de se maintenir sous l'isohyète 50 mm. Le rhinocéros noir man-ge des rameaux, des feuilles, des écorces d'arbres et de buissons. Il s'ac-comode donc de biotopes variés et va parfois chercher sa nourriture àplus de 50 kilomètres d'un point d'eau. Le rhinocéros blanc est,lui, trèsexigeant en nourriture et en eau. C'est un herbivore qui tond I'herbe dela savane. Il ne s'éloigne jamais beaucoup d'un point d'eau et parcourttout au plus 10 kilomètres par jour. En conséquence, parmi les espècesde la grande faune sauvage représentées dans l'Adrar des lforas, le rhi-nocéros blanc est le meilleur marqueur climatique. Des autres animauxsauvages qui furent gravés, c'est le guib qui incontestablement est Ieplus sensible aux variations d'humidité. Lui aussi ne s'éloigne jamaisbeaucoup d'un point d'eau et est un herbivore de savane. Rhinocérosblancs et guibs ne vivent que sous des latitudes où la pluviosité assurela formation d'un tapis herbacé relativement continu. Une telle situa-tion se rencontre aujourd'hui en zone sahélienne au sud des isohyètes200-300 mm. Ces minima pluviométriques, bien qu'intéressants, sont ensoi insuffisants pour apprécier la situation paléoclimatique de l'Adrardes Iforas à l'époque où sont réalisées les æuwes naturalistes.
F]n effet, ces 200-300 mm sont atteints et parfois même dépasséscertaines années dans la région. Les maxima enregistrés, dans les an-nées 1950, furent par exemple de 334 mm à Kidal (Dubief,1957), de 185mm à Tessalit (Dubief, t962) et, dans les années 1970, de 192,8 mm àKidal (Fabre et a1.,1982:6). Il n'empêche qu'aucune espèce de la grandefaune soudanienne ne vit aujourd'hui à ces latitudes et de mémoired'homme, il en a toujours été ainsi. Ce qui manque et ce qui ainanqué àces espèces sauvages, en sus d'une pluviosité mieux répartie et enmoyenne égale ou supérieure à 200 mm, c'est la présence de plans d'eaupermanents. Après une bonne saison des pluies,les vallées du massi{ ycompris la vallée d'Egharghagh au sol argileux entrecoupé de nombreuxchenaux, se couwent de mares éphémères qui ne restent jamais appro-visionnées en eau plus de trois mois. Les rares mares pérennes du mas-sif connues des Touaregs, se situent à flanc de montagne et aux piedsd'éboulis.
Par le passé, des étendues d'eau pérennes durent nécessairementexister dans les vallées de l'Adrar des Iforas puisque des rhinocérosblancs et un guib y furent gravés. Une telle situation a longtemps pré-valu à I'ouest de l'Adrar des Iforas ainsi que I'attestent des données surles paléomilieux holocènes enregistrées pàr l'équipe de N. Petit-Maire etJ. Riser (1983). Une recherche pluridisciplinaire associant des spécia-listes en Sciences de la Terre à des spécialistes en Sciences de I'Hommea en effet permis de mettre en évidence I'existence d'un réseau de lacsfossiles couwant une bonne partie du Sahara malien. Lierg Ine Sakane(20"30-21'N; 0-1"E), situé à une centaine de kilomètres à l'ouest-nord-ouest de l'Adrar des lforas, constituait l'appendice le plus oriental de cecomplexe lacustre qui fut approvisionné en eau pendant près de cinqmillénaires, de 9500 à 4000 BP* (Riser, Hillaire-Marcel et Rognon, 1983:81-84). Sur un des gisements préhistoriques distribués sur cet erg, datéde 4100 à 3400 BR C. Guerin et M. Faure (1983: 24I) ont identifré des
74 SAIIARA M999 Dupuy
Fig. 4. Eléphant en marche avec, enarrière plan, un individu de taille plusréduite (peut-être un éléphanteau)dont seule la tête est représentée, wai-semblablement par respect de la règlede non transparence des corps (hau-teur de l'éléphant = 0,80 m).
*Âges 1aC non corrigés.
,1.,
/
/
4ossements de bovidés ne s'éloignant jamais beaucoup d'un point d'eau,en l'occurence du buftle (Syncerus caffer), de l'éIan de Derby (Taurotra-gus derbyanus) et du guib harnaché (Tlagelaphus scriptus). Liidentifrca-tion de cette dernière espèce est particulièrement intéressante puisquec'est elle que nous voyons représentée sur la magistrale composition na-turaliste relevée à Issamadanen en bordure de la vallée d'Egharghagh(Fig.3).
Des ossements de guib harnaché ont aussi été exhumés non loin dela boucle du Niger, dans la basse vallée du Tilemsi à Karkarichinkat(17oN, 0o à 1" E) dans des gisements archéologiques datés de 4000 à3400 BP, renfermant, entre autres ossements, divers restes de bovinset de chèvres (Smith, 1975 et 1979). Par ailleurs, cinq dents d'un bovi-né ont été identifrées dans le Sahara malien, sur le site d'A3aouane(Guerin et Faure L983:247).Il est malheureusement difficile dè dire sicet animal était domestique et si Ia date de 6970t130 BP (GIF 5495)obtenue sur os de poisson lui est attribuable.
Un cadre chronologique émerge de ces données et situe grossière-ment la phase à gtavures naturalistes de lAdrar des Iforas. Dans I'hy-pothèse où le boviné d'Araouane était domestique, on peut placer pro-visoirement en limite inférieure de ce cadre, la date, il est wai discu-table, de 6970t130 BP. En limite supérieure, on peut retenir les datesde 4000-3400 BP, époque où Ia présence de bovins est attestée à Karka-richinkat, mais époque aussi, où des guibs harnachés et très waisem-blablement des rhinocéros blancs vivaient autour des derniers mari-gots d'un Sahara malien entrant dans sa phase d'aridification sub-ac-tuelle. Face à Ia disparition progressive des points d'eau, ces espècesmigrèrent vers Ie sud, mais quelques individus purent aussi se refugierdans les vallées ouvertes de I'Adrar des Iforas, véritables impluviumsnaturels à condition, bien entendu, que la pluviosité ait été suffrsantepour assurer Ie maintien d'un réseau de mares pérennes; auquel cas ladate extrème de 3400 BP retenue par référence à l'erg Ine Sakane se-rait encore trop ancienne.
Ces quelques données incitent à placer la phase rupestre à gravuresnaturalistes de l'Adrar des Iforas entre la frn du VIe et la frn du II" mil-lénaire avant J.-C. Cette fourchette chronologique qui au total englobequatre millénaires, est démesurée en regard des quarante-six æuvresnaturalistes relevées. Aussi allons-nous chercher à I'affiner en nous re-
FiS.5. Représentation d'éléphantsdans des attitudes différenciées recou-vertes par des gravures stylisées deréalisation plus récente. La règle denon tranparence des corps se retrouveappliquée dans cette composition na-turaliste (largeur de la composition =0,90 m).
SAHARA LL/I999 Dupuy 75
Fig.6. Girafes finement incisées (hau-teur = 0,45 m). Toutes deux sont repré-sentées en marche et en des phases lo-comotrices diftrenciées. Celle de droi-te est oblitérée par un personnage à latête et au corps vtrs de face et entière-ment piquetés.
portant aux données archéologiques et paléoécologiques enregistréesdans d'autres régions d'Afrique septentrionale, au sein desquelles etnon loin desquelles ont été relevées des gravures rupestres apparentéessur les plans des thèmes et des styles aux expressions naturalistes del'Adrar des Iforas.
Des æuures naturalistes dans une uasteaire géographique \Des gravures rupestres répondant à la définition du style naturalistetelle qu'elle est établie au début de cet article à partir de l'observationdes représentations animales et humaines de I'Adrar des Iforas se fai-sant le reflet d'une réa1ité animée, ont été relevées dans les MessakMellet et Settafet, la Tadrart Akakous et méridionale, Ie Tassili-n-Ajjer,I'Ahaggar, le versant occidental du fibesti, le Djado et ses environs.Dans ces régions comme dans l'Adrar des lforas, le caractère naturalis-te s'observe surtout à la manière dont les membres des animaux et despersonnages sont traités. Ils sont bien proportionnés et leurs positionscorrectement transcrites. De plus, les tracés des membres de secondplan s'arrêtent à l'endroit où, conformément à la réalité, ceux de pre-mier plan les masquent. Les graveurs créaient par ce biais l'illusiond'une profondeur de champ qui rend possible l'identification desmembres antérieurs et postérieurs droits et gauches des animaux, et dela même manière, celles des bras et jambes droits et gauches des per-sonnages parfois représentés à leurs côtés.
Les densités dæuwes naturalistes les plus élevées se notent aux la-titudes les plus septentrionales, en bordure des vallées entaillant lesentablements rocheux des Messak Mellet et Settafet et du Tassili-n-Aj-jer. Avec ses quarantes gravures naturalistes, la station d'Issamadanen,au nord-ouest de I'Adrar des Iforas, fait frgure d'exception. En effet,rares sont les lieux entre les 24e et 19" parallèles à avoir liwé jusqu'àprésent plus de vingt gravures de ce style. Aucune n'est connue plus au
76 SAIiARA1V1999 Dupuy
sud. Une autre précision sTmpose ici. Aucune des silhouettes humaineset animales gxavées sur les rochers de plein air de l'A,rr, de l'Ahnet, del'Ennedi, et plus loin, de l'Atlas en Algérie, du Haut-Atlas et de fAnti-Atlas au Maroc, du Sahara Atlantique et de la vallée du Nil, ne montreles perspectives, ni n'épouse les attitudes dynamiques des représenta-tions naturalistes du Sahara. Le plus souvent, seuls les membres depremier plan sont figurés et ceux d'anrière plan omis. Sur les rares re-présentations animales aux quatres pattes traitées, la continuité et l'en-lacement des tracés en partie haute des avant-bras et des cuisses en-trainent des figurations en plan indifférencié. Ces stylisations alliéesaux thèmes et aux compositions spécifiques que développent les gra-vures sur les rochers de ces régions, témoignent de la distance culturel-le séparant leur réalisation de celles du Sahara central et méridionalcomprenant des æuwes naturalistes.
Où que l'on se situe dans l'aire géographique délimitée par cesæuvres, des représentations animales et humaines au naturalisme malaffinné se retrouvent associées sur des parois communes à des æuwesplus élaborées sur le plan des styles. Malgré leur élaboration diflérente,ces gravures suivent les mêmes thèmes et les mêmes mouvements. Deplus, toutes présentent les mêmes traits et les mêmes patines. Leuragencement en compositions témoignent de leur contemporanéïté. Aussiconvient-il de parler à propos de l'art développé par ces gravures àl'échelle de plusieurs régions du Sahara, comme nous l'avons fait plushaut à propos de lAdrar des lforas, d'un art rupestre à gravures natu-ralistes plutôt que d'un art naturaliste.
Indépendamment des régions considérées, les bovins, les éléphants,les girafes et les rhinocéros comptaient parmi les sujets préférés desgraveurs. De multiples recoupements stylistiques et thématiques dansl'art rupestre des Messak Settafet et Mellet et du Tassili-n-Ajjeqconfirment Ia contemporanéïté des réalisations d'animaux sauvages etd'animaux domestiques. Certaines parois montrent des gravures natu-ralistes de bovins sous-jacentes à celles d'animaux sauvages. Liordreinverse d'oblitération existe aussi. Quelques réalisations associent di-vers tSpes de traits: des incisions larges, profondes et polies aux côtésde tracés fins et superficiels. Ces associations attestent l'utilisationconjointe de plusieurs techniques de gravure. Des æuwes slndividuali-sent par leurs dimensions imposantes, parfois supérieures à celles desanimaux frgurés. Ces derniers apparaissent sur les rochers à des al-lures et en des phases locomotrices différenciées. Les bovins sont soit àl'arrêt soit en marche, isolés ou en troupeaux avec effet de perspectivedû à la non transparence des corps. Cette règle toutefois n'était pastoujours suivie de façon rigoureuse. Il arrive en effet que certains su-jets soient vus à travers les corps d'autres sujets. Les grandes espècessauvages se déplacent souvent d'un même élan. Des girafes et des élé-phants sont figurés en course. Iiinquiétude de rhinocéros en marche
Fig. 7. Protomée de girafe fondu dansle corps d'un individu entièrement re-présenté (hauteur = L,20 m). Les yeuxsont rendus par des cupules groupéespar paire sur des têtes de profil.
SAIIARA LUt999 Dupuy 77
est décelable à leurs queues en position verticale. Les graveurs sa-vaient rendre compte avec précision d'autres attitudes. Ici un taureause lèche une patte arrière. Ailleurs des animaux apparaissent couchés,pattes repliées sous le ventre. Certainb sujets sont réduits à leur têteou à leur avant train. Les yeux sont traités en amende ou rendus pardes cupules groupées par paire sur des têtes de profrl. Lorsque liéespar superposition à des représentations animales et humaines ren-voyant à d'autres thèmes et à d'autres conventions, les gravures de sty-le naturaliste apparaissent toujours sous-jacentes (Dupuy 1996: 175).De fait, elles se présentent en tous lieux comme les plus anciennes ma-nifestations d'art rupestre du Sahara.
Les représentations humaines associées à ces représentations ani-males méritent un développement particulier tant elles aussi participentde thèmes caractéristiques de cette époque qui a vu naître puis s'expri-mer au Sahara l'art rupestre à gravures naturalistes. De certains person-nages njétaient traités que la tête ou le buste comme de certains animauxnjétaient rendus que le protomée ou Ïavant-train. Ceux entièrement re-présentés s'animent souvent sur les rochers, les pieds orientés dans lesens des déplacements, les coudes parfois étirés vers Ïarrière. Quelquesuns accompagnent des animaux sauvages ou des animaux domestiques,ou léurs font face ou bien leurs touchent I'arrière train. Des compositionsévoquent la chasse. D'autres en revanche s'écartent de la réalité à llnstarde ces êtres mythiques à tête de lycaon représentés en marche dans lesMessak, avec des aurochs sur leurs épaules et des têtes de rhinocéros sus-pendues à leur ventre. Leur force surnaturelle renvoie à celle du person-nage masqué de lâdrar des lforas, porteur de deux girafes. \
Il est diffrcile de voir le fruit du hasard dans ces caractères récur-rents qui ne se retrouvent jamais appliqués aru( grarues rupestres deréalisation plus récente oblitérant, en divers endroits, des æuwes natu-ralistes... à moins de concevoir que la transcription des mouvements etdes perspectives, que la précision des attitudes, que les thèmes et lesconventions décrits jusqu'ici, aient pu naître spontanément, au hasarddu temps, çà et là, dans une aire géographique importante, de la mainde quelques marginaux doués des mêmes potentialités artistiques queles auteurs des gravures naturalistes de l'Adrar des lforas.
D'autres thèmes, également caractéristiques de cette phase ancien-ne à gravures naturalistes, connaissent des répartitions géographiquesplus limitées. En dresser la liste deviendrait vite fastidieux étant don-né qu'aucun ensemble de gravures naturalistes présent en un lieu dé-terminé n'est strictement identique à aucun autre. Que l'on considère,par exemple, les personnages coiffés de têtes animales ou cerxr mascu-lins fortement sexués, représentés dans une attitude évoquant celle dudieu Bès égyptien (Choppy, 1996), ou bien encore ceux féminins sil-houettés bras levés et à demi-tendus ou baissés et ramenés le long deshanches, jambes écartées et à moitié pliées, parfois associés dans desscènes érotiques à des êtres ithyphalliques à corps humain et tête dechacal (Camps, 1997), aucun de ces sujets n'aété relevé jusqu'à présentdans l'Adrar des Iforas et dans le Tibesti alors que leur présence estavérée plus au nord en divers endroits. I-létat lacunaire des inventaires
78 SAIIARA1V1999 Dupuy
Fig. 8. Rhinocéros noir (Diceros bicor-nis). Hauteur = 0,30 m.
FiS.9. Lionne (hauteur = 0,20 m).
peut expliquer ces différences. Toutefois, une autre explication est envi-sageable dès lors que des absences du même ordre se notent entre desensembles de gravures réalisées à différents endroits dans une mêmerégion (Dupuy, 1989) ou bien entre ceux répartis en bordure d'une mê-me vallée (Van Albada, 1996). Dans ces conditions, les aptitudes, sensi-bilités et choix différents des graveurs,leurs degrés divers d'initiation,l'évolution de leurs préoccupations, les finalités diverses des æuvresproduites, les changements de lieux d'expression selon les saisons et aufil des générations, deviennent autant de facteurs susceptibles d'expli-quer ces variations iconographiques multiples se jouant à diverseséche.lles.
A ce stade de I'analyse, on peut retenir que les gravures naturalistesde I'Adrar des Iforas et du Tilemsi voisin se rattachent indéniablementà une aire géographique qui a été l'aire d'une seule et même entité cul-turelle. Où qu'ils se soient exprimés, les auteurs de ces gravures vi-vaient au côté d'une faune soudanienne dont ils frxaient sur les rochersune certaine symbolique. Leurs æurres rupestres nous indiquent égale-ment qu'ils élevaient des bovins. Ceux des Messak Mellet et Settafetpossédaient des chèvres, des moutons et des chiens que nous fontconnaître les découvertes de ces quinzes dernières années. Quelquesgravures naturalistes de chiens et de moutons sont présentes parailleurs dans le Tassili-n-Ajjer, I'Ahaggar et au Djado.
Une question de mobilitéLa vaste répartition géographique de l'art rupestre du Sahara à gra-vures naturalistes reçoit deux explications:- ou bien eIIe témoigne de I'existence de groupes d'éleveurs mobilesqui appartenaient à une seule et même société et qui, chemin faisant,
FiS. 10. Autruches (hauteur du sujetcentral = 0,80 m). Les tracés piquetésdes sujets gravés dans la partie bassede la paroi offrent des tons de patinesplus clairs que ceux ayant présidé à laréalisation des deux autruches de sty-le naturaliste en position centrale.
SAHARA IIf.999 Dupuy 79
FiS. 11. Tête de bovin à cornes pen-dantes aux courbures inverses (hau-teur = 0,50 m). La corne d'arrièreplan n'est pas vue par transparence àtravers la tête et la corne de premierplan. Uæil est représenté en amendecomme sur les figures 3, L2, LB et L4.
FiS. 12. Tête de bovin à cornes pen-dantes vue de face (hautellr = 0,45 m).
avaient pour tradition d'exprimer par la gravure des préoccupations su-jettes à variations suivant les individus, les générations et les lieux,mais slnspirant toutes d'un même univers conceptuel;- ou bien elle atteste une communauté de pensée à laquelle adhérè-rent diverses sociétés qui pratiquaient l'élevage sur des territoires voi-sins et exprimaient par la gravure, suivant des conventions établies, despréoccupations semblables à de nombreux égards.
Plusieurs données en relation avec les observations qui précèdent,conduisent à privilégier la première de ces deux hypothèses; à commen-cer par celles relatives à un ensemble de gravures rupestres réaliséesau Sahara entre le V et le XII. siècles ap. J.-C.
Ces gravures se caractérisent par l'omniprésence des représenta-tions de chevaux et de dromadaires associées en divers endroits à desantilopes, à des autruches, à des porteurs de javelots et à des inscrip-tions libyques. Les thèmes développés sur les rochers renvoient à destraditions et à des coutumes propres aux Touaregs tels que la monte deschevaux et des dromadaires, la pratique de la chasse à courre, le port deplusieurs javelots et de vêtements amples et bien couwants, l'usage del'écriture. Reportées sur une carte, ces (Euvres rupestres délimitent uneaire géographique qui recouvre Ia majeure partie du domaine touareg -un domaine grand comme trois fois la France - à I'exception de sa fran-ge méridionale confinant au domaine des cultures sous pluies des agri-culteurs du Sahel. Aussi paraît-il logique d'attribuer cet art rupestreaux ancêtres des Touaregs bien qu'aucun ensemble de gravures ne soitstrictement identique à aucun autre par delà leurs registres stylistiqueet thématique communs (Dupuy, 1998). Cet exemple témoigne du bonrecouwement pouvant s'établir entre l'espace occupé par une sociétécomposée de gtoupes d'éleveurs mobiles et celui sur lequel se sont ex-primés ses graveurs. Il est alors tentant de transposer cette situation àdes périodes plus anciennes, et notamment à l'époque d'expression deI'art rupestre saharien à gravures naturalistes en vue d'en attribuer laréalisation à une société de pasteurs nomades. La tentation est d'autantplus grande que les résultats convergents issus de recherches ethnolo-giques confortent plutôt cette hypothèse.
Au sein des sociétés africaines pratiquant le nomadisme pastoraldans les régions de savane, ce sont les hommes qui guident le bétailvers les points d'eau et les pâturages dont Ia gestion collective est fac-teur d'unité. Ce sont aussi les hommes qui protègent leurs animaux desdangers de la brousse; une responsabilité dont les femmes sont déchar-gées parce que souvent moins mobiles du fait de leurs activités quoti-diennes. Ces dernières se déroulent Ia plupart du temps'à I'intérieur età faible distance des campements; elles consistent en l'aménagement etI'entretien réguliers de l'habitat, en la garde des enfants en bas âge, auxpréparations culinaires et à ce qu'elles impliquent d'intendance. Aussi
80 SAHARA 11/1999 Dupuy
est-ce par les hommes et non par les femmes que se transmettent lesmythes sur l'origine des premiers animaux domestiques, les recettesmagiques de fertilité du bétail, les croyances sur la faune sauvage, quisont autant de préoccupations masculines tournées vers l'extérieur descampements. Une autre régularité se dégage de ces recherches en an-thropologie sociale: la tendance générale des sociétés de pasteurs no-mades à l'expansion territoriale sous les effets conjugués de Ia multipli-cation des lignages et de l'accroissement des troupeaux. Cette expan-sion est amplifiée en milieu sahéIien par I'irrégularité des précipita-tions et par la nature et répartition variables des pluies selon la latitu-de et la longitude aux conséquences parfois néfastes sur les pâturages.IJexemple des Peuls nomades illustre bien cette situation. Scindés enpetits groupes, ceux-ci se répartissent dans une aire géographique im-portante à I'ouest du lac Tchad. En année de sécheresse, certainsgroupes suivent, à travers les savanes arborées de Centrafrique et duNord-Cameroun, Ieurs bovins sur des distances dépassant les cinq centskilomètres (Boutrais, 1988)...
Revenons alors à l'art rupestre du Sahara à gravures naturalistes.En admettant que des hommes, pasteurs nomades aux préoccupationstournées vers I'extérieur des campements, en furent les auteurs, on s'ex-plique mieux la vaste aire géographique que délimitent les æuvres ru-pestres, le caractère animalier prédominant des thèmes qu'ellès déve-loppent sur les rochers et simultanément la sous-représentation despersonnages féminins ainsi que l'omission figurative sur leurs activitésquotidiennes. Les données iconographiques s'accordent ainsi avec lesdonnées ethnologiques pour attribuer cet art rupestre du Sahara à gra-vures naturalistes à une société qui était composée de groupes d'éle-veurs mobiles plutôt qu'à diverses sociétés qui auraient pratiqué l'éle-vage sur des territoires voisins tout en exprimant par la gravure, sui-vant des conventions communes, des préoccupations semblables sur denombreux plans.
Les paysages contrastés du Sahdra ù I'Holocène rnoyenAux éléments de datations qui proviennent des fouilles archéologiqueset des recherches paléoenvironnementales menées dans le Sahara ma-lien viennent s'ajouter ceux enregistrés dans l'aire géographique délimi-tée par les gravures naturalistes et dans les régions voisines.
Des fouilles réalisées sur les sites du Fayoum et de Merimdé dans labasse vallée du Nil, d'autres effectuées à l'est des Messak, sous les abrisnaturels de Ti-n-Torha Nord et de l'Uan Muhuggiag dans la TadrartAkakous, ont permis Ia mise au jour d'ossements de bovins, de moutonset de chèvres (Barich et al.,1987; Brewer, 1989; Driesch und Boessneck,1985). Les plus anciens restes de ces animaux étaient intégrés dans desniveaux datés par la méthode du radiocarbone des VI-V" millénaires av.
FiS. 13. Bovin à encornure lyriformevue de face sur une tête de profil(hauteur de la tête = 0,20 m).Uoreille d'arrière plan n'est pas re-présentée. Le contour du corps del'animal très stylisé a été obtenu parun piquetage plus grossier que celuidélimitant la tête et les cornes; cequi suggère une réalisation en deuxtemps et probablement à deuxépoques différentes.
SAHARA LL/L999 Dupuy 81
/
,
4
/--
\-
'/
;
I
J.-C. (âges réels ou corrigés). C'est de cette même époque que sont datésles plus anciens restes de bovins exhumés autour de l'Adrar Bous enbordure nord-occidentale du Ténéré (Paris, 1997). IJapparition des bo-vins tant au nord qu'au sud de I'aire géographique délimitée par I'art ru-pestre à gravures naturalistes, se situe donc dans les VI-V" millénairesav. J.-C. Les premières représentations de ces animaux au Sahara auxcôtés de celles d'animaux sauvages ne peuvent, par conséquent (jusqu'àpreuve archéologique contraire), remonter au-delà de cette époque.
Les données sédimentologiques et paléoécologiques enregistrées sousces mêmes latitudes, permettent, elles, de frxer Ia limite chronologiquebasse de cet art rupestre. Les premiers dépôts sablo-silteux sous l'abride Ti-n-Hanakaten dans le Tassili-n-Ajjer méridional sont datés du VII.millénaire av. J.-C.; ils traduisent une amorce d'aridification qui serasans rémission jusqu'à nos jours (Aumassip, I9B4:202). Les spectres pol-liniques indiquent qu'une végétation de type semi-aride est en placedans la Tadrart Akakous aux V-IV" millénaires av. J.-C. (Pasa e Pasa-Du-rante, L962). Les scènes figurées à Saqqarah vers 2500 av. J.-C. dans lestombes des hauts fonctionnaires de l'Ancien Empire ne montrent quedes antilopes adaptées au désert. Ces données suggèrent fortement quele climat au nord du 24e parallèle s'était détérioré à tel point à I'aubedu III" millénaire av. J.-C. que les espèces les plus exigeantes en eautels que les hippopotames, crocodiles, rhinocéros blancs, poissons, fla-mants roses, pélicans que I'on retrouve gravées en bordure de valléesdans les Messak Mellet et Settafet et, pour partie, dans le Tassili-n-Aj-jer, ne pouvaient y survivre. Leurs représentations datent donc selon
82 SAHARA 11/1999 Dupuv
FiS. 14. Deux bovinscrochet orientées versverts par des gravuresplus récente (hauteurl'individu au corps enreprésenté = 0,20 m).
aux cornes enl'arrière recou-de réalisationde la tête degrande partie
toute vraisemblance d'avant cette époque. Ces repères chronologiquespermettent ainsi d'établir que I'art rupestre à gravures naturalistess'est exprimé à un moment ou à un autre entre Ie VI" millénaire et lafrn du IVe millénaire av. J.-C.
À partir du VI" millénaire av. J.-C., Ie Sahara fut soumis à des ré-gimes de précipitations différenciés dépendant de la latitude. Tandis quele Sahara libyco-égyptien était arrosé par les pluies d'hiver de plus enplus capricieuses liées à la descente du front polaire au sud du golfe deGrande Syrte (Brookes, 1989; Haynes, 1980; Wendorf & Schild, 1980),succédait aux pluies fines et régulières qui avaient arrosé les massifsméridionaux depuis la fin du Pléistocène, un régime de pluies à caractè-re orageux comparable à la mousson actuelle (Durand et Lang, 1986;Maley, 1981; Rognon, 1989; Servant, 1973). En conséquence le tapis her-bacé dans Ie sud du Sahara, probablement, ne se développa plus au mê-me rythme que celui du Sahara libyco-éryptien. C'est après Ia mousson,soit en automne, que les vallées des massifs sud-sahariens, présentaientles meilleurs pâturages alors que, parallèlement, la flore des régionsplus septentrionales attendait, pour se régénérer, les précipitations d'hi-ver liées à la descente du front polaire. Cet étalement des pluies devaitnon seulement modifier les cycles migratoires des grandes espèces sau-vages mais aussi infléchir les itinéraires des groupes de pasteurs saha-riens. Il devient alors tentant de corréler la forte représentativité de I'artrupestre à gravures naturalistes au nord ùa,24 parallèle et sa sporadici-té au sud, aux flux et reflux saisonniers de groupes de pasteurs en quêtede points d'eaux et de pâturages de meilleure qualité que ceux qui floris-saient dans leur aire de nomadisation traditionnelle. Cette dernière inté-grait probablement Ie Tassili-n-Ajjer et les Messak si I'on en juge par ladensité élevée des æuvres naturalistes dans ces deux régions.
Le fait que des moutons et des antilopes addax et oryx aient été re-présentés au nord du24'parallèle, autrement-dit dans les régions à for-te densité de gravures naturalistes, alors qu'aucune de leur silhouetterattachable à la phase ancienne n'aété relevée à cejour entre les 24 et19" parallèles, peut s'expliquer également en regard de ces conditionsparticulières du climat. Les antilopes orJD( et addax sont des espècesadaptées aux milieux arides que l'on ne rencontre jamais dans les mi-lieux de savane boisée. Quant aux moutons, il est intéressant de rappor-ter ici les observations faites par Jean Boutrais (1988: 134) en Centra-frique auprès de Peuls nomades issus de régions sèches plus septentrio-nales. Dès les premières pluies, les moutons introduits par ces éleveursont souffert d'un parasitisme interne, de diarrhées et d'infections auxpattes qui ont été fatals à nombre d'entre eux. À ces pertes dues au cli-mat froid et humide des débuts de la saison des pluies de mousson, sesont ajoutées celles, également importantes, dues aux carnivores telsque panthères et civettes dont les agneaux constituent des proies facilesdans les hautes herbes caractéristiques des paysages soudaniens. Ladécimation du cheptel ovin sous I'effet de ces facteurs conjugués, a rapi-dement conduit les Peuls nomades à abandonner l'élevage du moutonen Centrafrique. Or nous avons noté plus haut qu'à l'époque où s'expri-me l'art rupestre à gravures naturalistes dans I'Adrar des Iforas, unesavane arborée et des mares perennes se maintiennent dans les valléesalors qu'un réseau de lacs s'étend à la majeure partie du Sahara malien(Petit-Maire et Riser, 1983). Dans ces conditions,le sort des moutons enlibre pâture, à supposer que des individus ait pu seulement atteindreces contrées méridionales, ne dut être guère plus enviable que celui ré-
FiS. 15. Bovin aux longues cornes dé-versées vers l'arrière et au corps cloi-sonné traduisant l'existence d'une robebigarrée (hauteur de la tête = 0,30 m).
SAHARA l1./I999 Dupuy 83
servé aujourd'hui à leurs congénères dans les hautes herbes de Centra-frique. Lexistence de biotopes par trop humides au sud du 24 parallèlepeut donc avoir causé l'absence physique de cet animal de même quecelles d'antilopes oryx et addax et expliquer par là même les absencesconjuguées de leur représentation. Ce n'est là bien entendu qu'une hy-pothèse. Celle de choix culturels peut aussi être avancée. Toutefois il estintéressant de rappeler ici que les restes de faune mis au jour à Karka-richinkat dans la basse vallée du Tilemsi sur deux gisements datés desIII-II" millénaire av. J.-C., comprenaient des ossements de bovins, dechèvres et d'espèces inféodées à I'eau parmi lesquelles du guib harna-ché. Les fouilles n'ont livré, en revanche, aucun indice sur la présencede moutons et d'antilopes addax et oryx (Smith, 7975:201).
Une autre absence fait sens dans l'hypothèse d'une pratique du no-madisme pastoral au Néolithique à travers un Sahara régulièrementsoumis à l'aridité dans sa partie septentrionale: celle généralisée des re-présentations gravées de porcs alors que la présence de cet animal,vraisemblablement domestique, est avérée sur les sites de Merimdé etdu Fayoum, dans les niveaux ayant livré les plus anciens ossements debovins, de chèvres et de moutons. Le porc n'aime pas s'exposer long-temps au soleil. De plus il craint les fortes chaleurs et a besoin de boire,s'ébattre et se souiller quotidiennement. Autrement dit, cet animal n'estpas candidat à un départ pour une vie nomade en milieux découverts etsemi-arides. Uabsence de sa représentation et de ses restes au Sahara,fournit, par conséquent, un indice supplémentaire en faveur d'une pra-tique du nomadisme de la part de la société pastorale de I'Holocènemoyen à l'origine de l'art rupestre à gravures naturalistes.
Associés à la mobilité des groupes d'éleveurs dont était composée cet-te société, quelques graveurs furent conduits à réaliser une quarantained'æuvres naturalistes sur des rochers situés en bordure du Tilemsi et dedeux de ses affluents de rive gauche. Ces gravures, marginales sur leplan des styles, s'avèrent aujourd'hui très précieuses: elles consituent eneffet les premiers indices en faveur d'une pratique de l'élevage, et, selontoute vraisemblance, du nomadisme pastoral dans le nord du Mali à unmoment ou à un autre entre le VIe et le IV" millénaires av. J.-C.
Bibliographie non exhaustive.La présentation synthétique des gra-uures naturalistes du Sahara qui est foi-te plus haut dans le para,graphe ,,Desæuures naturalistes dans une uaste airegéographique,,, s'appuie sur l'examen denombreux releués, présentés dans diuersliures et articles. Citer leurs auteurs au
Bibliographie
niueau du texte aurait imposé de mul-tiples et répétitifs renuois. Aussi a-t-il étédécidé d'intégrer ces études uniquementdans la bibliographie afin de ne pas en-trecouper le paragraphe en question pclrde multiples références. Le lecteur pour-ra donc s'y reporter pour jugnn docu-mertts à. l'appui, des affinités stylistiques
et thématiques qui s'établissent entre lesgrauures rupestres de diuerses régiortsdu Sahara. Précisons encore que cesliures et art icles renuoient ù d'autresétudes non mentionnées ci-dessous maisqui, el les aussi, contribuent ù Ia connais-sance de I'art rupestre du Sahara ù gra-uures naturalistes.
Almnn-HuanD L. ET P. Huann, 1983.Les grauures rupestres du Saharaet du I{il: I'ère pastorale. Le Caire:Étude Scientifîque, 65 p.
Ar.,r,ann-Huano L. trT P. Hu.tRt,1985 . Le cheual, le fu, et le cha-meau sur le ll/il et au Sahara. LeCaire' Étnde Scientifique, 84 p.
Auuassp G., 1984. Le site de Ti-n-Hanakaten et Ia néolithisationsur les marges orientales du Sa-hara central. Cah. O.R.S.Z O.M.,sér. GéoI. , XIY 2:189-2L2.
Bantcn B.E. (nt.), 1987 . Archaeologyand enuirorument in the LibyanSahara. The excauations in theTadrart AcacLts, 1978-1983. Cam-bridge: Monographs in AfricanArchaeology, BAR InternationalSer ies, 368 ,347 p.
Banrs H., 1857. Reisen Entdechun-
gen in Ir{ord und Central Afrika.Edit. Perthe s, 2 vol.
Bournats J., 1988. Des Peuls en se,-uarLes humides. Déueloppementpastoral dans I'Ouest-centrafri-cain Paris: ORSTOM, 383 p.
Bnpwnn D.J., 1989. Fishermen,Hunters and Herders, Zooarchae-ology in the Fayum (ca. 8200-5000 BP). Cambridge: Mono-graphs in African Archaeology,BAR International Series, 478,186 p.
BnooNBs I.A., 1989. Early Holocenebasinal sediments of the Dakh-Iah oasis region, south centralEgypt. Quaternary Research, 32:139- r52.
Caups G., I97 4. Les ciuilisationspréhistoriques de I'Afrique duIr{ord et du Sahara. Paris: Edit.
Doin, 366 p.Cartps G., 1997. Le chacal de Ti-n-
Affelfelen (AhaggàY, Algérie).Gravures rupestres et ensemblesfunéraires protohistoriques. So-hara, 9: 35-50
Casrrct,roNr A. B 4., G. Npcno, 1986.Fiumi di pietra. Archiuio dellapreistoria sahariana. Varese: Edi-zioni Lativa, 366 p.
CHoppY J. Er 8., 1996. Le "djenoun',,définition et aire de répartition.Sahara, S: 86-90.
DnrpscH A. (Vow Dpx) UND J. Bops-SNECK, 1985 . Die Tiernochenfun-de aus der Ir{eolitischen Siedlunguon Merimde-Benisalame e,mWest l ichen Ml Del ta. Mùnchen,Institut ftr Palaeoanatomie, Do-mestikationsforschung und Ge-schichte der Tiermedizin. Deut-
84 SAHARA I1lI999 Dupuy
sches Archaeologisches Institutdes Universitât, AbteilungKairo.
DusmF J.,1957. Le Précambrien sa-harien du sud de l'Adrar des Ifo-ras. In: H. Radier (sous la dir. de),Contribution ù I'étude géologiquedu Soudan oriental (A.O.F.)., Bvll.Serv. géol. et prosp. min. A.O.F., 26,2 tomes: 1331 p.
DusIor J.,7962. Le climat du Saha-ro. Alger: Inst. Rech. saharienne,2 tomes,587 p.
Dupuy C., 1989. Les gravures natu-ralistes de lAdrar des Iforas(Mali) dans le contexte de l'artrupestre saharien. Tlau. LAPMO,Aix-en-Prov ence: I5 I- 17 4.
Dupw C., 1995. Primauté du mas-culin dans les arts gravés du Sa-hara. Nomadisme pastoral et so-ciétés. In: R. Chénorkian (éd.),IiHomme méditerranéen. Mé-langes offerts à Gabriel Camps.Aix-en-Provence, Publications deI'Université : 193-207 .
Dupuv C., 1996. Mobilité des peu-plements et arts rupestres dansIes bassins des fleuves Niger etNil..In: D. Commelin, C. Dupuy etM. Raimbault (éds), Les fleuvesrefuges africains. Hommes et cli-mats à I'Holocène. Préhistoire etAnthropologie Méditenanéenne,5: 173-196.
Dupw C., 1998. Réflexion surl'identité des guerriers représen-tés dans les gravures rupestresde lAdrar des Iforas et de I'Aïr.Sahara,10: 3 1-54.
Dunewn A. pr J. LeNc, 1986. Ap-proche critique des méthodes dereconstitution paléoclimatique: leSahel nigéro-tchadien depuis40.000 ans. Bull. Soc. Géol. Fran-ce,2:267-278.
Fesnn J. Er At., 1982. La chainepan-africaine, son avant-pays etla zone de suture au Mali. Cartegéologique de lAdrar des Iforasau 1:500.000. Bamako: Direc. Na-tion. de la Géol. et des Mines, 85p.
FnoenxIus L., 1937. Ekade Ehtab,die Felsbilder Fezzan. Leipzig:Harrassowitz,T9 p.
Geunrrnn Y., C. GaururER, A. Monplnr T. Trr,lnr, 1996. IiArt du Saha-ra. Archiues des sables. Pafis:Seuil, 139 p.
Gaurmn A., 1987. The archaeozoolo-gical sequence of the Acacus. 1n:B.E. Barich (sous la dir. de), Ar-chaeology and enuironment in theLibyan Sahara. The excauationsin the Tadrart Acacus, 1978- 1983.B.A.R. International Ser. 368, 12:283-307.
GupRrr.r C. pr M. FeuRn, 1983. Mam-mifères. 1n: N. Petit-Maire et J.Riser (sous la dir. de), Sq.hara ou
Sahel: Quaternaire récent duBassin de Taoudenni (Malil.Lab. de Géol. du Quatern. duCNRS:239-272.
Gnazosl P., 1942. I)arte rupestredella Libia. Napoli: ed. della Mo-stra d'Oltremare, 2 vol., 326 p.
fIecHIo M., 1998. Le Tassili des f,j-jers. Aux sources de I'Afrique, 50siècles auant les pyramides. Al-ger: Edif 2000-Paris Méditerran-née, 310 p.
Her-rmn U.W., 1990. Die Entwich-lung der Felsbildhunst Nordafri-has. Untersuchungen auf Grandneuerer Felsbilfunde in der Sùd-Saharq (1). Stuttgart: Franz Stei-ner, 150 p. + 164 pl.
Helrmn U.W., 1995. Felsbilder frù-her Jcigeruôlh.er der Zentral-Sa-hara. Rundkofte, Grauiere4 Pun-zen Untersuchungen auf Grundneuerer Felsbilfunde in der Siid-Sahara (3). Stuttgart: Franz Stei-ner, 198 p.
Hellmn U.W. uNn B.C. H.qllmn,7992. Felsbilder der Zentral-Sa-hara. Untersuchungen auf Grundneuerer Felsbilfunde in der Sùd-Sahara (2). Stuttgart: Franz Stei-ner,249 p.
Herrvns C.V., 1980. Geological evi-dence of pluvial climates in theNabta area of the western Egypt.In: F. Wendorf and R. Schild(eds), Prehistory of the EasternSahara. Dallas. New York: Acade-mic Press, p. 353-371.
Huenn P. nr J. PErrr, 1975. Leschasseurs-graveurs du Hoggar.Libyca,23: 133-179.
Letorx J.-D., 1962. Merueilles duTassili-n-Ajjer. Paris: Éait. duChêne, 195 p.
Le.roux J.-D., t977 . Tassili-n-Ajjer:art rupestre du Sahara préhisto-rique. Paris: Edit. du Chêne, 182p.
Lecr"aNr J. or Huenn P., 1981. ,Loculture des chasseurs du Nil etdu Sahara. Alger: C.R.A.P.E.(Mémoire, XXIX),555 p.
Ln Quelrnc J.-L., 1998. Art ru-pestre et préhistoire du Sahara.Le Messah libyen. Paris: Biblio-thèque scientifique Payot,616 p.
Luore H., 1952. Gravures, pein-tures et inscriptions rupestres duKaouar, de l'Air et de lAdrar desIforas. Dakar: Bulletin IFAN,14:1268-1340.
Lnorp H., 1970. Gravures mpestresde Ti-n-Terirt, Iharir, AharararMellen, Amsedenet et I-n-Tebour-bouga (Tassili-n-Ajjer, Sahara cen-tral). Libyca, 18: L85-234.
LHorp H.,1975-76. Les grauures ru-pestres de I'Oued Djerat (Tassili-n-Ajjer). Alger: C.R.A.P.E. (Mé-moire, XX), 2 tomes, 830 p.
Lnorn H. (evpc LA coLr"aBoRATroN
DE P. CoLoMenL),1979. Grauures,peintures rupestres et uestiges ar-chéologiques des enuirons de Dja-net (Tassili-n-Ajjer). Alger: Pu-blic. de I'Office du Parc Nationaldu Tassil i, 31 p.
LHorp H. pr R. TouessoN, 1967.Gravures rupestres de la hautevallée du Tilemsi (Adrar des lfo-ras, République du Mali). 6eCongr. panafr. Préhist. (Dakar),p.235-24I
Lurz R. AND G., 7995. The secret ofthe desert. The roch art of Mes-sak Settafet and Messah Mellet,Libya.Innsbruck: Golf V., 177 p.
Melpv J., 1981. Etudes palynolo-giques dans le bassin du Tchadet paléoclimatologie de I'Afriquenord-tropicale de 30.000 ans àl'époque actuelle. Paris: Travauxet documents de I'ORSTOM, 129,586 p.
Meuw R., 7954. Grauures, pein-tures et inscriptions rupestres deI'ouest africain. Dakar: Mém.IFAN, XI,91P,
MonI F., 7965. Tadrart Acacus. Arterupestre del Sahara preistorico.Turin: Einaudi,257 p.
Mullnn-KanPE 4., 1986. Archâolo-gische Denkmâler des Oued Tis-salatine (Sùd-Agerien). Beitrâgezrar Allgemeinen und Verglei-chenden Archiiologie, 8: I77 -2L2.
Muzzol-tNr 4., 1986 "Akakus". In: G.Camps (sous la dir. de), Encyclo-pédie Berbère, Aix-en-Provence:Edisud, III: 339-408.
Muzzoll lI 4., 1995. Les images.ru-pestres du Sahara. Toulouse: Edi-té par l'auteur, 447 p.
NecRo G., A. RevoNNA E R. SrnroNrs(ons), 7996. Arte rupestre nelCiad: Borhou, Ennedi, Tibesti.Milan: Pyramids, Sahara DossierI ,725 p.
Panrs F., 1997. Les inhumations deBos au Sahara méridional auNéolithique . Archaeozoologia, IX,La Pensée Sauvage: L73-722.
Plse A. E M.V. Pese-Dunanrn,7962. Analisi paleoclimatichenel deposito di Uan Muhuggiag,nel Massiccio dell'Acacus (Fez-zan meridionale). Mern. Mus.Ciu. di Storia Nat. diVerona, T0:257-255.
Pour-Mernn N. or J. Rrspn (ros),L983. Sahara ou Sahel ? Quater-naire récent du bassin de Taou-denni (Mali). Marseille-Luminy:CNRS, 473 p.
Rrson J., C. Hm,nrnp-Mencpl or P.RocNoN, 1983. Les phases la-custres holocènes. fte: N. Petit-Maire et J. Riser (eds), Sahara ouSahel? Quaternaire récent duBassin de Taoudenni (Malil. Pu-bl. du Lab. de Géol. du Quatern.:65-86.
SAHARA lll7999 Dupuy 85
Rocxol P., 1989. Biographie d'undésert Paris: Plon, 347 p.
Snnvexr M., L973. Séquences conti-nentales et uariations clima-tiques: éuolution du bassin duTchad au Cénozoïque supérieur.Paris: Travaux et documents deI',ORSTOM, 94,346 p.
SUIIH A.B. , L975. A Note on the Flo-ra and Fauna from the post-Pa-leolithic Sites of KarkarichinkatNord and Sud. W. Af, J. Ar-chaeoL, 5: 20I-204.
SutrH A.8., 1979. Biogeographicalconsiderations of colonization ofthe lower Tilemsi VaIIey in thesecond millennium B.C. J. AridEnuironment. , 5: 355-36 1
SolntlHAvoup F., 1988. Découvertesarchéologiques exceptionnellesau sud de l'Ahaggar. Sahara, 1:49-72
Sot Btt HAVouP F., 1990. Nouvellesstations rupestres à l'ouest deI'Ahag gar. Sahara, 3: 7 I-82
Sozzext M. E G. Npcno, 1989. Dueinteressanti incisioni del Tadrartalgerin o. Sahara, 2: I00- 105
SraBwnN C. UND K.H. SrRrnnrER,1987. Gonoa. Stuttgart: FranzSteiner,325 p.
Tnosr F., 1981. Die Felsbilder desZentralen Ahaggar (AlgerischeSahara). Graz: AkademischeDruck - u. VerlagsanstaIt,2Sl p.
TRosr F., 1990. Egig: un site impor-tant de gravures rupestres et demonuments funéraires préisla-miques dans l'Ahaggar. Sahara,3: 98-99
TRosr F., 1997. Pinturas. Felsbilderdes Ahaggar (Algerische Sahara).Graz: Akademische Druck - u.Verlagsanstalt 336p.
Vax Areeon A. Er A.-M., 1990.Scènes de danse et de chasse surles rochers du plateau noir en Li-bye. Archeologia, 26I: 32-45
Vax AL,eanA A.-M. nr A. (nns), 1994.Art rupestre du Sahara. Les pas-teurs-chasseurs du Messalzlibyen Dijon: Les dossiers d'ar-chéologie, 85 p.
Vnx AleanA A.-M. nr A. ,1996. Orga-nisation de I'espace orné dans IeMessak au Sahara l ibyen. An-thropologie (Brno), XXXIYIL-2:1 1 1- I28.
VBoy J., 1962. Contribution à f in-ventaire de la station rupestrede Dao Timni-Woro-Yat (Niger).BIFAAI, XXIV B, 3-4: 325-37 I.
Wnxnonr F. aNn R. Scnnn R. (pn.),1980. Prehistory of the EasternSahara. New York: AcademicPress.
86 SAHARA IIII999 Dupuy