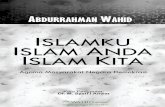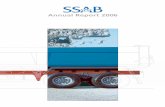1981-4.pdf - KU Leuven Bibliotheken
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 1981-4.pdf - KU Leuven Bibliotheken
441 La transformation de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite en banque publique
4 73 Elektronisch Debet en Cheque-inhouding
491
511
Conférence De l'épargne à l'emploi : proposition d'économie financière
Loi et Jurisprudence Overdracht of pandgeving van schuldvorderingen op publieke instellingen gesubsidieerd door de Staat Commentaire de
J. Le Brun
R. Deplancke
Voordracht
H. Neuman
Wet en rechtspraak
A. Stranart-Thilly
Faits, documents, opinions Feiten, dokumenten, standpunten 51 7 Aspects of the new Japanese law on foreign
exchange and foreign trade control
527 De rentelabiliteit in het management van financiële instellingen
54 7 La volatilité des taux d'intérêt et gestion des institutions financières
553 Bons de caisse et de capitalisation
559 De banken binnen de financiële sektor : enige vergelijkende gegevens
567 Procès-verbal du jury du prix C.O.B.
5 71 Bibliographie 5 7 4 Revue des Revues 5 76 Communications
lf 4/1981
Ph. De Smedt
H. Fayt
M. Dachy
P. Van Osse/
Boekbespreking Tijdschriftenpanorama
Mededelingen
439
440
f S'il y a la moindre faille dans votre ' système de protection, vous êtes en danger.
En spécialistes - et selon une formule qui nous est propre -nous étudions l'ensemble des risques que vous courez.
Nous vous proposons les mesures de surveillance et de sécurité adaptées, sur mesure, à vos besoins.
Nous nous occupons exclusivement de sécurité. Nous maîtrisons les techniques les plus sophistiquées. Nos méthodes sont éprouvées et ajustées en permanence aux exigences les plus actuelles. Nos agents sont des professionnels sévèrement sélectionnés,
Nous mettons au service de votre sécurité un ensemble complet de moyens efficaces :
Surveillance,
Soit statique : effectuée de jour comme de nuit par des agents de garde qui surveillent et contrôlent.
Soit mobile : au moyen de véhicules qui sillonnent une zone déterminée et sont en liaison radio avec notre Centre de Sécurité.
Transports de fonds,
Prévention des vols. Dans les surfaces de vente: surveillance de la clientèle, du personnel, des marchandises, des quais de réception et d'expédition, des transports intersuccursales. Par inspectrices anonymes ou non et par circuits fermés de télévision.
de valeurs et de documents.
A toute heure, fonds et valeurs sont transportés par véhicules spécialement aménagés et accompagnés de gardes armés et protégés.
Sécurité organisée, rentabilité accrue.
rigoureusement formés et régulièrement recyclés dans notre école de sécurité unique en Belgique. Cette école est à la disposition des entreprises pour la formation de leurs chefs de sécurité dans leurs missions spécifiques.
Alarmes. Détection par tous moyens
adéquats (détections volumétriques, radar, ultrasons, contacts de vibrations, etc) en cas d'intrusion.
Ces systèmes peuvent être reliés à notre Centre de Sécurité.
Surveillance à distance et interventions.
Détection immédiate de toute menace d'incendie, d'inondation ou de toutes pannes techniques (réfrigération, chauffage, fours, pressions, etc.).
Avec transmission instantanée à notre Centre de Sécurité, d'où toutes les
mesures d'interventions sont aussitôt déclenchées, 24 heures sur 24.
Contrôles d'accès. L'entrée et la sortie des
locaux désignés sont exclusivement réservées aux personnes autorisées.
Soit par appareils spéciaux donnant ou refusant l'accès.
Soit au moyen de circuits fermés de télévision, permettant la surveillance de tous lieux et de toutes opérations. i
rrn __ ,~ - 29.7.1934et4.5.1936
Nouvelle société de surveillance et de sécurité s.a. Engerstraat 87 - 3071 Erps Kwerps
TEL : 02/759.79.80 Anvers 031/49.39.80 • Brabant 02/735.61.30 - 016/23.11.50 • Courtrai 056/21.62.46 • Gand 091/23.78.99 •
Hainaut 064/22.61.24 • Liège 041/32.20.53 • Limbourg 011/22.86.56 • Namur 081/22.10.71
1?4/1981
La transformation de la Caisse Générale d' Epargne et de Retraite en banque publique
par Jean Le Brun
Né en 1936. Professeur à la Faculté de Droit de l'U.C.L. et à la F.U.C.A.M. (enseignements en droit public économique et financier et en droit boursier et bancaire). Codirecteur du Centre du Droit de la Gestion et de l'Economie publiques à l'U.C.L. et conseiller au Service des études générales et juridiques de la Commission bancaire. Adresse : avenue De Fré, 233, 1180 Bruxelles
1. Introduction 1. Le statut de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite a subi une transformation fondamentale par l'effet de trois arrêtés de pouvoirs spéciaux pris le 24 décembre 1980 (1) sur base des articles 92 et suivants (1) Mon. 8 janvier 1981 et les avis du Conseil d'Etat,Mon. 13 janvier 1981. Voy. sur cette réforme, Ceurvelt G ., De Algemene Spaar- en Lijfrentekas is omgevormd tot bank, Bull. Min. Finances, 1981, n° 4, p. 21. Sur le statut juridique antérieur de la C.G.E.R., voy. R.P.D.B., Compl. IV, V° C.G.E.R., Receuil annoté des lois et règlements et Centre du Droit de la gestion et de l'Economie publiques, Dictionnaire des Services Publics, Louvain, Oyez, 1978. Sur l'histoire, les fonctions et la place de la C.G.E.R. dans l'appareil financier, voy. Mémorial 1865-1965; et Vandeputte R., Abraham J.P. et Lempereur Cl., Les institutions financières belges, tome 1, Namur, Erasme, 1981, p. 79; C.E.P.E.S.S., Les institutions financières en Belgique. Problèmes actuels, 1979, n° 5-6, p. 21 et les relevés publiés annuellement dans cette Revue.
de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980. L'histoire de cette réorganisation a été marquée par les aléas de la vie politique et législative belge au cours des dernières années. L'accord politique annexé à la déclaration gouvernementale faite au Parlement le 7 juin 1977 prévoyait que« compte tenu de l'importance du rôle des institutions financières, le Gouvernement veillera à associer leur action à la politique économique,
[? 4/1981 441
442
financière et monétaire, principalement en ce qui concerne l'expansion et la reconversion économique ».
Parmi d'autres. mesures annoncées à ce titre, le Gouvernement indiquait : « La fonction bancaire, dans son plein exercice, sera introduite dans le secteur public du crédit. Le Gouvernement choisira rapidement celle des institutions dont la vocation à cette fonction est la plus justifiée. La part d'activité qui sera consacrée par cette institution à la fonction bancaire sera soumise au même contrôle que celui qui s'exerce sur les banques » (2). Cet objectif (3) fut traduit dans un des (2)
Annexe Il, Chapitre 1, n° (3) 14. Lié à d'autres réformes dans le secteur financier, telles que la désignation de délégués du Gouvernement auprès du conseil d'administration des quatre plus grandes banques belges Qoi du 5 août 1978, art. 18) et la modification du statut et des fonctions des reviseurs des établissements privés de crédit (loi du 8 août 1980, art. 95 et suiv.).
deux projets de lois dits« anti-crise » (4). L'article 1 5 de ce projet prévoyait que « le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes mesures utiles en vue d'introduire dans le secteur public du crédit, la fonction bancaire dans son plein exercice ». Il devint l'article 1 6 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires (5) qui, après amendement, disposait en outre : « Pour l'exercice de cette fonction bancaire, les mêmes conditions de concurrence que celles qui existent pour les banques privées sont d'application ». Une crise gouvernementale, suivie de la dissolution des Chambres, a empêché la mise en œuvre des pouvoirs attribués de la sorte au Roi et qui expiraient le 31 décembre 1978 (6).
2. L'idée fut reprise dans l'accord gouvernemental suivant (7). Elle prit forme dans les dispositions introduites sous les articles 46 à 48 du projet de loi relatif aux propositions budgétaires 1979-1980 (8). Ces dispositions tendaient à conférer au Roi les pouvoirs nécessaires en vue de permettre à la C.G.E.R. de mener l'ensemble des activités bancaires. Le Roi était également habilité à adapter les organes d'administration et de gestion de cette institution. Le législateur fixait certains principes à respecter dans la mise en œuvre des pouvoirs d'habilitation qui devaient expirer le 31 décembre 1980. De nouveaux avatars politiques ont fait reporter jusqu'en février-mars 1980 l'examen de ces dispositions du projet en Commission des Finances de la Chambre. Après un premier rapport de la Commission (9), le projet vint en séance publique le 1 9 mars mais son vote fut suspendu le 2 avril.
(? 4/1981
(4) Doc. Ch., 1977-1978, n° 450/ 1 du 22 juin 1978.
(5) Mon. 17 août.
(6) Loi du 5 août 1978, art. 89, § 1".
(7) Accord de Gouvernement du 1" avril 1979, titre Il, Section Il, A. (8) Doc. Ch., 1979-1980, n° 323 / 1 du 13 novembre 1979.
(9) Rapport de M. Dupré, Doc. Ch., 1979-1980, n° 323/47, pp. 91 etsuiv. et pp. 121 et suiv.
3. A la suite d'une nouvelle crise gouvernementale, la coalition suivante reprit l'intention de faire aboutir la réforme, précisant cependant que ce serait « moyennant respect des conditions de concurrence et de contrainte équivalentes pour toutes les institutions financières » (10). Le projet en suspens fut repris mais amendé et renuméroté à l'initiative du Gouvernement (11) et devint la loi du 8 août 1980 (1 2). Une nouvelle crise gouvernementale, en octobre 1980, retardera les travaux de mise en œuvre de ces dispositions qui aboutirent le 24 décembre 1 980, peu avant l'expiration du délai légal.
Il. Les inspirations de la réforme 4. La transformation de la C.G.E.R. a concerné essentiellement sa fonction d'établissement d'épargne et de crédit. Les autres activités de l'institution, orientées vers l'assurance privée ou sociale, n'étaient pas visées directement et n'ont vu leur statut adapté que par contrecoup ou en symbiose avec la réforme de la Caisse d'épargne. Il n'est pas aisé de déterminer l'inspiration de la réforme de la Caisse d'épargne. On peut, semble-t-il, distinguer plusieurs influences, les unes lointaines, les autres récentes.
5. La prise de contrôle par les pouvoirs publics de /'activité de crédit est un thème ancien du mouvement socialiste et des forces politiques et syndicales qui lui sont proches (13). Elle pose, par définition, le problème d'une gestion de droit public de tout ou partie de cette activité (14). Elle débouche naturellement, d'une part,
(14) Voy. spécialement l'avant-projet de loi repris dans: L"exécution du Plan du Travail, Anvers, De Sikkel, 1935, p. 39 et dans Frantzen P., Hendrik De Man, tome IV, Het planisme, Anvers-Amsterdam, Standaard, 1975, p. 103; plus récemment certaines propositions faites au sein de la Commission gouvernementale pour l'étude de propositions de réforme des lois relatives à la banque et à l'épargne, Rapport, 1970, p. 90.
sur un transfert direct ou indirect aux pouvoirs publics de la propriété de tous ou certains des établissements privés de crédit et, d'autre part, sur un développement et un infléchissement du rôle des institutions du secteur public davantage mises au service de la politique des pouvoirs publics. Il n'est pas possible de faire ici l'histoire et l'analyse des propositions avanceés au titre de ce qui est dénommé « réformes de structures ». On notera l'actualité nouvelle qu'elles ont prises au cours des dernières années (15), spécialement dans une évolution vers un système d'économie mixte marqué par une place croissante des entreprises publiques dans
[?4/1981
(10) Accord de Gouvernement des 14 et 15 mai 1980, titre Il, Section Il, n' 3 . (11) Amendements du Gouvernement, Doc. Ch., 1979-1980, n°323/61, pp. 12 et 1 3. Les articles 46 à 48 devenaient les articles 91 à 93. Un rapport complémentaire de la Commission de la Chambre fut fait par M. Dupré, Doc. Ch., 1979-1980, n° 323/73, pp. 61 et suiv. (12) Mon. 15 août - La réforme de la C.G.E.R. y est réglée par les articles 92 à 94 -Sur l'appréciation de cette loi, De Clercq W., Intermédiaire, 9 janvier 1981.
(13) Une banque publique. Pourquoi ? et comment ? Reflets et perspectives de la vie économique, 1978, p. 360.
(15) Une banque publique ... loc. cit.
443
444
(16) Loi du 2 avril 1962, modifiée spécialement par les lois du 30 mars 1976 et du 4 août 1978. (17) Loi du 15 juillet 1970. (18) Loi précitée du 4 août 1978. (19)
le secteur concurrentiel. Une étape importante de cette adaptation structurelle de l'économie résulte de la possibilité donnée aux pouvoirs publics, spécialement à l'intervention de la Société nationale d'investissement (16), des sociétés de développement régional (17) et des sociétés régionales d'investissement (18), de participer au développement industriel et, plus généralement, à l'initiative économique par des prises de participations et d'autres interventions financières de type capitalistique. Cette évolution, intéressant l'ensemble de l'économie, est complétée par des interventions intéressant des secteurs déterminés, tel en dernier lieu celui de l'énergie (19).
Voir articles 168 à 185 et 6. On doit, d'autre part, noter une adaptation des formes 192 de la loi du 8 août
préconisées pour la prise de contrôle public de l'activité 1980 relative aux propositions budgétaires
de crédit. Délaissant la nationalisation des 1979-1980 et article 42
établissements privés, une tendance doctrinale préfère de la loi-programme 1981
assurer au secteur public du crédit existant une place du 2 juillet 1981 -
plus grande, parfois à l'abri de monopoles pour certains types d'opérations ou sous le bénéfice d'interventions administratives « éclusant » les demandes de crédit (20). Par sa place importante dans ce secteur, la Caisse d'épargne était évidemment en première ligne dans ces débats.
(20) Voy. en ce sens, les propositions du Groupe B/Y: Régionalisation du crédit: clé du redressement wallon, Bruxelles, 1977, où cette préoccupation est combinée avec une régionalisation de l'appareil public de crédit. Voir également Bardos - Feltoronyi N., La régionalisation du crédit : pourquoi et comment la faire? Reflets et perspectives de la vie économique, 1979, p. 403.
7. Par ailleurs, on doit inscrire la transformation de la Caisse d'épargne en banque publique dans le mouvement de déspécialisation des activités et statuts des intermédiaires financiers. Ce mouvement qui remonte à plusieurs décennies s'est le plus souvent traduit dans les faits de la concurrence nationale et internationale avant d'inspirer les adaptations statutaires, législatives et réglementaires qui l'ont sanctionné et amplifié. C'est ainsi qu'en ce qui concerne la Caisse d'épargne, les travaux de la Commission gouvernementale pour l'étude des problèmes de financement de l'économie (21) avaient déjà inspiré les mesures prises principalement par les arrêtés royaux n° 20 du 23 mai 1967 (22) et n° 44 du 24 octobre 1967 (23) et par la loi du 30 juin 1975 (24). Il en est résulté un élargissement successif de ses possibilités de collecte de l'épargne et une libéralisation de ses facultés de crédit et de placement, notamment dans le but de favoriser et d'étendre son intervention dans le financement de l'économie. On doit y ajouter
[f 4/1981
(21) Commission dite « De Voghel » du nom de son président. Voy. spécialement rapport du 30 novembre 1970, p. 109. (22) Mon. 25 mai. (23) Mon. 27 octobre; err. 8 novembre. (24) Mon. 2 août.
une série de décisions prises par le ministre des Finances sur base de la loi organique de la C.G.E.R. (25) qui ont, au titre des placements autorisés, élargi la gamme des activités et opérations permises à la Caisse. Sans qu'il soit possible de les synthétiser de façon exhaustive, compte tenu de l'étroite imbrication des opérations financières, la Caisse était ainsi déjà habilitée à pratiquer une très large gamme d'activités bancaires, à l'exception notoire des opérations en devises et de l'essentiel des opérations internationales. Aucune limite d'ordre juridique n'étant mise au pouvoir du ministre des Finances, celui-ci était en mesure de poursuivre, par cette voie, l'élargissement de la fonction bancaire de la Caisse d'épargne (26). Encore que la réforme de celle-ci n'ait pas procédé essentiellement, dans le chef du législateur, d'une volonté d'y mettre fin, le Gouvernement a relevé qu'il eût été malsain de recourir à cette technique pour dépasser certaines limites (27).
8. Il n'est pas possible d'identifier l'influenc,e de ces facteurs dans la décision de reformer la Caisse d'épargne. Sur le plan politique proprement dit, le projet n'est appuyé, ni dans les déclarations gouvernementales, ni dans les travaux préparatoires des lois précitées des 5 août 1978 et 8 août 1980, d'une justification précise (28).
(28) Les cinq gouvernements qui se sont succédé pendant le cours cles travaux ont compris toutes les formations politiques à l'exception de deux partis ... qui étaient également favorables au principe de la réforme.
Sur le plan économique et institutionnel et sans doute pour cela, le Gouvernement n'a pas davantage exprimé les raisons d'économie publique ou privée qui lui paraissaient justifier cette réforme (29). La chose a été
(29) La doctrine est peu alimentée en la matière en Belgique. On consultera cependant avec intérêt, Craeybeckx L., Réformes de structure, Bruxelles, Editions Lumière, 1946, pp. 34 à 121; voir également C.E.P.E.S.S., Lés institutions financières en Belgique - Problèmes actuels, 1979, 11° 5-6, p. 53 et p. 127 ainsi que D'Hoogh C. et Deterck-Spillebout M., Openbare bank en hervorming van de instellingen, Economisch en Sociaal Tijdschrift, 1979, p. 665.
relevée tant au Parlement qu'en dehors (30).,Compromis
(25) En dernier lieu, en vertu des articles 28, 7° et 29, 8° de sa loi organique.
(26) Déclaration du ministre des Finances à la Commission de la Chambre, Doc. pari. 1979-1980, n°323/47, p. 94.
(27) Rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 1, Mon. 8 janvier 1981, p. 100.
politique, pragmatisme et résignation ont fait que la (30)
généralisation de la fonction bancaire de la Caisse Voy. spécialement les
d'épargne et de la sorte la constitution d'une banque positionsdel'Association ' ' belge des Banques dans
publique, ont été acquises dans leur principe sans ses rapports annuels pour
véritable débat concernant les fins recherchées et sans 1979, p. 26 et pour
évaluation de leur incidence vraisemblable. Ces 1980• P-
22·
questions ont d'ailleurs été absorbées par l'attention qui s'est portée sur les modalités de la mise en œuvre
(p4/1981 445
446
du projet, spécialement sur le plan du régime de concurrence à organiser avec les banques privées.
9. Le principe d'égalité dans la concurrence entre banque publique et banques privées a trouvé sa première expression dans l'amendement apporté par la Commission de la Chambre au projet qui allait devenir la loi du 5 août 1978 (31 ). Enchaînant sur cette préoccupation du législateur, le Gouvernement fut plus explicite dans le projet qui allait devenir la loi du 8 août 1980. D'une part, la loi vise à l'égalité juridique de concurrence entre la banque publique et les banques privées, en interdisant, pour les activités et opérations bancaires ordinaires de la Caisse d'épargne, le maintien ou l'introduction de charges ou d'avantages légaux ou réglementaires par rapport aux activités et opérations similaires effectuées par les banques (32). Ce principe allait inspirer non seulement l'élimination de dispositions jouant en faveur ou en défaveur de la Caisse d'épargne par rapport aux banques privées (33), mais également certaines dispositions organiques nouvelles relatives à la définition des activités et à la gestion de la Caisse d'épargne. Dans le même esprit, la loi limite la portée de la garantie d'Etat dont bénéficiait la C.G.E.R. (34). D'autre part, la Caisse d'épargne est libérée de certains contrôles administratifs comportant des contraintes de gestion (35) et se voit étendre, à tout
(35) Il s'agit de l'inapplication à la Caisse d'épargne de la loi du 15 mars 1954 sur le contrôle de certains organismes d'intérêt public (art. 92, § 3) - voir infra, n° 31.
le moins par équivalence sur certains points, des règles de surveillance applicables aux banques privées (36). Ces dispositions devaient rapprocher la situation de la Caisse d'épargne de celle des banques privées. Du fait même, la caisse devrait se distinguer de deux autres secteurs avec lesquels elle se trouvait, jusqu'alors, en état de plus grande proximité, voire de symbiose. Il s'agit, d'une part, des caisses d'épargne privées dont le statut légal avait, dès l'origine (37) et ultérieurement (38), été conçu et adapté parallèlement à celui de la C.G.E.R. Il s'agit, d'autre part, des autres organismes publics de crédit avec lesquels elle entretenait des liens particuliers (39) et qui se trouvaient placés, avec la C.G.E.R., sous le régime de concertation présidé par le Conseil des Institutions publiques de crédit (40).
(40) A.R. du 22 octobre 1937, modifié par l'A.R. n° 18 du 23 mai 1967.
[?4/1981
(31) Voir supra n° 1 . Amendement de MM. Dupré et Wauthy (Doc. Ch. 1977-1978, n° 450/ 13), sous-amendé par MM. Dupré et Tobback (n° 450/18).
(32) Art. 92, § 2, 1 °.
(33) Voir l'A.R. n° 3 du 24 décembre 1980, articles 4 et suiv., en matière fiscale ou de réglementation économique et financière.
(34) Art. 92, § 1w, 1° in finevoir infra, n° 19.
(36) Art. 92, § 2, 3° à 5° - voir infra, n° 33.
(37) A.R.n°42du15 décembre 1934, section
(38) A.R. précités des 23 mai 1967 et 24 octobre 1967 et loi du 30 juin 1975 (voir n° 7). (39) Voir C.G.E.R. Receuil annoté des loi et règlements et Centre du Droit de la Gestion et de l'Economie publiques, Dictionnaire des Services publics, 1978, C.G.E.R., n° 17, rubriques 8 et 10.
L'évolution réalisée par rapport aux caisses d'épargne privées ne souleva pas de questions d'autant qu'elles-mêmes se rapprochent progressivement des banques (41) et que l'institution devait, dans l'esprit du Gouvernement, demeurer, à titre principal et pendant un certain temps encore, un établissement d'épargne (42). Il n'en alla pas de même à l'égard des autres institutions publiques de crédit qui pouvaient s'attendre à une accentuation de la concurrence de la part de la Caisse d'épargne (43). Ce problème explique en partie
(43) Un amendement de M. Surgeon, non adopté, tendait à élargir les activités de crédit de la S.N.C.I. (Doc. pari. Ch. 1979-1980, n' 323/9, p. 6).
le délai mis par le Gouvernement à faire choix de la Caisse d'épargne comme future banque publique (44) et l'annonce de la mise à l'examen de la concertation interne au secteur public ainsi que du renforcement de son efficacité. Le Conseil des institutions publiques de crédit déjà cité, ainsi qu'une Commission d'étude que le Gouvernement se proposait de constituer devraient y concourir (45). Plutôt que de transformer un organisme public de crédit en banque à fonction générale, la proposition avait parfois été avancée que le secteur public de crédit, agissant globalement, soit en mesure d'offrir la gamme complète des opérations et services bancaires sans qu'une institution y ait une position prépondérante (46). Cette formule vague n'a cependant jamais été assortie des précisions démontrant son caractère opérationnel, spécialement eu égard à la place prééminente de la Caisse d'épargne.
111. Les axes de la réforme 1 O. Comme on l'a dit, c'est après un délai de réflexion et non sans difficulté qu'il a été fait choix de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite. Le Gouvernement a justifié ce choix par la circonstance que cette institution était la plus déspécialisée et la mieux implantée par son réseau de succursales et d'agences et s'adressait au public le plus large. D'autres formules ont été, explicitement ou implicitement, écartées (4 7). c· est ainsi qu'on a parfois évoqué une fusion des institutions publiques de crédit (48). Les spécificités organiques et
(48) Du moins de certaines d'entre elles. Voy. en ce sens, notamment, CEPESS, étude citée, p. 56; Doc. Ch., 1977-1978, n' 450/ 23, p. 114 et Doc. S., 1979-1980, n' 483/ 9, p. 65. La fusion avec l'Office des Chèques Postaux a également été parfois proposée.
opérationnelles de chacune d'elles l'aurait rendue, sinon impossible, au moins difficile et longue à mettre au point. A fortiori, n'a-t-il pas été envisagé de constituer à
[? 4/1981
(41) Maes M., Een vergelijking van de banken met de privé-spaarkassen. Banken Financiewezen, cahier n' 5, 1979 et, pour l'évolution récente, notre chronique, cette Revue, 1980, cahier 10, n' 48 et suiv. (42) Rapport au Roi précédant l'A.R. n' 1, Mon, 8 janvier 1981, p. 101.
(44) Voir infra n' 10. (45) Déclaration gouvernementale du 7 juin 19 7 7 et exposé des motifs de la loi du 5 août 1978 (Doc. pari., Ch. 1977-1978, n'450/1, p. 23 et rapport de la Commission du Sénat, Doc., S., 1977-1978, n' 436/2, pp. 44 et suiv. Exposé des motifs de la loi du 8 août 1980 (Doc. pari. Ch. 1979-1980, n' 323/ 1, p. 16). Sur le retrait d'un amendement de MM. Surgeon et Busquin tendant à la création par la loi de la Commission d'étude envisagée (Doc. pari., Ch. 1979-1980, n' 323/9-IV), voy. Doc. pari., Ch., n' 323/47, p. 123. (46) Voy. notamment en ce sens, C.E.P.E.S.S., Les Institutions financières en Belgique ... déjà cité, p. 127.
(47) Voy. leur examen dans « Une banque publique ... »,
étude citée, p. 364.
447
448
neuf un établissement bancaire public (49). Le degré de développement atteint par les institutions existantes,
(49) Voy. cependant la possibilité évoquée par !'Exécutif régional wallon lors de la constitution de plusieurs gouvernements récents (notre chronique, cette Revue, 1980, cahiern° 10, p. 10).
tout spécialement par la C.G.E.R., devait en dissuader, à un moment où le secteur bancaire ne connaît plus la même croissance qu'antérieurement et où la pénétration dans le marché de nouveaux établissements à vocation générale se heurte à des charges et à des risques élevés. Le Gouvernement s'en est, d'ailleurs, tenu à une interprétation de la déclaration gouvernementale au terme de laquelle la banque publique devait procéder de « l'une des institutions publiques de crédit existantes » (50).
11 . Le législateur a, par ailleurs, décidé de conserver à la C.G.E.R. son unité juridique. Un amendement a été présenté en vue d'une scission entre la Caisse d'épargne et les autres caisses (51 ). L'idée en était d'isoler les opérations bancaires, de mettre fin à la garantie de l'Etat dont bénéficiait la Caisse d'épargne, de doter celle-ci, à titre de fonds propres, d'une partie du fonds de réserve de la C.G.E.R. et de prévoir la rémunération de ces fonds propres. Le Gouvernement s'y opposa pour la raison, citée au numéro précédent, déduite de l'interprétation de la déclaration gouvernementale. Il n'accueillit pas davantage un argument tiré des directives communautaires applicables à l'activité d'assurance et, à ce titre, à la caisse d'assurance de la C.G.E.R. (52). Cet argument portait à faux dans la mesure où la directive du 5 mars 1979 sur l'assurance-vie comporte, dans cette matière, une exception au bénéfice de cette institution (53). Cette question est différente de celle posée par l'exercice de l'assurance-incendie par la C.G.E.R. qui ne bénéficie pas d'une même exception de texte (54).
12. En maintenant l'unité juridique de la C.G.E.R., le législateur a tranché en faveur du maintien de sa forme juridique d'établissement public (55). Le problème n'a pas été directement soulevé au cours des travaux préparatoires. L'adoption de l'amendement de M. Dupré (56) aurait conduit à envisager cette question qu'il ne réglait pas. Une réorganisation administrative et financière plus fondamentale aurait pu, en effet, emprunter la voie de la création d'établissements publics distincts ou de sociétés publiques dont l'Etat -seul ou en association avec les Régions - aurait été actionnaire. On ajoutera que depuis l'extension du rôle (r] 1!]4/1981
(50) Déclaration du Ministre des Finances in Rapport de la Commission de la Chambre, Doc. 1979-1980, n° 323/47, p. 94. (51) Amendement de M. Dupré (Doc. Pari., Ch., 1979-1980, n° 323/ 40-1) et la discussion (Doc. Pari., Ch., 1979-1980, n°47, p. 93 et p. 122). (52) Rapport de la Commission de la Chambre, Doc. Ch. n° 323/47, p. 98-99. (53) Art. 33, § 5. Voy. en ce sens, la réponse du Ministre même rapport, p. 99, ainsi que la réponse de la Commission des Communautés européennes à la question écrite n° 1359/80, de M. Damseaux (J.O.C.E. n° C 352 p. 21).
(54) Sur l'application des articles 8, § 1, litt. b et 30, § 4, al. 2 de la directive du 24 juillet 1973, relative à l'assurance-dommage, voy. notamment les réponses de la Commission des Communautés européennes aux questions écrites de M. Damseaux n° 273/80 (J.O.C.E. n° C 183, p. 60) n° 13 59/80 (J.O.C.E., n° C 352 p. 21) et n° 2014/80 (J.O.C.E. n° C 103, p. 20), les réponses du Ministre des Affaires économiques aux , questions de M. Knoops, · n° 204 du 23 juillet 1980 (Bull. Q.R., Ch., p. 1702) et n° 99 du 1 5 janvier 1981 (Bull. Q.R., Ch., p. 1 702) et la réponse du Ministre des Affaires économiques à l'interpellation de M. Knoops, séance de la Chambre du 15 mai 1981). (55) L'article 1 ~ nouveau de la loi organique de la C.G.E.R. énonce cette qualification. (56) Cité au n° 11 .
de la S.N.I. et la création des S.R.I. (57), un établissement bancaire peut être créé à l'initiative du secteur public par ces institutions en recourant aux formes du droit commun. Enfin, en reconnaissant aux nouveaux pouvoirs régionaux une compétence pour les aspects régionaux du crédit (58), la réforme institutionnelle semble bien avoir autorisé la création de services publics de crédit par décrets régionaux. C'est, en tout cas, l'interprétation que paraît avoir adoptée !'Exécutif wallon (59). La conservation à la C.G.E.R. de sa nature s'accompagne du maintien de contrôles de tutelle pesant sur elle en sa qualité d'établissement public, spécialement de la tutelle générale du ministre des Finances exercée à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement (60). Cette tutelle continue à se justifier en raison des responsabilités de l'Etat dans le contrôle de l'action de la C.G.E.R. Elle va toutefois être combinée, pour le contrôle de la Caisse d'épargne, avec le rôle de surveillance financière qui est confié à la Commission bancaire (61) (62). Par ailleurs, la C.G.E.R. restera en principe soumise aux mesures imposées spécifiquement au secteur public (63). (62) Cette situation préexistait d'ailleurs à la réforme en ce qui concerne les activités d'assurances soumises, depuis un arrêté royal du 15 avril 1977, à la surveillance de l'Office de Contrôle des Assurances. (63) Economies imposées aux administrations et institutions publiques, contributions de solidarité en matière de rémunérations, restrictions dans le régime des pensions, régime linguistique, syndical. ..
13. Une option majeure est l'organisation à l'intérieur de la C.G.E.R. de deux fonctions distinctes, celles de banque et d'entreprise d'assurance, dotées non seulement, comme antérieurement, de règles de gestion propres mais aussi d'organes d'administration séparés. Cette option, visiblement postérieure à la loi du 8 août 1 980 dont les travaux préparatoires sont muets à cet égard et qui a été justifiée par le Rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 1 (64), était cependant largement impliquée par les principes posés par la loi. L'extension du rôle de la Caisse d'épargne et les difficultés et risques associés à ses nouvelles activités appellaient une spécialisation des gestions et des garanties d'efficacité du contrôle interne de celles-ci. Cette spécialisation passait par des structures d'administrations distinctes. La pertinence et l'efficacité des contrôles externes - par des reviseurs, par la Commission bancaire et par l'Office de Contrôle des Assurances - exigeaient de même cette spécialisation. La volonté du législateur belge et de la CEE de voir assurer des conditions de concurrence correctes avec le
[?4/1981
(57) Voy. les lois citées au n• 5.
(58) Loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle.art. 6, § 1 "", V, 3°.
(59) Voy. la déclaration évoquée au n• 1 O.
(60) Voy. notamment l'exposé des motifs de la loi du 8 août 1980. Doc. Ch. 1979-1980, n• 323/ 1, p. 17 et le Rapport au Roi, précédant l'arrêté royal n• 1, Mon. 8 janvier 1981, p. 101. (61) Voy. infra. n• 33.
(64) Mon. 8 janvier, p. 99 et suiv.
449
450
secteur privé, tant pour l'activité bancaire (65) que pour (65)
celle d'assurances (66), invitait à ce que les autorités Loi du 8 août 1980. art.
Publiques de contrôle aient des interlocuteurs en charge 92· §
2•
10 et directive du
12 décembre 1 9 77. de responsabilités circonscrites et distinctes et que les (66)
comptes annuels des deux gestions présentent les Loi du 9 juillet 1975; · d ' · Pl arrêté royal 15 avril 1977;
garanties e transparence necessaires. us directives des 24 juillet
particulièrement en ce qui concerne la banque publique, le 1973 et 5 mars 1979.
principe de spécialisation des fonctions de direction, (67)
traduit dès 1935 dans la législation bancaire, a inspiré Rapport au Roi précédant I' arreté royal n'
la réorganisation des structures (67). 11 trouve un 185 du 9 juillet 1935,
parallèle dans la réglementation communautaire de Mon 10 juillet p. 4358;
l'assurance qui organise en principe un cloisonnement Rapport au Roi précédant l'arreté royal n° 1, Mon. 8
avec les autres activités. janvier 1981 p. 102.
14. Cette spécialisation - qui n'est pas une innovation (68) - a cependant été limitée à ce qui paraissait strictement nécessaire pour les fins recherchées (69). Les services de la C.G.E.R. et leur infrastructure, tant au niveau de l'administration centrale que des succursales et agences, étaient largement communs à l'ensemble de ses fonctions. Il n'était pas concevable et il eût été nuisible et coûteux d'en imposer la scission et le dédoublement. En particulier, le personnel était unique et régi par un seul cadre administratif, un seul cadre linguistique et un seul statut. Le Gouvernement n'a pas voulu en provoquer la répartition qui eût d'ailleurs posé de délicats problèmes statutaires. linguistiques et de personnes. Il est cependant évident que le développement des fonctions anciennes et le déploiement d'activités bancaires nouvelles vont comporter des risques accrus (70) et faire apparaître le besoin de structures administratives nouvelles ou la redéfinition des frontières au sein des anciennes (70). (70) Crédit aux entreprises, crédits internationaux, placements, opérations en devises, opérations de change et d'arbitrage, ..
Limitée, dès le départ, à la transformation nette des organes d'administration et de gestion, la réforme de la C.G.E.R. pourrait donc progressivement, en fonction du besoin, se prolonger sur le plan administratif (71 ). c· est pourquoi, si l'article 2 nouveau du statut organique peut parler des deux « entités » constituées au sein de la C.G.E.R., il aurait présenté une vue inexacte en parlant de « sections » ou de « départements » comme le Conseil d'Etat l'avait proposé (72).
15. La philosophie qui vient d'être résumée est traduite dans le nouveau statut organique. La C.G.E.R. est un établissement public unique. Un conseil général exerce le haut contrôle (73) sur l'ensemble de ses activités (74) dans une fonction comparable, mutatis mutandis. à
~ 4/1981
(68) Voy. parmi d'autres, les structures d'administration de l'I.N.A.M.I. et de l'O.N.E.M. et les compétences des sections du conseil d'administration de la S.N.I. après la réforme opérée par la loi du 30 mars 1976. La transformation prévue de certains organismes d'intérêt public nationaux pour, sans scission juridique, tenir compte de la réforme des institutions pourrait emprunter la même voie. (69) Rapport au Roi, Mon. 8 janvier1981,p.101.
(71) Rapport au Roi, Mon. 8 janvier, p. 102.
(72) Mon. 13 janvier, p. 311 .
(73) Art. 8. (74) Sa composition reflète son rôle
celle d'une assemblée générale (75). Des comptes consolidés (76) approuvés par le Conseil général donnent une vue de la situation de l'ensemble de l'institution et en permettent notamment le contrôle politique et administratif. Ils sont, en outre, soumis à la même publicité que les comptes des sociétés (77). Par ailleurs, une gestion commune a été instaurée pour ce qui est du personnel (78), des bâtiments, des
(76) Selon l'expression utilisée dans le passé par la C.G.E.R. (art. 6). En réalité il s·agit plutôt de comptes intégrés des deux entités. Chacune de celle-ci a des comptes distincts; ceux-ci sont globalisés. pour !"ensemble constitué par les caisses de retraite, d'assurances et de rentes - accidents du travail, chacune de ces caisses ayant des comptes propres en fonction de la réglementation qui lui est applicable. Les comptes distincts des deux entités peuvent être doublés de comptes consolidés au cas de détention de filiales. (77) Art. 67, al. 2 nouveau. (78) Notamment, et de façon expresse, pour l'établissement des statuts et cadres, la nomination et la révocation du personnel et la fixation de leur rémunération (art. 26, al. 3).
équipements et, en général de l'infrastructure commune (79). Elle est assurée, selon les mêmes règles que celles qui valent pour les deux « entités », par la réunion des organe:; de celles-ci (80). Ces derniers ont à en préciser l'objet dans le double respect, d'une part, des responsabilités distinctes des organes des deux entités pour les décisions (81) relatives aux opérations qui en relèvent, d'autre part, des exigences découlant des réglementations respectivement applicables aux activités bancaires et d'assurances (82). La définition du champ de la gestion commune, placée sous le haut contrôle du Conseil général (83), peut être modifiée à l'initiative des organes des deux entités par transfert à ceux-ci de matières jusqu'alors communes (84). Les organes chargés de la gestion commune arrêtent, enfin, les comptes consolidés (85) et les présentent au Conseil général (86).
(86) Une imputation des élémen1s de la gestion commune dans les comptes annuels des deux entités de•,ra être effectuée en fonction de la part qu'elles y prennent.
Ces dispositions doivent permettre aux organes de la C.G.E.R. de trouver ainsi un équilibre entre la spécialisation et l'efficacité immédiate mises à la base de la réforme et l'évolution permise vers une plus grande répartition des gestions et de l'administration, en fonction du développement de l'activité bancaire de la Caisse d'épargne. En tout état de cause, aux deux entités (87), dotées d'organes propres,correspondent des gestions, des comptabilités et des caisses distinctes (88).
~4/1981
(75) Voy. l'art. 11 (notamment l'audition de rapports et l'approbation des comptes des caisses et celle des comptes consolidés de la C.G.E.R. ainsi que le pouvoir d'avis sur la gestion des caisses).
(79) Art. 26.
(80) Art. 26, al. 1, 2 et 4.
(81) Les tâches d'exécution peuvent donc rester communes. Voy. commentaire de l'article 26, Mon. 8 janvier 1981, p. 111. (82) et (83) Même commentaire. (84) Art. 26, al. 6. (85) Art. 26, al. 5.
(87) Art. 4. (88) Art. 6, al. 1 et 2. Sur les comptabilités voy. n05 32 et 36. Sur 1 'imputation des dons et legs, voy. art. 7, al. 1~.
451
452
16. Le nouveau statut comporte, par ailleurs, des éléments d'assouplissement de la gestion de la C.G.E.R. et des caisses qui la composent. La C.G.E.R. exerce ses activités de façon directe (89). Ce principe correspond à l'importance des fonctions qu'elle assume. Elle peut toutefois recourir à la collaboration de tiers, d'organismes publics (90), personnes, institutions
(90) Le statut prévoit l'obligation pour la C.G.E.R., dans un esprit de bonne gestion financière et d'égalité dans la concurrence, de rembourser à ces organismes le prix de revient de leur intervention.
ou entreprises privées. Le réseau des collaborations existantes au sein du secteur public, le recours à des agents, l'appui pris sur des sociétés agréées, comme en matière de crédit au logement, ou sur les comptoirs agricoles ou d'escomptes, peut donc subsister et se développer. Par ailleurs, la C.G.E.R. peut exercer toutes activités connexes et accessoires à ses fonctions principales. Elle peut être autorisée par le ministre des Finances (91) à
(91) Moyennant l'avis conforme du ministre des Affaires économiques pour les Caisses de retraites et d'assurances. Cette intervention est nouvelle, la C.G.E.R. étant.jusqu'alors, sous la tutelle du seul ministre des Finances. Elle semble avoir été inspirée par la circonstance que l'essentiel des activités de ces caisses relève de l'assurance qui ressortit au ministre des Affaires économiques.
exercer pour compte propre ou pour compte de tiers toutes activités de nature à faciliter la réalisation de ses missions (92). De même, lui a-t-il été permis de compromettre (93). Sur le plan administratif, enfin, la C.G.E.R. bénéficie d'une autonomie accrue puisque l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ne lui est dorénavant plus applicable (94). Elle peut donc fixer les cadres et statuts du personnel de façon autonome et sous le seul contrôle de tutelle du ministre des Finances. Enfin, pour mettre l'institution sur pied d'égalité avec la concurrence privée, la législation sur les marchés des travaux et de fournitures lui a été rendue inapplicable (95).
1 7. Une autre option essentielle de la réorganisation des structures d'administration et de gestion des caisses composant la C.G.E.R. consiste dans l'introduction d'organes dualistes correspondant au système dit « protocolaire » existant dans le secteur bancaire (96). Le Rapport au Roi (97) invoque, en outre, des précédents rencontrés, sous des formes plus ou moins proches, dans le secteur public (98), dans le droit général des sociétés à l'étranger et dans le projet de réforme du droit des sociétés (99).
1?4/1981
(89) Art. 4.
(92) Art. 5. (93) Art. 7, al. 2. Elle pouvait déjà transiger. (94) A.R. n' 3, art. 2. Voy. à cet égard, les modifications de l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 apportées par la loi du 30 juin 1975 (art. 88) et prévues par l'article 84, al. 2 - aujourd'hui caduc - de la loi du 5 août 1978. (95) Art. 7, al. 3. Voy. pareillement pour ce qui est de la S.N.I. et des S.R.I., la loi du 2 avril 1962, art. 2, § 5. (96) Voy. à ce propos l'article 69 de la loi du 30 juin 1975 et le protocole relatif à l'autonomie de la fonction bancaire conclu entre la Commission bancaire et les banques belges. Rapport Comm. banc.1973-1974, p. 230; R.P.0.8., Compl. V, V0 Epargne publique, n" 170 et suiv. (97) Mon. 8 janvier 1981, p. 102-103. (98) Banque nationale, S.N.I., Sabena ... (99) Doc. pari. Ch., 1979-1980, n' 287 / 1, art. 90 et suiv.
Chacune des deu>: entités (100) est dotée d'un conseil d'administration et d'un comité de direction dont la
(100) Compte tenu de sa vocation à se généraliser la structure adoptée pour la Caisse d'épargne l'a été également pour les autres caisses. Rapport au Roi, Mon. 8 janvier 1981. p. 103.
(101)
composition et les fonctions sont conformes au système «protocolaire» (101). L'ensemble de l'activité de chacune des entités est géré par le comité de direction, organe collégial dont les membres excercent des fonctions de plein exercice. Le conseil d'administration
Voy. les art. 15, al. 1 ~ et 19.
assure essentiellement une fonction de plein exercice. Le conseil d'administration assure essentiellement une fonction d'orientation de la politique générale et de contrôle de la gestion du comité de direction. Pour leur assurer une autonomie de gestion suffisante, des règles faisant place à une forme de cooptation président à la désignation des m1~mbres du comité de direction. Ceux-ci font partie du conseil d'administration mais en y ayant une position minoritaire (102) justifiée par le rôle de contrôle exercé par le conseil sur leur gestion (103). (103) Toutefois, les membres du comité de direction tirent de cette qualité celle d'administrateur alors qUE·, dans le système protocolaire, la fonction d'administrateur est. juridiquement, antérieure à celle de membre du comité
Les fonctions de président du conseil et de membre du
(102) Art. 12. al. 3.
comité sont incompatibles (104). (104)
L'introduction de ce système a été justifiée par plusieurs Art. 12- al. 5 -
raisons. Par la répartition des fonctions de gestion et de contrôle, il doit favoriser le dialogue interne concernant la définition, la mise en œuvre et le contrôle de l'exécution de la politique suivie. A ce titre, les structures nouvelles devraient contribuer à accroître le dynamisme de l'institution. Plus spécifiquement, ces structures doivent assurer l'autonomie de gestion et la responsabilité des dirigeants. Le passage d'une fonction de grand établissement public d'épargne encore fort lié par certains aspects aux pouvoirs publics, à celle de banque de plein exercice supposait logiquement l'octroi à la direction de la Caisse d'épargne du maximum d'autonomie et de responsabilité compatible avec la conservation de sa nature d'établissement public et avec le contrôle tutélaire qui y est lié. A ce titre, la transposition du système protocolaire existant dans les banques en matière de désignation des membres des comités de direction à l'initiative de leurs collègues est sans doute une innovation dans le secteur public. Elle devrait contribuer, sinon à l'exclusion (105), au moins à (105) Notamment parce que la nc,mination est faite par le conseil d'administration où sont représentés les poU'✓oirs publics. Au reste. des problèmes comparables d'équilibres, mêmes politiques. peuvent se poser dans de grands groupes privés.
~ 4/1981 453
454
la limitation de la politisation des nominations des responsables quotidiens (1 06). (106) Les organes nouveaux de la C.G.E.R. devaient être mis en place pour le 31 mars 1981 (art. 69, § 1 "). Leur constitution, qui a soulevé des problèmes politiques et linguistiques portés sur la place publique, n·est pas encore acquise (voy. interpellation de M. Defosset, Ch. des Repr., 19 mars 1 981 et 8 juillet 1981 et de M. Humblet, Sénat, 9 juillet 1981 ). Entretemps, les organes anciens de la C.G.E.R. restent en place et assurent la gestion de ses activités sur base du principe de continuité du service public.
Compte tenu de la nature de la C.G.E.R., les nouveaux textes applicables à la composition de ses organes font d'ailleurs place au pouvoir de décision politique là où le régime protocolaire des banques aurait conduit à laisser la décision à l'intérieur de l'institution. C'est ainsi que la nomination des présidents et vice-présidents parmi les membres des comités de direction (107) se fait par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur une liste double, présentée par le conseil d'administration après avis du comité de direction (108) et non, comme dans les banques privées, par le conseil d'administration sur proposition du comité de direction (109). Des règles d'équilibre linguistique inspirées de (109) La Commission bancaire n'est pas, comme dans les banques, appelée à donner son avis sur leur désignation (v. R.P.D.B. V0 cit. n' 191 ).
celles qui valent en Conseil des Ministres et à la S.N.I. (110) ont été expressément prévues pour la composition des organes (111 ). Pour des raisons tenant tantôt à la nature publique de l'institution, tantôt à la nécessaire autonomie de ses dirigeants, un régime d'incompatibilités a été prévu pour ceux-ci. En ce qui concerne les administrateurs (112), elles visent les fonctions considérées comme politiques (113), les fonctions exercées au sein (113) Elles sont inspirées de l'article 3 ter de la loi du 2 avril 1962 sur la S.N.I. et les S.R.I. Le commentaire de l'article précise que l'intervention des pouvoirs publics doit se limiter aux rôles du Conseil général, à la tutelle du ministère des Finances et au contrôle de la Commission bancaire et de l'Office de contrôle des Assurances (Mon. 8 janvier, p. 108).
d'autorités publiques surveillant la C.G.E.R. et les fonctions de gestion courante dans les autres institutions publiques de crédit ou d'assurance. Cette dernière incompatibilité s'explique par la nécessité de rendre autonome et spécifique l'organe définissant la politique des caisses de la C.G.E.R. (114). Une incompatibilité - comparable à celle qui vaut pour d'autres institutions publiques de crédit - existe, enfin, avec toutes les fonctions exercées dans un établissement privé de crédit ou d'assurance ou dans une société ou institution détenant dans un tel établissement une participation directe ou indirecte de 25 % au moins (115). Les membres des comités de
(p4/1981
(107) Le titre de directeur conféré à ceux-ci (art. 1 7, al. 2, 3° et 24, al. 2, 3°) ne qualifie pas une fonction administrative de cadre mais, comme à la Banque Nationale de Belgique ou à la Société Générale de Belgique, un mandat au sein d"un organe d"administration supérieure. (108) Art. 17, al. 4 et 24, al. 4.
(110) Const. art. 86 bis; loi du 2 avril 1962, art. 3 bis, § 1s, al. 3. (111) Art. 12, al. 6, 17, al. 6,
23, al. 6 et 24, al. 6.
(112) Art. 13 - Voy. la disposition transitoire à l'article 69, § ::
(114) et(l 1 b) Voy. commentaire des articles, p. citée à la note précédente.
direction sont soumis, en outre, à des incompatibilités spécifiques destinéeis à assurer leUr autonomie de gestion et leur indépendance de décision. Elles s'inspirent des règles valant pour les dirigeants actifs des banques privées (116). Comme pour ceux-ci (11 7), des possibilités de dérogations sont prévues dont l'usage pourra s'inspirer de la doctrine de la Commission bancaire en la matière (118). Ces dérogations sont décidées par le ministre des Finances après avis du conseil d'administration et du comité de direction (119).
18. La régionalisation du crédit (120) trouve diverses applications dans les nouvelles structures de la C.G.E.R. (121 ). D'une part, les pouvoirs régionaux (122) font les (121) Le Gouvernement de l'époque avait, en 1979, consulté les organismes publics de crédit sur les modes de réalisation de cette régionalisation par la voie de modification de leurs organes dirigeants, prévue par la déclaration gouvernementale du 1" avril 1979.
présentations au Roi pour la désignation de cinq membres du conseil général (123). D'autre part, ils sont associés par des avis à la désignation de certains administrateurs (124). On relèvera que le parallélisme entre les structures et les modes de composition des organes des deux entités ainsi que le rôle unitaire joué par le conseil général, ont conduit à introduire des éléments de régionalisation dans l'activité de la seconde entité, alors que l'assurance n'est pas une matière régionalisée. Par ailleurs, l'organisation administrative de la C.G.E.R. fait place, depuis 1976, à une régionalisation de la direction des sièges (125). Une direction régionale el<iste respectivement pour les sièges flamands et wallons, tandis que les sièges bruxellois relèvent de la direction générale. Un amendement tendant à imposer lé!]alement la création d'organismes régionaux coordonnés entre eux et, subsidiairement, l'organisation de départements régionaux distincts, n'a pas été retenue (126). Enfin, comme le Conseil d'Etat l'a relevé (127), le Commissaire du Gouvernement doit veiller au respect de l'intérêt général comprenant les aspects tant régionaux que nationaux de la politique du crédit.
19. Un des problèmes les plus passionnément discutés depuis qu'il est quest,1on de transformer la Caisse d' Epargne en banque publique se rapporte à la garantie de l'Etat dont la C.G.E.R. bénéficie (128). Cette (128) Aux termes de l'article 1w de a loi du 16 mars 1865, « il est institué une Caisse d'épargne sous la gar,,ntie de l'Etat ». Bien que la disposition annexant la caisse de retraite à la Caisse d'épargne ne le prévoyait pas expressément, on peut considérer que la garantie bénéficiait à l'ensemble de la C.G.E.R.
(F 4/1981
(116) Art. 18. (117) Et pour les dirigeants de la S.N.I. (Loi du 2 avril 1962, art. 3 bis, § 3, al. 9). (118) R.P.D.8., V0 cit., n' 151 et suiv. (119) Art. 18, al. 3. (120) Voy. notre chronique précitée, cette Revue, 1980, cahier 10, n° 5.
(122) Curieusement dénommés « exécutifs régionaux et communautaires » (art. 9, al. 1", 5°, 12, al. 2, 3° et 23, al. 2, 3°), étant respectivement l'exécutif flamand, l'exécutif régional wallon et l'exécutif de la région bruxelloise (Rapport au Roi, Mon. 8 janvier, p. 103).
(123) Art. 9, al. 1", 4°. La répartition de ces membres entre régions n'a pas été fixée par le statut. (124) Art. 12, al. 2, 3° et 23, al. 2, 3°. (125) Voy. rapports de la C.G.E.R. pour 1976, p. 7; pour 1977, p. 1 0; pour 1979, p. 7. (126) Amendement De M. De Wasseige, Doc. Pari. S. 1979-1980, n°483/13, p. 4 et la discussion Doc. Pari. S., n' 483/9, p. 67. (127) Mon.13janvier, p. 315.
455
456
garantie était générale et globale, même si elle ne devait jouer que si les pertes empêchaient cette institution de satisfaire ses déposants et créanciers (129). Le débat portait sur l'équilibre à trouver entre la sécurité à procurer aux épargnants, la stabilité de l'institution et l'égalité dans la concurrence avec les établissements du secteur privé. Dans son premier stade le projet devenu loi du 8 août 1980 n'abordait pas expressément cette question. La disposition relative à l'élimination des avantages ou charges concurrentiels (-130) aurait peut-être permis de modifier le régime de la garantie. Ce n'était cependant pas, semble-t-il, l'intention du Gouvernement ( 1 31). L'amendement du projet ( 1 3 2) a conduit à modifier le régime de la garantie. La loi du 8 août 1980, comporte, en effet, cette règle que « la garantie de l'Etat ... ne s'appliquera pas aux activités nouvelles que la C.G.E.R. pourra exercer» (133). L'article 3 nouveau de la loi organique rattache dorénavant la garantie aux engagements de la C.G.E.R. Elle la maintient intégralement pour les activités d'assurances, ainsi que pour les activités non concurrentielles - c'est-à-dire les missions légales spéciales (134) - de la Caisse d'épargne. Pour les activités bancaires ordinaires par contre, la garantie reçoit un objet délimité sur base tant de l'article 92 § 1°', 1°, précité que de l'article 92, § 2, 1° de la loi d'habilitation postulant l'élimination des dispositions discriminatoires. Dans la mise en œuvre de cette philosophie, il a été tenu compte, en outre, de l'impossibilité technique et juridique d'énoncer les « activités nouvelles » permises à la Caisse d'épargne. D'une part, les activités qui leur étaient antérieurement autorisées n'étaient pas répertoriables avec certitude (135). D'autre part, nombre d'opérations bancaires et financières, notamment dans ses domaines nouveaux d'activités, résultent d'enchevêtrements d'actes dont certains pouvaient être jadis autorisés. Aussi, la garantie a été rattachée aux opérations classiques d'épargne (dépôts) ainsi qu'aux obligations et bons de caisse (136). L'accès de la Caisse d'épargne aux opérations internationales et interbancaires a conduit à exclure les engagements en devises et les dépôts en francs belges d'institutions financières. Pour les dépôts en francs belges d'entreprises non financières, dépôts reçus de longue date, le maintien de la garantie pouvait, de prime abord, comporter un avantage concurrentiel. Cependant, les entreprises n'ont intérêt à confier leurs liquidités à un intermédiaire financier qu'en raison des services qu'il leur assure en retour. C'est à ce titre que les risques de distorsion de concurrence ont été évités par l'égalisation du montant pour lequel la garantie
!? 4/1981
(129) C.G.E.R. Recueil annoté des lois et règlements, n' 104.
(130) Art. 46, § 2, 1° du projet n' 323.
(131) Voy. les déclarations du ministre des Finances en Commission de la Chambre, Doc. Ch. 1979-1980, n°323/47, p. 95. (132) Voy. supra n' 3. (133) Art. 92, § 1 ~. 1 ° in fine.
(134) Voy. n' 26.
(135) Voy. n' 7.
(136) Voy. la justification dans le Rapport au Roi, Mon. 8 janvier, p. 105.
publique peut être donnée à la Caisse d'épargne pour la sûreté des crédits alloués par elle aux entreprises sur base des lois prévoyant l'intervention de l'Etat, des Communautés et des Régions sous forme de garanties ou de subventions (1137). Par ailleurs, les travaux préparatoires de la loi du 8 août 1980 (138) et le rapport au Roi précédant l'A.R. n° 1 (139) précisent que le Commissaire du Gouvernement devra veiller à ce que la Caisse d' épar!~ne ne fasse pas état, spécialement dans ses documents commerciaux et administratifs, de la garantie dont ses engagements bénéficient.
20. De même, la publicité faite par la C.G.E.R. par voie d'émissions national,es (140) de radio et de télévision, (140) Pour les émissions faites sur des antennes étrangères, l'égalité de situations était acquise.
qu'elle finance, a soulevé le problème de l'inégalité de concurrence avec le secteur privé à qui cette formule est exclue. C'est également au Commissaire du Gouvernement qu'il appartient de ve:iller à ce qu'il n'y soit plus recouru (141 ). Le problème se poserait toutefois dans des termes nouveaux si la publicité par voie de radio et de télévision venait à être, comme c'est prévu, ouverte aux entreprises. Le principe d'égalité de concurrence devrait conduire à revoir ces instructions en fonction de ce qui serait autorisé aux banques privées.
IV. Organisation et fonctions de la Caisse d'épargne
21 . Avant sa transformation en banque publique, la Caisse d'épargne, bien que confondue au sein de la C.G.E.R., faisait déjà l'objet d'une identification organique, financière et comptable. Elle était indiscutablement visée seule par nombre de dispositions de la législation financière, qui citaient pourtant la C.G.E.R. ou qui visaient, selon les cas, les « institutions de crédit créées par une loi speciale », les « institutions publiques de crédit », les « organismes publics de crédit » ou les « intermédiaires financiers du secteur public ». Même si certaines opérations (prêt hypothécaire notamment) pouvaient être rattachées et à la Caisse d'épargne et à l'une ou à plusieurs des autres caisses, la loi organique de la C.G.E.R. leur définissait pour chacune un régime spécifique pour ses opérations actives et passives. 11 en résultait une situation ambiguë ou à tout le moins peu nette. La chose est apparue également sur le plan du droit communautaire où des directives distinctes s'appliquent aux activités
[?4/1981
(137) Lois diverses dites d'expansion économique, de crédit aux classes moyennes et à l'investissement agricole (A.R. n° 3, art. 14, al. 1~). Voy. cependant l'exception limitée prévue à l'article 14, al. 2. Les arrêtés royaux de mise en concordance de ces lois avec l'A.R. n° 3 n'ont pas encore été pris. (138) Voy. notamment Exposé des motifs, Doc. Ch. 1979-1980, n° 323/ 1, p. 13. (139) Mon. 8 janvier, p. 105.
(141) Voy. notamment Exposé des motifs, Doc. Ch. 1979-1980, n° 323/ 1, p. 13.
457
458
respectives d'intermédiaires financiers (142) et d'assurance (143) de la C.G.E.R. et citent parfois nommément celle-ci. Sur le plan du nouveau droit institutionnel, seule l'activité de crédit de la C.G.E.R. tombe sous la régionalisation partielle prévue par la loi spéciale du 8 août 1980 (144). La nouvelle loi organique apporte à cette situation une clarification partielle qui va se répercuter sur l'interprétation d'autres lois et règlements visant la C.G.E.R. en termes généraux. La suppression de certaines différences qui existaient entre la Caisse d'épargne et les établissements privés de crédit va contribuer à préciser certaines dispositions (145).
22. Le nouveau régime de la Caisse d'épargne résulte de la combinaison des règles ayant des objets distincts : dispositions statutaires nouvelles, inscrites dans la loi organique de la C.G.E.R. du 16 mars 1865 (146), et
(146) A.R. n• 1 - Tant pour des raisons juridiques tenant à la limitation de l'habilitation de pouvoirs que par égard pour une loi plus que centenaire ayant créé un des premiers organismes publics, le cadre légal antérieur a été conservé.
dispositions organisant son contrôle prudentiel spécifique (14 7) ou supprimant des différences de régimes existant entre elles et les banques privées (148). Compte tenu de sa nature d'établissement public, il n'était pas possible de la soumettre entièrement à une législation bancaire conçue pour des établissements de droit privé (149). Il aurait, autrement, été nécessaire d'y
(149) Sur des différences de techniques juridiques à adopter, en ces matières, à l'égard d'établissements privés et publics, voy. notre article, cette Revue, 1979, p. 41 et p. 54.
prévoir de nombreuses exceptions ou adaptations. Ainsi s'explique que la C.G.E.R. - c'est-à-dire la Caisse d'épargne - continue à être soustraite comme telle à la législation bancaire, comme d'allieurs à celles qui visent les caisses d'épargne priveés et certains autres établissements de crédit (1 50).
23. La banque publique continue à être désignée par la dénomination de« Caisse d'épargne » qui est employée tant par la loi du 8 août 1 980 que par les arrêtés du 24 décembre 1 980 (1 51 ).
(151) Conformément à l'article 28 de l'arrêté royal du 23 juin 1967 portant coordination de la législation relative aux caisses d'épargne privées, elle peut, comme celles-ci, faire usage de ces termes.
LP4/1981
(142) Directive du 1 2 décembre 1977 (J.O. n° L 332 du 17 décembre 1977) à laquelle le Gouvernement belge a entendu soumettre la C.G.E.R. (voy. notre étude, cette Revue, 1979, p. 54). (143) Directives « assurance-dommage »
du 24 juillet 1973 (J.O. n° L 228 du 16 août 1973) et « assurance-vie » du 5 mars 1979 (J.O. n• L 63 du 13 mars 1979). (144) Loi spéciale du 8 août 1980, art. 6, § 1•, V, 3°voy. cependant n° 18. (145) A.R. n° 3, art. 4 à 14.
(147) A.R. n°2. (148) A.R. n°3.
(150) A.R. n° 185 du 9 juillet 1935, art. 1 •. al. 2, 1 °; disp. coord. sur les caisses d'épargne privées art. 2 et loi du 10 juin 1964. art 1•, al. 1
En vertu du statut légal des banques, elle peut cependant, depuis 1935, user de la dénomination de « banque » bien qu'elle ne soit pas soumise à ce statut (1 52). Dans le cadre de ses activités futures à l'étranger, elle pouIrra, en outre, sur base des directives communautaires (153), faire usage de sa dénomination dans les pays de la C.E.E., quelle que soit la réglementation applicable en cette matière dans les autres Etats membres. On notera, à cet égard, que les termes de « banque publique » - au reste non repris dans les dispositions nouvelles - ne constituent pas une innovation. Les opérations de « banqu~s publiques » étaient réputées commerciales dès l'origine par le Code de Commerce (154). On devait entendre par là tant les banques d'émission que les institutions publiques de crédit (155). D'ailleurs, comme il en va pour d'autres institutions publiques, le nouveau statut de la C.G.E.R. prévoit expressément que ses opérations sont réputées commerciales (1 56}. Il en découle notamment son assujettissement à la législation comptable (157). Bien que la pratique en la matière soit incertaine pour les organismes publics exerçant des activités commerciales (158), la C.G.E.R. pourra être inscrite au Registre du Commerce.
24. Les activités de la caisse d'épargne sont dorénavant définies en termes extensifs (1 59) et non plus par voie de dispositions limitatives (1 60). Le Rapport au Roi précise qu'elle pourra mener toutes les activités qui ne sont pas interdites aux banques privées (161 ). Elles comprennent à titre principal « l'ensemble des activités permises aux banques, spécialement en matière de récolte d'emprunts de fonds, de crédits, de placements, d'opérations de change, de garanties et de services ». Par cette formule, la Caisse d'épargne se trouve habilitée à mener toutes les opérations rentrant dans l'activité bancaire au sens tant de l'article 2 du Code de Commerce que du statut des banques (1 62). Elle est également en droit de mener les activités réservées aux banques par des législations particulières (163) et qui ne lui auraient pas été autorisées expressément, et elle se trouve habilitée à faire les opérations qui viendraient à l'avenir à être permises ou réservées aux banques. La loi actuelle laissant aux banques le droit de mener, sauf quelques exceptions (164), l'ensemble des activités bancaires et financières, la Caisse d'épargne voit d'emblée son champ d'action défini de la façon la plus large (1 65). Sans doute, la (165) En outre, la Caisse d'épargne peut effectuer toutes les opérations se rapportant indirectement à sa fonction bancaire. Elle dispose des possibilités d'actions prévues par les art. 4 et 5. Voy. supra, n° 16.
[f 4/1981
(152) A. R. n° 185 du 9 juillet 1935, art. 3. (153) Directives du 28 juin 1973 (J.O. 16 juillet), art. 6, § 1 ~ et du 1 2 décembre 1977 (J.O. 17 décembre), art. 5.
(154) Voy. art. 2, al. 9 actuel. (155) Voy. la doctrine citée dans notre étude, cette Revue, 1966, p. 710. (156) A.R. n° 1, art. 5, al. 2. (157) Loi 17 juillet 1975, art. 1M - v. cependant, infra, n05
32 et 36. (158) Olivier, « L'entreprise publique et le droit commercial», J.T., 1976, p. 538. (159) A.R. n° 1, art. 32. (160) Anciens articles 20, 25 et 28 et suiv. - voy. cependant le pouvoir antérieur du ministre des Finances cité au n° 7. (161) Mon. 8 janvier, p. 112.
(162) A.R. n° 185 du 9 juillet 1935, art. 1~.
(163) Voy. R.P.D.B., Compl. V, V0 Epargne publique, n° 127.
(164) Voy. infra n° 27.
459
460
Caisse d'épargne devra-t-elle progressivement acquérir le « know-how » et l'infrastructure technique nécessaires au déploiement de certains activités qu'elle ne pratiquait pas encore. li lui faudra également développer des contacts pour se faire sa place comme banque dans le secteur financier national et international. Mais elle ne se heurtera à aucune limite juridique qui ne vaudrait pas pour les banques privées. Les dispositions nouvelles comportent par ailleurs la levée des interventions spéciales de tutelle applicables au volume ou aux conditions de ses opérations bancaires. La Caisse d'épargne ne ressortit donc plus, à cet égard, qu'aux disciplines communes à l'ensemble des intermédiaires financiers (166).
25. L'accession de la Caisse d'épargne au statut plein de banque comporte une dimension territoriale importante. Alors qu'en principe (167) les institutions (167) AI' exception des organismes, des activités ou opérations qui ont, par nature. une dimension internationale et des cas où le législateur ou un traité international en a expressément disposé autrement.
de droit public voient leur rayon d'action limité au territoire national, à tout le moins pour leur implantation et pour l'exercice direct de leur activité, la Caisse est autorisée expressément à opérer à l'étranger (168). Elle peut le faire selon toutes les voies utilisées par les banques : directement, par voie de succursale ou de prestation de services sans implantation là où elle est permise, ou indirectement par création de filiales (1 69) ou par recours à des correspondants (1 70). (170) Pour les opérations internationales autorisées sous l'empire de son ancien statut, la C.G.E.R. avait déjà un réseau de correspondants étendu à travers le monde.
A ce titre, la Caisse va concrètement pouvoir bénéficier à plein des facultés et facilités offertes par le droit communautaire en matière de liberté d'établissement et de prestation de services et se trouver soumise aux disciplines et contrôles qui y sont liés (1 71 ).
26. La Caisse d'épargne demeure, malgré la banalisation de ses activités bancaires principales, chargée de tâches bancaires spéciales d'intérêt public. Le législateur l'a chargée d'opérations de réception de fonds et, plus souvent, de crédits et de placements de fonds répondant à d'importantes missions spéciales d'intérêt général ou social que son organisation et sa pratique des activités financières rendaient souhaitable de lui voir confier pour compte propre ou pour compte de l'Etat (172). On doit citer spécialement
[?4/1981
(166) L'article 16 de l'A.R. n° 3 en tire les conséquences du point de vue de la concertation spécifique existant dans le secteur public à l'intervention du Conseil des Institutions publiques de crédit (voy. le commentaire de cette disposition, notamment pour ce qui est du maintien de la concertation des taux d'intérêt créditeurs, Mon. 8 janvier, p. 129).
(168) Art. 32, al. 2.
(169) Voy. infra, n° 27.
(171) Voy. les directives citées au n° 23.
(172) Voy. spécialement la loi du 29 mars 1963.
le financement du logement social, de l'enseignement universitaire, des hôpitaux, de certains régimes sociaux ... encore que ces missions ne lui soient pas toujours imposées par la loi elle-même. La loi du 8 août 1 980 a considéré que les activités à statut légal particulier, sources de sujétions administratives et financières, devaient continuer à être rattachées à la Caisse d'épargne mais bénéficier d'un traitement spécifique. L'élimination des inégalités juridiques de traitement par rapport aux banques privées ne les concerne pas (1 73). La gestion, la caisse et la comptabilité des opérations ordinaires doivent être distinctes (174). Par conséquence, il doit en être tenu de spécifiques pour ces missions particulières. Par contre, le principe du contrôle prudentiel et de la fixation de coefficients de gestion englobe l'ensemble de la Caisse d'épargne (175) moyennant, s'il y a lieu, des exigences appropriées aux divers types de missions. L'arrêté royal n° 1 a donc confirmé la Caisse d'épargne dans les missions spéciales prévues tant par les lois actuelles que par celles qui pourraient intervenir (1 76). Il a, par ailleurs, tenu compte de ce qu'elles n'étaient pas susceptibles de toutes les disciplines applicables aux banques privées. Dans un but de transparence des comptes de la Caisse d'épargne relatifs à ses opérations bancaires ordinaires, les comptes annuels et situations périodiques destinées aux autorités de contrôle doivent identifier et mettre en évidence les opérations relevant de missions spéciales ainsi que les ressources qui leur sont affectées, notamment à charge des ressources ordinaires de la Caisse. Le compte de résultat doit, de même, faire apparaître les produits et charges propres à ces activités (1 77). Ces dispositions devront conduire à l'établissement de comptes de liaison entre la gestion ordinaire et la gestion spéciale, notamment pour ce qui est des ressources financières et de l'imputation des charges en personnel et en infrastructure. Elles permettront en outre, tant sous l'angle du contrôle que de la publicité, d'apprécier la consistance et la rentabilité respectives des opérations ordinaires -typiques de la « fonction bancaire de plein exercice » -
et des opérations spécifiques de service public. Le nouveau statut rattache deux conséquences importantes à cette distinction. Dans l'esprit de l'article 92, § 1 °', 1 ° de la loi du 8 août 1980, les engagements de la Caisse d'épargne découlant de ses missions légales spéciales continuent à bénéficier à plein de la garantie de l'Etat (178). La rémunération annuelle de la garantie de l'Etat (179) est déterminée « en tenant compte de l'incidence financière des missions sociales »
~ lf-' 4/1981
(173) Art. 92, § 2, 1°.
(174) Art. 92, § 2, 2°.
(175) Art. 92, § 2, 3° et 4°.
(176) Art. 32, al. 2. Ces missions s'exercent, notamment au point de vue de l'accomplissement des opérations, conformément à ces lois spéciales.
(177) Art. 35, al. 3 mettant en œuvre l'article 92, § 2, 2° de la loi du 8 août 1980.
(178) Art. 3, 2° - voy. n' 19. (179) Art. 36, al. 3 - voy. n' 30.
461
462
qui incombent à la Caisse d'épargne. Cette expression vise assurément les missions spéciales qui se font à des conditions préférentielles. Par contre, les dispositions favorables dont la Caisse d'épargne bénéficiait, notamment sur le plan fiscal, ont été supprimées pour l'ensemble des activités de la Caisse d'épargne, en raison soit de ce qu'elles s'appliquent à l'infrastructure générale de la Caisse d'épargne, voire de la C.G.E.R. dans son ensemble (1 80), soit de ce que les opérations en cause ne pouvaient être imputées spécifiquement aux missions ordinaires ou spéciales de la Caisse d'épargne.
27. La transposition à la Caisse d'épargne des principes applicables à l'activité des banques a posé le problème de la détention par elle d'actions et de participations (181 ). Elle ne pouvait antérieurement détenir d'actions de sociétés mais bien des obligations de sociétés belges. Fort logiquement, le régime applicable aux banques constituées sous forme de sociétés de capitaux (182), lui a été étendu. D'une part, la Caisse d'épargne, par sa taille et ses fonctions, sera comparable aux grandes banques, toutes soumises à ce régime. D'autre part, les banques constituées en sociétés de personnes et soustraites aux mêmes interdictions et limites en la matière n'ont plus qu'une place marginale. Par analogie, l'article 33 qui réalise cette extension attribue au ministre des Finances les pouvoirs de dérogation que la Commission bancaire détient en la matière mais qu'il exercera après avis de celle-ci. Par ailleurs, il soumettra à l'avis du conseil d'administration les règlements de la Commission bancaire fixant certaines limites et conditions en la matière de même qu'ils sont, pour le secteur privé, soumis à l'Association belge des Banques (183).
28. Un problème de structure du marché bancaire a été réglé par l'article 33, alinéa 2. Le statut bancaire a voulu, en soumettant les fusions de banques à l'autorisation de la Commission bancaire (184), prévenir une concentration excessive que la crise de l'époque avait favorisée. Pour réaliser les fins recherchées, la Commission a interprété largement la notion de fusion comme visant toutes les opérations de cession et mêmes les prises de contrôle d'activités bancaires (185). Le nouveau statut de la Caisse d'épargne s'inspire de ces dispositions et de leur interprétation pour assurer la continuité de la politique restrictive suivie en la matière, pour assurer un équilibre institutionnel entre le secteur privé et le nouvel établissement bancaire public en voie de constitution et
(F 4/1981
(180) Voy. par exemple l"A.R. n° 3, art. 4, concernant l'immunisation du précompte immobilier.
(181) Pour l'octroi de crédits aux dirigeants, voy. art. 34 à comparer avec l'art. 1 7 de l'A.R. n° 185 du 9 juillet 1935 qui est plus exigeant pour les banques et avec l'art. 26, al. 1 et 2 des dispositions coordonnées sur les caisses d'épargne privées qui lui est semblable. Par contre, l'art. 15 du statut bancaire sur le contrôle des frais de publicité n'a pas été étendu (voy. R.P.D.B., v0
cit., nos 221 et suiv.). (182) A.R. n° 185, art. 14 -R.P.D.B., V0 cit., nos 227 et suiv.
(183) Art. 33, al. 1~.
(184) A.R. n° 185, art. 4.
(185) R.P.D.B., V0 cit., nos 205 et suiv. et notre chronique, cette Revue, 1980, cahier 10, nos31 et 49.
pour soumettre à des contraintes comparables en fait à celles valant pour les banques privées les opérations de prises de participations dans des intermédiaires financiers et d'autres établissements du secteur financier (186). Pour les banques, une contrainte importante découle de l'obligation de couvrir ces prises de participations à 100 % par des fonds propres (187). A défaut ou dans l'attente qu'une telle contrainte soit imposée à la Caisse d'épargne sur base des coefficients comparables (188), eu égard spécialement à l'impo•1ance de ses fonds propres actuels et compte tenu de ce que la consistance des fonds propres des institutions publiques de crédit pourrait être définie plus largement que pour les banques (189), les opérations (189) Le Rapport au Roi fait état d'une assimilation possible du montant des engagements des établissements publics de crédit couverts par la garantie de l'Etat à des fonds propres en vertu d'un avant-projet de loi non encore déposé (Mon. 8 janvier, p. 113).
de fusions et de prises de participations sont subordonnées à l'autorisation du ministre des Finances après avis de la Commission bancaire qui pourra éclairer le Ministre sur l'attitude qui serait prise dans le cas d'une banque privée (190).
29. La gestion de la Caisse d'épargne pourra, de plus, être encadrée par des règles découlant de coefficients de structures en matière de liquidité, de solvabilité et de rentabilité. Conformément à l'article 92, § 2, 3° de la loi du 8 août 1980, ces coefficients seront fixés par le ministre des Finances. Celui-ci prendra l'avis de la Commission bancaire, de la Banque Nationale (191) et du Conseil général de la C.G.E.R. (192). Pour assurer (192) A.R. n' 2, art. 2. Les associations professionnelles des institutions privées sont consultées en vertu des dispositions citées au n' précédent. La consultation du conseil d"administration de la Caisse d'épargne aurait été plus logiquement prévue si le texte légal de base n·avait imposé celle du Conseil général dont les attributions couvrent l'ensemble de la C.G.E.R.
l'unité de conception des coefficients structurels applicables à la Caisse d'épargne et aux banques privées, la Commission est expressément habilitée à faire, au ministre des Finances, des propositions de règlements de structure. Les arrêtés en la matière seront publiés au Moniteur. Le ministre des Finances pourra y autoriser des dérogations, sur avis de la Commission bancaire, comme celle-ci peut en autoriser dans le cas des banques (193). La Commission bancaire aura donc, (193) A.R. n' 2, art. 2, al. 2 et 4. En matière monétaire, la Caisse d'épargne relève, depuis la loi du 28 décembre 1973, des disciplines communes aux intermédiaires financiers. Les règlements imposant les mesures requises sont pris par le ministre des Finances (art. 1 ~, § 2) qui peut y autoriser des dérogations. L'article 17 de l'A.R. n' 3 soumet celles-<:i à ravis préalable de la Commission bancaire.
[F 4/1981
(186) Rapport au Roi, Mon. 8 janvier, p. 113. (187) Règlement du 13 juin 1972 sur les fonds propres, art. 3, 5, 8 et 9, § 1~. (188) Voy. n° 29.
(190) Art. 33, al. 2 et Rapport au Roi, cod. loc.
(191) Ainsi quïl en va pour les banques (A.R. n' 185, art. 11) et pour les caisses d'épargne privées (disp. coord., art. 16).
463
464
en fait, un rôle important à jouer en la matière, dans l'esprit des règles qui valent pour les banques privées. Bien que les textes ne le prévoient pas expressément, il se pourrait que les coefficients doivent tenir compte des conditions particulières des opérations faites par la Caisse d'épargne en vertu de ses missions légales spéciales (194). L'esprit du Rapport au Roi relatif à l'article 33 déjà cité (195) conduit cependant à ce que, toutes choses étant égales, les contraintes de gestion doivent être comparables.
30. Une différence importante de contrainte dans la gestion aurait pu résulter de ce que, comme établissement public, la Caisse d'épargne n'a pas à rémunérer un capital. Ce problème a été évoqué à diverses reprises lors des travaux préparatoires de la loi du 8 août 1980. Le Gouvernement a estimé que la Caisse devait être amenée à générer un bénéfice tant pour des raisons concurrentielles que pour couvrir les risques afférents à son activité bancaire (196). En outre, le nouveau statut impose à la Caisse d'épargne une rémunération de la garantie de l'Etat, dont bénéficient ses engagements rattachés à ses opérations bancaires ordinaires (197). Le (197) Art. 36, al. 2. Comp. des obligations similaires, dans leur principe du moins, en ce qui concerne la C.N.C.P., lï.N.C.A., ou sur base des lois d"expansion économique.
pourcentage de cette rémunération sera fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres compte tenu de l'incidence financière des missions sociales de la Caisse d'épargne (198). Elle ne pourra cependant pas conduire à une amputation du fonds de réserve tel qu'il s'établissait au 31 décembre 1980.
31 . Le souci de donner à la Caisse d'épargne une souplesse de gestion comparable à celle des établissements privés a entraîné la levée, en ce qui la concerne, des contrôles et contraintes administratives découlant de l'assujettissement antérieur de la C.G.E.R. à la loi du 1 6 mars 1 954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. La Caisse d'épargne se trouve ainsi maîtresse de sa politique, spécialement en matière de budgets et comptes, de comptabilité, d'emprunts et de placements (199), sous réserve de la tutelle générale du ministre des Finances à laquelle elle demeure soumise. En outre, elle doit tenir compte des règles qui lui sont applicables, soit en vertu de son régime organique propre (200) ou du régime organique (200) Ainsi en matière de comptabilité et de comptes annuels ou pour ce qui est de la rémunération de la garantie de l'Etat- Sur le ..,ontrôle de ses comptes, voy. infra n" 32.
[f 4/1981
(194) Voy. n" 26. (195) Voy. n" 19.
(196) Mon. 8 janvier, p. 114.
(198' Voy. supra n" 26.
(199) Pour les marchés, voy. au n" 16 la règle applicable à l'ensemble de la C.G.E.R.
général de la C.G.E.R. (201), soit en vertu de son assujettissement nouveau d'un régime de contrôle « prudentiel » (202).
(201) Ainsi en matière de cadre et de statut de son personnel voy n° 1 5 et 1 6.
32. Dans l'identification de la gestion relevant de la Caisse d'épargne, dans son administration et dans le contrôle de son activité bancaire, le régime de la comptabilité et des comptes annuels joue un rôle déterminant. Ce régime est défini par les articles 6 et 35 nouveaux de la loi organique. Comme les autres caisses, la Caisse d'épargne a une comptabilité et des comptes annuels spécifiques qui comportent des fonds propres distincts (203) et spécialement un fonds de réserve auquel sont imputés les résultats de l'exercice et qui supporte les interventions éventuelles de l'Etat au titre de la garantie des engagements de la Caisse d'épargne (204). Les règles relatives à la tenue de la comptabilité et à l'établissement des comptes sont celles qui valent pour les banques (205). L'article 73 de la loi du 30 juin 1975 donnant au Roi le pouvoir de fixer des règles pour les intermédiaires financiers privés et publics est également applicable. Dans un but de transparence déjà exposé, l'article 35, alinéa 3 impose l'identification comptable des opérations faites par la Caisse d'épargne en vertu de missions à statut spécial. Un régime de publicité des comptes annuels de la Caisse d'épargne (206) est organisé par extension des règles prévues pour les sociétés (207). Ces comptes doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce et sont transmis à la Centrale des Bilans (207). (208) Ces obligations sont spécifiques à la Caisse d'épargne. Sur les obligations comptables de l'ensemble de la C.G.E.R., voy. n° 15.
Le contrôle des comptes annuels revient aux reviseurs de la Caisse d'épargne (208) qui font rapport, d'une part, au conseil d'administration (209), d'autre part, à la Commission bancaire (210). Eu égard aux garanties découlant de cette extension du contrôle revisoral propre au secteur financier, le législateur à soustrait les Caisse d'épargne au contrôle de la Cour des Comptes (212). Ce contrôle a pris fin par suite de l'inapplication (212) La loi du 8 août 1980 (art. 92 § 3, al 1 ") n'a pas adopté la même solution pour le contrôle des caisses d'assurances organisées cependant de façon largement parallèle (A.R. n' 1, art. 27 nouveau, al. 2 et 3; loi du 9 juillet 1975 sur le contrôle des entreprises d'assurances et A.R. du 15 avril 1977).
de la loi du 16 mars 1954 prévue par l'article 92, § 3, alinéa 1"' de la loi du 8 août 1 980 mise en œuvre par l'article 1"' de l'arrêté royal n° 3.
lf 4/1981
(202) Voy. n° 33.
(203) Art. 6, al. 2 - voy. n° 15.
(204) Art. 36, al. 1 et 2. (205) Art. 35 -v. R.P.D.B., V0
cit., n05 280 et suiv.
(206) En ce compris les éventuels comptes consolidés établis pour celle-ci.
(207) Art. 10 et 80, al. 3 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales rendus applicables par l'art. 35, al. 2 nouveau.
(209) Voy. infra n' 33. (210) A.R. n° 1, art. 27 nouveau, al. 1"" et 3. (211) A.R. n° 2, art. 1 "", al. 4.
465
466
33. La Caisse d'épargne est, comme banque publique, soumise à la surveillance de la Commission bancaire. Il ne s'est pas agi de lui imposer gratuitement des contraintes administratives comparables à celles valant pour le secteur privé mais de traduire, notamment sur base de la directive communautaire déjà citée du 1 2 décembre 1977, les exigences d'un contrôle prudentiel comparable des deux secteurs dans une préoccupation de protection de l'épargne. Le Gouvernement a prévu d'ailleurs, pour cette raison, un tel contrôle pour le reste du secteur public de crédit. La nécessité d'un régime prudentiel, nonobstant l'existence d'une garantie d'Etat couvrant certains engagements de la Caisse d'épargne, a été motivée par la rigueur dans la gestion et dans le contrôle requise par la complexité croissante des opérations financières, les risques liés à l'internationalisation des activités et les circonstances de la crise (213). Cette situation se rencontre d'ailleurs à l'étranger. De la même manière qu'il n'était pas possible de soumettre globalement la Caisse d'épargne à la législation bancaire (214), la loi (21 5) et l'arrêté organisant le contrôle de la Commission bancaire ont tenu compte de certaines particularités existant dans le chef d'un établissement public et ont articulé ce contrôle et le pouvoir de tutelle du ministre des Finances. Le principe et l'objectif du contrôle de la Commission sont posés à l'article 1 "', alinéa 1 "' de l'arrêté royal n° 2 : « La Commission bancaire surveille la situation et les activités de la Caisse d'épargne sous l'angle de son organisation administrative et comptable, de son contrôle interne, ainsi que de sa liquidité, de sa solvabilité et de sa rentabilité ». Ces termes s'inspirent de l'article 25, § 1er, alinéa 1er de la législation bancaire (216). Pour le surplus, le contrôle de la Commission est
(216) Sur l'objectif du contrôle des banques par la Commission, voy. R.P.D.B., V0
cit., n05 313 et suiv. Le contrôle de la Commission bancaire englobe les « mécanismes particuliers » éventuels de fraude fiscale visés à l"art. 39, al. 2 de l'A.R. n' 185 (Rapport au Roi précédant l'A.R. n' 2, Mon. 8 janvier, p. 126). Par conséquent, le devoir de dénonciation au ministre des Finances découlant de l'art. 235, § 5 nouveau du C.I.R., modifié par la loi du 8 août 1980, s'imposerait à la Commission.
défini - moyennant des adaptations minimes - par renvoi à certaines dispositions de la législation bancaire : pouvoir de contrôle de la Commission (21 7); désignation - mais avec l'accord du ministre des Finances - de reviseurs agréés dont les pouvoirs sont identiques à ceux qui sont en fonction auprès des banques (218), secret professionnel de la Commission et des reviseurs (21 9),
~ 4/1981
(213) Voy. Rapport au Roi précédant l'A.R. n' 2, Mon. 8 janvier, p. 124.
(214) Voy. n' 22. (215) Art. 92, § 2, 3° de la loi du 8 août 1 980 et l'exposé des motifs, Doc. pari., Ch., 1979-1980, n° 323/ 1, p. 17.
(217) A.R. n' 2, art. 1 ~. al. 2. (218) A.R. n' 2, art. 1Œ, al. 4. (219) A.R. n' 2, art. 4.
communications à faire à la Commission (220) (221 ). La disposition la plus spécifique (222) est relative aux
(220) A.R. n° 2, art. 1 ~. al. 3 - Ces informations sont communiquées en copie au ministre des Finances. (221) Pour la contribution de la Caisse d'épargne aux frais de fonctionnement de la Commission, voy. A.R. n° 2, art. 5 et A.R. 3 juillet 1981 (Mon. 4 août)
interventions exceptionnelles de la Commission appelées par des situations dangereuses ou critiquables. La nature juridique de la C.G.E.R. excluait qu'on lui appliquât éventuellement des mesures telles que la désignation d'un commissaire spécial, la suspension de tout ou partie de ses activités ou la révocation définitive de son droit d'exercer celles-ci. Aussi, l'article 3 de l'arrêté royal n° 2 organise-t-il autrement l'intervention de la Commission (223). En un premier stade, ses observations et sa mise en demeure sont adressés aux organes de direction de la Caisse d'épargne, avec copie au commissaire du Gouvernement qui est mis en mesure de suivre l'évolution de la situation constatée. Mais en fin de compte, si le redressement n'est pas opéré, c'est au ministre des Finances, saisi des observations de la Commission à l'intervention du commissaire du Gouvernement, à prendre les mesures qui s'imposent. Le problème devient politique et c'est par les voies politiques qu'il devrait trouver sa solution (224). Il vaut d'être relevé que les reviseurs disposent du pouvoir d'opposer leur veto, comme auprès des banques privées, pour les décisions de la Caisse d'épargne dont l'exécution constituerait une infraction pénale (225). C'est qu'il s'agit d'interventions ponctuelles où la paralysie de la décision, outre qu'elle se recommande d'une raison supérieure, n'est pas de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de l'institution (226).
V. Organisation et fonctions des caisses d'assurance 34. La réforme de la C.G.E.R. n'a pas touché aux caisses de retraite, d'assurances et de rentes-accidents du travail que sous l'angle de /'administration et de la gestion de l'institution (227), et dans le prolongement des réformes adoptées pour la Caisse d'épargne. Ce n'est donc pas ici le lieu d'exposer l'ensemble de leur statut juridique. Celui-ci découle de la loi organique de la C.G.E.R. (228), des nombreuses législations sociales confiant à ces caisses des missions d'assurances, de sécurité ou de prévoyance sociale, et du régime généralisé de contrôle des entreprises d'assurances prévu par de la loi du 9
LF 4/1981
(222) Comp. pour les banques, l'art. 25 de l'A.R. n° 185.
(223) Voy. sur la philosophie de ce système, la déclaration du ministre des Finances en commission de la Chambre (Doc. Ch., 1979-1980, n° 323/47, pp. 94 et 100) et Rapport au Roi précédant l'A.R. n° 2, Mon. 8 janvier, p. 125. (224) On notera que l'art. 23 de la loi du 16 mars 1954 qui permettait au Ministre de faire délibérer la Caisse d'épargne sur ses propositions et, à défaut, qui habilitait le Roi à se substituer à celle-ci, a été rendu inapplicable (voy. n° 31). (225) A.R. n° 185, art. 23, al. 2 rendu applicable par l'A.R. n° 2, art. 1~, al. 4. Le Rapport au Roi précédant ce dernier arrêté prévoit l'information - par le reviseur, pense+on - du commissaire du Gouvernement (Mon. 8 janvier, p. 125). (226) Voy, par ailleurs sur l'extension partielle du régime de contrôle des entreprises de prêt hypothécaire, A.R. n° 3, art. 15. et la réponse du Ministre des Affaires Economiques à la question de M. Knoops n° 113 du 15 janvier 1 981 (Bull. Q.R. ch., p. 1496) (227) Loi 8 août 1980, art. 92, § 1~, 20. (228) Chapitres Ill et IV.
467
468
juillet 1975 (229) et rendu applicable à la C.G.E.R. par l'arrêté royal du 1 5 avril 1977 (230). On se limitera à (229) Telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 9 juin 1981 (Mon. 24 juin) pour tenir compte de la directive du 5 mars 1979 relative à l'assurance-vie (voir également le régime de contrôle de la caisse d'assurances - accidents du travail).
(230) Voy. sur ce régime, Claassens, H., Le contrôle généralisé des entreprises d'assurances en Belgique, Bulletin des Assurances, 1976.
relever les modifications principales résultant de la réforme de la C.G.E.R. en dehors des transformations de ses modes de gestion et de réalisation de ses activités (231 ). (231)
35. Le régime d'activité des caisses de retraite et d'assurances est modifié sur deux points. Consécutivement à la transformation du régime de la Caisse d'épargne, le placement des actifs disponibles des caisses de retraite et d'assurances est réglé par renvoi à la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances sur la vie (232). Le second est plus fondamental. La réglementation applicable à la Caisse d'épargne pour les prises de participations et parts dans des institutions de crédit ou financières et pour les reprises totales ou partielles de leurs activités (233) est étendue aux autres caisses (234). Le but est de prévenir que les opérations qui n'auraient pas été permises à la Caisse d'épargne soient réalisées par les autres caisses (235).
36. Chacune des caisses de retraite, d'assurances et de rentes-accidents du travail doit avoir une comptabilité et des comptes annuels distincts comportant des fonds de réserves propres. Ce principe énoncé dans la loi organique de la C.G.E.R. confirme des obligations résultant déjà des législations et des réglementations applicables aux activités menées par ces caisses. Au reste, il ne porte pas préjudice aux règles particulières découlant de ces législations et réglementations qui comportent des régimes plus détaillés (236). En outre, des comptes annuels globaux doivent être établis pour l'ensemble des caisses de retraite, d'assurances et de rentes - accidents du travail et, pareillement à ce qui vaut pour la Caisse d'épargne (237), doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce et être transmis par celui-ci à la Centrale des Bilans (238). Le contrôle des comptes des caisses de retraite, d'assurances et de rentes-accidents du travail est confié à un ou plusieurs reviseurs. Ceux-ci sont désignés conformément aux règles valant pour les associations d'assurances mutuelles en vertu de la loi de contrôle
(?4/1981
Voir supra, n° 1 7.
(232) Art. 63, al. 1~ nouveau.
(233) Voy. supra, n° 2 7. (234) Art. 63, al. 2 nouveau.
(235) Rapport au Roi, Mon. 8 janvier, p. 115.
(236) Art. 6, al. 2 nouveau.
(237) Voy. supra, n° 32.
(238) Art. 67 nouveau.
des assurances (239). Il doit cependant s'agir de reviseurs d'entreprises (240). Leur fonction est définie par référence à la réglementation des assurances. Celle-ci prévoyait bien l'extension aux organismes publics d'assurances, tels que la C.G.E.R., de la surveillance de l'Office de contrôle des Assurances (241) mais n'avait pas prévu la désignation d'un commissaire agréé auprès de ces institutions. Sans doute, en vertu de la loi du 16 mars 1954 relatif au contrôle de certains organismes d'intérêt public (242), ces organismes se voyaient désigner un reviseur. Encore était-ce pour les besoins du contrôle administratif et non pour l'application spécifique de la réglementation sur les assurances. Aussi l'arrêté royal n° 3 a-t-il modifié la loi de 1954 pour dispenser la C.G.E.R. d'avoir des reviseurs au sens de cette législation (243). Contrairement à ce qui vaut pour la Caisse d'épargne (244), les autres caisses restent soumises au contrôle de la Cour des Comptes comme, d'ailleurs, à toutes les dispositions de la loi de 1954 à l'exception de l'article 11 relatif aux cadres et statuts du personnel et de l'article 1 3 qu'on vient d'évoquer. Les travaux préparatoires de la loi de 1980 sont muets sur cette différence. Si l'on peut se l'expliquer par l'accent mis sur l'égalisation des situations de la Caisse d'épargne et des banques privées, ainsi que par une revendication ancienne des institutions publiques de crédit soumises à la loi de 1954, il n'est pas interdit d'y trouver une justification dans la circonstance que plusieurs des autres caisses gèrent des fonds provenant des budgets de l'Etat et des organismes de sécurité sociale.
VI. Conclusions
3 7. Né d'une idée politique ancienne débouchant dans un compromis politique non motivé et discuté au Parlement de manière peu explicite, sans au reste qu'il ait donné lieu à un réel débat sur le plan économique, l'élargissement à toute l'activité bancaire des fonctions de la Caisse d'épargne de la C.G.E.R. n'a pas plus soulevé de vraies objections que de véritables enthousiasmes. Traduite dans la loi du 8 août 1980 sous la forme de principes généraux d'organisation, de fonctionnement et de contrôle, combinant les règles du service public et celles qui valent pour les banques privées avec qui la Caisse d'épargne est placeé en concurrence, la réforme conduit à l'apparition potentielle d'une nouvelle grande banque - mais de droit publique - à côté des grandes banques privées. Pour une part, c'est la consécration des faits, même si
1?4/1981
(239) Loi du 9 juillet 1 9 7 5. art. 8, al. 3, 5 et 6. (240) Voir les termes de l'art. 6, al. 2 précité et la réponse du Ministre des Finances à la question n' 1 09 de M. Knoops (Bull. O.R. Ch. p. 1832). (241) Loi du 9 juillet 1975, art. 2, § 3, 2°. (242) Art. 13.
(243) Art. 3 pris en vertu de la loi du 8 août 1980, art. 92, § 5. (244) Voy. supra, n' 32.
469
470
toutes les activités anciennes de la Caisse n'avaient pas une poids égal à ce qui peut être attendu. Pour une autre, qui concerne les activités internationales et interbancaires, il s'agit d'une évolution à tout prendre fort normale compte tenu du développement acquis par l'institution et de la taille qui est la sienne. Savoir si cette transformation du cadre juridique sera traduite rapidement dans les faits est une question à laquelle personne, sans doute, ne peut répondre. Le développement futur de la Caisse d'épargne sera, en effet, tributaire de la contrainte des réalités plus que de la permission des textes. Ceux-ci expriment la volonté du législateur que l'extension et la diversification des activités de la Caisse d'épargne se fassent dans le respect des normes qui s'imposent aux établissements de crédit à large, rayonnement national et international. Les projets exprimés par les dirigeants de l'établissement manifestent leur volonté de s'inscrire de manière dynamique dans cette voie, pour que la réforme d'une institution au passé fécond la rende encore plus utile à l'économie et au besoins de toute la population.
38. La transformation des modes et règles de gestion et de contrôle de la C.G.E.R. est inspirée par la même préoccupation. Compte tenu des options du législateur et, tout autant, du respect qui s'imposait à l'égard d'une institution polyvalente et diverse, la définition des responsabilités d'impulsion, de gestion et de contrôle ne pouvait se faire qu'au prix d'une certaine complexité. Il n'est pas interdit de penser que les termes de référence nationaux et communautaires utilisés à cette fin.loin de dévaloriser un service public à l'histoire prestigieuse et à la fonction importante,lui apportent des possibilités de conduire, avec cette autonomie accrue indispensable à une bonne gestion et qu'elle réclamait sur nombre de points, un développement progressif de ses activités et de son organisation. Il n'est pas non plus à exclure que l'extension du rôle de la Caisse d'épargne entraîne, indirectement, celle de ses fonctions d'assureur, aujourd'hui moins importantes. La scission des fonctions de gestion de ces deux activités peut être, à cet égard, un stimulant. Cet effet indirect, que le pouvoir politique ne semble pas avoir considéré, au départ du moins, ne serait pas un mince paradox.
39. Cette réforme, qui n'a ni un caractère radical ni une portée simplement formelle, constitue une étape dans la modernisation sans cesse à reprendre de l'appareil financier de notre pays. Elle comporte à
LF4/1981
terme, une activation de la concurrence tant à l'intérieur de secteur public qu'avec le secteur privé. Au moment où la situation économique pénalise les institutions immobiles et rend chaque jour plus complexe la gestion de celles qui sont dynamiques, il est profitable que soient réexaminées et réaménagées l'organisation et les activités du secteur du crédit de façon à prévenir ce qui peut le menacer et à mobiliser les forces qu'il comporte. Il est à souhaiter qu'au travers des inévitables compromis qu'elle suppose au niveau national. comme dans les enceintes européennes et internationales, cette œuvre prenne en compte l'importance croissante qui s'attache, dans nos économies et nos sociétés, à ce que le système financier soit actif, ouvert et assuré.
(p 4/1981 471
472
le grand de la P.hoto fait progresser la photocopie.
Kodak lance en Europe les nouveaux copieurs de bureau Ektaprint. La mise au point de cette nouvelle génération de copieurs résulte d'un siècle d'expérience en techniques de reproduction. Et Kodak a su, en outre, mettre largement à prof,t les progrès rapides du micro-processing.
Chaque phase du développement de son projet a permis à Kodak de mieux rencontrer vos besoins en matière de copies. Le résultat se traduit par une série d'innovations au point de vue de la qualité, de la
productivité (70 copies par minute), de la facilité d'utilisation et de /'efficience du service.
Ceci est valable tant pour les entreprises que pour les services publics. Larges possibilités d'utilisation et fiabilité inconnue à ce Jour caractérisent cette nouvelle génération de copieurs de bureau Kodak Ektaprint.
Pour toutes informations: KODAK S.A.Division Copy Products - Steenstraat 20 -1800 Vilvoorde - Tél. 02/267/8.00. Ext. 315.
NI Kodak Ektaprint Copier-Duplicators. /!image de pointe de Kodak.
KODAK et EKTAPRJNT sont des m<lrques déposées.
[? 4/1981
Elektronisch debet en cheque-inhouding n
door Raoul Deplancke
Kortrijk 1923. Procuratiehouder bij de Kredietbank. Verantwoordelijke voor het Beleid van de Centrale Afdeling Binnenlands Betalingsverkeer.
lnhoud: 1 Definitie 2 Hoe kwmn de cheque - inhouding tot stand 2. 1 De omgeving 2.2 Moeilijkheden die moesten worden overwonnen 2.3 De beslissing 3 Hoe werkt het syateem 3.1 Een fundamentele verandering 3. 2 De werking 3. 3 De deelnemers 3.4 Evolutie van het aantal verrichtingen en het limietbedrag 3.5 Kostenverrekening 3.6 Opzoekingen en betwistingen 4 Evaluatie van het systeem 5 Ui1bntidingen van het syateem 6 Besluit
1 Definitie Binnen de financiële sector in België behoort de term « cheque-inhouding » (1) tot het dagelijks gebruik en elkeen is vertrouwd met de inhoud van het begrip. Daarbuiten is de betekenis ervan begrijpelijkerwijs veel minder duidelijk. Met « cheque-inhouding » wordt bedoeld : het incasseren van een cheque volgens een procedure die bestaat in het louter doorgeven op een magnetische informatiedrager van de essentiële gegevens nodig voor het incasseren en debiteren van de cheque terwijl
[?4/1981
(') Een artikel dat deel uitmaakt van de artikelenreeks over de telematica in de Belgische financiële sektor.
(1) ln het Frans « non«hange de chèque». 1 n het Engels « cheque-truncation ».
473
474
de fysische cheque zelf wordt ingehouden op het eerste punt waar hij in de financiële sector wordt ingegeven. Met andere woorden; door het kantoor van de financiële instelling waar de ingifte ter incasso gebeurt worden de gegevens van de cheques door computerverwerking op magneetband gebracht. De magneetband wordt bezorgd aan het UCV (2) die de gegevens uitsplitst over verschillende magneetbanden bestemd voor de financiële instellingen waarop de cheques werden getrokken. Aan de hand van deze magneetbanden worden de uitschrijvers van de cheques op rekening gedebiteerd. De fysische cheques worden gearchiveerd door de financiële instelling bij dewelke zij werden ingegeven. Hierop wordt verder uitvoeriger ingegaan.
2 Hoe kwam de « cheque-inhouding »
tot stand
2.1 De omgeving Bij het einde van de jaren zestig begon een sterke stijging van het aantal bankverrichtingen, in een niet geringe mate te wijten aan de groeiende girale loonbetalingen, die een vulgarisering van het aantal zichtrekeningen met zich bracht. Op deze expansie kwam zich de toename enten van het chequegebruik veroorzaakt door het succes van de chequegarantiekaarten die na korte tijd werden vervangen door de Eurocheque-garantiekaart. De bijval van de Eurocheque versterkt het groeiritme van het aantal zichtrekeningen en het chequegebruik. Het aantal door de ban ken uitgereikte cheques stijgt tussen 1965 en 1975 jaarlijks met ± 25 %.
Uit9ereikte cheques
Jaar Aantal (in miljoenen)
1969 27,1 1970 36,4 1971 42,1 1972 57,3 1973 68,4 1974 76,3 1975 81,3
Bron : Bel9ische Vereni9in9 der Banken, jaarversla9 1976.
(p 4/ 1981
Toename (in%)
-+ 34,3 + 15,7 + 36,1 + 19,4 + 11,5 + 6,6
(2) u.c.v. = Uitwisselin9scentrum voor te verrekenen Verrichtin9en. Zie artikel « Het U.C.V. : huidi9e toestand en toekomstperspectieven »
van B. Lietaer. blz. 79 en vol9ende in nr 1-1980 van dit tijdschrift.
ln diezelfde periode beginnen de openbare kredietinstellingen en de privé-spaarkassen pas goed actief te worden op het terrein dat voordien uitsluitend betreden werd door de banken. Dit verhoogt nog meer het aantal in omloop gebrachte cheques en meteen het aantal partners betrakken bij de interbancaire cheque-uitwisseling in de Verrekenkamers vooral deze te Brussel, waar het uitwisselingsvolume voor cheques om de 2 / 3 jaar verdubbelde. Deze snelle volumetoename veraorzaakte moeilijkheden in de diensten van de Nationale Bank die traditioneel instond voor het verplaatsen van de uit te wisselen cheques van de ene Verrekenkamer naar de andere. ln 1971 maakt de Nationale Bank een einde aan deze dienstverlening behalve in het geval de betrakken banken elkaar in geen enkele Verrekenkamer ontmoeten.
ln die periode stijgen de loonkosten zeer snel en graeit het aantal cheques voor kleine bedragen (lager dan F 500) verontrustend snel tot meer dan 25 % van het totaal aantal. De Nationale Bank maakt zich samen met de financiële instellingen ongerust over deze situatie vooral vanaf einde 1973. lnmiddels waren sinds 1969 een aantal directieleden van de bijzonderste banken, in het raam van de Belgische Vereniging der Ban ken en gesteund door de Nationale Bank, bezig met een onderzoek om na te gaan hoe de individuele automatiseringsplannen van de financiële instellingen konden worden gecoordineerd en volgens gemeenschappelijke krachtlijnen konden worden ontwikkeld. De twee hoofdprincipes die werden weerhouden waren de volgende : - het transport van papier moet zo dicht mogelijk bij de bran van de verrichting worden gestopt - de verrichting moet worden uitgevoerd op basis van de gegevens die zo dicht mogelijk bij de bran volledig en op een gecontraleerde wijze op een automatische verwerkbare gegevendrager worden opgenomen.
Ter voorbereiding van de concretisering van deze principes werden vanaf 1970 door alle financiële instellingen in België overeenkomsten ondertekend ter normalisering van de basiselementen nodig voor een onderlinge electranische uitwisseling (3). Om het hoofd te bieden aan de snelle graei van het aantal uit te wisselen cheques en om dit volume te
(p 4/1981
(3) Zie artikel : La télématique financière en Belgique " van J. Rega, blz. 291 in nr 3-1 981 van dit tijdschrift.
475
H6
kunnen verwerken binnen de gestelde korte tijdslimieten konden de banken dus kiezen tussen volgende drie oplossingen :
een klassieke reorganisatie van de Verrekenkamer met inzet van bijkomende middelen : personeel, ruimte, machines voor het tellen en sorteren, enz.
het indijken van het chequevolume door het penaliseren van de cheques uitgeschreven voor kleine bedragen
het automatiseren van de uitwisselingen tussen de banken volgens de hierboven aangehaalde principes.
ln juni 1973 werd besloten de toepasbaarheid van de laatste oplossing ni. de cheque-inhouding te onderzoeken.
2.2 Moeilijkheden die moesten worden overwonnen De moeilijkheden die moesten worden overwonnen kunnen worden ingedeeld in twee groepen :
deze met een louter psychologische en praktische inslag
deze met een juridisch en wettelijk karakter.
Psychologische en praktische moeilijkheden Vooreerst was er de natuurlijke weerstand van de mens tegen elke vernieuwing, in dit geval nog versterkt door het feit dat een vertrouwd document dat door de mens leesbaar is, en aan wettelijk bepaalde vormen beantwoordt, werd vervangen door een magnetische drager die enkel met een aangepaste apparatuur leesbaar is. Vervolgens was er de bezorgdheid van de ban ken om te vermijden dat de cliëntele zou worden lastig gevallen met veranderingen die tenslotte uitsluitend een intern probleem in de banksector moesten oplossen. Speciaal in dit verband moest worden bereikt dat :
de remittent even snel ais voorheen werd gecrediteerd
de mogelijkheid werd behouden om alle vragen van de gedebiteerde of gecrediteerde te beantwoorden binnen een redelijke termijn en om een fotocopie of uitzonderlijk de originele cheque voor te leggen wanneer dit nodig mocht zijn
de uitschrijver zo vlug mogelijk zou worden gedebiteerd en dezelfde informatie zou ontvangen ais voorheen
de kwaliteit van de gegeven informatie onveranderd zou blijven en zo mogelijk nog verbeterd zou worden door een vermindering van het aantal fouten.
lf 4/1981
Het derde probleem bestond erin dat enkele buitenlandse bedrijven na betaling hun cheques teruggezonden kregen. Door de cheque-inhouding werd deze praktijk onmogelijk. Deze gewoonte kon zonder veel moeite totaal worden uitgeroeid ook al omdat er zeer weinig gevallen bestonden.
Juridische en wettelijke problemen Hier dient een onderscheid gemaakt tussen het hoofdprobleem ni. het niet-nazien van de handtekening van de uitschrijver van de cheque en een aantal aanverwante problemen.
a Nazien van de handtekening Het hoofdbezwaar tegen de invoering van de cheque-inhouding was de onmogelijkheid om de handtekening na te zien. Hierover werd lang en dikwijls geredetwist. Uiteindelijk werd de zaak ais volgt beslecht. ln feite was er geen juridisch probleem omdat de wet het nazicht van de handtekening niet verplicht. Wei is de betrokken bankier verantwoordelijk indien hij door het niet nazien, cheques betaalt die een duidelijk waarneembare valse handtekening dragen of onregelmatig of onvoldoende ondertekend zijn. Het volstond dus in een multilaterale overeenkomst te preciseren dat de betrokken bank verantwoordelijk bleef voor de geldigheid van de handtekening op de cheque ook al kon zij deze niet nazien omdat de cheque haar niet werd voorgelegd en dat de aanbiedende bank enkel moest nazien of de cheque inderdaad was ondertekend.
b Juridische nevenaspecten Andere juridische bepalingen leggen allerlei verplichtingen op die echter geen problemen stelden omdat de verplichtingen evengoed door de aanbiedende ais door de betrokken bank konden vervuld worden. Het was dus voldoende in diezelfde multilaterale overeenkomst vast te leggen wie voor wat verantwoordelijk was. Wij denken hier o.m. aan de verplichte vermeldingen op de cheque, de regelmatigheid van de endossementen, het kruisen van de cheque, het protesteren van de cheque, de kennisgeving van niet-betaling, e.a.
2.3 Beslissing Bij het einde van het onderzoek kwam men tot volgende vaststellingen :
Lf 4/1981 477
478
door de voorafgaande normalisaties was de nodige infra-structuur aanwezig om de cheque-inhouding in te voeren
door het ruim verspreid gebruik van de microfilmering was het mogelijk snel de ingehouden cheque te localiseren en inlichtingen te verstrekken op vraag van cliënten of voor eigen behoeften.
het was mogelijk de invoering van de cheque-inhouding gedeeltelijk te realiseren d.w.z. voor een beperkt aantal instellingen en deze groep geleidelijk uit te breiden. De toetreding tot het systeem kon dus facultatief gelaten worden.
de belangrijkste instellingen die ruim 80 % van het chequeverkeer voor hun rekening namen waren bereid van meet af aan aan het systeem deel te nemen en de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het niet nazien van de handtekeningen op zich te nemen. Vanzelfsprekend werd tijdens het onderzoek een evaluatie gemaakt van het risico en van de voordelen, maar toch bleef er een onzekerheid met betrekking tot onvoorspelbare en onmeetbare gevolgen. Niettemin werd in juni 1974 beslist in de loop van datzelfde jaar met de cheque-inhouding te starten, voorzichtigheidshalve beperkt tot cheques van maximum F 10.000.
3 Hoe werkt het systeen1
3.1 Fundamentele verandering ln de klassieke verrekenkamer was de uitwisseling van de informatie (op papier) gekoppeld aan de financiële afwikkeling van de operatie. · ln de nieuwe situatie wordt de informatie op magnetische dragers uitgewisseld in het UCV en worden enkel de totaalbedragen verkregen uit de UCV-verwerking financieel geregeld in de verrekenkamer. De uitwisseling van de informatie gaat vanzelfsprekend steeds de financiële vereffening vooraf. De gelijktijdigheid is echter verdwenen en men komt tot een losser tijdsverband, een a-synchronisme tussen de gegevensuitwisseling en de financiële vereffening van de operaties, hetgeen een veel soepeler werking toelaat.
De noties tijd en plaats zullen meer en meer aan invloed verliezen bij de uitwisseling van de informatie. De financiële vereffening blijft evenwel nog tijdsgebonden alleen al omwille van de nood aan een menselijke interventie voor het nemen van de uiteindelijke beslissingen.
(f 4/1981
3.2 De werking Een bank ontvangt van haar cliënt een aantal cheques ter incasso. De elementen nodig voor het incasso worden op terminal geregistreerd zijnde
het rekeningnummer van de uitschrijver (12 posities) - het bedrag (maximaal 6 posities) - de laatste 4 cijfers van het chequenummer (4 posities) - de aardcode van de cheque (1 positie). Bij de opname wordt automatisch gecontroleerd of de betrokken bank (eerste drie cijfers in het rekeningnummer) deelneemt aan het systeem van de cheque-inhouding. Zoniet wordt de cheque fysisch ter incasso aangeboden. Zo ja, worden de geregistreerde gegevens via computerverwerking op magneetband samengebracht en automatisch aangevuld met een aantal bijkomende gegevens nodig voor de verwerking. Het belangrijkste hierbij is het herkennings- en refertenummer waarop wij verder terugkomen. De magneetband wordt aan het UCV bezorgd met naleving van strikte veiligheidsregels. De verwerking van het UCV bestaat erin de binnengebrachte magneetbanden te lezen, de gegevens te hergroeperen per betrokken financiële instelling, en de cheque-gegevens op een magneetband per betrokken instelling over te schrijven. Eike deelnemende bank ontvangt de magneetband waarop de cheques voorkomen die op haar zijn getrokken met bovendien een borderel waarop o.m. de totalen voorkomen van deze cheques en ook van de cheques die zij zelf ter incasso op magneetband heeft ingegeven. De totalen van dit borderel worden dan overgenomen op het likwidatieblad in de klassieke verrekenkamer en aldaar financieel vereffend. De ingegeven magneetbanden worden naargelang het tijdstip van afgifte verwerkt tijdens de nachtverwerking of in de late voormiddag. Naast de magneetband worden door het UCV ook soepele schijven aanvaard ais invoerdragers. Het UCV levert ais uitvoerdragers magneetbanden of soepele schijven af maar ook debetberichten op papier aan financiële instellingen die voorlopig nog geen magnetische dragers kunnen verwerken maar toch bereid zijn op deze wijze de automatisering bij de andere instellingen niet te vertragen. Aan de hand van de ontvangen uitvoerdrager debiteert de betrokken bank uiteindelijk de rekening van de trekker (zie schematische voorstelling.
[?4/1981 479
480
ALGD1EEN Ol'GINIGAAM
1. Oleques in bezit van aanbiedende aangeslotene
2. Gegevens worden op automatische dragers gebracht
3. Overmaken aan u.c.v.
4. u.c.v. Brussel
5. Cheques gerangschikt per geadresseerde aangeslotene
6 .. Ovexmaken aan de gead.resseerde aangeslotene
7. Financiële instelling van de trekker
3.3 De deelnemers
inboeking debet
ELa::ncmsœ DEBET
De financiële instellingen die aan het systeem cheque-inhouding deelnemen kan men ais volgt indelen:
instellingen die de cheques op magnetische dragers aanbieden en dus actief deelnemen
instellingen die ais geadresseerden fungeren van magnetische dragers of debetberichten en dus passief aan het systeem deelnemen. Vanzelfsprekend zijn de actieve deelnemers gelijktijdig ook passieve deelnemers. ln onderstaande tabel vindt u de evolutie van het aantal deelnemende instellingen.
(é~ u'14119s1
inboekin debet
inboekin debet
ACTIEF PASSIEF
Op31/12 MB DISK MB DISK
1974 2 - 6 -1975 9 - 10 -1976 12 - 13 -1977 13 - 17 -1978 20 - 30 -1979 23 - 42 -1980 26 4 46 6
M B = l'nl!lgl'leetband DISK = QPlle schijf(vanaf 1.10.80)
3.4 Evolutie van het aantal verrichtingen en het limietbedrag Zoals hoger vermeld had men in 1974 uit voorzichtigheid tegenover onvoorziene repercussies de cheque-inhouding beperkt tot cheques van maximum F 10.000. Verrast door de enorme voordelen die aan het systeem waren verbonden werd dit limietbedrag snel opgevoerd tot F 2 5. 000. Naarmate de zekerheid groeide dat de winst die uit het systeem werd gehaald groter was dan het risico, werd het maximumbedrag nog verhoogd : tot F 50.000 op 5 mei 1978 tot F 100.000 op 5 mei 1981 Het aantal verrichtingen steeg naarmate het aantal actieve en passieve deelnemers toenam, naarmate het limietbedrag werd verhoogd maar ook ten gevolge van de toename van het chequegebruik.
Uit de hiernavolgende tabellen afkomstig uit het jaarverslag 1 980 van het UCV blijkt duidelijk dat de groei van het aantal UCV-verrichtingen de toename van het aantal verrekende cheques volledig heeft geneutraliseerd. Op dit ogenblik wordt ongeveer 85 % van de uitgewisselde cheques via het systeem cheque-inhouding verrekend.
(F 4/1981
D-bericht
-----25 25
481
482
Evolutie van de verrichtingen
Aantal cheques Kapitalen in miljoenen
Jaar
per jaar daggemid- per jaar daggemid-delde delde
1974 (1) 269.234 16.864 620 36 1975 16.669.904 66.414 35.783 143 1976 32.635.598 128.486 98.896 389 1977 43.433.102 173.732 141.639 567 1978 51.350.013 206.225 202.277 812 1979 64.687.600 259.790 287.016 1.153 1980 79.373.191 318.768 356.162 1.430
(1) Begin van de toepassing: 09.12. 74.
3.5 De kostenverrekening De verwerkingskosten in het UCV liggen per cheque uiterst laag ni. ongeveer 1 6 centiemen per cheque in 1980. Deze kosten worden voor de helft gedragen door de aanbieders en ontvangers van magnetische dragers. Omdat er anderzijds een onevenwicht bestaat per instelling tussen het aantal afgegeven cheques en het aantal ontvangen cheques en om te voorkomen dat een instelling veel vastleggingswerk zou moeten presteren zonder daaruit een evenredig voordeel te halen wordt de helft van de benaderende encodeerkosten door de ontvangende partijen betaald aan de aanbiedende partijen. De encodeerkosten worden om de twee jaar herzien en bedragen momenteel F 3. De facturatie van de werkingskosten en de encodeervergoeding verloopt volledig geautomatiseerd.
3.6 Opzoekingen en betwistingen Telkens een cheque in het systeem cheque-inhouding wordt ingebracht, wordt aan de opgenomen gegevens automatisch een herkennings- en refertenummer toegevoegd dat de chequegegevens vergezeld tot bij de bank van de trekker. Het herkenningsnummer identificeert de instelling die de cheque in het systeem heeft ingebracht terwijl het refertenummer (10 cijfers zonder bepaalde structuur) aan de instelling de mogelijkheid geeft de originele cheque vlug in haar archief terug te vinden of in haar microfilmeringsbestand een beeld van de cheque op te vragen.
[F 4/1981
Gemiddeld bedrag
percheque
2.305 2.147 3.030 3.261 3.939 4.437 4.487
EVOLUTIE VAN HET AANTAL VERREKENDE CHEQUES
EVOLUTION DU NOMBRE DE CHEQUES COMPENSES
( in miljoenen - en millions)
125 -------------+----------------- 125
100 ___ _
_ Totaal van de verrekende cheques Total dee c~ues compensés
Manuele verrekening Compensation manuelle
___ Verrekening via U.C.V.
Compensation via C.E.C.
75 -----+------+--
50 -+-----.-
25 / ,
/ • ,
I I
I 0
74 75 76 77 78
Bij opzoekingen en betwistingen volstaat doorgaans het voorleggen van een fotocopie van de cheque. ln gerechtszaken wordt nog wel de oorspronkelijke cheque ais bewijsstuk gevraagd. De meeste opzoekingen komen voort uit het feit dat de trekker de uitgifte van de
[?4/1981
100
75
50
25
·o 79 80
483
484
cheque niet noteert en zich de uitgifte niet meer herinnert bij de ontvangst van zijn rekeninguittreksel. Sommige banken rekenen voor dergelijke navragen terecht de reële kosten aan die niet te verwaarlozen zijn.
4 Evaluatie van het systeem Na bijna zeven jaar ervaring kan worden gezegd dat de cheque-inhouding meer heeft gegeven dan er werd van verwacht. Uit de grafiek op de vorige pagina blijkt dat de in 1974 gevreesde toename van de cheque-uitwisselingen van bij de start van de cheque-inhouding werd omgezet in een sterke daling van de manuele uitwisselingen. ln de volgende jaren was de uitbreiding van cheque-inhouding in staat de weerslag van de sterke stijging van het chequeverkeer op de manuele uitwisselingen te niet te doen en zelfs een vertraagde daling van deze uitwisselingen in stand te houden. De kostprijs van het incasseren van cheques is door de cheque-inhouding gevoelig gedaald zowel voor de aanbiedende ais voor de betrokken bank. Deze kostenvermindering in absolute cijfers uitdrukken is betrekkelijk moeilijk zoniet onmogelijk omdat zowel de oude ais de nieuwe werkmethodes van instelling tot instelling verschillen. Wei kan worden gesteld dat over het geheel van de operatie ongeveer 50 % kosten werden uitgespaard waarvan ± 2/3 bij de aanbiedende en 1 /3 bij de betrokken bank. De interne kostvermindering is per cheque relatief het grootst bij de betrokken bank. Bijkomend voordeel voor deze instelling is het feit dat de verzetslijsten automatisch kunnen nagezien worden.
Door de cheque-inhouding verhoogt de verwerkingssnelheid waaruit een tweevoudig voordeel wordt geput. De cheques worden doorgaans onmiddellijk op rekening gecrediteerd onder voorbehoud van betaling. De verhoogde incasseringssnelheid verkort de risico-periode omdat het uiteindelijk lot van de cheque vlugger gekend is. Bij de betrokken bank worden de verrekende cheques vlugger ingeboekt waardoor in het algemeen een beter balansinzicht wordt verkregen en een snellere exacte positieweergave van de cliëntenrekeningen tot stand komt wat een verhoogde veiligheid oplevert. Tenslotte is tengevolge van de eenmalig gecontroleerde vastlegging van de gegevens het aantal fouten en vergissingen tijdens de verwerking drastisch verminderd, en de winst die dit oplevert is onmeetbaar.
(f 4/1981
De gebreken van de cheque-inhouding zijn het gevolg van de nog niet overwonnen tijd- en plaatsgebondenheid van het UCV. Het UCV heeft sinds kort twee verwerkingsronden voor de ingehouden cheques hetgeen reeds een verbetering is tegenover de enige ronde van voorheen, maar toch blijven de banken verplicht hun invoerdragers voor de gestelde tijdslimieten af te geven. De organisaties van de banken zijn onvermijdelijk zeer verschillend waardoor ook het tijdstip waarop zij hun dagelijkse boekhoudingscyclus afsluiten van instelling tot instelling verschilt. Wanneer dit tijdstip niet past in het tijdsschema van het UCV ontstaat er een niet te vermijden vertraging van 24 uur en dit zowel bij de afgifte ais bij de ontvangst. Daarbij komt nog dat het UCV te Brussel werkzaam is en de magnetische invoerdragers uitsluitend te Brussel in de automatische verwerking kunnen ingebracht worden. Dit vormt een nadeel voor de instellingen die niet te Brussel gevestigd zijn. Zij moeten om de verwerking te bespoedigen de magnetische dragers per bezorger naar Brussel brengen of ze komen afhalen. De overhandiging van de magnetische dragers in de verrekenkamers in de provincie is mogelijk. Hierdoor wordt wel de verrekening van de invoerdragers bespoedigd maar de verwerking blijft vertraagd. De verrekening van de uitvoerdragers wordt niet bespoedigd en de verwerking evenmin. De vertraging is dubbel wanneer de cheque-inhouding gebeurt tussen twee instellingen zonder zetel te Brussel. Om aan deze gebreken te verhelpen wordt gewerkt aan een hervorming van het verwerkingssysteem van het ucv. Van een systeem met een strak uurrooster zou worden overgegaan naar een doorlopend systeem waarbij gedurende gans de dag invoerdragers zouden mogen afgegeven worden en de uitvoerdragers zouden worden geproduceerd op verzoek van de bestemmeling. Voeg daarbij dat in dit systeem ook de lijnverbinding ais in- en uitvoermedium zal worden voorzien en meteen is duidelijk dat de beperkingen van tijd en afstand uit de weg zijn geruimd. Blijft natuurlijk dater ergens een tijdstip zal moeten gesteld worden voor het afsluiten van de dagelijkse financiële verrekening. Dit tijdstip heeft echter geen invloed op de doorstroming van de informatie.
Een andere onvolkomenheid van het systeem ligt niet aan de cheque-inhouding ais dusdanig en ook niet aan het UCV maar wel aan het BCH (Bestuur der
~4/1981 485
486
Postchecks) dat tot nog toe niet heeft willen toestaan dat de duizenden postassignaties die dagelijks in het bankcircuit belanden via het cheque-inhoudingsysteem worden geïncasseerd.
5 Uitbreidingen van het systeem De cheque-inhouding werd sinds het ontstaan geregeld uitgebreid. Begonnen werd met de gewone genormaliseerde kliëntencheque uit een chequeboekje afgeleverd door de financiële instelling en uitgeschreven in België. Betrekkelijk vlug werd cheque-inhouding uitgebreid tot de eurocheques die door de Belgen in het buitenland worden uitgeschreven in deviezen en via een centraliserende Belgische bank worden geïncasseerd door de buitenlandse correspondenten. De verrekening door de centraliserende bank tegenover de bankier van de trekker gebeurt immers voor de tegenwaarde in Belgische frank. Via het systeem worden ook uitgewisseld :
de faktuurcheques (Colruyt-systeem) de verrichtingen op de biljetten-automaten van
Bancontact en M ister Cash de verrichtingen betaald via de
verkooppuntterminalen van dezelfde netten (bv. benzinepompen)
de circulaire cheques. Voorde toekomst worden nog andere uitbreidingen voorzien. Zo zijn er besprekingen aan de gang om de cheque-inhouding toe te passen op het wederzijds incasseren van eurocheques met Frankrijk. Dit zal dan niet verlopen via het UCV en de besprekingen kunnen nog wel een tijd in beslag nemen omdat er een aantal normaliseringen ontbreken die de realisatie in België heel wat vergemakkelijkt hebben. Zo is de struktuur van de rekeningnummers in Frankrijk niet genormaliseerd en is ook de codering van de financiële instellingen volgens heel andere basisregels opgebouwd. ln het binnenland wordt nog steeds gehoopt dat het Bestuur der Postchecks uiteindelijk zal inzien dat de opname van de postassignaties in het systeem van de cheque-inhouding onafwendbaar is en in het belang van iedereen.
6 Besluit België is het enige land ter wereld waar de cheque-inhouding bijna algemeen wordt toegepast. Slechts in enkele landen zijn er toepassingen in beperkte kring aan de gang maar de uitbreiding komt er zeer moeilijk op dreef.
(p 4/1981
Ais we naar de redenen peilen waarom de cheque-inhouding bij ons zo snel ingang heeft gevonden dan vinden wij in willekeurige volgorde de volgende:
vijf financiële instellingen vormen ongeveer 90 % van het chequeverkeer hetgeen de besprekingen vergemakkelijkt heeft;
er bestond een uitgebouwd verrekeningssysteem waarop nagenoeg alle financiële instellingen aangesloten waren;
veruit de meeste en belangrijkste financiële instellingen waren vertegenwoordigd in de verrekenkamer te Brussel, zodat met de start van het UCV en de cheque-inhouding op één plaats het gros van de uitwisselingen kon aangepakt worden;
een aantal basiselementen, zoals de struktuur van het rekeningnummer en de codering van de financiële instellingen waren genormaliseerd v66r de opbouw van de cheque-inhouding;
de kleine oppervlakte van het land waardoor nooit grote afstanden dienen overbrugd te worden en een gecentraliseerde verwerking mogelijk is.
De voornaamste reden van het welslagen lijkt ons nochtans te liggen in 1 een gezamenlijke wil om een bepaald doel te bereiken niettegenstaande de moeilijkheden (ook al waren zij niet zo groot ais eiders) 2 de louter technische aanpak van het project met de overtuiging dat heel de financiële sector er voordeel zou uit halen, maar zonder er zich om te bekommeren dat het voor de ene al wat groter kon zijn dan voor de andere. Onevenwichten konden achteraf door een passende tarifering gecompenseerd worden.
Sinds het invoeren van de cheque-inhouding in België komen delegaties op bezoek uit verschillende landen die de cheque-inhouding in eigen land wensen te realiseren. Zij hopen in België de oplossing te vinden voor hun problemen. Telkens blijkt dat zij inderdaad technische problemen hebben die wel wat moeilijker liggen dan bij ons, maar de fundamentele problemen lijken ons eerder van psychologische en menselijke aard te zijn. Het ontbreekt vooral aan wederzijds vertrouwen tussen de instellingen; er is commerciële naijver en achterdocht en in dit klimaat is een samenwerking en een vastberaden wil tot welslagen onmogelijk. Dank zij de samenwerking is de cheque-inhouding in België wel gelukt. De kosten van de cheque-verwerking heeft men
1?4/1981 487
488
daardoor aanzienlijk kunnen drukken en daarbij zijn niet alleen de financiële instellingen gebaat maar ook de cheque-gebruikers want de tarifering van het cheque-gebruik heeft men aldus tot nog toe kunnen afwenden.
~ 4/1981
Le Système Philips P4500: La distribution de l'informatique stimule l'homme et l'entreprise.
Le Philips P4500 est un système de gestion qui offre une nouvelle liberté d'action à ses utilisateurs. Dans n'importe quelle entreprise, il combine facilité d'utilisation et diffusion idéale des informations.
Claviers et écrans assurent, à tous les postes de travail, l'accès instantané aux données fournies par l'ordinateur. Les décisions peuvent être prises immédiatement, en toute connaissance de cause.
Le système Philips P4500 peut gérer, simultanément, jusqu'è. 32 applications différentes.
Des microprocesseurs ultra-rapides permettent de répondre à tous les besoins en matière de multiprogrammation, traitements transactionnel et par lots, communication de données. Le bon fonctionnement de l'ordinateur est contrôlé automatiquement. C'est un système souple, efficace et fiable. Un investissement qui, très vite, s'amortit lui-même par les économies qu'il permet de réaliser. Et dans sa configuration de base. il répond aussi aux nécessités des petites entreprises. Vous devriez vous informer.
Data Systems
(F 4/1981
• Philips éclaire l'informatique
: BON Envoyez-moi, gratuitement et sans : engagement, votre documentation : relative au Système P4500 .
: Nom: _____________ _
: Société: ____________ _
: Fonction:: ____________ _
Adresse: __________ _
Code postal: ______ _
Localité: _______ _
N° de téléphone: ____ _
«Bon)i à retourner à Philips Data Systems, 1, boulevard Anspach, bte 7, 1000 Bruxelles
PHILIPS
489
490
Au cœur de Bruxelles Trait d'union bancaire idéal entre la Belgique et le Continent Africain
BELGOLAISE Cantersteen 1 1 000 Bruxelles
Téléphone : (02) 513 38 90 Télex : 21375
Depuis 1909, spécialisée dans les relations avec /'Afrique, les Républiques du Zaire, du Burundi
et du Rwanda en particulier, la Be/go/aise met à votre service une expérience unique des affaires
africaines, les meilleurs contacts dans le monde entier.
Quels que soient les problèmes qui se posent à vous, du moindre au plus important, la Be/go/aise
vous assure en permanence le concours avisé des spécialistes les plus qualifiés.
N'hésitez jamais à la consulter.
ANVERS BRUXELLES LONDRES
Accueil personnalisé.
rP 4/1981
C Q.) +-' .c u ~
"'C ~
0 0 > ...........
en Q.) u C ~
'-Q.) '+c 0 u
De l'épargne à l'emploi: Propositions d'économie financière
par Henri Neuman (1)
Braine-le-Comte 1 91 7. Docteur en Droit (1940) et Licencié en Notariat (1 941) de l'Université Libre de Bruxelles. Professeur ordinaire de cette Université; Président de la Société Nationale d'investissement (S.N.I.) et de la Société Belge d' Investissement International (S.B.I.). Nombreuses conférences et publications, notamment « Traité d'Economie Financière -De l'Epargne à l'Emploi » P.U.F., (Paris 1980). Adresse professionnelle : rue Montoyer, 63 - 1040 Bruxelles.
Avant-propos Nous avons été empêchés, pour des raisons techniques, de publier, jusqu'ici, la conférence prononcée, en 1980, par Henri Neuman, sous l'égide de notre Centre, à l'occasion de la présentation de son Traité d'Economie financière « De /'Epargne à l'Emploi», publié par les Presses Universitaires de France. Eu égard à /'actualité des analyses et propositions formulées, nous avons estimé opportun de la publier dans la présente livraison.
1 Le contexte national et international 1.1 La croissance des revenus des démocraties industrielles européennes, durant les « golden sixties », a oblitéré, dans certains milieux et dans certains esprits, des évidences élémentaires. L'Etat, l'emploi et la Sécurité sociale reposent sur l'économie productive, de statut privé, public ou mixte. En fin de compte, c'est l'appareil de production ainsi que ses gérants et ses collaborateurs qui secrètent les moyens des Etats ainsi que de la condition, de la culture, des loisirs et des libertés de ses citoyens. Sans entreprises vivaces et sans investissements productifs et rentables,
(p 4/1981
(1) Cf., du même auteur, « Traité d'Economie financière - De !'Epargne à l'Emploi». Le financement des investissements, préface de H. Simonet, Presses Universitaires de France, Paris, 1980. Les textes placés entre guillemets, sans indication de référence, sont extraits de ce Traité.
491
492
régression des emplois durables, de la Sécurité sociale, des recettes fiscales et de change. Sans esprit et volonté d'entreprise et donc, sans entrepreneurs, gérants, cadres et autres travailleurs motivés, expansion du chômage, pénurie de finance et accroissement des charges publiques, de la fiscalité et de l'endettement public. Sans épargne, fertilisée en capital risqué dans une économie productrice de biens et/ ou de services commercialisables, affaissement de celle-ci et, dès lors, de l'emploi, de l'assiette fiscale, des recettes en devises et des réserves de change.
1.2 Cette approche interne doit être élargie au plan international. Le renouvellement permanent, devenu vital, des structures productives doit être ouvert sur le monde et adapté aux grandes mutations, qui s'y accélèrent. A. Toffler (2), les Rapports du « Club de Rome » (3) et du groupe « lnterfuturs » (4) les ont notamment mis en relief. Par exemple, quelles que soient les mesures d'utilisation rationnelle et d'économie de l'énergie, dont beaucoup trop demeurent à réaliser, la plupart des pays de la C.E.E., dont le nôtre, resteront dépendants de l'étranger dans ce secteur, jusqu'à la production généralisée d'énergies nouvelles et renouvelables. Cela n'est guère prévisible demain alors que le montant de la facture pétrolière s'est multiplié d'environ 20 fois depuis 1973. De plus, nous dépendons et dépendrons de l'étranger pour maintes autres importations « obligées » de matières de base et pour de multiples exportations nécessaires à nos activités et à notre emploi.
La revendication par les pays désavantagés d'un nouvel ordre, économique et social, mondial moins injuste et plus équilibré qu'aujourd'hui, est un fait politique majeur. Dans la ligne de cette aspiration légitime, les nations du Tiers Monde créent de nouveaux marchés, ouverts aux pays industrialisés mais aussi des outils qui concurrencent, voire menacent, nos productions traditionnelles. La compétition, non seulement des nations industrielles les plus avancées mais aussi des pays dits « nouvellement industrialisés » ou « en émergence »,
devient de plus en plus âpre. Le plein emploi de nos forces de travail implique l'ajustement constant de nos attitudes, de nos politiques et de nos structures à ces évolutions bouleversantes.
1.3 Au regard des illusions, nées de la croissance
[p 4/1981
(2) A. Toffler: « The Eco-spasm report : Why our economy is running out of control », Bantam, 1975. (3) Mesarovic, Mihajlo & Pestel : 2• Rapport « Stratégie pour demain », Paris, Seuil, 1974; Gabor, Dennis & Colombo : 4• Rapport : « Sortir de l'ère du gaspillage », Paris, Dunod, 1978; Tinbergen, 3• Rapport : « Nord-Sud, du défi au dialogue? », Paris, Dunod, 1979. (4) « lnterfuturs, Face aux Futurs, pour une maîtrise du vraisemblable et une gestion de l'imprévisible», I
Paris, OCDE, 1979.
1
des années soixante, les difficultés à affronter par les démocraties industrielles se sont ainsi multipliées et durcies. Si de nombreuses activités demeurent performantes, beaucoup d'autres sont ébranlées, condamnées ou détruites. Des secteurs entiers, comme la sidérurgie, le textile et les chantiers navals, sont atteints. Le taux de mortalité des entreprises et leurs appels à l'Etat traduisent cette seconde constatation. Le chômage s'étend et devient structurel. Le coût des importations d'énergie et des produits de base va croissant. Les taux de change et d'intérêt subissent des soubresauts qui affectent les activités, les prévisions et les investissements des entreprises. Le coût, élevé et fluctuant, des capitaux bride leurs initiatives, altère leurs budgets et devient prohibitif. La balance des paiements extérieurs devient déficitaire. L'inflation sévit partout, bien qu'à des degrés divers. Les caisses de l'Etat et de la Sécurité sociale se vident en dépit d'une fiscalité, de cotisations et de contrôles plus lourds. Cela explique, mais sans le justifier, le développement des évasions à l'étranger et des activités économiques « parallèles », conçues pour éviter frauduleusement les conséquences de cet alourdissement et de la multitude des formalités et des surveillances. Ces circuits parallèles croissent dans certains pays, branches ou régions au point de devenir des éléments vitaux de leurs structures de production et d'emploi ...
Les innovations productives et ouvertes, qu'il faudrait multiplier, dans les secteurs de pointe et d'avenir, pour remplacer les activités périmées, demeurent insuffisantes et dispersées. D'autre part, maintes injustices sociales persistent tandis que d'habiles pressions ou constructions, financières ou commerciales, d'intérêt privé, tendent à reporter sur l'Etat les conséquences des difficultés ou du déficit d'entreprises, voire de secteurs industriels, d'emploi élevé. Cela conduit d'autres groupes à confiner, aussi, leurs revendications à une vision plus égocentrique et courte que globale, solidaire et à long terme. De mêmes, vues et intérêts particularistes freinent l'action des associations et des institutions publiques intereuropéennes ou internationales. La nécessité de sacrifices au nom de l'intérêt commun, est souvent proclamée mais n'est, trop fréquemment, acceptée que si le prix en est payé par les autres ou moyennant ce qui est appelé « un juste retour ».
Tel est, schématiquement, le contexte difficile auquel les pouvoirs publics des démocraties industrielles sont confrontés, dans une mesure variable selon les pays et
[f 4/1981 493
494
les régions. Et cela, malgré les forces considérables de travail et ae production de ces démocraties, leurs réserves et leurs niveaux de vie relativement élevés, leurs positions dominantes dans de nombreux domaines et, surtout, leur vaste patrimoine de savoir, de savoir-faire, d'intelligence formée, d'expérience, d'organisation et d'esprit de créativité et d'entreprise. Ce premier éclairage met en relief la nécessité, pour ces démocraties et pour l'Europe, de répondre à ces défis en valorisant ces atouts tant individuellement que par des actions convergentes, communes et solidaires.
2 Lignes générales de solutions 2.1 Sous l'angle financier, il faut souligner d'abord l'ampleur des investissements nécessaires pour assurer l'adaptation de notre appareil productif. Globalement, ces investissements doivent être couverts par l'épargne interne, complétée, s'il échet, par des apports extérieurs dans la mesure où leurs charges sont supportables. « Sur le plan qualitatif et ponctuel, les investissements doivent être financés par une épargne répondant, en forme, en durée et en nature, à leurs particularités. Investir à long terme avec du crédit court, c'est engendrer le désordre et l'inflation. Financer des innovations et des risques d'entreprises d'un rendement aléatoire ou différé, par des capitaux grevés de charges fixes et de remboursements prématurés, c'est produire des déséquilibres. S'endetter au-delà de sa capacité d'honorer ses emprunts et leurs charges, c'est anéantir sa solvabilité et son indépendance ».
De tels dangers menacent les Etats et les entreprises. Pour les éviter, une première priorité apparaît : celle de dépenser mieux et moins, pour former et acheminer une épargne suffisante vers les investissements directement productifs, requis par l'adaptation et la rénovation de l'économie, c'est-à-dire par un emploi durable. Les générations au pouvoir en ont le devoir à l'égard de celles, trop souvent désorientées, qui les suivent. A moins de puiser dans des réserves qui se tarissent, seules des activités rentables et des ventes, internes et externes, de biens et de services demandés peuvent procurer aux collectivités les ressources nécessaires pour couvrir durablement leurs dépenses et leurs engagements. A moins d'altérer les libertés et les conditions de vie, le nœud du problème est donc de promouvoir l'économie productive, les innovations et les initiatives créatrices, publiques, privées ou mixtes, répondant aux besoins et aux fins des communautés. Pour cela, je n'aperçois pas
[P 4/1981
d'autre voie que celle de valoriser l'entreprise et le capital risqué qui la sous-tend, le travail, l'épargne, l'innovation créatrice, l'amélioration de la productivité et l'adaptation des outils économiques et du commerce extérieur aux défis du temps. Cela me paraît la seule manière d' « atteindre, conjointement et durablement, les objectifs d'une société de progrès et de plein emploi optimum, sécurisée par des protections sociales, libérée par l'extension du temps libre et consciente de son interdépendance ainsi que de sa solidarité avec les autres sociétés, spécialement du Tiers Monde ».
2.2 Encore est-il moins malaisé de s'accorder sur de telles fins que de mobiliser et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour les atteindre ainsi que d'en payer le prix. La dure bataille du progrès économique et social ne peut être gagnée que sur le terrain, par des politiques imaginatives, clairvoyantes et courageuses ainsi que par des hommes qui acceptent de s'engager dans l'action audacieuse, dans le risque productif et dans l'effort tenace. N'étant que rarement des saints et des apôtres bâtisseurs, ces hommes doivent être motivés à tous les niveaux. Dès lors, au cœur du problème aussi, apparaissent plusieurs nécessités conjointes :
celle de fertiliser les virtualités humaines d'idéalisme, de participation, de civisme, de courage, de solidarité et de générosité;
celle de stimuler et de récompenser l'initiative et l'esprit d'entreprise, conciliés avec l'intérêt général;
celle de découvrir les moyens nécessaires aux rénovations créatrices ainsi qu'en faciliter la dispensation;
celle d'anéantir les privilèges et le parasitisme, injustes, les routines paresseuses et les laxités stériles. Et cela, dans l'économie tant publique que privée.
L'emploi et la Sécurité sociale ne peuvent être maintenus et améliorés, comme ils doivent l'être, que moyennant un Etat et un appareil productif maintenus crédibles et vigoureux par des gérants et par des collaborateurs dynamiques, motivés et responsables.
3 Propositions spécifiques Dans ce cadre général, les propositions spécifiques suivantes, plus faciles à énoncer qu'à appliquer, paraissent pouvoir être formulées, parmi beaucoup d'autres possibles.
3.1 Concernant l'Etat L'Etat est devenu l'employeur le plus important des
[?4/1981 495
496
démocraties industrielles. Prélevant et redistribuant jusqu'à plus de 50 % du produit national, il est au cœur des actions à mener sur le plan de l'économie financière. Là comme ailleurs, il faut s'en prendre aux causes profondes plutôt qu'aux symptômes. Partout l'exemple vient d'en haut. Cela met en relief la nécessité de maintenir ou de restaurer la fiabilité de toutes les branches de l'économie publique et de leur administration. Si un bon exercice de leur vocation conforte la démocratie, en revanche, leurs insuffisances, leurs doubles-emplois, leurs réglementations trop complexes ou excessives et leurs dépenses injustifiées la sapent ou la détruisent. De plus, les impôts consument leur support au-delà d'un seuil, déjà trop souvent atteint, voire dépassé. Qu'on l'accepte ou non, ils induisent alors des contribuables à une défense ressentie par eux comme légitime et, dès lors, à des évasions et à des fraudes, nuisibles à la communauté et à la justice sociale. Pour réprimer ces déviations, les Etats sont portés à instaurer, coûteusement, plus de formalités, de contrôles, de contraintes, de police administrative et de sanctions. Mais, poussées trop loin, de telles mesures manquent leur but et rapprochent des sociétés de police étatique. Elles gonflent aussi les dépenses, improductives, d'administration et de recherche de moyens d'évasion. Demeurons attentifs à ces cercles vicieux et à ces pièges. Pour les éviter, je n'aperçois guère d'autre politique générale que de contracter la hausse des dépenses et des prélèvements publics et parapublics, de les sélectionner et de les arbitrer selon leur utilité objective, d'améliorer leur productivité, d'adapter en conséquence les services publics et le statut de leurs agents, ainsi que de simplifier la fiscalité, les formalités et les contrôles administratifs, dans la plus large mesure possible.
Plus facile à flécher qu'à suivre, cette voie implique une réforme permanente qui, en démocratie, ne peut être fondée que sur l'information objective, sur la concertation préalable et sur l'acceptation des responsabilités qu'elle implique. En bonne gestion, le financement de l'Etat et du secteur public devrait être programmé et traduit en budgets, après un arbitrage concerté démocratiquement, des options, des priorités et des choix, à adapter aux recettes et aux moyens de les obtenir (5). Les charges et les prélèvements publics compressibles devraient être revus périodiquement en comparant leurs avantages à leurs coûts, directs et indirects. Les fonctions et les services publics devraient faire l'objet de mêmes adaptations périodiques, tendant à leur
(p 4/1961
(5) Le recours au « Planning, Programming, Budgeting System » (PPBS) ainsi qu'aux méthodes de « Rationalisation des choi> budgétaires » (RCB) et de « Cost-Benefits-Analyses », contribue à atteindre cet objectif.
productivité optimale. Malgré l'énorme difficulté de la tâche, la rénovation tant des structures et des procédures de l'Etat que du statut des fonctionnaires, de leur mobilité et de leurs motivations devrait donc devenir un objectif majeur. Tant au sein de l'Etat que des entreprises, les facilités et les routines ont la vie dure. La bureaucratie engendre plus de bureaucratie. Parkinson l'a souligné avec esprit en Occident. Krouchtchev l'a stigmatisé crûment à propos de l'URSS par une constatation applicable chez nous : « Les fainéants occupés se multiplient ». Puissions-nous avoir le courage d'y substituer, partout où ils prolifèrent, des travailleurs productifs et heureux parce que rendus plus responsables, intéressés, innovateurs et conscients de leur utilité.
3.2 Au niveau des entreprises privées et publiques Une seconde proposition d'économie financière concerne les entreprises tant publiques que privées ou mixtes. Leur vitalité, leur créativité et leur financement sont fonction de leurs marges bénéficiaires. A leur tour, celles-ci dépendent d'abord de facteurs internes, singulièrement l'efficacité, la créativité et le dynamisme des gérants et de leurs collaborateurs. Mais elles sont liées aussi à des facteurs externes, parmi lesquels leurs coûts de production, leurs conditions d'exploitation et de vente, ainsi que leur régime fiscal. Si ces marges bénéficiaires demeurent suffisantes, voire élevées, dans maintes activités non seulement dans des branches protégées mais même en première ligne de risque industriel, elles ont rétréci ou disparu dans beaucoup d'autres. Et cela, tantôt par des reconversions et des investissements insuffisants, tantôt par des déficiences de gestion ou de motivation, tantôt par l'aggravation de la concurrence, par un mauvais climat d'entreprise ou par un absentéisme élevé, tantôt par un effet de ciseaux, provenant d'une hausse des coûts de production plus élevée que celle des prix de vente possibles. Cette dernière distorsion a été aggravée récemment par la hausse du prix de l'énergie, de certaines matières premières et du crédit.
Fort heureusement, maintes entreprises, instituts de développement ou holdings, publics et privés, ont su et pu éviter cette anémie pernicieuse. Les voies suivies, souvent avec le support des Etats et des travailleurs, consistent en des innovations, en des reconversions ou rationalisations d'activités et/ ou de la gestion, en un émondage de productions ou de services sans avenir, en des regroupements, des fusions ou des absorptions,
(S LJ 4/1981 497
498
assurant des économies d'échelle ainsi qu'en une politique d'innovation sociale, d'information et de participation des collaborateurs. Si, cependant, de telles initiatives sont encore trop dispersées et clairsemées, c'est pour plusieurs motifs convergents. Elles comportent non seulement la prise de risques bien préparés et l'apport des capitaux nécessaires pour les couvrir, mais aussi des réductions et des recyclages d'activités et d'emplois, la fermeture de sièges et/ ou un déplacement de travailleurs. Or, les capitaux à risque se raréfient tandis que pareilles mutations suscitent des réactions de défense de positions acquises, la création d'emplois compensatoires étant insuffisante. Nous reviendrons sur les moyens de pallier ces deux déficiences.
Pour compléter ce diagnostic, constatons d'abord que le cisaillement des marges bénéficiaires affecte ou anéantit les entreprises non seulement gérées de façon césariste, médiocre ou trop intéressée, mais aussi de taille ou de moyens insuffisants, opérant dans des branches encombrées ou facilement concurrençables par des technologies plus avancées ou par des pays à salaires plus faibles. Qu'on le veuille ou non, à moins de les rationaliser, de le.s reconvertir ou de les regrouper valablement, ces dernières entreprises sont vouées au dépérissement. Les soutiens publics dispensés coûteusement, au coup par coup et sans plan d'ensemble, pour réduire ou étaler les conséquences désastreuses de leur fermeture, n'aboutissent en général qu'à retarder celle-ci. Souvent aussi, de tels supports compromettent de meilleures solutions et entraînent des effets pervers. Le « dumping » des produits ou des services de ces outils subsidiés en menace d'autres demeurés vivaces. En outre, les forces humaines et les deniers engagés de la sorte ne sont plus disponibles à d'autres fins plus fertiles. Les moyens financiers des Etats ne sont pas sans limite.
D'un côté, ces constatations conduisent à subordonner les soutiens publics à des programmes réalistes et à des concours efficaces, assurant des perspectives d'emplois durables et donc, de rentabilité des entreprises confortées. Elles impliquent aussi un climat et des mesures propices à l'économie productive et à sa reconversion permanente. Complétée par des initiatives de recyclage professionnel et de réorientation des exportations vers les produits et les marchés d'avenir, cette politique me paraît devenue un autre impératif. Elle devrait aller des incitants aux diverses phases des processus rénovateurs jusqu'à l'initiative publique directe, à l'intermédiaire d'instituts spécialisés dont
(F 4/1981
l'exercice optimal de la vocation serait assuré par un régime adéquat (6). En outre, elle devrait être rendue complémentaire et convergente à l'échelle internationale. Maints problèmes d'entreprises et de branches en difficultés ne peuvent être résolus durablement, au meilleur rapport rendement/ coût, que par une approche dépassant les frontières nationales et, a fortiori, régionales. A défaut, nous continuerons à subir les charges et les nuisances de mauvaises socialisations des risques.
3.3 Impératif et support de l'innovation économique Complexes, lentes et parsemées d'échecs inévitables, les innovations économiques ne sont ni spontanées ni sans risques. Comme l'a souligné l'A.N.V.A.R. (7), « il faut en propager le goût, en faire naître l'occasion, en aider le développement. L'innovation a besoin de conseils et de savoir-faire. Elle réclame des partenaires qui en partagent les risques financiers et s'évertuent patiemment à sa réussite, longtemps encore après l'apparition des premiers succès ». Ses filières comportent de multiples études et phases, où foisonnent incertitudes, obstacles et embûches. Maintes expériences ont montré combien il est léger et coûteux de brûler les étapes. La réponse au défi de l'innovation n'autorise ni la simplification ni la facilité, ni la critique, unilatérale et méprisante, de difficultés ou de certains insuccès inévitables. Les innovations les mieux préparées demeurent un pari sur l'avenir. Comme l'a dit P. Massé : « La croissance est une aventure calculée ».
Un rapport de l'OCDE a énoncé les conditions de succès d'une politique de rénovation. Je n'en citerai qu'un extrait. « Tout d'abord, les résultats des activités d'innovation sont incertains, aussi les risques pris doivent-ils être récompensés et les individus et les institutions doivent-ils pouvoir s'adapter à des situations nouvelles et imprévues. Ensuite, l'innovation implique souvent des modifications désagréables, pour lesquelles des pressions doivent exister et dont le coût social doit être réduit le plus possible. Enfin, le passage des connaissances technologiques se faisant principalement par l'intermédiaire de personnes, on doit encourager la mobilité et les contacts entre les personnes, aussi bien à l'intérieur des institutions qu'entre elles aux différentes étapes du processus d'innovation » (8). Des propositions peuvent être déduites de ces éclairages. En amont de l'innovation, les recherches fondamentales et appliquées ainsi que l'efficacité des organismes publics de leur valorisation (9) devraient être encouragées sélectivement par l'Etat. En aval, il
(? 4/1981
(6) Cet aspect sera traité sub 3, ci-après.
(7) Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (ANVAR), Rapport d" Activité 1 9 77, Dix Ans Neuilly s/ Seine, France.
(8) Cf. « Conditions de succès de l'innovation technologique •, Paris, OCDE, 1971. (9) Dits« ONVR », ces organismes (tels l'ANVAR en France et l'OPI en Belgique) ont les fonctions, plus ou moins larges selon les pays, de prospecter, sélectionner, promouvoir, protéger, développer et commercialiser les inventions de produits, de techniques ou de procédés valorisables ainsi que de promouvoir des synergies avec les entreprises et les secteurs économiques. Leur rayonnement et leur réussite dépendent non seulement des dotations dont les Etats les pourvoient mais surtout de leur statut et de leur régime d'administration et de gestion. Là aussi, le choix et la motivation de leurs administrateurs et collaborateurs sont essentiels.
499
500
devrait en être de même pour les opérateurs économiques qui concrétisent les innovations et pour les sociétés ou instituts publics, privés ou mixtes, en mesure soit de conseiller ces agents soit de promouvoir ou d'appuyer leurs initiatives, soit d'y participer en les finançant ou en s'y engageant, soit encore de les relayer ou de les prendre eux-mêmes. Concrètement, « le développement de sociétés privées agréées et des instituts publics de « venture capital » pourrait être encouragé de diverses manières : par des avantages fiscaux en faveur de leurs actionnaires; par la faculté de former des provisions pour risques en exemption d'impôts; par une participation à leurs dépenses et à leurs risques éligibles, ou à la couverture de ceux-ci, moyennant une procédure d'approbation générale ou ponctuelle; voire par des participations ou par des dotatfons publiques doilt l'usage serait déterminé et contrôlé ». Au niveau des entreprises innovatrices, des mécanismes similaires pourraient être instaurés. Complétés par des« lettres d'agrément de l'innovation » (France), par des primes, par des subventions d'intérêt, par des avals et par l'instauration de fonds de garantie (10), ils adouciraient les risques de projets agréés, jugés d'intérêt général. De telles dispositions et d'autres, déjà prises ou amorcées par certaines démocraties industrielles, devraient être accentuées et généralisées. Les expériences françaises, japonaises, allemandes et américaines notamment, devraient être étudiées en vue de la transposition « mutatis mutandis », de leurs résultats heureux. Par exemple, la qualité de l'innovation au Japon est attribuée notamment à la stimulation des initiatives aux échelons inférieurs et à des procédures de concertation ascendante (11 ).
3.4 Statut du capital risqué dans un intérêt public Sur le plan du financement, une anomalie doit être rappelée. Le traitement fiscal du capital-risque, apporté définitivement, est généralement plus rigoureux que celui des prêts remboursables. Cela pénalise tant les entreprises qui en ont besoin que ses apporteurs possibles. Logiquement, sa rémunération, espérée bien qu'aléatoire, devrait être égale à celle des prêts majorée d'une prime de risque et de congélation. Sinon, comment espérer l'alimentation en fonds propres des innovations et des entreprises privées ou publiques, créatrices, sans interventions ou subsides d'Etat? Qui plus est, les fruits incertains de ce capital, socialement indispensable, sont la cible de convoitises, de revendications et de prélèvements grandissants.
(p 4/1981
(10) Cf. notamment à ce sujet l'expérience en matière d crédit de la Caisse Nationale de Crédit Professionnel (CNCP) belge, et dans des domaines plus larges, du Crédit National français 222 et 255 du Traité précité).
(11) Cf. notamment O. Gélini « Comment va changer I" entreprise ? », Le Mond 20.4.1980.
Trop souvent, ceux-ci ne distinguent guère ni la nature industrielle, commerciale, financière, spéculative ou rentière des fonds engagés, ni leur utilité collective et sociale, ni les emplois qu'ils sauvegardent ou procurent. Si nécessaire soit-il de réduire les inégalités injustes de revenus, la pénalisation générale du capital-risque le fait fuir et se révèle néfaste aussi bien socialement qu'économiquement. L'appréciation et le statut fiscal des fruits du capital et des initiatives, servant l'intérêt public et renforçant l'appareil productif, devraient donc être réformés de façon à les stimuler. C'est un autre impératif d'économie financière.
3.5 Les entreprises publiques 3.5. 1 Expansion et importance Ce qui vaut pour le secteur privé devrait être appliqué aux entreprises publiques dont la multiplication et la croissance ont été spectaculaires dans les démocraties industrielles. Cette expansion, son coût ainsi que la variété des statuts et des missions de ces entreprises appellent la recherche de deux optimums : celui de l'exercice de leur vocation et celui de l'emploi de leurs moyens humains et financiers. A. Bizaguet a calculé ce qu'est devenu récemment, en chiffres bruts, le secteur des entreprises publiques européennes (1 2) : « Ses effectifs, qui dépassent actuellement 8.300.000 unités, sont passés de 8,3 % de l'ensemble des salariés de l'économie marchande non agricole de la C.E.E., en 1973, à 10 % en 1976 et à 11,9 % au début de 1980. La valeur ajoutée, qui mesure la vitesse de croissance, partant de 11 % en 1973 atteignait 12 % en 1976 et 13,2 % de la même économie marchande non agricole européenne pour l'exercice 1979. La formation brute de capital fixe, qui s'était consolidée dans les premières années de la crise pétrolière d'une manière plus forte encore, passant de 22 % en 1973 à 24 % en 1976, se maintenait encore, quoique ayant retrouvé dans son ensemble un rythme moins soutenu, pour le même exercice 1979, à 22,5 % de la F.B.C.F. de l'ensemble
(12) Exposé au Congrès International du C.E.E.P., Athènes, mai 1 981 .
des entreprises européennes (hors services non (13)
marchands et agriculture). Si on appliquait les mêmes critères aux branches
Si r on faisait - ce qui est certes très arbitraire, mais industrielles au sens large,
a-t-on d'autres systèmes ? - la moyenne arithmétique de c'est-à-dire comprenant
ces trois critères de l'emploi, de la production et de l'énergie, les mines, les , . . . transports et les
1 investissement qui caractérisent toute puissance communications et les
économique, on aboutirait pour les entreprises divers secteurs industriels
publiques à un pourcentage de 15,8 % de l'économie proprement dits, nous arriverions entre 20 et
européenne non agricole, soit entre le sixième et le 21 % de l'ensemble de
septième de cette économie (13). Or, nous avions cité ces branches.
les pourcentages de 13,8 % en 1973 et de 15,3 % en 1976 ».
[?4/1981 501
502
De plus, si ce développement s'est produit aux niveaux nationaux et régionaux, ici encore, le phénomène franchit les frontières. Les sociétés ou instituts internationaux, groupant des Etats et/ ou des entreprises publiques, se multiplient. Cette évolution a été remarquable spécialement en matière de financement des investissements et du développement (14).
3.5.2 Nécessité et conditions d'un exercice optimal de leur vocation A elles seules, ces données soulignent la nécessité d'un régime adéquat, si possible harmonisé, des entreprises publiques et de leurs relations avec les Etats tutélaires. Outre ses avantages budgétaires, la nécessité d'un tel régime est accentuée par plusieurs motifs concordants :
le contrepoids que des entreprises publiques bien conçues et gérées peuvent apporter aux insuffisances et aux risques d'excès du secteur privé, spécialement dans ses manifestations monopolistiques ou multinationales;
l'originalité de leur nature qui les conduit à concilier, d'une part, leurs fonctions d'agents économiques, soumis aux règles de la concurrence et de la rentabilité et, d'autre part, leur rôle d'instruments de l'Etat, attentifs à sa politique ainsi qu'à ses devoirs économiques et sociaux;
la contribution concrète qu'elles peuvent apporter à l'accomplissement de ces devoirs, notamment par leur capacité technique et leur potentiel d'innovation, par la valeur de leurs produits ou de leurs services et, dès lors, par leur support, direct et indirect, à l'emploi;
le risque de déformation de leurs missions par l'Etat en vue de résoudre les problèmes nés de la crise, à court terme et de façon dispersée plutôt que dans une perspective plus lointaine et globale;
le risque d'altération du statut de leurs collaborateurs et dirigeants, pour le rapprocher, par exemple, de celui, différent par nature, des fonctionnaires, en accentuant, du même coup, son infériorité par rapport aux régimes en vigueur dans les entreprises privées comparables;
les atteintes à l'efficacité et à la souplesse de gestion ainsi que les démotivations entraînées par de telles mesures.
Pour ces motifs et en raison de déviations trop fréquentes, il faudrait préciser, en une Charte européenne, les conditions optimales de l'exercice de la vocation des entreprises publiques. Ces conditions, définies dans les rapports et Congrès internationaux du C.E.E.P., sont, en résumé, les suivantes:
(p 4/1981
(14) Cf. par exemple, outre le groupe de la Banque Mondiale, la Banque Européenne d'investissement, la Banque Asiatique de Développement, la Banqu lnteraméricaine de Développement, la Banqu Centre-américaine d'intégration Economique la Banque Africaine de Développement, la Banqu de Développement de l'Afrique de l'Est, la Banque de Développem des Etats de l'Afrique Centrale, la Banque Ouest-Américaine de Développement des Caraïbes. Plus récemment les pays producteurs d'hydrocarbures disposan de réserves, ont appuyé certaines de ces institutions, en ont créé nouvelles ou participé à leur création, notamment le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social; le Fonds Islamique de Développement; I' « Arab Mining Company», le Fonds spécial de l'OPEP, Banque Arabe pour le Développement économique en Afrique.
(a) Les opérations et les initiatives des entreprises publiques doivent être conformes à la politique des pouvoirs publics mais au départ de missions ou d'objectifs clairement définis, voire publiés par ceux-ci. (b) Leur statut, ainsi que leurs moyens financiers, techniques et humains doivent être adaptés à ces missions et à ces objectifs de manière à maintenir leur équilibre et leur crédibilité. (c) Leur administration et leurs résultats doivent être contrôlés « a posteriori », et non « a priori », pour ne pas entraver ou retarder leurs opérations et leurs facultés créatrices. En contrepartie de cette autonomie, les gestionnaires doivent être responsables et fournir périodiquement des comptes et des rapports, fiables et transparents. (d) Leurs organes d'administration doivent être conçus en fonction de leurs missions particulières, des compétences requises pour les exercer ainsi que de l'efficacité et de la rapidité de leurs décisions. (e) Leur gestion interne doit être décentralisée sur la base participative de délégations de pouvoirs, assorties de responsabilités, à tous les niveaux. Les dirigeants et collaborateurs doivent être choisis sans interférence politique perverse, d'après leurs aptitudes professionnelles, caractérielles et psychologiques. Leur statut doit être assez motivant et mobile pour stimuler leur productivité, leur courage, leur créativité et leur esprit social.
L'application générale de ces règles dans la C.E.E. renforcerait non seulement, au moindre coût, le rôle économique et social des entreprises publiques mais encore la démocratie. C'est pourquoi il serait souhaitable que ces principes soient traduits dans une Charte européenne de !'Entreprise publique. L'adoption d'une telle charte par la Commission de la C.E.E. devrait conduire à la recommandation, voire à la directive, de son application par les Etats membres (15).
3.6 Les instituts publics d'investissement ou de développement Responsables finals du développement, les Etats ont créé des entreprises publiques non seulement de crédit mais aussi« d'investissement ou de développement», pour contribuer, notamment par l'apport de capitaux à risque, à l'adaptation et à la rénovation de leur appareil productif. La variété des contextes de création de ces instituts et de leurs missions explique celle de leurs facultés d'intervention, de leurs régimes et de leurs moyens. Selon les cas, ils sont ou deviennent des instruments, plus ou moins complémentaires et
(C~ li 411981
(15) Cela fut proposé lors du Congrès du Centre Européen de I' Entreprise Publique (CEEP), à Athènes, en mai 1 981 .
503
504
concurrentiels ou monopolistiques et privilégiés, de la politique des Etats. Dans les pays techniquement peu avancés, leur rôle est irremplaçable en vue de créer, d'entraîner, voire de gérer, des outils de production. Dans les démocraties industrielles, bien que leur création ait été controversée, leur utilité économique et sociale a été démontrée sur le terrain. Sans leur intervention, maintes entreprises n'auraient été ni adaptées ni créées et de multiples emplois auraient été perdus. Ces instituts (16) exercent des fonctions, souvent conjointes, soit de stimulation et d'accompagnement du secteur privé, soit d'initiative économique directe, soit de holding public. Ils peuvent aussi être chargés de missions spécifiques par l'Etat, qui en assume normalement la couverture.
Dans l'exercice de ces tâches, malaisées à démarquer en raison de leurs recoupements, ces instituts s'attachent à choisir des créneaux et des projets répondant aux besoins de rénovation de l'économie ainsi qu'aux programmes, voire aux mandements, des pouvoirs publics. Ils recherchent des synergies et des effets multiplicateurs par des associations, par la création de filiales spécialisées et par leur transformation progressive en groupes financiers et industriels. Ils s'efforcent aussi de concilier leurs objectifs d'intérêt général avec la sauvegarde des deniers publics dont ils ont la charge. Faut-il le dire, cette conciliation se révèle difficile, surtout en période de crise et de déficit des finances publiques. En effet, leur autonomie de décision et leur dynamisme peuvent être entravés, d'abord, par des déviations démagogiques du statut de leurs collaborateurs et de leurs dirigeants (1 7). Ils peuvent l'être aussi par des pressions en vue d'interventions dans des entreprises ou dans des branches en difficultés structurelles irrémédiables à moins de rénovations profondes, coûteuses et souvent aléatoires comme il a été dit. De plus, l'Etat impécunieux est porté à se décharger sur ces instituts d'une partie de ses problèmes de financement et à « débudgétiser », à leur intermédiaire, certains de ses engagements.
Les pays de la C.E.E. ont créé, aussi, des entités d'intérêt public spécialisées dans les investissements à l'étranger (18). Ces entités contribuent à des engrenages concrets de coopération avec les pays en développement. Appuyant, d'un côté, l'économie productive de ces pays, ils facilitent, de l'autre, des exportations nobles d'installations « produits et/ ou services en mains», de biens d'équipement et de
rP 4/1981
(16) Tels que I' lstituto per la Ricostruzione lndustriale (IRI) en Italie; l'Institut de Développement Industriel (IDI) en France, le National Enterprise Board (NEB) en Grande-Bretagne; la Société Nationale d'investissement (SNI) en Belgique.
(17) Comme il fut dit au Congrès du C.E.E.P. précité (Athènes 1981 ), ce régime doit être conçu de manière à maintenir et à stimuler leurs virtualités d'imagination, d'initiative, de créativité, de dynamisme et de performance. « On ne peut demander à des bureaucrates de devenir des entrepreneurs constructifs et des pionniers, engagés sur le terrain ... ».
(18) Ce sont notamment la Deutsche Entwicklungsgesellschaft (DEG) en Allemagne Fédérale; la Commonwealth Development Corporation (CDC) en Grande-Bretagne; la Caisse Centrale de Coopération Economique (CCCE) en France; la « Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden »
(FMO) aux Pays-Bas; le « lndustrialiseringsfondene for Udviklungslanden (IFU) » au Danemark; la Société Belge d' Investissement International (SBI) en Belgique.
savoir-faire des nations industrielles. Cette jonction d'intérêts bien compris explique les supports publics très généralement apportés à leurs opérations (19). Ces supports sont d'autant plus nécessaires et fructueux que les pays en développement subordonnent de plus en plus leurs achats croissants d'unités ou de complexes tout faits à un engagement, participatif et sécurisant, émanant des pays vendeurs. Or, il est rare que les entreprises d'ingénierie, de montage ou industrielles de ces pays puissent répondre, seules, à une telle exigence. C'est pourquoi des entités publiques spécialisées, ont été créées dans ce but.
L'utilité de ces deux catégories d'instituts a été mise en relief par la crise. Dans la mesure où leurs Etats tutélaires respectent les règles précitées d'un exercice optimal de leur vocation, leur bilan économique, financier et social se révèle largement positif. Les incidences, directes et dérivées, de leurs interventions sont, en effet, très marquées et favorables dans plusieurs domaines vitaux: les activités et la rénovation des structures productives, l'emploi, l'équilibre et la vitalité des régions, l'expansion des entreprises petites et moyennes, le produit national, les finances publiques, les relations économiques avec les pays tiers, les exportations et la balance des paiements. C'est pourquoi, un régime adéquat de ces instituts et le support public de leurs opérations apparaissent comme d'autres priorités d'économie financière.
3.7 Nécessité d'un institut public européen de développement Malgré le développement extraordinaire des échanges intracommunautaires, l'Europe de l'industrie et des régions ne prend corps qu'avec des horizons trop courts, dominés par plus de dispersions et d'égocentrismes que de ~onvergences concertées et programmées. Surplombant les entités précitées, uri institut public européen de développement pourrait devenir le levier et l'instrument de politiques et d'actions communes, comme cela fut proposé dans les congrès du Centre Européen de I' Entreprise Publique (CEEP). Au niveau mondial, la Société Financière Internationale (SFI), complète depuis longtemps le rôle de la Banque Mondiale et de l'Association Internationale de Développement (AID). Un tel outil manque dans la C.E.E. Cependant, il est devenu indispensable, à côté de la Banque Européenne d'investissement (BEI) et des autres agences communautaires de développement, avec lesquelles il collaborerait. Il devrait être chargé non
[p 4/1981
(19) Paradoxalement, ce n'est pas le cas en Belgique, malgré la dépendance particulière de notre pays à l'égard de ses exportations. Les rapports de la SBI mentionnent qu· elle a attiré, de façon insistante et répétée, l'attention des pouvoirs publics à ce sujet.
505
506
seulement de stimuler et d'appuyer les innovations et les entreprises dynamiques notamment par l'apport indispensable de capitaux à risque, mais aussi de prendre des initiatives propres, intégrant l'économique et le social. Dans ce cadre, ses missions pourraient être les suivantes : (a) Rechercher, promouvoir et financer des investissements directement productifs, régionaux mais d'intérêt européen, ou concernant plusieurs pays de la C.E.E. (b) Préparer la programmation, voire la planification, de la rénovation productive européenne dans des branches d'avenir (20) et dans toutes celles dont l'adaptation est d'utilité collective. (c) Susciter, faciliter, voire arbitrer, les rationalisations, groupements, fusions ou reconversions nécessaires dans les secteurs en difficultés ou menacés. (d) Améliorer l'utilité économique et sociale des investissements étrangers en Europe en s'associant, seul ou avec d'autres, aux entreprises étrangères ou multinationales qui y occupent ou veulent y occuper des positions dominantes dans des secteurs vitaux. (e) Appuyer et unir les forces des organismes nationaux de valorisation de la recherche (ONVR) et des instituts de développement nationaux ou régionaux, notamment par des opérations conjointes et par l'instauration de rapprochements ou de services communs. (f) Etayer, de la même manière, les opérations des entités publiques spécialisées dans l'investissement à l'étranger. Fertiliser, dans le domaine essentiel de l'économie productive, les accords de Lomé avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (A.C.P.).
Quant à ses moyens et à ses partenaires, la préparation d'un tel institut pourrait s'inspirer de l'expérience, déjà longue, tant des entreprises ou des groupes publics européens ou internationaux de développement (21) que des recommandations, précitées, résultant des travaux du Centre Européen de I' Entreprise Publique (CEEP). Sur de telles bases éprouvées, il serait possible de créer un instrument, solide et crédible, dont le rôle, entraînant, synergique et multiplicateur, favoriserait l'insertion harmonieuse et solidaire, de la C.E.E. dans un tissu mondial en mouvance accélérée mais périlleuse.
3.8 Pour une épargne humaine complétant l'épargne monétaire Pour couvrir les dépenses croissantes et assurer l'emploi optimal des communautés, il faut y mobiliser une
If 4/1981
(20) Dispersées, les nations et les régions d" Europe manqueraient le départ et l'arrivée dans la course ouverte par les grandes aventures technologiques du temps. Telles que citées dans le Rapport « lnterfuturs », celles-ci sont notamment: tous les complexes électromécaniques en ce compris la télématique et l'automatisation; la biologie et ses multiples applications; la production d'énergie et la substitution de nouvelles sources d'énergies primaires; l'utilisation des océans et des espaces.
(21) Tels que la Banque Européenne d'investissement (BEI) et le Groupe de la Banque Mondiale.
épargne non seulement monétaire mais aussi humaine. Le chômage et le sous-emploi, endémiques dans les pays en développement, croissent dangereusement dans les démocraties industrielles. Cette plaie y affecte tant des forces de travail peu qualifiées que des universitaires, des cadres et des travailleurs expérimentés. Et cela, alors que le Tiers Monde aspire aux transferts réels de formation, d'encadrement et de technologie requis par sa volonté d'ascension. Moyennant des initiatives appropriées, telles que l'assurance publique d'une continuité d'emploi des volontaires, maintes capacités humaines, inoccupées ou sous-employées dans les sociétés industrielles, pourraient être réorientées à des tâches productives vers les pays en développement. Chacun y trouverait son compte. Les vastes besoins de cette nature s'étendent et se renouvellent dans le Tiers Monde. Moyennant des recrutements judicieux, une telle assurance publique ne devrait donc jouer que rarement et temporairement. Son coût serait très largement compensé par des économies d'allocations de chômage et par les multiples retombées favorables d'une coopération, humaine et technique, plus poussée entre les pays industriels et les autres. Une telle proposition d'économie financière doit donc aussi être formulée.
3.9 Concours des investisseurs institutionnels aux risques d'entreprise et d'innovation Une source de financement de l'économie productive devrait aussi être trouvée dans le vaste secteur des investisseurs dits « institutionnels » (22), dont l'expansion des ressources a alourdi le poids dans les marchés financiers des démocraties industrielles. En Europe continentale, leurs placements sont orientés essentiellement selon des critères de sécurité de rentabilité régulière, de liquidité et de neutralité. D'autre part, les encadrements publics qui régissent ces placements sont inspirés surtout par la protection de leur clientèle. C'est pourquoi, ces investisseurs ne contribuent guère au financement des risques d'entreprises et d'innovation. Des formules nouvelles permettraient d'atteindre cet objectif tout en maintenant une gestion financière équilibrée de leur patrimoine. Par exemple, « là où existent des instituts de développement ou d'investissement ou des holdings d'intérêt public, ceux-ci pourraient être autorisés à émettre des actions auxquelles l'Etat garantirait (ou subsidierait) un intérêt ou un dividende minimum et qu'il s'engagerait à racheter, en cas de demande, à des prix-planchers et à des échéances convenues (cinq ou dix ans, par exemple). L'émission de pareils titres,
(f 4/1981
(22) Tels que les compagnies d'assurance, les caisses, associations ou banques d'épargne, les fonds de pension ou de sécurité sociale, sociétés philanthropiques, religieuses, scientifiques ou culturelles, voire certains fonds communs de placement.
507
508
répondant aux critères des investisseurs institutionnels, permettrait d'accroître les transferts d'épargne vers l'économie productive. Et ce, suivant les orientations définies par l'Etat démocratique et appliquées sous ses directives et son contrôle, par des instituts publics. A ceux qui invoqueraient, pour la réfuter, le coût et les risques pour l'Etat d'une telle initiative, il est aisé de répondre par des arguments de poids. Créer des emplois productifs, durables et utiles, rapporte à la société et à l'Etat beaucoup plus que de s'enliser dans des tentatives, souvent vaines et coûteuses, de soutenir des entreprises ou des branches d'activités, condamnées et moribondes. Mieux vaut procurer des activités à des chômeurs aspirant au travail et financer, s'il le faut, leur reconversion que payer des indemnités d'entretien inactif. Mieux vaut, pour l'Etat, ne s'engager qu'à terme et conditionnellement, en assumant en deuxième ligne, des risques calculés, que dépenser immédiatement et à fonds perdus ».
Plus généralement, par de telles formules et par d'autres similaires, des capitaux prudents, conservateurs ou en quête de havres étrangers, d;une sûreté d'ailleurs souvent douteuse, seraient transformables en investissements productifs et générateurs de travail.
Condusions Telles sont, schématiquement, quelques suggestions d'économie financière qui contribueraient à la solution des multiples problèmes de nos sociétés et de l'Europe en crise. Il en est bien d'autres, possibles et souhaitables. Ce sont, par exemple, l'application d'un nouveau concept d'épargne légale (23); l'harmonisation, au niveau de la C.E.E., des encadrements publics et du régime, aujourd'hui disparates, de la plupart des modes de financement des entreprises ainsi que de leurs appels publics à l'épargne, des institutions et des mécanismes qui y concourent. Malgré les réalités de la crise, les grandes illusions de la société de consommation et des « golden sixties » sont fallacieuses mais tenaces. Elles induisent les communautés nationales ou régionales, les groupes sociaux et les individus à vouloir maintenir, chacun et isolément, des positions et des droits considérés comme acquis mais devenus précaires. Dans cette foulée, certains formulent des revendications attrayantes mais irréalisable durablement sans sacrifices équitablement répartis et sans initiatives créatrices, productives, conjointes et convergentes. Il faut intégrer l'économique et le social mais en demeurant lucide devant les réalités mouvantes. Qu'il s'agisse des peuples et des hommes,
(p 4/1981
(23) Décrit dans le Traité d'Economie financière, précité, p. 31 et 32.
nous devons répondre aux aspirations légitimes d'ascension et de justice des plus désavantagés ainsi qu'à la demande de travail des inoccupés. Mais nous devons aussi créer les conditions de répondre à ces appels ainsi que de sauvegarder et d'améliorer la Sécurité sociale réellement et durablement, plutôt que « sur le papier ». Oui veut la fin doit aussi en vouloir et en appliquer les moyens. Ceux-ci comportent une réforme profonde et courageuse, non seulement des structures d'administration et de procédure périmées ou inadéquates mais encore des consciences, des mentalités et des motivations. En particulier, les esprits d'entreprise, de prospective innovatrice, de civisme réaliste et de service public doivent être non seulement relancés avec force mais aussi récompensés. L'appareil productif, support final des dépenses possibles des nations, doit être maintenu vivace par des politiques appropriées. Malgré la complexité et l'immense difficulté de la tâche, les démocraties industrielles sont placées devant le défi de rénovation permanente de leur économie publique et privée. La générosité rejoignant ici les intérêts particuliers, ce renouvellement doit être adapté à l'interdépendance et à la concurrence internationales. Au-delà des vues et des chauvinismes nationaux ou régionaux, cette rénovation doit donc s'inscrire dans la perspective d'une Europe plus forte et de sa participation à l'instauration progressive d'un nouvel ordre mondial plus juste et plus équilibré. Le progrès des sociétés et des hommes dépend plus que jamais de leur solidarité active et entreprenante. Leur avenir est lié à un diagnostic constant et objectif des difficultés qui compromettent leur salut, des causes et des conséquences de ces difficultés ainsi qu'à la recherche et à l'application de solutions réalistes pour les surmonter, c'est-à-dire à la mobilisation des ressources nécessaires pour mettre en œuvre ces solutions. Les illusions des droits supposés acquis et de la laxité doivent s· effacer devant le libre examen et le courage de la vérité. Moyennant un engagement déterminé, opiniâtre et optimiste, des efforts et des sacrifices équitablement partagés et une ouverture sur le monde, les démocraties industrielles sont capables de forger ces nouvelles « armes de la paix ». Puissent-elles en prendre conscience, s'y efforcer et y parvenir ensemble!
[f 4/1981 509
Tout le seIVice d'une banque. Tout l'intérêt de la caisse d'épargne.
Al de diensten van een bank. Al de voordelen van de spaarkas.
COER~ASLK CAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKA6
510 lf 4/1981
.::t. CO CO 1...
a. en ....., ..c u Q)
C: C Q) ....., Q)
s ..........
Q) u C Q)
-0 :::::, 1...
C. en 1... :::::, -, ....., Q)
■-
0 _J
'
Overdracht of pandgeving van schuldvorderingen op publieke instellingen gesubsidieerd door de Staat Hof van Cassatie (1 ste Kamer) 23 april 1981
par Anne-Marie Stranart-Thilly Avocat au Barreau de Bruxelles Chargé de cours à l'Université Libre de Bruxelles.
Samenvatting 1 Uit kracht van de bepalingen van de artikelen 1, 2 en 3, van het enige artikel van de wet van 3 januari 1 958 betreffende de cessies en inpandgevingen van schuldvorderingen op de Belgische Staat uit hoofde van werken en leveringen, is een voorrecht toegekend aan de schuldvorderingen voortkomende met name uit leveringen van materialen en andere voorwerpen die dienen voor de uitvoering van de voor rekening van de Staat verrichtte of te verrichten werken of uit leveringen voor rekening van het Ministerie van Landsverdediging .
2 Dit voorrecht komt ten bate van de onderaannemer van diegenen die voor rekening van de Staat werken uitvoeren en van de onderaannemers van leveranciers van het Ministerie van Landsverdediging voor de dienst van de strijdkrachten.
3 Voormelde wetsbepalingen wijken van het gemene recht af en moeten derhalve strikt geihterpreteerd worden. De uitvoering van werken voor een andere openbare inste/ling dan de Staat, onder meer voor een gemeente, kan niet worden gelijkgesteld met de uitvoering van werken voor rekening van de Staat, ook niet wanneer die werken worden gesubsidieerd door de Staat, die uiteindelijk de financiële last ervan volledig of gedeeltelijk draagt.
4 Uit de bepalingen van de wet van 3 januari 1958, zoals zij toegelicht werden in de loop van de parlementaire voorbereidingen, blijkt dat de regeling van deze wet niet kan worden uitgebreid tot schuldvorderingen voortspruitende uit openbare werken voor andere besturen dan de Staat en dat schuldvorderingen met betrekking tot de werken voor de gemeenten en de provinciën aan het gemene recht onderworpen blijven.
ff 4/1981 511
512
Résumé 1 Il résulte des dispositions des articles 1,2 et 3, compris dans /'article unique de la loi du 3 janvier 1958 relative aux cessions et mises en gage de créances sur /'Etat du chef de travaux et fournitures qu'un privilège est reconnu notamment aux créances provenant des fournitures de matériaux et autres objets servant à /'exécution des travaux faits ou à faire pour le compte de l'Etat, ou des fournitures faites pour le compte du Ministère de la Défense Nationale.
2 Le bénéfice de ce privilège s'étend au profit des sous-entrepreneurs de ceux qui exécutent des travaux pour le compte de /'Etat et des sous-entrepreneurs des fournisseurs du Ministère de la Défense Nationale pour le service des forces armées.
3 Les dispositions pr(jcitées dérogent au droit commun, et partant, doivent être interprétées de manière restrictive. L'exécution de travaux pour une autre personne publique que l'Etat, entre autres pour une commune, ne peut être assimilée à l'exécution de travaux pour compte de l'Etat, même si ces travaux sont subsidiés par /'Etat, qui, en définitive, en supporte la charge financière totalement ou partiellement.
4 Des dispositions de la loi du 3 janvier 1958, telles qu'elles furent explicitées au cours des travaux préparatoires, il apparatt que le régime de cette loi ne peut être étendu aux créances relatives à des travaux publics pour d'autres Administrations que celle de /'Etat, et que les créances afférentes aux travaux pour les communes et les provinces demeurent soumises au droit commun.
Uittreksel ... Gelet op het bestreden arrest, op 30 november 1979 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1, 2, 3 en 5 van de wet van 3 januari 1 958 betreffende de cessies en inpandgevingen van schuldvorderingen op de Belgische Staat uit hoofde van werken en leveringen,
doordat het arrest, na vastgesteld te hebben dat eiseres ais onderaannemer van de gefailleerde naamloze vennootschap ... , bepaalde werken heeft uitgevoerd, dat de hoofdaannemingsovereenkomst nopens deze werken werd gesloten tussen voormelde gefailleerde vennootschap en de stad Gent, en dat de werken van deze aanneming volledig gesubsidieerd werden door de Staat, beslist dat het voorrecht van de wet van 3 januari 1958 niet toepasselijk is op de schuldvordering van
[?4/1981
eiseres voor de uitvoering van bedoelde werken ais onderaannemer, op grand dat het voorrecht van genoemde wet slechts toepasselijk is op werken « voor rekening van de Staat uitgevoerd of uit te voeren »; dat het subsidiëren door de Staat van werken die door een gemeente aan een aannemer werden toegewezen, niet betekent dat de aannemer wegens de uitvoering van die werken schuldeiser wordt van de Staat, zelfs indien deze werken een nationaal belang hebben en de Staat er om die reden uiteindelijk de financiële last van draagt; dat de woorden van de wet van 3 januari 1958 geen uitbreiding bij analogie toelaten van het door hen ingesteld voorrecht tot werken die door een gemeente aanbesteed worden; dat een dergelijke uitbreiding zou berusten op verwarring tussen schuld wegens contract enerzijds en geldelijke bijdrage wegens finaal belang anderzijds,
terwijl de wet van 3 januari 1 958, zoals blijkt uit de artikelen 1, 2, 3 en 5 ervan, een voorrecht instelt dat in het algemeen toepasselijk is op werken « voor rekening van de Staat », dit wil zeggen werken waarvoor de Staat in feite de financiële last draagt, en niet uitsluitend op werken uitgevoerd in opdracht van de Staat, dat wil zeggen werken waarvan de Staat de opdrachtgever is; zodat het arrest, door te beslissen dat het voorrecht van de wet van 3 januari 1 958 niet toepasselijk is op werken die volledig gesubsidieerd zijn door de Staat, de artikelen 1, 2, 3 en 5 van genoemde wet schendt :
Overwegende dat, uit kracht van de bepalingen van de artikelen 1, 2 en 3, begrepen in het enige artikel van de wet van 3 januari 1 958 betreffende de cessies en inpandgevingen van schuldvorderingen op de Belgische Staat uit hoofde van werken en leveringen, een voorrecht is toegekend aan de schuldvorderingen voortkomende met name uit leveringen van materialen en andere voorwerpen welke dienen voor de uitvoering van de voor rekening van de Staat verrichtte of te verrichten werken of uit leveringen voor rekening van het Ministerïe van Landsverdediging; dat dit voorrecht ten bate komt van de onderaannemer van diegenen die voor rekening van de Staat werken uitvoeren en van de onderaannemers van leveranciers van het Ministerie van Landsverdediging voor de dienst van de strijdkrachten; dat het slaat op de fondsen welke in de kassen van de rijksrekenplichtigen zijn gedeponeerd om aan die aannemers of leveranciers te worden uitgekeerd;
Overwegende dat voormelde wetsbepalingen van het gemene recht afwijken en derhalve strikt moeten worden geïnterpreteerd; dat de uitvoering van werken voor een andere openbare instelling dan de Staat, onder
[F 4/1981 513
514
meer voor een gemeente, met de uitvoering van werken voor rekening van de Staat niet kan worden gelijkgesteld, ook niet wanneer die werken worden gesubsidieerd door de Staat, die uiteindelijk de financiële last ervan volledig of gedeeltelijk draagt;
Overwegende dat uit de bepalingen van de wet van 3 januari 1 958, zoals zij toegelicht werden in de loop van de parlementaire voorbereiding, blijkt dat de regeling van deze wet niet kan worden uitgebreid tot schuldvorderingen voortspruitende uit openbare werken voor andere besturen dan de Staat en dat schuldvorderingen met betrekking tot de werken voor de gemeenten en de provinciën aan het gemene recht onderworpen blijven;
Dat de door het middel bekritiseerde beslissing van het arrest de door eiseres ingeroepen wetsbepalingen niet schendt;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, En zonder acht te slaan op de memorie van antwoord die na het verstrijken van de bij artikel 1 093 van het Gerechtelijk Wetboek gestelde termijn voor de verweerders meesters Van M ... , V ... en H ... ter griffie van het Hof werd neergelegd; Verwerpt de voorziening ( ... )
11 Observations Nous avions brièvement approuvé, dans ces colonnes (1 ), un arrêt de la Cour d'appel de Gand (1 '• chambre) du 30 novembre 1979, décidant que le privilège qui résulte des articles 2 et 3 de la loi du 3 janvier 1 958 relative aux cessions et mises en gage de créances sur l'Etat du chef de travaux et fournitures, n'existe que si l'Etat est le maître d'œuvre et n'a pas lieu dans le cas de travaux adjugés par ou accomplis pour le compte d'une commune, même si l'entreprise est subsidiée en totalité par l'Etat.
Par l'arrêt ci-dessus reproduit, la Cour de Cassation rejette le pourvoi qui - nous l'avions signalé - avait été introduit contre cette décision. Il s'agit d'un arrêt de principe, particulièrement ferme et précis. Le moyen unique faisait valoir que par des travaux « pour compte de l'Etat », il fallait entendre des travaux dont l'Etat supporte en fait la charge financière et non exclusivement des travaux exécutés sur commande de l'Etat, c'est-à-dire dont celui-ci est le maître d'œuvre.
La Cour de Cassation a rejeté cette application extensive
[? 4/1981
(1) Revue de la Banque 1 981 p. 197 sp. p. 200.
au nom du principe général d'interprétation restrictive des dispositions qui, telles celles de la loi du 3 janvier 1 958, dérogent au droit commun : des travaux exécutés pour compte d'une autre personne publique que l'Etat ne peuvent être assimilés à des travaux pour compte de ce dernier même s'il en supporte en définitive la charge financière. Outre la référence judicieuse qu'il fait au surplus à l'intention du législateur exprimée dans les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1958, l'arrêt commenté présente également le mérite d'énoncer de manière expresse qu'un véritable privilège découle de cette loi et que cette préférence s'étend au sous-entrepreneur. Voici une controverse heureusement tranchée.
[p 4/1981 515
ffiBanque RRI Bruxelles Lambert ◄
La BBL, ou commeat profiter pleinement de votre banque.
Banque Bruxelles Lambert. La banque Abecor en Belqique. Avenue Marnix 24, B-1050 Bruxelles. Tél. (02)513.81.81. Télex 26392 BBLIN.
516 rp4/1981
u, C C Q) 0...., C C . - ::::, a. a. 0 '"'C
C CO
... u, ...., C Q)
E ::::, (.) 0
'"'C
...., u,
... C Q) ...., C Q)
E ... ::::, J!3 (.) ·- 0 Lf '"'C
... C Q) ...., ·-Q)
u..
Aspects of the new Japanese Law on Foreign Exchange and Foreign Trade Contrai
by Philippe De Smedt
Born in 1945 in Brussels. Brussels University (Juris Doctor, Licence en Notariat, 1971 ), lnstitute of European Studies (Special Degree in European Law, 1976) and Georgetown University Law School (LL. M. 1977). Has been practising in London, New York
Introduction
and Brussels. Presently avocat in Brussels. Has published various articles in Belgian and foreign reviews in the field of international and financial law. Address : Lebrun & De Smedt Franklin D. Roosevelt Ave. 96 A 1050 Brussels
A law to amend the Foreign Exchange and Foreign Trade Contrai Law was recently enacted in Japan . This amending law (the « new Law ») became effective as from December 1, 1980. The principle feature of the new Law is that most foreign exchange transactions have been liberalized and instead of being subject to prior governmental notice are simply subject to a reporting pracedure. The purpose of the reporting procedure is to enable the Japanese Finance Minister to survey foreign exchange transactions and bring in contrais at any time of emergency, e.g. disorder on the financial market. However, there are still some cases where a licence is required e.g. the foreign exchange deposits made outside Japan by a Japanese resident, so each case should be studied individually. The purpose of this paper is to give a case by case study of the typical situations which arise in international business transactions.
1 Effects on lnvestments and Transactions by Foreign Companies in Japan or with Japanese Companies
1.1 Effects on lnvestrnents and Transactions by Foreign Companies doing Business in Japan lt is assumed that the intended business activities are
[? 4/1981 517
518
conducted by the foreign companies through their Japanese subsidiaries, affiliates or branches.
a Acquisition and Disposai of Shares in a Subsidiary or Affiliate 1 Acquisition of Shares Acquisition of the shares in a Japanese company falls under the definition of a Direct Domestic lnvestment as defined by the new Law and generally has to be reported to the Japanese Minister of Finance, if the Japanese company is a private corporation. This is true whether the shares are acquired in connection with the incorporation of a new subsidiary or the formation of a new joint venture with a Japanese partner. Acquisition of shares as a result of a capital increase of a Japanese company or a transfer of existing shares from a Japanese to a foreign shareholder is also subject to the reporting requirement. However, acquisition of shares without making a new contribution to an issuing company is generally not subject to the reporting requirement. ln other words, acquisition of shares as stock dividends or as a result of a stock split, or a transfer of the reserved fund to the corporate capital, etc. need not be reported. Moreover, if a foreign company acquires such shares from another foreign company, the acquisition is not subject to the reporting requirement.
2 Disposai of Shares As just mentioned, transfer of shares from a foreign company to another foreign company does not fall under the reporting requirement of the new Law. ln the same manner, a foreign company can transfer the shares held in a Japanese company to another Japanese company or to an individual without being subject to any licence or reporting requirement.
3 Payment of Dividends or other Distributions Payments of dividends or other distributions related to shares held in a Japanese company can be freely effected from a Japanese to a foreign company provided that the acquisition by the foreign company was previously reported, or exempt from being reported.
b Approval of Corporate Purpose Modifications of a Subsidiary or Affiliate If a foreign company holds one-third or more of the total issued shares of a Japanese company, its intention to modify the corporate purpose of the Japanese company is subject to the reporting requirement as being a Direct Domestic lnvestment.
[p 4/1981
c Loan to a Subsidiary or Affiliate A loan from a foreign company to its Japanese subsidiary or affiliate can be classified as either a Direct Domestic lnvestment or a Capital Transaction under the new Law definition, depending on the magnitude and circumstances. If a loan exceeds the amount to be specified by the Ministry of Finance, which should not be less than 1 00 million yen, and exceeds a period of one year, then it is categorized as a Direct Domestic lnvestment. A loan for a shorter period or for a smaller amount is treated as a Capital Transaction. Although such a Capital Transaction has to be reported to the Minister of Finance, the latter cannot make any recommendation or order of alteration or suspension.
d Acquisition of Bonds of a Subsidiary or Affiliate Acquisition of bonds in a Japanese subsidiary or affiliate is subject to the same reporting requirements as in the case of loans. ln other words, if the redemption period of the bonds is more than one year and the consideration is in excess of such a.mount to be specified by the Ministry of Finance, then acquisition of the bonds is considered as a Direct Domestic lnvestment. Ac.;quisitions of other bonds are defined as Capital Transactions and are subject to the corresponding reporting requirements.
e Licensing of lndustrial Property Rights or Technical Assistance to a Subsidiary or Affiliate When a foreign company licenses the use of patents or other industrial property rights or gives technical assistance to a Japanese subsidiary or affiliate, such a transaction is classified as the conclusion of a Technology Introduction Contract and is subject to a corresponding reporting requirement.
f Establishment and Operation of a Japanese Branch
1 Establishment of a Japanese Branch If a foreign company intends to establish a branch in Japan, it is required to file a special report with the Minister of Finance as this is considered as a Direct Domestic lnvestment. However, in cases where the establishment of a branch in Japan is subject to a licence or approval requirement under other laws (for example, establishment of branches of foreign banks or securities companies), then the reporting under the new Law is not necessary.
2 Remittance of Funds to a Japanese Branch If a foreign company remits funds to a Japanese
~ 4/1981 519
520
branch for its establishment, such remittance falls into the category of a Capital Transaction. However, though it is categorized as a Capital Transaction, the remittance of the funds itself is, except in case of emergency, not subject to the reporting requirement imposed on most of the Capital Transactions. However, being considered as a Direct Domestic lnvestment, the establishment of a Japanese branch is subject to the corresponding reporting requirement. On the other hand, transfer of normal operating funds by a foreign company to its Japanese branch is not regarded as a Capital Transaction, as long as they are not related to the establishment or expansion of the branch.
3 Payment of Profits to a Foreign Company Payment by a Japanese branch to its foreign head office of profits or residual assets upon the closing of the Japanese branch is a Capital Transaction. Such payment, however, is not subject to the reporting requirement otherwise than in cases of emergency.
4 Loan by a Japanese Branch to a Japanese Company If a Japanese branch intends to make a loan to a Japanese company, it will be required to file a Direct Domestic lnvestment report with the Minister of Finance, provided that the loan has a term of more than one year and is in excess of the amount to be determined by the Ministry of Finance. Should the loan be in a lesser amount or with a shorter term, the Japanese branch can freely grant a loan to a Japanese company in the Japanese currency. However, a loan in a foreign currency cannot be effected without obtaining an advance licence from the Minister of Finance.
g Establishment and Operation of a Representative Office A foreign company can establish a representative office without filing a Direct Domestic lnvestment report, provided that such office is to be more particularly engaged in such activities as market researching or information collecting. ln addition, remittance of funds to a representative office in Japan, whether for establishing or operating the office, can be effected without reporting.
1 .2 Effects on Portfolio or other lnvestments by Foreign lnvestors in Japan a Acquisition of Shares of a Publicly-Held Company When a foreign investor acquires shares of a Japanese
[F 4/1981
company the stock of which is traded on a stock exchange or over the counter, such transaction will not be subject to any reporting requirement as long as the following conditions are met : 1 Acquisition of the shares is made from or through a designated securities company; 2 The total of the shares to be acquired by the foreign investor and the shares already held by the foreign investor and its affiliated companies does not exceed 1 O % of the total issued shares of the company; 3 The total of the shares to be acquired and the shares already held by foreign companies and non-resident individuals does not reach or exceed 25 % or such other percentage as specified by the relevant M inisters of the total issued shares of the Japanese company; and, 4 Acquisition of the shares is not made by a Japanese company or resident iridividual on the behalf of the foreign investor.
If the above condition (2) is not satisfied, the foreign investor is required to file a Direct Domestic lnvestment report. On the other hand, in case the conditions (2) and (3) are satisfied but the condition (1) is not, then a foreign investor is required to make a Capital Transaction report. If the acquisition of shares is made by a Japanese company or a Japanese resident individual on behalf of a foreign investor, such Japanese company or resident individual will be required to file a report with the Minister of Finance in advance, unless a report has to be filed as a Direct Domestic lnvestment.
b Acquisition of Bonds A foreign investor can acquire bonds publicly issued by a Japanese company without being subject to the reporting requirement, as long as the acquisition is made from or through a designated securities company. As far as concerns bonds issued in a private offering, a Direct Domestic lnvestment is required to be filed with the Minister of Finance, provided that the consideration for the acquisition exceeds the amount to be designated by the Ministry of Finance, which should not be less than 1 00 million yen, and has a redemption term of more than one year. ln all other cases, acquisition of bonds privately issued is subject to the reporting requirement corresponding to a Capital Transaction, unless acquisition is made from or through a securities company.
re lr 411gs1 521
522
c Acquisition of Real Estate A foreign investor can acquire a right on real estate located in Japan only after filing a special report with the Minister of Finance.
d Deposit in the Japanese Currency A foreign investor can deposit the Japanese currency with an authorized foreign exchange bank without filing any report, except in cases of emergency. There is no longer any distinction between domestic yen and free yen, (the latter being the yen equivalent of foreign currencies), unlike the case under the old Law. Accordingly, a foreign investor need no longer worry about the type of yen being deposited. Although, except in cases of emergency, authorized foreign exchange banks can freely accept deposits in Japanese currency from foreign investors, they may be subject to certain regulations imposed from time to time by the Minister of Finance or the Bank of Japan, such as prohibition of interest payments on yen accounts or imposition of the special reserve requirement.
1 .3 Effects on Fund Raising Activities by a Foreign Company in Japan or in the Japanese Currency a Effect on lssuance of Securities by a Foreign Company in Japan ln order to issue securities in Japan, whether denominated in Japanese currency or in a foreign currency, a foreign company is required to file an advance report of a Capital Transaction with the Minister of Finance.
b Effects on /ssuance of Securities in the Japanese Currency by a Foreign Company outside of Japan When a foreign company issues securities denominated in Japanese currency outside Japan, such as Euro-yen bonds, it is required to obtain a prior licence from the Minister of Finance. Apparently, this licence requirement was imposed following international practice whereby the sovereign state whose currency is involved in the issue of securities outside such state, has normally to grant prior approval.
c Effect on a Loan granted to a Foreign Company by a Japanese Company ln order to obtain a loan from a Japanese company, a foreign company should file a report of a Capital Transaction with the Minister of Finance.
[?4/1981
2 Effects on lnvestments and Transactions by Japanese Companies in Foreign Countries or with Foreign Companies
2.1 Effects on lnvestments and Transactions by Japanese Companies doing Business Abroad ln order to do business in a foreign country, a Japanese company usually establishes a subsidiary or a branch or enters into a joint venture agreement with a local partner.
a Acquisition of Shares of a Subsidiary or Affiliate If a Japanese company acquires 1 0 % or more of the total issued shares of a foreign company, such acquisition is categorized as a Direct Foreign lnvestment subject to the corresponding reporting requirement to the Minister of Finance.
b Loan to a Subsidiary or an Affiliate If a Japanese company grants a loan with a term exceeding one year to a foreign company, the loan is regulated as a Direct Foreign lnvestment, provided that the Japanese company holds 1 0 % or more of the total issued shares of the foreign company. As a Direct Foreign lnvestment, the loan is subject to a similar reporting requirement as in the case of stock acquisition of a subsidiary or affiliate. If the loan has a term of one year or less, then it is not a Direct Foreign lnvestment, but such a short-term loan has nevertheless to be reported to the Minister of Finance as a Capital Transaction.
c Guarantee Contract to a Subsidiary or an Affiliate A Japanese company can furnish a guarantee for its foreign subsidiary or affiliate without filing any report. However, such a guarantee is a Capital Transaction and can be subject to the emergency measures.
d Establishment and Operation of an Overseas Branch To make a remittance of funds necessary to establish or expand a branch in a foreign country, a Japanese company is required to file a Direct Foreign lnvestment report. However, remittance of ordinary operational funds is neither a Direct Foreign lnvestment nor a Capital Transaction whereas receipt of profits by a Japanese company from its foreign branch will be considered as a Capital Transaction, although not generally subject to the reporting requirement.
[?4/1981 523
524
e Establishment of a Representative Office A Japanese company can freely transfer the necessary operating funds to its foreign representative office without having to file a report, since such payment is nota Capital Transaction.
2.2 Effects on Portfolio or other lnvestments by Japanese lnvestors in Foreign Countries or in Foreign Currencies
a Effects on the Acquisition of Securities of a Foreign Company by a Japanese lnvestor If a Japanese investor acquires 1 0 % or more of the total issued shares of a foreign company, then the acquisition is classified as a Direct Foreign lnvestment (As portfolio investment, acquisition of shares of a publicly-held foreign company in such a magnitude is rare, if any). Except in the cases classified as Direct Foreign lnvestments, acquisition of securities of a foreign company by a Japanese investor from or through a designated securities company is not subject to the reporting or licence requirement except in cases of emergency. However, acquisition of securities without the intervention of a designated securities company should be reported to the Minister of Finance.
b Effects on Deposits in Foreign Currencies with Foreign Banks by a Japanese lnvestor A Japanese investor can make a deposit in a foreign currency with any authorized foreign exchange bank in Japan without being subject to the reporting or licence requirement except in cases of emergency. There is no longer any limitation on the amounts or reasons for such deposits as it was the case un der the old Law. However, if he wants to make a foreign currency deposit outside Japan or with a Japanese or foreign bank which is not an authorized foreign exchange bank, he must first obtain a licence from the Minister of Finance.
c Effects on the Acquisition of Real Estate in a Foreign Country by a Japanese lnvestor A Japanese investor can acquire real estate located in a foreign country without filing any report or obtaining a licence beforehand. Acquisition of real estate abroad is, however, a Capital Transaction and is subject to the licence requirement applicable to cases of emergency.
~ 4/1981
2.3 Effects on Fund Raising Activities by Japanese Companies in Foreign Countries or in Foreign Currencies a Effects on lssuance of Securities in a Foreign Country ln order to issue securities in a foreign country, whether denominated in Japanese or in a foreign currency, a Japanese company must file a preliminary Capital Transaction report with the Minister of Finance. ln addition, a Japanese company is required to report to the Minister of Finance if it guarantees liabilities incurred by its foreign subsidiary upon its issue of securities in a foreign country.
b Effects on lssuance of Securities in a Foreign Currency in Japan The issue of securities in Japan denominated or payable in a foreign currency by a Japanese company is subject to the appropriate reporting requirement as a Capital Transaction.
c Effects on Borrowing from a Foreign Company If a Japanese company borrows money from a foreign financing institution, such as a bank, a trust company, an insu rance company a securities company or a financing company, it will be required to file a Capital Transaction report. Although such a loan has to be reported to the Minister of Finance, the Japanese company can draw down a loan immediately after reporting and the loan is not subject to any Ministerial recommendation or order of alteration or suspension. A borrowing made by a Japanese company with a foreign company other than a financing institution will be treated as either a Direct Domestic lnvestment or a Capital Transaction, depending on the terms and amount of the loan. The typical case where such a loan is made by a foreign parent company to its Japanese subsidiary and the treatment of such a loan under the new Law has been discussed above (1 .1 (c)).
d Effects on Borrowing in a Foreign Currency by a Japanese Company in Japan A Japanese company can borrow money in a foreign currency from an authorized foreign exchange bank without being subject to the reporting or licence requirement, except in cases of emergency, as long as the loan is granted by the bank as part of its ordinary business activities. For example, lending by such a bank in a foreign currency to a Japanese company is often made in connection with the import of goods by the Japanese company.
[p 4/1981 525
526
Borrowing in a foreign currency by a Japanese company from another Japanese company which is not an authorized foreign exchange bank is subject to the licence requirement, unless the lending company is controlled by a foreign company and the loan is classified as a Direct Domestic lnvestment.
~ 4/1981
De rentelabiliteit in het management van financiële instellingen *
door Henri Fayt
Herent (Leuven) 1 931 . Doctoraat in de Rechten, Leuven (1954). Toe9epaste Economische Wetenschappen, Leuven (1958). Beheerder, Lid van het Directiecomité van de Generale Bankmaatschappij. Beheerder van de Antwerpse Diamantbank.
De manager van een bank of van een financiële instelling is voortdurend bekommerd om de liquiditeit, de rendabiliteit en de stabiliteit van zijn onderneming, dit wil zeggen, om haar voortbestaan. Die drie eigenschappen zijn onontbeerlijk om het vertrouwen te blijven genieten, vertrouwen waarop de gehele geldhandel is gegrondvest. lk zal mijn betoog rondom die drie thema's opbouwen, want de rentelabiliteit maakt door de onzekerheid die zij teweegbrengt, de financiële bedrijvigheid riskanter en vergt bijgevolg grotere inspanningen om de inherente risico's te beperken.
De rentelabiliteit Sedert enkele jaren vertonen de rentetarieven ruime en vaak onvoorspelbare schommelingen. lk zal niet uitweiden over dit punt maar toch wil ik een paar aspecten belichten die mij van belang lijken voor het duidelijk begrijpen van de beschouwingen die zullen volgen.
V66r 1975 waren de rentetarieven strak gebonden aan de conjunctuurcyclus; de tarieven waren laag in perioden van slappe bedrijvigheid en de spanningen van hoogconjunctuur brachten een stijging van de geldhuur en een verscherping van de leenvoorwaarden teweeg. Het emissie-instituut intervenieerde om de
Lf 4/1981
n ln samenwerking met de diensten van de Generale Bankmaatschappij. Toespraak gehouden door de heer H. Fayt ter gelegenheid van de jaarlijkse ontmoetingsdag van het Studiecentrum voor het Financiewezen te Brussel op 14 mei 1981. De tabellen en grafieken zijn bijgewerkt tot die periode.
527
528
oververhitting te verminderen en om de kredietvraag te matigen. Zelfs al bespoedigden de spanningen van het einde van de welvaartsperiode de gebeurtenissen, dan nog was het verloop van de cyclus over verscheidene jaren gespreid. De inflatie en de rentetarieven voor de hele cyclus bleven doorgaans vrij gematigd; voorts kon men op grond van de opeenvolgende economische verschijnselen een voorspelling maken die voldoende was om niet « op zicht » te moeten sturen. Die samenhang kennen wij thans niet meer. Het stelsel van Bretton Woods is ineengestort en de door de inflatie uitgeholde munten worden meegesleurd in de maalstroom van de valutamarkten. De betalingsbalansen van talrijke industrielanden vertonen ernstige tekorten. De rentetarieven zijn aan ruime schommelingen onderhevig; zij zijn losgeslagen. Zou het ook anders kunnen, nu de monetaire overheid ten onrechte wordt gevraagd, nagenoeg zonder andere hulpmiddelen, ernstige onevenwichtigheden te herstellen, en nu kapitaalbewegingen die dikwijls door speculatie worden aangewakkerd en op buitenmate grote bedragen betrekking hebben, de internationale markten verstoren ?
Uit de grafieken 1 tot 3 van het verloop van de rentetarieven in de Verenigde Staten, Duitsland en België - om slechts de meest typische te noemen - blijkt dat duidelijk. Vorig jaar daalde het tarief van de Federal Funds in de Verenigde Staten van 1 7 ,6 % eind april tot 9 % eind juli, en daarna steeg het weer tot 18,9 % per eind december; de prime rate schommelde tussen 11 % en 21,50 %. De gedragingen van de Amerikaanse tarieven hebben uiteraard een beslissende invloed op het verloop van de Europese en Belgische tarieven.
ln België waren de schommelingen van de rentetarieven ook zeer frequent sedert de jongste conjunctuurpiek van 1973-74. De rentelabiliteit in de laatste jaren vloeide niet meer voort uit het activiteitspeil maar uit de kwetsbaarheid van de deviezen en uit de noodzaak voor de N.B.B., de BF te ondersteunen telkens ais hij bedreigd werd in zijn verhouding tot de munten waarmee hij verbonden is op grond van overeenkomsten die bedoeld zijn om in Europa enige muntstabiliteit te herstellen. Deze laatste kon slechts worden bereikt ten koste van onder meer een grotere onstandvastigheid van de rentetarieven ais gevolg van het gebrek aan harmonie tussen het economische, het sociale en het begrotingsbeleid. De verantwoordelijken voor het economisch en politiek
[? 4/1981
Grafiek 1 : Rentevoeten - Taux d'intérêt
20.
18.
16.
u.
••
VERENIGDE STATEN / ~TATS-UNIS
DISCDNTO/ESCOMPTE ----- FE□. FUNDS . ...............• GVT BONDS US __________ EURO Z 3 M.
DUITSLAND / ALLEnAGNE
,~ , ' ' .
DISCONTO/ESCOMPTE GELD OP 3 MAANOEN/ARGENT A 3 MOIS LANGE TERMIJN/LONG TERME
12. EURO-DM 3 M.
11.
10.
9.
e. ',...J,,_,...._'\ ,. 6.
5.
,. 3.
2.
1.916 ·1911 1918 191'3 1980
bestel van ons land hebben niet steeds de mogelijkheid, of de moed, gehad, de fundamentele ontregelingen aan te pakken die uiteindelijk het dynamisme van de ondernemingen en de gezondheid van de munt hebben ondermijnd.
[f 4/1981
. . r,{ .. . ' ' ' ' : .
:zo.
1e.
160
e •
15 •
13.
11.
1981
529
(J1 w 0
7fb Grafiek 2: t Rentevoeten België - Taux d'intérêt belge CS:, CO
18,
15,
12,
10,
•• ,.
1968
BF-INTERBANKTARIEF 3 MAANDEN/INTERBANQUES FB 3 MOlS DISCONTO/ESCOMPTE CERTIF. RENTENFONDS 4·MAANDEN/CERTIF, FONDS DES RENTES 4 MOIS RENDEMENT STAATSFDNOSEN + 5 JAAR/REND. FONDS D'ETAT+ 5 ANS
1969 19'10 1912 ·]913 ·1914 ·]915
,. ' ' ' ' ' ' ' '
·]916
11.
1c.
1z.
10.
•• ,.
1911 ·]918 1919 1980 1981
Bij de van buitenuit opgelegde tariefschommelingen kwamen er dus - soms onverwacht grote - die voortvloeiden uit de noodzaak de tariefverschillen ten opzichte van het buitenland genoeg op te trekken om de speculatie tegen te houden en een ommekeer in het kapitaalverkeer aan te wakkeren. Die reacties worden qua rentetarieven, soms met opzet door het emissie-instituut overdreven, zoals onlangs eind maart/begin april, om een psychologische schok te veroorzaken en mogelijke speculatie te bevechten. Het overdreven karakter van de reactie is immers een noodzakelijk kwaad, want in een periode van muntcrisis primeert de hoop op kapitaalwinst op de aantrekkingskracht van normale verschillen in rente-opbrengst. ln grafiek 3 wordt de rentelabiliteit in de Verenigde Staten en in België tijdens de jongste jaren goed verduidelijkt, om de specifieke redenen die ik zopas opsomdc.
Grafiek 3: Schommelingen van de rentetarieven Fluctuations des taux d'intérêt. verschillen in punten na 3 maanden
f'EDERAI. f'UIVDS Différences en points à 3 mois d'écart
11:SF-INTERBJ\N~TAAIEF 3 MAIINDEN/INTERBANOUES FB 3 MCJIS
1916 19T1 1918 1919 19BO 1981
f? 4/1981 531
532
Hoe reageren nu de financiële instellingen ten aanzien van die realiteit? Uiteindelijk zullen hun reacties een structurele dimensie krijgen want het komt er niet op aan, een tijdelijk voorval op te vangen, maar het hoofd te bieden aan storingen die veel dieper zijn geworteld.
Liquiditeit De rentelabiliteit komt zeer rechtstreeks tot uiting in een torse schommeling van de verschillen tussen kortlopende en langlopende tarieven. ln normale tijden is een rendementscurve opwaarts gericht; hoe langer de looptijden, hoe hoger de tarieven zijn, dit om rekening te houden met de premie voor de « liquiditeit ». ln perioden van spanning echter wordt de rentestruktuur omgekeerd; de kortlopende tarieven, die gevoeliger zijn dan de langlopende, kunnen deze laatste kruisen en zelfs tijdens een min of meer lange periode voorbijsteken. ln de afgelopen jaren noteerde men talrijke gevallen waarin de langlopende tarieven de kortlopende voorbijstaken, in België zowel ais in het buitenland, zoals blijkt uit grafieken 4 en 5. Die tariefbewegingen laten de ontleners en evenmin de deponenten of de financiële instellingen onberoerd.
Grafiek 4: Verschil in punten tarief korte termijn min tarief lange termijn Ecarts en points taux court terme moins taux long terme
BELGIE / BELGIQUE ...
6.
"· 2.
DUITSLAND / ALLEMAGNE 6.
o. 1-----4--+-....I....--C.~'Z-"'!!CL---! o.
U.K. / ROYAUME-UNI NEDERLAND / PAYS-BAS :s.
,6 11 18 19 80 8"1 16 11 18 19 80 8"1
(p 4/1981
Grafiek 5:
Verschillen tussen rentetarieven BF Ecarts entre taux d'intérêt FB Verschillen in punten Différences en points
JNTER~ANKTARIEF 3 M.V.NDEN MIN RENDEMENT STMTSFDNDSEN(• 5 JAAR)
TI JNTERBANOUES 3 MOIS MOINS TI RENO.FONDS ETATl+SANSI 10. 10.
s. :s.
o.
-3. _,_
TA.'UEF CERT IF. REll,TENFONDS MIN RENDEMENT ST AATSf::J~•DS!cN ( + 5 JAAR) TX CERTIF.FONOS RENTES M'JHJS TX RENC.FONOS ETATl+SANSI
10.
s. 5.
o.
-:s. -~-TAAIEF GROTE ~POSITC'S 3 MAANDEN MIN TARIEF G!cwONE DEPOSITO'S 3 MAANOEN
s.
z.
"'·
z.
/r J
TX ~ROS DEPOTS 3 MOIS MOINS TX ORD.3 MOIS
VERMéLOE TAPIE'VEN nIN f<ENOEMENT. STMTSFDNOSEN(+ 5 JMR)
TAUX JNOIOUtS MOINS TI R~NJ.FONOS ETATl+SANSI
VER!':ELDE T ARIE\JEN MIN INTERBANKTARIEF 3 nAMDE.'I TAUX INDIOU~S MOINS TI INTERBAr;OUES J MOIS
CRO'Tf OEPOSlTO'S 3 1W11<0EH l<.AS<.Rf Dlff
VERMELDE TARIEVEN MIN INiERBl'.NKTARIEF 3 MAANOErl TAUX INDIQUES MOINS TI INTERBANOUES J MOIS
CCVJ~ 015CC~T,, ,a.e.11. - - - VDORSCNOfU.N DUITE."6 O\.OTA
1 ,, 1.
l[ 1
J 4/1981
10.
o.
1.
o.
-1.
,.
z.
o.
"· z.
o.
-z.
_,_
533
534
De bestaande struktuur, die dan nog merkelijk kan verschillen van instelling tot instelling, kan zwaar doorwegen. lnderdaad zullen de « mix » van de aangetrokken middelen enerzijds door hun zeer uiteenlopende en meestal grote rentegevoeligheid, en die van de herbeleggingen, met een doorgaans geringere renteaanpasbaarheid anderzijds, een min of meer groter individueel reaktiepotentieel bieden. Dit heeft een ingrijpende invloed op de respectieve gedragspatronen, waaruit dan ook, ten slotte, evoluerende politieken kunnen voortvloeien bij, en zelfs spanningen tussen de drie grote financiële sektoren. De verschuivingen in de activa en passiva merkt men onder meer in het verloop van de zichtdeposito's en depositoboekjes, enerzijds, en van de termijndeposito's anderzijds. De kliënteel is veel aandacht gaan schenken aan de vergoedingsmogelijkheden die voor haar beschikbare middelen worden geboden; bovendien maken de beheerstechnieken en -instrumenten van de ondernemingen het hun thans mogelijk, hun kasvoorraden in grote mate te beperken en naar een zo optimaal mogelijk rendement van hun liquiditeiten te streven. Wanneer de kortlopende tarieven de langlopende overtreffen, wordt de voor de grote deposito's geboden vergoeding bijzonder aantrekkelijk vermits ze zich richt naar de tarieven van de interbankenmarkt.
Voorts vertoont de opneming van de kredietlijnen de neiging te versnellen, ondanks de geleidelijke verhoging van de debettarieven die het verloop van de gevoelige tarieven volgen; de ontlener vreest vqor een kwantitatieve beperking van het krediet en wil zich ertegen wapenen, ofwel zoekt hijj kapitaalwinsten te maken, onder meer door middel van « leads and lags ».
De verkrapping van de geldmarkt kan ook leiden tot een verschuiving van de kredietvraag van een instelling naar een andere die, bijvoorbeeld, gemakkelijker toegankelijk blijft. Indien daarentegen de liquide middelen overvloediger worden, of het nu een terugvloeiing van geld dan wel het gevolg van een vermindering van de economische bedrijvigheid betreft, doen zich andere soorten verschuivingen voor in de activa en passiva van de financiële instellingen, waarop de managers des te meer letten daar de concurrentie sedert de branchevervaging en de steeds grotere internationalisatie van hun activeiten scherper is geworden en daar de overheidssector wegens de behoeften van de Staat een onverzadigbare afnemer
[f4/1981
geworden is. De Staat heeft aldus een feitelijk « leadership » in handen wat de vaststelling van de debetrentetarieven op halflange en lange termijn betreft.
De managers van de financiële instellingen hebben uiteraard een inspanning gedaan om zich aan die wijzigingen aan te passen en zelfs om er de hand aan te houden. Door de aard van hun opdracht zijn bankiers termijnomvormers; normaal zamelen zij gelden in op korte termijn om ze uit te lenen op langere termijn. Die klassieke houding wordt teniet gedaan door de rentelabiliteit en door het soms langdurige tegengestelde verloop van de rentecurves. Daardoor komt de bankmanager ertoe, zijn beleidspatronen te herzien, zijn methoden en technieken aan te passen. ln die optiek zal hij in de eerste plaats meer aandacht besteden dan voorheen aan de indeling van de produkten. Hij wil meer en meer weten waar de uitleenbare gelden vandaan komen, hoeveel ze kosten, wanneer men ze moet terugbetalen, hoe en voor welke duur ze belegd zullen kunnen worden.
Laten we voorlopig het aspect « rendabiliteit », waarop ik nog zal terugkomen, onbesproken, en laten we alleen het aspect« liquiditeit » onder ogen nemen. Om beter de mogelijke werkmiddelen aan te trekken, hebben de financiële ir'lstellingen nieuwe depositomodaliteiten of beleggingsmogelijkheden voorgesteld door een grotere diversifiëring van de voorwaarden of van de looptijden. Aldus werd het begrip « grote deposito's » onder de druk van de buitenlandse concurrentie gewijzigd. Hoe hoger de tarieven zijn, hoe meer voordeel sommige ingezetenen erbij hebben hun gelden in het buitenland te beleggen, vooral in het Groothertogdom Luxemburg en in Nederland waar de voorheffing niet wordt aangerekend : 20 % van 7,5 % interest maakt slechts een verschil van 1,5 punt; maar dat verschil loopt op tot 3 punten wanneer de voorheffing op een rente van 15 % wordt geheven. ln een periode van hoge rentetarieven en dus van verkrapping van de liquiditeit hebben de banken in het buitenland verder geen moeilijkheden om de aldus in BF ingezamelde gelden op de interbankenmarkt te herbeleggen. Om de deponenten aan te trekken, had de buitenlandse concurrentie het bedrag aanzienlijk verlaagd vanaf hetwelk op de deposito's bevoorrechte vergoedingsvoorwaarden van toepassing zijn die op soepele wijze aan de interbankentarieven zijn aangepast.
[?4/1981 535
536
ln België werd gereageerd door de drempel te verlagen vanaf welke de deposito's in Belgische franken bijzondere voorwaarden genieten die van de uitgehangen tarieven afwijken. Dit is een voorbeeld van aanpassing van het produkt aan de nieuwe marktomstandigheden. Er zijn er nog andere die betrekking hebben op de depositoboekjes waarvoor men diverse getrouwheids- en groeipremies verleent, of op de kasbons die in grote mate gediversifieerd werden. De diversifiëring had ook betrekking op de herbeleggingen. De rentelabiliteit heeft nieuwe soorten kredieten begunstigd : het « roll-over »-krediet en de « straight loans ». Die aanpassing van de produkten vloeit niet alleen voort uit het streven naar een betere voldoening van de wensen van de kliënteel, maar ook uit de behoefte aan een beter evenwicht tussen de activa en de passiva die dan ook scherper volgens hun respectieve vervaldagen dienen gerangschikt. Wanneer de tarieven neerwaarts georiënteerd zijn, zijn de financiële tussenpersonen in principe geneigd liever op lange termijn uit te lenen en middelen op korte termijn in te zamelen. Wanneer de tarieven omhoog gaan, trachten zij eerder op korte termijn uit te lenen en hun middelen op lange termijn op te voeren. Aldus kunnen zij voordeel trekken van de « gapping ».
ln werkelijkheid echter verlopen de zaken vaak anders : de bankier kan niet steeds de looptijden van kredieten of deposito's zelf bepalen; ondanks de branchevervaging blijft hij in sterkere mate gericht op de korte termijn dan wel op de halflange of de lange termijn. Bovendien moet rekening worden gehouden met de invloed van de vroegere verbintenissen. Indien bijvoorbeeld de beleggingen op halflange termijn niet volledig gefinancierd worden door passiva met een gelijkwaardige duur, noopt een omgekeerde rentecurve hem er uiteindelijk toe zijn langlopende activa door kortlopende middelen te financieren, die duurder zouden uitvallen dan de bedongen aktief opbrengsten. ln een periode van stijging of grote labiliteit der tarieven zal de financiële tussenpersoon dus aan middelen trachten te geraken met een zo lang mogelijke looptijd -bijvoorbeeld door kasbons te plaatsen - en zal hij ernaar streven de duur van de aanwendingen te beperken door clausules in te voeren die een frequentere herziening mogelijk maken, wat erop neerkomt vaste tarieven door veranderlijke tarieven te vervangen. Voldoende liquiditeit handhaven is vitaal in tijden van forse druk op de rentetarieven, die meestal samenvalt
(?4/1981
met verkrapping van de geldmarkt. Die inkrimping wordt soms door de monetaire overheid nog in de hand gewerkt om haar kredietbegrenzingsactie te versterken en een speculatie op de munt of een eventuele oververhitting van de bedrijvigheid te voorkomen. Opdat onder die omstandigheden de liquiditeit niet zou worden herschapen ten nadele van het krediet aan de overheidssector, treedt de monetaire overheid dan vaak op om de portefeuilles overheidsfondsen en -papier te blokkeren door beperkingen op te leggen of naar andere beschikbare instrumenten te grijpen. Al houdt de « gapping » meer risico's in perioden van rentelabiliteit in, het parallellisme van de vervaldagen kan vaak moeilijk integraal worden gerespecteerd, en de aanpassingen moeten uiteindelijk vooral met betrekking tot de marge worden gedaan. De kunst van de manager, die ten dele intuilie is, zal erin bestaan een optimale liquiditeit te plannen en te handhaven op grond van het waarschijnlijke verloop van de rentetarieven. Vandaar het belang van de samenstelling van de portefeuille, de mobiliseerbaarheid ervan en de spreiding van de vervaldagen. We vermelden hier de praktijk die zich tel ontwikkeld heeft, in te schrijven op speciaal overheidspapier met aangepaste vervaldag, waardoor de thesaurie nauwkeuriger kan worden beheerd (grafiek 6).
De internationalisatie van ons financieel bestel, en meer bepaald van de banken, maakte de toegang tot werkmiddelen van buitenlandse oorsprong gemakkelijker. De post « bankiers » op het passief van de globale staat der banken nam de jongste jaren fors toe. Via die internationalisatie kon men financiële bronnen aanboren waarvan de rentevoet soms goedkoper uitviel. Aldus trachten de banken gunstiger voorwaarden te ontdekken voor het ontlenen van deviezen voor de financiering van kredieten aan het buitenland of met betrekking tot de buitenlandse handel; men doet echter ook beroep op die hulpbronnen om een groeiend deel van de in België zelf toegestane kredieten te dekken, waarbij men tracht het grootste voordeel uit de rente- en wisselkoersschommelingen te halen. Bij de prognoses in verband met de rentetarieven komen dan nog die van de wisselkoersen (grafiek 7). Er wordt vaker beroep gedaan op de termijnmarkt om dekkingsredenen, want de banken hebben zichzelf het verbod opgelegd, tegen een munt te speculeren. ln principe zal de rentelabiliteit geen weerslag op de deviezenverrichtingen hebben. De toeneming van de arbitrageverrichtingen in crisisperioden is overwegend
(éJ l_î4119a1 537
(.11
w (X)
7Îb I Grafiek 6 : _.,.
----<D (X)
Verhouding overheidspapier tot overheidsfondsen en rentetarieven glijdende gemiddelden 3 maanden
,,. -,o.
J~.
J,.
2,.
IM:RHEIOSPAl'IER TOT OVER~IOSFONOSEN (GEl/l'EN'.IJll 8AHltEN)X100
PORT ,EFrETs f'\JllLICS SUR FONDS rUBLICS IENSEl'8LE. Œ.S 8ANOUESIX100
/• 1 1 • 1 1 1
' ' ' 1 • 1
' 1 ' 1 ' 1
' 1 ' 1 ,' •. ,
: ' ,'
' "'•·"',, ; ' i
., i \ ' ' r--' "''-
• !
20, / \\ I ' '
' ·15. '
i 10,
'.. __ ,,.._,, ' \ \ \. __ ... ,
,' ' ' ' ' ' 1 ,_
\ . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
' 1
\ ' '
Rapport port, effets sur fonds publics et taux d'intérêt moyennes mobiles 3 mois
~ " " " : , '1 1. ' 1 1 ' 1 : ' 1
' 1 1 1 1
' ' ' 1 ,, : ,, ' 1 ,, ' . 1
' ' ' ' 1
' 1 1 1
' . '
fh"l!llilllrlKTMil!I' l\tN ~l'l!NT STMTSFG,OSEN
TX INTEAB~S l'lllNS Tll llfNO, l'OMlS D'ETAT
r• . ' '1 I \
• 1 r ,: \ ' 1
' 1 ' 1
' 1 ' 1 , 1
' 1 ' 1 ! '·
1
·1· ; .. ' '. 1 • 1 1
' 1 ' ! \ : ~ ' t
1 • 1 •
1 ' 1 1
\ ' .
;
' 1
' ' 1 ,, ,
,. ,. ,.
z.
1.
o.
-·•· .z.
5. Il 111111 Il I li 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 'Il Il Il 111111111111111lili111111111 111111111111 11111111 1111 1111111111111111Il1!1111111 Il 1 .. 3.
·1968 1969 1910 1911 1912 ·(913 191t. ·1915 1916 1311 1916 1919 1980 1981
Grafiek 7: Verschil in punten interbanktarief min tarief Eurovaluata's (3 maanden) Ecarts en points TX interbanques moins TX Euro-devises (3mois)
EUP.0-DOLL!IR 15. 15. 10.
10. 10. 5.
5. 5. o.
o. o. -:ç.
-5. . -5. -,o .
EURO-FL 10. 10. 5.
5. 5.
o. o. -5.
-5. . J..t... .. -5. -10 •
EURO-FS 15.
1 lJ 1 "1~- 5.
10.
1 '"· o.
5. ·~~ 5. -5. #. .tfr-.t. '.
·,.@ f,/ -o. o. -10.
16 11 18 19 80 81. 16 11 18
het werk van de kliënten - particulieren en ondernemingen - die tracht zich tegen de wisselkoersrisico's te beveiligen of voordeel te trekken uit de koersschommelingen.
·'
Er wordt vaker beroep gedaan op de termijnmarkt om dekkingsredenen, want de banken hebben zichzelf het verbod opgelegd tegen een munt te speculeren. ln principe zal de rentelabiliteit geen weerslag op de deviezenverrichtingen hebben. De toeneming van de arbitrageverrichtingen in crisisperioden is overwegend het werk van de kliënteel - particulieren en ondernemingen - die tracht zich tegen de wisselkoersrisico's te beveiligen of voordeel te trekken uit de koersschommelingen.
Rendabiliteit De liquiditeit heeft een directe weerslag op de rendabiliteit, onder meer wanneer de werkmiddelen tegen hoge tarieven moeten worden vernieuwd of
1?4/1981
u.,.
~-"·
-5.
-10.
~-"·
-5 •
'· ' ' 1 . .I .. • .. -1'l.
s.
o.
-5.
-10.
19 80 81.
539
540
aangevuld. De rentelabiliteit, die vooral op het vlak van de« bijkomende » werkmiddelen en de hermobiliseringstarieven wordt waargenomen, is dus zeer belangrijk voor het verloop van de rentemarge, die de sleutel tot de rendabiliteit van een financiële instelling is. lk zal dus vooral dat aspect ervan nader toelichten. Het verloop van de rentemarge hangt af van de trend van de nominale tarieven, doch ook van de ontwikkeling van de structuur van de activa, resp. de passiva. Op het eerste gezicht zou de rentemarge moeten verbeteren wanneer de debettarieven stijgen onder de impuls van de geldmarkt, vermits een deel van de credittarieven niet erg gevoelig is voor de op de geldmarkt geboekte hausses (dadelijk opvraagbare deposito's, depositoboekjes en zelfs gewone termijndeposito's ... ). Die zienswijze is echter onjuist, want wanneer de geldmarkt onder druk komt en het beleid van de monetaire overheid restrictief wordt, dan verminderen de mogelijkheden tot hermobilisering aanzienlijk en kan deze laatste slechts tegen alsmaar hogere tarieven geschieden; in het voorkomend geval is er dan een heel systeem van quota's gericht op het doorvoeren van een kwantitatieve rantsoenering. Op de interbankenmarkt bijkomende middelen vinden of grote klientendeposito's aantrekken kost dan steeds maar meer.
Die tariefschommelingen veroorzaken verschuivingen tussen passiva- en activaposten, en een groter deel van de BF-activa dan gewoonlijk moet dan met BF-passiva bankiers worden gefinancierd tegen veel hoger tarieven dan die waarmee de gewone deposito's worden vergoed. ln een tamelijk recent verleden moest een aanzienlijk gedeelte van de financieringen op halflange en lange termijn, dat niet opnieuw kon worden gemobiliseerd wegens het opdrogen van de kapitaalmarkt, worden gefinancierd met kortlopende voorschotten waarvan de kostprijs geruime tijd boven de tarieven van de investeringskredieten en het woonkrediet lag. Voorts dient men ermee rekening te houden dat, zelfs wanneer er tot tariefaanpassingen wordt besloten, deze niet altijd « hic et nunc » op de vervaldagen van de activa en de passiva kunnen worden toegepast. Volgens het type produkt bestaat er vaak een min of meer lange termijn voordat een wijziging in werking kan treden. Globaal ontstaat de rentemarge dus uit het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van de middelen en de gemiddelde opbrengst van de aanwendingen, met dien
[?4/1981
verstande dat eveneens rekening dient te worden gehouden met de tegoeden en verbintenissen onder « bankiers », zulks wegens het gebrek aan evenwicht tussen de aanwendingen en de klientendeposito's. Men moet ook de deviezenverrichtingen onder ogen nemen, die zeer fors zijn toegenomen en waarop de marge, die afhangt van de internationale marktvoorwaarden, betrekkelijk klein is.
De rentemarge nauwkeurig bepalen is voor een financiële instelling een nogal ingewikkelde berekening; het ligt niet in het bereik van wie niet over de bijzonderheden van de interne boekhouding beschikt (detail van de werkmiddelen en van de aanwendingen, van de overeenstemmende rentetarieven, van de vervaldagen). Enige benadering is mogelijk door het onderzoek van de winst- en verliesrekening, mits men bij het nettobedrag van de (geïnde min de vergoede) interesten en provisies de opbrengsten uit de effektenportefeuille en participaties optelt. Dat nettobedrag zou dan tegenover de totale opeisbare passiva kunnen worden gesteld. Dat is echter slechts een zeer benaderende berekening. De rentemarge is uiteraard niet de enige winstbron voor de financiële tussenpersonen; men moet de diverse inkomsten erbij tellen, onder meer uit deviezen- en effectenverrichtingen. Talrijke financiële dienstverleningen worden niet tegen hun kostprijs vergoed of geschieden zelfs kosteloos. Het staat vast dat indien zij gepast werden vergoed, de rentemarge ietwat zou kunnen worden verminderd of ten minste niet zou moeten worden opgetrokken ais gevolg van de druk die de algemene kosten uitoefenen.
De rentelabiliteit oefent ook nog andere invloeden uit op de resultaten van een financiële instelling, met name via de afschrijvingen. Hoge rentetarieven verzwaren de kredietrisico's en leiden uiteraard tot relatief grotere afschrijvingen. Voorts stemt een stijging van de rentetarieven voor de effecten in portefeuille overeen met een vermindering van hun beurswaarde, die logischerwijs ook tot een afschrijving zou moeten aanleiding geven. De rentelabiliteit kan dus mede de omvang bepalen van het gedeelte van de voorzieningen en afschrijvingen dat boven de werkelijke waardevermindering van de activa en het bedrag van de te voorziene verliezen op schuldvorderingen uitstijgt. Men moet ook toegeven dat ze evenmin de verschillende financiële tussenpersonen op dezelfde wijze treft, daar de rentetariefstijgingen een verschillende weerslag uitoefenen volgens de bijzondere
[? 4/1981 541
542
structuur van hun activa en passiva en volgens hun eigen reactievermogen, zoals reeds hoger vermeld.
Stabiliteit Net ais de liquiditeit invloed heeft op de rendabiliteit, is er geen stabiliteit zonder voldoende rendabiliteit. Want stabiliteit betekent niet ontstentenis van groei, doch vastheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Eike financiële tussenpersoon moet een profiel vertonen dat veiligheid uitstraalt. De huidige tijden worden echter gekenmerkt door onzekerheden, onderbroken tempo's, spanningen en desescalaties. Die onregelmatigheden komen in dit geval tot uiting in de rentelabiliteit en slaan over op de structuur van de activa en de passiva, en uiteindelijk op de resultaten van de financiële instellingen. Het feit dat de gemiddelde kostprijs van de werkmiddelen sneller stijgt dan de ontvangsten uit aanwendingen, ongeacht of het om op de kredieten geïnde interesten of om het rendement van de portefeuille gaat, drukt soms zwaar op de winsten van de financiële instellingen. ln het buitenland, waar gelijkaardige toestanden worden waargenomen, hebben sommige banken dit jaar beslist geen dividenden uit te keren om hun eigen middelen veilig te stellen. Een dergelijke toestand spreekt ons scherp aan, en duidt op de ernst van de aan gang zijnde evoluties.
lk zou hier mijn onderwerp niet willen te buiten gaan, doch de aandacht dient op die bekommernis te worden gevestigd. Wellicht kan men naar compensaties zoeken, bijvoorbeeld door het tariferen van de dienstverleningen, door veranderingen in het commerciële beleid, ja zelfs door een herziening van de doelstellingen en het verleggen van de werkgebieden : uitbreiding van « corporate ban king », van de internationale dimensie door het aantal vestigingen in het buitenland op te voeren, zoals weleer van het agentschappennet te lande. Meer op het vlak van het dagelijks beleid noopt de rentelabiliteit, met heel de beperking van de previsionele horizon die ermee gepaard gaat, vooral de manager ertoe zijn technieken te verfijnen, een misschien onverwoorde strategie te ontwikkelen, een beroep te doen op al de facetten van zijn bekwaamheid, die aldus door een verscherpte vindingrijkheid een hoofdbestanddeel van de door de omstandigheden vereiste inspanning tot produktiviteit vormt.
Besluit Mijn conclusie zal kort zijn. De rentelabiliteit doemt voor
[?4/1981
de manager van een financiële instelling op ais een gegeven waarop niet veel af te dingen valt. Zij wordt niet langer enkel door de economische logica bepaald, doch politiek en zelfs psychologie hebben een ruim aandeel erin. De financiële tussenpersonen zijn derhalve niet langer louter omvormers van termijnen. Zij moeten het onzekere beheren om het zoveel mogelijk in -rendabele en produktieve - zekerheden om te zetten. Crisisbeleid wordt dus ook voor hen duidelijk werkelijkheid. Die omvorming is fundamenteler dan ze lijkt. Bevat zij niet in de kiem, waarschijnlijk in tegenstelling met de trend tot branchevervaging van de jongste jaren, een oriëntering naar een nieuwe eigenheid van elke betrokken instelling, in overeenstemming met een vernieuwd profiel, beter aangepast aan de specifieke mogelijkheden die kunnen worden aangewend om aan de meest aanvaardbare behoeften van een duidelijker omlijnde kliënteel te beantwoorden.
Tabel der BF - Rentetarieven begin mei 1981
A. Ontvangen rente
Private sector (eind 1980)
kaskrediet (min. tarief) (GBM) 19,25 (per kwartaal na verloop van de termijn)
gewoon disconto (min. tarief) (GBM) 16,50
hypothecair krediet woonleningen (A.S. L. K.) (gew. woning, lage quota)
13,75
investeringskrediet (N.M.K.N.) (j
(')
(per kwart. na verloop van de termijn) 14,50
ln het kader van de wetten van 1959 en 1970.
(f 4/1981
(15, 75)
(14,25)
(13,75)
(14,00)
543
544
Overheidskrediet
schatkistcertificaten
1 maand 3 maanden
17,00 17,00
certificaten van het rentenfonds 4 maanden 17,00
schatkistcertificaten 6 maanden 16,50
gemiddeld rendement Staatsfondsen + 5 jaar 13,30 (ger)
nieuwe uitgifte Belgische Staat januari 81 13,24
B. Betaalde rente
Gewone deposito 's en rekeningen-courant
Basis
met 1 5 d. opzegging termijnrekeningen
(eind 1980)
1 m 3m 6m
12 m
5,75 6,75 7,50 8,00 9,00
A
6,00 7,00 7,75 8,25 9,25
Depositoboekjes (en gewone getrouwheidspremie) 6,25
Grote deposito 's (5 tot - 20 miljoen BF)
op 1 m 16,25 3 m 16,25 6 m 15,50
12m 14,50
Kasbons
12 m 3 jaar 5 jaar
10 jaar
(p 4/1981
9,00 12,50 13,00 13,00
(1 2,25) (12,75)
(13, 10)
(13,00)
(13,04)
B
6,40 7,40 8, 15
(6,25)
(11 ,63) (12,25) (12,63) (1 2,63)
( 9,00) (1 2,25) (12,50) (12,50)
Gewaarborgd daggeld
(maandgem iddelde)
Tarieven N.B. B.
16,44 april
Gecertificeerde wissels aangerekend op herdiscontoplafon 14,00 Gewone voorschotten 16,00 Voorschot. buiten quota 1 8,00
Herdisconto H. W./.
( 9, 73) (dec.)
(1 2,00) (12,00) (13,00)
Wissels 1 20 dagen aan te rekenen op herdiscontoplafon
N.B.B. 13,90 (11,80)
Door het H. W /. genegocieerde niet bankabele wissels
60 dagen 16,30 (12,00)
lnterbanken (leners)
1 maand 3 maanden 6 maanden
12 maanden
[F4/1981
16,75 16,75 15,88 14,88
(12,13) (12, 75) (13,00) (1 3,00)
545
Volatilité des taux d'intérêt et gestion des institutions financières (*)
(') psM.Dachy
Ixelles 1935. Docteur en droit et Licencié en sciences économiques appliquées de UCL. Actuellement Directeur aux A.G. Securitas, responsable du Département Placements. Adresse : Av. du Verseau, 6, 1410 Waterloo.
Un exposé donné par monsieur M. Dachy à l'occasion de la journée annuelle du Centre d'Etudes Financières, à Bruxelles le 14 mai 1981.
Introduction J'aborderai le sujet de ce jour dans le domaine des assurances sous les trois approches suivantes : d'abord, les influences sur le volume des affaires d'assurance; ensuite, les conséquences sur les actifs de placements et enfin, les effets sur l'équilibre entre les engagements de passif et les actifs représentatifs de ces engagements.
Remarques préliminaires Tout d'abord, quelques constatations : Sur les 20 dernières années, on constate que l'amplitude des mouvements de hausse et de baisse des taux d'intérêt s'est développée; d'autre part, la succession de ces mouvements s'est accélérée; enfin, sur longue période, la suite des minima et des maxima a connu une tendance résolument haussière. Ces constatations sont générales pour tous les taux mais encore plus marquées pour les taux de court terme. A titre illustratif, les minima successifs des taux des certificats de Trésorerie à 3 mois depuis 1960 ont été les suivants: 3,25 - 3 - 3, 75 - 3,5 - 6 - 6 - 5,6 - 7,85 -12, 1. Les maxima de leur côté : 4,5 - 5,8 - 8,5 - 11, 75 -13,5-9,5-10-17,5-17. De leur côté, les crédits hypothécaires ont connu les évolutions suivantes : 6 - 6,5 - 7, 75 - 7, 75 - 10 - 9, 75 pourlesminimaet6,75-8,5-10-12,5-11,5-14,25 % pour les maxima.
[f4/1981 547
548
Une deuxième remarque préliminaire est qu'il convient de distinguer l'influence de la hauteur des taux d'intérêt et celle de la volatilité de ces derniers. Il convient aussi de souligner que les taux d'intérêt sont la résultante de situations économiques et monétaires et que par conséquent il convient d'examiner les effets de ces situations avant tout. Les taux d'intérêt en tant que tels ne sont pas réellement explicatifs si on ne les examine pas en relation avec les situations économiques et monétaires qui les déterminent. Par ailleurs, le niveau comparatif des taux les uns vis-à-vis des autres peut fréquemment entraîner des conséquences de déplacement de choix comme, par exemple, lorsque de façon durable les taux de court terme se situent à des niveaux supérieurs à ceux du long terme. Ceci peut également être vrai lorsque se mêlent à la décision des différences de situation fiscale.
Dernière remarque préliminaire : la volatilité peut provoquer certaines attentes, à la hausse comme à la baisse, avec comme conséquences des freinages ou des accélérations de décisions à caractère souvent perturbateur.
1 Impact au niveau du volume des affaires d'assurances Passons en revue les différents grands types d'assurances.
1.1. Assurance-Vie 1. 1. 1. Particuliers : Les particuliers peuvent envisager de souscrire un contrat d'assurance-vie pour différents motifs :
a) Motivation P.H. La combinaison de taux d'intérêt élevés joints à une situation économique aux perspectives d'emploi et d'évolution des revenus défavorables, constitue un faisceau d'influences dépressives sur les intentions des emprunteurs hypothécaires potentiels. La volatilité des taux, dans la mesure où elle constitue une expression des incertitudes économiques, est un élément négatif supplémentaire. L'influence des attentes de modification de taux est négative aux niveaux de taux actuels même dans une perspective de hausse attendue; dans le cas inverse, l'espoir de baisse doit être tempéré par les attentes plus générales sur le plan de l'emploi et des revenus.
re lr" 4119a1
b) Motivation Epargne L'assurance-vie, en tant qu'instrument pur d'épargne, a besoin de confiance et de stabilité. Dans un contexte de grande volatilité, le climat général n'est pas favorable à l'assurance-vie étant donné l'inquiétude à s'engager à long terme et la concurrence d'autres instruments d'épargne, souvent à court terme à revenus immédiats élevés et d'un degré de discrétion fiscale plus élevé. Il faut aussi signaler que sur le plan fiscal, l'encouragement à l'épargne sous forme d'assurance-vie a considérablement diminué par le non-réajustement des plafonds d'immunisation.
c) Motivation des couvertures des risques de décès Ici également, comme dans le domaine hypothécaire, la situation économique générale défavorable ayant une influence négative sur les achats à crédit, les assurances-décès connexes à ces opérations de financement sont également touchées.
1.1.2. Entreprises: Dans le domaine des assurances de groupes, c'est également la situation générale des entreprises due à l'expansion ou à la régression des données économiques générales qui est déterminante au niveau des résultats de cette branche d'assurance. La progression des rémunérations ou leur modération est également essentielle pour le niveau d'encaissement de primes dans ce secteur d'activité. Ici encore, le niveau des taux d'intérêts et leur volatilité ne sont pas les éléments d'influence déterminants.
1.2. Assurances I.A.R.D. 1. 2. 2. Particuliers : On peut se reporter dans ce domaine à ce qui a été dit au sujet des prêts hypothécaires et donc de la situation du secteur immobilier ainsi qu'au sujet de certains achats, tels l'automobile ou le mobilier. On peut y ajouter également le secteur des vacances. Dans tous ces cas, ce sont les perspectives économiques qui sont déterminantes sur les dépenses des particuliers et par là sur les souscriptions d'assurances qui en découlent. Il en est de même pour les assurances individuelles-accidents ou les assurances contre la maladie, mais cependant ici les craintes engendrées par une détérioration de la situation économique peuvent mener dans certains cas à des souscriptions de précaution.
1?4/1981 549
550
1.2.2. Entreprises: On pourrait croire que le niveau des taux d'intérêt est l'élément essentiel dans la décision d'investir et/ ou d'étendre les affaires existantes. Il est évident que ce niveau entre en ligne de compte dans ce type de décision mais bien plus encore ce seront les perspectives de rentabilité globale de la dépense qui seront décisives et cela dépend très largement des perspectives d'expansion de l'économie en général et de la branche d'activités en particulier. Si, à une situation économique en régression vient s'ajouter un niveau élevé des taux d'intérêt, il est clair que toutes les conditions sont réunies pour un freinage ou même pour une paralysie des dépenses des entreprises avec les effets négatifs induits sur la souscription de polices d'assurances. A titre illustratif, les assurances liées au domaine de la construction, Tous Risques Chantiers, Responsabilité Civile Décennale, Responsabilité Civile des Architectes et Ingénieurs, etc. souffrent particulièrement dans ces situations. Dans ces circonstances défavorables où les affaires sont moins nombreuses, on constate un développement considérable de la concurrence.
Une dernière conséquence négative à signaler, dont les effets se retrouveront au niveau des placements effectués par les Assureurs, est le ralentissement des paiements effectués par les assurés ainsi que le gonflement des soldes de comptes.
2 Influence au point de vue des actifs de placements Une conséquence évidente de la volatilité des taux d'intérêt est la grande difficulté qu'il y a de risquer des prévisions tant en ce qui concerne l'ampleur des mouvements de taux à attendre que le timing de ces mouvements. Cette difficulté supplémentaire pousse tant à la modestie qu'à tout refus des attitudes spéculatives. Au niveau des placements, ce qui a été dit plus haut sur la nécessité de juger de l'effet de taux d'intérêt élevés et/ ou volatiles en relation avec les perspectives économiques du moment est également d'application. c· est ainsi que le niveau de la demande de crédits, tant hypothécaires que pour les entreprises, sera plus influencé par des perspectives de revenus ou de rentabilité médiocres ou mauvaises que par les taux d'intérêt.
[f 4/1981
De leur côté, les investissements immobiliers dans le domaine résidentiel peuvent être favorisés dans le but ,d'acquérir ainsi des valeurs dites réelles. Mais lorsque la différence de rendements, conjuguée avec un ensemble de mesures qui objectivement s'attaquent aux placements immobiliers, dépasse un certain seuil, l'investisseur se décourage et se tourne vers d'autres horizons. c'est-à-dire bien souvent vers des placements à court terme, de haute rentabilité immédiate, sans risque sur le capital nominal et souvent bien protégés des attaques fiscales. Cette évolution précipite le marasme et la diminution des valeurs immobilières. L'assureur qui n'est pas souvent un investisseur immobilier résidentiel n'est donc guère touché directement mais indirectement, l'effet se fait sentir, non seulement sur ses affaires d'assurances comme dit plus haut, mais également sur la valeur de réalisation des gages hypothécaires, ceci dans une période où les difficultés des emprunteurs hypothécaires se multiplient. Dans le secteur des bureaux, c'est également le niveau des affaires qui influence le niveau de la demande et la tenue des loyers. Devant une telle situation, la rentabilité à attendre de ce type de placements n'est guère compétitive par rapport aux opportunités qui se présentent dans d'autres secteurs de placements. De leur côté, les cours en Bourse des actions et des obligations chutent brutalement lors des hausses brusques et importantes des taux d'intérêt. Pour les obligations, les conséquences sur les résultats annuels ne sont pas significatives dès lors que les remboursements à l'échéance ne sont pas compromis ce qui permet de ne pas acter de réduction de valeur. Par contre, en ce qui concerne les actions, cela provoque d'importantes réductions de valeur sauf à considérer avec prudence ces chutes de cours comme des événements passagers.
Dans le cadre des arbitrages d'obligations, c'est-à-dire essentiellement du papier d'Etat côté, les ventes provoqueraient de lourdes pertes si un système judicieux n'existait qui permet de compenser les pertes par l'actualisation des bénéfices attendus de l'arbitrage. On peut encore souligner le danger, dans le domaine des prêts hypothécaires, du développement des remboursements anticipés quand à une montée importante des taux hypothécaires succède une rechute suffisamment importante elle aussi.
(F 4/1981 551
552
3 Influence sur l"équilibre entre les engagements de passif et leurs couvertures d'actifs en ce qui concerne les assurances-vie Jusqu'au début des années 70, les écarts limités entre les minima et les maxima des taux d'intérêt ainsi que la tendance assez plate des taux d'intérêt sur longue période, permettaient aux assureurs de se fonder sur la durée moyenne de leurs engagements qui est à assez long terme, pour en déduire que leurs placements également devaient être envisagés à long terme. Les hausses structurelles des taux d'intérêt et la volatilité de ceux-ci surtout en ce qui concerne le court terme, forcent à analyser les situations de plus près et à constater que la dispersion des durées réelles des engagements autour de la durée moyenne de ceux-ci conduit à s'interroger sur les durées des placements à réaliser pour qu'un juste parallélisme existe entre la loi d'extinction des réserves de passifs et l'extinction d'actifs correspondants acquis à l'époque de la constitution de chaque tranche annuelle de réserve.
[p 4/1981
Bons de caisse et capitalisation
Problèmes de cohérence dans les taux d'intérêt
par Pierre Van Ossel
Bruxelles 1930. Licencié en sciences mathématiques (1967) de l'Université Libre de Bruxelles. Au service du Crédit Communal de Belgique depuis 1946, où il s· occupa entre autres de planification financière. Actuellement conseiller scientifique. Adresse : rue Timmermans 4B 11 90 Bruxelles
1 Introduction Traditionnellement un bon de caisse est un titre doté de coupons annuels tous de même montant et tel que la valeur de remboursement à l'échéance finale soit identique à la valeur d'émission. A côté de ces bons de caisse traditionnels sont apparus progressivement sur le marché, des bons dépourvus de coupon et dont les intérêts sont capitalisés jusqu'à l'échéance finale. C'est ce que nous appelons des bons de capitalisation. Lorsqu'une banque émet des bons de caisse traditionnels et désire compléter la gamme des placements qu'elle offre à sa clientèle, en émettant également un bon de capitalisation, elle se trouve confrontée par le fait même, à un problème de cohérence entre les taux d'intérêts. Faut-il attribuer à ce nouveau bon un taux d'intérêt composé moins élevé que celui accordé aux bons ordinaires de même durée, ou bien au contraire faut-il lui accorder un taux d'intérêt plus élevé ?
Sur base d'une démarche empirique, les banques optent en général pour la première éventualité qui leur paraît plus avantageuse. Nous allons montrer qu'en réalité c'est la seconde éventualité qui devrait être retenue si la question est traitée rigoureusement. La méthode exposée est absolument générale et il
[f 3/1981 553
554
serait tentant pour un mathématicien, de la traiter en tant que telle sur le mode abstrait qui lui est familier. Nous avons cependant préféré raisonner sur un exemple numérique en supposant un bagage mathématique minimum, car notre but est de montrer que la méthode est non seulement rigoureuse mais aussi beaucoup plus simple d'application que tout ce qui a été imaginé jusqu'ici. En fait, elle est basée sur le principe de /'additivité des prix à l'exclusion de toute autre axiome à la base de l'algèbre financière.
2 Une méthode empirique Avant d'aborder la méthode rigoureuse, il est intéressant de considérer une des méthodes parmi celles qui viennent facilement à l'esprit des comptables et des experts financiers et qui semblent justifier a priori un taux de capitalisation inférieur au taux facial du bon de caisse.
Nous supposons que les taux des bons de caisse ordinaires soient les suivants :
Ci= 4 %, C2 = 5 %, C3 = 6 %, C4 = 7 %, Cs= 8 %
Les indices se référant à la durée des bons. Considérons cinq bons de capitalisation de 1 F valeur d'émission et de durées respectives 1, 2. 3, 4, 5 ans. Les valeurs de remboursement à déterminer seront désignées par
U1 , U2 , U3 , U4 , Us respectivement.
Les formules généralement utilisées par les comptables sont alors les suivantes :
U1 = 1 + C1
U2 = 1 + C2 (1 + U1)
U3 = 1 + C3 (1 + U1 + U2)
U4 = 1 + C4 (1 + U1 + U2 + U3)
Us = 1 + Cs (1 + U1 + U2 + U3 + U4)
Si nous prenons le bon de capitalisation à 3 ans par exemple, la troisième équation suppose que les intérêts de la première année doivent être replacés pour deux ans et ceux de la deuxième année doivent être replacés pour 1 an. De même pour les autres équations.
Ces calculs donnent :
U1 = 1,0400 soit i1 = 4,00 %
U2 = 1, 1020 i2 = 4,98 %
U3 = 1, 1885 i3 = 5,93 %
U4 = 1,3031 i4 = 6,84 % Us= 1,4507 is = 7, 72 %
Lf311981
( 1)
(2)
Les taux moyens de capitalisation se calculent par :
1 n
in= Un - 1 Pour séduisantes que soient ces formules, les résultats sont néanmoins faux. En effet, l'introduction d'échéances annuelles fictives où les intérêts doivent obligatoirement être replacés pour un nouveau terme, ne correspond à aucune réalité. Il faut être tombé dans ce piège et avoir tenté d'en sortir par soi-même pour apprécier la simplicité de la véritable solution qui va suivre.
3 Espace des ventes Nous appelons bon de caisse en général tout titre comportant des promesses de paiement parfaitement déterminées tant en ce qui concerne le montant que l'échéance. Le titre ne doit comporter aucune option. En d'autres termes nous sommes dans la théorie des opérations financières certaines. Deux bons de caisse X1 , X2 peuvent s'additionner et nous désignerons par X1 + X2 le bon de caisse qui rèprend sur un titre unique l'ensemble des promesses de X 1 et de X2 . Le prix d'émission du bon de caisse X sera désigné par p(X). Ce prix est censé jouir de la propriété d'additivité :
p (X1 + X2) = p (X1) + p (X2)
Si X est un bon de caisse et si k est une constante, nous désignerons par kX le bon de caisse obtenu en multipliant tous les montants de X par le nombre k . Donc si Ys est un bon de caisse ordinaire de 1 F nominal muni de 5 coupons de 0,08 F, le bon de caisse,
100.000 Ys, sera un bon de caisse de 100.000 F nominal muni de 5 coupons de 8.000 F.
Il résulte de l'additivité des prix que
p(kX) = kp(X)
et plus généralement :
p(k1X1 + k2X) = k1 p(X1) + k2 p(X2)
Ceux qui ont un tant soit peu étudié la mathématique moderne, reconnaîtront sans peine que l'ensemble des bons de caisse algébriquement possibles, constitue un espace vectoriel V et que le prix p est une forme linéaire sur V. Nous appelerons V l'espace des ventes.
(?3/1981
(3)
(4)
(5)
555
556
Les considérations précédentes peuvent s'appliquer à n'importe quel commerce de détail P.t n'ont absolument rien d'extraordinaire.
4 Résolution du problème Soient Y1 , Y2 , Yi , Y4 , Ys les bons de caisse ordinaires de valeur nominale 1 F et dont les durées vont de 1 à 5 ans. Les coupons de ces bons sont respectivement :
C1 = 0,04, C2 = 0,05, Ci = 0,06, C4 = 0,07, Cs = 0,08 comme précédemment.
Soient Z1 , Z2 , Zi , ~ , Zs les bons de capitalisation dont la valeur de remboursement est de 1 F et dont les durées vont de 1 à 5 ans.
Entre les bons ordinaires et les bons de capitalisation existent les relations :
Y1 = 1,04 Z1 Y2 = 1 ,05 Z2 + 0,05 Z1 Yi = 1,06 Zi + 0,06 (Z, + Z2) Y4 = 1 ,07 Z4 + 0,07 (Z, + Z2 + Zi) Ys = 1,08 Zs + 0,08 (Z, + Z2 + Zi + Z4)
Il est beaucoup plus clair d'utiliser la notation matricielle
Y, 1,04 Y2 0,05 1,05 Yi = 0,06 0,06 1,06 y4 0,07 0,07 0,07 1,07 Ys 0,08 0,08 0,08 0,08 1,08
que nous pouvons abréger en
Y = AZ
lnversément les bons de capitalisation s'expriment en fonction des bons ordinaires
Z = BY
avec B= A-' désignant la matrice inverse de A.
La dernière équation matricielle s'écrit de façon non abrégée sous la forme :
z, 0,962
Z2 - 0,046 0,952 Zi = - 0,052 - 0,054 0,943 z4 - 0,057 - 0,059 - 0,062 0,935
z, Z2 Zi z4 Zs
Zs - 0,060 - 0,062 - 0,065 - 0,069
Ceux qui ne sont pas familiers avec le calcul matriciel peuvent obtenir les mêmes relations en résolvant les
(p 3/1981
0,926
(6)
(7)
(8
équations (6) de proche en proche à partir de la première. Les bons de caisse ordinaires et les bons de capitalisation forment deux représentations équivalentes de l'espace des ventes.
Posons maintenant
Vn = P(Z..n) pour n = 1, 2, 3, 4, 5.
Les vn sont donc les valeurs d'émission des bons de capitalisation Zn . A partir des équations (8) et en utilisant la propriété additive des prix nous trouvons :
+ 0,952 - 0,054 + 0,943 - 0,059 - 0,062
(9) = 0,962 = 0,906 = 0,837 = 0,757
V1 = 0,962 V2 = - 0,046 V3 = - 0,052 V4 = - 0,057
Vs = - 0,060 - 0,062 - 0,065 + 0,935 - 0,069 + 0,926 = 0,670
Par exemple, la relation pour V3 s'obtient à partir de la 3• des relations (8) :
Z3 = - 0,052 Y1 - 0,054 Y2 + 0,943 Y3
p(ZJ) = - 0,052 P(Y1) - 0,054 P(Y2) + 0,943 p(Y3)
V3 = - 0,052 - 0,054 + 0,943 = 0,837
car évidemment et par hypothèse : p(Y n) = 1 pour tout n.
Par la relation Un = 1 / vn , nous trouvons la valeur de remboursement des bons de capitalisation de 1 F, valeur d'émission.
U1 = 1,040 (10) U2 = 1,103
U3 = 1,194 U4 = 1,320
Us = 1,494
D'où les taux d'intérêt composés:
i1 = 4 %, i2 = 5,03 %, i3 = 6,08 %, i4 = 7, 19 %, is = 8,36 %
qui sont donc les valeurs exactes des taux cherchés.
5 Taux d'intérêt marginaux Le taux marginal in est par définition le taux d'intérêt offert pour une année additionnelle de placement décidée au moment de la souscription. Il se calcule par la formule
(p 3/1981
(1 1)
557
558
n = 1, 2, 3, 4, 5
Le calcul donne dans l'exemple que nous avons retenu :
i1=4%, i2=6,06%, j3=8,23%, j4= 10,57%, is= 13,17%.
Les taux marginaux ont à notre avis beaucoup plus de signification en marketing que les taux nominaux que l'on considère habituellement. Ils constituent en effet, une mesure de l'avantage financier qui invite le client à choisir des termes de plus en plus longs. Nous ne pouvons approfondir ce point car le temps est venu de tirer une conclusion : La méthode exposée permet d'attribuer des taux d'intérêt plus justes à certains placements et ouvre la porte à une analyse rationnelle des taux dont le marketing et la recherche opérationnelle pourraient tirer le meilleur profit.
Références générales
R. BALLIEU et F. SIMONART, ALGEBRE Librairie universitaire Louvain Gauthier-Villars, Paris.
M. MAURICE, Les opérations financières et viagères Editions comptables commerciales et financières, Bruxelles.
J. LECAILLON, Analyse micro-économique Ed. CUJAS, Paris.
J. BOUTELOUP, Calcul matriciel élémentaire Que sais-je? n' 927, Presse universitaire de France.
(p3/19B1
De banken binnen de financiële sektor
Enige vergelijkende gegevens
Het Tijdschrift voor Bank- en Financiewezen publiceert sinds 1977 jaarlijks een klassement van de Belgische financiële instellingen volgens hun balanstotaal en het totaal van hun deposito's. De onderstaande lijst is de bijwerking voor het jaar 1 980. De auteurs houden eraan te herinneren dat deze lijst geen precieze rangschikking beoogt te zijn waaraan enigerlei intrinsieke waarde zou zijn verbonden. Het enige opzet is een kader te leveren dat toelaat, volgens kriteria met precieze ekonomische betekenis, een geheel van instellingen, met naargelang de branchevervaging vordert steeds nauwer bij mekaar aanleunende bedrijvigheden, tegenover elkaar te situeren.
1 Rangschikking der openbare kredietinstellingen, banken, privéspaarkassen en kredietmaatschappijen volgens hun balanstotaal voor het boekjaar 1 980
Sector Naam
C
j ~ ~ S2 C ::!!:
a.. 0 ~ if ~
A B C D
u:aJ C a,
Cl C
~g ml
1 B GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ 1.002.215 2 A GEMEENTEKREDIET VAN BELGIE 698. 707 3 B BANK BRUSSEL LAMBERT (30.9.80) (1) 692.001 4 A ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS (2) 679.709 5 B KREDIETBANK (31.3.81) 486.327 6 A NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR KREDIET A/D NIJ-
VERHEID 341.239 7 B CREDIT LYONNAIS 316.986
(p 4/1981 559
A (1) Openbare kredietinstellingen. Voor de instellingen wier boekjaar
niet op 31 december eindigt is de B afsluitingsdatum weergegeven De « Banque Belge pour tussen haakjes achter hun naam. I' Etranger » , die geen bankactiviteiten in België heeft, is (2) niet in de rangschikkingen Uitsluitend de spaarkas. opgenomen.
(3) C Ondememing die weliswaar Privéspaarkassen. onderworpen is aan de wet van
10.6.1964 maar wier D hoofdactiviteit niet gevormd wordt Kredietmaatschappijen, d.w.z. door het aantrekken van ondememingen ingeschreven deposito's en het vertenen van overeenkomstig artikel 2, § 1, van kredieten. de wet van 10 juni 1964.
8 C CENTRALE RAIFFEISENKAS (CERA) 148.143
9 B THE SUMITOMO BANK (31.3.81) 132.903
10 C BELGISCHE ARBEIDERSCOOPERATIE (BAC) 132.465
11 B BANQUE EUROPEENNE DE CREDIT 107.469
12 B BANK VAN PARIJS EN DE NEDERLANDEN BELGIE 103.294
13 B MORGAN GUARANTY TRUST CY OF N.Y. 97.850
14 C ANlWERPSE HYPOTHEEKKAS (AN-HYP) 94.432
15 B INTERNATIONAL WESTMINSTER BANK 93.856
16 B BANQUE NATIONALE DE PARIS 87.802 17 B THE MITSUI BANK (31.3.81) 84.335
18 A NATIONALE KAS VOOR BEROEPSKREDIET 73.990 19 B CITIBANKN.A. 71.804 20 B BARCLAY$ BANK INTERNATIONAL 66.795 21 C BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ EN SPAAR-
KASIPPA 54.803 22 B CONTINENTAL BANK 46.639 23 B ALGEMENE BANK NEDERLAND 44.356
24 B BANQUE EUROPEENNE ARABE 38.734
25 C HYPOTHEEK- EN SPAARMAATSCHAPPIJ VAN ANT-WERPEN 37.432
26 B THE SANWA BANK (31.3.81) 37.239 27 A NATIONAAL INSTITUUT VOOR LANDBOUWKREDIET 34.864
28 B CHEMICAL BANK 34.755
29 A CENTRAAL BUREAU VOOR HYPOTHECAIR KREDIET 32.300
30 B THE BANK OF TOKYO (31.3.81) 32.037
31 B DEUTSCHE BANK 31.609
32 B CREDIT GENERAL 31.540
33 B BELGO-ZAIRESE BANK 30.250
34 B THE TAIYO KOBE BANK (31.3.81) 28.950 35 B THE FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO 27.989
36 B HANDELSBANK 27.427
37 B BENELUX BANK (31.3.81) 23.535 38 B SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE 23.211
39 B BANK VAN ROESELARE EN WEST-VLAANDEREN 22.670
40 B BANK OF AMERICA 22.143 41 C SPAARKREDIET 20.656
42 D FIDISCO 20.516 43 B MANUFACTURER$ HANOVER BANK 19.333
44 B AMRO BANK VOOR BELGIE 19.103
45 D KREDIETMAATSCHAPPIJ IPPA 19.040
46 B FAMIBANK 18.563 47 C HYPOTHECAIRE BELEGGINGSKAS 18.189
48 C CODEP 17.122
49 B BANK NAGELMACKERS (30.9.80) 16.468
560 lP 4/1981
50 B NIPPON EURO PEAN BANK (31.3.81) 16.277
51 B BANQUE EUROPEENNE POUR L'AMERIQUE LATINE (30.6.80) 15.213
52 B ANlWERPSE DIAMANTBANK (31.3.81) 14.560
53 B MITSUBISHI BANK (EUROPE) 14.395
54 B BANQUE SUD BELGE 12.469
55 B BANK IPPA 12.056
56 B COMMERZBANK 11.952
57 C VOLKSDEPOSITOKAS 11.733
58 B BELGISCHE BANK VOOR INDUSTRIE 11.379
59 B CREDIT DU NORD BELGE 11.333
60 B BANK DEGROOF (30.9.80) 10.844
61 C ONDERLING HYPOTHECAIR KREDIET 10.587
62 D ARGENTA 9.872
63 B BANK J. VAN BREDA & C0 8.821 64 C ATLANTA 8.506
65 B INTERNATIONALE HANDELS- EN DIAMANTBANK 8.221
66 B BANCO Dl ROMA (BELGIO) (30.6.80) 8.194
67 C ASSUBEL-SPMRKAS 7.861
68 C EURAL 7.601
69 B LLOYDS BANK INTERNATIONAL (30.9.80) 7.587
70 C ANlWERPSE MMTSCHAPPIJ VOOR DEP. EN HY-POTHEKEN 6.939
71 B BANK COPINE 6.632
72 B PRIVATE KAS BANK 6.549 73 B BANCO DO BRASIL 6.329 74 D MERCATOR (3) 6.326 75 B MTBC & SCHRODER BANK 6.310 76 D KREFIMA 6.236 77 C ASPA 5.480 78 B BYBLOS ARAB FINANCE BANK 4.757 79 B CREDIT COMMERCIAL DE MONS 3.916 80 B MITSUI TRUST BANK (31.3.81) 3.723 81 B EUROPABANK 3.672 82 B SOFIBANK 3.492
83 B SAIT AMA BANK (van maart tot december 80) 3.471
84 B THE BANK OF NOVA SCOTIA (31.10.80) 3.219
85 C ALCREDIMA 3.212
86 D FIGEBEL-HYPOFINA 3.109 87 B SLAVENBURG'S BANK 3.109
88 B BANQUE DU CREDIT LIEGEOIS 2.907
89 C DE LUIKSE GRONDMMTSCHAPPIJ 2.814
90 B EUROPESE BANK VOOR HET MIDDEN OOSTEN 2.663
91 B HANDELSDISKONTO BANK 2.383 92 B BANK OF BARODA 2.368 93 B BANKUNIE 2.180 94 C WESTVLAAMSE HYPOTHEEKKAS 2.173 95 B BANK MAX FISCHER 2.089 96 B BANKGROEP BANK- EN BEHEERMMTSCHAPPIJ 1.936 97 C BELGISCHE ZEE- EN BINNENVMRT KREDIETMMT-
SCHAPPIJ 1.673 98 B STANDARD CHARTERED BANK 1.657 99 B BANCO EXTERIOR BELGICA 1.550
100 D HYPOTHEEK- EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ 1.389 101 D EPECE (3) 1.353 102 B O. de SCHAETZEN & Cie BANKIERS 1.347 103 B BANQUE DREZE 1.311 104 B TIENSE BANK (30.9.80) 1.248 105 B GEOFFREY'S BANK (30.6.80) 1.187 106 C LANDSSPMRKAS 1.165 107 D HYPOTHEEK- EN KAPITALISATIEMMTSCHAPPIJ 987
[?4/1981 561
108 B ALLIED IRISH BANKS (31.3.81) (van jan. tot maart) 963
109 D KREDIET ARFIN 848 110 C MINERVE 753
111 B HABIB BANK 738
112 C DE FAMILIE 708
113 B BANK VOOR KOOPHANDEL VAN BRUSSEL 672
114 D SODECREDI 655
115 B METROPOLITAN BANK (31.3.81) 643
116 B BANQUE DE BIENNE 598
117 C CAISSE D'EPARGNE ET DE DEPOTS D'OUGREE 552
118 D WESTKREDIET 548
119 B SCALDISBANK 450 120 D DE VERENIGDE VERZEKERDEN - LEVEN (3) 436
121 D HULPKAS VOOR VOLKSKREDIET 386 122 C FIGEBEL 385
123 D GENTSE KREDIETMAATSCHAPPIJ 382
124 C DE EUROPESE VERENIGING SPAARKAS EURESPAS 306 125 B BEECKMANS, GHEYSENS, VANDERLINDEN & Cie 301
126 C A.G.F. 291
127 B BANK VAN SINTE MARIABURG 278
128 D CENTRALE KREDIETVERLENING 276
129 D BELGISCHE HYPOTHEEK- EN GRONDLENINGSKAS 271
130 D LEEN- EN DEPOSITOKAS 254
131 D HANDELS- EN KREDIETMAATSCHAPPIJ 252
132 D EURAL UNITAS (3) 195
133 B BANK CHAABI VAN MAROKKO IN BELGIE 191
134 D FINANCIELE VENNOOTSCHAP GB-INNO-BM 171
135 C CAISSE RURALE DE NIVEZE 151
136 B BANCO CENTRAL 149
137 C DE VRIJWILLIGE VOORZORG 93 138 C MAURETUS 86 139 D FIMEN 72 140 D CREDITO 66
141 C SPAARKAS VAN DE A.G.-GROEP -AGESPAR 55 142 D NAKREMA 40
143 C SEFB - SPAARKAS VIH PERSONEEL DER OPENBARE
BESTUREN 24
144 D HYPOTHEEK- EN GRONDUNIE 7
562 (F 4/1981
2 Rangschikking der openbare kredietinstellingen, banken, privéspaarkassen en kredietmaatschappijen volgens hun totaal aan deposito"s. obligaties en kasbons voor het boekjaar 1980
Sector Naam CL cc C
C 0) ~ 23 Jl ig "' ~
:,.:: ..!li C
~ ~ I o. 0 ~ :,.::
A B C D
1 A GEMEENTEKREDIET VAN BELGIE 619.505 2 A ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS (2) 612.847
3 B GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ 527.584 4 B BANK BRUSSEL LAMBERT (30.9.80) (1) 324.479
5 B KREDIETBANK (31.3.81) 289.295
6 A NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR KREDIET A/ D NIJVERHEID 283.261
7 C CENTRALE RAIFFEISENKAS (CERA) 133.720
8 C BELGISCHE ARBEIDERSCOOPERATIE (BAq 120.733
9 C ANlWERPSE HYPOTHEEKKAS (AN-HYP) 84.056
10 A NATIONALE KAS VOOR BEROEPSKREDIET 66.549
11 C BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ EN SPAARKASIPPA 50.211
12 B BANK VAN PARIJS EN DE NEDERLANDEN BELGIE 40.259
13 C HYPOTHEEK- EN SPAARMAATSCHAPPIJ VAN ANlWERPEN 34.355
14 A NATIONAAL INSTITUUT VOOR LANDBOUWKREDIET 29.585
15 B CREDIT LYONNAIS 21.412
16 A CENTRAAL BUREAU VOOR HYPOTHECAIR KREDIET 19.132 17 B BANK VAN ROESELARE EN WEST-VLAANDEREN 18.991
18 B MORGAN GUARANTY TRUST CY OF N.Y. 18.594
19 B CREDIT GENERAL 17.865
20 C SPAARKREDIET 17.383
21 C HYPOTHECAIRE BELEGGINGSKAS 16.958
22 D KREDIETMAATSCHAPPIJ IPPA 16.847
23 B INTERNATIONAL WESTMINSTER BANK 16.465
24 C CODEP 15.989
25 B BELGO-ZAIRESE BANK 14.728
26 B FAMIBANK 14.674
27 B BANK NAGELMACKERS (30.9.80) 13.669
28 B BANQUE SUD BELGE 11.316
29 C VOLKSDEPOSITOKAS 11.186
30 D FIDISCO 10.718
31 B HANDELSBANK 10.480
32 B BENELUX BANK (31.3.81) 10.265
33 B BANK IPPA 10.016
34 B CONTINENTAL BANK 8.684
35 B BANQUE NATIONALE DE PARIS 8.585
36 B CREDIT DU NORD BELGE 8.579
37 C ONDERLING HYPOTHECAIR KREDIET 8.462
38 B BARCLAYS BANK INTERNATIONAL 8.409
39 D ARGENTA 8.110
40 B SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE 7.569
41 B BANK J. VAN BREDA & C0 7.530
42 B BANQUE EUROPEENNE DE CREDIT 7.489
43 B BANK DEGROOF (30.9.80) 7.308
~ 4/1981 563
44 C EURAL 7.010
45 C ASSUBEL- SPAARKAS 6.560
46 B BELGISCHE BANK VOOR INDUSTRli:: 6.192
47 C ATLANTA 6.089
48 B PRIVATE KAS BANK 5.995
49 C ANlWERPSE MAATSCHAPPIJ VOOR DEP. EN HYPOTHEKEN 5.778
50 B BANK COPINE 5.204
51 B ALGEMENE BANK NEDERLAND 5.054
52 D KREFIMA 4.972
53 C ASPA 4.801
54 B CITIBANK N.A. 4.468
55 B BANCO Dl ROMA (BELGIO) (30.6.80) 4.367
56 B BANQUE EUROPEENNE POUR L'AMERIQUE LATINE (30.6.80) 4.303
57 B URERS HANOVER BANK 4.274
58 B BANK OF AMERICA 3.364
59 B CREDIT COMMERCIAL DE MONS 3.314
60 B EUROPABANK 3.297
61 B MITSUI BANK (31.3.81) 2.970
62 B ANlWERPSE DIAMANTBANK (31.3.81) 2.775
63 C DE LUIKSE GRONDMAATSCHAPPIJ 2.653
64 B BANQUE DU CREDIT LIEGEOIS 2.470
65 D FIGEBEL- HYPOFINA 2.416
66 B BYBLOS ARAB FINANCE BANK 2.301
67 B SOFIBANK 2.193
68 C WESTVLAAMSE HYPOTHEEKKAS 2.158
69 B HANDELSDISKONTO BANK 2.111
70 B BANKUNIE 2.048
71 B EUROPESE BANK VOOR HET MIDDEN OOSTEN 1.999
72 B LLOYDS BANK INTERNATIONAL (30.9.80) 1.931
73 B BANK MAX FISCHER 1.888
74 C ALCREDIMA 1.878
75 B BANQUE EUROPEENNE ARABE 1.581
76 B INTERNATIONALE HANDELS- EN DIAMANTBANK 1 567 77 B BANKGROEP BANK- EN BEHEERMAATSCHAPPIJ 1.550
78 B AMRO BANK VOOR BELGIE 1.476
79 B BANK OF BARODA 1.446
80 B BANQUEDREZE 1.162
81 B DEUTSCHE BANK 1.160
82 B TIENSE BANK (30.9.80) 1.123
83 B SLAVENBURG'S BANK 1.116
84 B BANCO EXTERIOR BELGICA 1.088
85 C LANDSSPAARKAS 1.004
86 D HYPOTHEEK- EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ 997 87 B COMMERZBANK 992
88 B THE FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO 917
89 B GEOFFREY'S BANK (30.6.80) 889
90 B O. de SCHAETZEN & Cie BANKIERS 820 91 C BELGISCHEZEE- EN BINNENVAART
KREDIETMAATSCHAPPIJ 799
92 B CHEMICAL BANK 760
93 D HYPOTHEEK- EN KAPITALISATIEMAATSCHAPPIJ 725
94 B THE SUMITOMO BANK (31.3.81) 650
95 C DE FAMILIE 645
96 C MINERVE 638 97 B THE BANK OF TOKYO (31.3.81) 575
98 B HABIB BANK 575 99 D KREDIET ARFIN 560
100 B MTBC & SCHRODER BANK 529 101 B BANK VOOR KOOPHANDEL VAN BRUSSEL 526
564 [F4/1981
102 B METROPOLITAN BANK (31.3.81) 501
103 C CAISSE D'EPARGNE ET DE DEPOTS D'OUGREE 494
104 B BANQUE DE BIENNE 455
105 B SCALDISBANK 347
106 C FIGEBEL 345
107 C DE EUROPESE VERENIGING • SPAARKAS EURESPA 272
108 B STANDARD CHARTERED BANK 256
109 D HULPKAS VOOR VOLKSKREDIET 242
110 D WESTKREDIET 231
111 B BEECKMANS, GHEYSENS, VANDERLINDEN & Cie 229
112 C A.G.F. 226
113 B THE BANK OF NOVA SCOTIA (31.10.80) 222
114 B BANK VAN SINTE MARIABURG 213
115 D MERCATOR (3) 208
116 D BELGISCHE HYPOTHEEK- EN GRONDLENINGSKAS 203
117 D HANDELS- EN KREDIETMAATSCHAPPIJ 191
118 D CENTRALE KREDIETVERLENING 184
119 D LEEN- EN DEPOSITOKAS 151
120 B THE TAIYO KOBE BANK (31.3.81) 144
121 C CAISSE RURALE DE NIVEZE 137
122 B THE SANWA BANK (31.3.81) 132
123 D DE VERENIGDE VERZEKERDEN • LEVEN (3) 129
124 D FINANCIELE VENNOOTSCHAP GB-INNO-BM 108
125 D GENTSE KREDIETMAATSCHAPPIJ 90
126 C DE VRIJWILLIGE VOORZORG 80
127 D SODECREDI 61
128 D CREDITO 54
129 D EPECE (3) 42
130 B MITSUBISHI BANK (EUROPE) 40
131 B BANCO CENTRAL 34
132 D EURAL UNITAS (3) 26
133 B BANK CHAABI VAN MAROKKO IN BELGIE 25
134 C MAURETUS 18
135 D NAKREMA 18
136 B BANCO DO BRASIL 16
137 C SEFB. SPAARKAS V/H PERSONEEL DER OPENBARE
BESTUREN 12
138 D FIMEN 2
139 B NIPPON EUROPEAN BANK (31.3.81) 1
140 B SAITAMA BANK (van maart tot december 80) 0,3
141 B ALLIED IRISH BANKS (31.3.81) (van jan. tot maart) 0,3
142 D HYPOTHEEK- EN GRONDUNIE o. 1
143 C SPAARKAS VAN DE AG.-GROEP • AGESPAR 0
144 B MITSUI TRUST BANK (31.3.81)
~ 4/1981 565
566
3 De voornaamste in België gevestigde banken, naar het balanstotaal en het totaal der deposito•s (dienstjaar 1980, miljarden BF)
Balanstotaal
GBM A 1.002,2 BBL A 692,0 KB A 486,3 Crédit Lyonnais D 317,0 Sumitomo D 132,9 BEC C 107,5 Paribas B 103,3 Morgan D 97,9 Westminster D 93,9 BNP D 87,8 MitsuiBank D 84,3 Citibank D 71,8 Barclays D 66,8 Continental Bank B 46,6 ABN D 44,4
Banque Eur. Arabe C 38,7 SanwaBank D 37,2 Chemical Bank D 34,8 The Bank of Tokyo D 32,0 Deutsche Bank D 31,6
Cliëntendeposito · s
GBM A 527,6 BBL A 324,5 KB A 289,3 Paribas B 40,3 Crédit Lyonnais D 21.4 Bank van Roeselare A 19,0 Morgan D 18,6 Crédit Général A 17,9 Westminster D 16,5 Belgo-Zaïrese Bank A 14,7 Famibank B 14,7 Bank Nagelmackers A 13,7 Banque Sud Belge A 11,3 Handelsbank B 10,5 Benelux Bank B 10,3 Banklppa A 10,0 Continental Bank B 8,7 BNP Crédit du Nord Barclays
D 8,6 B 8,6 D 8,4
A Bank naar Belgisch recht met Belgische meerderheid. B Bank naar Belgisch recht, filiaal of subfiliaal van buitenlandse bank(en). C Consortium met buitenlandse meerderheid. D Bank naar buitenlands recht.
4 Aandeel van de vier groepen instellingen in het geheel van de financiële sector op 31 december 1980, in miljarden BF en in%
OKI Banken PSK KM
Balanstotaal 1.861 4.106 596 74 28,04 % 61,87 % 8,98 % 1 , 11 %
Clïentendeposito' s 1.631 1.475 535 47 44,22 % 40,00 % 14,51 % 1,27 %
[p 4/1981
Procès-verbal du jury du prix C.O.B. 1980
Chaque année un grand nombre d'auteurs présentent leurs ouvrages souvent de très bonne qualité, dans l'espoir d'obtenir le prix C.0.B. Il s'agit essentiellement de travaux de doctorat ou de post-doctorat réalisés dans des universités belges ou étrangères. Pour le prix 1980, nous avons reçu 17 ouvrages, dont 9 de la part d'auteurs francophones et 8 de la part d'auteurs néerlandophones. Huit textes étaient en français, 5 en anglais et 4 en néerlandais. La grande valeur scientifique de ces ouvrages est déjà en soi une preuve vivante que le prix C.0.B. a stimulé et orienté considérablement la recherche économique vers des problèmes monétaires et financiers. Le jury se réjouit de la quantité des ouvrages reçus, bien que cette abondance n'ait pas facilité son choix. Néanmoins, le jury s'est prononcé à l'unanimité et sans hésitation en faveur d'un seul ouvrage pour le prix; il s'agit de l'étude du Dr Paul Reding, intitulée« Le refinancement bancaire et l'offre de monnaie en Belgique 1960-1978 ».
Cet ouvrage est issu d'une thèse de doctorat, qui a été approfondie et actualisée pour l'obtention du prix C.0.B.
Monsieur Paul Reding est né à Luxembourg, le 2 août 1950. Après ses études secondaires au collège épiscopal de Saint-Vith, il obtint la licence et maîtrise en sciences économiques et sociales aux Facultés Universitaires Notre-Dame-de-la-Paix à Namur. Il continua ses études aux Universités de Constance et de Rochester sous la direction du professeur Karl Brunner et fit aussi un séjour de quelques mois à l'université de Bern. Comme aspirant du Fonds National de la Recherche Scientifique, et sous la direction du professeur Jacques de Groote, il obtint en 1978 le doctorat en sciences économiques et sociales aux Facultés de Namur. Actuellement Monsieur Paul Reding est chargé de cours associé à cette institution. Comme le titre le suggère, l'ouvrage est consacré au
(F 4/1981 567
568
comportement de refinancement des banques dans le contexte institutionnel propre à la Belgique. On recherche plus précisément dans quelle mesure ce comportement bancaire constitue une entrave pour une politique monétaire qui serait fondée sur la gestion d'agrégats monétaires. On étudie également si et comment l'existence de ce mécanisme de refinancement confirme ou infirme la thèse de la causalité inverse entre création de monnaie et activité économique. Une réponse négative à cette problématique est en effet cruciale pour les thèses monétaristes en matière de politique de stabilisation. Dans son étude, Monsieur Reding, couvre un domaine qui a déjà été exploré par d'autres avant lui, mais son approche se distingue très nettement de ce qui a déjà été réalisé jusqu'à présent, tant par l'originalité du schéma conceptuel auquel il a été fait appel au niveau théorique que par la rigueur avec laquelle l'analyse a été menée. Au centre de cette démarche se trouve la spécification de la fonction de refinancement fondée sur la base solide de la théorie micro-économique des choix en conditions d'incertitude. Notre auteur formalise le comportement du banquier d'une façon très attrayante au plan théorique. Sans aucun doute, nous trouvons ici une contribution originale qui, du point de vue de l'élégance théorique et de la valeur explicative générale, dépasse de loin d'autres tentatives dans le même sens. Ce modèle micro-économique constitue la base pour un modèle macro-économique de l'offre de monnaie qui, en mettant en relief le mécanisme du refinancement, permet d'élaborer une approche réaliste des conditions belges. Une traduction économétrique alerte permet enfin d'évaluer la pertinence de la théorie qui a été proposée et de mesurer l'intensité des principales interdépendances. La valeur de l'ouvrage est réhaussée par l'analyse critique du contexte institutionnel dans lequel la politique monétaire opère en Belgique. L'analyse théorique et empirique combinée à une connaissance approfondie des données institutionnelles permettent à l'auteur de proposer au lecteur nombre de suggestions intéressantes sur le plan de la gestion. Il souligne que les autorités monétaires en Belgique sont dans l'impossibilité de contrôler de façon effective la masse monétaire, sauf à agir radicalement sur l'organisation institutionnelle du refinancement, e.a. par l'introduction de plafonds de refinancement et de taux d'intérêt plus flexibles.
[?4/1981
De l'avis du jury, il s'agit d'un ouvrage exceptionnel, de par l'originalité, la conception et la diversité des méthodes utilisées. En effet, l'auteur ne se limite pas à une analyse monétaire sensu stricto. Il prouve qu'il domine à la fois la théorie micro-économique et macro-économique et qu'il maîtrise sans difficultés, aussi bien en théorie qu'en pratique, les problèmes économétriques les plus complexes. Pour toutes ces raisons, et malgré la présence d'autres ouvrages de très bonne qualité, le jury a désigné comme seul lauréat du prix C.O.B. le Dr Paul Reding.
Cahier spécial Revue de la Banque mai 1981
De overheidstussenkomst in het financiewezen. Effectief? Efficient ?
documents de travail de la Commission « Bank- en Krediet » du XVe Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, 8-9 mei 1 981
Commander en versant 300 Fau C.C.P. 000-0346526-42 du Centre d'Etudes Financières, Bruxelles.
(f 4/1981 569
SNCI le spécialiste du crédit à toute les entreprises
~ NMKN
de specialist voor kredieten aan bedriiven
570 (f 4/1981
C Wadsworth, J.E. and De Staten nog geen tastbare drie aspekten aanmeldt : de graad
Q) Juvigny, F.L., edit., New resultaten heeft opgeleverd, tenzij van onafhankelijkheid van de
approaches in monetary policy, meer onrust op de wisselmarkt Centrale Bank t.o.v. de regering, C) Financial and Monetary policy gezien de onmogelijkheid van de optimale policy mix tussen
C studies n° 4 (') Sijthoff and Europa om de rentevoeten even monetaire politiek en budgetaire
Noordhoff, Alphen aan den Rijn, fors te laten fluktueren zoals de politiek, de verhoudingen tussen
~ 1979, 390 blz. V.S., dat de Bundesbank onder de monetaire politiek en de andere
Q) zware politieke druk staat om het instrumenten van ekonomische
(') published in C0-0peration with rentepeil niet fors op te trekken politiek. ~ SUERF. ondanks de DM-moeilijkheden, Al bij al is dit werk een kleine
a. dat de BIB-ekonomische raadgever encyclopedie over de monetaire
en Dit werk bevat de referaten die Lamfalussy meer dan ooit politiek. De lektuur ervan is vlot
Q) werden voorgebracht op het 7 de aandringt om een globale gezien de afwezigheid van een Colloquium van SUERF dat in ekonomische aanpak i.p.v. louter wiskundige approach, die
..0 Wiesbaden doorging in de herfst monetair instrumentarium, loont nochtans dikwijls wordt gebruikt
~ van 1977 met ais centraal tema: het de moeite dit boek door te door de monetaristen. innovaties i. v.m. de monetaire nemen om de verschillende F. Lierman Q) politiek. Het boek bevat 26 formules tegen elkaar af te wegen.
0 bijdragen uitgesplitst in vier delen, Wat kan worden geleerd uit de
CO resp. : kontrole van geld en krediet, ervaringen van anderen ? enkele internationale aspekten van Het ganse debat stoelt uiteindelijk de monetaire politiek, monetaire op vijf vragen : Waarom grijpt men
........... politiek in het kader van de terug naar monetaire objektieven ? ekonomische politiek, Op welke basis kan men die
Q) doelmatigheid van de monetaire objektieven samenstel/en ? politiek. De Belgische bijdragen Wat mag men ervan verwachten ?
..c worden verzorgd door J. Hoe kan men de naleving ervan
a. Baudewijns, hoofd van de bekomen? Studiedienst van de N.B.B. en Zijn de Centrale Bank.en, die
ro door prof. Th. Peeters, CES, monetaire objektieven hanteren ~ KU Leuven. monetaristische bolwerken ?
C) Het boek heeft een grote waarde Alle antwoorden hierop schijnen
0 voor diegenen die zich wensen zeer genuanceerd en verschillend vertrouwd te maken met de te zijn bij het doorlopen van de verschillende aspekten van de versch illende referaten.
..0 monetaire politiek. Zo krijgt men Het is tevens duidelijk gebleken Vasseur M., Droit bancaire
■-o.m. een overzicht van de dat men nog mijlen ver verwijderd français et Marché commun, La
CO gevolgde monetaire politiek in 12 is van een algemene teorie over de revue « Banque », Editeur, 1981 Europese landen, naast monetaire politiek, ondanks de 96 pages. beschouwingen over de toenadering tussen de internationale samenhang tussen monetaristen en de L'étude de la pénétration du de betrokken politieken, over de neokeynesianen. De communautaire dans la band met de overheidsfinanciën, monetaristische benadering blijft réglementation d'un secteur over de mogelijkheden en veel tegenwind ontmoeten. économique national déterminé beperkingen van de monetaire Opvallend is eveneens dat de représente toujours un exercice politiek en over de monetaire ontwikkeling van de monetaire délicat et difficile. Elle est l'histoire teorie. politiek in nauw verband staat met de mouvements en sens contraire Op een ogenblik dat het de zwevende wisselkoersen, die où les réflexes protectionnistes monetaristisch experiment in op hun beurt een instrument van succèdent aux élans Groot-Brittannië op een fiasco ekonomische politiek zijn. Ten communautaires. dreigt uit te lopen, dat de strenge slotte wordt ook stilgestaan bij het L'auteur, bien connu de nos Fed-politiek in de Verenigde koherentieprobleem dat zich onder milieux bancaires, aborde
~ 4/1981 571
57?
l'imbroglio de la réglementation « communautaire » du secteur bancaire français avec une maîtrise et une clarté qui font souhaiter au lecteur belge la publication d'un ouvrage « Droit bancaire belge et marché commun ».
Il est impossible de résumer en quelques lignes la première partie de l'ouvrage intitulée« les libertés communautaires et les banques françaises ». Trop de réglementations ont émaillé l'histoire de la progressive libération de la circulation des capitaux. Ainsi. 1· auteurs· étend longuement sur la question de la libération des transactions relatives aux valeurs mobilières. sur les récents développements en France de la réglementation des investissements étrangers directs. La première partie comprend en outre l'étude de la libération des services et établissements. décrit les efforts faits par la CEE en faveur de la coordination des législations communautaires et aborde enfin une conséquence pour les banques de la libre circulation des marchandises : le cautionnement de transit communautaire. L'auteur regrette notamment l'insuffisante coordination des législations bancaires, réduite à la directive européenne du 12 décembre 1977 et les restrictions mises encore par la réglementation française à l'accès des banques étrangères au marché national. De la seconde partie ayant trait aux politiques de concurrence, monétaire, commerciale et fiscale communes, on retiendra en particulier les réflexions de M. Vasseur relatives au droit monétaire communautaire. Ainsi. il décrit longuement le contenu et clarifie la valeur juridique des différents instruments de ce droit communautaire. véritable imbroglio de textes administratifs pris - l'auteur le regrette - « en l'absence de tout relais de droit national ».
Le livre - théorique et pratique -s'adresse à tout juriste qui doit appliquer le droit bancaire interne et communautaire. Il retiendra bien évidemment aussi l'attention des spécialistes du droit européen. Les juristes belges consulteront avec intérêt cet ouvrage. d'où ils tireront de précieux enseignements de droit communautaire et comparé.
Yves Poul/et
[f 4/1981
Centre d'Etudes Européennes de Waterloo. Le rôle des capitaux publics dans le financement de l'industrie en Europe occidentale aux XIX• et XX• siècles, Ets Bruylant. Brussel. 1981, 214blzn.
Dit historisch interessant boek is de verzameling van dertien rapporten die werden voorgebracht op het tweejaarlijks colloquium dat het Europees Studiecentrum van Waterloo organizeerde van 29 november tot en met 1 december 1979, met ais tema de roi van de overheidskapitalen in de financiering van de Westeuropese industrie in de XIX• en XX• eeuw. De rapporten geven een overzicht van de ontwikkelingen hieromtrent in Frankrijk. Duitsland. Groot-Brittannië, Nederland en België; vijf landen die ook in de veldslag van Waterloo. anno 1815, waren betrokken. Het hoger vermelde ~tudiecentrum heeft trouwens ais streefdoel telkens vertegenwoordigers van deze vijf landen bijeen te brengen op haar colloquia. Het doornemen van de rapporten toont ons dat men tijdens de beschouwde periode. die start met de industriële revolutie in Groot-Brittannië, een achttal etappes kan onderscheiden. Aanvankelijk was er een komplementariteit tussen de publieke en de private kapitalen in de financiering van de industrie. Hierop volgde het ontstaan van het begrip « publieke dienst » dat leidde tot een uiteengroeien van de manier waarop publieke en private kapitalen werden beheerd. Toch kon nog niet worden gesproken van echte gescheiden publieke en private sektoren. Tijdens de eerste wereldoorlog werd men voor het eerst gekonfronteerd met een rechtstreekse ingreep van de overheid in de ekonomie toen een oorlogsindustrie moest worden uitgebouwd. Dit luidde het einde in van het kwasi-monopolie van de invloed der burgerij op de regering. Vervolgens ontstond. onder druk van het opkomende socialisme, de tendens om het beheer van de publieke sektor van de ekonomie centraal te stellen en de verhoudingen ervan met de private sektor te analyseren.
De krisis van de jaren dertig w een nieuw belangrijk keerpunt leidde tot het algemeen verval het liberalisme. De groeiende staatsinmenging werd ais het geïnstitutionalizeerd door o.a. nationalisaties. het geloof dat regeringstussenkomst een go zaak was. Dit lokte echter een bundeling uit van al diegenen nog vertrouwen stelden in de private sektor zodat deze laatst een nieuwe opleving kende. N tweede wereldoorlog verwierf privé kapitaal opnieuw voorran zeker qua rendabiliteit van de gefinancierde investeringen. D ontwikkeling mondde zelfs uit i een privatizering van sommige bedrijven die een publieke dienstverlening verzekerden of was de aanleiding tot de oprichting van gemengde ondernemingen. Uiteindelijk kwam via de EG KS en de EG h internationalizeringsfenomeen verhoudingen tussen het publie en het private kapitaal grondig wijzigen. De private ondernemingen internationalizeerden, terwijl oo het aktiedomein van de publiek kapitaalbewegingen met enige vertraging een internationaal uitzicht ve,wierf. Uit deze samenvatting mag blij dat de huidige verhoudingen tussen de private en de publiek sektor het resultaat zijn van een zeer lang proces dat vooral tu de twee wereldoorlogen een definitieve koersverandering kende. De lezers die zich wensen te verdiepen in deze problematiek. alsook bijv. in het waarom van d nationalizering van Renault en v de politiek van Mevr. Thatcher. i de roi van de Europese investeringsbank. in de ontwikkeling van de Duitse elektriciteitssektor, in de verschillende juridische vormen die het publiek ekonomisch initiatief in België heeft aangenomen. enz. komen zeker aan hun trekken. De bundel van 'I
1 3 rapporten zou men gerust kunnen beschouwen ais een i
bijlage bij het vorig jaar gepubliceerde cahier van Bank- e Financiewezen over « Financiewezen in België 1830-1980 ».
F. Lierrm
Pleyer K. - Bellinger D. (éd.), Das Recht der Hypothekenbanken in Europa, Eine rechtsvergleichende Studie, in Bankrechtliche Schriften des Instituts für Bankwirtschaft und Bankrecht an der Universitat zu Koln, Tome X, C.H. Bech'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1981, 347 pages.
La remarquable étude de droit comparé sur le crédit foncier que nous offrent l'Institut de droit bancaire de l'Université de Cologne et l'association des banques hypothécaires allemandes après une large consultation des milieux intéressés des pays de la Communauté européenne, constituera indiscutablement un instrument précieux pour les juristes intéressés par cette question. Le développement progressif d'un véritable marché commun transforme l'activité des banques, crédits fonciers et autres organismes pratiquant le prêt hypothécaire. Leurs activités couvrent désormais des actions ou institutions communautaires et de nombreuses sociétés de crédit foncier ont des implantations extérieures. On sait, d'autre part, que la commission de la CEE a présenté en 1978 une proposition relative au crédit à la construction. Cette proposition se base sur l'idée de faire entrer en concurrence, par-dessus les frontières, les systèmes européens de crédit foncier et ce, sur chaque marché national, selon la législation du pays d'origine. L'épargnant pourrait donc être amené à choisir entre des obligations hypothécaires de nature juridique différente et surtout le preneur d'un prêt hypothécaire, entre des prêts de structure différente. Les règles relatives au prêt maximum, à la détermination de la valeur du gage et à la teneur du contrat de prêt sont en effet profondément originales à chaque législation. Tout cela explique l'intérêt, l'utilité et l'urgence de cette étude comparative. Elle aborde l'ensemble des aspects du crédit foncier - la question de la forme juridique de l'organisme prêteur -les problèmes de montant, teneur
~ lf 4/1981
et modalités des prêts - ceux liés à l'émission d'obligations hypothécaires et à d'autres formes de financement - ceux, complémentaires, de la couverture, des coefficients de solvabilité et liquidité. Enfin, le crédit communal comme forme particulière de crédit foncier est longuement étudié. Sur tous ces points, les auteurs ne se contentent pas d'une pure étude comparative descriptive. Ils cherchent à dessiner les lignes essentielles d'une future législation communautaire. Reprenant en annexe les textes des six législations européennes les plus importantes et un résumé fort complet dans les différentes langues communautaires, l'ouvrage recensé mérite indéniablement l'attention des lecteurs de la Revue de la Banque.
Yves Poul/et
573
(0 A propos des euro-crédits. Le New Ways of Financing lntemalionaal Bankieran. 0
E phénomène des euro-crédits et Nalionalized Industries by dit onderwerp in dit nummer - statistiques. C. Dufloux et L. Stephen Lumby, pp. 34, Lloyds bijdragen van drs. H .J. Margulici. Banque n' 403, février Bank Review, July 1981, Number Berenschot, drs. W.G. Jiskoot,
(0 1981, pp. 149. 141. drs. J.C. Van Kessel, J.H. Mul ~ prof. dr. C.J. Rijnvos, mr. G.J.
0 Le contr61e de la sécurité de Fraude, Controle et Tammes, dr. P.M. Verboom en
C n111p01188bi1ités, Contl6le en een drietal interviews. Bank- e rinfonnatique dans la l>Mque. verantwoordelijkheicl 1-1 981 . Effectenbedrijf, juni/juli 1981.
(0 J. de Lantivy et B. Périer. Banque C.B.N.C.R. / B.C.N.A.R.
C. n°403, février 1981, pp. 187. Banking ragulation, profits a
C Consoliclatie en Comrole van capital generalion by Peter
Q) Internationale geconsolidesde Rekeningen. Cooke. The Banker, August 19 Vseinheidichung des 2-1981. C.B.N.C.R. / B.C-.N.A.R . n' 666, p. 21. ...., Kaufrechts. Prof. Dr. Dr. H.C.
"1-- Mult. Ernst von Caemmerer ·- WiU technology undennine ~ (Freiburg 1. Br.) : Schweizerische Le défi de la croissance zéro par 10day's --v· control ..r::. Juristen- Zeitung, Revue Suisse de M. Jacques F. Poos. Cahiers techniques? by Marjorie Gree (.) Jurisprudence, september 1 981 , Economiques 3/81. The Banker, August 1981, p. 2
16/17, pp. 257. en La Banque dans le monde '81 -"'O l'Echo de la Bourse -AGEFI, juin De betekeningen die de N ·- T&11dm1CN récentes des 1981. moat laten uitvoeren __, ·- financemen1s intemationaux de aanleicling van de verkoping
1- projels. M. Sarmet. Banque, n' Réflexions sur le système _.. een onroerend goed, dat 409, septembre 1981, pp. 957. monétaire international dans les tot een failliate boedel
........... années 80 par S.E.M. Pierre Tijdschrift voor Notarissen. 45e
Werner. Cahiers Economiques jaargang, juli-augustus 1981, n
en Le vidéotex et son application 2/81. 7-8.
Q) dans la bMque. B. Périer et J. de Focus on bMking for 1he '8~ Lantivy. Banque, n' 409, Réflexions sur nos crédits à ::::, septembre 1981, pp. 997. l'exportation et nos prê1S Management Focus, vol. 28, n".
> bancaires à destination du july-Augustus 1981.
Q) Le œrminal dans les agences : T .... Monde. A.
~ quelques avis des utilisateurs. Postel-Vinay.Banque, n' 407, juin Stille Reserven und direkte
W. Grossin et R. de Guillebon. 1981, p. 669. Einlagensicherung durch Werr en Banque, n' 409, septembre A. Müller. Kreditwesen, 34.
Q) 1981, pp. 1005. Evolution des ressources et des Jahrgang. Heft 15, 1. Augustus
"'O emplois des banques AFB et 1981, p. 672 Comptabilité avec le droit des moyens de paiement en
Q) communautaire du régime 1980. Banque, n' 407, juin Die Hypo1hekenbanken in de fiecal des 80RIIIIN versées par 1981. A.F.B., p. 697. sich entwickelnden EG-
::::, le contribuable ou son Bankrecht. Dieter Bellinger. Die
> employeur dans le cadre d'une Bank, Zeitschrift für Bankpolitik 888UIWIC8 complémentaire libre Die Bewilligung zum und Bankpraxis 7 / Augustus
Q) ou affectées à ramortissement Geadliiftabetrieb einer nach 1981, p. 318.
a: d'un emprunt hypothécaire. Schweizerissche Recht Articles 45, 3° et 54, l'à 3° du organisierten Bank (Vogeli), Da frMzosische Scheckreclrl Code des impôts sur les revenus) Müller, Schweizerische Juriste11- Günter Baumann. Die Bank, par Marc Dassesse. Page 65, Zeitung, Revue Suisse de Zeitschrift für Bankpolitik und Journal du droit fiscal, mars-avril Jurisprudence, n' 11, juni 1981, Bankpraxis 8 / Augustus 1 981, ~ 1981. p. 186. 406.
574 (p 4/1981
Offshora- Geechifft : Lagisllllives Kunstprodukt oder Malktbeclürfnia ? Hans-Joachim Schreiber - p. 724.
Offshora- Geechifft - oder inlamationaliaierung der F'IIIMZll18lkte ? Rüdiger v. Tresckow. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 34. Jahrgang Heft 1 6, augustus 1981.
L'écu et le Système monétaire européen, par Tommaso Padoa-Schioppa, p. 245. L'écu dans certaines relations fiœnc:ièr'N, par Paolo Baffi, p. 251. L'écu et les relations bencaires, par Francesco Cingano, p. 254. L'écu dms les NSUrances, par Alfonso Desiata, p. 257. Bancaria, n° 3, Marzo 1981.
Speciaal Cahier Bank- en Financiewezen
De overheidstussenkomst fi na nciewezen. Effectief? Efficient?
mei 1981
. 1n het
werkdocumenten van de Commissie « Bank- en Krediet » van XVe Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, 8-9 mei 1 981
Bestellen door overschrijving van 300 F op P.R. 000-0346526-42 van het Studiecentrum, Brussel.
~ 4/1981 575
576
C Q) C) C ·-Q)
"O Q)
"O Q)
~ ............
u, C 0 ...., CO (.) ·-c :::::,
E E 0 u
FERNAND COLLIN - PRIJS 1981
Op maandag 25 mei jongstleden werd in de lokalen van de Universitaire Stichting de « Fernand Collin - Prijs 1981 » plechtig uitgereikt. De prijs, die thans 300.000 F bedraagt, sloeg op de driejaarlijkse periode 1978-79-80. De laureaat is de heer Marc Maresceau, Doctor in Europees Recht van de R.U.G. Het bekroonde werk: De Directe Werking van het Europees Gemeenschapsrecht ».
Op de plechtigheid waren .- benevens de 83-jarige stichter van de prijs, Professer Emeritus Fernand Collin - o.m. de heren Rectoren van de vier nederlandstalige universiteiten van het land aanwezig. De voorzitter van de Jury, Raadsheer Emeritus in het Hof van Cassatie, de heer A. de Vreese, beklemtoonde het belang van de « bijzonderste wetenschappelijke juridische prijs in nederlandstalig België » en prees de grote verdienste van de laureaat en de uitzonderlijke kwaliteit van het bekroonde werk. Niet min dan tien jonge geleerden waren ais kandidaat voorgedragen en hadden een werk aan de beoordeling van de jury onderworpen. De voortreffelijke kwaliteit van al deze werken werd door de jury verheugend geacht en kenmerkend voor het peil van de Vlaamse rechtswetenschap vandaag.
PLANIFICATION A COURT TERME EN GESTION BANCAIRE
Le CENTRE DE PERFECTIONNEMENT dans la DIRECTION des ENTREPRISES - Groupe de Recherche sur la Politique Economique et Financière, de l'Université Catholique de Louvain, organise à Louvain-la-Neuve le mardi 24 novembre 1981 une journée d'étude ayant pour thème la
PLANIFICATION A COURT TERME EN GESTION BANCAIRE
Tous renseignements complémentaires, et notamment un programme détaillé, peuvent être obtenus au Centre de Perfectionnement dans la Direction des Entreprises, I.A.G., UCL, avenue de l'Espinette, 14, B - 1348 - Louvain-la-Neuve. Tél.(010)418181,ext. 3019et3020.
[f4/1981
2• CONGRES EUROPEEN SUR L'ORGANISATION DES INSTITUTIONS FINANCIERES - « BANQUE » - LUXEMBOURG -17 AU 19 NOVEMBRE 1981 - INFORMATIONS GENERALES
L(;ls banques se trouvent face à un développement des automatismes qui ne cesse de modifier leur organisation interne. C'est ce thème qui a été retenu pour le Congrès qui va se tenir du 1 7 au 19 novembre prochain à Luxembourg à l'occasion de la très vaste exposition de matériels spécialisés, organisée par la Société des Foires Internationales de Luxembourg. Comme en 1979, il a été demandé à l'INSIG - Institut de Recherche Interbancaire à Paris - de prendre en charge les conférences et débats. Conformément aux principes de cet Institut, ce sont des banquiers, européens en la circonstance, qui présenteront les expériences les plus avancées, menées par leurs établissements dans des domaines essentiels : - décentralisation de l'informatique, remise en cause des responsabilités et des postes de travail,
développement d'un réseau interbancaire de guichets automatiques, prise en charge des tâches administratives par la bureautique, conception nouvelle des centres de traitement des opérations, formation des Cadres et du Personnel aux nouvelles techniques.
Deux sujets fondamentaux seront également étudiés à cette occasion : - Les syndicats de banque face au développement des automatismes, thème traité par une tribune composée de syndicalistes Allemand, Français, Luxembourgeois, Suédois et du responsable secteur Banque de la Fédération Internationale FIET, - la Banque de Demain, traitée par un éminent spécialiste de la filiale berlinoise de la Commerzbank.
Renseignements complémentaires : Société des Foires Internationales de Luxembourg S.A. Direction : Luxembourg Kirchberg - Bot"te Postale 110 L- Luxembourg 2 R.C. Luxembourg tél: 20931
CENTRE D'ETUDES EUROPEENNES DE WATERLOO
Le centre d'études européennes de Waterloo organise son 3• COLLOQUE INTERNATIONAL sur le thème de« L'INFORMATION FINANCIERE INTERNATIONALE, FACTEUR D'INTERDEPENDANCE ECONOMIQUE • (Du pigeon de Rotschild au vidéomaster de Reuter. Quel fut le rôle de l'information financière dans l'interdépendance économique des pays d'occident?). Séance inaugurale : jeudi 26 novembre à 20 h 30. Journées de travail : vendredi 27 et samedi 28 novembre 1981 dans les locaux du Musée Wellington, à Waterloo. Les orateur sont des personnalités appartenant aux milieux économique, financier et universitaire des pays ayant participé, en 1815, à la bataille de Waterloo. Le droit d'inscription est fixé à 2.500 F. Informations complémentaires et bulletins d'inscriptions peuvent être obtenus sur simple demande au secrétariat du colloque, 18 rue Clément Delpierre, 1310 La Hulpe (tél. les lundis et jeudis de 10 à 12 heures au (02) 354 93 22).
[p 4/1981 577
Revue de la Banque Publiée par le
Bank- en Financiewezen Tijdschrift, uitgegeven door het
Studiecentrum voor het Financiewezen vzw. Centre d'études financières asbl. place Madou 8, boîte 9 1 030 Bruxelles Tél. (02) 218 02 89
Madouplein 8, bus 9 1 030 Brussel
Tel. (02) 218 02 89
Comité de Pa'lronage Beschermcomité
Président Membres
Cecil de Strycker Luc Aerts / Louis Delmotte / Hubert Detremmerie
Georges Everaert / Eric de Villegas de Clercamp Karel Dierckx / Alex Florquin / Jean Godeaux
François Narmon / Henri Neuman / Jean Reyers Jacques Thierry / Robert Vandeputte / Robert Vanes /
John Van Waterschoot / Edward Wauters
Voorzitter Leden
Conseil d'Administration Raad van Beheer
Président Membres
Directeur
Jean-Paul Abraham Jean Adant / Roland Beauvois/ Guy Blampain
Alphonse Brouwers / Michel De Smet / René Deweeck Paul Dirix / Lucien Dorny / Piet Frantzen / Léo Goldschmidt /
Wilfried Janssens / Marie-Henriette Lambert / Claude Lempereur Pierre Quiévy / Albert Raport / Jan Sercu Edward Thielemans / Pierre Van Dessel
Theo Hensels
Voorzitter Leden
Directeur
Comité de rédaction Redactiecomité
Présidente Membres
Rédactrice
Marie-Henriette Lambert Jean-Paul Abraham / Jean-Paul Glorieux / Jacques Heenen
Theo Hensels / Wilfried Janssens / Claude Lempereur Claude Martin / Armand Mertens de Wilmars / Jacques Rega
Raoul Salmon / Georges Martin Katia Vermeersch
Voorzitster Leden
Redactrice
Groupe de travail Bibliographie Recensenten
Frank Lierman / Michel Dumont / Luc Roeges / Jan Smets / Michel Simal / Yves Poullet
Printed in Belgium by Robert Louis, 1050 Brussels, Rue Borrens 35-43