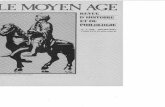« Perte et récupération de l’Espagne. Les constructions léonaises (XIe-XIIIe siècle) »
-
Upload
ephe-sorbonne -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of « Perte et récupération de l’Espagne. Les constructions léonaises (XIe-XIIIe siècle) »
I Mythes, CRITIQUE ET HISTOIRE
Collection dirigée par Chantal Grell
Derniéres parutions
Les Religions du paganisme antique dans l'Europe cbrétienne (vl-XVUI siécles)Chantal Grell et Francois Laplanche (dir.)
Primitivisme et mythes des origines dans la France des Lumiéres (1680-1820)Chanral Grell et Christian Michel (dir.)
Pratiques et concepts de l'histoire en Europe (XVI-XVIII siécles)Chantal Grell (dir.)
Les Panégyriques du roi prononcés dans l'AcadémiePierre Zoberman (dir.)
La République des lettres et l'bistoire du [udaisme antique (XVI-XVIII siécles)Chantal Grell (dir.)
L'Égypte imaginaire de la Renaissance a ChampollionChantal Grell er Daniel Droixhe (dir.)
Le Bernin et l'Europe. Du baroque triomphant a lage romantiqueChantal Grell et Milovan Stanic (dir.)
L'Éducation des jeunes jilles nobles en Europe (xvtr-xvur siécles)Chantal Grell er Arnaud Rarniere de Fortanier (dir.)
La Conversion et le politique a l'époque moderneDaniel Tollet (dir.)
Les Églises et le Talmud.Ce que les chrétiens sauaient du judaisme (XVi-X!)( siécles)
Daniel Tollet (dir.)
Les Historiographes en Europe de la jin du Moyen Age a la RévolutionChanta! Grell (dir.)
~.'Rl;;;, .>
,. .• ,,--1' \\\
t- -/,.., (,í ~j ~';'l' ~\.,:. I
' ':':<C'lCO
Pierre Chasrang (dir.)
L P " 1"e asse a epreuvedu présent
Appropriations et usages du passédu Moyen Áge a la Renaissance
-'PUPS
PERTE ET RÉCUPÉRATION DE L'ESPAGNE.LES CONSTRUCTIONS LÉONAISES (Xle-XIII< SI.ECLES)
Patrick HenrietUniversité Miehel de Montaigne - Bordeaux III
En 711, les musulmans débarquent en Espagne et s'y installent pour
des siecles. Cet événement capital, que l' on a pris l'habitude de caraetériser
des le Moyen Áge eomme la « perte de l'Espagne », est un moreeau de
bravoure obligé dans l'historiographie hispanique depuis le IXe siecle, Il enva de me me pour la « réeupération » des territoires, appelée « Reconquéte »
depuis le XIXe siecle. La « perte}) n' est pas seulement un événementimportant, elle est l'événement par définition, eelui a partir duquel s'organise
la temporalité hispanique. Point nodal de la mémoire colleetive, elle joue un
róle de « stabilisateur du souvenir », pour reprendre une expression de JanAssmann '. Comme pour toute mémoire sociale - on ne s'intéresse pas id ala mémoire individuelle -, nous avons affaire a des eonstruetions 2. Il s'agit
done de repérer dans le diseours sur le passé des choix, des glissements, desruptures et des prises de position. Les mérnes événements ont été présentés et
interprétés de plusieurs facons, Pour ce qui est du Moyen Áge, il est possiblede distinguer deux schémas assez différents, voire en franche opposition,
tant pour la perte que pour la récupération. Il est a noter que ces discoursn'apparaissent, clairement formulés, qu'á partir de la fin du IXe siecle.
Jan Assmann, Moise l'égyptien. Un essai d'histaire de la mémoire, Paris, Aubier, 2001[éd. al!. 1998], rééd. Flammarion, 2003, p. 60.
2 Cette notion, actuellement tres utilisée par les historiens et partlculiérement par lesmédiévistes, doit beaucoup, comme on le sait, 11 Maurice Halbwachs, LesCadressociauxde la mémoire, Paris, F.Alcan, 1925, et La Mémoire collective, Paris, PUF,1950 (ouvrageposthume). Jan Assmann (Das kulturelle Gediichtnis. Schri{t, Erinnerung und politischeIdentitiit in frühen Hochkulturen, München, Beck, 1992) rappelle I'héritage d'Halbwachs(auquel est consacré le premier chapitre) et propase le concept de « mémoire culturelle »(la mémoire est une « kulturelle Schopfung », ibid., P.48), qui doit beaucoup 11 AbyWarburg.
119
r-tn
~V>V>tn->.e-ti-"":.otne<tntie"":.otn-V>tnZ...¡
""e""V>
'"oo00
120
Cornmencons par la « perte », La question qui se pose id est celle desresponsabilités. Ramón Menéndez Pidal a clairement opposé deux schémas,qu'il considérait tous deux comme rnozarabes '. Le premier exonere de touteresponsabilité Witiza, l'avant-dernier souverain wisigothique (702-710), ainsique son lignage. Il fait du roi Rodrigue (710-7 II) le seul responsable de ladéfaite et met en avant la figure de ]ulien, un grand aristocrate qui appelle lesmusulmans car il veut se venger du roi, lequel a abusé de sa fille. Cette version,méridionale, serait le fait des aristocrates goths ayant choisi de pactiser avecl'envahisseur musulman. Elle apparaít d' abord dans les sources árabes". Al'opposé un autre discours, cette fois-cí septentrional, accable Witiza et sesfils, sans pour autant dégager toujours Rodrigue de toute responsabilité>. De
fait, 11 partir du IX' siecle, bien des chroniques associent les deux souverainsdans le péché. Cette construction fut systématiquement reprise aux époquesmodernes et contemporaines, la fin de l'époque wisigothique étant vuecomme une période de débauche généralisée qui ne pouvait déboucher quesur une défaíte rnilitaire",
Le therne de la « récupération » de I'Espagne apparait pour la premierefois dans la Chronique d'Alphonse III, 11 la fin du IXe siecle", II évoluenotablernent par la suite. Le schéma fondateur privilégie l'autonomie deshispaniques et la figure du mythique roi Pélage, miraculeux vainqueur dela plus ou moins mythique bataille de Covadonga (718, 721 ou ca.737).Plus tardivernent, une autre construction accepte l'idée d'une aide extérieuredans le processus de reconquéte, Cette tendance apparaít au XII' siecle avecla matiere carolingienne. Elle remonte sans doute au XI' síecle mais noussommes id tributaires des textes. Dans cette configuration, Charlemagnedevient le vrai responsable des victoires chrétiennes". Lopposition latente
3 L'exposé de Ramón Menéndez Pidal apparatt d'ailleurs dans un chapitre intitulé« Visigotismo mozárabe », dans La épica medieval española, desde sus órigenes hasta
su disolución en el romancero, éd. Diego Catalán et María del Mar de Bustos, Madrid.Espasa-Calpe, coll. « Obras completas de R. Menéndez Pidal », XIII, 1992. P.297-319.Une introduction explique les conditions de cette édition posthume. Du meme RamónMenéndez Pidal, Floresta de leyendas heroícas españolas. Madrid. La Lectura. 1925.3 t. Belle analyse du thérne de la « perte» par Georges Martin. « La chute du royaumewisigothique d'Espagne dans I'historiographie chrétienne des VIII' et IX' siécles,Sémiologie socio-historique », Cahiers de linguistique hispanique médiévale, 9, 1984,P·198-214, repris sous le titre, « Un récit (la chute du royaume wisigothique d'Espagnedans I'historiographie chrétienne des VIII' et IX' siécles) », dans Histoires de l'Espagnemédiévale. Historiographie. geste, romancero, Paris, Klincksieck, coll. « Annexes desCahiers de linguistique hispanique médiévale », 11.1997. p. 11-42.
4 Pour la prerníére fois en Péninsule dans al-Rasí. qui ne nous est connue que dans unetraduction portugaise puis castillane du début du Xlv" siécte : Crónica del moro Rasis:versión del Ajbar muluk al-Andalus de Ahmad ibn Muhammad ibn Musii AI-Razi, 889-
955; romanzada para el rey don Dionís de Portugal hacia 1300 por Mohamad, Alarife,y Gil Pérez, éd. Diego Catálán y Mª Soledad de Andrés. con la colaboración de MargaritaEstarellas. Madrid. Gredos, 1975. Version portugaise dans la Crónica Geral de Espanha
de 1344. éd. Luís Filipe Lindley Cintra. Lisboa. Academia portuguesa da hlstória, 1954.t. 11, P·301-380. Pour Menéndez Pidal (La épica medieval ...• op. cit., P.315). la versionanti-rodriguiste est le fait de chrétiens « acomodaticio s o claudicantes », qui transférentsur la personne de Rodrigue les fautes de Witiza. Ces partisans de Witiza sont décritsailleurs (ibid .• p. 299) comme des « magnates godos y prelados que habían pactadocon los invasores y recibían de ellos los cargos públicos, civiles y eclesiásticos para elgobierno de los cristianos sometidos », 115 sont des « cristianos gubernamentales », Surles turpitudes de Rodrigue, voir aussi Thomas Deswarte, « Le viol commis par Rodrigueet la perte de l'Espagne dans la tradition mozarabe (VIII'-XII' siécles) », dans Mariage etsexualité au Moyen Age. dir. Michel Rouche, Paris. PUPS,2000. p. 69-79.
5 Version déja attestée dans la Chronique de Moissac (milieu du IX' síécte, sur la base dematériaux antérieurs ?) : MGH SS. l. p. 290. Pour la datatlcn, Patrick Geary, « Un fragmentrécemment découvert du Chronicon moissiacense », dans Bibtiotnéoue de l'École deschartes, 136, 1978. p.69-73. Voir Georges Martin. « Un récit... », art. cit., p.21-23. lcl,Witiza est seul responsable (irritans furorem Dominl). Pour Ramón Menéndez Pidal,les adversaires de Witiza sont les vrais patriotes qui se dressent contre un parti « faltode sentido nacional» (La épica medievat..; op. cit., P.299). 115 ont émigré dans lesAsturies ou ont conservé leur identité au sud: « los más exaltados y decididos habían
ido a refugiarse en las montañas del norte. creando el reino asturiano. o habían emigradollevando a la Galia y a la Germania algunos frutos de la superior cultura visigótica : los quehabían permanecido rnozárabes, mantenían su nacionalismo y su cristiandad ferviente. ymuy lejos de honrar a Witiza y a Ollán, se veián impulsados a denigrarlos. como causantesde la destrucción del reino godo. que efectivamente a ellos era debida» (ibid., P.299-300). Pour une analyse détaillée de la tendance anti-witiziste. Alexander Pierre Bronlsch,Reconquista und heiliger Krieg. Die Deutung des Krieges im christlichen Spanien vonden Westgoten bis ins frühe 12. iantbundert, Münster, Aschendorff, 1998. p. 258 sq.
6 Présentation générale et références dans le beau livre de José Álvarez Junco. Materdolorosa. La idea de España en el siglo XIX. Madrid, Taurus, 2001. p. 214-218.
7 Les deux versions de la Chronique ont fait I'objet de trois tres belles éditions : Die ChronikAlfon·slll. Untersuchungen und kritische Edition der vier Redaktionen. éd. Jan Prelog,Frankfurt/Bern/Cirencester, Peter D. l.ang, coll. « Europalsche Hochschulschriften.111. Geschichte und ihre Hilfwissenschaften », 134. 1980; Chroniques asturiennes(fin IX< siécte), éd. Yves Bonnaz, Paris, CNRSÉditions. 1987; Crónicas asturianas. etéd. Juan Gil Fernández. trad. et notes lose L. Moralejo, éd. prélim. Ignacio Ruiz de la Peña,Oviedo, Universidad de Oviedo, 1985. Pour une analyse du thérne de la perte dans laChronique d'Alphonse 111, Georges Martin, « Un récit... », arto cit., p. 35-42. Pour la notiond'« invention de la reconquéte » a la fin du IX' siécle, un chapitre du grand livre de PeterLinehan, History and the Historians of Medieval Spoin, Oxford, Clarendon Press, 1993,p. 95 so.
8 Sur Charlemagne en Péninsule, voir les nombreuses références données par MarcelinDefourneaux, Les trancots en Espagne aux XI' et XII' siécles, Paris, PUF, 1949, P.258-316, ainsi que Jacques Horrent, « L'histoire légendaire de Charlemagne en Espagne »,dans Charlemagne et l'épopée romane. Actes du VII' conqrés international de la Société
Rencesvals, Paris, Les Belles Lettres, 1978. p. 125-156. Voir les réflexions et les référencesd'Adeline Rucquoi, « La France dans I'historiographie médiévale castillane »,Annales ESC,
1989, p. 677-689. et de Klaus Herbers, « Carlomagno y Santiago. Dos mitos europeos »,dans El Pseudo- Turpín, lazo entre el culto jacobeo y el culto de Carlomagno, Santiago,Xerencia de Promoción do Camiño de Santiago, 2002, p. 29-42.
121
~::oñ~:t:~::o
~'Uro;::¡.ro~ro,nc:"O
~'~o·"c.roni'""ODJ
CJQ
"(Or-'ro'"no"~<=::lo'"'"¡¡;;o"DJ¡¡;.ti>
'"~~-.'"(5;nñ)e
122
entre ces deux types de récit permet au xnr' siécle I'apparition d'une légenderelative a une sorte d' anti-Charlemagne hispanique, Bernardo del Carpio 9 o
Au rnoment de retracer cette histoire, philologues er historiens se SOntsurtour intéressés aux chroniques, Pourtanr, d'autres textes conrríbuenr
forternenr a la construction d'une mémoire hispanique: ce SOnt les récitshagiographiques, particulierernen¡ Iéonaís, donr on va voir qu'ils livrent
des versions intéressantes et parfois précoces des deux doubles schémasdonr il a été question. le voudrais donc aujourd'hui convoquer deux piéces,
généralement négligées dans la perspective qui est la nótre, er voir quellesvariations elles proposent autour du thérne de la pene er de la récupération
de l'Espagne. Léonaises, ces ceuvres datent des XIe-XU< siecles. Elles serontmises en relation avec des chroniques composées a la rnérne époque er dans
le mérne environnemenr, Un Iieu unique est a l'origine d'au moins trois deces textes, peur-étre des quatre : c'est le rnonastere de Saint-Isidore de León,
qui abrite une communauté double jusqu'au milieu du xr' siecle, selon unmodele traditionnel en Hispania, puis des chanoines réguliers suivant la regle
de saint Augustin a partir de II48'°0 Nous examinerons done, dans l'ordrechronologique de rédaction :
1. Une Translatio sancti Isidori de la fin du xr' siecle ".
20 Une chronique, généralement appelée Historia Silense, qui date de laseconde décennie du xns siecle 12 o
30 Une Historia translationis sancti Isidori, de la fin du xn" ou du débutdu xnr' siecle 13 o
40 Le Chronicon mundi de Lucas de Tuy, rédigé dans les années 1220-
1230'40Ce choix ne permet cenes pas d'embrasser I'ensemble de la question
« perte et récupération »0 II autorise cependant 11 poser la question du lieuou se construir la mémoire, un concept 11 ne pas confondre avec celui du
« lieu de mémoire », pas plus que I'on ne peut mettre sur un rnérne planle centre de production historique et I'objet de la mérnoire. Le « lieu de
mémoire» cristallise par sa profondeur historique, réelle ou symbolique,
des enjeux et des discours qui valent pour une vas te communauté humaine
et qui le dépassent (ainsi Reims et Saint-Denis pour la France, ou encoreTolede pour I'Hispania) '5 o D'abord objet, u ne se construit pas toujours
lui-rnérne, ce qui signifie qu'il n'a pas nécessairement le statut de centre de« production mémoriale »0Celui-ci, en revanche, est directement responsable
de la construction d'un discours sur le passé qui, s'il peut dans certains cas
n'intéresser que lui, revét parfois une toute autre arnpleur, Du point de vue
qui nous intéresse id (perte et récupération de l'Hispania), León n' est pas un
Iieu de mémoire mais un centre de (re-) consrruction du passé.
Les textes hagiographiques, nécessairement centrés sur un culte particulier
géré par un établissement spécifique, ne se situent normalement pas dans unetrame temporelle et spatiale aussi générale que les chroniques universelles ou
« nationales »0IIs ne devraient donc normalement proposer que des « horizonsmémoriaux» rnédiocres. Voici pour la théorie. Cependant, ainsi que nous
allons le voir, les vies de saints, les récits de translation et les recueils de mirades
peuvent également véhiculer des bribes de discours hísrorlographique ". Le
9 Sur le mythe de Bernardo del Carpio, voir Marcelin Defourneaux, «La légende deBernardo del Carpio », Bulletin hispanique, 45, 1943, p. 1170139, et ido, Les Francais enEspagne, op. cito, p. 30203160Pour un état de la recherche au début du xx' siécle, TheodorHeinermann, Untersuchungen zur Entstehung der Sage von Bernardo de Carpio, Münster,Halle, Karras, Króber und Nietschmann, 19270 Récemment, la présentation de GeorgesMartin dans Histoire de la Iittérature espagnole, t. 1,Moyen Age oxvr: siécle oXVII' siécte,dir. lean Canavaggio, Paris, Fayard, 1993, p. 53056, Diego Catalán, La épica esoañota.
Nueva dacumentación y nueva evaluación, Madrid, Fundación Ramón Menéndez Pidal,2000, p. 67-75, et Klaus Herbers, «Le culte de saint Jacques et le souvenir carolingienchez Lucas de Tuyo Indices d'une conception historiographique (début XIII' siécle), dansA la recherche de légitimités cbrétlennes. Représentations de l'espace et du tempsdans l'Espagne tnédiévale (¡X'-XII" siécle) dir, Patrick Henriet, Lyon, ENS tditions/Casade Velázquez, coll, «Annexes des Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniquesmédiévales », 15, 2003, p. 149-176, ici p. 158 sq.
10 Sur I'histoire de Saint-Isidore de León, voir le livre ancien de Julio Pérez Llamazares,Historia de la Real Colegiata de San Isidoro de León, León, lrnp. Moderna, 1927, etMoGarcía Colombas, San Pelayo de León y Santa Marra de Carbajal, León, Monasterio deSanta María de Carbajal, 1982, p. 19-530
11 PL, t. LXXXI, col. 39-43 (BHL 4488)0 Traduction partielle (Patrick Henriet) dans Les Saintsdans l'Histoire. Sources hagiographiques du Haut Moyen Age, dlr, Anne Wagner, Rosny-sous-Bois, Bréal, 2004, p. 265-2710
12 Historia Silense (désormais HS), éd. Justo Pérez de Urbel et Atilano González Ruiz-Zorrilla,Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cientíñcas, 1959. Traduction anglaise etprésentation de cette importante chronique dans Simon Barton et Richard A. Fletcher, The
World of El Cid : Chronicles of the spanish Reconquest. Selected Sources translated andannotated, Manchester/New York, Manchester University Press, 2000.
13 Historia translationis sancti Isidori (désormais HD, éd. Juan A. Estévez Sola, Turnhout,Brepols, coll. «CCCM », 73, 1997, p. 143-179 (BHL 4491).
14 Lucas de Tuy, Chronicon mundi (désormais CM), éd. Emma Falque Rey, Turnhout, Brepols,coll.« CCCM", 74, 2003·
15 On pense ici, bien entendu, a I'entreprise fondatrice des Lieux de mémoire dirigés parPierre Nora entre 1986 et 1993. Pour l'Espagne, qui n'a rien d'équivalent, voir cependantles Signos de identidad histórica para Navarra, dir. Angel Martín Duque, Pamplona,Biblioteca Caja de Ahorros de Navarra, 1996, 2 t.
16 Sur les rapports entre hagiographie et historiographie, voir en particulier MartinHeinzelmann, «Hagiographischer und historischer Diskurs bei Gregor von Tours ] »,dans Aevum inter utrumque. Mélanges offerts a Gabriel Sanders, professeur éméritea {'université de Gand, dir. Marc van Uytfanghe et Roland Demeulenaere, Den Haag,M. Nijhoff international, coll, « Instrumenta Patristica », XXIII, 1991, p. 237-258; WilliamD. McCready, Mirae/es and the Venerable Bede, Toronto, Pontiñcallnstitute of MediaevalStudies, colí. « Pontiñcallnstitute of Mediaeval Studies. Studies and Texts », 118, 1994,p. 195-213; Felice Lifshitz, «Beyond Positivism and Genre: "Hagiographical" Texts asHistorical Narrative », Viator, 25, 1994, p. 95-113 ; ead., The Norman Conquest ot Pious
123
s"~;>:
:t~"§~~~(1),nc:"O(1),
~o':::lo.(1)
rn'""O
'"OQ:::l!"r-'(1)
'"no:::l
~c:::¡o':::l
'"¡;;;o:::l
'"iñ'(1)
'"~~--.'"m;nlO~
corpus reten u invite donc a s'interroger sur I'arricularion des mémoires localeset générales. L'hagiographíe releverait d'abord de la prerniere, les chroniquesde la seconde. Nous tenterons de suggérer qu'une telle distinction n'est paspleinement opératoire, loin s'en faut ...
LE PREMIER RÉClT DE LA TRANSLATION D'ISIDORE
124
A la suite d'une expédition pacifique organisée par le roi Ferdinand I",les restes d'lsidore de Séville furenr transférés a León en I063 '7. Ils furenra partir de cette date conservés dans I'église de Saint-jean Baptíste et Saint-Pélage, qui prit rapidemenr le nom de Saint-lsidore'8. Des la fin du xr' siecle,un auteur anonyme, qui pourrait étre un clerc de ce monastere alors double,rédigea un récit de la translation qui nous a été conservé sous la forme de neuflecons liturgiques. Le manuscrit écrit en caracteres dits wisigothiques, maisaussi un passage OU l'auteur affirme avoir interrogé des témoins oculaires,suffisent a situer la rédaction vers la fin du xr" siecle'9. Lhagiographe utilisel'ere de l'incarnarion du Chrisr, ce qui pourrait indiquer son origine nonhispanique?", Si ce texte rapporte pour I'essentiel, comme on était en droitde s'y attendre, les événements survenus a Séville et sur le chemin du retour a
Neustria. Historiographic Discourse and Saintly Relics, 684'1090, Toronto, PontificalInstitute of Mediaeval Studies, coll. « Studies and Texts », 122, 1995 ; Hans Werner Goetz,« Vergangenheitswahrnehmung, Vergangenheitsgebrauch und Geschichtssymbolysmus in
der Geschichtschreibung der Karolingerzeit », Ideologie epratiche del reimpiego nell'altomedioevo, 1, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, coll. « Settimane di
studio del centro italiano di studi sull 'alto medioevo », 46, 1999, p. 177'225; PatrickHenriet, « Texte et contexte. Tendances récentes de la recherche en haglologíe »,dans Religion et mentalités au Moyen Age. Mélanges en l'honneur d'Hervé Martin,Rennes, PUR, 2003, P·75·86, ici p. 79-81. Sur l'Espagne, quelques éléments dans id.,« Hagiographie et historiographie en péninsule ibérique (Xle_Xllle siécles) : quelquesremarques », Cahiers de linguistique hispanique médiévale, 23, 2000, p. 53-85.
17 Sur la translation et le culte, voir Antonio Viñayo González, « Cuestiones histórico-críticasen torno a las traslación del cuerpo de San Isidoro », dans Isidoriana. Estudios sobre sanIsidoro en elXIV centenario de su nacimiento, León, Centro de estudios San Isidoro, 1961,
p. 285-297, et Baudoin de Gaiffier, « Le culte de saint Isidore. Esquisse d'un travail »,p. 271-283
18 Le premier document conservé aprés la formidable dotation de Ferdinand 1"' et Sancha
(22 décembre 1063) est une donation d'Alphonse VI (1099). 11 est déja question de labaselica beati Ysidori et de l'autet de saint Jean-Baptiste et saint Isidore. D'autres
documents de la me me année montrent qu'lsidore résume désormais I'identité dumonastérs (depuis 1063 ?). Dans les documents du début du Xlle siécle, cependant, Isidoreest encore associé au jeune martyr Pélage : Patrimonio cultural de San Isidoro de León.Documentos de los siglos X-XIII. Colección diplomática, éd. Maria Encarnacíon MartínLópez, León, Universidad de León, 1995, n° 9, io, 11, etc.
19 Madrid, Biblioteca nacional, ms. 112.20 PL, t. LXXXI, col. 43 A-B.
León, il s'ouvre cependant par une premiere lecon qui est un petit condensédes événements survenus en 7II et dans les années qui suivirent. Il constituedone la prerniere version léonaise de la « perte de l'Espagne », Lisons :
La soixante-quinzierne année aprés la mort du glorieux prélat Isidore, a la
suite d'un occulte jugement de Dieu, tout le peuple des Goths fut frappé
par le glaive des gentils. Traversant cette mer qui baigne la ville de Séville, les
Sarrasins d' au-delá de la mer prirent d' abord cette ville. Ils occuperent ensuite
les provinces de Bétique et de Lusitanie. Réunissant l'armée des goths, le roi
Rodrigue se porta a leur rencontre pour les combattre. Mais comme ce roi,
négligeant la religion divine, s'étair soumis a la domination des vices, il prit
bientót la fuite et toute l'armée fut passée par le glaive, quasiment jusqu'á la
destruction. Les Sarrasins, errant ensuite d'un caté et de l' autre, perpérrerent
des massacres horribles et innombrables. Combien de massacres, combien de
carnages ils iníligerenr aux nótres, les fortifications détruites en témoignent,
ainsi que les murailles abattues des villes anciennes. A cette époque toute
I'Hispania pleura ses rnonastéres jetés a bas, ses dioceses détruits, les livres
de la loi sacrée brúlés par le feu, les trésors des églises pillés, ainsi que tous les
habitants consumés par le fer, les Hammes et la faim2'.
Ce récit est suivi (seconde lecon) d' une histoire du redressement chrétien sousla conduite de Pélage, dans une version directement inspirée de la Chroniqued'Alphonse III (fin du IX" siecle), Pour ce qui est de la « perte », nous avonsdonc un schéma exclusivement anti-rodriguiste, qui ne mentionne pas lesturpitudes de Witiza. Par rapport a la version « méridionale » canonique, lerécit est encore tres incomplet puisqu'il ne fait aucune allusion a I'épisodede Julien. Néanmoins, nous sommes loin de la version « septentrionale »
répandue par la Chronique d'Alphonse III: Witiza et son lignage n'ontpas ici la moindre responsabilité dans la défaite des chrétiens. La versiondes événements donnée par le premier récit de la translation peut done étre
considérée comme r) ouvertement anti-rodriguiste et 2) pro-witizisre par
21 « Anno igitur septuagesimo V,post transitum gloriosissimi praesulis Isidori omnis gensGothorum occulto Dei judicio gentili gladio [erienda est tradita. Transmarini namqueSaraceni mare illud quod Hispalensi urbi alludit transfretantes, primum eamdem urbemceperunt; dein Baeticam, et Lusitaniam provinciam occuparunt. Quibus Rudericusrex, aggregato exereitu Gothorum, armatus oecurrit. Sed quia praefatus rex, neglectareligione divina, vitiorum se dominio mancipaverat, protinus in fugam versus et omnisexercitus [ere ad internecionem usque gladio deletus esto Saraeeni deineeps longelateque vagantes, innumeras, horridasque eaedes perpetrarunt. Qui quantas caedesquantasque strages nostrorum dederint, testantur eversa castra, et antiquarum urbiumdiruta moenia. Ea tempestate omnis Hispania luxit monasteria in se eversa, episcopiadestructa, libros sacrae legis igne eombustos, thesauros eeclesiarum direptos, omnesineolas ferro, flamma, [ame consumptos » (PL,t. LXXXI, col. 39 D-40 B).
125
~::oñ~:t~::ot;;'"'-oro;;~ro'nc:"C
~'~z:::Jel.ro
rrtU1
"C
'"OQ::J!"r=roU1
no::J
~c:r:¡s:::JU1
¡;¡;o::J
'"¡¡;.roU1
"X'-.~-.U1(5;n¡;;-e
126
défaur. Au nord de la Péninsule, elle est le premier témoignage, certes encore
tronqué, d'une version de la perte de l'Espagne qui ne correspond pas auschérna traditionnel fixé dans les Asturies a la fin du IX< siecle,
Pour des raisons qui tiennent vraisemblablement a l'origine hagiographique
et non historiographique du récit en question, celui-ci n'est que rarementpris en compre. Ramón Menéndez Pidal, dans son étude sur «Witiza et
Rodrigue ». lui consacre tout de mérne quelques lignes et se demande s'ilest d'orígine léonaise ou si les thernes véhículés auraient pu étre rapportés
par l'expédition sévíllane de Ferdinand I"22. De fait, la tradition exonérant
Witiza et ses fils de toute responsabilité apparait d'abord dans des sourcesarabes ínforrnées par des chrétlens ". La question mérite done d'étre posée.
Sans pouvoir faire preuve de belles certitudes, nous penchons pour laseconde solution, 11convient en effet de lire attentivement une phrase, a maconnaissance jamais relevée, qui figure dans une réécriture de la translationcornposée a León a la fin du XII< ou au tout début du xnr' siecle. Le chanoine
auteur de ce texte précise en effet que les mozarabes de Séville déclarerent,
alors que la translation des restes d'lsidore semblait imminente, qu'ilspréféraient s'exiler (<< transmigrare »}, -s'il en résultait pour eux la liberté»
(<< si eis inde esset libertas» 24). Vers le début du XIII' siécle, on avait done
a León comme une sorte de vague souvenir de I'arrivée de chrétiens d'al-Andalus en compagnie des reliques isidoriennes.
Avant d'entrer dans le vif de son sujet, le récit de la translation ne se
contente pas d'expliquer les événements qui rnenerent a la perte de Sévilleet a la destruction du royaume goth. 11 résume aussi les débuts de la
« Reconquéte », sur un mode assez classique cette fois-ci. La célebre histoire
de Pélage, qui remporte depuis sa cueva dominica (Covadonga) la premierevictoire chrétienne face aux musulmans, la légende de la montagne quis'écroule sur I'armée adverse, tous ces événernents avaient éré fixés pour la
postérité dans la Chronique d'Alphonse III. lis sont ici livrés conformément
22 Ramón Menéndez Pidal, « Witiza y Rodrigo », p. 307'308. Ménendez Pidal voit unedimension antl-witizlste dans le fait que la conquéte de Séville et de l'Espagne, qui fontdéja partie du plan de Dieu, sont rapportées avant la défaite de Rodrigue. Pourtant, letexte ne parle de stupre et de négligence religieuse que pour celui-ci.
23 Outre la chronique d'al-Rasi, voir en particulier I'égyptien Ibn al-Hakam (t 871. trad. fr.
Albert Gateau, Alger, Carbonel, 1947), l'Abjar Machmúa (fin du x' siécle ; éd. et trad. esp.Emilio Lafuente y Alcántara, Madrid, Real Academia de la Historia, 1867) et le récit d'lbnat-Oütiva, qui date de la fin du x' slécle (trad. esp. J. Ribera, Madrid, Real Academia de laHistoria, 1926). Ce dernier auteur est un descendant de Sara la Gothe, elle-mérne petite
fille de Witiza. Voir Ramón Menéndez Pidal, El rey Radriga, p. 15-16 et 24-25, id., «Witizay Rodrigo », p. 316-318, ainsi que Thomas Deswarte, « Le viol commis par Rodrigue ... »,art. cit., p. 70-72.
24 HT, p. 154.
a cette version canonique, l'auteur précisant d'ailleurs, dans une transparente
allusion a cette ceuvre, que « si quelqu'un veut connaitre pleinement ces
faits, qu'il lise la lugubre histoire de cette époque »25_A la suite de Pélage,une série de rois restaure le royaume des Goths. Les dioceses sont rétablis,
les églises sont reconstruites, les trésors sont reconstitués, des livres, enfin,
sont copiés. Mais un roi, nous dit l'hagiographe, s'illustre plus que tous les
autres: c'est Ferdinand I", qui chátie durement les Sarrasins avant d'obtenir
les reliques isidoriennes26. Pour bien comprendre le róle de Ferdinand dansce récit et plus généralement dans tout le dossier hagiographique isidorien, ilconvient de prendre en cornpte non seulement sa responsabilité directe dans
la translation, mais aussi le fait qu'en 1065, il mourut et fut inhumé dans
la basilique de saint lsidore. 11devint alors et pour des siecles le personnagele plus prestigieux parmi tous ceux qui, hormis les saints, reposaient dans
cette église27. La construction de la mémoire et celle du lieu de mémoire seconfondent ainsi, autour d'un panthéon royal qui était en mérne ternps un
trésor de reliquesf".
LE RÉClT DE L'HISTORIA SILENSE
LHistoria Silense est l'oeuvre d'un moine qui écrit vraisemblablement
dans la seconde décennie du XII' siecle et se présente comme issu d'une
domum seminis'". Traditionnellement, cette « demeure de la graine» avaitété identifiée avec le monastere castillan de Silos, d' OU le nom d' Historiasilense. Or plus personne ne croit aujourd'hui a cette origine, en faveur
25 «Tandem pietas illa, quae nan est solita eos, quos corripit, ad internecionem usquedele re, sed, f/agellando, misericorditer corrige re, animas Pelagii cujusdam, qui regiatraduce exstitit oriundus, corroboravit, et contra Saracenos loco, qui dicitur CavaSanctae Mariae, rebellando, eis bellum indixit. Qualiter autem in conf/ictu illo divinamanus pro nos tris pugnaverit, ex hoc poterit adverti, quod armorum spicula, a Saracenismissa, in eos ipsos vis divina retorsit ; et rupes quaedam, Dei nutu praescissa, corruit, etex Saracenis non minimam multitudinem opprimendo exstinxit : quod si quis ad plenumvoluerit noscere, lugubrem historiam temporum illorum studeat legere » (PL, t. LXXXI,
col. 40 S-C).26 «Ex quorum illustri prosapia emersit vir c1arissimus Fredinandus Sancii regis {ilius, qui,
ut sceptra regni possedit, non est nostra intentio evolvere, quantam et quam crebramperniciem Saracenis tmuiertt » (ibid. (col. 40 C-D).
27 Le récit exemplaire de la mort de Ferdinand est rapporté a la fin de I'Historia silense (HS,p. 207-2°9), puis dans I'Historia translationis (HT, p. 163-165) et enfin dans Lucas de Tuy
(CM, p. 294-296). De la, iI passe a I'historiographie castillane du XIII' stécle.28 Sur Saint-Isidore comme panthéon royal, voir maintenant la mise au point de Manuel
Carriedo Tejedo, « Panteones reales leoneses (siglos x-xIII) », dans Estudio antropológicodel panteón real de San Isidoro de León, dir. Maria Encina Prada Marcos, León, 2006
[éd. dlgltale], t. 1,p. 8-97·29 HS, p. 118.
127
-e
~"ñ;>;
:x:~"¡;;...¡
"ro~ro:P.ro'nc::'C!!!'~o·'"o-roni'"'COl
""'"ror-ro'"no'"~2~o·'"'"m;o'"Ol¡¡;.ro'"'X'~.i,;=.'"¡;;;n¡¡;e
128
de laquelIe il n'existe pas l'ombre d'un indíce?". Tout semble en revancheindiquer une rédaction non pas castillane mais bien léonaise, a commencer
par l'incorporation dans le corps de la chronique du récit de la translationd'Isidore. Le lieu de composition pourrait étre le monastere de Saint-JeanBaptiste et Saint-Pélage, mérne s'il convient tour de mérne d'étre prudent sur
ce point ".Le récit de la perte de l'Espagne est original. Dans une perspective
providentialiste qui, elle, ne l'est guere, la défaite est une conséquence dureláchernent généralisé des mceurs, mais aussi des crimes commis tant par
Witiza que par Rodrigue. Dans le récit relatif au regne de ce dernier, nousapprenons qu'il avait expulsé les fils de Witiza, lesquels s'étaient réfugiés
en Tingitane ou ils étaient entrés en contact avec le comte [ulíen ". Cepersonnage, promis a un bel avenir dans la mythographie hispanique, fait
ici sa prerniére apparition dans la littérature latine ". Alliés, Julien et les fils
de Witiza décident d'introduire les Maures en Espagne « pour la perte decelle-ci »34. Si [ulien, homme somme toute honorable, était disposé a agir
de la sorte, c'est parce que Rodrigue avait violé sa fille, puis en avait fait sa
concubine au lieu de l' épouser.La version de la Silense n'est pas exclusivement anti-rodriguiste (les enfants
de Witiza jouent un róle direct dans les préparatifs d'invasion et leur pecene vaut pas mieux que Rodrigue "), mais elle véhicule tout de mérne des
éléments qui renvoient a une tradition originaire du sud de la péninsule.Ainsi, le personnage de Julien n'était jusqu'alors apparu que dans des sourcesarabes ". Si l' auteur de la Silense est bien léonaís, comme il y a tout lieu de
30 Voir pour une mise au point l'introduction de Richard A. Fletcher a la traduction anglaisede I'Historia Silense (voir note iz), que nous continuons a appeler ainsi par commodité.
31 Manuel C. Díaz y Díaz a suggéré que la lecon « domus seminis» pourrait étre une
mauvaise lecture de « domus sci innis ». (= lohannis) « maison de saint lean ». Voir entreautres Manuel C. Díaz y Díaz, « Isidoro en la Edad media hispana ». dans De /sidoro alsiglo XI. Ocho estudios sobre la vida literaria peninsular. Barcelona. El Albir Universal,
1976. p. 190.32 « /uliano comittl, quem Victica rex in suis fidelibus familiarissimum babuerat,
adheserunt, ibique de iIIatis contumeliis ingemiscentes » (HS. p. 127).33 Pour ne plus la quitter. Iulien se convertit par la suite en une sorte de mvthe, a tel
point que l'écrivain Juan Goytisolo a pu intituler l'un de ses livres les plus importantsReivindicación del conde don tutián (lé" éd. Mexico. Joaquín Mortiz. 1970).
34 « Mauros introducendo, et sibi et totius /spanie regno perditum iri disposuerunt » (HS.p.127).
35 « Vita et moribis Victice non dissimilis » (ibid .• p. 127 [a propos de Rodriguej).36 Iulien apparait également dans la chronique latine dite Pseudo-tsidortana, que l'on
a longtemps tenues pour un texte tolédan du Xle slécle, Le dossier est éminemment
complexe. 11 est désormais certain que si l'auteur avait a sa disposition des sourcesarabes, il ne se contentait pas de traduire. L'ceuvre ne peut étre antérieure a la prerniére
moitié du Xlle siede et pourrait avoir été composée en Catalogne ou en Aragon. Witiza
le penser, nous avons la une confirmation qu'il existait a León une traditionlocale, déja présente dans le premier récit de la translation, qui faisait de
Rodrígue le premier responsable de la « perte ».LHistoria Silense n'est pas moins originale dans sa description de la
« récupération» de l'Espagne. II convient cependant de ne pas s'arréter
trop longtemps sur le récit des exploits de Pélage, directement copié de lachronique d'Alphonse Ilp7, mais plutót sur un chapitre que l'auteur a jugé
bon d'ajouter a peopos de Charlemagne. Nous avons la une sorte de morceau
de bravoure anti-franyais, dont nous ne donnons qu'un extrait
Hormis Dieu le Pere qui sanctionne miséricordieusemenr de sa verge lespéchés des hommes, personne, parmi les peuples étrangers, n'est venu au secoursde I'Espagne. Pas meme Charlemagne, dont les franes disenr faussemenr qu'i\a arraché aux paíens un certain nombre de villes de ce cóté des Pyrénées
38.
Le chroniqueur explique ensuite que si Charlemagne est bien ven u [usqu'á
Pampelune et Saragosse, il a été corrompu dans cette ville par l'or musulman.
De toute facon, son plus cher désir n'était-il pas d'aller se baigner dans les
mermes qu'il venait de se faire construire a Aix-la-Chapelle ? Sur le chemin
du retour, I'empereur dut subir l'artaque de Roncevaux39. La [econ de cesurprenant récit est facile a établir : avec l'aide de Dieu, le peuple goth est seulresponsable de son redressement. Nous avons done la un texte « nationaliste »,
en ce sens qu'il postule l'existence d'une communauté hispanique tout en se
révélant passionnément anti-franc40. Cette derniece tendance n'empéchc pas
le chroniqueur de puiser abondarnment ses sources et aussi ses mots dansÉginhard et les annales franques, par exernple lorsqu'il dresse le portrait de
Ferdinand 1<r41•Pro-hispanique par príncipe, l'auteur n'en oublie pas pour
autant le royaume et I'église de León, au point d'encasrrer dans sa chronique
la roralité du récit de la translation d'Isídore ".
est présenté sous un jour favorable. mais il abuse de la fille de julien. Présentation trescomplete du dossier de la Pseudo·/sidoriona par son dernier éditeur. Fernando GonzálezMuñoz. La chronica gothorum pseudo·isidoriana (ms. Paris BN 6113)· Edición crítica yestudio. A Coruña. Editorial Toxosoutos. 2000.
37 HS. p. 132.136.38
« Preter Deum oatrem, qui peccata hominum in virga misericorditer visitat, nemoexterarum gentium /spaniam sublevase cognoscitur. Sed neaue Carolus, quem infraPirineos montes quasdam civitates a manibus paganorum eripuisse Franci falso
asserunt i (ibid .• p. 129).39 /bid .• p. 130.40 Voir Adeline Rucquoi. « La France dans l·historiographie ... », art. clt., et Diego Catalán. La
épica española ...• op. cit .• p. 239.241.4
1Voir l'introduction de Pérez de Urbel et Ruiz·Zorrilla. p. 49.52. Ajoutons que dans le récitde la mort de Ferdinand. l'auteur utilise également la Vie de Louis le Pieux par Thégan.
42 HS. p. 198.204.
129
S::oñ:-;;¡:
~~~-oro¡;~ro'nc:"C
""~s::Jo-rorrtti>"C
'"CIQ::J!"r--roti>no::J~<=~o"::Jti>¡:¡;;o::J
'"¡¡;"<t>ti>
'X-.~-.ti>m;nro~
Venons-en maintenant a la troisiérne píéce du dossier. Celle-ci se situe dansla continuiré des deux rextes examinés pour l'instanr, mais elle s'en détachesur un point essentiel qui l'oppose radicaJement a l'Historia Silense. II s'agitdu second récit de la translation d'Isidore.
lE SECONO RÉClT DE LA TRANSLATlON
130
rHistoria translationis saneti lsidori est une version réécrite et supplémentéedu premier récit de la translation. Elle a pour auteur un chanoine de Sainr-Isidore de León qui écrit a une date postérieure a la canonisation de 1homasde Canterbury et antérieure aux années 122043.
Traitanr la pene de I'Espagne et la question des responsabilités, notrechanoine combine une version anti-rodriguiste a un discours anti-witiziste,mentionnant a la fois les fils de Witiza et le cornte julieriw. Le récit suitl'Historia Silense, ainsi que la Chronique d'Alphonse III pour ce qui esrde Witiza4S. Cependant, tout en restant tres proche de ces chroniques,I'Historia translationis propose une mise en perspective tres nouve!le. Le récitdu désastre est en effet précédé d'un paragraphe relaríf a Isidore de Sévilleernprunré a la Vita saneti lsidori, un rexte anonyme sans doure rédigé peuavant I'Historia translationir», Ce passage rapporte pour l'essenríe] uneprophéríe. Isidore vienr de donner leurs lois aux rois goths, en rnérne tempsqu'i! imposait la « discipline ecclésiastique» a l'Église. II profere alors unemise en garde : lorsque le peuple goth délaissera ces préceptes, il tomberasous la triple atreinte du glaive des ennemis, de la famine et de la pestev.
La topique des trois maux, qui apparaissait déjá dans le premier récit de latranslation pour décrire la situation de I'Espagne pendanr l'invasion-", fonde
43 L'Historia translatianis est connue de Lucas de Tuy, qui écrit un recueil des miraclesd'lsidore il partir des années 1220 (présentation dans Patrick Henriet, « Hagiographie etpolitique il León au début du XIII" siecle : les chanoines réguliers de Saint-lsidore et laprise de Baeza », Revue MabiJ/an, n.S. 8 (= t. LXIX), 1997, p. 53.82.
44 HT, p. 145-146.
45 Witiza est qualifié de « f/agiciosus ». comme dans la version Rotense de la Chroniqued'Alphonse 111.
46 HT, p. 144, reprenant Vita sancti Isidori (BHL 4486), PL, t. LXXXII, col. 19-56. Voir JacquesFontaine, « A propos de la Vita sancti Isidori (CPL1214) : ou comment on récrit I'Histoire »,Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniques médiévales, 24, 2001, p. 235-248.
47 « Et ore prophetico protestatus est dicens : Cum in his traditionibus permanseritis purocarde, in presenti vita pace fruemini in bonis et in eterna gloria coronabimini laudeperpetua. Cum autem hec precepto derelinqueritis, apprehendent vos mira mala et cadetgens Gothorum fame et gladio inimicorum et peste. Cum autem conversi ad Dominumfueritis perquirentes ea, possidebit semen vestrum portas inimicorum suotum, et eritvobis gloria maior quam fuerit unquam » (HT, p. 144).
48 « Omnes incolas ferro, flamma, [ame consumptos » (PL, t. LXXXI,col. 40 B).
désormais une prophétie. Ce court texte permet ainsi de lier plus étroiternentl'histoire de la Péninsule et la figure d'!sidore, qui en connalt le moteur et enfixe les regles.
Le récit des reconquétes chrétiennes nous réserve quant a lui une importantesurprise, tout particulierernent lorsqu'on le rapporte a ce!ui que donnaitI'Historia Silense. Tout commence, banalement, par l'histoire de Covadongate! que la livrait le premier récit de la Translatio. Mais immédiatement apresvient un texte étonnant, qui semble prendre systématiquement le contre-piedde la Silense. Lisons ;
Alors Charles, fameux roi de France, prévenu en songe par le bienheureux
apótre Jacques er exercanr avec zéle la loi de Dieu en compagnie d'une illustre
armée de franes, élimina par le glaive les Sarrasins des confins du Poirou et
de la Vasconie. Passant au temps du roi de León Alphonse le Grand les cols
pyrénéens, il parvinr alors a Saragosse. En signe d' amirié, il donna sa tres noble
cousine en mariage a ce roi. Er alors que le tres chrérien roi Charles visirait
pour y prier le seuil du bienheureux apótre Jacques, le roi Alphonse accorda
sur son tres sain conseil l'honneur rnérropolirain a l'église de l'apótre saint
Jacqucs. Avec l'accord du pape romain, il décréta que tant ces cleres que ceux
du reste de l'Espagne vivraienr désormais selon la regle du saint pere Isidore,
afin que ce donr la négligcnce avait éré cause de chure fUt désormais renouveau
pour l'Espagne49.
Ce passage, inattendu dans une oeuvre de cene nature, renvoie bienévidemment a une « rnatiere carolingienne» re!ative a la venue deCharlemagne en Espagne!". Le songe de I'empereur, ses bonnes relationsavec Alphonse II, son pelerinage a Compostelle et sa réforme « isidorienne »de l'église hispanique, tour cela se trouvait déja, presque en ces termes, dans lachronique du Pseudo-Turpin S'. Le plus ancien manuscrit de celle-ci, il n'est
49 « Set et Karolus famosus Francie rex, a beato apostolo lacobo per visum ammonitus,cum preclaro Francorum generatione zelum legis Dei exercens, de Pictavie et Vasconieconfinibus rumfeali ultione sarracenos eliminavit et per Pireneica iugo usqueCesaragustam tempore Adefonsi magni regis Legionensis devenit et dilectionis causaeidem regi Adefonso consubrinam suam nobilissimam in coniugio copulavit. Liminaetiam beati lacobi apostoli cum christianissimus rex Karolus gratia visitaret orandi,saniori eius consi/ia rex Adefonsus sancti lacobi apostoli ecclesiam metropolitanahonore ex romani pope assensu, decoravit atque ut secundum sancti pa tris Ysidoriregulam viverent tam ipsi quam omnis Yspanie clerus, statuit, ut hoc esset Yspaniaesubievatio, cuius neglectus extiterat ei causa deiectionis » (HT, p. 147).
so Voir note 8.51 Sur ce texte célebre, on s'orientera dans la bibliographie il partir du récent colloque dirigé
par Klaus Herbers, El Pseudo- Turpin, lazo entre el culto jacobeo y el culto de Caro magno,op. cit. On consultera le texte dans I'édition Klaus Herbers et Manuel Santos Noia, Libersancti jacobi. Codex Calixtinus (désormais LS/), Santiago de Compostela, Xerencia dePromoción do Camiño de Santiago, 1998, p. 199-229.
131
~;o
ñ;.;;¡;
~;o
~-o~;;;~It),ne'C
~'~o'~c.It)
niIn'C
'"CIQ~!"r-'It)InrvO~~e~O'~Inm;O~Qj
¡¡;'It)In
Si"-.~-.'"~;nrn~
132
pas indifférent de le rappeler, n'est autre que le célebre Codex calixtinus, copiéa Compostelle vers le milieu du XII" siecle52. C' est donc la tradition vilipendéetrois quarrs de siecle plus tót par l'auteur de la Silense que notre hagiographereprend ici. Il ne le fait cependant pas inconsidérément, car si le Pseudo-Turpinmentionnait longuement les vicroires militaires de Charlemagne en péninsuleet les villes arrachées aux musulmans par ses soins 53, l'Historia transLationis seconcentre sur la restauration des lois, parriculierement ecclésiastiques. I.:auteurne mentionne pas direcremenr les conqueres miliraires de Charlemagne _ ilne les nie pas non plus, contrairement a I'aureur de la Silense _, mais il faittour de mérne de l'empereur franc le principal responsable de la restaurationde l'Espagne avec et apres Pélage. La suite du récit passe a Ferdinand lec, quise voit également accorder un róle de premier plan 54. A sa facon, l'aureur del'Historia transLationis concilie done les discours contradictoires du premierrécit de la translation, de la Chronique d'Alphonse III, de l'Historia SiLenseer du Pseudo-Turpin. Il est lui rnéme largernenr repris, que!ques années plustard, dans le Chronicon mundi de Lucas de Tuy.
LE RÉCIT DE LUCAS DE TUY
Sans doute chanoine de Saint-Isidore, Lucas de Tuy écrit sa « chronique dumonde» (en fair de l'Espagne) dans les années 123055. Il peut alors disposerd'un assez riche corpus de textes, constitué pour l'essentíel par la Chroniqued'Alphonse III et les rexres léonais qui Ont suivi ou interprété ceHe-ci. Pource qui est de la pene de I'Espagne, Lucas s'étend longuemenr sur la poliriqueimmorale er néfasre de Wiriza, non sans innover. Il signale en paniculier que ceroi fir venir des juifs en Espagne et leur Octroyades priviléges d'immuniré, aumépris des droits de l'Église. Cette mention precede directement la conclusiondu passage, selon laquelle c'est bien la politique de Witiza qui a entrainé laruine des hommes er la subversion des Espagnes56• Le régne de Rodrigue,
52 Sur ee manuserit, voir Manuel Díaz y Díaz, El códice calixtino de la catedral de Santiago:estudia codicológico y de contenida, Santiago de Compostela, Centro de Estudios}acobeos, col!. « MonografTas de Compostellanum », 2, 1988, ainsi que }ohn W. Williamset Alison Stones, TheCodexCalixtinus and the Shrine of Saint 1ames,Tübingen, G. Narr,coll. «Jakobus Studien >', 3, 1992.
53 LS1,p. 201-202.54 HT, p. 148.
55 Sans doute depuis le début des années 1230 et avant 1239. Voir désormais la rieheintroduetion d'Emma Falque Rey a son édition du Chranicon mundi, op. cit., avee tous leséléments bibliographiques néeessaires.
56 «Addidit et vittca iniquitatem super iniquitatem et ludeos ad Yspanias evocavit atquefractis eccleslarum privilegiis tudeis inmunitatum privilegia dedito Deus autem tantum[acinus tantamque maliciam aborrens, hominum ruinam et subversionem Yspaniarumpopulis intulit» (CM,p. 219).
« uita et moribus Vitice non dissimilis ", est longuement détaillé, de mérneque le róle de Julien et des fils de Witiza 57. Pour ce qui est de la reconquéte,Lucas livre évidemment le récit de Covadonga mais il reprend aussi la venuede Charlemagne en Espagne, avec I'épisode de Roncevaux et le pelerinagea Compostelle. Plus développée que celle de l'Historia translationis, cettesynthese en est tout de meme assez proche. La principale innovarion résidedans I'apparition de deux personnages pleinement hispaniques, sans doureissus de la tradition orale, qui n'hésitent pas a combattre les empereurs franes.Le premier, nommé Bernard, est directernent responsable de Roncevaux maisil se rallie ultérieurement a Charlemagne-". Environ un siecle plus tard, unhomonyme appelé Bernardo de! Carpio combat un rnystérieux empereurappelé Charles Martel s", Ces deux figures jouent donc le róle de trait d'unionentre le discours anti-franc de la Silense, qui tendait a voir les carolingienset plus généralement les franes comme des envahisseurs, et le discours pro-carolingien te! qu'il s'était répandu depuis Compostelle sans doure. Lucasatrribue rnérne a Charlemagne divers combats et massacres de musulmans,ce que n'osait pas encore faire, comme nous l'avons vu, l'auteur de l'Historiatranslationis'",
Les différentes versions de la pene de I'Espagne er de ses conséquencesreposent toutes, au-delá des variations qui les différencient, sur un mérne« paradigme providenrialíste »61: les péchés des chrétiens (Witiza, Rodrigue,les cleres, etc.) sont punis par Dieu qui leur envoie les musulmans pourchátiment, un chátiment qui doit cependant erre compris comme uneépreuve plus que comme une sanction définitive. Cet épisode et ce schémaont constirué pour des siécles le socle d'une vision proprement hispanique del'Histoire, ils ont nourri ce que l'on pourrait appe!er un « régime d'historicité »
péninsulaire. Un événement nodal, riche de conséquences et facile a replacerdans le plan divin, perrnertait d'orienter le temps.
Les différents textes qui ont été présentés rnontrent comment en un mérnelieu, durant environ un siecle et demi, des solutions différentes furent
57 Ibid., p. 219-222.58 Ibid., p. 235-236.59 Ibid., p. 245-247. Voir Patriek Henriet, «Xénophobie et intégration isidoriennes a León
au XIII' síécle. Le diseours de Lueas de Túy (t 1249) sur les étrangers », dans L'Étrangerau Moyen Age, Paris, Publieations de la Sorbonne, 2000, p. 37-58, iei p. 41-43, et KlausHerbers, « Le eulte de saint }aeques et le souvenir earolingien ... », art. eit.
60 « Funesta truncatione Ysmaheliticum populum trucidavit» (CM, p. 235); « exsarracenorum nobilibus innumerabilem extinguens multitudinem » (ibid., p. 236).
61 J'emprunte eette expression a Dominique Barthélemy (qui I'utilise évidemment dans untout autre eontexte) : L'An Mil et la paix de Dieu. La France chrétienne et féodale, 980-1060, Paris, Fayard, 1999, p. 189.
133
~"ñ;o<;
l:tT1Z
"¡;;-1
"'"ª~~'c:u"',~o·:>C.
'"rn'"U
'""":>!"r=
'"'"no:>
~c:ns::>'"¡¡;;o:>
'"¡¡;.'"'"'X'-.~-.'";o;niD~
134
apportées a un rnérne problerne, non sans hésitations et táronnements.
Ces mises au point successives aboutirent a une sorte de synthese dans lachronique de Lucas de Tuy, qui nourrit elle-mérne, avec celle de ]iménez deRada, les chroniques royales du xnr' siecle. A l'époque id prise en compte,
les enjeux initialement véhiculés par les traditions relatives a la perte et ala récupération de l'Espagne s'étaient déjá déplacés, et ils continuaienr de
le faire. Lopposition primitive entre partisans de Rodrigue et de Witiza, si
I'on en croit la reconstruction de Menéndez Pidal, n'était sans doute plus
clairernent per<;:ue, Elle derneurait cependant comme une strate de discoursancien, révélatrice d'une origine, méridionale ou seprenrrionale, dont on
n'avait certainernent plus conscience. Le véritable enjeu se reporta donc surla question de la récupération/reconquéte, et plus particulierernent sur le rólequi devait erre assigné aux franci.
Dans la construction d'une mémoire hispano-Iéonaise, la notion de va-et-vient apparait centrale. Il y a d'abord va-et-vient entre les genres « littéraires »,
soit, id, l'hagiographie et l'historiographie. Ailleurs, dans d'autres opérations
de reconstruction du passé, interviendront des cartulaires, des sourcesiconographiques, etc. La mise au point d'une mémoire commune n'est done
pas le seul fait de l'historiographie. Mais il y a aussi va-et-vient permanent
entre un discours localiste er un discours englobant, qui prétend s'adresser al'ensemble de la patria hispanique. Au-dela des trouvailles ponctuelles, c'estfinalement tout l'intérét de notre dossier léonais. Les deux discours, en effet,
ne s'opposent pas mais se nourrissent réciproquement. Le lieu construit sa
mémoire, et ce faisant il se construir comme lieu de mémoire en s'insc~ivantdans une trame temporelle générale et connue de tous. Ainsi, des le début, ilaffirme ses prétentions globalisantes, « nationales» si l'on veut. A León, cene
orientation est facilitée par la nature particuliére du culte a l'ombre duquel ont
été écrits les textes : Isidore de Séville était en effet considéré comme le DoctorHispaniarum et son action intéressait, idéalement au moins, l'ensemble de
la péninsule. On voit done bien ici comment la construction mémorialedu Locus s'articule a celle de l'espace (Hispania) er comment les différentes
échelles de mémoire se raccordent les unes avec les autres, Du caté du locus,soit Saint-Isidore de León, tour part et aboutit aux au souvenir du saint
éponyme. Cependant, le róle supposé d'Isidore dans l'histoire de l'Espagne -
législation civile er religieuse, lutte contre l'hérésie, annonce prophétique desmalheurs futurs - invite les hagiographes a enchásser leur discours dans une
sorte d'écrin historiographique, et donc a ficher le particulier dans le général.L'exemple de León invite a ne pas sous-estimer le róle des constructions
mémoriales locales. Nous avons ici deux textes hagíographíques=, de
62 Voire trois en comptant la Vita saneti Isidori, premiére ceuvre a ma connaissance arapporter la prophétie isidorienne de ruine de l'Espagne « gothique ».
portée théoriquement plus restreinte que les chroniques contemporaines.Or ces deux récits de uanslation se révélent plus d'une fois en avance sur
l'historiographie. C'est la TransLatio sancti Isidori qui, pour la prerniere foisau nord de la péninsule, propose une version des faíts qui ne mentionne pas
la culpabilité de Witiza. C' est l'Historia transLationis qui, la prerniere a León,
introduit Charlemagne comme un acteur majeur dans la restauration de
l'Espagne chrétienne.La reconstruction du passé se faít-elle ailleurs sur un mode résolument
différent de celui que nous avons tenté d'éclairer pour León? Il n'y a aucune
raison de l'affirmer a priori. II importe donc de raisonner par centres en
s'intéressant aux lieux, dans une perspective comparatiste et sans jamais perdrede vue que ces derniers, des lors qu'ils produisent un discours structuré, sepercoivent et se présentent comme des póles. Leurs constructions mémoriales
ne fonctionnent donc jamais totalement en circuit fermé.135
~-i;xl
ñ:><:
:t~;xl¡;;-i
"~lO~"',"<:"O"',elo'::oCl.
'"m'""O
'"CIQ::o~r-'
'"'"rvo::o~2!).o'::o'"¡¡;;o::o
'"¡¡;.'"'"-X-;,
~-;,'"~;
me