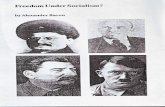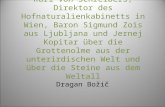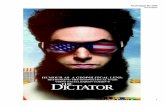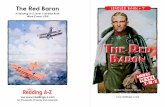« Les Mystères de Paris transgressent-ils la morale ? Sur la contradiction entre deux censures de...
-
Upload
republique-des-savoirs -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of « Les Mystères de Paris transgressent-ils la morale ? Sur la contradiction entre deux censures de...
É,tudes réunies et présentées parChristine Baron
TRANS GRES S ION, LITTÉRATUREET DROIT
la licornePnnssps UÀrrvEnslrAIREs DE RnNNEs
20r3-r06
Directeur de la publication: S. Bikialo
C-omité de Édaction: Stéphane Bikido, Michel Briand, Pascale Drouet, Francisco
Ferreira, Raphaëlle Guidée, Anne-Cécile Guilbard, Liliane Louvel, Pierre Martin, DenisMellier, Gilles Menegaldo, Liza Méry Dominique Moncond'huy, Marie Parmentier,
Catherine Rannoux, Julien Rault, Henri Scepi
Secrétaire de rédaction: Vanessa Merle
Publié avec le soutien de I'UFR de Lettres et Langues et I'Université de Poitiers
Correspondance éditoriale :
La Licorne
Maison des Sciences de I'Homme et de la Société
BâtimenrA5
5 rue Théodore læfbvre
86000 Poitiers
(0549453210 - fax 0549454668)e-mail : lalicornepmshs.univ-poitiers.fr
Pour les abonnements, s'adresser à:
Presses Universitaires de Rennes
Campus de la Harpe
2, rue doyen Denis-Leroy
35044 Rennes CEDEXTé1. : +33 (0)2 99141401 - fax: +33 (0)2 99 141407
Conception et réalisation :
Vanessa Merle
Dépôt légal: 2. semestre 2013
ISBN : 978-2 -7 535-27 54-6
TRANSGRESSIOIUNE AFEAIX
Erenissrs f.r3lÊdÊhFrhlrpndchç-ç n obi- o çe ttuidclcobmchÊGæporæd@êcrdrtdlgd.Eh'- crddGtrct enùc drohct FnÉn
l.Ious aurons dabord.Gidc scs points dc rupor (rirqgdbn dcr æ-rrc à dcr rhtJirr.bnqrr ægerrripa1c inurogé per dcr pqI'itrrç appdtc cû dG rr'r-ahrrrnsgrcsÉoo inpËçcrd-àlccartù:ntæclc&irÉrcdcdlccrfdfrcrh--iFrtn àfinecrtcb&&hE'farrcmhcr
L!Èf-irFÈcf,tÛ$L'" lLdr.'-r-llt5LI-&dtb.*e&'rr.-3
AEôEfrih, I*La/
LES MYSTÈRES DE PARISTRANSGRESSENT-ILS t MORALE ?
SUR LA CONTRADICTIONENTRE DEUX CENSURES DE LINDD(
Jean'Baptiste AMADIEU
Le 22 janvier 1852,la Congrégation romaine de I'lndex interdit aux fidèles
câtholiques la lecture des æuvres d'Eugène Sue. Après le nom de I'auteur, le décret
du tribunal ecclésiastique mentionne en effet la clausule générale de condam-nation " Opera omnia qaocamque idiomate exarata n. Publiés dix ans plus tôt,Les Mystères dt Paris sont inclus dans la condamnation des ceuvres complètes de
Sue, dans quelque langue que ce soit. Sans l'ouverture des archives de I'Index par la
Congrégation pour la Doctrine de la foi en 1998', on ignorerait encore le déroule-
ment la procédure ayant abouti à cette proscription canonique, ainsi que les motifsqui justitèrent la mise à I'lndex. Les collections historiques de la Congregationnous apprennent même que I'ceuvre de Sue fut examinée deux fois:
- un premier procès, en 1845, examina exclusivement Les Mystères fu Paris(procédure nominative) et se conclut par I'abandon des poursuites;
- après des débuts de nouvelle procédure de la pan du Maître du Sacré Palais puis
du Saint-OfÊce, I'Index s'attela à un nouvel exarnen de Sue, mais général à toutes ses
productions. Cette dernière procédure aboutit au décret du 22 janvier 1852,
Le second examen de I'Index analyse les ceuvres complètes de Sue, titre après
titre'z, Les Mystères dz Paris furent donc examinés deux fois, une fois en 1845
l.Arcbitio dclk Cottgregaqiore pel la Dultita delkfede (Archives de la Congrégation pour la doctrine de la foi,Pù*zzo del Santo Officio, 00120 Città del Vaticano). En abréç: ÂCDF.
2. Martiq lbnfdrrt trtilw, oa hs némoins d'un tnbt dc cbambre; Izs Enfattts tlt fanour; I-a Bonne Awttate i Lz Morne-a*Diabh, ot I'awil*ier; l:s Mystères de Pari,ri Pailz Mouti, oc I'Hôt l linbeil; Matbildr, némoi*s d'*ne jcuncfemmc;
36 Jean-Baptiste AMADIEU
dans une procédure ne jugeant pas le roman digne de condamnarion, une aurreen 1852 lors de la première condamnation générale d'un romancier français parI'Index au xIxesiècle. Entre 1845 et 1852, I'avis de la censure ecclésiastique surcette æuvre connaît un retournement exemplaire.
Écrits à sept ans de distance, les deux rapports de censure, nommés uott,présentent un cas d'une aussi grande rareté que curiosité dans I'histoire de laCongrégation, en raison de leur contradiction. Le premier uotum nie la trans-gression morale, quand le second I'affirme. Le partage de mêmes valeurs, au sein
d'une communauté interprétative homogène comme la Congrégation de I'Index,montre que l'interprétation d'une transgression en fait de littérature ne se réduitpas à la déÊnition et à I'extension de la norme et de sa déviance, comme uneopinion rapide le laisserait penser. La divergence entre les deux rapports éclaireI'importance de I'acte de lecture dans la saisie de la transgression, plus que les
choix éthiques à I'aune desquels on évalue cette transgression.
VOTUM DE LAUREANI SUR LES MYSTÈRES DE PARIS (SESSION DUl3 JANVTER 1845)
Une procédure de I'Index suit plusieurs étapes réglementées par la constitu-ti,on Sollicita ac prouida (1753) de Benoît XIV, encore en vigueur au xrf siècle.
Après avoir reçu une plainte ou dénonciation contre l'æuvre, le secrétaire dela Congrégation confie le dossier à un consulteur (ecclésiastique membre de laCongrégation, sans être cardinal), qui rédige un rapport sur l'æuvre. Ce rapport,nommé uotttm, sert de document du travail au tribunal. Une fois le aotum rédigé,il est imprimé puis diffusé aux consulteurs et cardinaux de I'Index. Les premiersse réunissent d'abord en o congrégation préparatoire o, pour proposer un avis
consultatif aux cardinaux. Après ce premier jugement collégial, les cardinaux se
réunissent à leur tour en o congrégation générale, afin de décréter sur l'ceuvre.
Eux seuls ont voix délibérative. Le décret, non encore public, est ensuite soumisau pape pour qu il le promulgue.
Les collections d'archives conseryent trà peu de dénonciations. Les rapportsde congrégations préparatoires et générales sont pauvres en informations. Seuls
les uota nous fournissent le détail des incriminations retenues contre une æuvre.Uauteur du premier aotam sur Les Mystères dc Paris fut I'abbé Gabriele Laureani
lt Berger de Kraun; Plik el Plok; Atar-Cil/, L,e Paitien en mr; Comédiet socialet el scànes dialogrées; Jean Cnulier, otles fanatiqau des Céwnnet; Ia Coucarakha; Ia Vigie ù Koal-Vm; Arthtr; Deux Ilistoiret. ls Atentures d'HernhHardi; Ia Salanandn; I t Commandeur de Mabe; Iilfratnonl; Tb#se Dcnqeri lz Jaif enant.
LES MWTÈRES DE P/4RISTMNSGRËSSENT.ILS 1-A MORALE? 37
(1788-l84gz). Professeur de littérature grecque et de rhétorique, ftru d'archéolo-gie, membre de I'Académie de religion catholique et custode de la BibliothèqueVaticane, il est nommé consulteur de la Congrégation en 1843, Le uotum sur
Les Mystères de Paris est le seul rapport qu'il commit pour I'Index.Laureani rend son uotum avant le 16 décembre 1844, date de la congrégation
préparatoire. Il occupe un peu plus d'une page imprimée, adressée au secrétaire
de I'Index:
3. Pour une prosopographie de Laureani, voir Philippe Bouuy, Sowtzin et pontife. Reebcnh* pronpographiqtes
sttr la Cai) -ÀAia'l'âge de k Restasratiott (1514:1-846), Rome, É,cole française de Rome, coll. de l'Écolefrançaise de Rome (no 300),2002,p.772i etHetman H. Schwedt, TobiasLa,galz, Pmopogmpbh nn riiaiscbcr
Inquisition md Indcxk"otgregtion, l8l4J 917, coll. < Ninisch Inquisition and Ind*Aongregation > (dir. Huben Wolf),Paderborn, Fetdinand Schôningh,2005, t. II, p. 835-837.
Con tntimcnto di uera aergogtra mando cosi
urdi a Vossignoia Rcuerendi*ima il mio parere
soprai misteri di parigi di Eugenio Sue ec. ec, edinsieme i uentiqudttro fascicoli contenenti lb?craindicata,
Non saprci dire, sc questo libro sia un intero ro-
manzt, o an ftEcozzrtmento di awenimenti parteuri, pane inuentati, ed accaduti in Parigi ad unillustre pmonagio 7èdesco (il Gran Duca Rodolfo
di Gerobtein) il quah dopo an ertore giouaniltsi tennc lontano di casa del Padre, dimorando inParigi per ahun tcmpo in sttetto occubo con solo
un suo ajofrdlh, ed iri con istrane manicre bene-
fche si propose di cspiare airtuosamentc ed alkeroica il commesso suo falh,
Avec le sentiment d'une grande honte, je vousenvoie tardivement mon avis sut bt lulttmtde Parit d'Eugène Sue et, en même temps, les
vingt-quatre fascicules de I'auvte elle-même.
Je ne saurais dire si ce livre est entièrementun român, ou s'iL est un recueil d'événementsen partie vrais, en partie inventés, survenusà Paris à un i-llustre personnâge allemand (egrand-duc Rodolphe de Gerolstein), lequel,après une erreur de jeunesse, est resté éloi-gné de la maison de son père, demeurant à
Paris pendant quelque temps, dans un endroitcaché, avec seulement un ptécepteur Êdèle, etlà, d'une étrange façon bénéfique, il se pro-posa d'expier vertueus€ment et hétoiquementla faute commise.
38 Jem-Baptiste AMADIEU
La décision proposée par Laureani aux membres de la Congrégation est I'aban-don des poursuites:7e crois qu'ilfaat Ia laisser mourir dblh-même.La menrion le-
Il romanzo, se lo aogliamo chiamare cosi, è sempre
uirtuoso e morab, anzi eminentemente tale, nèui si rinaiene cià che accade negli ahri, quel nonso che, per cui si guastano gli animi dei lzttori,anche quando uogliano ispirare sensi di moralc.Credo chc il suo autore abbia sceho questo tito-la misterioso, eiae i misteri di Parigi, perche inesso cgli disaek gli eccessi che accadono in quelkimmensità di gcnte di ogni condizione, e parlaapertamcntc dei difetti legali, e dzlh conezionabnon bene adattata d tanta uarietà d'immora-lità ed irreligione. A che si aggiunga il nominareco'propi cognomi presso chc tutti i soggetti che
entrano a fgurare nell' intcra azione. Se si uo-
glia notare quahhe cosa sarebbe il gridare che faI'autore contro il sisæma di tencre insieme chiusinclle case di conezione e nelb efettiae prigionitanti indiuidai, i quali chi diuiene cattiuo, chidiuiene peggiore e tutti perdzndo nell' uscir faorih pubblicafama, sono costrctti a commettere altridzlitti pcr sussistere, e quindi perdeni per sempre.E quelb cbe è più, il uoler sostituire alla com-marc pena di morte il racchiulzre in perpetuoil reo in und tctîa scgreta: pend che, come eglicrede, sarebbe di migliore efexo pcr ritcnere gliuomini dai dzlitti, porgenh al pensiero umanouna sensazione più orribile dzlh morte, e poidando agio al medcsimo incarcerato di ritorndrcal buon senso e salaarsi col ritornare a Dio pen-tcndosi sinceramentc. Ma questo non cottitaiscel'opera, cssendo deno per incidznza, e I'opera spira*tta sanez,za di religione e di buoni cosrumi: percui aedzrei di doacrlafar moire da se stessa; che
certo moirà presto, come scritto che non contieneaerun lenocinio nè alla mente, nè al cuore
ACDF, Index, Protæolli 1842-1845, î. 559rv.Traâ.fean-Baptiste Amadieu
Læ roman, si nous voulons l'appeler ainsi, esttoujours veftueux et mord et même remar-quablement tel, et I'on n y decouvre pas ce quiarrive dans les autres, ce je ne sais quoi qui cor-rompt les âmes des lecteurs, même quand onveut inspirer un sens moral. Je crois que I'au-teur a choisi ce titre mystéri eux, Les Mystères dtParis, parce qu'en lui il dévoile les excès de ce
grand nombre de gens de toutes conditions, eril parle ouvertement des défauts dans les lois, etde la correction qui n'est pas très bien adaptée à
une telle variété d'immoralirés et d'irréligions.À ceci s'ajoute le fait d'appeler par leurs nomsde famille propres à peu près tous les acreursqui Êgurent dans I'acrion. Si on veut noterquelque chose, ce serait le cri de l'auteur contrele système qui consiste à garder ensemble,enfermés dans des maisons de correction etdans des prisons, tant d'individus; parmi eux,les uns deviennent méchants, les autres encoreplus méchants; et tous ayanr perdu, à leur sor-tie, leur réputation, ils sont obligés de com-mettre d'autres délits pour subsister er ainsi se
perdre à jamais. Mieux, il veut subsriruer, à lacommune peine de mort, I'inrernement à viedu coupable dans une cellule secrète: peinequi, comme il le croit, serait plus efficace pourprévenir des délits, laissant imaginer une sen-sation plus horrible, et puis donnant la possi-bilité au prisonnier de retourner au bon sens
et de se sauver en retournant à Dieu par sonsincère repentir.,. Mais ceci ne constitue pasl'æuvre, cette idée nétait qu'incidemmentexprimée, et l'æuvre respire une religion trèssaine et de bonnes mcurs: aussi, je crois qu'ilfaut la laisser mourir d'elle-même; car il esr cer-tain qu'elle mourra vite, comme un écrit quin'attire ni I'esprit ni le cæur.
LES MYSTÈRES DE PIXISTMNSGRESSENT.ILS IA MORALE? 39
tine correspondant à cet avis est u dikta u; elle est inscrite de manière manuscritesur I'exemplaire du aotam conservé dans les Protocollia, ainsi que sur la convoca-tion envoyée aux cardinauxs. Cette sorte d'acquittement est approuvée par les
consulteurs le 16 décemb re 1844, et adoptée par les cardinaux le 13 janvier 1845.Les Mystères de Paris ne figurent donc pas sur le décret de cette date. laffaire est
classée sans suite par I'Index. Pourtant le Congrégation reprend I'affaite à l'hiver1851-1852, pour aboutir non seulement à une condamnation des Mlstèrcs dtParis, mais des æuvres complètes de Sue.
VOTUM DE DE FERMRI INTITULÉ * CENSURA DI TUTTE LE OPERE DIEUGENIO SUE, * EXTRAIT CONCERNANT T.E'S MYSTÈRES DE PANS(SESSTON DU 22JANVIER 1852)
Le uotum sur les æuvres complètes de Sue est dù au dominicain GiacintoDe Ferrari (1804-1874)6. Maître en théologie, académicien, bibliothécaire et
théologue.de la Bibliothèque Casanatense, visiteur général de la province domi-nicaine de Sardaigne, entiquaire, numismâte, éditeur scientifique de deux traitésde Thomas d'Aquin, De Ferrari est I'auteur de nombreux ouvrages sevants et dis-cours dont une Philosophia tomistica qua aeteris ac nouae schohe docnina ana[tticaexpenditar en trois volumes. Avant de composer son aotam sur Sue, il a déjà rédigé
plus d'une vingtaine de rapports pour la Congrégation, dont il est consulteurdepuis le 22 novembre 1843 (il est nommé le même jour que laureani).
Le 3 novembre 1851, Giacinto De Ferrari termine son untum intitulé Censura
di tatte le opere di Eagenio Jza. Il est imprimé av^ntla congrégation préparatoite du1 3 janvier 1852 (septième annive rsaire du décret qui n'a pas condamné Izr Mlstèrxde Parit), et compte vingt-deux pages. Sur les dix-huit euvres examinées, lacensure la plus longue (uste avant I* Iof etanl) est celle des Mlstères de Pais, qr;is'étend sur plus de deux pages:
4. Ibid., f.559r.
5. Ibid., f.531.
6. Voir P. Bouuy, Sowcrair et poltlife, op. ciL, p.6E6-687 ; et HInqrisition md Inùxkongrgttion, 0p. ci/., t.l, p. 396-415.
H. Schwedt, T.Lagxz, Pn@ogfa?bic wn diaiscber
40 Jean-Baptiste AMADIEU
Il genio di Stle non poteaa inwnire più abboutosa
nahi4 ,rè più acîonda alla sua inclina4ione, clte ri-whani alb notturne bettolt, alh kubrose combricole,
alb pigioni, ai pntribuli, in brete, a ogri hqo infame.
Ogni genere di dclitto sommini$ra alla meladrammati-
ca sea pema di ebc inturtenerc il orioso, e di nrtrista-re l"tomo aJtennalo. I nisni di Parigi sono dunqu rxtestûo descrifrtao dti dditti connessi nelle knebre, clte
egli ra disaehndo con allusioil personali delle percone
compromuæ di Paigi, o di abitatori di qaella eapitah
della Francia, nx t*îe h più laide, e odiose eircostanqe,
adottanda ancbe Ie fruti pk*ali
Le génie de Sue ne pouvair pas trouver matièreplus abondante ni plus adaptée à son incli-nation, qu'en se retournant vers les gargotesnocturnes, les bandes obscures, les prisons,les bordels, en bre[, vers quelque lieu inftme.Chaque genre de délit conêre au mélodramesa veine dont le propre est de renir en haleinele curieux et d'attrister le sage. Les Mlstères /zParis sont donc un tissu de délits commis dansI'ombre. [,a description evence en revélant desallusions privées à des personnalités compro-mises de Paris ou à ceux qui habirenr la capiralede la France, avec toutes les circonstances lesplus laides et les odieuses, adoptant même des
Nel primo tomo infatti introducesi a suiluppareun intrigo notturno fra Rodolfo, Chorineur, e laprottituita giouinetta Goualcuse, e a nandr cid-scheduno k propria aita, c i propri ai$. Percià ladonna dicc, di esere stata già in prigione, qaindiuscitanc per applicarsi all'infame seraizio di unaotcurd ltcandd i ni padroni le dissero. Youlezvous venir loger chez nous ? nous vous donne-rons de belles robes, et vous n'aurez qu'à vousamuser. T I p. 45. E qù appunto la sconsigliatadimoraua quando aenne rd?ita da Rodolfo. T 1.
p. I 18 e segg. dando cosi luogo a nuoui, e t?mprepiù nefandi cpisodj, ossia des intrigues de fem-me. T 2. o. 81.
Dans le premier volume, on commencepar développer une intrigue nocrurne enrreRodolphe, le Chourineur et la Goualeuse,une jeune prostituée, et chacun de raconter sa
propre vie et ses propres vices. La dame dit ainsiqu'elle est déjà allée en prison, qu'elle en est en-suite sortie pour s'appliquer à l'infâme besognedans une sombre auberge dont les patrons luidirent: Voaltz-uous aenir loger chez nous? nousuous donnerons de belles robes et uous n'aurez qa'àuout amusen Et l'imprudente y demeura jusqu'àce qu'elle fut enlevée par Rodolphe, donnantainsi lieu à de nouveaux épisodes, toujours plusinâmes, c'est-à-dire des intrigues de femme.
LES MYSTÈRES DE ?IRISTRANSGRESSENT-ILS LA MOMLE? 4t
In cotali ancdnti osceni è più noubile quantosi narra di rurpe, di criminale sul conto di cet-
to Abbate Cesare Polidoi prctc cattolico. T 2.
p. 140. impie fourbe hypocrite, contempteursacrilège de ce qu'il y a de plus sacré, ctc. Ben-
chè non sia improbabile simil fatto, pilre te ne
forma un Mcntore, nelk cai bocca poncsi ogniperacrso consiglio. Le prêtre répondit a son élèveqdil n'y avait en effet rien de plus fastidieuxque l'étude are T 2. p. 141 ... Que les voluptés,même excessives, loin de démordiser un princeheureusement doué, le rendâient souvent au
conraire clément, et généreux, par cette rai-son que les belles âmes ne sont jamâis mieuxprédisposées à la bienveillance, et à I'afectuo-sité que par le bonheur. T 2. P. 143. et depuisdisait I'Abbé, que de grands hommes des tems
anciens, et modernes avaient largement sacrifié
à l'épicuréisme le plus rafiné. (Loc. cit.) Nè gio-ua che più innanzi ci dica csserc cortili uû Men-tore detescabilg impcrciocchè tatti i russcguenti
uolumi sono imbranati dzl più immondo epicu-
reismo. S'introducono donzelle a cantare: Fautbien que jeunesse se passe!... à jolie Âlle beau
gerçon:... vive l'amour, er allez donc. T.4,p.45. 49. &guono i dialoghi: vous me ditesdonc d'espérer ? - D'espérer quoi ? - Que vous
nriaimerez ? - Je vous aime déjà erc. (Loc, cit.),
Parmi ces anecdotes obscènes, on remar-quera suftout qu'on raconte des sdetés et des
crimes sur le compte d'un cenain abbé César
Polidori, prêtre catholique impie, fourbe, lrypo-
crite, contemptear sacrihgt dz ce qu'il I a ù plussacré, etc, Quoique pareil fait ne soit pas im-probable, on en fait quand même un mentor,dans la bouche duquel on met toute sorte deconseils pervers: Lc ptêttt repondit à son llèacqu'il n'y audit en efct ien dc plus fastidicux qucl\tafu, etc. t..,1 Que bs aoluptés, même e*ccs-
iacs, loin dz dlmoraliser an pincc hearcuscmcnt
daué, lt rendaient souaatt au contraire climcnt,et gcnheux, pdr cctte /diton quc hs belhs âmes
ne sont jamais micat prédisposëet à h bicnucil-lance, ct à l'aftcnosité qu par le bonbeat [.. .Jet dcpuis disait lbbbé, quc dt gmnds hommes
des temps ancicns et modancs auaient latgementnctlfe à l'épicarcisme h plw raffné. Il ne senà rien qu'on dise plus loin que celui-ci est undltestable mentor, ds fait que tous les volumessuivants sont entachés du plus immondeépicurisme. On y introduit des jeunes âlles
chantant: Faut bien qac jeune*e sc p*sc!... àjolie flle bcau garçon:... aiac lhmout et alhzdonc. Saiuent les dialogues: uous mc ditct doncdbspérer ? - Dkpher quoi | - Qtc uoas mhime-rez? - Je ùouJ dimc déjà, erc,
42 Jean-Baptiste AMADIEU
Particokrmentc it tomo V. è riboccantc di osce-
nissime stoiellz. Fatto precedzre il suicidio d.el
Marchese d'Haraillz, ne tpiega la causa perglintrighi drlla noglie, lamentandosi foftemen-te, che il diuorzio non sia permesso: Parla cosi
D'Haruillz: que dois-je faire pour elle mainte-nant? - La délivrer des liens odieux que monegoisme lui a imposé ma mort seule peut bri-ser ces liens... il faut donc que ie me tue... etvoilà pourquoi M. D'Harville avait accomplice grand, ce douloureux sacrifice. Si le divorceeut existé, ce malheureux se serait-il suicidé?Non. arr. T 5. p. 52. Poi sifa hrgo a dtscriuerclz prigioni, e le pigioniere di Saint-Lazare, ouc
erano rinchirce più di 200. donne voleuses, etprostituees. T 5. p. 5j. 243. Nanando k storiadi ciaschcduna: dépravées non pas seulementde leur jeunesse, mais dès leur plus tendre en-fance, mais dès leur naissance. T 5. p. 73. Daqai sgorga un torrentc impurittimo di ogni gene-re di disonestà dzscrhte coi più seducenti colori,principiando dalllnceste de faire coucher leursenfants, frères et sæurs rte p. 105. Segucndo ananale come poi facesero commerce de amitié,t)engono a indicare comc nel luogo infamc si trouiscritto: Adressez vous au portiel T 5. p. 161.oae i mariti consegnaaano h noglie, e i padri bfglic ctc. etc.
læ tome v en pafticulier regorge d'historiettestrès obscènes. Juste avant le suicide du mar-quis d'Harville, on en explique la cause par les
aventures de sa femme, se lamentant fortementque le divorce ne soit pas permis. D'Harvilleparle ainsi: que dois-jc faire pour ellz mainte-nailt?-La deliurer des liens odieux que monégoiime lui a imposés. Ma mort seule pcut briserces liens... i I faut donc que j e me tue. . . - Et aoilàpourqaoi M. d'Haruille auait ltccompli cc grdnd,ce doutnureux sacrifce. Si lz diuorce aût existé, ce
malhcarcux se scruit-il suicide ? Noz, etc. On se
fait ensuite prodigue en descriptions des pri-sons et des prisonnières de Saint-Lazare, oùétaient détenues plus de deux cents femmesuoleuses et prostitules. On raconte I'histoire dechacune: depraaées non pdt seulcment dzs leurplus tendre enfance, mais dès lzur naissance.
De là jaillit un torrent très impur de chaquesone d'indecences, qui sont décrites avec les
couleurs les plus séduisantes, en commençanrpat l'inceste defaire coucher leurs cnfants,frèrcs ettcurs, etc. En arrivant à raconter comment onpourrait faire commerce dVmitié, on en vienr àindiquer qu'en un lieu infâ.me on trouve écrir:Adresscz uout au porticî, oir les maris livraientleur femme, les pères leurs filles, etc.
Per lt quali brutture c laidezze duea figione anperiodico del Belgio di csckmare con santo sde-
gnot Al^ France qui les enfante, à la Franceces cyniques et impies productions: qu'elle s'enrepaisse et s'en sature! nous n'avons rien à yvoir. (Bibl. Cathol. An. 2. p. 287. Paris 1842.)I redattori della citata Bibliografa cattolica giu-stifcdno cotale rimprouero: Oh! que nous avonsbien mérité ceme méprisante apostrophe! Per-chè in cotali Mystères de Paris I'intention irré-ligieuse est maniGsre; on la surprend partoutdans ce roman: on dirait un système. (Loc. cit.).
ACDF, Index, Protocolli 1852-1853, f. 10v-1Iv.Tiad. Jem-Baptiste Amadieu
Du fait de ces sa-letés et de ces laideurs, ilavait raison ce périodique belge de s'exclameravec une sainte indignation: À la France quiIts enfante, à k France ces cyniques et impiesproductions: qu'eltz s'cn repaisse et s'en sature!nous n'aaons rien à y uoir. Les rédacteurs de laBibliographie catholique, qui cite ce reproche,le justifient: Oh! que nous auont bien méitécette méprisante apottrophe! Parcc que dans ces
Mystères de Paris, I'intention inéligieuse est ma-nifestc; on la sarprend partout datu ce roman: ondirait un systèmc.
LES MYSTÈRES DE PIXISTMNSGRESSENT.ILS I.\ MORALE? 43
Comme cette censure est suivie d'autres exemens d'ceuvres, il faut se reporterà la fin dr aotum commun pour connaitre I'avis proposé à la Congrég^tioni < non
ai è alcun dubbio cbe tutte le opere di Sue meritino l'assolata condanna, onde impe-
dire almeno il magior mah' ,. La congrégation préparatoire du 13 janvier suit cet
aviss, et le 22 janvier les cardinaux décident de condamner sous clausule générale
l'æuvre de Sue. Le décret mentionne : n Opera omnia qaocamque idiomdtc exa-
rata>, La seconde lecture aboutit à une conséquence radicalement opposée à la
première. IJinterprétation de l'æuvre par un consulteur détermine la suite de la
procédure; la Congrégation vote à I'unanimité dans le sens du consulteur, qu'ils'agisse du premier ou du second procès.
LE PROBLÈME HERMÉNEUTIQUE DE LATMNSGRËSSION
Les aléas que connut la procédure contre Eugène Sue à Rome offrent I'avan-
tage de laisser à la postérité deux examens d'une même æuvre aux issues dift-rentes, donc deux interprétations divergentes. la part d'arbitraire de I'exercice
censorial, pourtant dans une communauté aux valeurs partagées, peut conduire à
des jugements en tout opposés.
Mais en bien des points, le aotum de De Ferrari désavoue tellement la pre-
mière analyse de Laureani qu il semble lui répondre. Presque chaque phrase dupremier censeur trouve une réfutation dans le texte de 1851. laureani affirme-t-il que I'ouvrage n appartient pas à la classe des romens impies et immoraux,qu il o è sempre uirtuoso e morale, anzi cminentemente tah ,, et que " lbpera spira
tutta sanezu di religione e di buoni costumi > ? De Ferrari réplique qu il est à la
fois impie et immoral: I'immoralité paraît clairement dâns la suite d'anecdotes,
qualifiées d'obscènes et d'inâmes. Lobscénité n'est pas en reste' on en trouvepresque tout l'éventail, du très classique adultère à la corruption des enfants dès
le berceau, en passant par la prostitution féminine et masculine, l'allusion à la
sodomie, I'inceste; les qualiÊcations abondent, non dépourvues de superlatifs:anedoti osceni, oscenissime storielle, più immondo epicureismo, tonente impurissimo
di ogni genere di disonestà. En outre, les anecdotes rapportées mêlent I'obscénité à
d'autres forfaits, en particulier le sacrilège de mettre des propos indécents dans la
bouche d'un prêtre, et le suicide (interprété comme un o sacrifice n) du marquisd'Harville, qui aboutit à une apologie du divorce ... Voilà pourla sanezza di buoni
7, Ibid., f,18r. Trad. : < il n'y a aucun doute qu€ toutes les æuvres de Sue médteraient la condamnation absolue,
afin d'empêcher au moins le plus grand mal >,
E. Ibid,, f.7 .
44 Jm-BaptisteAMADIEU
costumi dont parle Laureani. I-a sanezza di religione? De Ferrari ne la réfute pas
directement, il cite la Bibliographie catholique qui affirmait: n I'intention irréli-gieuse est manifeste o. Que ce jugement public soit de 1842, soitplus de deux ans
avant la relation de Laureani, accentue la cécité de ce dernier, et lui ôre I'excusede I'ignorance. Sur la qualification générale du roman, De Ferrari s'oppose à sonprédécesseur en voyant dans Les Mystères de Paris une æuvre impie et immorale.
D'autres lieux d'opposition apparaissent, plus anecdotiques. Tout d'abord surle châtiment et la correction. Ce qui rend l'æuvre morale selon Laureani, c'est laplace qu'elle accorde à I'expiation. Rodolphe répare son erreur passée: < con istra-ne maniere benefche si propose di espiare uirtuosdmente ed alk eroica il commesso
suofallo r. Plus généralement, les défauts représentés dans le roman sont corri-gés, même si la correction n'est pas toujours bien adéquate. De Ferrari reconnaîtque le vice est parfois présenté comme tel, mais cela est bien peu de choses auregard de I'abondance des délits : " Nè gioua, che più innanzi ci dica essere costui
['abbé Polidori] un Mentore detestabile o. La proposition négative qui ouvre laphrase crée cet effet de polyphonie et de réfutation propre aux tournures adversa-tives. Qui De Ferrari réfute-t-il ? Un objecteur fictif, comme I'usage rhétorique enconstruit habituellement. On peut aussi lire cette négation comme une contesra-tion du propos de Laureani.
Laureani ne nie pas la présence du mal dans l'æuvre. Outre I'idée de châti-ment, il lui trouve une seconde nuance: les défauts de l'ceuvre sont incidents.Laureani riapprouve pas les illusions humanitaires de Sue, soucieux de supprimerla peine de mort et relevant les effets pervers de l'internement. C'est la seuleremarque qu'il formule contre l'æuvre. Il ajoute: < questo non costituisce lbpera,essendo detto per incidenza r. Les travers de l'æuvre ne Sont pas constitutifs maisincidents. De Ferrari ne partage pas cette appréciation qui conclut la censurede 1844, et, pour clore la sienne, il énonce un avis inverse, une fois de plus demanière indirecte, en citanr la Bibliographie catholique. Le périodique écrit ausujet de I'intention irréligieuse: n on la surprend parrour dans ce roman : on diraitun système ,. De I'avis du second censeut les égarements de Sue ne sont pas mar-ginaux mais fondamentaux.
IJunique bévue des Mystères de Parh, selon Laureani, concerne l'épisode des
prisons; De Ferrari multiplie au contraire les péripéties répréhensibles. Il traiteaussi des prisons, mais leurs lectures de cet épisode divergent. l,aureani n'en re-tient qu'une réflexion généreuse et chimérique sur le système carcéral et la peinecapitale. De Ferrari y voit en revanche I'occasion de prodiguer au lecreur toutesorte de iécits infâmes, puisqu'il n y pas moins de deux cents détenues voleuses
LES MYSTÈRES DE PIRISTRANSGRESSENT.ILS I"T MOMLEI 45
et prostituées, et qu'on raconte I'histoire de chacune: o Nananda la storia di cia-scheduna r, d'oir le jaillissant <<torrente impurissimo di ogni genere di disonestà>.
Son prédécesseur dans la censure de Sue en est resté aux idées générales, sans envenir aux faits concrets racontés.
La réfutation ne serait pas complète si De Ferrari n avait pas raison de la der-nière affirmation de Laureani, selon laquelle la lecture du roman ne serait pas
dangereuse. À la diffet ttce des autres productions romanesques' on ne trouve pas
dans Les Mystères de Paris K quel non so che, per cui si guntano gli animi dei httor r.De Ferrari désavoue ce constat: les aventures coupables du roman sont suscep-
tibles d'< intertenere il [uomoJ carioso u. Cette difftrence d'évaluation découle de
jugements discordants sur I'esthétique de l'æuvre. Laureani ne prévoit qu'un suc-
cès de mode au romen, lequel disparaîtra vite de la mémoire littéraire, puisque
c'est un écirt " che nan contiene ueran lenocinio nè alla mente, nè al cuore ,.lx h-nocinio renvoie aux hnocini dtlk retorica, aux artifices de style, à la pompe, mais
il signiGe aussi le maquerellage. Ce mélange d'attrait esthétique et de racolage
trouve des équivalents français dars séduction ou appâts, tout aussi équivoques.
Selon Laureani, Les Mystères dt Paris n'ont pas cet aftifice propre à ravir I'adhésion
du lecteut à convaincre son esprit ou persuader son cæur, en un mot à le séduire.
IJappréciation du second censeur infirme cet avis: les aventures et surtout les
indécences de I'ceuvre sont o descritte coi più seducenti colori ,. Revêtir une ceuvre
immorale et impie d'un style séduisant, c'est la rendre dangereuse. Si le jugement
esthétique préalable diverge, la conclusion diftre aussi. Non seulement le.iuge-ment esthétique diverge (l'æuvre est-elle séduisante?), mais le jugement éthiqueaussi (l'æuvre est-elle impie et immorale?). Les deux uota s'opposent point par
point. La comparaison est troublante. Les plus méticuleux pourraient même rele-
ver des tournures de détail qui semblent se répondre. Lorsque Laureani introduitainsi sa remarque sur la prison, seul reproche evencé contre l'æuvre, il ouvre son
propos par: n Se si uoglia notare qaalche cosa>r. Un autre épisode paraît surtouto notable u à De Ferrari, les infamies mises sur le compte du prêtre catholique,qu'il introduit par le tour " è più notabile qudnto >, etc.
Est-il exagéré de voir dans le second aotan une réponse au premier ? Certains
indices textuels vont dans ce sens. De plus, De Ferrari est présent à la congréga-
tion préparatoire des consulteurs de décembre 1844.lI possède donc le texte im-primé de Laureani, et a participé aux débats sur I'ceuvre. Il a voté certes' commeses confrères, pour qu'on ne poursuive pas l'æuvre'. Mais il riavait probablement
9. ACDF, Index, Protocolli 1842-7E45, f . 531 : < Unaniniter in nto Conultois [dilatal >.
46 lean-BaptisteAMADtEU
pas lu l'æuvre et s'était fié au rapport de laureani; en ourre, il avait obrenului-même un vote unanime en faveur de la proscription de I'essai de FrancescoBozzrlli De lhnion de k philosophie auec Ia morale, dont on lui avait confié lerapport. En janvier 1852, il est le seul consulteur à avoir assisté à la congrégationde décembre 1844.Il fut même le seul membre de la Congrégation à participeraux deux sessions, puisque les cardinaux de janvier 1852 ne sont plus ceux dejanvier 1845, et les responsables de la Congrégation ont eux aussi changé: la pré-fecture est passée du cardinal Mai au cardinal Altieri, et le R. P Modena remplacele R. P. Degola en qualité de secrétaire'.. De Ferrari est donc le seul à connaîrrele contenu de la première procédure, et le seul à même d'apprécier sa n réponse n.
Que ce second texte soit une réponse ou non à la première censure, il permetd'apprécier la part d'arbitraire inhérente à une recension d'æuvre. À co*pa.erles deux examens; on pourrait se demander si leurs auteurs ont lu le même livre.Mais ce n'est pas le livre qui est autre. On sait que pour un texte unique, les lec-tures sont variées, qu il n'y a pas une interprétation adéquate qui ferait autorité,et que chaque lecture crée sa propre représentation de l'æuvre. Ces affirmationsassez récentes, apparues dans un contexte de critique du sens commun, et sen-tant le souffre du relativisme, on est bien étonné de voir avec quelle justesse ellesdécrivent le travail d'un censeur, avec quelle pertinence elles s'appliquent à des
lecteurs qui partagent pourtant de mêmes valeurs, et non pas des valeurs < mini-mâles o, mais un corps de doctrine précis, élaboré et institutionnalisé.
Devx aota, deux constructions de l'æuvre examinée. Laureani donne de Sue
I'image d'un philanthrope vertueux, certes peu au fait des réalités humaines, no-tamment dans la punition des fautes, mais qui, somme toute, écrit une æuvreconforme à la morale naturelle, sans grand talent, ni dangers pour la société.La figure qui ressort de I'autre examen est tout autre: Sue est un cynique, il se
complaît dans I'horreur, se laisse entraîner dans les surenchères infrmes er cor-rompt son lecteur en flattant sa curiosité malsaine. Le premier fait de I'aureurun étourdi; De Ferrari le juge malfaisant. Le censeur de 1844 propose I'acquit-tement; celui de 1852 la proscription. Les deux congrégations préparatoires deconsulteurs approuvent chaque fois à I'unanimité ces avis contradicroires.
10. Voir: RIIG, 1814-1917, II, 1, p.247 (session du 13 ianvier 1845) ct 304 (session du 22 janvier 1852).
LES MYSTÈRES DE ?IRISTRANSGRESSENT-ILS Iâ MORALE? 47
La qualification de transgression reste tributaire d'une interprétation, nonexclusivement liée à I'opinion que I'on se forge sur une norme et ses déviances.
Les deux censures contradictoires, au sein d'une communauté interprétative par-
tageant les mêmes conceptions morales, révèlent une divergence d'interprétationindépendante de la norme morale, mais relative à la littérarité de l'æuvre examinée.
Sur les faits narrés, les deux censures reconnaissent leur caractère transgressif: les
comportements de nombreux personnages s'écartent des règles morales. Llæuvre
en elle-même est-elle pourtant transgressive ? Le décalage entre les deux censures
ne tient pes aux âits énoncés, mais à leur énonciation. Lénonciation recouvre
autant la narration que le sryle.
En ce qui concerne l'énonciation narretive, le censeur cherche à identifier laou les voix dominantes, les plus audibles pour les lecteurs, celles qui donnent le
sens général de l'æuvre. La question de la voix dominante affecte la parole dunarrateur et celles des personnages:
- comment le narrateur conduit-il les faits narrés, comment les donne-t-ilà lire ? Autrement dit, maîtrise-t-il la narration, et selon quelle orientation mo-rale ? Pour le premier censeur, les voix sont hiérarchisées: le narrateur mène une
entreprise de dévoilement des excès et des lois défaillantes câr non suffisamment
chrétiennes. Il suppose donc une posture active et surplombante du narrateur, de
narure morale voire moralisante. Chez le second censeur, la hiérarchisation des
voix est moindre, presque inexistante. La posture plutôt passive du narrateur est
marquée par I'insuffisance du jugement moral, sinon la complaisance à l'égard des
vices décrits. Le diftrend sur la position du narrateur dérive d'un défaut d'outil-lage critique adéquat;
- du côté des personnages, une âutre divergence distingue les deux censures.
Le premier censeur passe presque sous silence les personnages; le choix s'explique
par la place prépondérante accordée au narreteur. Le second, au contraire, cite des
situations, des paroles et même des chansons de personnages. Mais la questiondes personnages ne se réduit pas au seul rapport avec le nârrateur. Elle est abordée
selon I'autorité des personnages. La première censure évoque le protagoniste duromân, le grand-duc de Gerolstein, à la posture héroïque et morale (n il se proposâ
d'expier vertueusement et hérorquement la faute commise n). En qualité de héros,
sa voix domine les autres et fait à ce titre autorité sur le lecteur. En revanche, le
second censeur aborde l'autorité des personnages selon la perspective de I'anti-héroisme, en particulier par la figure du mauvais ecclésiastique, l'abbé Polidori.
La parole du narrateur, en Ie campant en ( mauvais mentor >, lui parait insuffi-sante à neutraliser I'autorité qu'un ecclésiastique est susceptible d'exercer sur un
48 Jem-BaptisteAMADIEU
lecteur catholique. La seconde censure sélectionne les actes et paroles de person-nages les plus transgressifs à l'égard de la norme morale. Pourquoi ce choix ? Sans
doute en vertu de la tradition censoriale, selon laquelle un examen relève les seuls
énoncés incompatibles avec I'enseignement ecclésial". Mais c'est lire un récit po-lyphonique à la manière d'un traité spéculatif assumé par un aureur.
(Jne autre appréciation subjective porte sur l'énonciation comme sryle. Pourle premier censeur, le style de Sue est faible ; l'æuvre n'est pas destinée à une pres-tigieuse postérité mais o n'attire ni I'esprit ni le cceur o. Le second censeur ne par-tage pas ce point de vue. Le roman est séduisant et séducteur, racoleur, malgré lagrossièreté du langage. Le propre de sa veine u est de tenir en haleine le curieux ,.Leffet du style sur le lecteur est le principal enjeu des censures relatives aux texreslittéraires. Le livre examiné est-il susceptible de séduire le lecteur? Si oui, il renddélectable le récit des immoralités et mérite la mise à l'Index; sinon, l'Indexabandonne les poursuites (tel fut le cas de Chatterton de Vigny, non condamnéen raison des défauts littéraires). Même dans une institution remarquable par sa
cohérence et sa rigueur en matière morale, I'interprétation se heurte donc auxcaractéristiques littéraires, propres à déstabiliser la logique censoriale.
I l. À ce sujet, voir Bruno Neveu, LEneur et sonjlge, RtmarQrcs srr hs censrru tloclrinalet à l'époqw moderne,Napoh,Bibliopolis, coll. < Serie Studi > (n' XII), 1993.
l)'oi d"r- L l ,".er n d,oi, d" 1., li',.n.ur I .
rclâtions compldcs dc la littérature etd! droit ontpoùrpie.rede roùche h qùesrion dc lâ trânsgrcsion. Or celle0i mt toùtoù.s eu regar{i de lâ loi. lpp.éciéc de mrniè.econu',!llc L6 t-m-tr.. di\.,r, dunc d\n.-ùon "lrr1.c, dïne époque à l'aùt,e. ei pârloisi à t'e{r.êmei,1.'. ."',"'1.,1'r-,!,' 1""- * J, rlr,a,r. r, "o'g'.nde L vâriàhiliré des lig $ de târLâg$ q e les ùornFss.ciàles. n,ordles.légâl* r€nd€nr con.,ùneô. Cr$t à l nrterprétâtiondeceshnit4,etàcælimitesentantqù cllcsrelèvent dùne inrerp.érâtion qùe s iùié.€$e cc colhctilq". 13.-nbl" d.. , h.' h-'r-"1 - icn,".'unIc.:iùrietes- pl,ilosonhcs. spûialisl€s dc lift.!ture l.,t(âiseoù.oqlâræ qùesrionnerr ainsi,de l^ntiqùiré à l'dLrèneiô êùpo' âd. J.\4 +s u'oJrli,- J-
'.1: i {,.du d'or -
d€ lâ litténùre avisâgées à partir de c€ qùi tr amgrese hstrontièr6 dù social et du poliiiqùe. du p.iréer du pùbl,c.dê l-éthiqùe indiiduelle et.ollecfive.
û,' i.ùnê BJnr. t,'ni"sêu' J- ,i rr,'u'-. v' 't,: -- d
li,nn.rinÉ d. PôniPrr
LsA'rùRs,
hù,.8âplisle AIUAUEUCltrntine B^F0N
h.n.tnùçon I W[^lOliviei(;UlinRIlB
Tlomc H0CHM-{NNrjerÈ\'vs Qlll\rlCIR
rridérique LuctIT[nDominiqne LHUILLIIR.trI.{R I lNltll l
Ch li.e PLI;\'INEICrit \'ïrt.0H,\T0
CsbriEb !ICI([RII,{N.RIBITIO]\"7PblippeZÀRD
0n.orverltrie:P Bùoi.{}n:u.c.t1\o.2012.
ffiïgiiiLïiiïiiiiÊ r r,iffi ,t,.
lllLllllj.lll-e0lltûflS.ll I 11,1'r'
ISBN 97&2.7535 275+6
,illll]lltill[[[|[ilPri{ | 16€



















![Karlo barun Prandau, glasbenik [Carl baron Prandau, a musician]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631782057451843eec0ab331/karlo-barun-prandau-glasbenik-carl-baron-prandau-a-musician.jpg)