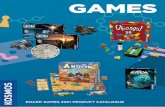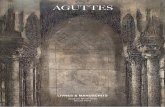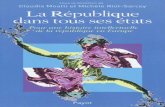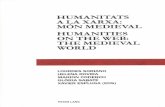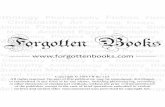« Du cosmos à la Chrétienté. Images d’évêques dans quelques manuscrits hispaniques des...
-
Upload
ephe-sorbonne -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of « Du cosmos à la Chrétienté. Images d’évêques dans quelques manuscrits hispaniques des...
La imagen del obispohispano en la Edad Media
Martín Aurell,Angeles García de la Borbolla
(editores)
€UNSAEDICIONES UNIVERSIDAD DE NAVARRA, S.A.
PAMPLONA
-sn '1- \...
¡1{1J ,el
{. \ \ r-.
Consejo Editorial de la Colección HISTÓRICA
Director: Prof. Dr. Santiago Aurell Cardona
Vocales: Prof. Dra. Cristina Diz-Lois MartínezProf. Dr. Mercedes Vázquez de PradaProf. Dra. M: del Mar Larraza Micheltorena
Secretaria: Prof. Dra. Julia Pavón Benito
r'I/'L ,ILI,¡~.:¿. ,. ( , Iba ¿' I! I ;,
Primera edición: Julio 2004
© 2004. Martín Aurell, Ángeles García de la Borbolla (eds.)Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA)
Plaza de los Sauces, l y 2. 31010 Barañáin (Navarra) - EspañaTeléfono: +3494825 68 50 - Fax: +34948256854
e-rnail: [email protected]
ISBN: 84-313-2201-2Depósito legal: NA 1.896-2004
Ilustración cubierta: Synodus 110Vell1episcoporum in lacca.Anónimo de mediados del siglo XII
Imprime: GRÁFICASALZATE,S.L. PoI. Ipertegui IJ. Orcoyen (Navarra)
Printed in Spain - Impreso en España
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunica-ción pública y transformación, total o parcial, de esta obra sin contar con autorización escrita de los titulares delCopyright, La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelec-tual (Artículo, 270 y ss. del Código Penal).
Índice general
Prólogo .Ángeles Garcia de la Borbolla
9
Obispos y santos. La construcción de la Historia cós-mica en la Hispania visigodaSantiago Castellanos . 15
La santidad episcopal y el culto cívico. Algunas notastrasmitidas por los relatos hagiográficos del siglo XIIIÁngeles Garcia de la Borbolla . 37
La liturgie épiscopale au Moyen Áge et sa significationthéologique et politiqueEric Palazzo 61
Du cosmos a la Chrétienté: images dévéques dansquelques manuscrits hispaniques des xe-XIIIe sieclesPatrick Henriet . 75
8 Índice general
La figura del obispo cronista como ideólogo de la Rea-leza en León y Castilla: la construcción de un nuevomodelo de didáctica política en la primera mitaddel siglo XIIIManuel Alejandro Rodríguez de la Peña .
¿Una nueva metrópoli en Oviedo? dos falsas bulasdel obispo Pelayo (1098/1101-1130)Th0/11aS Deswa rte .
«Tolosae moritur, Pampilonae sepelitur» Pierre d' An-douque, un évéque malmenéMyriatn Soria .
Juan Serrano, un évéque assassinéSophie Coussemacker .
ConclusionsMartín Aurell .
Bibliografía .
Índice de nombres .
115
153
167
185
251
265
281
Prólogo
Bajo el epígrafe «La imagen del obispo en la Edad Media»se recogen una serie de trabajos científicos fruto de una ardualabor de investigación que arrojan nuevas luces sobre estas fi-guras eclesiásticas que vivieron y murieron en un marco histó-rico y un ámbito social determinado, la Península Ibérica y lossiglos medievales.
El vocablo griego épiskopos puede traducirse como aquelhombre o dios que ejerce las funciones de guardián, de protec-tor o de patrón. Este mismo término se emplea en el Cristianis-mo aunque el episcopado cristiano presenta siempre referen-cias con los textos del Nuevo Testamento donde quedabadefinido tanto sus funciones corno el ideal espiritual. Así losepiskopoi son los guardianes del rebaño, el pueblo de Dios.Esta función, confiada por el Espíritu Santo, se presenta comouna gracia particular, lo que san Pablo llama carismas, conce-dida por Dios a un cristiano para que cumpla mejor una fun-ción especial en su Iglesia.
En estos textos sagrados se encuentra el modelo fundamen-tal y Pablo en la carta a Timoteo señala las cualidades exigidaspara ejercer esta función episcopal '. De manera que aquel que
1 1Timoteo 3, 3: «Por eso es preciso que el obispo sea irreprensible, ma-rido de una sóla mujer, sobrio, prudente, digno en su porte, hospitala-rio, idoneo para enseñar, ni bebedor ni violento, sino templado, enemi-go de litigios, sin avaricia, que gobierne bien su propia casa».
Du cosmos a la Chrétienté:images d' évéques dans quelques manuscrits
hispaniques des X"-XIIle síecles
Patrick HenrietUniversité de Paris Iv-Sorbonne
La péninsule ibérique possede une tradition spécifique etnourrie de représentation des évéques. Celle-ci démarre véri-tablement au X" siecle avec les grands codices de la Rioja, Al-beldensis et /Smilianensís, qui représentent en particulier lesconciles de l' église hispanique, antique et wisigothique l. Untravail sur l'image de l'évéque dan s les manuscrits hispani-ques a partir du X" siecle mérite donc une recherche en soi, quipourrait avantageusement faire l'objet d'une these. Mon pro-pos, on s'en doute, sera beaucoup plus modeste. A partir detrois miniatures élaborées aux X", Xll" et Xlll" siecles, j' aime-rais suggérer que la perception du róle de l' évéque a notable-ment changé au fil du temps. Les trois images choisies ren-voient a des milieux différents: monastique dans le premiercas, épiscopal dan s le second, archiépiscopal -et conscient del'etre- dans le dernier. Aucune ne se contente d'illustrer lestextes qui les accompagnent, leurs liens avec ceux-ci étant par-fois tres ténus. Ces enluminures doivent donc étre étudiéesdans une perspective d' «exégese visuelle», pour reprendre uneexpression qui a fait son chemin depuis quelques années: end'autres termes, la construction d'un discours propre structuré
I Silva y Verástegui (1984, 375-419). cr. aussi Reynolds (1987, 1, 207-249).
76 Patrick Henriet
par l'image 2. Mon exposé portera done sur des discours (visuels)plus que sur des faits. Dans les trois cas retenus, nous avons af-faire a des figures circulaires qui prétendent, d'une facon ou d'u-ne autre, signifier une totalité. Il s'agira par conséquent de com-prendre comment l' évéque, ou les évéques, ont été présentés enrelation avec un ensemble plus vaste, ce qui nous amenera a nousinterroger sur les rapports complexes entre le prélat et son espa-ce symbolique de domination.
La «roue des évéques» daos le Codex IEmilianensis
Notre point de départ est une image tirée du Codex /Smilia-nensis, l'un des plus célebres manuscrits du X" siecle hispani-que 3. Avant de la décrire et d'en proposer une analyse, je doispréciser que bien des éléments du développement qui va sui-vre n'auraient pas été possibles sans un remarquable artic1ed'Otto-Karl Werckmeister, le premier chercheur a avoir attirél'attention, des 1968, sur cette enluminure aussi exception-nelle que riche de sens 4. Exécuté au rnonastere de San Millánde la Cogolla (Rioja), terminé en 993 ou 994, le codex /Smi-lianensis copie en regle générale, tant du point de vue du texteque de celui des illustrations, le codex Albeldensis, composéquant a lui en 976 au monastere de Saint-Martin d' Albelda 5.
L'enluminure qui nous intéresse se trouve au folio 392 v 6. Elle
2 Esmeijer (1978). Utilisations récentes de ce concept: Sicard (1993);Saurma Jeltsch (1997, 668-672), (avec indications bibliographiques p.669, n. 144); Goullet (1999,100-101).
3 La description la plus minutieuse est celle d' Antolín (1907, 72, 184-195, 366-378, 542-551, 628-641); (1908b, 76, 310-323, 457-470);(1909, 77 48-56 et 131-136), puis, du meme (1910, 320-368). Díaz yDíaz (1979, 155-162). Pour les aspects artistiques, Silva y Verástegui(1984,46-52 et 68-72).
4 Werckmeister (1968, 399-423).5 Antolín (1910, 368-404). Díaz y Díaz (1979, 64-70).6 Cf. iIlustration l.
Du cosmos 11 la Chrétienté: images d'évéques 77
illustre une liste des dioceses de J'époque wisigothique, répar-tis en six provinces ecc1ésiastiques. Celles ci s' organisent, degauche a droite et de haut en bas, comme suit (entre parenthe-ses la métropole): Galice (Braga), Lusitanie (Mérida), Bétique(Séville), Carthaginoise (Tolede), Tarraconaise (Tarragone) etGaule (Narbonne). L'image occupe le centre du folio. Elle re-présente douze personnages situés frontalement, la téte endemi-profil. Tous tiennent un báton. I1s se situent dans unemandorle et leurs pieds reposent sur un rond central. On notea l'arriere-plan l'image d'un disque, ou d'une roue, composéede plusieurs cerc1es.
Cette image exceptionnelle est un hapax dans l' iconographiehispanique et plus généralement chrétienne médiévale. Alorsque le codex IEmilianensis, oü figure notre image, copie l'AI-beldensis, ce demier présente d'ailleurs la liste des diocesessans aucune illustration. La liste n' est d' autre part pas exacte-ment la rnéme dans les deux cas, ce qui acheve d'établir l'indé-pendance de l' IEmilianensis pour ce folio. Il reste évidemmentpossible que celui-ci soit la copie d'un modele aujourd'hui dis-paru. De ce point de vue, cependant, un examen soigneux durapport entre texte et image permet d'acquérir quelques certitu-des. Reprenons les observations d'Otto Werckmeister, qui mon-trent c1airement conunent c'est le texte qui s'adapte a l'image,et non l'inverse. Pour commencer, les deux premieres colonnessupérieures, ainsi que la cinquiéme, prennent place cornme ellespeuvent autour de la rota, parfaitement située au centre du folio.Notons en particulier la facon dont se termine la deuxieme co-lonne, celle de la province de Mérida. Le nom du diocese d' E-xonoba ( = Ossonoba, Faro) est réparti de part et d' autre du longcierge qui sépare deux des c1ercs de la moitié supérieure de laroue. Quant au demier diocese de la colonne, Olisibona (Lis-bonne), le copiste a manqué de place pour l'inscrire et a dü, enconséquence, rajouter le 'a' sous la ligne, tout contre le disque.De tels tátonnements sont peu vraisemblables dans l'hypothesed'une copie. 11faut par conséquent admettre que J'image de la
78 Patrick Henriet
roue des évéques a été créée pour le codex /Emilianensis, ou entout cas qu'elle s'y est trouvée associée pour la prerniere fois ala liste des dioceses.
n nous reste a savoir ce que I'enlumineur a véritablementvoulu représenter, et done ce qu'il a voulu dire. n est évidem-ment tentant d'interpréter, sans plus, les douze personnagescomme douze évéques. Nous aurions alors une image symbo-lique du corps épiscopal hispanique, le chiffre douze rappelantl' apostolicité des prélats. Cette interprétation est dans une cer-taine mesure renforcée par l'existence, dans l' Antiquité tardi-ve au moins, de représentations du college des douze apótrespar le biais d'une composition circulaire. Werckmeister a ain-si pu signaler I'existence d'un vase d'or, aujourd'hui conservéau musée du Vatican, qui offre une image de ce type 7. Mais ilest impossible de savoir si I'enlumineur de San MilIán avait asa disposition une représentation de cet ordre. D'autres élé-ments peuvent par ailleurs amener a nuancer cette interpréta-tion. Aucun des douze personnages, en effet, ne porte I'especede mitre, caractéristique de la fonction épiscopale, qui apparaitdans les nombreuses représentations d'évéques des manuscritsAlbeldensis et /Smilianensís 8. Les bátons portés par les douzefigures posent églement problerne. Six d'entre eux, recourbésa leur extrémité, semblent indéniablement épiscopaux. Peut-étre s'agit-il ici de désigner díscretement les six métropolitainsde Tarragone, Narbonne, Braga, Mérida, SévilIe et Tolede?Cette hypothese serait renforcée par la présence de quatre deces personnages a crosse au sommet de la composition, ce quipourrait correspondre aux quatre listes de la partie supérieuredu folio. Les deux autres crosses épiscopales se trouvent dansle quart inférieur gauche de l' enluminure. Elles pourraient
7 Werekmeister (1968, 403), avee reproduetion (156a).8 Cf. les nombreuses enluminures reproduites dan s Silva y Verástegui
(1984), lam. XVII, XVIII, XX, 131 sq. ete ... Sur I'origine de eette «tia-re» pontifieale, ef. Broniseh (1999).
Du cosmos a la Chrétienté: images d'évéques 79
alors désigner les métropolitains de Tarragone et de Narbonne,mais on ne peut cependant s'empécher de remarquer que leurspossesseurs regardent uniquement vers Tarragone. Si l' on suitcette interprétation, il reste maintenant a identifier les six au-tres figures. Les bátons de trois d'entre elles se terminent entau, ceux des trois autres par une boule. Or si ces insignes nesont pas nécessairement épiscopaux, ils peuvent aussi étre por-tés par des évéques, Prenons a titre de comparaison les enlu-minures de l' Albeldensis et de l' /Emilianensis illustrant I' Or-do de celebrando concilio, soit le déroulement des conciles telque l'avait fixé le canon 4 du quatrieme concile de Tolede(633). Le groupe des évéques (episcopi) est composé de cinqprélats. Les trois premiers sont mitrés et ont une crosse. Lesdeux suivants n'ont pas de mitre et portent respectivement unbáton en tau et un báton terminé par un petit globe 9. On peutpenser qu'il s'agit d'évéques (episcopi, dit l'inscription), maisaussi de prétres et de diacres. Une autre solution consisterait aidentifier les trois personnages dotés d'une mitre comme desmétropolitains, suivis de simples évéques. Mais il n'est paspossible d'exc1ure totalement la possibilité que l'enlumineur,qui travaillait a San MilIán de la Cogolla, ait aussi voulu repré-senter des moines. En tout état de cause, et a la différence descrosses, les bátons surmontés du tau ou du globe ne sont pasl'apanage des évéques, voire méme des c1ercs. Dans cettemérne miniature de l' ordo de celebrando concilio, l' ostiarius,c1erc chargé de contróler les portes de l' église pendant la tenuedu concile, tient un báton surmonté d'un globe. Quant au roi,il porte ce mérne insigne dans le codex Albeldensis, mais leglobe est devenu un tau dans I'/Emilianensis ... Ainsi, seul lebáton recourbé semble immanquablement désigner l' évéque.Les choix iconographiques du créateur de la «roue des évé-
9 Silva y Verástegui (1984, 398-401), lam. XVII et XVIII. Sur ee texte,qui, dans sa version longue, n' est transmis que par l'Albeldensis et l' IE-milianensis, ef. Munier (1963, 250-271).
80 Patrick Henriet
ques» apparaissent done subtils. L'illustrateur savait qu'enplacant la roue au cceur d'une liste de dioceses, le lecteur se-rait amené a interpréter les douze personnages comme douzeévéques, image symbolique du corps apostolique. Les évéquesn' étaient-ils pas les successeurs des apótres, comme l' avaitrappelé par exemple le seizieme concile de Tolede? 10. Mais enméme temps, la volonté de ne pas coiffer les personnages de lamitre épiscopale et la diversification des «bátons de souverai-neté» permettait d' offrir une image assez vague, voire indiffé-renciée, du corps ecc1ésial. C'est en fait l'Église wisigothiquedans son ensemble, voire 1'Église universelle, qui était repré-sentée. Cette lecture symbolique est d' ailleurs confirmée parl' arriere-plan conciliaire de la «roue des évéques», ainsi quel' a remarquablement montré Werckmeister 11.
Les douze personnages animant la roue sont inscrits dansune mandorle. Or dans onze cas sur douze, on constate la pré-sence sur celle-ci et autour des figures humaines de cinq globesdorés, situés a la hauteur des reins, des épaules, et aussi au-des-sus de la téte. Dans le douzieme cas, en haut a droite, le prélatest doté de sept boules et non de cinq. Au total, celles-ci sontdonc au nombre de 62. Ce chiffre ne correspond pas a la listeaccompagnant 1'image, puisque celle-ci donne 68 dioceses. Enrevanche, 62 correspond au nombre d'évéques présents auxconciles de Tolede 3 et 4, soit les assemblées qui entérinerent laconversion de Reccared au catholicisme (Tolede 3) puis fixe-rent les regles de fonctionnement de l' église wisigothique(ToIMe 4) 12. Ce chiffre constitue par ailleurs l'affluence recordde tous les conciles wisigothiques. La comcidence est sansdoute trop belle pour en étre une. Il faut cependant noter qu'u-ne tradition mozarabe véhiculait de son cóté une liste de dioce-ses qui, a la différence de celle que copie l' /Emilianensis, of-
10 Vives (1963, 513).II Werckmeister (1968, 413-414 et 416).12 Orlandis-Ramos Lissón (1986, 197-226 et 261-298).
Du cosmos a la Chrétienté: images d'évéques 81
frait bien 62 noms 13. On peut done se demander si notre enlu-mmeur fait subtilement aIlusion aux conciles fondateurs de l'É-glise hispanique, ou s'il dépend simplement de cette traditionaltemative. Dans la mesure oü la liste retranscrite par l' IEmilia-nensis comporte bel et bien 68 dioceses, la prerniere solutionsemble s' imposer. La roue des évéques iIlustre done, de faconaussi discrete que subtile, \'activité conciliaire wisigothique.L'indifférenciation assez poussée des douze prélats, caractéri-sés par la seule forme de leur báton, pourrait indiquer que cel-le-ci n'était pas le seul fait des évéques.
Présentation du corps épiscopal comme corps apostolique,indifférenciation des c1ercs représentant 1'Église hispanique,conciliarisme wisigothique: voila qui suffirait a faire de cetteimage une réalisation particulierement riche de sens. Mais il ya sans doute plus. L'enluminure de l' IEmilianensis possedeaussi, a nen pas douter, une dimension que 1'0n peut qualifierde «cosmique». Reprenons en effet la figure dan s laquelles'inscrivent les douze figures, soit celle du cerc1e. Dans la tra-dition hispanique, et plus précisément isidorienne, un schémal'annonce et la rappelle immanquablement: c'est celui de larose des vents. Toute une tradition antique, issue des manuelsscolaires vulgarisant Aristote et Platon, avait en effet représen-
13 Ou plus exactement prétendait mentionner 62 noms. Cette liste estprésente dans le ms 4879 de la Bibliotheque nationale de Madrid (msarabe DXCUI), qui donne des canons conciliaires. Le texte accompag-nant la liste parle de 62 sieges, mais celle-ci en donne en réalité 70. Se-Ion Werckmeister (1968, 402), note 18, le chiffre de 62 est atteint sanscompter les dix sieges de la Narbonnaise et six siéges de la Bétique,mais si mon propre décompte n'est pas faux, on arrive ainsi a 64. Onretombe en revanche a 62 en ne comptant ni la Narbonnaise ni un cer-tain nombre de lignes qui semblent avoir été laissées en blanc dans lescolonnes de la Bétique, de la Lusitanie, de la Galice et de la Tarraconai-se. Ce codex écrit en arabe date de 1049. Description dans Catálogo delos manuscritos árabes existentes en la Biblioteca Nacional de Madrid,1889,242-244. Édition de la liste (avec traduction au castillan) dans Si-monet (1983, 809-812) et commentaire (726-729).
82 Patrick Henriet
té l'espace, le temps, et plus généralement le cosmos, sous laforme de diverses raues, qui furent reprises par Isidore dan sson grand Traité de la Nature: roue des mois, roue de l' annéeet roue du monde, roue des cercles du monde, roue des plane-tes, enfin roue -nous disons rase- des vents 14. Ces illustra-tions, que l'on retrouve en partie dans les Étymologies, avaientvalu au De natura rerum l' appellation de Liber rotarum, cecides l'époque d'Isidore 15. Or parmi ces différentes figures cir-culaires, une seule combinait le disque et la présence de douzefigures humaines réparties sur son pourtour: la rose des vents.Conformément a l'enseignement isidorien, ces derniers étaienten effet au nombre de douze: quatre vents «cardinaux» -leSeptentrion, le Subsolanus, l' Auster et le Zéphyr-, flanquéschacun de trois vents secondaires. Or les manuscrits Albelden-sis et JEmilianensis donnent tous deux des extraits des Étymo-logies accompagnés d'une rase des vents 16. Celle-ci porte enson centre une image symbolique de la terre, séparée en arida(terre ferme) et maria (mer). Les douze figures allégoriquessoufflent, selon leur importance, dans une ou deux trampettes.Elles sont non seulement parfaitement humanisées, mais aussihabillées d' une facon qui rappelle les prélats peuplant lesnombreuses images conciliaires de ces deux manuscrits. C' estdone, de toute évidence, dans cette tradition qu' il faut situernotre «rose des évéques». Reste une différence de taille: lesrases des vents des manuscrits Albeldensis et JEmilianensissont, en effet, clairement hiérarchisées. Les quatre vents prin-cipaux sont situés dans une position axiale. Ils ont deux trorn-pettes, au lieu d'une pour les vents secondaires, et ils sont repré-
14 Fontaine (1960, 15-18) et (2000b, 297-310).15 Cf. l'incipit du poerne astronomique de Sisebut, concu comme une
postface au De natura rerum d'Isidore: Incipit epistula Sisebuti regisgothorum missa ad lsidorum de libro rotarum, Fontaine (1960, 328).
16 Albeldense: fol. 14v; IEmilianense: fol. 11v. Cf. infra, i11.2 et 3. Des-cription dan s Silva y Verástegui (1984, 452-457).
Du cosmos a la Chrétienté: images d'éveques 83
sentés de face et non de prafil. Or cette dimension a été totale-ment gommée dans la «rase des évéques». Les figures sont icidessinées, sans exception, en demi profil, et surtout elles sontdécalées par rapport aux axes. On trouve done trois personna-ges dans chacune des quatre sections composant le disque, sansqu'Il soit possible d'accorder une prééminence que1conque al'un plutót qu'a l'autre. Tous posent les pieds sur un rond cen-tral qui évoque la terre, voire le cosmos de la roses des vents.En privilégiant l'égalité, le génial enlumineur de I'JEmilianen-sis faisait vraisemblablement référence au college des apótres,Il reprenait le schéma bien connu de la rose des vents, présentquelques folios plus haut, mais il l'aménageait sur un modeaussi discret qu' original. Il n' est cependant pas excIu qu' il sesoit aussi inspiré d'autres rotae que celle des manuscrits com-posés dans la Rioja du X" siecle. En effet, les codices isidoriensdu haut Moyen Áge, hispaniques, caralingiens ou insu1aires,présentent parfois un schéma qui, a certains égards, est plusproche du notre. De nombreuses rases des vents présentent ain-si une vision non hiérarchisée du texte isidorien, avec découpa-ge du cercle en douze sections égales a l' exclusion de touteperspective axiale 17. C'est par exemple le cas d'un manuscrithispanique du De natura rerum qui remonte au VIIe siecle 18.
On retrouve fréquemment la méme logique dans la roue desdouze mois 19. Il n'est cependant pas possible de dire si l'enlu-mineur de l' JEenúlianensis avait sous les yeux un manuscrit dece type, ou plutót une représentation du college apostoliquecomme celle que Werckmeister a trauvée au Vaticano
En définitive la richesse, mais aussi la comp1exité de cetteimage, ne laissent pas de surprendre. Il serait diffici1e, pour ne
17 Cf. infra, ill. 4.18 Bibliotheque de l'Escorial, ms R.II.18. Fontaine (1960,20-22). Cf. in-fra, ill. 4.
19 Cf. infra, ill. 5.
84 Patrick Henriet
pas dire impossible, de trouver un discours aussi subtil dansles textes composés au X" siecle en péninsule ibérique. Voilácertainement un signe de l'importance des enluminures dansla gestation des idéologies chrétiennes du nord de la péninsu-le, au cours du haut Moyen Áge. Les différents sens de la«roue des évéques» s'ernboitent et se completent harmonieu-sement. A partir d'une liste de dioceses purement descriptive,l' artiste a mis en valeur l' indifférenciation idéale du c1ergéchrétien, symbolisé par ses évéques, en mérne temps que l'ac-tivité conciliaire comme fondement identitaire de l'Église wi-sigothique. Mais il a aussí enchássé ce discours dans une pers-pective cosmique, rernplacant les douze vents soufflant auxquatre coins de la terre par douze clercs occupant la totalité deI'unívers, et assurant par la le passage de l'espace wisigothi-que a celui du mundus 20. Cette dimension a la fois cosmique etchrétienne se retrouve a peu pres a la mérne époque dans uneenlumínure du Beatus dit de Gérone. Ce manuscrit, qui est enréalité originaire du royaume de Leon (Tabara?), fut achevé en975, soit une petite génération avant l' /Emilianensis 21. Parrapport aux autres Beatus, il se caractérise par I'importancedes représentations christologiques. Or aux folios 3v-4, il of-fre une image circulaire du ciel qui n' est pas sans rappeler no-tre Rota episcoporum. Jésus siege au centre. Il est entouré dedivers cerc1es concentriques, peuplés d'anges et d'esprits. Lecaractere cosmique de la composition est bien marqué: ainsi lafigure du Christ est-elle flanquée de la lune et du soleil, alorsque le cercle le plus rapproché est rempli d' étoiles (Stelle et lu-men). Cette composition, elle aussi unique, n'a certainementpas servi de modele direct au Codex /Enúlianensis, celui-ci sesituant, comme nous l'avons rappelé, dans une descendanceisidorienne. Il n'est cependant pas totalement exclu que le Bea-
20 Mundus est universitas omnis quae constat ex caelo et terra, Isidore,De natura rerum, IX, Fontaine (1960, 206).
21 Sur ee manuserit et l'enluminure du folio 3v-4, ef. WiJliams (1994, 52).
Du cosmos a la Chrétienté: images d'évéques 85
tus léonais ait été vu par l'enlumineur de San Millán. Il parti-cipe en tout cas d'un méme univers symbolique, puisant sansdoute ses sources dan s une lointaine Antiquité, au sein duquella perfection est circulaire et radiale 22.
Le probleme qui se pose pour terminer est bien de savoirjusqu'ou I'interprétation de cette enluminure peut et doit étrepoussée. En conc1usion de son étude, Otto Werclaneister pro-pose de voir dans la «roue des évéques» un message d'utopieet d' espérance dans le futuro Il établit a cet effet un paralleleentre le codex /Emilianensis et la Biblia Hispalense, une Biblecopiée et enluminée quelques décennies plus tót par un artistemozarabe de Cordoue 23. Ce dernier manuscrit contient des re-présentations des petits prophetes Michée, Nahum et Zacharie.Arguant du fait que, contrairement aux autres illustrations ducodex, ces trois figures s'éloignent des modeles stylistiques is-lamiques, Werckmeister a proposé de voir en elles une reven-dication de la tradition wisigothique en mérne temps qu'unecritique, voilée mais vigoureuse, de l' islam 24. Par sa négationde la réalité diocésaine des années 990 -soit l'époque oü al-Mansur ravageait réguliérement les régions septentrionales dela péninsule-, la «roue des évéques» se situerait dans la mémeperspective. Je ne suis pas persuadé que cette conclusion soitdéfinitive. En ce qui concerne l'esprit combatif de la BibliaHispalense, nous en sommes réduits a des conjectures fauted'une connaissance réelle des représentations figurées dansl'al-Andalus califa!. La seule ímage humaine connue, une tétesur un mur du palais de Madinat al-Zahra, est de surcroit assez
22 Sur l' origine antique du eiel du Beatus de Tabara, ef. Nordstrorn,(1977, 120-127). Mise au point bibliographique WiJliams (1994, 52)qui rejette la théorie d'un arehétype islamique défendue par ManuelaChurruea en 1939, puis ensuite par Mireille Mentré.
23 Millares Carlo (1931, 97-130). Cf. Aussi la notiee de Williams (1993,85, 162).
24 Werekmeister (1963, 141-188).
86 Patrick Henriet
proche des trois petits prophetes, ce qui infirme la propositionde Werckmeister " ... Quant a l'enluminure de l'/Emilianensis,elle constitue peut-étre plus une référence a un passé wisigo-thique idéalisé --ce dont témoignent d' ailleurs les autres enlu-minures du manuscrit et de son modele, l'Albeldense- qu'aun futur victorieux. Les années 990 n'étaient guere encoura-geantes, en termes de succes militaires, pour les chrétiens, etc'est incontestablement l'a-historicisme qui domine, pour desraisons assez compréhensibles, la «roue des évéques». Ainsi,le passé idéalisé d' une Église wisigothique investissant lemonde devrait-il étre interprété, non pas teIlement commel'affirmation d'une volonté belliciste et reconquérante, maisplutót comme un désir de refuge face aux vicissitudes d'unprésent peu glorieux.
Pelagius episcopus me fecit: une enlurninuredu Corpus pelagianum
La deuxierne image étudiée provient d'un manuscrit du dé-but du Xlll" siecle, ce qui ne signifie pas, comme nous aIlonsle voir, qu'elle soit une création ex nihilo. Le manuscrit enquestion, numéro 1513 de la bibliotheque nationale de Ma-drid, est parfois appelé «códice de Batres» 26. Avant de présen-ter l'enluminure qui nous retient ici, il importe de le dater aumoins approximativement et de fixer l' époque de compositionde son modele.
25 Williams (1993, 85, 162). n. 5. Pour une reproduction de la téte deMadinat al-Zahra: Torres Balbás (1957, 725).
26 Du nom de la villa, située entre Madrid et Tolede, dans laquelle il setrouvait au XVIe siecle, parmi les volumes que Garcilaso de la Vega (ane pas confondre avec le poete) avait recu de son grand-pere HemanPérez de Guzman. Sur ce manuscrit, décrit pour la prerniere fois et an-noté par Ambrosio de Morales (Madrid, BN, Ms 1346), cf. la biblio-graphie donnée par Galván Freile (1997, 479-497). Ajouter Cirot(1924, 14-31 et 108-ll4), qui donne la description la plus complete dece manuscrit et constitue aujourd'hui encore un guide fort utile.
Du cosmos a la Chrétienté: images d'évéques 87
Le manuscrit de Batres est l'un de ceux qui nous ont trans-mis la compilation historiographique du fameux évéque Péla-ge d'Oviedo (t 1153?), connue sous le nom de Corpus pela-gianum 27. 11est le plus richement iIlustré de toute la série,puisqu' il ne comporte pas moins de vingt-cinq miniatures.L'étude paléographique autant que celle des enluminures invi-te a le dater du XIIle siecle, peut-étre du premier tiers selonl'un de ses plus récents commentateurs 28. L'iconographie of-fre néanmoins un mélange significatif de détails archaísantsd'une part, novateurs et pleinement gothiques de l'autre. lei,des manteaux a fibule ou noués, des chapiteaux et des colon-nes de type roman, une organisation de l'espace assez tradi-tionnelle. La, des encadrements, des trónes, des sceptres fleur-delisés ou encore des figures, comme celle d' Abraham oud'une Vierge tendrement enlacée a l'enfant, qui sont difficile-ment envisageables avant 120029
• Cette hétérogénéité ne peutguere s'expliquer que si le manuscrit 1513, images comprises,est la copie d'un modele du XIIe siecle. On a vraisernblable-ment repris a ce dernier le texte et les illustrations, tout en me-ttant celles-ci, mais dans une certaine mesure seulement, augoüt du jour. Fernando Galván Freile a justement fait remar-quer combien leur facture était médiocre, alors qu' elles ornaientun manuscrit faisant l'objet d'un effort d'embellissement sansprécédent. On peut done raisonnablement conjecturer que lemodele du Xll" siecle comportait déja des rniniatures, sansdoute plus luxueuses, qui furent reproduites quelques décen-nies plus tard avec un soin ou une compétence moindres 30. Unautre élément confortant l'hypothese d'un modele directement
27 Sur le Corpus Pelagianum, cf. Pérez de Urbel (1952, 136-165); F. Fer-nández Conde (197150-69); Femández Vallina (1995,231-401).
28 Galván Freile (1997, 495).29 Ibid., avec reproduction des figures d' Abraham et de la Vierge.30 Ibid., pp. 496-497.
88 Patrick Henriet
«pélagien» est précisément la miniature gue nous allons main-tenant examiner 31 •
Dans le manuscrit 1513 de Madrid, le Corpus pelagianumest introduit par une série de pieces gui, san s étre véritable-ment historiographigues, donnent a la compilation de Pélageune profondeur a la fois spatiale et chronologigue. Nous avonsd'abord une Divisio hominum in terrae regionibus?', gui por-te en son centre une représentation symboligue de Jérusalem,puis une table des degrés de parenté tirée d'Isidore 33, et enfin
31 Cirot (1924,113) proposait deja un stemrna faisant la part belle a uncodex d'Oviedo, perdu mais recopié par Morales (BN de Madrid, ms1346). Il manque évidernrnent une étude récente sur cette question. Onpeut aussi érnettre l'hypothese d'un modele réalisé apres la mort de Pé-lage, comrne le fait Fernández Vallina, (1995, 335, n. 341), qui penseque le modele du ms 1513 serait une réalisation de la seconde moitié duXll" siecle. Rappelons tout de mérne que Pélage, selon le Libro de lasKalendas d'Oviedo, serait mort en 1153. Un autre élément a prendre encompte est J'incipit: Incipit liber chronicorum ab exordio mundi usqueera MCLXXX, qui pourrait désigner la date de cornposition du codex,soit J'année 1142 de l'ere chrétienne. Nous pensons quant a nous qu'iln'existe aucune raison dirimante pour ne pas prendre en compte lamention Pelagius episcopus me [ecit. Le caractere particulierernent lu-xueux du modele et les divers aménagements apportés a la présentationdu Corpus pelagianum pourraient désigner le ms 1513 cornme la der-niére édition de celui-ci, peut-étre réalisée a la fin de la vie de Pélage,soit a une époque oü il n'exercait plus ses fonctions épiscopales. Defait,1. Pérez de Urbe1 (1952,155-168) fait du manuscrit de Batres unreprésentant de la derniere des trais éditions du Corpus Pelagianumqu'il croit repérer. Rien n'empéche, i1est vrai, de penser, que le mode-le ait été achevé apres la mort de Pélage. En effet, le pralogue du ma-nuscrit, fol. 1r, invite a entretenir la mérnoire de celui-ci (Predictumepiscopum Pelagium die ac nocte in memoriam habeatisi. Cette men-tion pourrait indiquer que Pélage était mort au moment de la composi-tion du prologue (mais pas nécessairement du début de la compositionde J'archétype). Cette phrase peut cependant étre interprétée de diffé-rentes facons et ne rnérite sans doute pas qu'on lui accorde trop d'im-portance.
32 Fol. lv.33 Fo!. 2r, avec texte d'Isidore (Etym IX, 5-6) en 2 r-v.
Du cosmos a la Chrétienté: i1nages d'éveques 89
une rose des vents, elle aussi isidorienne 34. La partie propre-ment historiographique commence ensuite, au folio 4, par laChronique d'Isidore. La rose des vents du folio 3, sur laguellenous souhaiterions maintenant attirer l' attention, est l' enlumi-nure la plus soignée du manuscrit 35. Elle occupe toute la par-tie supérieure du feuillet, alors gue les autres images ne dépas-sent pas la largeur d'une colonne et sont toujours inférieuresen hauteur a la moitié de la page. Situés sur les axes est/ouestet nord/sud, les guatre vents principaux sont représentés pardes personnages revétus d'une tunigue et soufflant dans deuxcomes, a leur droite et a leur gauche. Les autres vents, gui onttous l'apparence de personnages bicéphales, s'intercalent en-tre ces guatre figures. L' ensemble de la composition est en-chássé dans une roue gui, sur les deux cercles externes, donnele nom des vents en rouge et en bleu. Ríen pour l'instant d'ex-ceptionnel. L'enlumineur a repris ce schéma gui, depuis lehaut Moyen Áge, accompagnait dans de nombreux manuscritsle De natura rerum ou les Étymologies d'Isidore de Séville.De méme pour le court texte isidorien gui accompagne cetterota. Nous avons déja vu comment les manuscrits Albeldensiset IEmilianensis offraient, a la fin du X" siecle, des représenta-tions tres semblables a celle-ci. La seule innovation véritable,et c'est elle gui nous intéresse ici, est une inscription placéedans lapartie centrale de la roue, zone a partir de laguelle ra-yonnent les différents vents: Pelagius episcopus me [ecit ":
34 Fol. 3r, avec texte (et autre rase des vents, plus petite) en 3r-3v (EtyrnXIII, 11,2-3)
3S Cf. infra, ill. 6.36 On retrauve la rose des vents accompagnée de la mention Pelagius me
[ecit dan s une autre copie du Corpus pelagianum, le manuscrit K. B.Sp. 11 de Stochkolm, fol. 68v. Description: Hogberg (1916, 459-463).Pérez de Urbel (1952, 176-177) note a la fois la ressernblance avec lecodex de Batres et quelques variantes. [] suggere que le manuscrit deStockolrn (K) serait la copie d'un archétype réalisé en 1143 (J'incipitportant era MCLXXXI). Dans J'état actuel des recherches, il sernble ce-
90 Patrick Henriet
Cette inscription se retrouve au verso du rnéme folio, dansune autre rose, plus petite et plus simple, qui ne comportepas de représentations figurées et semble inachevée 37. Dernérne qu'un court prologue, dédié a la consécration épisco-pale de Pélage et a la rénovation par ses soins des anciens au-tels de la cathédrale et des églises de la ville, ouvrait la sériedes pieces préliminaires 38, c'est done, derriere cette doublerose des vents et son commentaire isidorien, la figure de Pé-lage qui la clóture, L' ensemble du codex est ainsi dominé parla figure du prélat, a la fois auteur et commanditaire. Pelagiusepiscopus se situe sur un double plan. Il est d' abord l' évéqued'une ville et d'un diocese particuliers, Oviedo, ainsi que lerappelle le prologue. Celui-ci souligne en effet l'enracine-ment dans un lieu et un temps propre, puisqu'il inaugure lecodex par une date de consécration. Mais le cadre symboliqueébauché par les premiers folios situe parallelernent Pélagenon seulement au centre d'un diocese, mais aussi du cosmos.Au folio 2v, c'est Jérusalem qui apparaissait au cceur des te-rres habitées (Europe, Asie, Afrique). lei, le nom de Pélagesemble donner naissance aux vents qui, dans une figure circu-laire signifiant le macrocosme, soufflent de par l'univers.N'y-a-t-il pas la un programme symbolique valant pour l'en-semble de l'ceuvre de Pélage, et en particulier pour le Corpuspelagianum?
Cette compilation, dont il importe de souligner qu'elle nousest encore mal connue, qu'elle existe en plusieurs recensions,enfin qu' elle est inédite en tant que telle, constitue de fait,
pendant difficile d'exc!ure que Stockholm et Batres copient un rnérnearchétype. Le copiste de K prend d'ailleurs la peine de préciser qu'ilsupprime tel ou tel passage [Pérez de Urbel (1952, 177)] ce qui pourraitsignifier aussi d'autres remaniernents, l'ordre des pieces n'étant pasexactement le méme dans Batres et dans K.
37 Cf. infra, ill. 7.38 Cf. ES 38, p. 371.
Du cosmos a la Chrétienté: images d'éveques 91
comme toute l' ceuvre de Pélage, un véritable monument a lagloire de 1'église d'Oviedo. Celle-ci se voit attribuer un rólede premier plan dans une histoire volontiers concue commetotale, Pélage n'hésitant pas, par exemple, a intégrer dans sacompilation le Liber Historiae Francorum. On sait que leCorpus Pelagianum a été concu en étroite relation avec legrand cartulaire de l'église d'Oviedo, le fameux Liber Testa-mentorum ecclesiae Ovetensis, lui aussi rédigé sous le patro-nage de Pélage 39. Mais la visée du Corpus pelagianum estplus ample, en particulier paree qu'il reprend 1'ensemble deschroniques alors connues de son auteur. Dans cette vision del'histoire hispanique, les évéques ont une place de premierplan, juste derriere les souverains. Le manuscrit 1513 repré-sente 18 rois ou reines, contre 6 évéques, les moines et les lai-ques «ordinaires» brillant par leur absence 40. Pélage, qui ap-parait fréquemment dans le texte -il est présent dans leprologue général, dans la retranscription de sa propre chroni-que et dans bien d' autres passages encore-, est sans doute leseul évéque contemporain représenté par une enluminure 4\. Ilest de toute évidence, et au moins sur un plan symbolique, latéte épiscopale de l' Hispania, de mérne que son diocese enest le centre ecclésiastique.
39 Femández Conde (1971). Valdés Gallego (2000).40 Jéróme est représenté en prétre, avec des habits qui rappelent ceux des
évéques mais sans mitre (fol. 21 v). On trouve également deux clercsromains envoyés a Grégoire VII par Alphonse VI (fol. 67v), mais ilssont beaucoup plus petits que le roi, ce qui n' est pas le cas des diffé-rents évéques lorsque ceux-ci se trouvent sur la meme image qu'unsouverain (fol. 38v, 43v, 48v, 64 r). Les autres personnages sont bibli-ques (Adarn, Noé, Abraham, Moise et la Vierge). Notons pour terminerque le premier personnage représenté, lsidore de Séville, est un évéque.
41 Fol. 64r. Cf. infra, ill. 8. La légende Pelagio obispo de Oviedo est rno-derne, Elle est acceptée par Femández Vallina (1995,398). Pélage n'estévidemment pas contemporain du roi Bermude II (t 999), auquel il faitface, mais il est l'auteur de la chronique, qui, sur ce folio, décrit l'ave-nement de Bermude.
92 Patrick Henriet
En reprenant la classique rose des vents isidorienne, il s' a-gissait done de suggérer que le monde s'organisait autour dePélage, implicitement identifié a Oviedo. La rose des évéquesdu manuscrit /Smilíanensis nous proposait la vision a-histori.que d'un college épiscopal organisant 1'univers sur le modeleapostolique. De ce schéma remarquable, dont on aimerait d' ai-Ileurs savoir si Pélage l' a connu, nous sommes passés a uneautre roue, a la fois proche et tres différente. Le cadre est tou-jours celui du cosmos isidorien. Mais la référence apostoliquea disparu, la collégialité n' est plus de mise, et surtout l'universn'est plus soustrait a la trame du temps. L'inscription donne eneffet un nom, ce qui ramene le lecteur du codex 1513 au tempsréel. A 1'époque de Pélage, le présent était dominé par la re-construction de la carte ecclésiastique et par la lutte des diffé-rents dio ceses pour leur indépendance, voire, dan s le cas deCompostelle ou de Tolede, pour leur suprématie. En d'autrestermes, et a la différence de l'image du codex JEmilianensis, ils' agissait bien ici de défendre, sur un plan a la fois historio-graphique et symbolique, des intéréts particuliers dans un con-texte historique précis. Le cadre est done encore hispanique etcosmique, mais il n'est plus a-historique. On ne trouve en re-vanche aucune référence a la Chrétienté, entendue commel' ensemble des chrétiens, au moins latins, placés sous l' autori-té du pape. Pour trouver ce concept présent dans un contextehispanique, nous avons choisi d'examiner maintenant un rna-nuscrit tolédan du milieu du XIIle siecle.
Les Notule de primatu et le sermon de Jiménez de Rada auconcile de Latran IV (1215)
Le codex de la bibliotheque nationale de Madrid caté Vitr15-5 (olim Tolede, BC, 21-5) est connu sous le nom de Notulede primatu nobilitate et dominio ecclesiae toletanae. Il s'agitd'un manuscrit complexe, dont les quarante et un folios sontrichement illustrés. Divers travaux importants lui ont déja été
Du cosmos a la Chrétienté: ilnages d' éveques 93
consacrés, en particulier par Antonio García y García, Ray-monde Foreville, Peter Feige et Peter Linehan, mais on enattend encore a la fois une édition critique et une analyse ex-haustive 42. De nombreuses questions demeurent par consé-quent, qui touchent aussi bien les aspects codicologiques quela datation ou les sources. Nous nous contenterons ici, dans unpremier temps, de décrire brievement le contenu de ce manus-crit, tout en indiquant les principaux problemes qui se posent,avant d'étudier l'image «épiscopale», a vrai dire exception-nelle, qui a retenu notre attention.
Les Notule sont composées de deux parties principales. Lapremiere porte sur l' antiquité de l' église de Tolede et sur sonpassé conciliaire wisigothique, la seconde est une sorte de bul-laire recueillant des diplomes pontificaux relatifs a la primatie.Le manuscrit comporte également des listes des archevéquesde Tolede, des papes et des empereurs romains, depuis Augustejusqu'a Frédéric II, ainsi que diverses pieces relatives a la géo-graphie ecclésiastique péninsulaire 43. A une date inconnue, unereliure malencontreuse a bouleversé l' ordre des cahiers. C' estainsi au feuillet 33, soit bien avant la fin, que l' on peut lire uncolophon donnant la date de rédaction du manuscrit: 125344.
42 García y García (1987,187-208); Foreville (1966, ll, 1121-1130); Fei-ge (1978, 345-351); (l988b 675-714); Linehan (1993, 328-332, 359-368).
43 11n' existe a ma connaissance aucune description complete du manus-crit. Cf. cependant Hernández (1996, XVIII-XIX).
44 Scriptum est !iber iste Toleti civitate regia, regnante rege Aldefonsoibidem et in Castella et Legione, Galletie, Cordube, Murcye, Sibifie etlahenni, fratre suo infante Santio efecto regente ecclesiam toletanam.Anno ab Adami VI mil DLXXIXa populatione Tofeti 11Mil DCXLab era Cesaris MCCXCIab incarnatione MCCLlIIregni supradicti regis primoConsumatus 11ydus mai.Cf. Hernández (1996, XIX).
94 Patrick Henriet
Les Notule ont par ailleurs été «supplémentées» par deuxmains différentes, tant au bas des feuillets que dans les mar-ges. La liste des archevéques de Tolede a elle-mérne été pro-longéejusqu'aux années 1270, puisjusqu'en 132045.
Le manuscrit est done daté du 14 mai 1253, soit six ansapres la mort de I'archevéque Rodrigo Jiménez de Rada. Ain-si que l' a remarqué Peter Linehan, la question que pose ce co-lophon extrémement précis est sans doute de savoir a quandremonte la conception du codex. Nous avons en gros deuxpossibilités: ou bien il a été rapidement copié, peut-étre enmoins d'un an, comme le suggerent Raymonde Foreville etaussi, implicitement, Peter Feige 46. Ou bien sa compositions' est étalée sur une assez longue période de temps et pourraitrenvoyer, au moins pour la mise en chantier, al' épiscopat deJiménez de Rada. Celui-ci en deviendrait ainsi le véritablemaitre d'oeuvre. Peter Linehan a été le premier a défendre ce-tte these, non sans mettre en avant de bons arguments 47. Il aainsi pu suggérer, contre Peter Feige, que les Notule avaientcertainement constitué un réservoir de faits et d'argumentspour la fameuse chronique de Rodrigue, le De rebus Hispa-niae. Cette proposition se heurte néanmoins a un obstac1e detaille: la main responsable du colophon daté de 1253 sembleétre la mérne qui a éxécuté le corps principal et originel dumanuscrit. On ne peut pourtant exc1ure que des dossiers prépa-ratoires, voire un archétype des Notule, aient été mis au pointdes l' époque de Jiménez de Rada. Le manuscrit Madrid, Vitr15-5, serait alors une copie supplémentée. Hypothese qui vau-drait aussi pour les illustrations. Faute d'une analyse codicolo-
45 Ce qui permit a Fidel Fita de rejeter les informations de la Pars Conci-lii Laterani: Fita (1902, 35-45 (IV) et 178-195 (V); 3, 49-52 (VI) et 52-61 (VII), V, 179-180 (V) et 61 (VI).
46 ForevilIe (1966, n, 1128). Feige (1978, 694-695), et Linehan (1993,359).
47 tu«, 359-368.
Du cosmos a la Chrétienté: images d'éveques 95
gique et de contenu, il semble difficile de pousser le raisonne-ment plus loin 48.
Au folio 22, notre manuscrit présente un dessin =-plutótqu'une enluminure- représentant dix personnages 49. Sixd'entre eux sont identifiés par une légende: ce sont, de gauchea droite et de haut en bas: les patriarches de Constantinople etde Jérusalem, les archevéques de Compostelle, Tarragone,Braga et Narbonne. Deux figures, qui ne portent pas de signesdistinctifs et ne sont accompagnées d' aucune légende, sont as-sises en bas de la scene. Il s'agit vraisemblablement de laics.L'ensemble est dominé par un personnage qui, coiffé d'unbonnet, est assis sur un tróne plus important que les autres. En-fin, au centre de la composition, une figure épiscopale degrande taille se tient debout et semble prononcer un sermon. Ils'agit maintenant, pour identifier la scene, de mettre en rap-port texte et dessin.
L'image en question illustre la Pars Concilii Laterani, untexte de réputation incertaine qui rapporte l' intervention del'archevéque Rodrigo Jiménez de Rada au concile de LatranIV (1215)50. Si 1'on en croit ce récit, Rodrigue aurait alors pro-noncé un sermon devant le concile présidé par le pape Inno-cent IlI. Mettant a profit un extraordinaire don pour les lan-
48 Il est eependant raisonnable d'attribuer au texte ilIustré par I'imagedont il va étre question, la Pars Concilii Laterani, une date nette-ment antérieure a 1253: il en existe version plus eourte et assez dif-férente, a partir de Quoniam velut umbra, dans le ms Tolede, BC 42-21, sur un folio rajouté en téte du manuserit. Édition de eette versionpar Rivera (1951, 336-337). Cf. Aussi Feige (1978, 264), ainsi queHenriet (2001).
49 Cf. infra, il!. 9.50 Edition peu fiable de García de Loaysa (1595, 287-292), reprise dans
Mansi (1903, 1071-1075). Version espagnole dan s Gorosterratzu(1925,174-175). Derniere édition (avee des erreurs). García y García(1987,204-208). Pour un résumé des polémiques entrainées par ee tex-te: Gorosterratzu (1925,160-170), et Henriet (2001).
96 Patrick Henriet
gues, il aurait utilisé successivement le latin, l' italien, l' alle-mand, le francais, l' anglais, le basque, l' espagnol et enfin,pour conclure, de nouveau le latin 51. Lors du concile, 1'ar-chevéque de Tolede aurait obtenu une légation apostolique surtoute l'Espagne et le droit de «créer» des évéques dans tous lesdioceses ultérieurement regagnés sur les musulmans 52. MaisLatran IV aurait aussi été le théátre d'un affrontement entreRodrigue, qui revendiquait la primatie sur toute l'Espagne, etles archevéques de Braga et de Compostelle, ceux de Tarrago-ne et de Narbonne se faisant seulement représenter. Devant leconsistoire et le pape, le prélat tolédan aurait en effet lu diffé-rents privileges confirmant ses droit primatiaux. Désireux deremettre a sa place I'archevéque de Braga, il aurait ensuiterappelé l' action, un siecle plus tót, de son prédécesseur Mau-rice «Bourdin», antipape de l' empereur «Otton» (en fait HenriV) sous le nom de Grégoire VIII. Maurice avait finalement étéemprisonné par le pape «Alexandre 11» (en réalité Calixte 11),cornme en témoignait une fresque de la salle, située dans le pa-lais du Latran, ou se déroulait la controverse 53. Contre l' ar-chevéque de Compostelle, la discussion se serait située sur unautre terrain. Rappelant que saint Jacques avait été le premiera répandre en Espagne le «Verbe de Dieu», celui-ci en auraitlogiquement tiré la conclusion que Compostelle ne pouvaitobéir a Tolede. Mais Tolede, aurait alors rappelé Rada, avaitété fondée de son caté par Eugene, disciple de I'apótre Paul.
51 Laycis et il/iteratis in linguagiis maternis videlicet Romanorum, Teu-tonicorum, Francorum, Anglorum, Navarrorurn el Yspanorum, éd.García y García (1987,204) (j'ai rétabli «illi tantis» en «illiteratis»).
52 Optinuit etiam quod quam cito civitas Yspalensis redderetur cultuichristian o sine strepitu iudicii et de plano iure primatus subesset eccle-sie Toletane, ibid., García y García, (1987, 205).
53 Sur cette fresque, cf. Ladner (1935,269-280), et Walter (1970,162-166). Sur Maurice Bourdin, résumé et indications bibliographiquesdans la notice «Grégoire VIII» (G. Schwaiger), dans Levillain (dir.),(1994,750-751).
Du cosmos a la Chrétienté: images d'évéques 97
Elle avait ensuite été sanctifiée par la Vierge, dont chacun sa-vait qu'elle était apparue a saint Ildephonse pendant la messe.Quant a la prédication hispanique de saint Jacques, il s'agissaitla d'une fable, car l'apótre n'avait pas mis les pieds en pénin-sule de son vivant. Sur un mode sarcastique, Rada rapportaitrneme avoir entendu, dans son enfance, quelques saintes mo-niales raconter que l'apótre Jacques, débarquant en Espagne,n'avait pu convertir qu'une vieille femme avant de reprendrela route de 1'Orient, découragé par la dureté de cceur des his-paniques 54. Tolede avait done bien le droit d' exercer son auto-rité sur Compostelle.
Tentons maintenant d'identifier la scene représentée sur lemanuscrit Vitrina, 15/5, de Madrid. Antonio García y García etRaymonde Foreville l' ont décrite, pratiquement en mérnetemps, au début des années 6055. Or leurs interprétations sontdiamétralement opposées. Pour Raymonde Foreville, le per-sonnage central est Jiménez de Rada, celui qui tróne au som-met de la composition est Innocent 111, et le dessin représentele sermon polyglotte prononcé devant 1'assemblée par le pré-lat tolédan. Antonio García y García propose de son caté unelecture bien différente: la figure centrale est Innocent 111, celledu dessus représente l'empereur. La scene n'implique aucuneaffirmation de la primatie tolédane et Jiménez de Rada n' estméme pas représenté 56 ... Disons-le tout net, cette interpreta-tion nous semble inacceptable. Pour commencer, le personna-ge assis sur un tróne et dominant la composition ne peut étre
54 El sic, dijfisus quod nihil proficeret in predicando, mortus est in repa-triando, éd. García y García (1987, 207) (proficeret remplacant profi-cisceret).
55 García y García (1987, 203-204); Foreville (1960,1125-1127). le n'aipas pu consulter la these inédite de Ramírez Rigo (1985).
56 «Estas figuras carecen de valor iconográfico. Tampoco constituye estaescena ninguna afirmación del primado toledano, ya que falta en ella laimagen del arzobispo Jiménez de Rada», García y García (1987, 204).
98 Patrick: Henriet
l'empereur -Frédéric 11n'était mérne pas présent a LatranIV-. Il s'agit bien, il ne peut s'agir que, d'Innocent III. Exa-minons pour nous en convaincre les dessins des folios précé-dents, illustrant divers pri vileges pontificaux en faveur deTolede. Les évéques et archevéques hispaniques, qui ouvrentparfois les mains en signe de réception, sont toujours situésvis-a-vis d'un personnage dont la position montre bien le sta-tut de donateur 57. Celui-ci, qui porte un bonnet plat commedans la composition qui nous intéresse, est évidemment lepape. Si un doute subsistait malgré tout, il suffirait de se repor-ter, par exemple, au folio 2058. Le dessin, situé de part et d'au-tre du texte, iIlustre une lettre datée de 1234, par laqueIle Gré-goire IX demande aux évéques de Ségovie, de Salamanque etde León, de réunir l' information nécessaire au preces oppo-sant les archevéques de ComposteIle et de Tolede 59. Trois per-sonnages mitrés sont dotés d'une crosse. Il s'agit a l'évidencedu trio épiscopal mentionné. La figure assise a gauche et coif-fée d'un chapeau plat ne peut done étre que Grégoire IX. Cebonnet, qui a pu dérouter Antonio García y García, est sansdoute le «camauro», une coiffe d' origine orientale et sans dou-te monastique, attestée depuis le IXe siecle 60.
Le personnage situé au centre de la scene et dominant lacomposition n'est done pas Innocent III, mais bien Jiménez deRada. Il reste a savoir queIle scene a voulu représenter l' artis-te. Raymonde Foreville a suggéré qu'il ne pouvait s'agir de ladispute autour de la primatie tolédane, car les quatre prélatshispaniques concurrents de Tolede sont représentés, alors queles titulaires des sieges de Narbonne et de Tarragone n'assiste-rent pas aux débats. L' archevéque de Tarragone fut en effet re-
57 Cf. les illustrations des folios 14, l4v, 20, 21, 21 v, 24, 24v, 33, et in-fra, ill. 10-12.
58 Cf. infra, ill. 12.59 Gorosterratzu (1925, n° 107).60 Levillain (dir.), (1994, s. v. «Vétements», 1714).
Du cosmos a la Chrétienté: images d'évéques 99
présenté par l'évéque de Vich, et celui de Narbonne se justifiale lendemain de son absence. Notre image représenterait doncuniquement l'extraordinaire sermon prononcé par Jiménez deRada dans une demi-douzaine de langues. Cette interprétationse voit confortée par la présence sur le dessin d'un public deIaíques, dont il est bien précisé dans le texte qu' ils assisterentau sermon, ainsi que par celle des patriarches de Constantino-pIe et de Jérusalem, absents lors de la discussion sur la prima-tie tolédane 61. Doit-on pour autant dénier au dessin toute allu-sion a celle-ci? Nous ne le croyons paso En effet, les quatremétropolitains sur lesquels Jiménez de Rada entendait asseoirsa domination ne sont pas expressément nommés commeayant assisté au sermon. Logiquement, ils n' apparaissent dansle texte qu'au moment oü est abordée la question de la prima-tie, soit aprés le récit du sermon po1yglotte 62. Ils sont néan-moins présents, de part et d'autre de l'orateur, sur le dessin. Lesentiment prévaut done qu'il y a eu contamination d'un themepar l'autre et que cette iIlustration vaut non pas uniquementpour le sermon du prélat tolédan, mais aussi pour l' ensemblede la Pars Concilii Laterani. Comment ne pas remarquer, d'ai-Ileurs, que Jiménez de Rada est au moins deux fois plus grandque tous les autres évéques représentés, y compris le pape?
Il reste a savoir si cette iIlustration peut étre considéréecomme représentative de l'époque a laqueIle il est fait allu-sion, ou tout au moins de celle oü Jiménez de Rada, en parti-culier dans le De rebus Hispaniae, donnait a Tolede les instru-ments idéologiques lui permettant de justifier ses prétentions.
61 Le texte ne dit rien de leur absence, mais il aurait évidemment men-tionné leur présence s'ill'avait pu.
62 Ab eodem papa proposuit in pleno consistorio coram ipso et cardina-libus et pluribus archiepiscopis et episcopis et abbatibus et canonicis etaliis c1ericis querimoniam de Bracharensi et Compostellano el Tarra-conensi et Narbonensi archiepiscopis, quod nolebant ei tanquam pri-mati SUD obedire, García y García (1987, 205).
100 Patrick Henriet
Raymonde Foreville a suggéré que deux artistes étaient inter-venus. Le premier serait responsable des enluminures propre-ment dites, le second se contenterait de dessiner. A celui-la se-raient dues, a deux exceptions pres, les images de la premierepartie du manuscrit ainsi que di verses figures de papes et d' ar-chevéques. A celui-ci devraient étre attribués les dessins de laseconde partie, dont celui dont il est ici question. Le trait de cesecond artiste rappelerait par ailleurs celui du scribe auquelsont dues «les transcriptions complémentaires» -mais il y aen réalité deux mains «cornplémentaires» bien distinctes. Ce-tte hypothese amene en tout cas Raymonde Foreville a daterl' image de Latran IV, comme toutes celles du «dessinateur»,aux alentours de 127063. Il se pourrait cependant que le demiermot sur cette question n' ait pas été dit. En effet, la representa-tion du sermon de Rada montre que le copiste s' est adapté audes sin. La figure du pape est soigneusement entourée par desmots qui la respectent scrupuleusement, suivant un tracé quiest a la fois complexe et assuré. Les images sont done, selontoute probabilité, antérieures a la copie du texte. On voit en ef-fet assez mal comment elles auraient pu étre pensées et insérésapres coup. Or la Pars Concilii Laterani est copiée par la mainqui, dans le colophon du folio 33, date le manuscrit de 1253.Cette date constitue done nécessairement un terminus antequem pour le dessin. Il est difficile d' aller plus loin, mais voiládeja qui nous rapproche de Jiménez de Rada, voire, si la com-position du manuscrit s'est étendue sur plusieurs années ou siles illustrations ont repris un modele plus ancien, qui nous si-tue sous son épiscopat.
La représentation du concile de Latran IV est en définitivela plus inattendue et la moins stéréotypée de tout le manuscritoElle iIlustre et résume un texte, la Pars Concilii Laterani, parlequell'église tolédane affirmait sur un mode résolument po-
63 Foreville (1960, 1130).
Du cosmos a la Chrétienté: images d'évéques 101
lémique -nous pensons tout palticulierement au «dicours ja-cobéen»- ses droits a la domination de tout l'espace ibérique.Cette image étonnante mérite d'étre opposée a celles qui rap-pellent, dans la prerniere partie de l' reuvre, la tenue des dix-huit conciles de Tolede 64. Latran IV est en effet le seul concile«modeme» auquel il soit fait allusion, et de quelle facon, dansle manucrit des Notule. Or les différences sautent aux yeux.L'illustrateur a en effet délibérément choisi de ne pas suivre lemodele iconographique, peut-étre inspiré d'une tradition anté-rieure, qui avait été fixé dans la premiere partie du codex 65. Ilpeut ainsi se situer, sans équivoque possible, dans un cadrenon plus national mais universel: ce sont le pape et les deuxpatriarches de Constantinop1e et de Jérusalem qui dominent lacomposition, au-dessus des métropolitains d'Espagne et desla'iques. Comme dans les deux images étudiées précédem-ment, le plan circulaire symbolise une totalité structurée par lafigure de l' évéque, Mais ici, pour la prerniere fois, cette totali-té est celle de la chrétienté, entendue aussi bien géographique-ment -Orient et Occident- que chronologiquement -l215.Cette visée universaliste n'en est pas moins au service din-téréts particuliers. Tolede et son plus illustre représentant, Ro-drigo Jiménez de Rada, sont ainsi clairement posés au coeur dumonde chrétien.
Ces trois images ont en commun la notion d'investissementde l' espace chrétien par la figure de l' évéque. Mais dans lepremier cas, c'est une conception collégiale de la fonctionépiscopale, sans exaltation d' aucun siege particulier, qui s' im-pose. Les choses changent avec la deuxierne et la troisiemeimages, qui correspondent a des époques de (re-) construction
64 Les prélats sont toujours représentés assis, sous les rois et les évéquesde Tolede, et non en cercle. Reproductions de Tolede II et III dans Li-nehan (1993, 366-367), de Tolede XII dans Foreville (1960, fig. 8).
65 lbid., p. 1127.
102 Patrick Henriet
de la carte diocésaine et d'affirmation acharnée des prérogati-ves propres achaque siege. En définitive, nous avons cru pou-voir repérer:
1) Une vision allégorique, a-historique et cosmique del'évéque. Le prélat n'est central qu'en tant que membre d'uncorps, peut-étre pas seulement épiscopal. Celui-ci investit l' es-pace du monde, qui est ainsi totalement christianisé. Ce ri'estpas la un mince paradoxe, puisque cette image correspond aune époque de domination islamique doublée de grandes diffi-cultés pour les chrétiens. Elle joue sans doute le róle de refuge(image 1).
2) Une vision cosmique centrée, mais aussi resserrée.L' évéque et son diocese sont désormais envisagés dans leurconjoncture spécifique. Ils occupent le centre d'un espace,mais la logique est ici plus centripete que centrifuge et l' espa-ce «marqué» n'a sans doute pas vocation a s'étendre infini-ment. C' est le temps des grandes constructions idéologiquesmonastique et épiscopales, dans le cadre d'une «Reconquéte»qui progresse (image 2).
3) Une vision totalement historicisée (Latran IV, 1215), quiutilise toujours la figure du cerc1e. lei, la dimension cosmiqueest abandonnée au profit du concept de Chrétienté universelle,orientale et occidentale. Le centre de la composition est tou-jours occupé par un évéque défendant les intéréts particuliersde son siege, mais le rayonnement se fait symboliquementdans le cadre de la Chrétienté romaine, notion absente des re-présentations antérieures (image 3).
Du cosmos a la Chrétienté: images d'évéques 103
T '. .,.. ·1 '1' 1...•• t: V~":~ .:1.'\:::\J ..••··nr h-mJ!J4(f •••~1t.$1"AH1r·. .
J. f\t('Uf't·." tl ",(tlct\l.
. "''''''¡,I". "''''''TI.,T I"tl't\1~'(lt.. : fi "A u. .
e' ""ti" \..'Ut S",!tlrn<tnn1CU
~-,~r~(,u.,~m~.. t"U,CltU.
11 ftto " •...~U1"O
t:..,,,~
.~
'toPIjINr'tA (.2\MAC;' N1,.:_~~:
• ~-('Il..c'twn\t'b.f'O~.(·
(' ""fl.u,.
....~'('i·"'~=r- ...uT ,Jru'l\"'-~·:bll.61',ru.-!:)f;()\n~
1l' u~(f"\n . 'jo ••• ,
1\ f'Cu.L1('\.I,. ,;,..•;,
~'¡ ..,¡ '.;,\! .1. t : ,"(' •
r l't'~,.l.n
r ~"~~f'
~"""11((,11'~,.ntufl' ,,,,{¡f .
1n-U{lrt: '1uct-t,..l,l" ,.r, l;\'CfT>.
'l,;.\"«hu .J\f~bontt .
A"-I1,HiH"
1fMlCU.•...
1 () 11m\("
i\ uf'1CnfC •
,Ji~. ~1i.:;.,1'~
.~1:
e ('fU,tl'\I~lIf'nl
1tufft"r '"
\ \(luC"¡lI1T1f
T\U((lr 1It"'t'UC"tlU
e (1"1\
t· uf"1"tnl"",
('. t't","~I'. r ItTtrrrlf
.\ 'j"trr·I.U~II
<\III¡ul:;'lfj(J
( o.lt1tiU\.l~(J(11(1'('.-"'
J.:l:J
;.o., (eno
FllfunJu1 fl'\f'UpUr
.•.. ~lln., 'r ter' ••.·
l. Codex /Emilianensis, Bibliotheque de l'Escorial, ms d.I.l, fol. 392v. Roue desévéques.
104 Patrick Henriet
e-, ..'1-1..."",' •• ('~· .•,,"t';~i.....~,,-< ....,.....•...•.~:.i t t T ••
·.i~ ••.~", .
'j·U';'l"orar
• > ";).
f•.\
~~;'~
"'.'-:',
frl/
¡.
"'1 ' ~ '?:T .,__ o
, 'L'~~Cl."'<:'~l. '11 " ~\'~,,;':.:~~:;:::.:..~:.:::i~::;:;":':i;:I-···· ..c.," '::",.:,.::,;., •..'.:..\••••. ~,"f
H~~{;~,~~:{~~ª4~~~:'l,~ .I>~l·"'-'••'Í'A· . "1 ., ,r ..~(.-.J'.';"'( n,,.,: __ •• tu ~('I~ tt"f~f """"". :"
i\'••,I"t ••••-:f '!.I~·.•.,...'~,,~":""If~ ~tn.r~!~.~'1:. ,••.•; ·~""'U" '••.u~.C'••;".Iwt.."' •.. ';-o~~ftll ••f~ •.•:,"" .":~'..t~;r:~ ....".."..•.."':~~...,.,~'1•.f.'7of_ •• ' •••••,
:>.
1//1/ '1 orc<>, lle-l'''''';o='1Ló. '. '.', i.r -, .. " "~"'of-".~J.\Jnf"'''~· h,;;_:.:t¡(o.I;'l\.t Oo¡t'I-\ ,...".,.,¡ .
~:~~'~;;:'~~.=~(-,:·:-:,~:~:.~(~7:1E~:;':~~:.1 ~tQ, p.1\I.'.'l~"¡:<H? ' ,. . ,
lí'! ".1(11 mI'( r;..,....f 11.:.' "'~:OT-Of'..0(':-' '\;";.!\ 1••.•'I'l'1rl¡~I\i(- ••••:'1& .•
.' ~:;:':;';::.~"'..::,::~:.::'::--:-:~',,~~,;:;::,:,:.t,;:O.·" .•..1
t " , .-e- (" ttt r .",1 • .).,. ;
.. !,.I:,".<t.¡,? l •
2. Codex Albeldensis (ou Vigilano), Bibliotheque de l'Escorial, ms d.I.2, fol. 14v.Rose des vents.
iI
Du COSI1'WS a la Chrétienté: images d' éveques 105
3. Codex IEmilianensis, Bibliotheque de l'Escorial, ms d.I.l, fol. 11v. Rose desvents .
106 Patrick. Henriet
4. Isidore de Séville, De natura reruin, Palimpseste de Fleury, BNF 6400G (finVI¡Csiecle). Rose des vents.
Du cosmos a la Chrétienté: images d' éveques 107
5. Isidore de Séville, De natura rerum, Palimpseste de Fleury, BNF 6400G (finVIICsiecle). Rase des mois.
108 Patrick Henriet
\~~,'.~
~~~' ~:~~~~~~ ~. ':1, .' ~$~r,:\.~~.... __ ~¿~~~.
~~v.~ r. '. i-~~'YY" 1': .,;.~~ ~:<>-'.' .;;Jt;:!:-.:~:'·;-"(g~5~~r,:·~~. ., ." "";:,iil~:'~r'
6. Pélage d'Oviedo, Corpus pelagianum. Madrid, BNE, ms 1513, fol. 3. Dans lemédaillon central: Pelagius episcopus me fecit.
Du cosmos a la Chrétienté: images d'évéques 109
,t:r'
11l¡
\
id
.o ..:',~..";<tú 117ltlCrtI"fJflTh'flcro)Z ~ltttf. cernf ~Ltr-Il~lml1f ...Jqcr1llnnffl' firnr-m tm4 fmtlf. t:{: i,m¡:F111rtCl114,;J1IJlvomt='l'C" tttt
7. Pélage d'Oviedo, Corpus Pelagianum, Madrid, BNE, ms 1513, fol. 3v. Dans lemédaillon central: Pelagius episcopus me jecit
110 Patrick Henriet
~ éIfUlU"mm'iftt.-t1 mh-ret111-putxa 1m~1tcnt'/ .
,.rh J~f:I<ll~\":_)" J.? •• ;:'~~
>o¡,
.~
~tf2~~"/(¡'%~~C21110l:1111111111"!f~~,\jll'hnil~"~d<mtJfil1111
-1
tkij.l1fÍ!td':'dJwrttgt.Dl1r~qUlM f~ldlulÍi{)l1i111~1ilJ:!cft}t; q~PCéaf111t1ditJ qñ~ ttvtfu cue .tMlfffll ~ :-Lq~ñ -V1utt.nec fume( ~eta l'elP10tU(\ 4UOUJQ;foluaf 1 dmlr't¡1f 1'f!llWe-1-~ q1m.J)(X"4.UdinU~llnfirl1ÚCl~¡1t'afW!lC\:11fc~cVm dnin~~CItÚ. cm C01l1rotU'14t"/Cílercm etclám,1lUlft't" ilP["tul V1itni ou~wícVm itt1l:Znt' cú ccclí ~ fu e' .lb tIl1; dlCdñfltk fu~ f.1(\itf~
8. Pélage d'Oviedo, Corpus Pelagianum, Madrid, BNE, ms 1513, fol. 64. Légen-de (postérieure) au-dessus du personnage de gauche: Pelagio obispo de Ovie-do. Au-dessus du mi: Veremundus rex (Bermude Il, 985-999).
Du cosmos a la Chrétienté: images d'évéques 111
i : ~
1~!5. :.:~'.
.:.'(
.1. .••-.~~,.•••...,.
, ~,~...,.~~:;
'\
f;~;e
9. Notule de primatu nobilitate et dominio ecc/esiae toletanae. Madrid, BNE, rosVitr. 15-5, fol. 22.Sermon de l'archevéque Rodrigo Jiménez de Rada lors du concile de Latran IV(1215).
112 Patrick Henriet
·.~/;/':"~ •• ~. '. ,'. ~,. 4 ~-'("":i~":Y.. ' .'
'. . ,<:, ~~i~ '1Mtm mt~i"A1ii;'ai~{lln14~¡.~~ty,itffi1\~~.~~,..,',~, -.~=~~~~::,..~·~+~I\lnhh¡ fI.'"mJ~'~f\1IHIA5~~fuf,. . ,-~,~~~~:~ "~,,- "
. J!1I1MÚl""r~Jmt.ItI99W~" \. 41 ~~.~tl.~lnukttl4U41ttlUt6=/ (. I
¡;¡;..t'bt¡:-"'IC·'\I¡'Wtllt.,rca,.I!4fIk~1lt· ~ t"
m-t!!Wm9 ttllAlII J 4 (d4 ~,,~ rnwu Ilw tlIm;I)u~ ~bm .,,(.r.~mmAtti"tITl.",~.~~ '1SWlW'm~~t~
10, Notule de primatu nobilitate et dominio ecclesiae toletanae. Madrid, BNE, msVitr, 15-5, fol. 21 v.
Le cardinal Hyacinthe (gauche) face allx suffragants de I'archevéque de Corn-postelJe. F.l. HERNÁNDEZ, Los cartularios de Toledo, n? 618 (1172),
(. --"tWlamij.l! 'ftl4rnl Tll4g-ñ'1'MtlIlJ r~ ~1fta11C" eme VW clWU;~ !vIi;-'
_P.... •.• •• o o •• " ,. ~...•_ _ vo./ ..JUtl~' 1"..-nc.~UU·.,t1~~.Il"".~.cc·~~..x-.J'l'í'u--J 'bnt vw!Jl'1Í{·i·~·.1il"'~..:L1rn ~ !»fUll1"¡"lIj. -:t1--c¡tll;J '"'tM'~¡f}1\ñu)J. fllp!t" -VmU"M ,tvl~~ ~ .111J1UlM l~41tñ. /
tf} 19~ ~ (~(~"l'~ Ilh/ ~QB 1:t: ntliml~Hl"l'~ lUy9 tllUtmly~",~, /~(/"::7'
~r. ~~.fp4~ utUUrt9lf~ . ' ~t~\L~'..__ o 4tm74'f'liM-~.~u,f.1u> .~[ ••.•·~~II ñ4\nfr;:~"':'A·~ ..roWtn~1~r \ ,: O •.
pAlcñ m~",.Mq~~ ..l ~t~tl arli"rrliUl ~ ~líí'r~V~at.~cñtm ~ ~ 4r.tí(4 tq,~'tM~~. q~ ~G u1-m'4~ú1AUnty ~41~~~.~ftt~lf-~~~iCM tn~,,~ ~1\'
11.Notule de primatu nobilitate et dominio ecclesiae toletanae. Madrid, BNE, Il1S
Vitr, 15-5, fol. 21.
Grégoire IX (gauche) et Rodrigo Jiménez de Rada (droite), F. l. HERNÁNDEZ,Los cartularios de Toledo, n" 685 (22 mai 1231).
Du cosmos a la Chrétienté: images d'éveques 113
12,Notule de primatu nobilitate el dominio ecclesiae toletanae. Madrid, BNE, msVitr. 15-5, fol. 20,Grégoire IX face aux évéques de Ségovie, Salamanque et León, F. J.HERNÁNDEZ, Los cartularios de Toledo, n° 686 (6 mai 1234),
264 Conclusions
Fuentes
GIRAUDDEBARRI, Giraldi Cambrensis Opera, éd. J.S. BREWER,lF.DIMOCK,G. F. WARNER(RS 21), Londres, 1863.
RAOULDE DISS (DE DICETO), «Ymagines historiarum», Opera Histo-rica, éd. W. STUBBS(RS 68).
RrCHARDDEDEVIZES, Chronicon Richardi Divisensis de tempore re-gis Richardi Primi, éd. et trad. angl. J.T. ApPLEBY,Londres, 1963.
Bibliografía
ABADAL,Ramon d' (1948), L'abat Oliba, bisbe de Vic, i la se va epo-ca, Barcelona, Ayma.
AHERNE, Consuelo María (1949), Valerio of Bierzo. An Ascetic ofthe Late Yisigothic Period, Washington D.C., Catholic Universityof Arnerica. New series.
ALONSO, Manuel (1943), Diego Garcia, natural de Campos, Ma-drid, CSIC.
ANTOLÍN,Guillermo (1907), «El códice Emilianense del Escorial»,La Ciudad de Dios, 72, Revista Agustiniana, Madrid.
- (1916), Catálogo de los códices latinos del Escorial, I, Madrid,Imp. Helénica.
AUBRUN,Michel (1981), L'Ancien dio cese de Limoges des originesau milieu du XIe siécle, Clermont-Ferrand, Institut d'études duMassif central.
AURELL, Martín (1999), «Prédication, croisade et religion civique.Vie et rniracles d'Oleguer (t1137), évéque de Barcelone», RevueMabillon, 71, Ligugé, Abbaye Saint-Martin, 11-168.
- (2001) La Cour Plantagenét (1154-1204), AURELL,Martín (dir.),Poitiers, Université de Poitiers, Centre d'études supérieures de ci-vilisation médiévale.
AUTRAND,Francoise (1986), Charles VI. La folie du roi, Paris, Fa-yard.
BAXTER,Kenneth (1990), Conquerors and chroniclers of Early Me-dieval Spain, Liverpool, Translated Texts for Historians, vol. 9Revised.
266 La imagen del obispo hispano en la Edad Media
BEECH,Georges (1977), «Biography and the study of XPh century.Bishop Peter II of Poitiers, 1087-1115», Francia 7, Thorbecke,Deustchen Historichen Institut Paris, 101-121.
BOISSONNAÓE,Prosper (1934), «Les relations des ducs d' Aquitaineavec les états chrétiens d'Aragon Navarre (1014-1137)>>,Bulletinde la société des Antiquaires de l'Ouest, Poitiers, 264-316.
BOUSQUET,Jacques (1992), Le Rouergue au premier Moyen Age(vers 800 - vers 1250). Les pouvoirs, leurs rapports et leurs do-maines, Rodez, Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron.
BOZÓKY,Edina, HELVÉTIUS,Anne Marie (dir.) (1999), Les Reliques.Objets, cultes, symboles, Turnhout, Brepols.
BRONISCH,Alexandre Pierre (1999), «Die iberische Herrschertiara»,Frühmittelalterliche Studien, 33, 89-107.
BROWN,Peter (2000), «Enjoying the Saints in Late Antiquity»,Early Medieval Europe, 9, 1, 1-24.
BUR,Michel (1984), «A propos de la chranique de Mouzon. Archi-tecture et liturgie a Reims au temps d' Adalbéron (vers 976)>>,Cahiers de Civiiisation Médiévale, 27, Poitiers, Université dePoitiers, Centre d'études supérieures de civilisation médiévale,297-302.
BURGESS,Richard. W. (1993), The Chronicle of Hydatius and theConsularia Constantinopolitana, Oxford, Clarendon.
CABANES,Manuel (ed.) (1968), Rodrigo Jiménez de Rada, De Re-bus Hispaniae, Valencia.
CALDERÓNORTEGA,José Manuel (1998), Alvaro de Luna, riqueza ypoder en La CastiLLadel siglo XV, Madrid, Centro universitarioRamon Carande, Dykinso ed.
CASTELLANOS,Santiago (1998), Poder social, aristocracias y hom-bre santo en la Hispania visigoda. La Vita Aemiliani de Brauliode Zaragoza, Logroño, Universidad de La Rioja.
- (prensa), «The Political Nature ofTaxation in Visigothic Spain»,Early Medieval Europe, Oxford, Blackwell.
- MARTÍNVISO,Iñaki (prensa), «Local Articulation of the CentralPower in the North of the Iberian Peninsula (500-1000)>>, EarlyMedieval Europe, 11,2, Oxford, Blackwell.
CAVALLO,Guglielmo (1994), Exultet. Rotoli liturgici del medioevomeridionale, Roma, Librería dello Stato.
Bibliografía 267
CrROT,George (1924), De codicibus aliquot ad Historiam Hispa-niae antiquae pertinentibus olimque ab Ambrosio de Morales ad-hibitis, Bordeaux, Bibliotheca Latina Medii lEvi, 2.
COUSSEMACKER,Sophie (1994), L 'ordre de saint Jérome en Espag-ne (1373-1516), thése de doctorat inédite, Paris X.
Cox, Patricia (1983), Biography in Late Antiquity. A Questfor theHoly Man, Berkeley & Los Angeles, California U. P.
CRACCORUGGINI,Lellia (1981), «11miracolo nella cultura del tardoimpero: concetto e funzione», Hagiographie, cultures et sociétés,IVe-XIle siécles, Paris, Université Paris X, 161-204.
CHARLOBREA,Luis (1999), «Juan de Osma», Crónica Latina de losReyes de Castilla, Madrid, Akal.
CHIOVARO,Francesco (1986), Histoire des saints et de la saintetéchretienne. 1. La Nuée des temoins, Paris, Hachette.
DE VIC, Claude et VAISSETTE,Joseph (1875), Histoire générale duLanguedoc, IV-V, Toulouse, Privat.
DELEHAYE,Hippolyte (1930), «Les origines du culte des martyrs»,Subsidia hagiographica, 20, Bruxelles, Société des Bollandistes.
DESHMAN,Robert (1995), The Benedictional of Aethelwold, Prince-ton, Princenton University Press.
DESJARDINS,Gustave (1879), Cartulaire de l'abbaye de Conques enRouergue, Paris, Picard.
DEYERMOND,Alan (1984-1985), «The death and rebirth ofVisigot-hic Spain in the Estoria de España», Revista Canadiense de Es-tudios Hispánicos, 9, Toranto, University of Toronto Press.
DÍAZy DíAZ, Manuel Cecilio (1959), Index scriptorum latinorumMedii Aevi hispaniarum, Madrid, Patronato Menénendez y Pela-yo.
- (1974), La vida de san Fructuoso de Braga. Estudio y edicióncrítica, Braga.
- (1979), Libros y librerías en la Rioja altomedieval, Logroño, Di-putación Provincial, Servicio de Cultura.
DÍAZ,Pablo (1997), «La rue a Mérida au VIe siecle: usage sacré etusage profane», La rue, lieu de sociabilité?, Actes du colloque deRouen, Rouen, Université Rouen, 331-340.
- (2000), «El peregrino en la ciudad. Expresionismo religioso en laHispania tardoantigua», Lo sagrado en el proceso de municipali-
268 La imagen del obispo hispano en la Edad Media
zacián del Occidente latino, Iberia. Revista de la Antigüedad, 3,Logroño, Universidad de La Rioja, 151-166.
- VALVERDE,M" del Rosario (2000), «The Theoretical Strengthand Practical Weakness of the Visigothic Monarchy of Toledo»,en F. THEUWS,J.L. NELSON(eds.), Rituals of Power. From LateAntiquity to the Early Middle Ages, Leiden, Brill, 59-93.
DÍAZMARTÍN,Luis Vicente (1997), Los orígenes de la AudienciaReal Castellana, Sevilla, Universidad de Sevilla.
DIOS,Salustiano (1982), El Consejo Real de Castilla (1385- J 522),Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.
DOUAIS,Célestin (ed.) (1887), Cartulaire de l'abbaye de Saint-Ser-nin de Toulouse, Toulouse, Privat.
DURUAT,Jean (1990), Lesfinances publiques de Diocletien aux Ca-rolingiens (284-889), Sigmaringen, Beihefte der Francia.
ESTEBANRECIO,Asunción (1989), Palencia afines de la Edad Me-dia, una ciudad de señorio episcopal, Valladolid, Universidad deValladolid.
ESMEIJER,Anna C. (1978), «Divina quaternitas». A PreliminaryStudy in the Method and Application of Visual Exegesis, Assen,Gorcum.
FEIGE,Peter (1978), «Die Anfange des portugiesischen Konigtumsund seiner Landeskirche», Gesammelte Aufsiitze zur Kulturges-chichte Spaniens, 29, Münster, Aschendorff, 85-436.
- (1988) «Zum Primat der Erzbischofe von Toledo über Spanien.Das Argument seines westgotischen Ursprungs im toledaner Pri-matsbuch von 1253», Fiilschungen im Mittelalter. Internationa-ler Kongrefl der Monumenta Germaniae Historica. München,16.-I9. September I986, Hanovre, Monumenta Germaniae Histo-rica Schriften, 3311, 1, 675-714.
FERNÁNDEZCONDE,Francisco Javier (1971), El libro de los Testa-mentos de la Catedral de Oviedo, Roma, Iglesia Nacional Espa-ñola.
- (1971), «La obra del obispo ovetense D. Pelayo en la historiogra-fía española», Bidea, 73, 249-291.
- (1971), El libro de los testamentos de la catedral de Oviedo,Roma, Publicaciones del Instituto Español de Estudios Eclesias-ticos 17, 50-69.
Bibliografía 269- (1978), Gutierre de Toledo, obispo de Oviedo 1317-1389: refor-
ma de la iglesia bajomedieval asturiana, Oviedo, Universidad deOviedo.
FERNÁNDEZVALVERDE,Juan (ed.) (1987), «De Rebus Hispaniae»,Corpus Christianorum, Turnholt, Brepols.
- (1989) (ed.), Historia de los Hechos de España, Madrid, Alianza.FERNÁNDEZVALLlNA,Emiliano (1978), «Sampiro y el llamado Si-
lense: de los manuscritos y sus variantes», Helmantica, 29, Sala-manca, 51-60.
- (1995), «El obispo Pelayo de Oviedo. Su vida y su obra», LiberTestamentorum Ecclesiae Ovetensis, Barcelona, M. Moleiro D.L,231-401.
FITA,Fidel (1894), «El concilio nacional de Palencia en el año 1100y el de Gerona en 1101», Boletin de la Real Academia de la His-toria, 24, Madrid, Fortanet, 215-235.
- (1902), «Santiago de Galicia: nuevas impugnaciones y nueva de-fensa», Razón y Fe, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 2.
FLORIANO,Antonio (1962) «En torno a las Bulas del Papa JuanVIIl»,Archivum, 12, Paris, PUF, 117-135.
FLORIANOLLORENTE,Pedro (1997), «Crítica documental: los docu-mentos de la catedral de Oviedo», Homenaje a Juan Uria Riu, 1,Oviedo, Universidad de Oviedo, 69-80.
FONTAINE,Jacques (1960), Isidore de Séville. Traité de la Nature,Burdeos, Biblioheque de l'École des Hautes études Hispaniques,XXVIII.
- (1980), «King Sisebut's Vita Desiderii and the Political Functionof Visigothic Hagiography», Visigothic Spain: New Approaches,Oxford, Clarendon, 93-129.
- (1995), «L'évéque dan s la tradition littéraire du premier millénai-re en Occident», Les évéques normands du XI siécle, Universitéde Caen, Presses Universitaires de Caen, 41-51.
- (2000), Isidore de Séville. Genése et originalité de la culture his-panique au temps des wisigoths, Turnhout, Brepols.
FOREVILLE,Raymonde (1966), «L'iconographie du XIIe concilececuménique. Latran IV (1215)>>,Mélanges offerts a René Crozet,GALLAIS,Pierre-Rrou, Yves (eds.), Poitiers, Société d'Études Mé-diévales, II, 1121-1130.
270 La imagen del obispo hispano en la Edad Media
FOURACRE,Paul (1998), «The Nature of Frankish Political Institu-tions in the Seventh Century», Franks and Alamanni in the Mero-vingian Period: An Ethnographic Perspective, Woodbridge, Boy-dell.
GAIFFIER,Badouin de (1961), «Le culte de saint Isidore», Isidoria-na, León, Centro de Estudios «San Isidoro», 271-281.
GALÁNSÁNCHEZ,Pedro J. (1994), El género hlstoriográfico de laChronica. Las crónicas hispanas de época visigoda, Cáceres,Universidad de Extremadura.
GALBISDÍEZ,María del Carmen (1961), «Las Atarazanas de Sevi-lla», Archivo Hispalense, 35, n. 109, Sevilla, 155-184.
GALVÁNFREILE,Fernando (1997), «El ms. 1513 de la BibliotecaNacional de Madrid: primeros pasos en la miniatura gótica hispa-na», Anuario de Estudios Medievales, 27/1, Barcelona, CSIC,479-497.
GARCÍA,Sebastián, TRENADO,Felipe (1978), Guadalupe, historia,devocion, arte, Sevilla, Católica Española.
GARCÍAy GARCÍA,Antonio (1987), «El concilio 4 Lateranense y laPenínsula Ibérica», Iglesia y derecho 2, Salamanca, BibliothecaSalmanticensis. Estudios, 89, 187-208.
GARCÍADECORTAZAR,José Angel y otros (1985), Organización so-cial del espacio en la España medieval. La corona de Castilla enlos siglos VIII-XV, Barcelona, Ariel.
GARCÍADELAFUENTE,Olegario (1991), «Leovigildo, Hermenegil-do, Recaredo y Leandro en los "Dialogi" de Gregorio Magno»,Concilio III de Toledo, XIV Centenario, 589-1989, Toledo, Arzo-bispado/Caja de Toledo.
GARCÍADELOAYSA(1595), Collectio conciliorum Hispaniae, Ma-drid, Excudebat Petrus Madrigal.
GARCÍAMORENO,Luis (1994), «Gothic Survivals in the VisigothicKingdoms of Toulouse and Toledo», Francia, 21, Thorbecke,Deustchen Historichen Institut Paris.
GARCIATORAÑO,Paulino (1996), El rey don Pedro el cruel y sumundo, Madrid, Marcial Pons.
GEARY,Patrick J. (1988), Before France and Gerrnany. The Crea-tion and Transformation ofthe Merovingian World, Oxford, Ox-ford University Press.
Bibliografía 271
GERBET,Marie-Claude (1994), Les noblesses espagnoles au Mo-yen-Age, Paris, A. Cohn.
GIORDANENGO,Gérard (1988), Le droit féodal dans les pays de droitécrit. L'exemple de la Provence et du Dauphiné (XIIe-début XIVesiecle), Roma, École Francaise de Rome.
GIRY,Arthur (1894), Manuel de diplomatique, Paris, Librairie AI-can.
GOFFART,Walter (1988), The Narrators of Barbarian History (A. D.550-800). Jordanes, Gregory ofTours, Bede and Paul the Dea-con, Princeton, Princeton University Press.
GOÑIGAZTAMBIDE,José (1979), Historia de los obispos de Pamplo-na, siglos IV - XIII, Pamplona, EUNSA.
GOROSTERRATZU,Javier (1925), Don Rodrigo Ximéne: de Rada,gran estadista, escritor y prelado, Pamplona, Imp. y Lib. de Viu-da de T. Bescansa.
GOULLET,Monique-IoGNA-PRAT,Dominique (1996), «La Vierge enMajesté de Clermont-Ferrand», Marie. Le culte de la Vierge dansla société médiévale, Paris, Beauchesne, 383-405.
- (1999), «In vera visione vidi, in vero lumine audivi: écriture etillumination chez Hildegarde de Bingen», Francia, 611, 1999, Pa-ris,77-102.
GRASSOTTI,Hilda (1972), «Don Rodrigo Ximénez de Rada, gran se-ñor y hombre de negocios en la Castilla del siglo XIII», Cuader-nos de Historia de España, 55-56, Buenos Aires, Facultad de Fi-losofía y Letras, 1-302.
GREGOIRE,Réginald (1996), Manuale di agiologia. Introduzionealla letteratura agiografica, Fabriano, Monastero San SilvestroAbate.
GUIANCE,Ariel (1991), «Morir por la patria, morir por la fe, la ideo-logía de la muerte en la Historia de Rebus Hispaniae», Cuader-nos de Historia de España, 73, Buenos Aires, Facultad de Filoso-fía y Letras, 75-95.
HAMBURGER,Jeffrey (1984), «Bosch's Conjuror: an attack on magicand sacramental heresy», Simiolus, 14. Apeldoorn, Stichting voorNederlandse Kunsthistorische publicaties.
HEHL,Ernst Dieter (1994), «Was ist eigentlich ein Kreuzzug?», His-torische Zeitschrift, 259, München, Oldenbourg, 297-337.
272 La imagen del obispo hispano en la Edad Media
HENRIET, Patrick (1997), «Hagiographie et politique a León au dé-but du XIII siecle: les chanoins réguliers de saint-Isidore et la pri-se de Baeza», Revue Mabillon, 69, Ligugé, Abbaye Saint-Martin,53-82.
- (2001), «La dignité de la religion chrétienne et de la nation his-panique', ou Enrique Flórez et YEspaña sagrada. A propos d'uneréédition», Revue Mabillon, Ligugé: Abbaye Saint-Martin, 296-306.
- (2003), «Political Struggle and the Legitimation of the ToledanPrimacy: the Pars Lateranii Concilii», 1.ALFONSOet J. ESCALONAdirs., Building Legitimacy. Political Discourses and Forms 01Le-gitimation in Medieval Societies, Leyde-Cologne-Boston, Brill.
HERNÁNDEZ,Francisco Javier (1996), Los cartularios de Toledo.Catálogo documental, Madrid, Fundación Ramón Areces.
HERRMAN-MASCARD,Nicole (1975), Les reliques des saints. La for-mation coutumiére d'un droit, Paris, Klincksieck.
HIESTAND,Rudolf (1993), «Les légats pontificaux», GROSSE, Rolf(dir.), L'Église de France et la papauté, xe-XlIIe siecle, Bonn,Bouvier.
HILLGARTH,Jocelyn (1970), «Historiography in Visigothic Spain»,La storiografia altomedievale. XVII Settimane di Studio del Cen-tro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto, Centro italianodi studi sull'alto Medioevo, 261-311.
HÓGBERG,Paul (1916), «Manusctrits espagnols dans les bibliothe-ques suédoises», Revue Hispanique, 36, Paris, Picard, 377-474.
HUlC!, Ambrosio (1956), Las grandes batallas de la Reconquista,Madrid, Instituto de Estudios Africanos.
ISLAFREZ,Amancio (1990), «Las relaciones entre el reino visigodo ylos reyes merovingios a finales del siglo Vl», En la España medie-val, 13, Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 11-32.
JACQUART,Danielle, THOMASSET,Claude (1985), Sexualilé et SavoirMédical au Moyen Age, Paris, P.U.F.
KELLY,Thomas F. (1996), The Exultet in Southern Italy, New York-Oxford.
KRUSCH,Bruno (ed.) (1885), Gregorii Episcopi Turonensis Liber inGloria Martyrum, Monumenta Germanica Histórica, Scriptoresrerum merovingiorum, 1,2. Hannover, Hahn.
Bibliografía 273
- LEVISON,Wilhelm (eds.) (1951), Gregorii Episcopi TuronensisHistoriarum Libri X, Monumenta Germanica Histórica, Scripto-res rerum merovingiorum, 1, Hannover, Hahn.
JAEGER,C. Stephen (1985), The Origins 01 Courtliness. CivilizingTrends and the Formation of Courtly Ideals, Philadelphia, Phila-delphia University Press.
LACARRA,José María (1953), «La colonisation franque en Navarre-Aragon», Annales du Midi: revue archéologique, historique etphilologique de la France méridionale, Tolouse, Privat, 332-340.
- (1975), Historia del reino de Navarra en la Edad Media, Parn-plona, Aranzadi.
LADNER, G. (1935), «1 mosaici e gli affreschi ecclesiastico-politicinell'antico palazzo lateranense», Rivista di Archeologia Cristia-na, Roma, Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, 12,265-292.
LARREA,Juan José (1998), La Navarre du Ive au XII" siecle, peuple-ment et société, Bruxelles, De Boeck Université.
LAUWERS,Michel, DEssI, Rosa Maria (dir.) (1997), La Parole duprédicateur (Ve-XVe siécle), Nice, Z'editions
LEMARIGNIER,Jean-Francois (1956), «Autour de la royauté francai-se du IXe au XIIIe siecle», Bibliotheque de l'École des Chartes,113, Paris, Imprimerie Schneider et Langrand, 5-36.
LEVILLAIN,Phillipe (dir.) (1994), Dictionnaire historique de la pa-pauté, Paris, Fayard.
LINEHAN,Peter (1971), The Spanisli Church and the Papacy in theThirteenth Century, Cambridge, University Press.
- (1975), La Iglesia española y el Papado en el siglo XIII, Sala-manca, Universidad Pontificia.
- (1993), History and the Historians 01Medieval Spain, Oxford,Clarendon Press.
LIZZI, Rita (1990), «Ambrose's Contemporaries and the Christiani-sation of Northern Italy», Journal 01Roman Studies, 80, Londres,Society for the Promotion of Roman Studies, 156-173.
LOMAX, Derek W. (1974), «Rodrigo Jiménez de Rada como histo-riador», Actas del V Congreso de Hispanistas celebrado en Bor-deaux, ed. CHEVALIER,Maxime, Burdeos, Instituto de EstudiosIbéricos e Iberoamericanos.
274 La imagen del obispo hispano en la Edad Media
LYNCH,Charles H. (1938), Saint Braulio, bishop of Saragossa. Hislife and writings, Washintong, The Catolic University of Ameri-ea.
- (1950), San Braulio, obispo de Zaragoza, Madrid, Instituto En-rique Flórez.
MANSI,Dominicus (1903), Sacrorum conciliorum nova et amplissi-ma collectlo, 22, Graz, Akademische Druck.
MARTIN,Georges (1992), Les juges de Castille: Mentalités et dis-cours historique dans lEspagne médiévale, Paris. Klincksieck(Annexes des Cahiers de linguistique hispanique médiévale, 6).
MARTÍN,José Carlos (1998), «Verdad histórica y verdad hagiográfi-ea en la Vita Desiderii de Sisebuto», Habis, 29, Sevilla, Universi-dad de Sevilla, 291-30l.
MATEOSCRUZ,Pedro (1999), La basílica de Santa Eulalia de Méri-da. Arqueología y urbanismo, Madrid, CSIC.
MARTÍNEzDÍEZ, Gonzalo (1962), «Regesta de don Pelayo, obispode Oviedo», Bidea, 18,211-248.
MAYASÁNCHEZ,Antonio (ed.) (1992), «Vitas Sanctorum PatrumEmeretensium», Corpus Christianorum, S.L. 116, Turnhout, Bre-pols.
MENENDEZPIDAL,Ramón (1966), Historia de España, vol. XIV etXV, Madrid, Espasa Calpe.
MILLARESCARLO,Agustín (1931), «A propósito del Códex Hispa-lensis de la Biblia», Contribución al «corpus» de de códices visi-góticos, Madrid, 97-130.
MlNGUELLAYARNEDO,fr. Toribio (1912), Historia de la diócesis deSiguenza y de sus obispos, 4 vol., t. II, Madrid, ateliers de la «Re-vista de Archivos, Bibl. y Museos».
MOLENAT,Jean-Pierre (1997), Campagnes el Monts de Tolededu XIIe au XVe s., Madrid, Collection de la Casa de Velázquez,n° 63.
MOLLAT,Michel (1978), Les pauvres au Moyen Age. Etude sociale,París, Hachette.
Moxo, Francisco (1996), «La legitimidad de Benedicto XIII» en VICentenario del papa Luna 1394-1994, Jornadas de estudio, Ca-latayud - !llueca 1994, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilita-nos. Institución Fernando el Católico, 353-370.
Bibliografía 275
Moxó, Salvador de (1981), «El auge de la nobleza urbana y su pro-yeccion en el ámbito administrativo de la baja Edad Media», enBoletin de la Real Academia de la Historia, Madrid, Fortanet,407-518.
- (1983), Repoblación y sociedad en la España medieval cristiana,Madrid, Rialp.
MUNIER,Charles (1963), «L'Ordo de celebrando concilio wisigothi-que», Revue des Sciences Religieuses, 37, Paris, Boccard, 250-27l.
NEVEUX,Francois (1998), La Normandie des ducs aux rois, xe - XIIesiécle, Rennes, Ouest France.
NIETOSORrA,José Manuel (1993), Iglesia y genesis del estado mo-derno en Castilla 1369-1480, Madrid, Universidad Complutense.
NORDSTROM,Carl-Otto (1976), «Text and Myth in some Beatus Mi-niatures», I, Cahiers archéologiques, Paris, Klincksieck, XXv.
- (1977), «Text and Myth in some Beatus Miniatures», I, Cahiersarchéologiques, Paris, Klincksieck, XXVI, 117-136.
ORLANDIS,José, RAMos-LlssóN, Domingo (1986), Historia de losconcilios de la España romana y visigoda, Pamplona, EUNsA.
OROZ,José (1978), «Vita Sancti Aemiliani. Hymnus in festo sanctiAemiliani abbatis», Perficit, 9, Salamanca, Colegio de san Esta-nislao, 119-]20 y 165-227.
ORSELLI,Alba María (1965), «L'idea e il culto del santo patrono ci-ttadino nella leteratura latina cristiana», Studi e Ricerche, XII,Bolonia, 97-120.
PALAZZO,Eric (1999), L'évéque et son image. L'illustration du pon-tifical au Moyen Age, Bruxelles, Brepols.
- (2000), Liturgie et société au Moyen Age, Paris, Aubier.PÉREZDEURBEL,Justo (1952), Sampiro: su crónica y la monarquía
leonesa en el siglo X, Madrid, CSIC, 273-434 (Estudios, 26).PETERSEN,Joan M. (1984), The Dialogues ofGregory the Great in
their Late Antique Cultural Background, Toronto, Pontificallns-titute of Medieval Studies.
PrcARD,Charles (1998), «Les saints dans les églises latines», Éve-ques, saints et cités, Roma, École Francaise de Rome, 337-347.
POUZET,Philibert (1927), L'Anglais Jean dit Bellesmains (1122-1204), évéque de Poitiers, puis archevéque de Lyon (1162-1182... 1182-1193), Lyon, Camus et Carnte.
276 La imagen del obispo hispano en la Edad Media
PRINZ,Friedrich (1973) «Die bischofliche Stadherrschaft im Fran-kenreich vom. 5 bis zum 7. Jahrhundert», Historische Zeitschrift,217, Oldenbourg, 1-35.
RAMÍREZRIGo, Margarita (1985), Primacía de la Iglesia toledana(códice original y copia) de la Biblioteca Nacional de Madrid,Madrid, Universidad Complutense. Tesis inédita.
RASMUSSEN,Niels (1998), «Les pontificaux du haut Moyen Age.Genese du livre de I'évéque», Spicilegium sacrum lovaniense, 49,Lovaina, Université Catholique de Louvain.
REILLY,Bernard F. (1988), The Kingdom of León-Castilla underKing Alfonso VI, 1065-1109, Princeton, University Press.
REVUELTASOTOMALO,José María (1982), Los Jeránimos. Una or-den religiosa nacida en Guada laja ra. 1373-1415, Guadalajara,Institución Provincial de Cultura Marqués de Santillana.
REYNOLDS,Roger, E. (1983), «Image and Text: The Liturgy of Cle-rical Ordination in Early Medieval Art», Gesta, XXII, 27-38.
- (1987), «Rites and Signs of Conciliar Decisions in the EarlyMiddle Ages», Segni e riti nella Chiesa altomedievale occidenta-le, Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto me-dioevo, XXXII, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medio-evo.
REYNOLDS,Susan (1983), «Medieval Origines Gentium and theCommunity of the Realm», History, 68, 375-390.
- (1984), Kingdoms and Communities, Oxford, Clarendon.REYDELLET,Marc (1981), La royauté dans la littérature latine, de
Sidoine Apollinaire a Isidore de Séville, Roma, Bibliotheque desEcoles Francaises d' Athénes et de Rome.
RICHARD,Alfred (1903), Histoire des comtes de Poitou de 778 a1204,1, Paris, Picard.
RIVERA,Francisco José (1951), «Personajes hispanos asistentes en1215 al IV concilio de Letrán», Hispania Sacra, 4,1951, Madrid,Instituto Padre Enrique Florez, 335-355.
- (1969), Los arzobispos de Toledo en la Baja Edad Media (s. XI/-XV),Toledo, Diputación Provincial de Toledo.
ROSENTHAL,Jane (1981), «Three Drawings in an Anglo-Saxon Pon-tifical: Anthropomorphic Trinity of Threefold Christ?», The ArtBulletin, 63, New York, College Art Association of Americ, 547-562.
Bibliografia 277
RUCQUOl,Adeline (1997), «La royauté sous Alphonse VIII de Cas-tille», Histoire des Idées politiques dans lEspagne médiévale, ed.MARTIN,George, Paris (en prensa en los Cahiers de LinguistiqueHispanique). .
SANBERNARDINO,Jesús (1996), El santo y la ciudad. Una aproxi-mación al patrocinio cívico de los santos en época teodosiana(386-410 d.C.), Écija, Sol.
SÁNCHEZALBORNOZ,Claudio (1974), «Sobre una epístola del papaJuan IX a Alfonso III de Asturias», Bulletin de l' Institut Histori-que Beige de Rome, 44, Roma, 551-563.
SÁNCHEZHERRERO,José (1988), «Los obispos castellanos y su par-ticipación en el gobierno de Castilla (1350-1406)>>,Imágenes delpoder. España afines de la Edad Media, Valladolid, Universidadde Valladolid, 85-113.
SÁNCHEZSALOR,Eustaquio (1982), «El providencialismo en la his-toriografía cristiano-visigótica de España», Anuario de EstudiosFilológicos, 5, Universidad de Extremadura, 179-192.
SÁNCHEZSAUS,Rafael (1989), Caballería y linaje en la Sevilla me-dieval, Sevilla, Publicaciones Diputación de Sevilla.
SAURMAJELTSCH,Lieselotte E. (1997), «Das Bild in der Worttheo-logie Karls des Grossen. Zur Christologie in karolingischen Mi-niaturen», R. BERNDT(éd.), Das Frankfurter Konzil von 794.Kristallisationspunkt Karolingischer Kultur, Mayence, Selbstverlagder Gesellschaft für Mittelrheinische Kirchengeschichte (Quellenund Abhandlungen zur Mittelrheinischen Kirchengeschichte,80/1 et 80/2), II, 635-675.
SCORZABARCELLONA,Francesco y otros (1994), «Dal modello aimodelii», en Modelli di santita e modelli di comportamento, To-rino, Rosenberg e Sellier, 9-19.
SCHMITT,Jean Claude (1991-1992), «Le miroir du canoniste: apro-pos du Décret de Gratien de la Walters Art Gallery», The Journalof the Walters Art Gallery, 49/50,67-82.
SCHNEIDER,H, (1996), «Die Konzilsordines des Früh- und Hochmi-ttelalters», Monumenta Germanica Historica, Hannover.
SCHOTT,Andreas (ed) (1608), «Lucas de Tuy, Chronicon Mundi»,Hispaniae illustratae seu rerum in Hispania et praesertim in Ara-gonia gestarum scriptores varii, t. IV, Francofurti: apud Clau-dium Marnium & Haeredes lohannis Aubrii.
278 La imagen del obispo hispano en la Edad Media
SlCARD,Patrice (1993), Diagrammes médiévaux et exégése visuelle.Le libellus de formatione arche de Hugues de Saint- Victor, Turn-hout, Brepols.
SILVAy VERÁSTEGUI,María Soledad (1984), Iconografía del siglo Xen el reino de Pamplona-Nájera, Pamplona, Institución Príncipede Viana.
SIMONET,Francisco Javier (1983), Historia de los mozárabes en Es-paña, Madrid, Turner.
SMALLEY,Beryl (1973), The Becket Conflict and the Schools: AStudy of Intellectuals in Politics, Oxford, Blackwell.
SMITH,Damian J. (1999), «Soli hispani», Hispania Sacra, 51, Ma-drid, Instituto P. Enriquez Flórez.
SOT,Michel (1981), Gesta episcoporum, gesta abbatum, Turnhout,Brepols.
- (1993), Un historien et son Eglise. Flodoard de Reims, Paris, Fa-yard.
SOTORABANOS,José María (1990), «Braga y Toledo en la polémicaprimacial», Hispania, 50, Barcelona, Vicens- Vives, 5-37.
STOCKING,Rachel L. (2000), Bishops, Councils and Consensus inthe Visigothic Kingdom, 589-633, Ann Arbor, Michigan U.P.
SUÁREZFERNÁNDEZ,Luis (1960), Castilla, el cisma y la crisis con-ciliar (1378-1440), Madrid, Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas.
- (1977), Historia del reinado de Juan I de Castilla, Madrid, Uni-versidad Autónoma.
THACKER,Alan (2000), «Peculiaris Patronus Noster: The Saint asPatron of the State in the Early Middle Ages», The Medieval Sta-te. Essays Presented to James Campbell, London-Rio Grande,Hambledon Press, 1-24.
TORRESBALBÁS,Leopoldo (1957), «Arte hispano-musulmán», His-toria de España (dir.), Menéndez Pidal, 5, Madrid
TORRESSANZ,David (1982), La Administración Central castellanaen la Baja Edad Media, Valladolid, Universidad de Valladolid.
TREFFORT,Cécile (1996), L'Église carolingienne et la mort. Chris-tianisme, rites funéraires et pratiques commémoratives, Lyon,Presses Universitaires de Lyon.
TÜRK,Egbert (1977), Nuga: curialium. Le régne d'Henri II et l'éthi-que politique, Geneve, Droz.
Bibliografía 279
VALCÁRCEL,Vitalino (1990-91), «¿Uno o dos Frunimianos en VitaEmiliani y cartas de Braulio de Zaragoza?», Faventia, 12-13,Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 367-371.
- (1991), «Sobre el origen geográfico de la familia de Braulio,obispo de Zaragoza», Mnemosynum. C. Codoñer a discipulisoblatum, Salamanca, Universidad de Salamanca, 333-340.
- (1993), «Hagiografía hispanolatina visigótica y medieval (s. VII-XII)>>,1 Congreso Nacional de Latín Medieval, León, 191-209.
- (1997), «La Vita Emiliani de Braulio de Zaragoza: el autor, lacronología y los motivos para su redacción», Helmántica, 147,Salamanca, 375-407.
VALDÉSGALLEGO,Jose Antonio (2000), El «Liber testamentorumOvetensis». Estudio filológico y edición, Oviedo, Real Institutode Estudios Asturianos.
VALVERDECASTRO,M". del Rosario (1999), «Persecución religiosay defensa de la unidad del reino», Iberia. Revista de la Antigüe-dad, 2, Logroño, Universidad de La Rioja, 123-132.
- (2000), Ideología, simbolismo y ejercicio del poder real en la mo-narquía visigoda: un proceso de cambio, Salamanca, Universi-dad de Salamanca.
VALLEJOGIRVÉS,Margarita (1999), «Un asunto de chantaje. La fa-milia de Atanagildo entre Metz, Toledo y Constantinopla», Polis,Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, 11,261-279.
VAUCHEZ,André (dir.) (1995), La Religion civique a l'époque mé-diévale et moderne (Chrétienté et Islam), Roma, École Francaisede Rome.
VIGIL,Ciriaco Miguel (1887), Asturias Monumental, Epigrafica yDiplomática, 2, Oviedo (2" ed., Publicaciones del Principado deAsturias, 1987).
VILLARD,Francois (1973), «Guillaume IX d' Aquitaine et le concilede Reims de 1119», Cahiers de civilisation médiévale 16, Univer-sité de Poitiers, Centre d'Études Supérieures de Civilisation mé-diévale, 295-302.
VIÑAYOGONZÁLEZ,Antonio (1961), «Cuestiones histórico-críticasen torno a la traslación del cuerpo de san Isidoro», Isidoriana,León, Centro de estudios san Isidoro, 285-297.
280 La imagen del obispo hispano en la Edad Media
VIVES, José (1963), Concilios visigóticos e hispano-romanos, Ma-drid, Instituto Enrique Flórez.
VOGEL, Cyrille-Etzz, Reinhard (1963), Le Pontifical romano- ger-manique du X" siécle, Citta del Vaticano, Biblioteca apostolicaVaticana.
WALTER, Charles (1970), «Papal Political Imagery in Lateran Pala-ce», Cahiers archéologiques, 20, Paris, Klincksieck, 155-176.
WERCKMElSTER,Otto Karl (1963), «Die Bilder der drei Propheten inder Biblia Hispalense», Madrider Mitteilungen, Deutsches Ar-chaologisches Institut Abteilung Madrid 4, Heidelberg, Kerle,141-188
- (1968), «Das Bild zur Liste der Bistümer Spaniens im Codex/Emilianensis», Madrider Mitteilungen, 9, Heidelberg, Kerle,399-423.
WEST, Geoffrey (1997), «The Destiny of Nations: Treatment of Le-gendary Material in Rodrigo of Toledo's De Rebus Hispaniae»,The Medieval Mind. Hispanic Studies in Honour of Alan Deyer-mond, ed. Ian MACPHERSON,Londres, Boydell & Brewer.
WICKHAM, Chris (1984), «The Other Transition: From the AncientWorld to Feudalism», Past & Present Society, 103, Oxford, 3-36.
WILLIAMS, John (1993), The Art of Medieval Spain. A.d. 500-1200,New York, Metropolitan Museum of Art.
- (1994), The Illustrated Beatus. A Corpus ofthe Illustrations of[he Commentary on the Apocalypse, Il,Londres, Harvey Miller.
WOOD, Ian (1988), <donas, the Merovingians and Pope Honorius:Diplomata and the Vita Columbani», After Rome's Fall. Narra-tors and Sources of Early Medieval History. Essays presented toWalter Goffart, Toronto, University ofToronto Press, 99-120.
- (1994), The Merovingian Kingdoms 450-751, London-NewYork, Longman.
- (1998), «Forgery in Merovingian Hagiography», MonumentaGermanica Historica Schriften, 33, Fdlschungen im Mittelalter,V, Hannover, 369-385.
WRIGHT, Roger (1996), «Latin and romance in the Castilian chan-cery (1180-1230)>>, Bulletin of Hispanic Studies, 73, Liverpool,Liverpool University Press, 115-128.
Índice de nombres
Abadal, Ramón de, 257Abraham, 87, 9]Adalberón de Laón, 66, 120Adam de Brernen, ] 20Adán, 91Adrianápolis, batalla de, ]43África (Afrique), 90Agali (Toledo), 47Agila 1,27Agobardo de Lyon, 262Agustín, san, 15, 23, 38, 253Aherne, Consuelo M.", 21AL-Andalus, 50, 85, 254Alarcos (Ciudad Real), batalla
de, 146Alba de Tormes (Salarnanca),
monasterio de, 185Albelda (La Rioja), monasterio
de San Martín de, 76Albigenses, 170Albornoz, Gil Álvarez de, 236Alcalá de Henares (Madrid), 225,
228,244Alcaraz (Albacete), 243Alejandro de Lineoln, 120Alejandro II (papa), 96Alejandro III (papa), 172
Alfonso, cardenal (diácono deSan Eustaquio), 234
Alfonso, Diego, 195,200,219Alfonso de España Citerior, véa-
se: Alfonso III el MagnoAlfonso de Jordán (Alphonse
Jourdain), 181Alfonso de las Galieias, véase:
Alfonso III el MagnoAlfonso de Madrid, Juan, véase:
Alonso de Madrid, JuanAlfonso de Oviedo, véase: Alfon-
so III el MagnoAlfonso de Palencia, 237Alfonso 1 el Batallador, 172Alfonso Il el Casto, 158, 160Alfonso III el Magno, 154-156,
158-160,163-165Alfonso VI, 44,50,91, 153, 154,
155, 156Alfonso VII, 153Alfonso VIII el Noble, 129-131,
136,138,141-143,148,149,260
Alfonso IX, 138, 147Alfonso X el Sabio, 48, 118, 122,
]25,138,141