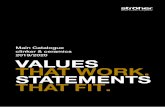FACULTE DES SCIENCES & TECHNIQUES U. F.R. Sciences et Techniques
UNIVERSITE CHEKH ANTA DIOP FACULTE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION
Transcript of UNIVERSITE CHEKH ANTA DIOP FACULTE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION
54
UNIVERSITE CHEKH ANTA DIOPFACULTE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE
L’EDUCATION ET DE LA FORMATION
Présenté par :
Encadré par :
Ahmadou BA F1A/ HG Mamadou FAYE Formateur
/FASTEF.
Thème: Etude toponymique de la communauté rurale de DIOSSONG
54
DEDICACES
Je dédie ce mémoire de fin de formation:
A mon Père
A ma Mère
A mes Frères Mamadou BA et Amadou BA et à leurs épouses
Diouldé et Esther
A mes petites sœurs Fatou BA, Aissatou BA et Ramata BA
A mes oncles Amadou Diallo, Amadou MALA et Bocar Sow
A la famille Gueye de Foundiougne
Je veux leurs dire qu’ils comptent beaucoup pour moi
A mes amis
Pape Waly Ndiaye (Baye Waly), Arona Bass, Papa Babacar BA
(Paco), Ibra Seye, Mor Awa Dieng, El Hadji N’Faly Bodian,
Malick Cissé (my Pa), Abdou khadre Diakaté, Niowi Sarr
Diouf, Ibrahima Thiaw (Mc Kenzy)
A mes cousins Alassane BA et Abdoulaye Diallo
54
REMERCIEMENTS
Je remercie du fond du Coeur:
Mamadou FAYE formateur à la FASTEF/UCAD d’avoir bien
voulu encadrer ce travail de recherche.
Mes collègues de la cellule Histoire-Géographie du
Lycée Mame cheikh Mbaye: Bakary Traoré, Mamadou Souané,
Souleymane Fickou, Aladji Badji, Mouhamadou Dangoura,
Toumany Sankharé, Mamadou L. Diallo, Maodo Ndao, Mada
Diallo, le CPI Augustin Ndecky
MM. le Proviseur Samba Dieng et le Censeur Joseph
Napel du Lycée Mame cheikh Mbaye de TAMBACOUNDA
El hadji N’faly Bodian professeur d’HG au college
Moriba Diakité
Mon ami Arona BASS et son frère Diaga BASS
54
Mon Frère Mamadou BA
M. Faye secrétaire de la communauté rurale de DIOSSONG
Sans l’aide et le soutien de ces personnes ce travail
n’aurait jamais abouti.
54
SOMMAIRE
DEDICACES
REMERCIEMENTS
AVANT PROPOS
PROBLEMATIQUE
I. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE
II. ETUDE TOPONYMIQUE DE LA ZONE DE DIOSSONG
III.ETUDE TOPONYMIQUE DE LA ZONE DE DIAGANE
IV. CLASSIFICATION TOPONYMIQUE
CONCLUSION GENERALE
54
Avant-propos
A part les objectifs scientifiques visés par cette
présente étude, le choix de la zone est motivé par des
considérations personnelles. En effet ce choix est
l’expression d’un profond attachement que j’éprouve vis-
à-vis de cette localité dans laquelle se situe mon
village natal. DAGA DIERY se trouve dans cette communauté
rurale dans la zone de NIASSENE. Le village a été fondé
par mon aïeul Samba BA qui avait été accueilli par une
famille de SERERE qui s’était déjà établi sur le terroir.
Par soucis de bons voisinages il a choisi de garder
l’appellation Sérère DAGA DIERY. Aujourd’hui pour
distinguer les deux villages on parle de DAGA DIERY PEUL
et de DAGA DIERY SERERE.
Cette étude toponymique à travers laquelle j’espère aider
à une meilleure connaissance de ma région a été une
occasion de revisiter les villages de ma communauté et
de nouer des amitiés qui je l’espère du fond du cœur
seront durables et fructueuses.
54
L’enquête de terrain réalisée dans la zone nous a mis en
contact avec une population qui vit des conditions
économiques difficiles. En effet la crise économique de
ces dernières années a sérieusement dégradé les
conditions d’existence des populations de la localité.
Naturellement la capacité d’intervention de l’Etat en
milieu rural s’est réduite considérablement. Et les
secteurs sociaux sont délaissés par l’administration
centrale au profit des collectivités locales qui triment
avec des dépenses sociales exorbitantes. Dans le cadre de
la décentralisation des secteurs comme la santé,
l’éducation et l’environnement font désormais parti des
compétences transférées. Et les fonds de dotations
alloués aux instances locales ne suffisent même pas à
leur budget de fonctionnement. Dans ces conditions il est
extrêmement ardu de satisfaire les besoins d’une
population en forte croissance démographique.
A cela on pourra ajouter les difficultés rencontrées au
niveau de l’agriculture, la principale activité
économique de la région.
Mise à part la péjoration climatique qui a contribué à la
diminution de la production. Le foncier rural sénégalais
qui n’accorde aux paysans qu’un droit d’usufruit,
l’outillage rudimentaire et archaïque, le manque
d’intrants agricoles et de structures d’encadrements et
54
de commercialisation efficaces pour accompagner les
agriculteurs, sont comptable de la baisse de la
production agricole et de la détérioration des conditions
de vie des populations.
Pourvu que cette étude puisse contribuer à attirer
davantage l’attention des différents acteurs politiques
et économiques présents dans la localité, de la place de
l’activité agricole dans la conscience collective des
populations. Cette place est bien mise en exergue par la
toponymie des villages.
54
Problématique
La toponymie est cette science qui se propose de
rechercher la signification et l’origine des noms des
lieux et aussi d’étudier leurs transformations (Jean
Poirier 1965). A travers cette définition classique du
mot trois objectifs sont visés dans une étude
toponymique. Elle recherche d’abord la signification des
noms des lieux en déterminant leur origine et étudie
leurs transformations. En réalité les altérations
sémantiques sont des évolutions qui sont dues à la
présence des pôles linguistiques différents et des
variations phonétiques et linguistiques.
Dans cette optique, la toponymie permet d’explorer le
passé linguistique et de comprendre le monde. Bref elle
peut servir indirectement à « reconstituer le passé
biogéographique, géomorphologique, hydrographique, aussi bien que
politique, linguistique, social, géographique en somme. » (J. Poirier
1965). Mieux dans un contexte de mise en pratique des
politiques de décentralisation et de développement
durable, la toponymie demeure un excellent outil pour
qu’une terre d’assistance devienne une terre d’initiative
(Aicha Bouroumi 2003). En fait la toponymie peut aider à
clarifier les concepts et les pratiques traditionnelles
des occupants ce qui est une condition sine qua none à la
réussite sociale. La connaissance et la compréhension du
54
milieu et des hommes qui l’occupent et le mettent en
valeur permettront de vivre en harmonie leur identité
collective et leur richesse culturelle.
Contexte et justification :
De ce qui précède nous pouvons retenir que l’étude
toponymique est un outil au service du développement
durable, décentralisé et participatif. C’est dans ce sens
que conscient de la rareté des études dans ce domaine
dans la communauté rurale de DIOSSONG, nous avons éprouvé
le besoin de comprendre la signification des noms des
lieux dans cette localité. Cela nous permettra de saisir
l’articulation entre l’histoire et la géographie dans la
localité à travers l’étude des noms des villages. En
réalité les stratégies d’occupation et de mise en valeur
traditionnelle des populations locales résultent des
réalités historiques. Actuellement les stratégies de mise
en valeur et d’exploitation des ressources telles que
préconisées par les pouvoirs publics entrent en conflits
avec celles mise en place par les populations depuis bien
longtemps. Dans cette optique on comprend aisément
l’échec retentissant des politiques de développement
mises en place par l’Etat post-colonial, politiques qui
n’ont pas eu l’écoute des populations intéressées. En
fait la mauvaise compréhension d’une réalité est un
obstacle à l’action et à l’intervention. L’Etat
54
sénégalais depuis son accession à l’indépendance en
1960, a parachuté dans le monde rural sénégalais des
agents chargés « faire le développement » des populations. Et
ceux-là ignoraient même jusqu’à la langue des
populations. Celle-ci demeure a n’en pas douté
un « précieux atout pour valoriser les pratiques des populations
actuelles en permettant de saisir les racines qui les fondent… » (A.
Bouroumi 2003). Ainsi la compréhension du milieu permet
d’allier le traditionnel et le moderne.
La communauté rurale de DIOSSONG est habitée par des
sociétés paysannes des ethnies Sérères et Wolofs
auxquelles se sont par la suite joints les peuls qui se
sont convertis à l’agriculture du fait de la sécheresse.
Ces ethnies se spécifient par leurs attachements à la
terre qu’elles sacralisent. C’est dans cet ordre d’idées
que Saliou Sambou parlant des ethnies de l’espace
sénégambien notamment les sérères disait qu’ils « ne
maîtrisent pas tout à fait les techniques de régénération et
d’enrichissement des sols, sont toujours obligés d’aller à la recherche
nouvelles terres de culture… » et il poursuivit en signalant que
rare sont les villages sérères vieux de 50 ans dont la
taille démographique atteint 100 habitants. Ce qui
explique d’ailleurs la dispersion de l’habitat dans la
communauté rurale qui compte 96 villages et quatre
hameaux.
54
La recherche toponymique dans la communauté rurale de
DIOSSONG permettra de comprendre la signification des
noms des villages et de connaitre leur origine et leur
évolution en vue d’un développement de l’esprit de
participation et de la citoyenneté chez les populations.
Ces dernières à travers cette compréhension pourront
faire siennes les politiques de développement. En réalité
un développement durable passe l’implication des
populations concernées dans ce processus et cela n’est
possible que si elles connaissent leur histoire et la
géographie de leur localité. La toponymie peut bien aider
à l’atteinte de cet objectif.
Naturellement une telle étude soulève un certains
nombre de questions à savoir quelle signification ces
populations donne-t-il au nom de leur village ? Quelle
est l’origine de cette appellation ? Le nom originel a-t-
il subit une altération sémantique ? Une classification
des noms est-elle possible ?
Un tel questionnement nous amène à revisiter certains
concepts comme la langue, l’ethnie, la culture et les
stratégies de mise en valeur traditionnelle, mais aussi
sur les possibles interactions entre ces variables. En
effet c’est un fait avéré qu’aujourd’hui que les
pratiques culturelles, les modes de vie et les traditions
sont spécifiques à chaque groupe ethnique qui par
54
ailleurs se particularise par sa langue. La compréhension
de celle-ci permet de saisir la signification des noms
des lieux et de déceler les altérations sémantiques pour
étudier leurs transformations.
A travers cette étude toponymique de la communauté rurale
de DIOSSONG, nous espérons identifier les premiers
occupants dans les différents villages puisqu’en Afrique
en général et au Sénégal en particulier, l’appellation
du village cherche toujours à établir une relation entre
le territoire, la terre et le groupe qui l’occupe.
HYPOTHESES
Ainsi à travers cette étude nous essayerons de vérifier
les hypothèses suivantes :
- La compréhension de l’histoire et de la géographie de
la localité est bien possible grâce à la toponymie.
Ce qui fait de celle-ci une source d’information
inestimable pour les travaux de recherches et les
agents de développement intervenant dans la
localité.
- La toponymie peut-être un outil au servir au
développement durable en sensibilisant les
populations à la sauvegarde de leur richesse
culturelle en vue d’une meilleure préservation de
leur environnement parce que c’est à travers
54
uniquement la mémoire collective et la culture que
les hommes pourront s’épanouir.
OBJECTIFS
Les objectifs visés par cette étude sont :
1.Etudier la toponymie des villages
2.Déterminer la signification des noms
3.Identifier les auteurs de ces noms de villages
4. Classifier les noms des localités.
METHODOLOGIE
La vérification de nos hypothèses de recherche et
l’atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés, nous
a amené à revisiter les modèles et les théories de mise
en valeur traditionnelle chez les sérères et les wolofs
dans le bassin arachidier. Cette recherche est sous-
tendue par des préoccupations précises. En fait il
s’agissait pour nous d’essayer de comprendre comment les
stratégies de mise valeur traditionnelles peuvent-elles
dictées l’appellation des villages et quelle relation
peut-on établir entre la culture ethnique et la toponymie
des villages. Cela nous a permis de recenser les écrits
sur la question.
Ensuite la collecte d’informations nous a amené à
s’entretenir avec des personnes ressources qui
54
bénéficient d’une certaine expérience sur la question.
Nous profitons de cette occasion pour remercier tous les
collègues de la cellule d’histoire et de géographie du
Lycée Mame Cheikh de Tambacounda pour leur aide. En effet
ils nous ont beaucoup aidés dans la méthodologie de
recherche et d’enquête de terrain, leurs critiques et
leurs suggestions nous ont été d’un grand apport. Il en
de même pour M. Faye secrétaire général de la communauté
rurale de Diossong et de tous ces collègues qui n’ont pas
hésité à mettre à notre disposition les données
statistiques et cartographiques de la communauté rurale.
Nous tenons aussi à leur signifier que leurs expériences
et leurs connaissances de la localité qu’ils ont bien
voulu partager avec nous, ont été d’un grand secours pour
la réalisation de ce travail.
En fin la dernière étape de cette collecte d’informations
est l’enquête de terrain. Elle s’est fait suivant une
fiche d’enquête qui cherchait à recueillir des
informations d’abord sur l’informateur et des questions
ayant trait à l’étude toponymique. Durant les enquêtes de
terrain ce sont les chefs de village qui ont été
interrogés. Nous tenons ici à leurs adresser nos sincères
remerciements.
54
Ces informations une fois recueillies nous ont permis de
réaliser l’étude toponymique des villages de la couronne
centrale de la communauté rurale de DIOSSONG.
BIBLIOGRAPHIE COMMENTEE
La recherche documentaire nous a amené à consulter
certains ouvrages et mémoires traitant de la question de
toponymie.
L’article de Aicha Bouroumi intitulé la toponymie : outil
culturel pour le développement durable en méditerranée et dans les
zones fragilisées le domaine libyco-berbère publié en novembre
2003 traite de l’intérêt de l’étude toponymique dans
le développement durable. En effet selon l’auteur la
toponymie est une science auxiliaire de l’histoire
qui étudie des phénomènes géographiques. De ce fait
elle peut servir de hiatus entre les deux
disciplines. En sus de cela elle est aussi un outil
de développement et peut aider à reconstituer la
chaîne de l’histoire humaine.
La production de Marc Erié Gruenais titré Territoire
autochtone et mise en valeur des terres a permis de cerner les
rapports entre les hommes et l’organisation spatiale
à travers l’étude du foncier rural en Afrique.
Assurément la terre selon le droit coutumier est une
propriété collective. L’exploitant n’a qu’un droit
54
d’usage et tout accès à celle-ci suppose la
reconnaissance de l’autorité locale détenu par le
doyen du groupe, le plus souvent le premier occupant.
Le livre Toponymie : Méthodes d’enquête de Jean POIRIER de
l’université du Québec publié en 1965, 165p ; a
permis de dégager les objectifs de l’étude
toponymique. Celle-ci cherche surtout à connaitre la
signification et l’origine des noms ainsi que leurs
transformations. Cet ouvrage se termine par des
conseils pratiques sur les méthodes d’enquêtes en
étude toponymique. Selon POIRIER pour réussir son
enquête il fait bien choisir ses informateurs, ainsi
que les items à consigner sur la fiche d’enquête.
Le fascicule de Gaston DESLANDES intitulé Eléments de
toponymie générale traite de la science toponymie telle
que conçue par l’IGN (institut géographique national
de France). Dans ce document DESLANDES fait une
description détaillée des méthodes et techniques de
recherche en toponymie utilisées par l’IGN.
Le Plan de développement local élaboré en 2007 dans
la communauté rurale de DIOSSONG nous a fourni les
éléments cartographiques et les indicateurs
démographiques dont nous avions besoins pour cette
étude. Ce document fut en réalité une source
54
d’informations précieuse quand il s’est agit pour
nous de faire l’état des lieux de la localité.
I. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE
Située dans le département de FOUNDIOUGNE dans la
région de FATICK, la communauté rurale de DIOSSONG qui
couvre une superficie de 376 km² se trouve dans la partie
Sud de l’arrondissement de DJILOR dont elle relève et
occupe près de 40 % de sa superficie. Elle partage
l’arrondissement avec la seule Communauté Rurale de
DJILOR.
Le relief est caractérisé par une micro topographie
accidentée, correspondant à une série de bas-fonds,
localisée dans les zones de vallées situées dans les
parties Centre-Nord et Est de la Communauté rurale. Une
autre zone dépressionnaire, abritant d’importants bas-
fonds, est localisée vers la partie Sud-ouest de la
Communauté rurale.
Les vastes plaines qui caractérisent le terroir dans sa
majeure partie, d’Est en Ouest sont le domaine des
grandes cultures.
La communauté rurale de Diossong compte 37 456
habitants répartis sur 98 villages officiels et 10
hameaux. Elle a une densité moyenne de 100 habitants
environ au km².
54
Les populations accèdent difficilement aux services
sociaux de base comme :
- la santé, l’hygiène et l’assainissement,
- l’éducation dans toutes ses formes,
- l’hydraulique villageoise ou l’accès à l’eau potable,
- l’électrification rurale,
- les routes, autres voies de désenclavement et moyens de
communication,
- la situation des groupes cibles vulnérables,
La population est composée essentiellement de Ouolofs
(49%), Sérères (42%), Peuls (5%) et autres minorités
(3%).
Elle est dans une grande majorité constituée de
musulmans (plus de 95%) et de chrétiens que l’on retrouve
surtout chez les sérères
La population s’active essentiellement dans l’agriculture
et dans l’élevage ; on y distingue aussi des pêcheurs
localisés dans la zone de Tallène.
Cette présente étude concernera les zones de
Diossong et de Diagane situées au centre ouest de la
communauté rurale qui forment la couronne centrale de la
communauté rurale soit une étude toponymique de 37
villages.
54
ii. ETUDE TOPONYMIQUE DE LA ZONE DE DIOSSONG
1.Le village DIOSSONG
C’est le chef-lieu de la communauté rurale de DIOSSONG.
Ce village fut fondé par les sérères qui l’ont appelé
« NDIOSSOKH » c'est-à-dire déplaçons-nous. Cette
appellation sera altérée par l’actuelle ethnie qui habite
la localité les wolofs en DIOSSONG. Ces sérères en
immigrant se sont établis à NDIAFFE NDIAFFE et ont
abandonné le village aux mains des wolofs qui eux
viennent de Nioro du Rip.
2.le village de KEBE COUDE
L’appellation vient des colons français qui l’ont désigné
KEBE COUDE qui signifie « Kebe des cordonniers » pour le
distinguer du village voisin KEBE ANSOU. Les fondateurs
du village sont de l’ethnie wolof et viennent de NDIMB
TABA dans le Nioro.
3. Le village de DAROU SADER KHOUMA
C’est un talibé de Serigne Touba, Sader Khouma qui après
ces études auprès du saint a fondé ce village. Darou est
un nom d’origine Arabe qui signifie maison.
54
4.Le village de KEUR KHALIFA
C’est KHALIFA SYLLA venant du village de PROKHANE qui a
créé ce village et lui a donné son nom. Donc
l’appellation keur Khalifa signifie la maison de Khalifa
ou chez Khalifa.
5.Le village de KEUR ELIMANE AICHA
Comme les fondateurs de Kébé Coudé, Elimane Aicha vient
de NDIMB TABA. Il a créé ce village et lui a donné son
nom. Le supplétif du nom Aicha vient de sa mère. C’est
une pratique courante chez les wolofs qui pour distinguer
les fils d’un père polygame complète par le nom de la
mère celui des enfants.
6.Le village de KEUR FAFA WELLY
Un migrant du nom de Fafa Welly venant du village de Keur
Baka a fondé ce village et lui donné son nom.
7.Le village de KEUR SETTE NIAKOUBA
Venant de Medina Sabakh, Sette Niakhouba s’installe
d’abord à Diossong avant de fonder un village auquel il
donne son nom.
8.le village de THIAKHO MALAYINE
54
Le nom de ce village vient de son fondateur MALAYINE
SAKHO, un cultivateur venu de keur Alassane du RIP. C’est
le village de la famille des SAKHO.
9.Le village de MBOWENE SOULEYE
Omar Mbow en fondant ce village lui a donné le nom de son
cousin Souleye. Contrairement aux appellations qu’on a
étudié jusque là, le nom du village est composé d’un
radical Mbow qui désigne le nom de famille du fondateur
et d’un suffixe « ene » pour signifier « chez les Mbow »,
à ce mot on rajoute le nom du chef de famille.
10. le village de NGAYENE DAOUR
En 1901 Daour GAYE fonde ce village. Le nom de ce
village signifie donc le village des GAYE fondé par
Daour. Les premiers habitants sont issus de Ngayène
Sabakh dans le département de NIORO.
11. Le village THIAMENE BIRANE
C’est le village de la famille des Thiam fondé par Birane
Thiam. Le fondateur vient de Sokone
12. Le village de NDIAFFE NDIAFFE
54
Ici c’est le prénom qui a été retenu pour nommer le
village. Le fondateur est Diaffé Sarr qui s’est déplacé
de Diossong avec sa famille pour créer ce village. Ce
type d’appellation qui signifie ceux de Diaffé est
courant dans la région sénégambienne surtout chez les
sérères. En effet ce nom consiste en une répétition d’un
nom ou d’un caractère du groupe ethnique pour désigner le
plus souvent les habitants d’une région. C’est le cas des
habitants du SINE appelés SINE-SINE.
13. Le village de NDIAYE NDIAYE WOLOF
Le village est habité par les wolofs d’où le complément,
mais il n’est pas fondé par ces derniers. L’existence
d’une population sérère nous fait penser que ceux-la sont
les fondateurs. C’est par la suite que les wolofs devenus
plus nombreux se sont l’appropriés. S’ils étaient les
fondateurs ils l’auraient sûrement désigné Ndiayène comme
on en trouve dans le Nioro.
14. le village de KEUR LAYINE FATIM
Avant d’être ainsi nommé, le village était appelé KEUR
LAYINE DOUBALI. « Doubali » est une plante qui sert d’arbre
à palabres dans la localité. Ce nom fut abandonné au
profit du nom du fondateur Layine fils de Fatim.
54
15. Le village de PASSY ALY DIE
Dans la zone le mot « PASSY » est utilisé pour designer
habitation donc c’est le village de ALY DIE TOURE. Celui-
ci a fondé le village en 1948.
III. ETUDE TOPONYMIQUE DE LA ZONE DE DIAGANE
1.Le village de NDRAME KEUR TAMSIR KHODIA
Le nom du village est composé de deux appellations.
Ndramé signifie chez la famille Dramé à cela on a ajouté
la maison de Tamsir Khodia comme pour s’approprier
davantage du terroir. Ici on est en face de deux
pratiques culturelles différentes celui des wolofs qui
désignent le nom de leurs villages par le prénom du chef
de famille, et celui du nom de famille Dramé qui n’est
pas wolof mais plutôt Manding qui n’utilise que le nom de
famille.
2.Le village de NDRAME MACOUMBA
Anciennement appelé GUEDIANE du nom d’un arbre très
répandu dans la localité, le village a par la suite pris
le nom de son fondateur Macoumba Dramé.
3.Le village de THIANDA CISSE
54
Le fondateur Modou Cissé du village est venu de Keur
Elimane. Interrogé le chef de village Keba Cissé dit
qu’il est wolof. Mais le nom du village qui n’entre pas
dans la moule toponymique des villages wolof nous fait
penser que le fondateur est de l’ethnie Manding avec le
patronyme Cissé. Cette thèse est renforcée par le fait
que le chef du village n’a pas pu nous donner une
explication satisfaisante de la signification du nom
Thianda.
4.Le village de PASSY MBITAYENE
Anciennement appelé Passy « TEGG » c'est-à-dire chez les
forgerons. Mais aujourd’hui ce nom est interdit par les
habitants du village qui préfèrent qu’on nomme leur
village Passy Mbitayene c'est-à-dire chez les Biteye (nom
de famille wolof).
5.Le village de LOUMENE
C’est un cultivateur venant de Keur Abdou Fana du nom de
Souleymane LOUM qui a fondé le village qui fut nommé chez
les Loum de la famille de Souleymane.
6.Les villages de NDIAKHA YOUSSOUF et de NDIANKHA ALY
54
Ce sont les villages de la famille des Diankha, fondés
par Yousouf et Aly Diankha. Ce sont deux frères qui ont
quittés le village de Guissane dans le département de
Kaffrine et ont crée ici deux villages Ndiankha Aly et
Ndiankha Youssouf.
7.les villages de KEUR BABOU COUMBA et de KEUR BABOU
KANY
Deux frères Babou Coumba et Babou Kany ont quitté Ndimb
Taba en passant par Keur Elimane, ont crée deux villages
auxquels ils ont donné leurs prénoms.
8.Le village de KEUR MALAW
MALAW DIAO a fondé ce village et lui a donné son nom.
9.Le village de KEUR OMAR DIOULLI
Omar Diouli Diao a quitté la maison de son frère MALAW
DIAO et a fondé ce village auquel il a donné son nom.
10. Le village de KEBE ANSOU
Venant de Keur Moussa dans le département de Nioro, Ansou
Kébé fonda ce village et lui donna son nom.
11. Le village de NDIOURBEL
54
C’est le village de la famille Ndour fondé par BARRO
NDOUR. Les habitants sont des wolofs bien que le
fondateur soit un SERERE. L’influence wolof pourrait
expliquer l’appellation NDIOURBEL puisque en pays SERERE
on aurait préféré NDOUR NDOUR par répétition du
patronyme.
12. Le village de THIOUROUM
Le nom de ce village vient de la déformation du nom de
son fondateur, un SERERE appelé THIOUKOULI CAMBE.
13. Le village de DIAGANE SADER
Le nom du village vient du mot wolof « DIAG » qui désigne
un tas de mil. Le fondateur MATAR KALA DRAME est
originaire de NDRAME DIMB dans le département de Nioro.
14. Le village de KEUR MOTH FANA
Anciennement appelé Santhie MOTH qui signifie le nouveau
village de Moth, le village a finalement prit le nom de
son fondateur MOTH FANA CISSE.
15. Le village de DAROU KEUR MOR KHOREDIA
C’est un talibé de Serigne Touba qui a fondé ce village
et lui a donné son nom. Le nom du village est formé du
mot arabe « Dar » qui signifie maison et de la toponymie
54
habituelle des villages wolof de la zone « Keur » maison
suivit du prénom du fondateur.
16. Le village de KEUR MBANGOU
Le village est fondé par MBANGOU CISSE qui lui a donné
son nom. Il est originaire de GOUYE MADI (Nioro). La
présence des wolofs de la famille MBENGUE nous fait
penser que MBANGOU pourrait être une déformation de ce
nom de famille.
17. Les villages de NDIAGNENE OMAR et de NDIAGNENE
YOUSSOUPHA
Deux frères maures youssoupha et Omar Diagne originaire
de NDIAGNENE département de KAFFRINE ont fondé deux
villages dans la localité. Le nom signifie chez la
famille DIAGNE. Pour distinguer ces deux villages on a
utilisé les qualificatifs wolofs « Gu mag » pour désigner
le village de Youssoupha et NDIAGNENE GOU NDAW pour le
village d’Omar Diagne. Mais aujourd’hui on préfère le nom
des fondateurs.
18. Le village de KEUR BIRANE KHOREDIA
Frère d’ALY DIE TOURE, BIRANE KHOREDIA fonde ce village
et son nom fut retenu pour le désigner.
54
19. Le village de KEUR ABDOU YACINE
Anciennement appelé DIOKOUL NDIAFFE du fait de sa
proximité avec NDIAFFE NDIAFFE village fondé par les
SERERE. En fait pour ces derniers le village est un
prolongement de NDIAFFE NDIAFFE, tandis que pour les
wolofs ces villages ne sont pas reliés tel est d’ailleurs
la signification de « Diokoul » en wolof. Ce nom sera
abandonné au profit du nom de son fondateur ABDOU FANA
TOURE.
20. Le village de KEUR BAKARY LY
Bakary ly le fondateur du village est originaire de Keur
Birane Khoredia. Il s’installa dans ce terroir et donna
son nom au village.
IV. CLASSIFICATION TOPONYMIQUE
L’étude toponymique portait sur les 37 villages de la
zone centre de la communauté rurale de DIOSSONG. Elle a
montré que l’essentiel de ces villages ont une
appellation à caractère humain qui renvoie au patronyme
du fondateur. Nonobstant cette remarque on peut
classifier les villages en fonction de leur toponymie :
- tous les villages dont leurs noms commencent par les
mots qui signifient maison ; « Keur » en wolof, ou
54
« Darou » en Arabe et « Passy » en Manding formeront le
groupe 1.
- Le groupe 2 sera composé des villages dont le nom est
formé du nom de famille occupant la première le
terroir suivit du suffixe « ene » pour signifier
l’appartenance du terroir à cette famille. A ces
villages on va ajouter tous les villages qui sont
désignés par le nom d’une famille.
- Et dans le groupe 3 nous y mettront le reste des
villages qui ont une toponymie qui n’a pas suivi ces
configurations ci-dessus nommées.
Tableau de classification toponymique des villages de la
communauté rurale de Diossong
Groupe Villages TotalGroupe
1
Keur moth Fana, Keur Babou, Keur Omar,
Keur Khalifa, Keur Elimane, Keur Fafa,
Darou Sader khouma, Keur Sette Niakhouba,
Passy Mbitayene, Passy Aly Dié, Keur
Layine, Keur Abdou Yacine, Keur Birane,
18
villag
es
54
Keur Mbangou, Darou Keur Mor Khoredia,
Keur Bakary Ly, Keur Abdou Fana ; Keur
MalawGroupe
2
Ndiankha Aly/ Youssouf, Kebe Coudé/Ansou,
Thiakho Malayine, Ngayène Daour, Thiamène
Birane, Ndramé, Loumene, Thianda Cissé,
Ndiagnene youssoupha/ Omar, Mbowène
Souleye
13
villag
es
Groupe
3
Diagane Sader, Ndiourbel, Thiouroum,
Diossong, Ndiaye Ndiaye wolof, Ndiaffé
Ndiaffé
6
villag
es
Diagramme circulaire des différents groupes toponymiques
rencontrés dans la zone étudiée
Dans la toponymie des villages du groupe 1, le chef de
famille ou le marabout fondateur du village cherche à
s’approprier les terres du village. Il est celui qui
détient l’autorité et le plus souvent le choix du chef de
54
village se fait dans sa famille. Son autorité reste
incontestée. Cette toponymie est la plus courante 48%
des villages dans la zone d’enquête l’appliquent. En
revanche dans le groupe 2 où on retrouve 35% des villages
enquêtés, la première famille qui occupe les lieux
s’approprie les terres au profit du groupe. Mais la
hiérarchisation des sociétés wolof fait que là aussi
l’autorité du chef de famille est reconnue d’où ce souci
de toujours ajouter au nom du village le prénom du chef
de concession. C’est ainsi qu’on a NDIANKHA ALY, MBOWENE
SOULEYE….
Mais cette pratique a aussi le mérite de faciliter la
distinction des villages fondés par les membres de la
même famille surtout pour l’administration. Ainsi les
villages fondés par les membres d’une même famille vont
se distinguer par les chefs de concession qui les ont
créés.
Alors que dans le premier groupe ce problème ne se posera
puisque ici on a déjà opté pour le prénom du chef pour
designer le village. C’est l’exemple de Keur Mbangou,
Keur Moth FANA, Keur Mor Khoredia qui sont tous des
villages créés par la famille Cissé. Mieux les familles
Touré et Dramé sont aussi très répandues dans la
localité, mais à travers uniquement la toponymie des
54
villages on ne peut se rendre compte de leur dispersion,
ni décelé les liens de parenté qui les unissent.
Les villages du troisième groupe (16%) ont une toponymie
qui ne suit pas le schéma habituel. C’est le cas le plus
souvent des villages sérères ou fondés par les SERERES.
La toponymie qu’on y trouve c’est la répétition du nom de
famille comme c’est le cas de NDIAYE
NDIAYE WOLOF ou du prénom du père fondateur comme à
NDIAFFE NDIAFFE.
Dans certains cas c’est une déformation d’une expression
(DIOSSONG) ou une altération sémantique du nom du
fondateur (THIOUROUM et NDIOURBEL).
Ce choix toponymique s’explique par le fait que chez les
SERERES où les sociétés sont égalitaires et la terre
sacralisée, on ne peut pas se l’approprier. Elle est le
bien de la communauté. Par contre pour les wolof bien que
la terre soit un bien collectif, cette ethnique voit en
elle une richesse dont il faut se l’approprier et y
exercer son autorité. Et le plus souvent chez les wolof
quand la famille s’élargit et que la pression devient
trop forte sur la ressource un chef de ménage quitte le
groupe pour aller s’installer ailleurs en fondant un
nouveau village.
Les villages wolofs dans le groupe 3 sont presque
inexistants. Néanmoins on peut citer le cas de DIAGANE où
54
une spécificité du terroir est prise pour désigner le
village, Guediagne et Keur Layine DOUBALI où des plantes
sont utilisées pour nommer des villages. Mais le souci de
s’approprier le terroir au profit du groupe reste
omniprésent. C’est pourquoi à Diagane on a ajouté le nom
de son fondateur Sader, à Guediane le nom est abandonné
encore au profit du père fondateur pour devenir Ndramé
Macoumba et Keur Layine Doubali est devenu Keur Layine
Fatim.
CONCLUSION GENERALE
Cette étude a montré qu’à travers la toponymie les
populations de la couronne centrale de la communauté
rurale de DIOSSONG cherche à établir leur propriété sur
le terroir. En effet selon le droit coutumier la terre
est un bien collectif et que l’individu n’a qu’un droit
d’usufruit. A cet effet tant qu’il l’occupe et le met en
valeur son autorité n’est pas contestée d’où ce souci de
se l’approprier non seulement par l’exploitation des
ressources qui s’y trouvent, mais aussi à travers la
toponymie. Donner un nom c’est établir son autorité mais
aussi donner une identité. C’est pourquoi l’établissement
dans un terroir déjà occupé suppose toujours la
reconnaissance de l’autorité préétablie.
54
Le peuplement de cette zone est le résultat de mouvements
migratoires. En effet les habitants de la zone à part la
population sérère disent être originaire du département
de NIORO et de KAFFRINE. Ainsi la conception différente
que les wolofs et les sérères ont de la terre se comprend
aisément. Si pour les sérères la terre est un bien
collectif et sacré, la toponymie de leur village ne
cherche pas à établir une autorité ni une propriété sur
elle. En revanche pour le chef de famille wolof ou même
le marabout la terre est une ressource, une richesse
inestimable. Mieux l’introduction de la culture
arachidière par la colonisation a contribué à la
désacralisation de celle-ci pour en faire une simple
ressource à exploiter et à mettre en valeur. A cela on
peut ajouter que la monoculture de l’arachide a
essoufflé les terres dans les départements de Nioro où la
pression sur la terre devenait inquiétante. Ces facteurs
conjugués ont poussé beaucoup de familles wolofs a migré
vers cette partie septentrionale du NIOMBATO réputée
pluvieuse où ils se sont appropriés les terres vacantes
en y établissant leur autorité à travers la toponymie.
A la lumière de ces informations une autre pratique qu’on
retrouve souvent dans le paysage agraire de la zone
s’éclaire. Quand la pression sur la ressource devient
trop forte du fait de la croissance démographique chez
54
les wolofs c’est un marabout ou un chef de ménage qui
quitte le village et en fonde un autre. Par contre chez
les sérères face à une telle menace c’est toute la
communauté qui se déplace pour trouver des terres plus
fertiles. C’est exactement ce qui s’est passé à DIOSSONG
village qui fut créé par les serères dont une partie de
ces habitants ont fondé le village de Ndiaffé Ndiaffé.
Ainsi la connaissance de la toponymie dans cette zone
permettra de redynamiser l’activité agricole dans la
zone. Ce sont des agriculteurs originaires du département
de Nioro et de Kaffrine qui s’y sont fixés et exploitent
cette zone. Les appellations de cette zone ont toujours
cherché d’ailleurs à établir un lien de parenté avec
leurs villages d’origine. On retrouve souvent la même
toponymie dans toute cet espace. Cela peut être une bonne
base pour une coopération entre collectivités locales,
qui bien que séparées administrativement garde de
profonds liens de parenté. La stratégie qui consiste à
réorganiser les collectivités locales sur la base de ces
liens historiques serait une bonne option pour un
aménagement du territoire plus efficient.
54
Fiche d’Enquête
Thème : Etude toponymie de la communauté rurale de
DIOSSONG
I. Informateur :
Prénom……………………………………..Nom……………………………………………Age………
Ethnie……………………………..Qualité……………………………………
Profession…………………………Adresse………………………………………………
téléphone……………………………………………………………………….………….
II. Etude toponymique :
54
1.Quel est le nom du
village ?............................................
.................
2.Que signifie ce
nom ?................................................
......................
3.D’où vient cette
appellation ?........................................
...................
4.Le nom a—il subit une altération sémantique ? OUI
NON
5.Si OUI Nom originel ……………………….Nom
Actuel………..........
6.Y a-t-il dans le voisinage un nom de village
semblable ?
OUI NON
7.Si OUI. Quel (s) village (s)………………………………………………………....
8.D’où vient le fondateur du
village ?............................................
......
9.De quelle ethnie sont-ils ? Wolof- Sérère- Peul-
Bambara- Autres
10. Le fondateur du village a-t-il des liens de
parenté avec les fondateurs des villages voisinant ?
OUI NON
54
Thème : La culture sous pluie : de la monoculture à la
diversification
LECON 3 : LES CONDITIONS PHYSIQUES (topographiques, climatiques,
édaphiques, hydrographiques, biogéographiques)
54
I. Déterminations initiales
1.Place de la leçon
Cette leçon est la troisième du programme de la classe de
sixième essentiellement axé sur le milieu proche de
l’élève. Ici ce milieu est le bassin arachidier, un
espace géographique qui occupe toute la partie centrale
du Sénégal. Cet espace se particularise par la
monoculture de l’arachide même si des efforts sont
entrain d’être faits ces dernières années pour une
diversification des cultures.
2.Intérêt de la leçon
A travers l’objectif qu’on s’est fixé à savoir la
connaissance des conditions physiques du milieu naturel,
nous montrerons aux élèves la spécificité de leur région
géographique. En effet si l’on sait que les conditions
physiques peuvent créer des conditions d’occupation
particulières, les élèves pourront identifier leur milieu
proche des autres régions du pays. Une telle compétence
permettra de prendre conscience de la complémentarité des
différents écosystèmes du Sénégal et de faire preuve de
respect vis-à-vis de son environnement.
3.Crédit horaire
Bien que le crédit horaire ne soit précisé dans le
programme dont nous disposons (programme consolidé de
géographie, octobre 2006), il nous semble tout à fait possible
54
de dérouler cette leçon en deux heures de temps. En fait
il ne faut pas perdre de vue que les élèves connaissent
beaucoup d’aspects physiques de leur milieu proche. Et la
leçon sera l’occasion pour eux de revisiter toutes les
facettes de leur environnement physique. Ce qui à coup
sûr suscitera des débats passionnants.
54
Fiche Pédagogique :
Leçon 3 : les conditions physiques (topographiques, climatiques, édaphiques, hydrographiques,
biogéographiques)
Objectif Général : Au terme de la leçon l’élève doit connaitre les conditions physiques du
bassin arachidier.
Objectifs Spécifiques :
1.Au terme de la séance l’élève sera capable de citer les unités du relief du bassin
arachidier
2.Au terme de la séance l’élève sera capable d’identifier les types de climat du bassin
arachidier
3.Au terme de la séance l’élève sera capable de reconnaître les types de sols du bassin
arachidier
54
4.Au terme de la séance l’élève sera capable de décrire la végétation du bassin
arachidier
5.Au terme de la séance l’élève sera capable de nommer les cours d’eau du bassin
arachidier
BIBLIOGRAPHIE :
1.Dictionnaire de Géographie : Yves Lacoste : de la géopolitique aux paysages,
Collection Armand Collins, 2003
2.Georges Rippstein, Alexandre Diouf, Male Sao : Développement des cultures
fourragères dans le bassin de l’arachide au Sénégal, ISRA-Dakar février 2004
3.Bocar diagana, Adrien Mankor, Cheikh S. Fall, Adama Gueye: Agriculture durable et
réduction de la pauvreté dans le basin arachidier du Sénégal, vol 6 numéro 5, 2008
54
4.Manuel pédagogique interculturel et pluridisciplinaire : Sénégal –Suisse, Janvier
2007, pp 56-67.
SUPPORTS :
1.Texte sur les spécificités du Bassin arachidier (source : Agriculture durable et
réduction de la pauvreté dans le basin arachidier du Sénégal, vol 6 numéro 5, 2008)
2.Carte du milieu physique du Sénégal : sécheresse et translation des isohyètes (source: J.
Leborgne IRD)
3.Carte du Profil météorologique du Sénégal 1961-1990 (source : FAO-CLIM)
4.Tableau récapitulatif du milieu naturel du bassin arachidier.
Chron
o
Objectifs Stratégies pédagogiques Supports Contenu
30mn Objectif Objectifs Part du Part de Doc 1 : Introduction :
54
Général Spécifiqu
es
prof. l’élève Texte
sur les
spécific
ités du
bassin
arachidi
er
Le bassin arachidier est la
région naturelle qui occupe
le centre du Sénégal sur
une superficie de 46 367
km². Elle s’étend de
Kebemer dans la région de
Louga au nord à la
frontière gambienne au Sud
et couvre la partie
orientale de la région de
Thiès, de l’intégralité des
régions de Fatick de
Kaolack, de Diourbel et de
Kaffrine. Le bassin
arachidier se caractérise
par la monoculture de
Connaitre
les
condition
s
physiques
du bassin
arachidie
r
1. Citer
les
unités du
relief
Expliq
uer la
notion de
milieu
naturel et
de milieu
proche
Distri
buer les
supports
Faire
lire le
texte à
deux
Déterminer
leur
milieu
proche :
le bassin
arachidier
Prendre
possession
du support
Lecture
attentive
du texte
Citer les
régions
54
élèves
Donner
les
régions
administra
tives
englobées
par le
bassin
arachidier
Résume
r les
spécifique
s
géographiq
ues du
administra
tives
englobées
par le
bassin
arachidier
Enumérer
d’autres
caractéris
tiques du
bassin
arachidier
à partir
du texte
Prise de
l’introduc
Doc 2 :
Carte du
milieu
physique
du
Sénégal
l’arachide et la richesse
de ces écosystèmes.
I. LE RELIEF
Les altitudes sont faibles
dans le bassin arachidier
et y dépassent rarement 50
m. en effet à l’exception
de la Thiès où elles font
128 m sur le plateau de
Thiès, le reste de cette
région est constituée de
plaines uniformes
traversées par les vallées
du Sine et du Saloum et des
54
bassin
arachidier
Ecrire
l’introduc
tion au
tableau
Faire
découvrir
le grand I
aux élèves
Distri
buer le
support de
la carte
du relief
du Sénégal
tion sur
leur
cahier
Découvrir
le grand I
Prendre
possession
du support
Délimiter
le bassin
arachidier
Décrire le
relief du
bassin
arachidier
Prendre
nombreux marigots.
54
Faire
délimiter
par les
élèves la
région
étudiée
Dégage
r les
unités
topographi
ques
rencontrée
s dans le
bassin
arachidier
Faire
le résumé du
grand I
54
découvrir
le grand
II aux
élèves
30mn
2.
Identifie
r les
types de
climat
Demander
aux
élèves
d’identi
fier les
saisons
climatiq
ues de
leur
région
Demander
aux
Découvrir
le grand
II
Identifier
les
saisons
climatique
s de leur
région
Caractéris
er ces
saisons
Doc 1 :
Carte du
milieu
physique
du
Sénégal
Doc 2 :
Carte du
profil
climatiq
II. LE CLIMAT
Cette région connait un
climat sahélien à deux
saisons contrastées :
- Une saison sèche
d’octobre à juin avec
une circulation des
vents dominée par les
alizés continentaux
appelés Harmattan qui
souffle à partir du
nord.
54
élèves
de
donner
les
différen
ces
entre
ces deux
saisons
Détermin
er la
températ
ure et
la
pluviomé
trie
Prendre
possession
du support
sur le
profil
climatique
du bassin
arachidier
Etudier la
répartitio
n des
températur
es et de
la
pluviométr
ie dans le
ue du
Sénégal
- Une saison des pluies
de juin à octobre.
Durant cette saison la
mousson souffle à
partir du sud et
apporte la pluie. La
moyenne annuelle des
précipitations est de
700 mm/an et les
températures varient
entre 28˚ C et 34˚ C.
54
durant
chaque
saison
Faire
découvri
r le
grand
III
bassin
arachidier
Découvrir
le grand
III
15mn 3.
Reconnaît
re les
types de
sols
Demander
aux
élèves
d’énumér
er les
sols
qu’on
Enumérer
les types
de sols
rencontrés
dans leur
localité
Différencie
III.SOLS ET VEGETATION
On rencontre quatre types
de sols dans le bassin
arachidier.
Les sols ferrugineux
lessivés appelés sols
54
trouve
dans
leur
Localité
Et
comment
peuvent-
ils les
distingu
er
r ces types
de sols
Localiser
les
emplacement
s de ces
types de
sols
« DIOR »
Les sols ferrugineux
non lessivés. Ce sont
les « DECK »
Les sols Halomorphes
avec une forte teneur
en sel : les TANNES
Les sols hydromorphes
qui sont localisés au
niveau des zones
inondées comme les
rivières et les
rizières.
Ces sols portent deux types
de végétations :
- Au nord on a le domaine
15mn 4.
Décrire
la
végétatio
Quelles
sont les
espèces
végétale
Enumérer
les types
d’arabes et
d’herbes
54
n s, les
élèves
rencontr
ent-ils
dans
leur
milieu ?
A quels
endroits
les
trouvent
-ils ?
Quelles
sont ces
espèces
?
rencontrés
dans leur
milieu
Identifier
leur
emplacement
Nommer les
espèces
végétales
rencontrées
Découvrir
le grand IV
sahélo soudanien avec
des arbres comme le
Faidherbia Albida (KAD)
et des combrétacées.
- Au sud où la
pluviométrie est assez
satisfaisante est
localisée le domaine
soudanien avec une
végétation arborée de
Khaya Senegalensis avec
un tapis herbacé très
dense.
54
Faire
découvri
r le
grand IV
30mn 5. Nommer
les cours
d’eau
Quels
sont les
points
qu’on
trouve
dans la
localité
L’eau est
–elle
salé ou
douce ?
Donner les
cours d’eau
de leur
localité
Déterminer
la nature
de ces
cours
(sont-ils
saisonniers
ou
Doc 3 :
Tableau
récapitu
IV. L’HYDROGRAPHIE
Les plaines du bassin
arachidier sont drainées
par un réseau
hydrographique très dense
en saison des pluies. A
côté des estuaires du Sine
et du Saloum, la région
compte de nombreux marigots
alimentés par les eaux de
ruissellement. Ces points
54
L’écoulem
ent est-
il
pérenne
ou
intermitt
ent ?
Nommer
ces
cours
d’eau.
pérennes ?)
Localiser
ces cours
d’eau
Nommer-les
latif
des
données
environn
ementale
s
d’eau servent souvent
d’abreuvoir aux animaux
domestiques une bonne
partie de l’année.
CONCLUSION
Pendant très longtemps le
bassin arachidier grâce à
son milieu physique fut le
grenier du Sénégal. En
effet 70% des terres
cultivées s’y trouvent, ce
qui lui permet de produire
67% de la production
d’arachide et 66% pour le
54
mil.
Ces performances agricoles
la région le doit surtout
au dynamisme de sa
population composée
essentiellement de peuples
agriculteurs : wolof et
sérère.
54
Évaluation :
Sujet I :
Exercice 1 : Texte à trou : compléter ce texte par les
mots qui conviennent (8pts)
Le bassin arachidier est la région naturelle qui se
trouve au 1…………….du Sénégal. Il couvre une superficie
de 2………….. et s’étend sur 3……….régions administratives
du pays. L’altitude la plus élevée du bassin
arachidier se trouve dans la région de 4…………à 5………..m
d’altitude. Les principaux cours d’eau sont les
estuaires du 6………… et 7…………. Et on y trouve 8……..types
de sols.
Exercice 2 : Répondez par Vrai ou Faux (6pts)
1.Au nord du bassin arachidier est localisé le
Khaya Senegalensis.
2.Un tapis végétal de combrétacée est localisé au
nord du bassin arachidier
3.La pluie est plus importante au nord du bassin
arachidier qu’au sud où il pleut moins.
4.Les sols hydromorphes sont aussi appelés les
vertisols.
54
Exercice 3 : Questions de cours (6pts)
1.Citez les différents types de sols qu’on trouve
dans le bassin arachidier. (2pts)
2.Décrivez la végétation dans le bassin arachidier.
(2pts)
3.Quelle est la différence entre :
a. un sol hydromorphe et un sol Halomorphe (1pt)
b.Un sol « DIOR » et un sol « DECK » (1pt)
Sujet II :
Dressez le tableau récapitulatif du milieu naturel du
bassin arachidier.
CORRIGE
Sujet I :
Exercice 1 : Texte à trou
1. Centre 2. 46 367 km² 3.Six 4. Thiès 5.
128m 6.Sine 7. Saloum
8. Quatre
Exercice 2 : Vrai ou faux
1.Faux
2.Vrai
54
3.Faux
4.Vrai
Exercice 3 : Questions de cours
1.Les différents types de sols qu’on trouve dans le
bassin arachidier sont :
Les sols ferrugineux lessivés appelés sols
« DIOR »
Les sols ferrugineux non lessivés. Ce sont les
« DECK »
Les sols Halomorphes avec une forte teneur en
sel : les TANNES
Les sols hydromorphes qui sont localisés au
niveau des zones inondées comme les rivières et
les rizières.
2.La végétation du bassin arachidier est ainsi
disposée :
- Au nord on a le domaine sahélo soudanien avec des
arbres comme le Faidherbia Albida (KAD) et des
combrétacées.
- Au sud où la pluviométrie est assez satisfaisante
est localisée le domaine soudanien avec une
végétation arborée de Khaya Senegalensis avec un
tapis herbacé très dense.
3.
54
a.Le sol halomorphe est salé tandis que celui
hydromorphes est inondé
b.Le sol DIOR est ferrugineux et lessivé par
contre le sol DECK est ferrugineux et non
lessivé.
Sujet II :
1.Tracer correctement le tableau (Cf. au support du
cours) en respectant les variables indiquées dans
les lignes et les colonnes (8pts)
2.Remplir correctement le tableau (8pts)
3.Respectez l’orthographe des mots (2pts)
4.Présentation (2pts)
SUPPORTS :
Thème : Le bassin arachidier : La culture sous pluie :
de la monoculture à la diversification.
54
Document 1 :
Le Bassin arachidier (BA) constitue la principale
région agricole du pays. Dans son acceptation
traditionnelle, ce qui est appelé le «vieux Bassin
arachidier » couvre 5 régions administratives (Louga,
Diourbel, Thiès, Kaolack et Fatick) se trouvant entre
les isohyètes 200 et 800 mm. Mais, un glissement
suivant un gradient Nord-Sud s’est opéré durant ces
dernières décennies pour englober une partie des
régions de Tamba et de Kolda. En termes de production,
le BA représente en moyenne 70% des surfaces
cultivées, 67% de la production d’arachide et 66% de
la production de mil sur le plan national (DAPS,
2005).
Bocar diagana ; Agriculture durable et réduction de la
pauvreté dans le basin arachidier du Sénégal, vol 6
numéro 5, 2008
54
Document 4 : Tableau récapitulatif des données du milieu naturel du bassin arachidier
Subdivisions
administrativ
es
Relief Pédologie Pluviométrie Végétation Hydrographie
Louga (dept de
Kebemer),
Thies,Fatick,
Kaolack,
Diourbel,
Kaffrine
Dunes
continental
es
Plateau de
calcaires
(Thiès)
Vasières
(mangrove
dans le
sine-
Saloum
Sols
ferrugineux
Sols
halomorphes
Sols
hydromorphe
s
(vertisols)
Cuirasses
(plateaux)
Entre 300
et 800
mm/an
105 à 120
jours de
pluies/an
Steppe et
savane
arborée
Mangrove
dans les
estuaires
Nappes
superficiel
les
(marigot)
Estuaire
s du Sine
et du
Saloum