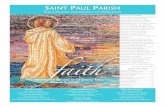Toulouse. Les Gaulois de Saint-Roch
Transcript of Toulouse. Les Gaulois de Saint-Roch
Midi-Pyrenn^
Tou
PAGE DE D R O I T E . La sépulture e n cours d e f o u i l l e après l e prélèvement d e s o f f r a n d e s . P h o t o © Ph G a r d e s . I N R A P
use, , Les Gaulois de Saint-Roch U n e f o u i l l e préventive menée à b i e n e n 2 0 0 6 d a n s l ' e m p r i s e d u s i t e g a u l o i s d e S a i n t - R o c h , a u s u d d e T o u l o u s e , a révélé d e u x e s p a c e s b i e n différenciés. L u n d ' e u x r e c e l a i t l ' u n e des r a r e s sépultures g a u l o i s e s retrouvées d a n s c e t t e ville ; e l l e présente des caractér i s t i q u e s p e u c o m m u n e s . Par P h i l i p p e G a r d e s e t P a t r i c e G e o r g e s
A fouille préventive de cette étroite bande de terre de 47 x 17 m environ Isous la direction de Ph. Gardes, INRAP), au 51 rue Saint-Roch,
a donné des résultats tout à fait inattendus. Le diagnostic, mené quelques mois auparavant, avait révélé des structures liées à un probable habitat, concentré en bordure de la rue Saint-Roch. Les vestiges se répartissent de manière assez homogène dans l'ensemble de l'emprise et témoignent d'une organisation rationnelle de l'espace. Deux zones d'occupation bien différenciées ont été mises en évidence : un secteur d'habitat d'un côté, et de l'autre, une vaste dépression correspondant à une zone d'extraction de sable, postérieurement convertie en dépotoir. L'intérêt de cette opération réside également dans la découverte de deux squelettes humains, dont l'existence pouvait difficilement être soupçonnée dans ce secteur théoriquement dédié à l'habitat.
L'agglomération gauloise de Saint-Roch La parcelle concernée, couvrant une surface de 775 m^ est située dans l'emprise du site gaulois de Saint-Roch, aujourd'hui considéré comme une agglomération de plaine de 80 à 100 ha par la plupart des chercheurs. Le site est connu depuis le XVII^ siècle, mais ce sont les recherches récentes qui ont apporté de nouveaux éléments sur sa structuration. La plupart des opérations ont révélé la présence de fossés, qui semblent appartenir à un réseau mis en place au cours du Ih siècle avant notre ère et subir au moins une réforme à la fin du 11̂ ou au
début du siècle avant notre ère (51 et 53-55 rue Saint-Roch, 129 avenue Jules Julien). L'autre enseignement tiré de ces recherches concerne la densité d'occupation. Le site se caractérise, en effet, par la juxtaposition d'espaces vides et de zones d'occupation denses entre la Garonne et la rue Saint-Roch. Au-delà vers l'est, les vestiges apparaissent beaucoup plus dispersés. Ainsi , les estimations généralement avancées concernant l'emprise du site doivent être sérieusement révisées. En réalité, la zone densément occupée ne couvre pas plus de 30 à 40 ha.
Des traces d'aménagements importants Le décapage a permis de mettre en évidence deux secteurs d'occupation aux fonctions complémentaires. Une partie des vestiges correspond probablement au soubassement d'un bâtiment s'inscrivant dans un rectangle assez régulier de 4,10 x 3 m. La couche est constituée de fragments d'amphores disposées surtout à plat et de gros galets calibrés, qui voisinent avec de gros tessons de panse de céramique, quelquefois écrasés en place. La densité de galets augmente en périphérie où ils sont associés à des demi-panses d'amphore couchées côte à côte. On peut déjà exclure la possibilité d'un niveau de circulation en raison de la position et du caractère peu fragmenté des éléments d'amphores. Il ne peut s'agir non plus d'un aménagement destiné à niveler le terrain compte tenu du soin apporté à la conception de la partie centrale et aux aménagements de bordure. En revanche, plusieurs indices vont dans le sens d'un radier de sol. La fouille
TOULOUSE
minutieuse a permis de mettre en évidence une étroite dépression linéaire, de 0,05 m de profondeur sur 0,10 à 0,15 m de large, localisée côté nord. Elle correspond peut-être à la fondation d'une superstructure qui se développe d'est en ouest sur 2,50 m de long. Le sol est flanqué au nord et au sud par deux alignements constitués de galets jointifs de petit module, ponctuellement associés à des tessons d'amphore. La chronologie d'occupation peut être fixée grâce à un mobilier abondant. Plusieurs catégories d'amphore figurent dans ce lot. Il s'agit d'exemplaires gréco-italiques avec un terminus post quem des années 150/140 avant notre ère. La vaisselle tournée présente un assortiment de formes typiques de la deuxième moitié du II* siècle av. J.-C. Un bord de pot à panse surbaissée renvoie même plus précisément au dernier quart de ce siècle. Un élément de vase en céramique peinte ne dépare pas dans ce contexte. Cette construction, partiellement conservée, est associée à un puits carré d'un mètre de côté environ. Il a été repéré, en surface, par une concentration de mobilier.
Au-delà, la construction donne sur une aire pavée de matériaux divers, identifiable à un sol extérieur qui s'étend sur au moins 5,80 m de large. Il pourrait aussi bien s'agir d'une cour que d'un axe de circulation.
Une fosse dans le sol Un autre secteur d'occupation situé plus au sud témoigne d'une fonction différente. Il s'agit d'une vaste zone probablement dédiée à l'extraction de sédiments, tout du moins dans un premier temps, ainsi que de plusieurs structures archéologiques associées et des excavations informes, plus difficiles à interpréter de prime abord. Au décapage, cette cuvette est apparue sous la forme d'une nappe de sable brun, légèrement plus sombre que l'encaissant et parsemée de mobilier archéologique en surface. Son contour est relativement régulier, excepté au sud où la bordure se révèle plus sinueuse. Les dimensions observées sont de 13,6 m environ du nord au sud, sur au moins 11 m d'est en ouest. La dépression offre un profil en légère cuvette. Un sondage réalisé dans sa partie sud a permis de mettre en évidence une série d'anomalies dans le substrat et dans la masse du remplissage de la cuvette. Même chose en bordure de la dépression, lors du curage définitif de la structure. Il s'agit de trous au contour irrégulîer, souvent très rapprochés, qui atteignent pour la plupart le substrat. Les plus importants ne dépassent pas 0,7 X 0,4 m de côté et 0,5 m de profondeur. L'hypothèse de chablis ayant été écartée par le géomorphologue L. Bruxelles (INRAP), l'irrégularité
CI-CONTRE. P l a n d'ensemble d e ta zone fouillée
au SI r u e Saint-Roch' en 200B. e>Ph. Gardes, INRAP.
LE SITE DE SAINT ROCH, DE LA DÉCOUVERTE AU SAUVETAGE
Connue de longue d a t e , ceUe agglomération gauloise s'est
révélée a u fil de nombreuses fouilles au XX* siècle. M a i s elle
est aujourd'hui menacée par l'urbanisation g a l o p a n t e de Toulouse.
Ce site, qui s'étend sur la plus basse des terrasses de la Garonne (aujourd'hui 7-8 m au-dessus de l'étiage), a été progressivement révélé depuis le début du XVII" siècle. Les premières véritables fouilles ont été pratiquées par Léon Joulin au moment de la construction de la Caserne Niel de 1901 à 1903. Si l'intervention n'a concerné que l'emplacement des fondations, elle a néanmoins mis au jour une centaine de structures, dont la majorité appartient à la fin de l'âge du Fer (puits et fosses essentiellement). Depuis, le développement urbain du secteur a engendré de nouvelles découvertes. Mais ce n'est que dans les années 1960 que les recherches de terrain ont repris. Une dizaine de puits et des structures associées, découverts fortuitement et menacés par des travaux, ont ainsi été fouillés par G. Fouet et son équipe en différents points du quartier. Les observations de G. Baccrabère, faites au hasard des travaux urbains, et les quelques fouilles de puits réalisées dans l'urgence par le Service régional de l'Archéologie (M. Vidal et B. Marty) ont complété la carte des découvertes dans les années 1970 et 1980. Jusqu'aux années 1980, les recherches archéologiques réalisées dans le quartier Saint-Roch se sont surtout focalisées autour des puits dits "funéraires". Ceci s'explique par les conditions de découverte et d'intervention. En effet, les vestiges sont apparus, la plupart du temps, à l'occasion de travaux urbains et, plus précisément, au moment des terrassements. L'intervention des archéologues s'est donc souvent limitée à fouiller les structures les plus profondes, seules épargnées.
Un des apports majeurs des fouilles récentes, menées désormais en amont des travaux et avec des moyens adaptés, est d'avoir permis de remettre ces puits dans leur environnement archéologique. L'étude spatiale des structures apparaît donc aujourd'hui comme une priorité pour mieux comprendre l'organisation de l'occupation sur le site gaulois de Saint-Roch. Ces dernières années, le développement de l'archéologie préventive a rendu possible l'élude systématique des parcelles menacées par les travaux d'urbanisme.
Localisation du site "51 rue Saint-Roch' à Toulouse 131). © Ph. Gardes. INRAP
CI-DESSOUS. Soubassement d'un bâtiment r e c t a n g u l a i r e constitué de f r a g m e n t s d'amphores e t de gros galets. Photo © Ph. Gardes, INRAP.
de ces structures, l'absence de vestiges anthro-piques et la nature du comblement plaident plutôt en faveur de petites fosses d'extraction de matériaux (sable ?). Une partie de ces structures pourrait être datée à la jonction des II" et siècles avant notre ère.
Deux intrigants squelettes Au cours du décapage mécanique, des ossements humains ont été dégagés superficiellement dans la partie sud-est de la dépression. Ils appartiennent à un squelette en connexion pour lequel aucune trace de fosse n'a été décetée. Le sujet, fouillé et étudié par Y. Tcheremissinoff (INRAPï, repose en position semi-fléchie, sur le côté droit. D'une manière générale, aucune organisation ne transparaît dans la position réciproque des membres. La surface de dépôt est également très irrégulière et présente un pendage bien lisible du sud vers le nord (0,2 m du pied au crâne). Aucun mobilier n'a pu être mis en relation avec ce dépôt. Cet individu paraît n'avoir bénéficié d'aucune attention particulière car rien ne plaide en faveur d'une sépulture au sens traditionnel du terme. L'hypothèse d'un enfouissement dans une fosse funéraire paraît exclue : il semble que le corps ait simplement été abandonné en bordure de la dépression. Malheureusement, l'origine du décès ne peut être déterminée à partir des restes osseux. Ce n'est en revanche pas le cas pour le second sujet retrouvé à 9 m du premier squelette. Il s'agît d'un adulte de sexe masculin, probablement âgé de plus de 30 ans et de moins de 60 ans. Comme pour le premier, aucune limite de fosse n'a été perçue. Il était partiellement allongé sur le dos, la moitié supérieure du corps reposant aussi en partie sur son côté droit ; ses membres inférieurs étaient en extension, dans le prolongement du corps. Une partie non négligeable des os des pieds a été retrouvée au niveau de la moitié supérieure du corps. Si ces éléments sont toujours dans le
C I - C O N T R E . Effets d e délimitation linéaire r e c o n n u s à d r o i t e e t à g a u c h e d u s u j e t sépulture. E s t - c e l e s i g n e d e l a présence i n i t i a l e d ' u n c o n t e n a n t ?
PAGE DE D R O I T E , E N H A U T . Le vase 18 était situé en a v a n t du c o r p s , v r a i s e m b l a b l e m e n t sur l e c o u v e r c l e d ' u n c o n t e n a n t ou l a c o u v e r t u r e de l a sépulture.
PAGE DE D R O I T E , E N B A S . P r o f i l d e l a f o s s e r e n d u p a r les c o t e s de p r o f o n d e u r , relevées à la b a s e d e s o s s e m e n t s . O Cotes d e p r o f o n d e u r relevées à l a b a s e d e s o s s e m e n t s
Profil l o n g i t u d i n a l d e l a fosse restitué à p a r t i r d e s c o t e s de p r o f o n d e u r O-- - N i v e a u restitué m i n i m a l P l u s i e u r s a r t e f a c t s o n t été déposés a v e c l e défunt. Un f r a g m e n t d'écuelle ln° 171. retrouvé à p l a t , en a v a n t d u crâne e t q u a s i m e n t a u c o n t a c t d e ce d e r n i e r ; un p o t (n° 18), retrouvé sur l a p a n s e 1 c m e n a v a n t d u fémur g a u c f i e car il a basculé médialement; u n p o t I n ' 191, retrouvé très légèrement sur l a p a n s e e n r a i s o n d ' u n b a s c u l e m e n t 3 , 5 c m e n a v a n t du t i b i a d r o i t e t u n p o t (n° 22} retrouvé sur l a p a n s e , e n a v a n t d e l'hémi-thorax d r o i t e t s o u s l a m a n d i b u l e , q u a s i m e n t a u c o n t a c t de c e t t e dernière.
Q P. G e o r g e s . I N R A P
TOULOUSE • • •
Détail d e l a sépulture en cours d e f o u i l l e . O n aperçoit u n e b l e s s u r e a u n i v e a u d u crâne, p a r t i e l l e m e n t r e c o u v e r t e p a r u n f r a g m e n t d'écuelle. P h o t o © P h . G a r d e s . I N R A P
C I - D E S S O U S . L o c a l i s a t i o n d e l a t r a c e observée s u r l e crâne. & P G e o r g e s , I N R A P
volume initial du cadavre, ils se sont déplacés, une fois disloqués, sur une très grande amplitude {distance supérieure à 1 m). Il semble difficile d'imputer ce déplacement à la seule action des liquides de décomposition. Nous envisageons donc une inondation de la fosse, à un moment où la décomposition, tout du moins au niveau des pieds, était déjà (très) avancée. C'est d'ailleurs ce que semble confirmer la position de ces os dans le thorax et la relative homogénéité de leurs cotes de profondeur. Deux ossements semblent être en dehors du
volume initial des chairs, signe d'une décomposition en espace vide. La connexion du squelette excluant un contenant surélevé de type civière, lit, ou tout autre dispositif comportant un fond, l'espace vide a été aménagé soit par une couverture placée sur la fosse, soit par un contenant aménagé i n s i t u . Dans ce dernier cas, à la différence d'un cercueil, ce coffrage à fond non construit n'aurait donc pas servi à transporter le corps. Il est apparu que des récipients en céramique datés du ll̂ '-l*'̂ siècle av. J.-C. ont été déposés avec lui. Ce sujet a donc été déposé dans une fosse, qui ne comportait pas de fond construit, mais qu'un aménagement protégeait du sédiment. Deux des vases se situaient vraisemblablement au contact du corps (n" 19 et n" 22} tandis qu'un troisième {n° 18) était nettement en avant de ce dernier, vraisemblablement sur la couverture de la fosse ou sur le couvercle du coffrage.
Une mort violente Dès la phase de fouille, il est apparu que le crâne de cet individu présentait une lacune osseuse importante au niveau des os frontal et pariétal gauche, immédiatement interprétée comme étant le résultat d'un coup violent. Un fragment de céramique, de taille relativement importante, cachait en partie cette blessure. Mais la trace relevée sur le crâne n'est pas le seul signe d'un acte violent à rencontre de cet individu. D'autres impacts ont été observés au niveau de l'avant-bras gauche : deux entailles marquées sur le radius et une autre, moins prononcée, sur l'ulna homolatéral. Sans que nous
L o c a l i s a t i o n d e s t r a c e s e t s e n s d e s c o u p s .
puissions en avoir la preuve formelle - bien que l'association des traces sur le crâne et le membre supérieur soit par ailleurs attestée - nous proposons l'hypothèse d'une protection de la victime alors que le coup avait pour but de la blesser ou tuer au niveau de la tête (lésions de défense). Les coups révèlent un certain acharnement à rencontre de cet individu. Mais rien ne permet de dire s'il s'agissait d'un combat et/ou s'il n'a fait que se défendre, d'autant que les traces conservées par le squelette ne peuvent refléter qu'une partie de l'acte violent.
Un secteur archéologiquement sensible Ces vestiges présentent un intérêt majeur dans la mesure où on ne connaissait jusqu'à présent que très peu de squelettes de la fin de l'âge du Fer dans le Midi toulousain. Ils correspondent en effet aux premiers squelettes en connexion jamais mentionnés dans le quartier Saint-Roch, pour la période considérée. Des restes humains avaient certes déjà été signalés dans te secteur mais exclusivement sous forme de pièces anatomiques isolées, correspondant essentiellement à des fragments crâniens ou à des os longs rejetés, sans précaution particulière, dans différents contextes domestiques, notamment des puits. Au-delà, ce phénomène n'est pas rare sur les sites d'habitat de la fin de l'âge du Fer et n'a, pour l'instant, pas été expliqué de manière totalement satisfaisante. En dehors de leur statut d ' u n i c u m , ces corps offrent un certain nombre de particularités difficilement compatibles avec un cadre funéraire habituel. Ils se singularisent en effet par leur contexte, à savoir un habitat aggloméré, la réutilisation opportuniste d'une excavation préexistante, la faible densité des sujets et la pratique de l' inhumation, alors que l'incinération semble être la règle dans les régions avoisinantes. À partir de ce constat, certaines interprétations peuvent déjà être écartées comme celle du sacrifice rituel. Seules deux autres hypothèses restent donc en lice : crime de droit commun ou acte de guerre. Dans ce dernier cas, une relation pourrait à la rigueur être envisagée avec la prise et le sac de Toulouse par le général romain Caepio, en 106-105 av. J. -C. Cette découverte appelle une vigilance de tous les instants dans ce quartier sud de Toulouse à l'urbanisation galopante. Elle amène à reprendre la documentation ancienne issue du quartier, et en particulier celle concernant d'autres squelettes en connexion, peut-être trop rapidement considérés comme antiques et mis en relation avec la nécropole sud de T o l o s a romaine.
Philippe Gardes, r e s p o n s a b l e d'opération
I N R A P , T R A C E S / U M H 5 6 0 8 ,
Patrice Georges, archéo-anthropologue
I N R A P , P A C E A / U M R 5 1 9 9
POUR EN SAVOIR PLUS
4 1 9 . Archéologia. " L e dépôt g a u l o i s d e T i n t i g n a c " , p a r C h . M a n i q u e t . 6 €. 1 2 0 . D o s s i e r s d'Archéologie. T o u l o u s e e t s a région. 9 , 5 0 €.
P o u r o b t e n i r l e s r e v u e s c i - d e s s u s , v e u i l l e z v o u s r e p o r t e r à l a p . 15. - 1 9 - G a u l o i s d e s p a y s d e G a r o n n e , c a t a l o g u e d ' e x p o s i t i o n , musée S a i n t -R a y m o n d , T o u l o u s e , 2 0 0 4 . 17 € ( 2 3 1 2 7 ) Épuisé - M A L R A I N F., M A T T E R N E F., MÉNIEL P., 2 0 0 2 , L e s p a y s a n s g a u l o i s . Éd. E r r a n c e , P a r i s . - 2 0 - B R U N A U X J . - L . , 1 9 9 6 , L e s r e l i g i o n s g a u l o i s e s . Éd. E r r a n c e , P a r i s . 2 9 €115562) Épuisé - L A B R O U S S E M . , 1 9 6 8 , T o u l o u s e a n t i q u e . D e s o r i g i n e s à l'établissement d e s W i s i g o t h s , Éd. d e B o c c a r d , P a r i s . - 2 1 - CHAUSSERIE-LAPRÉE J . , 2 0 0 2 , Le t e m p s d e s G a u l o i s e n P r o v e n c e , c a t a l o g u e d ' e x p o s i t i o n , musée S a i n t - R a y m o n d , T o u l o u s e . 2 0 0 2 . 15 € ( 2 2 8 7 8 ) P o u r o b t e n i r l e s o u v r a g e s référencés c i - d e s s u s , v e u i l l e z u t i l i s e r l e b o n d e c o m m a n d e d e l a L i b r a i r i e Archéologique (p. 7 2 ) s u r l e q u e l v o u s i n d i q u e r e z l e numéro c o r r e s p o n d a n t a u l i v r e souhaité.