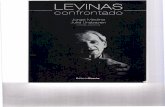Jewish Thought in Levinas and Buber (in Japanese/abstract in English)
Sur la solitude dans l’œuvre de Levinas
Transcript of Sur la solitude dans l’œuvre de Levinas
1
Février 2015
Lectures lévinassiennes : Une autre voie phénoménologique Séminaire de master et doctoral 2014-2015 Organisé par Les Archives Husserl/ENS, le département de philosophie de l’Ecole Normale Supérieure de Paris et le Collège des études juives et de philosophie contemporaine de l’Université Paris IV Sorbonne/Centre Emmanuel Levinas Sous la direction de Danielle Cohen-Levinas
D’une solitude à l’autre Sur la solitude dans l’œuvre de Levinas
2
Introduction Il y a sans doute quelque inconvenance à interroger la solitude dans une œuvre placée
sous le signe de l’altérité. Mais dans l’éloignement radical qu’elle suppose, la solitude n’en
appelle cependant pas à l’abolition de toute relation. Car si la solitude s’atteint dans
l’absence d’autrui, alors la pensée du seul ne fait sens que lorsque demeure une présence
autre par rapport à laquelle se définit ce manque.
La notion intervient tardivement sous la plume de Levinas. Ne faisant l’objet
d’aucune mention dans ses travaux académiques de la période 1929-1935, il faudra attendre
un tout premier texte personnel pour la voir apparaître. C’est finalement au sortir de la
guerre que la solitude devient un objet de réflexion, après quatre années de captivité.
Appelée à côtoyer le noyau dur de sa philosophie sous des formes diverses, le peu
d’homogénéité thématique sinon chronologique des textes de Levinas fait peu pour retirer à
la solitude de son équivocité.
Il s’agira ainsi de retracer, depuis la haine de l’être jusqu’au derniers écrits où elle
n’agit plus qu’en sous-œuvre, la pensée de la solitude telle qu’elle se déploie dans le corpus
lévinassien. Nous verrons comment celle-ci s’élabore progressivement à partir de sources
littéraires et philosophiques avant d’être élevée au rang de catégorie ontologique, pour enfin
avouer sa paradoxale ouverture à autrui. Dans un tel basculement, c’est l’Autre de la solitude
qui se laissera entrevoir, où la solitude est d’abord celle d’autrui depuis la proximité dans
laquelle il se tient.
1. Repenser la solitude 1.1. Les étapes d’une définition
1.1.1. Prélude d’une thématique centrale
Texte longtemps oublié après une publication initiale dans les Recherches
philosophiques en 1935 avant sa réédition en 1982 par Jacques Rolland, De l’évasion est le
tout premier texte personnel de Levinas. Les thèmes de la pesanteur de l’être, de la lassitude
existentielle et du désir d’évasion y sont esquissés, sans qu’il soit explicitement question de
la solitude. Dans cet écrit se reflète l’exil français de Levinas ainsi qu’une aspiration précoce
à un au-delà de l’être de la part de celui qui dira plus tard avoir trouvé dans la
phénoménologie une « respiration »1.
1 LESCOURET, Marie-Anne, Levinas, Grandes biographies, Flammarion, 1994, p. 118.
3
Lorsque la nausée fait l’objet de développements anticipés, la solitude n’est évoquée
qu’au détour d’une réflexion sur la honte ressentie par l’homme seul avec lui-même envers
son corps, en l’absence d’autrui pour justifier celle-ci et le laissant comme témoin de son
impouvoir sur son propre être :
Solitude, lieu de la honte de son propre corps.2
Dans l’une de ses rares occurrences au cours des années 1930, la solitude est ainsi
comprise comme un déterminant de l’accession à la conscience de la honte. Levinas
s’empare également du phénomène de la maladie, lorsque seul et abandonné, je ne peux que
me scandaliser d’être moi-même, dans l’humiliation qui m’est ainsi infligée. Dans la
solitude, je suis placé au devant de moi-même et éprouve la honte d’être celui que je suis. En
dépit du voisinage de thématiques apparentées, la solitude n’émerge ainsi pas encore en tant
que cette notion d’importance qu’elle sera appelée à devenir, et ce sont encore les
phénomènes de nausée et d’enfermement dans l’être qui captivent Levinas durant sa période
strasbourgeoise.
La place tenue par la littérature russe (Pouchkine au premier chef, puis Dostoïevski,
Tourgueniev, Tolstoï, Lermontov) dans les lectures de jeunesse annonçait pourtant très tôt
un intérêt marqué de la part de Levinas pour les interrogations relatives à l’existence et au
sens de la vie dont de discrètes traces écrites attestent. Ainsi, dans une note des Carnets,
Levinas rapporte la solitude à l’idée d’une perte de sens dont le champ d’application ne va
pas de soi, concernant non pas seulement l’existence mais les choses dont l’étrangeté se
réverbère sur l’existence et esseule le sujet :
Fromage et champagne à 5 h du matin. Creuser cette idée de la « perte de sens » par les
choses. Et la solitude qui en résulte.3
Si c’est à partir de la littérature que Levinas est interpellé par un état de fait dont la
problématisation ne lui est pas claire, c’est aussi au travers de la littérature qu’il entreprendra
de comprendre ce que la solitude peut avoir de spécifique.
1.1.2. La littérature comme lieu d’élaboration
C’est dans les écrits de la période de captivité (commencés en 1937 et poursuivis
jusqu’en 1950) que la notion de solitude apparaît en tant que telle sous la plume de Levinas,
2 De l’Evasion, Livre de Poche, 2011, p. 117. 3 « Carnets de captivité », Carnet 5, in Œuvres complètes I, Grasset, 2009, p. 132.
4
et occupe une réflexion qui aboutira sous une forme plus achevée peu après sa libération.
Dans les carnets de captivité, Levinas consigne notamment des citations attestant de
l’attention qu’il porte durant cette période à la solitude au travers d’un prisme littéraire, à
l’image de ces lignes de Vigny :
La solitude est empoisonnée pour lui comme l’air de la campagne de Rome. Il le sait ; mais il
s’y abandonne cependant, tout certain qu’il est d’y trouver une sorte de désespoir sans
transports, qui est l’absence de l’espérance.4
La recopie attentive de ces lignes de Stello rend compte de l’intérêt que Levinas
trouve au fil de ses lectures à couler sa réflexion dans le creuset de la littérature afin de
formuler une pensée neuve de la solitude. L’interprétation qu’il donne de Proust est un autre
indicateur de l’importance qu’il prête à la littérature pour la compréhension de la solitude :
Quand je dis que Proust est un poète du social et que toute son œuvre consiste à montrer ce
qu’est une personne devant l’autre, je ne veux pas évoquer simplement l’ancien thème de la
solitude fatale de chaque être (Cf. Solitudes d’Estaunié) – la situation est différente : à un être
tout de l’autre est caché – mais il n’en résulte pas une séparation – c’est précisément ce fait
de se cacher qui est le ferment de la vie sociale. C’est ma solitude qui intéresse autrui et tout
son comportement est une agitation autour de ma solitude.5
Lorsque Levinas trouve dans Proust l’idée d’une solitude satisfaisante par son acuité,
il confirme d’autant plus l’importance de sa lecture par la répudiation de cette solitude
surannée dont Estaunié fait figure de porte-étendard par ses litanies (l’impossibilité
d’échapper à soi, la fatalité de la solitude, le fardeau de l’existence). Ce qui au contraire fait
la force de Proust selon Levinas, c’est d’avoir su saisir la solitude dans une perspective
sociale dont il réaffirmera la justesse dans un court texte intitulé L’Autre dans Proust qu’il
lui consacre en 1947 :
Le thème de la solitude, de l’incommunicabilité foncière de la personne s’offre à la pensée et
à la littérature moderne comme l’obstacle fondamental auquel se heurte l’élan de la fraternité
universelle.6
4 Alfred de Vigny, Stello, cité in Levinas, Carnet 2, Œuvres complètes 1, 2008, Grasset, p. 76. 5 « Carnets de captivité », Carnet 5, op.cit., p. 145. 6 « L’Autre dans Proust », 1947, in Noms propres, Fata Morgana, 1976, p. 157.
5
C’est peu à peu que prend ainsi forme, au voisinage de la littérature, une pensée de la
solitude. C’est à l’issue des années de captivité que cette discussion féconde des grandes
œuvres atteint sa pleine mesure, comme si l’heure était déjà au bilan :
La solitude n’est donc pas seulement un désespoir et un abandon, mais aussi une virilité et
une fierté et une souveraineté. Traits que l’analyse existentialiste de la solitude, menée
exclusivement en termes de désespoir, a réussi à effacer, faisant oublier tous les thèmes de la
littérature et de la psychologie romantique et byronienne de la solitude fière, aristocratique,
géniale.7
Penser la solitude pour Levinas, c’est alors autant se garder de souscrire à ce qu’il
nomme l’existentialisme des garçons de café que marquer un retour à sa composante
romantique. L’ambition qui est la sienne, visant à hisser au rang de catégorie la solitude, ne
pouvait que conduire Levinas à discuter les positions philosophiques relatives à celle-ci.
1.2. Contre Heidegger
1.2.1. Une solitude trop peu seule
Si Levinas fut l’introducteur de la phénoménologie husserlienne et de Heidegger en
France, il ne manqua pas de se retourner tôt contre ce dernier, dont les réflexions relatives à
la solitude font l’objet d’une vive remise en question :
En transformant la solitude en une forme de l’In-der-Welt-Sein Heidegger s’interdit de voir
dans la solitude le néant du fait même de l’être et la voie du salut. Le mal de la solitude n’est
pas le fait d’un être se trouvant mal dans le monde ; mais le mal du fait même de l’être –
auquel on ne peut pas remédier par un être plus complet, mais par le salut. Salut n’est pas
l’être.8
Selon Heidegger, la solitude est un mode déficient du mitsein, ce qui revient à penser
l’absence d’autrui par laquelle je me trouve seul comme manque ou privation9. La solitude
se trouve ainsi située dans la socialité et il ne saurait ainsi jamais y avoir de parfaite
solitude : la possibilité d’être seul provient de l’être-avec10. Or c’est là manquer de saisir la
solitude dans ce qu’elle a de spécifique en la concevant comme un mode déficient de l’être-
7 Le temps et l’autre, PUF, 2009, p. 35. 8 « Carnets de captivité », 8 septembre 1937, op.cit., p. 52. 9 « L’autre ne peut manquer que dans et pour un être-avec. L’être seul est un mode déficient de l’être-avec, sa possibilité est la preuve de celui-ci » (Martin Heidegger, Etre et Temps, 26, Gallimard, 1986, p. 120). 10 « C’est seulement comme être-avec que le Dasein peut être seul » (Martin Heidegger, Prolégomènes à l’histoire du concept du temps, 26, Gallimard, 2006, p. 346).
6
avec. Car une telle solitude maintient encore une forme de liaison interdisant de parler d’une
solitude véritable dont Levinas croyait alors entrevoir la possibilité dans l’œuvre de Husserl :
Il y a en moi une possibilité de solitude malgré ma socialité effective et la présence du monde
pour moi. En tant que pensée précisément, je suis une monade, une monade toujours possible
dans un recul toujours possible à l’égard de mes engagements. Le tout où je suis, je suis
toujours en train d’aller vers lui, car je suis toujours dehors retranché dans ma pensée.11
Si le refus de souscrire à la conception heideggérienne de la solitude perdure dans
l’après-guerre, Levinas renoue cependant avec le questionnement dans la recherche d’une
contre-proposition autrement plus personnelle :
Comment une solitude peut-elle ne pas être sur le fond d’une coexistence ? Comment trouver
un pour soi premier qui ne soit pas un mode déficient ?12
Il appartiendra alors à Levinas de penser un sujet hors de toute dépendance sociale,
ne se laissant pas seulement identifier par la négative, de sorte à esquisser une solitude qui ne
soit pas si peu seule.
1.2.2. L’artificielle solitude du Dasein
Il est un second point sur lequel Levinas s’oppose à Heidegger, et significatif de la portée
qu’il entend conférer à la solitude. La solitude du Dasein, telle qu’elle est décrite, et en effet
celle d’un être jeté au sein d’un monde qu’il lui est offert de découvrir par sa vision et dont
l’essence est celle de l’être-séparé13. Poser un tel sujet revient selon Levinas à penser la
solitude comme caractéristique d’un hypothétique être en retrait à partir duquel s’effectuerait
le dévoilement du monde. Dans ce regard surplombant émanant d’une intériorité ouverte
mais sans réciprocité, Levinas reconnaît un nouveau Gygès :
Mais la position de Gygès ne comporte t-elle pas l'impunité d'un être seul au monde, c'est-à-dire
d'un être pour qui le monde est un spectacle ? Et n'est-ce pas là, la condition même de la liberté
solitaire, et, pour cela même, incontestée et impunie, de la certitude ?14
11 « L’œuvre d’Edmond Husserl », Revue philosophique, janvier-février 1940, in En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, 2010, p. 69. 12 « Notes philosophiques diverses », Liasse A, in Œuvres complètes 1, p. 244. 13 « Mettre la parole à l'origine de la vérité, c'est abandonner le dévoilement qui suppose la solitude de la vision - comme œuvre première de la vérité » (Totalité et Infini, Livre de Poche, 2009, p. 102). 14 Ibid., p. 90.
7
Admettre une telle conscience, dont la perception visuelle est condition du dévoilement
de l’être et de la vérité, cela revient finalement à enfermer un sujet dans un exister à jamais
solitaire. Lorsque Levinas reprochait à Heidegger de n’envisager la solitude que depuis
autrui, il ne souscrit ainsi pas plus à la solitude d’un sujet abstrait qui se réaliserait au mépris
de l’autre :
Un élément essentiel de ma philosophie – ce par quoi elle diffère de la philo. de Heidegger –
c’est l’importance de l’Autre. Eros comme moment central.15
La solitude ne doit par conséquent être conçue ni comme mode déficient de l’être-
avec, ni comme le propre d’un sujet qui depuis sa séparation absolue embrasserait le monde.
La solitude en appellerait ainsi autant à la distinction de l’Autre qu’à son accueil, dans la
crainte de sa mise à l’écart :
Risque d'occuper, dès le Da du Dasein, la place d'un autre et, ainsi, concrètement, de l'exiler,
de le vouer à la condition misérable dans quelque "tiers" ou "quart" monde, de le tuer.16
La solitude du Dasein, si elle est d’emblée refusée par Levinas précise ainsi une
exigence supplémentaire à laquelle la solitude lévinassienne devra satisfaire : on ne saurait
admettre une séparation absolue qui, dans le mépris de l’autre, condamnerait déjà celui-ci à
l’exil et la misère.
1.2.3. La place de la mort
La mort, dans le rapport qu’elle entretient avec la solitude, est le troisième et dernier
lieu d’opposition à Heidegger17. Lorsque pour celui-ci, la mort renvoie à la solitude du
Dasein en tant que sa possibilité la plus propre et par-là isolante18, Levinas y aperçoit au
contraire la marque même de l’altérité :
La solitude de la mort ne fait pas disparaître autrui, mais se tient dans une conscience de
l'hostilité et, par là même, rend encore possible un appel à autrui, à son amitié et à sa
médication.19
15 « Carnets de captivité », op.cit., p. 134. 16 « Philosophie et transcendance » in « Encyclopédie philosophique universelle », PUF, 1989 in Altérité et Transcendance, Livre de poche, 2006, p. 50. 17 « La mort c’est la mort d’autrui contrairement à la philosophie contemporaine attachée à la mort solitaire de soi » (« L’Autre dans Proust », op.cit., p. 157). 18 « Possibilité esseulante – car possibilité qui, comme la plus propre, coupe tous les liens avec les autres hommes » (« Le temps pensé à partir de la mort », 1976, in Dieu, la Mort et le Temps, Livre de Poche, 2010, p. 61). 19 Totalité et Infini, op.cit., p. 260.
8
Dans une telle inversion des termes dont Levinas est coutumier lorsqu’il s’agit de
commenter Heidegger, la mort est dans son étrangeté même placée sous le signe de l’altérité
plutôt que sous celui de l’isolement et m’enlève à ma solitude :
Cette approche de la mort indique que nous sommes en relation avec quelque chose qui est
absolument autre, quelque chose portant l’altérité, non pas comme une détermination
provisoire, que nous pouvons assimiler par la jouissance, mais quelque chose dont
l’existence même est fait d’altérité. Ma solitude ainsi n’est pas confirmée par la mort, mais
brisée par la mort.20
En tant que mise en relation avec l’absolument autre, la mort m’enlève à ma solitude,
dans son altérité même. La solitude, dans sa juste compréhension, requiert de ne plus
procéder de cette conception de la mort comme possibilité la plus propre, laquelle n’est pas
esseulement mais mise en relation avec l’autre.
Dans son opposition triple à Heidegger, Levinas pose ainsi les jalons devant guider
l’élaboration de sa pensée de la solitude. Celle d’un sujet dont la solitude ne se définirait pas
par rapport à autrui mais adviendrait depuis sa séparation. Celle encore d’un sujet qui ne
serait pas une abstraction et dont la solitude ne serait pas synonyme de mépris de l’autre.
Celle enfin qui dans la mort reconnaîtrait encore l’altérité plutôt que la garante d’un
esseulement illusoire.
2. De la solitude à l’Autre 2.1. Ontologie de la solitude
2.1.1. La fatalité esseulante de la matière
Dans son opposition frontale à Heidegger et après une période de gestation autour de
la littérature, la méditation de Levinas sur la solitude est désormais en mesure de conférer
une toute autre ampleur à la notion, prenant son essor dans les écrits de la période 1945-
1948. C’est à partir de l’analyse de la matière que Levinas identifie un point de départ afin
de définir une solitude libre des insuffisances signalées en première partie de ce travail. En
tant que pris dans la matière, je suis voué à une irrémédiable solitude, car la simple venue à
l’existence dans l’hypostase enchaîne le Moi qui aussitôt se fait solitude dans son identité à
soi exclusive :
20 Le temps et l’autre, op.cit., p. 63.
9
La matière est le malheur de l’hypostase. Solitude et matérialité vont ensemble. La solitude
n’est pas une inquiétude supérieure qui se révèle à un être quand tous ses besoins sont
satisfaits. Elle n’est pas l’expérience privilégiée de l’être pour la mort, mais la compagne, si
on peut dire, de l’existence quotidienne hantée par la matière.21
La solitude n’intervient ainsi pas a posteriori, comme réflexion de la conscience sur
un état de séparation ou bien dans le souci de l’autre en tant qu’absent. Solitude et
matérialité vont de pair, au sens où la solitude caractérise la condition du sujet hypostasié
rivé à lui-même et se définissant par cette unicité qui le délimite. La solitude ne consiste
donc pas en l’absence des autres et sa tragédie tient bien plutôt au « définitif de
l’enchaînement d’un moi à son soi »22 :
Ce définitif de l’existant qui constitue le tragique de la solitude, c’est la matérialité. La
solitude n’est pas tragique parce qu’elle est privation de l’autre, mais parce qu’elle est
enfermée dans la captivité de son identité, parce qu’elle est matière.23
Ainsi cloisonné dans son unicité définitive, le sujet dont l’hypostase marque la venue
est seul, « enfermé dans une existence définitivement une » 24. Le clos de l’être-soi impose
d’être à jamais avec soi-même et définit l’existence dans ce définitif qui se dit aussi
solitude25. De face à face, il n’y a au mieux que moi-même que je puis rencontrer : Le malheur de la subjectivité ne tient pas à la finitude de mon être et de mes pouvoirs, mais
précisément au fait même que je suis un être ou un être un.
Malheur qui révèle ce par quoi l’être complet est incomplet. Ce par quoi il est seul. La
solitude n’est pas la privation d’une collectivité de semblables – mais le retour fatal de moi à
soi. Être seul, c’est être son identité.26
Par son unicité et le définitif de sa présence à soi, le sujet est donc inévitablement
seul, retournant irrémédiablement à lui-même. La solitude est identité de Moi à Soi, sans
qu’un tel rapport puisse encore être qualifié de première relation.
21 Ibid., p. 39. 22 De l’existence à l’existant, Vrin, 2004, pp. 142-143. 23 Le temps et l’autre, op.cit., p. 38. 24 « Dans l’univers compris, je suis seul, c’est-à-dire enfermé dans une existence définitivement une » (De l’existence à l’existant, op.cit., p. 144). 25 « Le monde de l’intention et du désir est précisément la possibilité d’une telle liberté. Mais cette liberté ne m’arrache pas au définitif de mon existence même, au fait que je suis à jamais avec moi-même. Et ce définitif c’est la solitude. » (Ibid., p. 144). 26 « Parole et Silence », Conférence prononcée les 4 et 5 février 1948, in Œuvres complètes 2, Grasset, 2011, p. 97.
10
2.1.2. La solitude comme catégorie de l’être
La solitude est la fatalité d’un existant emprisonné dans un rapport de Moi à Soi que
la matière voue à l’unicité. Levinas ne s’en tient cependant pas à définir la solitude dans ce
fait d’être son identité, mais cherche alors à établir la solitude comme catégorie de l’être :
Nous voulons présenter la solitude comme une catégorie de l’être, montrer sa place dans une
dialectique de l’être ou, plutôt, - car le mot dialectique a un sens plus déterminé, - la place de
la solitude dans l’économie générale de l’être.27
Poser la solitude comme catégorie de l’être émane du refus d’envisager la solitude
« au sein d’une relation préalable avec l’autre »28. Afin de la porter au statut de catégorie et
de lui conférer toute son indépendance, Levinas donne la définition suivante de la solitude :
Elle tient à l’œuvre de l’hypostase. La solitude est l’unité même de l’existant, le fait qu’il y a
quelque chose dans l’exister à partir de quoi se fait l’existence. Le sujet est seul, parce qu’il
est un.29
Si la solitude tient à l’existence d’un existant30, lequel est par définition un, alors se
voit établi le lien ontologique entre l’existant et sa solitude. L’existant, aussitôt identifié, se
ferme sur lui-même et se fait monade, donc solitude31. C’est en manquant d’interroger la
portée exacte de cet « exister avec » et de ne pas questionner cette conviction que nous avons
d’exister avec autrui que Heidegger a pu concevoir la solitude comme s’accomplissant dans
la relation préalable avec l’autre. Car si mon existence est en partage, alors elle est propriété
plutôt que devenir, dans la mesure où le partage renvoie au champ de l’avoir. La simple
coexistence de l’existant dans son monde ne suffit donc pas à sortir de la solitude lorsque
son unicité dans l’être rendrait à l’inverse indépassable la solitude que réalise l’hypostase du
sujet. La solitude ontologique du sujet demeure irrécouvrable.
En cette proche fin des années 1940, la solitude telle que Levinas la comprend est
celle d’un Moi cadenassé par la matière dans laquelle il est d’emblée jeté et synonyme de
son ipséité en tant que rapport de Moi à Soi32 sans que la participation à l’être laisse
entrevoir un dépassement de cette solitude.
27 Le temps et l’autre, op.cit., p. 18. 28 Ibid., p. 18. 29 Ibid., p. 35. 30 Ibid., p. 22. 31 Ibid., pp. 31-32. 32 Ibid., p. 18.
11
2.2. L’irruption de l’Autre dans la solitude
2.2.1. L’inquiétude pour autrui de la raison
La solitude lévinassienne émane de la fatalité esseulante de la matière par laquelle se
justifie la solitude comme catégorie de l’être dans l’unicité de l’existant. Mais à cette
irrémissibilité du Moi à Soi à laquelle la matière voue l’existant ainsi condamné à
l’isolement, Levinas adjoint cependant la solitude de la raison :
Solitude de l’immanence, irrémissible poids de l’être … Solitude dans la lumière du savoir
absorbant tout autre, solitude de la raison essentiellement une33
Il faudrait ainsi encore tenir compte, en plus de cette solitude ontologiquement
déterminée, de la solitude de la raison. Car la raison est seule34, essentiellement une, et ne
trouve nul à qui parler35. Contre l’argument spontané de l’objectivité du savoir rationnel qui
placerait la raison dans le domaine de l’intersubjectivité, Levinas répond que la raison n’en
demeure pas moins solitaire :
L’objectivité du savoir rationnel n’enlève rien au caractère solitaire de la raison.36
La raison ne trouve pas plus son unité dans la reconnaissance de tout un chacun, sous
peine de quoi elle déposerait sa solitude contre la reconnaissance de l’Autre. De surcroît, la
raison demeure ultime et ravale tout Autre au Même en tant que puissance thématisante :
En englobant le tout dans son universalité, la raison se retrouve elle-même dans la solitude.
Le solipsisme n’est ni une aberration, ni un sophisme : c’est la structure même de la raison.
Non point en raison du caractère « subjectif » des sensations qu’elle combine, mais en raison
de l’universalité de la connaissance, c’est-à-dire de l’illimité de la lumière et de
l’impossibilité pour aucune chose d’être en dehors.37
C’est inévitablement que la raison marque un retour à elle-même dans son
arraisonnement d’un divers qu’elle s’approprie aussitôt, retournant infatigablement à elle-
même et demeurant dans son indépassable solitude38. Le solipsisme serait donc la structure
33 Ibid., p. 12. 34 « La raison est seule » (Ibid., p. 53). 35 « Carnets de captivité », in Œuvres complètes I, op.cit., p. 168. 36 Le temps et l’autre, op.cit., p. 48. 37 Ibid., p. 48. 38 « La notion de force – s’oppose à la raison qui est solitude – force intersubjective. La guerre opposée à la raison – Dans la force à la fois assomption à partir du <seul ?> et intersubjectivité – Notion complète de l’économie. » (« Carnets de captivité », in Œuvres Complètes 1, op.cit., p. 168).
12
même de la raison : tout s’absorbe, s’enlise et s’emmure dans le Même39 dit Levinas. On en
reviendrait ainsi à la solitude de l’âme platonicienne comme discussion de l’âme avec elle-
même40. Mais c’est déjà envisager que la raison, par-delà son inévitable retour à soi, soit
inquiétude de l’autre :
La question est-elle d’ores et déjà la fameuse question alternant avec la réponse dans un
dialogue que l’âme tiendrait avec elle-même et où Platon reconnaît la pensée, d’emblée
solitaire et allant vers la coïncidence avec elle-même, vers la conscience de soi ? Ne faut-il
pas admettre, au contraire, que la demande et la prière qu’on ne saurait dissimuler dans la
question, attestent une relation à autrui, relation qui ne tient pas dans l’intériorité d’une âme
solitaire, relation qui dans la question se dessine ?41
Avant toute réponse, le questionnement de la raison avec elle-même annonce déjà
son ouverture vers autrui. Aussi la solitude de la raison ménagerait t-elle toujours déjà une
place, aussi infime soit-elle, à l’Autre. L’intériorité du Moi serait ainsi marquée, en dépit de
son cloisonnement même, par la continuelle irruption de l’altérité dans l’incessant dialogue
de la raison, qui dans sa solitude se révèle inquiétée par l’Autre.
2.2.2. La solitude comme première relation
D’une solitude fondée sur l’unicité du Moi endigué dans la matière, replié sur lui-
même et fermé à l’Autre, nous avons découvert dans la raison l’ouverture vers autrui. Or
Levinas va plus loin : après la mise à mal du solipsisme de la raison dans son ouverture à
autrui, Levinas admet désormais dans l’unité même de l’existant une dualité faisant elle
aussi signe vers l’altérité :
Le double – non pas l’homme mauvais accompagnant l’homme bon – mais le tragique même
de la dualité d’être enchaîné à un autre – dédoublement à l’infini – être deux. Le moi est
deux. Yvan Karamazov et le diable. Cette dualité c’est le diabolique.42
Cette dualité du moi, aperçue chez l’un des écrivains les plus cités par Levinas,
revient sous les espèces d’une autre référence fétiche pour mieux illustrer encore la dualité
qu’instaure la coprésence du Moi au Soi :
39 « Idéologie et idéalisme », 1972, in De Dieu qui vient à l’Idée, Vrin, 2004, p. 31. 40 « Derrière les ressorts de l’âme, c’est le frisson par lequel le moi s’empare de soi, le dialogue en soi avec l’autre, l’âme de l’âme » L’Autre dans Proust, in Noms propres, op.cit., p. 156). 41 De Dieu qui vient à l’idée, op.cit., p. 168. 42 « Carnets de captivité », Carnet 4, in Œuvres Complètes I, op.cit., p. 113
13
Etre moi, ce n’est pas seulement être pour soi, c’est aussi être avec soi. Quand Oreste dit :
« … Et de moi-même me sauver tous les jours », ou quand Andromaque se plaint : » Captive,
toujours triste, importune à moi-même », le rapport avec soi que disent ces paroles, dépasse
la signification de métaphores.43
Ce que décèle donc Levinas chez Dostoïevski et Racine, ce sont de profondes
intuitions relatives à la structure de l’intériorité où dans la solitude du Moi se trouve déjà un
Soi qui l’accompagne non pas seulement comme l’ombre du voyageur mais comme
première relation :
Le moi possède un soi, où il ne se reflète pas seulement, mais auquel il a affaire comme à un
compagnon ou à un partenaire, relation qu’on appelle intimité.44
Lorsque la solitude se définissait comme rapport de Moi à Soi, voici donc qu’émerge
au sein de cette dualité une relation première dont la solitude est le berceau. L’unité de
l’existant dont Levinas tirait la solitude s’efface alors pour admettre dans sa dimension
plénière la part d’altérité que comporte la duplicité fondamentale du sujet :
La solitude du sujet est plus qu’un isolement d’un être, l’unité d’un objet. C’est, si l’on peut
dire, une solitude à deux ; cet autre que moi court comme une ombre accompagnant le moi.45
Une telle solitude admettant en son sein la relation première qu’est le rapport du Moi au
Soi accède à sa pleine légitimité dans les écrits des années 1960, où survient la thématique
d’une « solitude à deux » se concrétisant notamment dans la relation amoureuse :
Le rapport qui, dans la volupté, s'établit entre les amants, foncièrement réfractaire à
l'universalisation, est tout le contraire du rapport social. Il exclut le tiers, il demeure intimité,
solitude à deux, société close, le non-public par excellence.46
L’infléchissement que Levinas fait donc subir à ses vues initiales n’est donc pas
moindre, en allant jusqu’à décrire la solitude de l’intimité amoureuse comme se vivant à
deux sans que cette société sans société ne bascule pour autant dans le domaine du social.
43 De l’existence à l’existant, op.cit., p. 151. 44 Ibid., pp. 37-38. 45 Ibid., p. 151. 46 Totalité et infini, op.cit., p. 297.
14
2.2.3. Seul sans solitude
L’irruption de l’Autre se produirait donc autant dans la solitude d’une raison dont
l’incessant questionnement est inquiétude de l’autre que dans la duplicité d’une intériorité où
le rapport de Moi à Soi est la première relation que je puis avoir, et instaure la solitude
comme relation première. Mais à ainsi faire irruption, la présence d’autrui ne brise t-elle pas
la solitude du Moi ? Levinas, trop conscient de la difficulté que pose au sens commun cet
apparent paralogisme, reprend cette question au travers de ce qu’il nomme l’avec pour
formuler sa compréhension de la coprésence :
C’est la mise en question de cet avec, comme possibilité de sortir de la solitude, qui est
formulée ici.47
Selon Levinas, l’avec ne fait que désigner la présence d’autrui dans ce qu’elle a de
plus factuelle, ne suffisant nullement à rompre ma solitude. Car la séparation entre moi et
autrui n’en reste pas moins béante en vertu de la non-participation au genre de l’unicité.
Aussi, comprendre l’isolement fondamental de chacun d’où procède et subsiste la solitude
suppose une compréhension de l’altérité qui ne soit pas formelle :
Un individu est autre à l'autre. Altérité formelle : l'un n'est pas l'autre, quel que soit son
contenu. Chacun est autre à chacun. Chacun exclut tous les autres, et existe à part, et existe
pour sa part. Négativité purement logique et réciproque dans la communauté du genre.48
La coprésence simple ne suffit ainsi pas à abolir l’isolement de chacun à chacun.
C’est à ce niveau de compréhension inapproprié à la saisie de ce phénomène que l’avec
heideggérien se place pour établir la solitude du Dasein49. Or c’est dans la solitude la plus
innocente, antérieure au social et sans référence à autrui, que devient permise cette
exposition à l’autre autorisant le maintien de la solitude malgré l’irruption d’autrui :
Egoïste sans référence à autrui - je suis seul sans solitude, innocemment égoïste et seul. Pas
contre les autres, pas "quant à moi" - mais entièrement sourd à autrui, en dehors de toute
communication et de tout refus de communiquer - sans oreilles comme ventre affamé.50
47 Ethique et Infini, Livre de Poche, 2008, p. 50. 48 « De l'Unicité », in Entre Nous, Livre de poche, 1986, p.195. 49 « Mais comment la séparation de la solitude, comment l'intimité peuvent-elles se produire en face d'Autrui ? La présence d'Autrui, n'est-elle pas déjà langage et transcendance ? » (Totalité et Infini, p. 165) 50 Totalité et Infini, op.cit., p. 142. Cf. également une note préparatoire consignée dans les Notes philosophiques diverses in Œuvres complètes I, op.cit., p. 243 (« Le moi du besoin, ce n’est pas « moi et pas les autres » ni l’exclusive du « quant à moi ». C’est le moi sourd du « ventre affamé n’a pas d’oreilles ». Être seul,
15
Que l’Autre puisse surgir en moi sans pour autant briser ma solitude implique ainsi
de saisir la tonalité de cet égoïsme en lequel brille une solitude sans référence à autrui,
encore aveugle à l’autre, entièrement tourné vers soi. Alors se comprend la possibilité d’un
avec en dépit duquel le sujet peut demeurer seul sans solitude, se situant encore en-deçà de
celle-ci tel un moi seulement seul, encore inapte à accueillir une solitude qui en elle secrète
la présence d’autrui. La présence d’autrui n’implique donc pas une sortie de la solitude, au
contraire. Par-là, Levinas détermine la strate du seul, où la coprésence n’abolit pas la
séparation, et où chaque Moi demeure prisonnier de lui-même, dans l’attente que se produise
le face-à-face :
Le face à face est une relation où le Moi se libère de sa limitation à soi - qu'ainsi il découvre -
, de sa réclusion en soi, d'une existence dont les aventures ne sont qu'une odyssée, c'est-à-dire
le retour dans une île. 51
Cette solitude sans solitude ne se donne donc pas comme un manque mais plutôt
comme une étape, comme si la limitation à soi interdisait un horizon qui serait celui de la
solitude pour celui qui est seul. Aussi, Levinas affine un peu plus sa compréhension de la
solitude en admettant la possibilité d’être seul sans solitude, ainsi que la position tenue par
celle-ci face à l’altérité.
Ontologisée et indépassable dans un premier temps, la solitude admet l’irruption
d’autrui en tant que paradoxale relation première. Si la présence d’autrui ne suffit cependant
pas à m’enlever à mon exister solitaire, c’est en raison de l’insuffisance d’une
compréhension qui soit purement formelle, manquant d’apercevoir que la solitude se pense
encore au seuil de l’événement qu’est l’Autre. Elle articule ainsi, dans son ouverture à
l’autre dont cependant elle se préserve, le passage à l’altérité.
sans solitude. Solitude innocente. Pas solitude de la mort heideggérienne qui se réfère à la coexistence à laquelle elle s’arrache et qu’elle rend illusoire et pensable. »). 51 « Infini », Encyclopaedia Universalis, vol. 8, pp. 991-994, 1968, réédité in Altérité et Transcendance, op.cit., p. 72.
16
3. L’Autre de la solitude 3.1. La solitude de l’Autre
3.1.1. Solitude et esseulement
Des deux textes philosophiques centraux de Levinas, Totalité et Infini rassemble à lui
seul dix-sept occurrences du mot solitude lorsqu’il est impossible de recenser une unique
mention du terme dans le second ouvrage de 1974. La question de la solitude n’en est pas
pour autant délaissée, et si elle ne fait plus l’objet du même travail d’élaboration, c’est parce
qu’elle devient un lieu de questionnement. Aussi est-elle désormais saisie à partir d’autrui,
venant comme trame du rapport à l’autre :
La mort de l'autre homme me met en cause et en question comme si, de cette mort invisible à
l'autre qui s'y expose, je devenais, de par mon éventuelle indifférence, le complice ; et
comme si, avant même que de lui être voué moi-même, j'avais à répondre de cette mort de
l'autre, et à ne pas laisser autrui seul à sa solitude mortelle.52
Dans la crainte pour autrui et dans le droit d’être qui est le mien et dont il me faut
répondre, c’est désormais de la solitude d’autrui qu’il est question. Car mon existence, c’est-
à-dire l’exercice de mon droit d’être, est déjà le possible esseulement d’autrui dans sa mise à
l’écart de ce que je revendique comme ma place au soleil 53 . Cette thématique de
l’esseulement d’autrui, dans son exposition à la mort et la responsabilité à laquelle celui-ci
en appelle depuis l’abandon auquel je le voue possiblement, traverse les écrits des années
1980. Ainsi, dès 1979, Levinas écrit :
La mort de l’autre homme me met en cause et en question comme si de cette mort, invisible à l’autre
qui s’y expose, je devenais de par mon indifférence, le complice ; et comme si, avant même que de lui
être voué moi-même, j’avais à répondre de cette mort de l’autre, et à ne pas laisser autrui à la
solitude.54
52 « Philosophie et transcendance » in Encyclopédie philosophique universelle, PUF, 1989 réédité in Altérité et Transcendance, op.cit., p. 45. 53 « Avoir à répondre de son droit d'être, non pas par référence à l'abstraction de quelque loi anonyme, de quelque entité juridique, mais dans la crainte pour autrui. Mon être-au-monde ou ma "place au soleil", mon chez-moi, n’ont-ils pas été usurpation des lieux qui sont à d'autres déjà par moi opprimés ou affamés, expulsés dans un tiers-monde : un repousser, un exclure, un exiler, un dépouiller, un tuer. » (« De l'Un à l'Autre. Transcendance et Temps », in Entre Nous, op.cit., p.155). 54 « Notes sur le sens », 1979 in De Dieu qui vient à l’Idée, op.cit., p. 245.
17
C’est ce qu’une intervention de 1982 réaffirmera, la mort demeurant cet esseulement
à l’égard duquel je ne saurais demeurer indifférent55 et qui m’éveille à autrui dans
l’ « impossibilité de le laisser seul à sa solitude »56. Il est encore question en 1983 de
l’esseulement vers lequel la mort entraîne possiblement autrui et dont je me rends complice
en le laissant seul à sa solitude mortelle57, ce qu’un texte de 1983 répètera dans des termes
identiques58, auquel fera écho un texte de 1984 :
La proximité du prochain – la paix de la proximité – est la responsabilité du moi pour un
autre, l’impossibilité de le laisser seul face au mystère de la mort. Ce qui, concrètement, est
la susception de mourir pour l’autre.59
En 1989, c’est toujours de la solitude mortelle60 d’autrui dont il question et de la
responsabilité qui m’incombe à son égard. Dans ces dernières années, la solitude est
désormais le lieu depuis lequel l’interdiction d’abandonner l’autre à sa solitude dans le
mystère du mourir va se faire entendre.
3.1.2. L’appel de l’autre rive
Que la solitude soit dorénavant saisie depuis autrui dans son exposition avec la mort
présente une similitude trompeuse avec l’isolement heideggérien dans la mort entendue
comme possibilité la plus propre. Aussi Levinas insiste-t-il sur la nature de cet esseulement :
Nous avons essayé une phénoménologie de la socialité à partir du visage de l’autre homme en
lisant, avant toute mimique, dans sa droiture de visage, une exposition sans défense à
l’esseulement mystérieux de la mort et en entendant, avant toute expression verbale, du fond de
cette faiblesse, une voix qui commande, un ordre à moi signifié de ne pas rester indifférent à
cette mort, de ne pas laisser autrui mourir seul, c’est-à-dire de répondre de la vie de l’autre
homme, au risque de se faire le complice de cette mort.61
55 « Le philosophe et la mort », entretien avec Christian Chabanis, « La mort, un terme ou un commencement ? », Fayard, 1982 in Altérité et Transcendance, op.cit., p. 164. 56 Ibid., p. 166. 57 « Visage dans sa droiture du faire-face à ..., droiture de l'exposition à la mort invisible et à un mystérieux esseulement. » (De l'Un à l'Autre. Transcendance et Temps, in Entre Nous, op.cit., p. 156). 58 « La mort de l'autre homme me met en cause et en question, comme si de cette mort, le moi devenait par son indifférence le complice et avait à répondre de cette mort de l'autre et à ne pas le laisser mourir seul. » (« Détermination philosophique de l'Idée de culture », in Entre Nous, op.cit., p. 192). 59 « Paix et proximité », Les Cahiers de la nuit surveillée, 1984 in Altérité et Transcendance, op.cit., p. 145. 60 « Philosophie et transcendance», in « Encyclopédie philosophique universelle », PUF, 1989 in Altérité et Transcendance, op.cit., p. 45. 61 Ibid., pp. 49-50.
18
C’est depuis la solitude d’autrui que, avant toute expression verbale, une voix me
commande de ne pas rester indifférent à cette mort et ainsi de ne pas laisser autrui à sa
solitude mortelle :
Droiture d’une exposition à la mort, sans défense ; et, avant tout langage et avant toute mimique,
une demande à moi adressée du fond d’une absolue solitude ; demande adressée ou ordre
signifié, mise en question de ma présence et ma responsabilité.62
L’Autre, dans le lointain de sa solitude, m’interpelle depuis un esseulement tel que son
appel vient à moi comme interdiction de le laisser seul à sa mort63. Mais dans l’impossible
abandon d’autrui à cette solitude, il reste encore à savoir ce qu’il me faut répondre à cet
appel :
Même si, face à la mort – où la droiture même du visage qui me demande révèle enfin
pleinement et son exposition sans défense et son faire-face lui-même – même si, à la dernière
extrémité, le ne-pas-laisser-seul-l’autre-homme ne consiste, dans cette confrontation et cet
impuissant affrontement, qu’à répondre « me voici » à la demande qui m’interpelle.64
Dans son épiphanie, le visage de l’autre me demande et m’appelle, avec pour requête de
ne pas le laisser seul, solitude à laquelle ma présence est déjà réponse65. Dans la formulation
du Me voici, c’est la proximité rassurante de l’autre homme qui est exprimée. Mais dans
l’exposition mutuelle à la mort, la solitude s’inscrit alors dans une perspective en laquelle se
dessine son Autre.
3.2. D’une solitude à l’autre
3.2.1. La proximité comme séparation
Dans la proximité, l’ordre de ne pas laisser autrui seul à sa solitude trouve sa réponse.
Cela revient à faire de cette même proximité la contrepartie discrétionnaire de cette solitude
depuis laquelle l’appel de l’autre émane. Or il a été vu que la solitude devait s’estomper
devant la présence d’autrui lorsque formellement entrevue. C’est au même titre que la
proximité d’autrui est à comprendre dans une perspective non-thématisante :
62 « La mauvaise conscience et l’inexorable », Hiver 1981 in exercices de la patience n°2, De Dieu qui vient à l’Idée, op.cit., p. 263. 63 « La proximité de l’autre », entretien avec Anne-Catherine Benchelah, « Phréatique », 1986 in Altérité et Transcendance, op.cit., p. 113. 64 « La conscience non-intentionnelle », 1983, in Entre Nous, op.cit., p. 140. 65 « Le philosophe et la mort », entretien avec Christian Chabanis in « La mort, un terme ou un commencement ? », Fayard, 1982 in Altérité et Transcendance, op.cit., p. 166.
19
Il faut se demander – et ce serait l’autre terme d’une alternative – à propos de l’identité du moi,
si l’altérité d’autrui n’a pas – d’emblée – un caractère d’absolu, au sens étymologique du terme –
comme si autrui n’était pas seulement, au sens logique, autre : autre d’une altérité logiquement
surmontable dans un genre commun – ou transcendentalement surmontable, en se prêtant à la
synthèse opérée par un « je pense » kantien.66
Cette proximité en laquelle l’Autre se tient est telle qu’elle échappe à la communauté
d’un genre, en tant qu’elle se produit plus tôt que toute conscience de soi, dans l’absolue
nudité d’un rapport demeurant en-deçà de toute identité67 et de toute thématisation. Lorsque
la question de l’avec plaçait la proximité d’autrui en contradiction avec ma solitude, il est
désormais permis de mesurer la distance où bée la séparation ontologique non-
thématisable assurant la simultanéité de la proximité et de la solitude d’autrui
La solitude de la Selbstheit selon Rosenzweig ne doit pas être comprise comme l’entend
Heidegger qui en fait un modus deficiens du Mitsein : il s’agirait chez Rosenzweig d’un
isolement ne sortant aucunement de soi, n’ayant aucun souvenir de communauté, mais
isolement étranger aussi à la séparation des choses qui, individus, appartiennent déjà « sans
se connaître » à un genre humain ; il s’agirait d’un isolement du « rien en commun avec
personne et avec rien » et qui n’a pas besoin, disons-le en passant, d’une quelconque
« réduction transcendantale » pour signifier un « hors le monde ».68
Dans cette pensée de la séparation devant beaucoup à l’auteur de L’étoile de la
rédemption, une telle simultanéité prend la forme d’un isolement ne se laissant pas décrire
par le commun, antérieur à tout rapport, où absorption et disparition de l’un par l’autre ne
viendraient plus comme autant d’alternatives.
3.2.2. Solitude et rencontre
Cette pensée de la proximité de l’Autre maintenant la solitude en appelle ultimement à la
définition d’une relation irréductible où l’unique demeure en tant que tel sans que sa solitude
ne s’évanouisse :
Ici au contraire, dans la paix éthique, relation à l’autre inassimilable, à l’autre irréductible, à
l’autre, unique. Seul l’unique est irréductible et absolument autre !69
66 « Paix et Proximité » in Les Cahiers de la nuit surveillée, 1984, in Altérité et transcendance, op.cit., p.141. 67 Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, op.cit., p. 147. 68 « Le dialogue », 1980, in De Dieu qui vient à l’Idée, op.cit., pp. 221-222. 69 « Paix et proximité », in Les Cahiers de la nuit surveillée, 1984 in Altérité et Transcendance, op.cit., p. 142.
20
C’est dans l’irréductibilité de la relation éthique qu’il est permis à l’Autre de demeurer
en tant qu’Autre, dans cette proximité secrétant la séparation qui sous-tend la solitude. On
mesure alors la distance qui sépare désormais Levinas de ses vues initiales sur la solitude,
suivant lesquelles l’existant tenait sa solitude de son unicité dans le clos de la matière,
lorsque c’est désormais dans le rapport à l’autre que la solitude satisfait aux exigences
lévinassiennes. Ne brisant nullement la solitude, la proximité d’autrui n’est ainsi pas à tenir
pour l’échec d’une rencontre mais bien plutôt pour la concrétisation de cette paix dont parle
Levinas où le Même et l’Autre coexistent sans que cela n’enlève à leur singularité :
Il faut se demander si la paix, au lieu de tenir à l’absorption ou à la disparition de l’altérité, ne
serait pas au contraire la façon fraternelle d’une proximité d’autrui, laquelle ne serait pas
simplement le raté d’une coïncidence avec l’autre mais signifierait précisément le surcroît de la
socialité sur toute solitude – surcroît de la socialité et de l’amour.70
Proche de s’effacer mais demeurant égale à elle-même, la solitude apparaît contiguë de
la socialité, au point d’annoncer son retournement dans le surplomb que celle-ci aurait sur
elle, comme si en cet entre-deux que forme la proximité, entre socialité et solitude, se tenait
déjà la condition de la rencontre véritable :
La proximité ou la fraternité n’est ni la tranquillité troublée dans un sujet se voulant absolu et
seul ni le pis-aller d’une confusion impossible.71
Dans un tel basculement, c’est l’Autre de la solitude qui se laisse entrevoir, où la solitude est
d’abord celle d’autrui depuis la proximité dans laquelle il se tient.
Conclusion Peu présente mais pressentie dans les premiers écrits, Levinas approcha la notion de
solitude durant les années de captivité, élaborant sa réflexion à l’aune de ses lectures
littéraires. Contre Heidegger, il entreprit de penser une solitude qui ne se définirait ni par
rapport à autrui, ni dans un hypothétique sujet absolu, ni enfin dans l’esseulement de la mort.
Levinas développa à cet effet une ontologie de la solitude fondée sur la fatalité de la
matière et en cela indépassable, la solitude trouvant son unité constituante dans le définitif de
l’identité du sujet. Mais dans l’inévitable retour à soi de la raison s’annonçait déjà la relation
70 Ibid., p. 142. 71 Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, op.cit., p. 148.
21
à l’autre, ce qui conduisit Levinas à admettre la solitude comme paradoxale relation
première. Il s’agit alors de rompre avec une compréhension purement formelle de la solitude,
pour penser une présence d’autrui ne m’enlevant pas à mon exister solitaire. Cela revint à
penser la solitude au seuil de l’événement qu’est l’Autre.
Faussement absente des derniers écrits, c’est une solitude autre qui traverse les
derniers écrits de Levinas. Du questionnement, elle est désormais moins l’objet que le lieu,
intervenant comme trame des développements relatifs à l’exposition d’autrui à la mort et
l’esseulement auquel il m’enjoint de ne pas l’abandonner. Depuis sa solitude et dans son
appel, l’Autre exige alors de comprendre la proximité en laquelle il se tient, proximité telle
que la distance séparant l’Autre du Même maintienne cependant la solitude du Moi. C’est
finalement dans sa contiguïté avec l’altérité que la solitude décrit son Autre.
Contre son équivocité apparente, la solitude vient donc comme une composante
transversale du discours lévinassien. Dans la constellation formée par ses multiples figures,
d’une solitude à l’autre, se dessine par-delà les arabesques de la pensée et les notions de
responsabilité, de proximité et de rencontre, une attention à autrui, « attention au malheur
sans laquelle tout rapport retombe dans la nuit »72.
72 Maurice Blanchot, L’entretien infini, Gallimard, 2009, p. 197.
22
BIBLIOGRAPHIE PRIMAIRE Levinas – Livres, textes et entretiens
1935
De l’Evasion, Livre de Poche, 2011, 2ème édition
1937-1950
« Carnets de captivité 1940-1945 », in Œuvres complètes I, Grasset, 2009
1940
« L’œuvre d’Edmond Husserl », in En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger,
Vrin, 2010, 4ème édition corrigée
1949-1950
« Notes philosophiques diverses », Liasse A, in Œuvres complètes I, Grasset, 2009
1947
« L’Autre dans Proust », in Noms propres, Montpellier, Fata Morgana, 2014
Le temps et l’autre, Paris, PUF, 2009
De l’existence à l’existant, Paris, Vrin, 2004
1948
« Parole et Silence », Conférence prononcée les 4 et 5 février 1948, in Œuvres complètes II,
Grasset, 2011
1961
Totalité et Infini, Paris, Livre de Poche, 2009, 12ème édition
1968
Infini, « Encyclopaedia Universalis », vol. 8, pp. 991-994, in Altérité et Transcendance,
Livre de poche, 2006/2014, 5ème édition
1972
« Idéologie et Idéalisme » in De Dieu qui vient à l’idée, Vrin, 2004
1974
Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Livre de poche, 2008, 6ème édition
1976
« Le temps pensé à partir de la mort », in Dieu, la Mort et le Temps, Livre de Poche, 2010,
5ème édition
1979
« Notes sur le sens » in De Dieu qui vient à l’Idée, Vrin, 2004
1980
« Le dialogue », in De Dieu qui vient à l’Idée, Vrin, 2004
23
1981
« La mauvaise conscience et l’inexorable » in exercices de la patience n°2, in De Dieu qui
vient à l’Idée, Vrin, 2004
1982
« Le philosophe et la mort », entretien avec Christian Chabanis, « La mort, un terme ou un
commencement ? », Fayard, 1982 in Altérité et Transcendance, Livre de Poche, 2006, 6ème
édition
1983
« De l'Un à l'Autre. Transcendance et Temps », in Entre Nous, Livre de poche, 2014, 6ème
édition
« Détermination philosophique de l'Idée de culture », in Entre Nous, Livre de poche, 2014,
6ème édition
1984
Ethique et Infini, Livre de Poche, 2008, 14ème édition
« Paix et Proximité » in « Les Cahiers de la nuit surveillée », in Altérité et transcendance,
Livre de Poche, 2006, 6ème édition
1986
« La proximité de l’autre », entretien avec Anne-Catherine Benchelah, « Phréatique », in
Altérité et Transcendance
« De l'Unicité », in Entre Nous, Livre de poche, 2014, 6ème édition
1989
« Philosophie et transcendance », in « Encyclopédie philosophique universelle », PUF, 1989
in Altérité et Transcendance, Livre de Poche, 2006, 6ème édition
BIBLIOGRAPHIE SECONDAIRE
BLANCHOT, L’entretien infini, Paris, Gallimard, 2009
HEIDEGGER, Etre et Temps, Paris, Gallimard, 1986
HEIDEGGER, Prolégomènes à l’histoire du concept du temps, Gallimard, 2006
LESCOURET, Marie-Anne, Levinas, Flammarion, Grandes biographies, 1994
24
TABLE DES MATIERES
Introduction ...................................................................................................................................... 2
1. Repenser la solitude .................................................................................................................... 2 1.1. Les étapes d’une définition .............................................................................................................. 2
1.1.1. Prélude d’une thématique centrale ......................................................................................................... 2 1.1.2. La littérature comme lieu d’élaboration ............................................................................................... 3
1.2. Contre Heidegger ............................................................................................................................... 5 1.2.1. Une solitude trop peu seule ....................................................................................................................... 5 1.2.2. L’artificielle solitude du Dasein .............................................................................................................. 6 1.2.3. La place de la mort ...................................................................................................................................... 7
2. De la solitude à l’Autre ............................................................................................................... 8
2.1. Ontologie de la solitude .................................................................................................................... 8 2.1.1. La fatalité esseulante de la matière ........................................................................................................ 8 2.1.2. La solitude comme catégorie de l’être ............................................................................................... 10
2.2. L’irruption de l’Autre dans la solitude ...................................................................................... 11 2.2.1. L’inquiétude pour autrui de la raison ................................................................................................. 11 2.2.2. La solitude comme première relation ................................................................................................. 12 2.2.3. Seul sans solitude ...................................................................................................................................... 14
3. L’Autre de la solitude ............................................................................................................. 16
3.1. La solitude de l’Autre .................................................................................................................... 16 3.1.1. Solitude et esseulement ........................................................................................................................... 16 3.1.2. L’appel de l’autre rive ............................................................................................................................. 17
3.2. D’une solitude à l’autre ................................................................................................................. 18 3.2.1. La proximité comme séparation ........................................................................................................... 18 3.2.2. Solitude et rencontre ................................................................................................................................ 19
Conclusion ...................................................................................................................................... 20































![Emmanuel Levinas: Ikvat ha'acher [The Trace of the Other], translation and commentary (in Hebrew)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6338ac2b6a241b539d0080eb/emmanuel-levinas-ikvat-haacher-the-trace-of-the-other-translation-and-commentary.jpg)