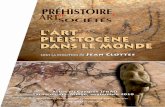De ontrafeling van een vrouwenberoep: Tapijtknoopsters in Rabat-Sale (Marokko) (1992)
STRATIGRAPHIE, SEDIMENTOLOGIE ET AGE DE LA FORMATION DU CORDON LITTORAL « POST-OULJIEN » DE TEMARA...
Transcript of STRATIGRAPHIE, SEDIMENTOLOGIE ET AGE DE LA FORMATION DU CORDON LITTORAL « POST-OULJIEN » DE TEMARA...
Sommaire RQM6, 2014
Gourari L. Typologie morphologique et pétrographie des travertins plio-quaternaires du géosystème karstique de l’Oued Aggai (Causse de Sefrou, Moyen-At las, Maroc).
Moussa K. et Boualla N. La sédimentation plio-quaternaire d’Oran (Ouest Algérie) : Aspects stratigraphiques et sédimentologiques.
Gretaa M., Aarab M., El Kamar1 A. & Laabidi A. Le Quaternaire de la région de Zebzat (Haute Moulouya, Maroc)
Laabidi A., Gourari L., El Hmaidi A. & Aarab M., Géomorphologie, lithostratigraphie et sédimentologie des dépôts quaternaires du bassin hydrographique de l’Oued Salloum (région
Sidi Abdalwahid, extrémité sud-est de la boutonnière d’Ahouli-Mibladane, Haute Moulouya, Maroc)
Sadkaoui D., Gourari L., Benabdelhadi M., El Arabi H., Oujaa A. & Fontugne M. Etude géomorphologique de Boutkhoubaye au nord-est de Michlifène (Moyen Atlas , Maroc).
Chahid D., Boudad L., Lenoble A., El Hmaidi A., Chakroun A., Jacobs Z. & Sitzia L. Stratigraphie , sédimentologie et âge de la formation du cordon littoral « post-ouljien » de Témara (sud-ouest de Rabat,Maroc).
Boudad L., Malek F., Baidder L. & Ridaoui M. Etude préliminaire d’une formation palustre holocène du bassin d’Ouarzazate à Skoura (sud-est du Maroc)
Aberkan M., Aboumaria Kh. & Ouadia M. Apport de l’observation du paysage côtier actuel et de l’organisation des séquences littorales sur la paléogéographie du pléistocène
récent au nord-ouest de Rabat (Maroc).
Damnati B., Etebaai I., Rhoujjati A., Arnaud D., Decobert M., Marais A. & TaiebM. Reconstitution de l’environnement lacustre actuel et de l’évolution paléo-climatique depuis 29.000 ans à partir d’une étude
multidisciplinaire des eaux et des sédiments: cas du lac Ifrah (Moyen Atlas, Maroc)
Idder A., Idder T., Nezli I., Cheloufi H., Hamdiaissa B., Hacini M. & Khemis R. Conséquence des interactions sol-eau sur la salinisation des aridosols nus (cas de la cuvette de Ouagla / Sahara algérien)
Damnati B., Ben Hardouze H. & Guibal F. Reconstitution du climat en se basant sur la dendroclimatologie : étude préliminaire du cas du cèdre de l’atlas (Moyen Atlas Marocain)
Aït Touchnt A., Boudad L., Peretto C., Vaccaro C. & Arzarello M. Approvisionnement en matières premières dans les sites paléolithiques de surface du sud-est marocain : sites d’Aza et d’Imlil.
El Hmaidi A., Zahid S., Abdallaoui A. & El Moumni B. Application des réseaux de neurones artificiels pour la prédiction des teneurs en carbone organique dans les dépôts du quaternaire
terminal de la mer d’Alboran.
Aouadi N., Khedhaier-El Asmi R., & Belhouchet L. Contribution à la connaissance des comportements de subsistance au Paléolithique Moyen en Tunisie : la faune du niveau moustérien
du site de l’Aïn el Guettar (Tunisie centrale)
Ouchaou B. Réexamen des caprines (Bovidae , Mammalia) du gisement de Kaf-Taht-el Ghar (Tétouan, Maroc).
Dridi Y., Aouadi N., Belhouchet L. & Mulazzani S. Nouvelles données sur le site néolithique de Kef el Agab (Jendouba, Tunisie)
Roubet C. & Ouchaou B. Sur la domestication animale holocène en Afrique du nord. Regard vers le pastoralisme en Algérie et au Maroc VI-III millénaire. cal BC.
Ben-Ncer A. & Bokbot Y. Etude de la sépulture 1 d’ifri n’Amr ou Moussa (Aït Siberne, Maroc)
Nocairi M., Ibnoussina M., Witam O. & El idrissi Laaouini My S. Les caracteristiques technologiques de l’industrie lithique du site d’Abadou (Marrakech, Maroc).
Heddouche A., Amara A., iddir S., benselama L. & Harichene Z. Recherches préhistoriques à Tabelbala (Saoura, Algérie): premiers résultats
Belhouchet L., Aouadi-Abdeljouad N. & Karray M. R. Les plus anciens témoignages de présence humaine en Tunisie centrale
Kherbouche F., Hachi S., Abdessadok S., Sehil N., Harichane Z., Merzoug S., Sari L., Fontugne M., Agsous S., Barbaza M. & Roubet C . Nouvelles recherches préhistoriques dans l’Adrar Gueldaman (Akbou, Algérie): premières fouilles dans la grotte GLD 1
Heddouche A. & Iddir S. Chronologie relative de quelques monuments funéraires de l’Ahaggar
Aïssani B. Modèle de formation des effondrements du Sahara septentrional algérien : cas de M’Rara et de Saheb-elbir.
7
18
24
36
47
60
73
79
86
93
101
107
127
135
146
164
175
191
199
205
215
219
229
235
Act
es d
e la
six
ièm
e R
enco
ntre
des
Qua
tern
aris
tes
Mar
ocai
ns (
RQ
M6)
2014
Géosciences, environnement et patrimoine de part et d’autre du détroit
de GibraltarActes de la sixième Rencontre des Quaternaristes Marocains (RQM6)
Tanger, 15-17 Novembre 2011
Publications de l’Association Marocaine pour l’Etude du QuaternaireSous la Direction scientifique des Prs. A. OUJAA, L. BOUDAD & B. OUCHAOU
ASSOCIATION MAROCAINEPOUR L’ETUDE DU QUATERNAIRE(AMEQ)
Mai 2014
Association AnnaserMIDAR
Comité de lecture (RQM6) :Oujaa A. (INSAP, Rabat); Boudad L. (FST, Errachidia); Ouchaou B. (FS, Meknès); Aboumaria K. (FST, Tanger); Aouraghe H. (FS, Oujda); Damnati B. (FST, Tanger); Debénath A. (MNHN, Paris); El Hammouti K. (FS, Oujda); El Hamouti N. (FS, Nador); Gourari L. (FS, Fès) ; Hachid M ; (CNRPAH, Alger); Lemjidi A. (CNPR, Agadir); Merzoug S. (CNRPAH, Alger); Nami M. (DPC, Rabat); Nespoulet R. (MNHN, Paris); Stoetzel E. (MNHN, Paris); Weisrock A. (MNHN, Paris);
60
STRATIGRAPHIE, SEDIMENTOLOGIE ET AGE DE LA FORMATION DU CORDON LITTORAL « POST-OULJIEN » DE TEMARA (SUD-OUEST DE RABAT, MAROC)
Stratigraphy, Sedimentology and age of the formation of temara “poSt-ouljian” coaStal ridge (South-weSt of rabat, morocco).
Driss CHAHID1, Larbi BOUDAD2, Arnaud LENOBLE3, Abdellah EL HMAIDI1, Amel CHAKROUN4, Zenobia JACOBS5, Luca SITZIA3
1Université Moulay Ismail, Faculté des Sciences, Département de Géologie, BP.11202, Zitoune, Meknès, Maroc ([email protected]) ; ([email protected] )2Université Moulay Ismail, Faculté des Sciences et Techniques, Département de Géologie, BP. 509, Boutalamine, Errachidia, Maroc , ([email protected])3Université Bordeaux I, PACEA – UMR CNRS 5199 ; 33405, Talence, France ([email protected]) ; ([email protected])4Université de Tunis, Faculté des Sciences, Département de géologie, Campus Universitaire, 2092, El Manar II, Tunisie ([email protected])5University of Wollongong, Centre for Archaeological Science, School of Earth and Environmental Sciences, Wollongong, NSW 2522, Australia ([email protected])
Résumé : La bande côtière atlantique de Témara (SW de Rabat, Maroc) est constituée de formations quaternaires sous forme de cordons dunaires allongés et juxtaposés parallèlement au trait de la côte. Cette étude porte sur l’analyse lithostratigraphique du dernier cordon dunaire consolidé qui se développe de la banlieue sud de Rabat jusqu’à l’entrée de la baie de l’oued Ykem. La falaise vive actuelle, creusée dans ce cordon, s’interrompt pour former les criques de Témara plage et de Val d’Or. Plusieurs études anciennes ont abordé sa constitution et son âge, mais leurs conclusions contradictoires sont sujettes à caution.
Le présent travail se base sur la description lithologique et l’analyse sédimentologique et stratigraphique des dépôts. Il en ressort une structure commune à l’ensemble du cordon où dominent des calcarénites éoliennes au sein desquelles s’intercale un dépôt supratidal, historiquement connu sous le nom de «Marne de Témara». Les observations stratigraphiques autorisent plusieurs scénarios d’âges pour ce cordon. La datation par OSL montre finalement que la totalité des unités constituant ce cordon s’est mise en place au cours du stade isotopique 5c.
Mots clés : Quaternaire, Pléistocène, Ouljien, formation littorale, calcarénite, Marne de Témara, lithologie, stratigraphie, stade isotopique 5, datation OSL, Maroc.
abstract: The Atlantic coastline in the Temara area (SW Rabat, Morocco) is composed of Quaternary formations that form elongated ridges running parallel to the shoreline. This study focuses on the lithostratigraphic analysis of the last consolidated ridge between the southern suburbs of Rabat to the entrance of the bay of the Ykem river. The current coastal cliff is dug deep current in this ridge that interrupts to form the coves of Temara and Val d’Or. Several early studies considered its constitution and age, but they led to contradictory results.The present study is based on the lithological description and on the sedimentological and stratigraphic analysis of deposits. The results show a common structure for the ridge with a dominance of coastal aeolianites, in which a supratidal deposit historically known as the “Marne de Témara” is interlayered. Stratigraphic observations allow multiple scenarios for the ages of the ridge. OSL dating of all the ridge units finally shows that all is set up during the 5c isotopic stage.
Key-words: Quaternary, Pleistocene, Ouljian, dunes ridges, calcarenite, Marne de Témara, lithology, sedimentology, stratigraphy,
isotopic stage 5, Temara, Morocco.
D. CHAHID et al, Actes RQM6, 2014, 60- 72
61
1. INTRODUCTION
La région de Témara, située sur la côte atlantique, appartient à la Meseta côtière nord-occidentale (fig. 1). Elle est limitée géographiquement par la ville de Rabat au nord-est, par l’oued Akrach à l’est, par l’oued Ykem au sud-ouest et par l’océan atlantique à l’ouest. Le Quaternaire de la région est représenté par des dépôts littoraux sous forme de cordons côtiers pléistocènes étagés, qui recèlent de nombreux sites préhistoriques en grotte.
Figure 1. Localisation des coupes étudiées sur le littoral de Témara.Figure 1. Location of the studied sections on the Temara coast.
2. CADRE GEOLOGIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE
La bande côtière de Témara fait partie de la Meseta côtière marocaine constituée de plaines et de plateaux, délimités par l’océan Atlantique à l’ouest, la chaîne rifaine au nord, la chaîne moyen atlasique à l’est et par le Haut Atlas au sud. La Meseta présente une morphologie en gradin doucement incliné vers l’Atlantique et s’étend de Safi jusqu’aux environs de Rabat. Elle est caractérisée par un système de cordons dunaires plio-quaternaires et de sillons inter-dunaires, parallèles entre eux et à la côte actuelle (Guilcher et Joly, 1954).Les formations quaternaires littorales, de la région de Témara, s’étendent depuis le Moghrébien (Choubert et Ambroggi, 1953) jusqu’au Rharbien (Choubert et Marcais, 1947 ; Lecointre, 1952 ; Gigout, 1957 ; Beaudet, 1969).
Entre le Bouregreg au nord-est et l’oued Ykem au sud-ouest, six principaux cordons dunaires s’allongent parallèlement au littoral (Beaudet, 1969). De la côte vers le continent, leurs sommets atteignent,
respectivement, les altitudes suivantes : 30-40 m, 50-60 m, 100-110 m, 160-170 m, 190-200 m et 240-250 m. Il ne s’agit ici que des principales formes, elles-mêmes constituées de plusieurs rides. Nos investigations nous ont permis de distinguer jusqu’à douze cordons plio-quaternaires pour les seuls 150 premiers mètres d’élévation de la bande côtière (fig. 2). Ces formations se développent sur un substratum constitué de marnes et sables biodétritiques miocènes (Chabli, 2009) et calcaire givetien (de l'oued Ykem) et des schistes primaires (Lacroix, 1974). L’ensemble du secteur montre une inclinaison vers l’océan atlantique (fig. 3).
Figure 2. Profil topographique avec identification et âges des différents cordons littoraux de Témara 1 à 12 : nombre de cordon.Figure 2. Topographical profile with identification and age of differents Temara coastal ridges 1 to 12 : nombre of ridges.
Figure 3: Carte géologique de la région de Témara (extrait de la carte de Rommani 1/100 000).Figure 3 : Gelogical map of Temara (extraction from the map of Rommani 1/100 000)
3. MATERIEL ET METHODES L’étude présentée ici concerne le plus jeune des cordons littoraux de Témara, c’est-à-dire le plus bas et le plus proche de la mer, dans lequel est taillée la falaise vive formant le trait de côte actuel. Elle se
D. CHAHID et al, Actes RQM6, 2014, 60- 72
62
base sur la description des faciès sédimentaires à des échelles macro et microscopiques, la reconstitution des géométries des corps sédimentaires et l’analyse stratigraphique des unités distinguées (Chahid, 2011). Elle se complète par la datation des dépôts par la méthode de luminescence stimulée optiquement (OSL) sur grains de quartz.
4. LITHOSTRATIGRAPHIE ET SEDIMENTOLOGIE DES FORMATIONS
Les cinq localités retenues dans cette étude s’étendent sur une dizaine de kilomètres entre Rabat et Skhirat de Dar es Soltan, au nord, jusqu’à Sidi El Abed, au sud (fig. 1). Les dépôts y sont décrits de bas en haut.
4. 1. Coupe de Dar es SoltanLa coupe de Dar es Soltan se situe sur la falaise vive à Dar es Soltan, au niveau de la station de pompage où le cordon apparait constitué par la superposition de quatre unités (fig. 4).
Figure 4. Coupe de Dar es Soltan.Figure 4. Dar es Soltan section.
L’unité 1, située sous l’action directe des vagues, est visible sur plus de 5 m d’épaisseur sans que sa base n’apparaisse. C’est une calcarénite indurée constituée d’un sable moyen à grossier jaunâtre. Les lits, décimétriques à pluridécimétriques, présentent une stratification plane oblique et une inclinaison de 22° vers l’est. Le passage à l’unité sus-jacente est marqué par un contact diffus. Sous le microscope, cette unité est une calcarénite grainstone de sables grossiers (taille moyenne 0,8 mm). Les grains arrondis, moyennement triés, sont formés de rares grains minéraux, d’isoclastes et surtout de bioclastes (algues, échinodermes et mollusques). Les enveloppes micritiques et une recristallisation
sparitique des bioclastes attestent d’une maturation par diagénèse précoce du matériel sédimentaire. Le ciment sparitique comble la plus grande partie des vides intergranulaires tandis-que des figures de dissolution (pores interganulaires) témoignent d’une évolution significative du sédiment après dépôt.
L’unité 2 est une calcarénite de structure massive constituée de sables moyens bien classés, riches en fragments de coquilles de taille millimétrique. Son épaisseur est d’environ 1,7 m. Elle est séparée du dépôt qui la surmonte par un contact assez net. En recul de la falaise, où l’unité 3 sus-jacente se biseaute, le sommet de l’unité 2 se marque alors par une calcrète pluricentimétrique laminée discontinue, de couleur rosâtre. La partie sommitale de cette unité porte par endroit des moules de racines (rhizolithes). Le microfaciès est identique à celui du dépôt sous-jacent.
L’unité 3 est une formation assez peu consolidée, composée de sables fins légèrement limoneux rougeâtres, très riches en coquilles bien conservées ou en débris de gastéropodes terrestres et marins. Son épaisseur est variable ; d’une puissance d’un mètre au niveau de la falaise, le dépôt est biseauté par la surface topographique actuelle en s’éloignant du front de la mer. Ce dépôt a été qualifié de « marne de Témara » par Bourcart (1943) tandis que Gigout (1957) le reconnaît sous le terme de grès rose. Le contact avec l’unité 4 sus-jacente est net et rectiligne.
Le microfaciès est distinctif (fig. 5). La quasi-totalité des bioclastes est anguleux et les grains minéraux, représentés par des quartz auxquels s’ajoutent quelques feldspaths et augites, forment une fraction significative du dépôt. La fraction limoneuse est présente sous la forme de coiffes qui enrobent partiellement les grains et la roche reste une calcarénite grainstone, mais mal triée. Enfin, la cimentation est moins importante, limitée à la formation d’un ciment microspartique impure revêtant les grains ou colmatant les pores les plus petits.
D. CHAHID et al, Actes RQM6, 2014, 60- 72
63
Figure 5. Lames minces au niveau du cordon post-ouljien de Témara. (A) Unité 3 – b : bioclaste, q : quartz ; (B) unité 1- a : algue, bm : bioclaste micritisé, bs : bioclaste sparitisé, pi : porosité intragranulaire, pv : porosité vacuolaire.Figure 5. Thin-sections on the post-ouljian ridge of Temara. (A) Unit 3 - b: bioclast, q: quartz (B) Unit 1 - a: algae, bm: micritized bioclasts, bs: sparitized bioclast, pi: intragranular porosity, pv: vuggy porosity.
L’unité 4 est une calcarénite composée d’un sable moyen jaunâtre, bien classé et riche en débris de coquilles. Par endroit, on observe un litage plan incliné de 3° à 5° vers l’est, c’est-à-dire vers le continent. Elle recèle quelques coquilles complètes de gastéropodes pulmonés de différents types. Son épaisseur augmente (de 0 à 0,80 m) vers la mer (épaisseur sur le bout de la falaise 0,80 m). Sa surface est fortement lapiazée avec des concrétionnements calcaires rosâtres (calcrètes). Le microfaciès est assez proche de celui des dépôts présents à la base du cordon, en ce sens que les grains minéraux sont rares et que les bioclastes sont recristallisés et subarrondis à arrondis. Il s’en distingue toutefois par une taille moyenne des grains moindre (0,75 mm) et par une cimentation sparitique ne colmatant que partiellement la porosité.
interprétation :
La coupe de Dar es Soltan est formée de quatre unités. La structure de l’unité de base, à savoir un litage plan fortement incliné (22° E), est un bon indicateur d’une formation dunaire (Purser, 1980 ; Reineck et Singh, 1975). La direction du pendage indique l’orientation des vents ayant conduit à l’édification de la dune, à savoir des vents marins dirigés vers le continent.
L’unité 2 se distingue de l’unité précédente par la disparition de la structure sédimentaire, les autres caractéristiques de nature, de taille ou de classement des grains restant identiques. Le contact diffus entre les deux unités et le caractère massif de cette unité peuvent être mis en relation avec un arrêt de sédimentation s’accompagnant d’une bioturbation des dépôts dont les rhizolites observés au sein de l’unité 2 seraient une manifestation (Purser, 1980). Le bon classement des grains indique que cette perte de structure se serait faite à partir d’une calcarénite éolienne, ou éolianite (Reineck et Singh, 1975).
L’unité 3, en revanche, présente un mauvais tri des constituants sableux et une association de fractions sableuse et limoneuse qui ne permettent plus d’y reconnaître un dépôt éolien. L’absence de toute trace de décarbonatation du dépôt exclût également l’origine à partir de la formation d’un sol par décarbonatation d’une calcarénite, comme cela a été décrit dans les éolianites littorales fossiles au nord de Rabat (Aberkan, 1989). Ce dépôt se caractérise en revanche, par une association de deux sources sédimentaires : un stock marin représenté par les nombreux bioclastes et un stock continental figuré par les grains minéraux plus nombreux ainsi que par la fraction limoneuse ou encore par les coquilles entières ou fragmentées de gastéropodes continentaux. Une seconde caractéristique de ce dépôt est le renouvellement du stock marin qui le constitue. Ce dernier n’est plus, à la différence des dépôts sous-jacents, un sédiment ayant maturé à l’espace intertidal ou sur les hauts de plage, comme l’atteste l’absence de toute forme de diagenèse précoce et le mauvais arrondi des grains, mais il représente un apport en sédiment frais prélevés vraisemblablement en dehors de la zone d’action des vagues. Cette dernière caractéristique peut marquer un prélèvement de sédiment marin à l’étage supratidal par un ou plusieurs événements
D. CHAHID et al, Actes RQM6, 2014, 60- 72
64
exceptionnels (Caron, 2011). C’est pourquoi, sur la base de ces deux caractéristiques, on reconnaît dans cette unité des sédiments accumulés à l’étage supratidal par des événements rares de type tempête ou autre.
Avec la calcarénite de l’unité 4, le bon classement et la nature des grains (bioclastes arrondis à diagenèse précoce) témoignent d’un dépôt dunaire littoral nourri pas des sables prélevés sur la plage. Le litage subhorizontale indique la constitution d’une nappe éolienne venant couvrir un relief déjà constitué, tandis-que la taille moyenne des grains refléterait l’importante relative de la distance par rapport à la source, c’est à dire du rivage (Weisrock et al., 2002). Ce plaquage éolien aurait donc pu se former en phase régressive sur un cordon déjà formé, alors que le reste des accumulations dunaires se situeraient quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres à l’ouest, dans un secteur aujourd’hui submergé. La calcrète rosâtre qui se surimpose au sommet de ce dépôt résulte, quant-à elle, à la redistribution des carbonates par altération du toit de cette calcarénite depuis sa formation et la coloration pourrait être due aux oxydes de fer.
4.2. Coupe d’El Harhoura
La coupe d’El Harhoura, localisée au niveau de la falaise vive, est constituée de quatre unités (fig. 6).
Figure 6. Coupe d’El Hahoura.Figure 6. El Hahoura section.
L’unité 1 est exposée à l’action directe des vagues. Elle affleure sur une épaisseur de 4 m au plus. Le faciès est celui d’une calcarénite brunâtre constituée de sables moyens à moules internes millimétriques de débris de coquilles. La structure est celle d’une stratification plane oblique par superposition de
lits centimétriques à infradécimétriques inclinés de 20° vers l’est.
L’unité 2 repose en discordance angulaire sur l’unité précédente. Il s’agit d’une calcarénite jaunâtre composée de sables moyens riches en débris de coquilles et épaisse d’environ 4 m. Elle est composée de lits pluricentimétriques subhorizontales à faiblement inclinés vers l’est. Elle se termine vers le sommet, à certains endroits, par une calcrète rosâtre à blanchâtre d’épaisseur inférieure à 3 cm.
L’unité 3 repose sur la surface irrégulière du toit de l’unité 2. Elle est massive, moyennement consolidée et son épaisseur ne dépasse pas 0,5 m. Elle est caractérisée par une teinte rougeâtre et une texture sablo-limoneuse avec de nombreuses coquilles complètes ou brisées de gastéropodes. Il s’agit essentiellement de gastéropodes terrestres (pulmonés) auxquels s’ajoutent quelques coquilles marines. Des manchons racinaires de diamètre très variables se surimposent au dépôt. Le passage à l’unité 4 est brutal et légèrement irrégulier.
L’unité 4 est une calcarénite jaunâtre, massive, constituée de sables moyens associés à des coquilles entières ou fragmentées de gastéropodes pulmonés cristallisés. Son épaisseur de 0,35 m est faible. Tout comme à Dar es Soltan, les unités 3 et 4 ne sont préservées que localement. Leur extension latérale ne dépasse pas quelques dizaines de mètres.
interprétation :
La similitude stratigraphique et lithologique entre cette section est celle de Dar es Soltan est remarquable. A la base du cordon, la stratification de l’unité 1, plane à forte inclinaison des lits de 20° E, indique une formation éolienne (Purser, 1980 ; Reineck et Singh, 1975). Ensuite, l’unité 2, aussi calcarénite éolienne, diffère de la précédente par sa structure. A El Harhoura, la stratification du dépôt, partiellement préservée avec un litage de faible inclinaison vers l’est, indique une accumulation formée au toit du cordon, une fois ce dernier est constitué. La surface d’érosion, séparant cette unité de la précédente, ne représenterait qu’une surface de réactivation du cordon et par conséquent la succession d’unités n’impliquerait pas obligatoirement deux phases distinctes de formation du cordon, mais probablement une seule. En effet, l’accroissement du cordon et le
D. CHAHID et al, Actes RQM6, 2014, 60- 72
65
déplacement corrélatif des fronts d’avalanche des dunes suffisent à générer une telle succession de structures (McKee, 2004).
Enfin, les faciès des unités 3 et 4 sont similaires à ceux observés à Dar es Soltan. C’est pourquoi la même interprétation peut être proposée, celle d’une unité 3 issue d’un remaniement à l’état supratidal d’un dépôt continental enrichi en apports marins, alors que l’unité 4 représenterait une nouvelle phase d’accrétion du cordon à la suite de nouveaux apports éoliens.
4. 3. Profil de Miramar
Au niveau du restaurant Miramar, en bordure septentrionale de la crique de Témara, peuvent être observées les dépôts formant le cordon, ainsi que leur relation avec les dépôts plus récents préservés dans l’oulja. Du rivage atlantique jusqu’au centre de l’oulja, c’est-à-dire vers le centre du sillon inter-dunaire situé en recul du cordon littoral (fig. 7), un profil a été choisi pour représenter les différents dépôts mis en place dans la région. Neuf unités y sont distinguées.
Figure 7. Profil de Miramar représentant les différentes unités superposées, emboitées ou se relayant latéralement.Figure 7. Profile of Miramar representing different units superposed, nested or taking turns laterally.
L’unité 1 est une calcarénite éolienne de texture sableuse (sable moyen à grossier) riche en débris de coquilles millimétriques, à litage subhorizontal. Son épaisseur, maximale avec environ 4 m sur le bord de la falaise, diminue progressivement de puissance vers le continent.
L’unité 2 présente une épaisseur d’environ 0,75 m au maximum. Elle se biseaute vers l’ouest et latéralement dans la direction nord-sud. Elle est formée d’un sédiment rouge clair sablo-limoneux riche en coquilles, complètes ou brisées, de gastéropodes marins et terrestres auxquels s’ajoutent de nombreux moules de racines et de rares lithoclastes de calcarénites infradécimétriques. Il s’agit du même faciès rencontré au niveau des coupes de Dar es Soltan et d’El Harhoura (unité 3 des figures 4 et 6).
L’unité 3 est une calcarénite jaune clair, massive de texture sableuse (sable moyen), présentant un bon classement. Sa surface est faiblement lapiazée et son épaisseur est d’environ 20 cm. Elle se coiffe par endroits par une calcrète finement laminée rougeâtre.
L’unité 4 est une lumachelle jaunâtre massive à
éléments figurés infracentimétriques représentés par des débris de coquilles et des lithoclastes. Des galets, d’environ 4 cm de longueur, aplatis et de pétrographie variée, peuvent localement y être observés. Cette unité présente une épaisseur d’environ 40 cm sans que sa base ne soit atteinte. Son toit lapiazé est tapissé d’une couche centimétrique de calcrète finement laminée brune à rougeâtre.
L’unité 5 est un dépôt meuble caractérisé par une texture limono-sableuse, une structure massive et une couleur rouge. Son épaisseur est faible de l’ordre du décimètre au plus. Elle comble pour partie les poches du lapiaz de la lumachelle sous-jacente (unité 4).
L’unité 6 est composée d’un sable coquillé brun fin à moyen lité et faiblement induré. Elle est observée sur une épaisseur inférieure au mètre. Sa structure livre une alternance de lits centimétriques à décimétriques, très riches en coquilles marines (bivalves, patelles, oursins…) où des structures entrecroisées de paléo-chenaux peuvent être aisément reconnues.
L’unité 7 se développe sur une longueur d’environ 100 m transversalement à l’Oulja et se suit de façon discontinue sur plusieurs kilomètres entre Dar es Soltan au nord et Miramar au sud. Deux faciès
D. CHAHID et al, Actes RQM6, 2014, 60- 72
66
se relaient latéralement. En direction du centre de l’Oulja, le dépôt est formé d’un grès grisâtre induré où alternent des lits de sable fin à moyen riches en débris de coquilles et des lits bruns claires de sable grossier à moyen à grands fragments de coquilles complètes (sous-unité 7a). Parmi ces coquilles, on relève la présence de moules, parfois sous la forme d’amas. Des lithoclastes rougeâtres de tailles et de formes variables que l’on pense issus de l’unité 4 démantelée, sont fréquemment associés à ces amas de moules. La surface de cette unité est généralement plane, localement lapiazée. Des structures métriques à inframétriques en auges
témoignent de paléochenaux (fig. 8).
En direction du cordon (falaise vive), la sous-unité 7a passe par interdigitations à un grès fin rouge clair massif représentant la sous-unité 7b. Cette dernière, d’épaisseur décimétrique, repose sur le lapiaz de l’unité 1 conformément à la topographie du cordon. Elle renferme des gastéropodes pulmonés et des lithoclastes de tailles variables, généralement anguleux et revêtus d’une couche de calcrète rouge. Il s’agit d’un caractère spécifique permettant de distinguer ce placage rougeâtre du faciès de l’unité 2 qui lui est très proche.
Figure 8: (A) Vue de surface des chenaux de la sous-unité 7a; (B et C) Section latérale de la sous-unité 7b et l’unité6.Figure 8. (A) Surface view of the channels of the sub-unit 7a (B and C) Lateral section of the sub-unit 7b and the unit6.
interprétation :
L’étude de la coupe de Miramar permet de relever les points suivants :
- Sur le bord de la falaise s’observe la succession d’éolianites à grès rouge intercalé reconnue à Dar es Soltan et à El Harhoura mais, également à Sidi El Abed (cf. infra). Il forme la séquence « classique » du cordon ;
- Deux faciès de dépôt gréseux rouges contenant des pulmonés peuvent et doivent être distingués. Le premier (unité 2) est intercalé dans le cordon dunaire, tandis que le second (sous-unité 7b) nappe le pied du cordon. Dans les deux cas, les sédiments
présentant ce faciès se superposent à la calcarénite éolienne de l’unité 1. Mais aucune continuité ne permet de rattacher ces dépôts qui présentent autrement des caractères distincts, à savoir la présence, dans la sous-unité 7b, de lithoclastes à calcrète laminée indiquant que cette dernière unité se nourrie, pour partie des sédiments repris à l’unité 2 sur incombant. Cette caractéristique permet d’y reconnaître, contra Gigout (1957), deux unités distinctes.
- Le contact entre le grès gris (sous-unité 7a) et le deuxième placage de grès rougeâtre (sous-unité 7b) prend la forme d’une interdigitation. Un tel contact témoigne de la contemporanéité de dépôt des deux faciès rattachés ici et, de nouveau contra Gigout (op. cit.) à une même unité.
Au final, il en ressort que les dépôts présents en bordure de l’oulja s’emboitent en se superposant au
D. CHAHID et al, Actes RQM6, 2014, 60- 72
67
cordon. Il s’agit de dépôts vraisemblablement plus récents, holocènes (Mellahien), si l’on se base sur les datations radiocarbones obtenues par Gigout (1959) sur les coquilles marines recueillies par l’auteur dans les dépôts rattachés à notre unité 6.
4. 4. Coupe synthétique de GayvilleCette coupe synthétique, de 40 m de longueur, permet de décrire les dépôts venant s’adosser à la falaise ouljienne (Gigout, 1965) sur le rebord interne de l’oulja (fig. 9). La description des formations se fera de l’ESE vers l’WNW.
Figure 9. (A): La coupe synthitique de Gayville ; (B): sou-unité 3a, les blocs de calcarénite dimunent de taille vers la mer ; (C) : l’interdigitation entre sous-unités 3a et 3b.Figure 9. (A): Synthitic section of Gayville; (B): sub-unit 3a, the calcarenite boulders decrease in size seaward; (B): interdigitation between sub-units 3a and 3b.
La falaise ouljienne est façonnée dans une calcarénite jaune formée de deux unités distinctes :L’unité 1 est une lumachelle bien consolidée de texture sableuse (sables moyens à grossiers), riche en débris de coquilles marines. D’une puissance minimale de trois mètres, elle forme la base de l’escarpement formant la paléofalaise, sans que sa base ne soit reconnue. Les sédiments se caractérisent par une stratification plane et une lamination horizontale ou, occasionnellement, oblique. Quelques lits de granules litho- et bioclastiques s’intercalent dans le dépôt. La surface sommitale de cette unité est lapiazée.L’unité 2 est une calcarénite constituée de sables
moyens à grossiers bien classés, à litage plan incliné vers l’océan. Epaisse d’un peu plus d’un mètre, elle repose directement sur l’unité 1 sous-jacente.Adossée à cette falaise fossile s’observe la succession de faciès formant l’unité 3. Ces faciès peuvent être regroupés en deux termes principaux :La sous-unité 3a regroupe les sédiments rougeâtres massifs riches en coquilles marines entières ou fragmentées ainsi qu’en coquilles de pulmonés. Il s’agit donc de la « Marne de Témara » des auteurs. La présence d’ossements de vertébrés et de quelques silex taillés est notable. Mais ceux qui caractérisent le plus ce dépôt dans sa position de prisme de dépôt adossé à la falaise sont les blocs de calcarénites, parfois volumineux, qui y sont englobés. La diminution progressive de la taille de ces blocs est remarquable : ils forment un véritable chaos au pied de la paléofalaise pour passer au-delà à des cailloux d’abord gros, puis petits, pour laisser
D. CHAHID et al, Actes RQM6, 2014, 60- 72
68
finalement place à un sable limono-argileux pauvre en débris au niveau de l’actuelle ligne de rivage. Au-delà encore, ce faciès passe par interdigitations à la calcarénite litée grise de la sous-unité 3b. Il s’agit d’un dépôt de sables moyens lumachelliques à litage plan faiblement incliné en direction du centre de l’Oulja (sous-unité 3b). Ce dernier faciès peut être observé, actuellement à marée basse, sur une puissance de 1,4 m.Une collecte de coquilles issue de la sous-unité 3a permet d’établir la liste de son contenue malacologique. Les gastéropodes continentaux sont représentés par Helix sp., Helix vermiculata (Müller), Helix lapicida (Linné) et Rumina decollata (Linné). Les gastéropodes marins contiennent Cerithium rupestre (Risso), Columbelle rustica (Linné), Gibbula sp., Narona coronata (Scacchi), Nassa reticulata (Linné), Nassarius circumcinctus (Adams), Thais haemastoma (Linné), Trivia monacha (Da Costa), Trochus sp. et Turbo sp. Les lamellibranches sont représentés par trois genres : Arca, Ostrea et Cardium. Au sein de ce dernier, ont été différenciées au moins deux espèces (Cardium echinatum, Linné et Cardium exiguum, Gmelin).
interprétation :
La paléo-falaise observée dans le secteur de Gayville est remarquable. Sa position en bordure de l’oulja permet d’y reconnaître la falaise ouljienne telle que définie par Gigout (1965). En outre, la bonne conservation de la morphologie originelle de la falaise, dont atteste l’encoche marine préservée à sa base, permet de situer à environ 2 m à peine au-dessus du niveau actuel de la mer la position passée de la mer ayant façonné la falaise fossile. C’est un argument supplémentaire pour reconnaître dans cette falaise fossile la ligne de rivage de la mer ouljienne (Gigout, op. cit.). Mais l’information principale livrée par cette section tient dans la succession de faciès des dépôts ennoyant cette falaise (unité 3). Ces derniers passent successivement d’un talus de blocs à un dépôt supra-littoral bioclastique rouge puis à un grès marin.Au sein de ces faciès, le terme le plus distale des sables bioclastiques rougeâtres ressemblent en tous points aux dépôts rapportés à la Marne de Témara sur les coupes de Dar es Soltan, d’El Harhoura et de Miramar : sables bioclastiques mêlant coquillages marins et continentaux, fraction limoneuse à l’origine du caractère chromatique du
dépôt et squelette de sables bioclastiques marins. La position de ce faciès dans la toposéquence, coincée entre un pôle continentale (dépôts de pente riche en blocs) et marin (sables bioclastique lités), accrédite l’interprétation d’un sédiment formé par mélange de ces deux stocks sédimentaires. Il permet, en outre, de préciser la position paléotopographique où ce faciès s’est formé, celle d’une position supratidale.Le caractère progressif voire l’interdigitation qui marque les transitions de faciès démontre la synchronie de leur formation et, dans la mesure où ce dépôt est postérieur à la falaise ouljienne qu’il ennoie, tous ces faciès sont donc à rapporter à une seule période de mise en place qui succède au dernier interglaciaire s.s. Il est intéressant ici de relever que le contenu malacologique de l’unité 3, où sont associés Thais haemastoma, Nassarius circumcinctus, donne à cet ensemble un cachet ouljien (Brébion, 1979). En contenant des taxons, à l’image des Nassarius, qui ne sont pas présents à l’actuel dans les eaux atlantiques marocaines, ce contenu malacologique exclut, à tout le moins, que cette unité puisse s’être formée en relation avec la mer holocène. Si elle n’est pas strictement contemporaine du dernier haut niveau marin, la mise en place de cette unité est toutefois en relation avec le dernier niveau ouljien. Les différentes hypothèses chronologiques qu’autorisent ces déductions sont discutées plus loin (cf. 5.2 âge de formation du cordon).
4.5. Coupe de Sidi El Abed Cette coupe a été relevée sur la falaise vive la plus haute à Sidi El Abed. Elle comporte 4 unités qui sont, de bas en haut (fig. 10) :
Figure 10. Coupe de Sidi Abed.Figure 10. Sidi Abed section.
D. CHAHID et al, Actes RQM6, 2014, 60- 72
69
L’unité 1 est une calcarénite jaune clair et épaisse de 4 à 8 m sans que sa base ne soit atteinte. Elle est formée de bancs pluridécimétriques à métriques. Sa structure est le plus souvent oblitérée par l’altération de l’affleurement exposé à la houle. Il est cependant possible d’observer un litage plan à faible inclinaison et, localement, un litage plan oblique d’inclinaison moyenne 18° E.
L’unité 2, d’une épaisseur moyenne de 10 à 14 m, est constituée d’un sable moyen jaune clair riche en coquilles fragmentées à litage plan oblique fortement incliné (27° E). L’épaisseur, constante sur une étendue supérieure à 150 m, montre qu’il s’agit d’un corps sédimentaire important du cordon.
L’unité 3 est un sable limoneux rougeâtre moyennement consolidé, ce qui lui confère un comportement de joint dégagée par l’érosion. Ce dépôt, observé sur une épaisseur maximale d’un mètre, contient des coquilles de gastéropodes, des rhizolithes (moules de racines) centimétriques à décimétriques, ainsi que quelques blocs infradécimétriques polygéniques anguleux et dispersés. Cette unité présente une évolution rapide de son épaisseur, qui indique que le dépôt prend place dans une morphologie de cordon déjà constituée. Ses limites inférieure et supérieure sont très nettes.
L’unité 4 est une calcarénite de couleur jaune claire, de texture sableuse (sable moyen riche en débris de coquilles), parfois des coquilles entières de pulmonés et des moules de racines (rhizolithes). Ce dépôt est marqué par un litage subhorizontal. La puissance de cette unité est variable, 2 m au maximum. Le dépôt se biseaute latéralement pour laisser affleurer les dépôts sous-jacents. La surface est fortement lapiazée ; elle est surmontée par endroit par une couche de calcrète finement litée.
interprétation :
La section de Sidi El Abed présente des termes similaires à ceux des autres sections du cordon littoral de la région de Témara. A la base affleure des éolianites formant le corps du cordon et dont les principales caractéristiques sont la forte inclinaison vers le continent des strates et le bon tri des constituants (unité 1 et 2). Un dépôt de sables bioclastiques rougeâtres contenant des gastéropodes terrestres est lui-même coiffé par une nouvelle génération de dépôts éoliens. L’intérêt de ce site est de montrer que si ces dépôts se superposent les uns aux autres, des discontinuités érosives séparent la mise en place du
dépôt rougeâtre des éolianites sus et sous-jacentes. Ces discontinuités sont attestées par les contacts nets entre unités, d’une part, et les fortes variations d’épaisseur de l’unité 3 de sables limoneux rougeâtres, d’autre part. Elles accréditent l’existence de hiatus entre les différentes phases de constitution du cordon, comme le suggèrent par ailleurs les différents stades de cimentations des unités observés sur les coupes de Dar es Soltan et d’El Harhoura.
5. DISCUSSION
5. 1. Structure du cordon
Le jeune cordon « externe » montre une remarquable constance stratigraphique sur l’ensemble de la zone d’étude. Cette dernière fait apparaître une succession de cinq unités (fig. 11).
Figure 11. Localisation des datations et âges des différentes unités de la coupe de Témara.
Figure 11. Location of datings of the cost of Temara.
Il débute par un corps dunaire (unité1 et unité 2) composé d’une calcarénite formée d’un sable moyen riche en fragments de coquilles bien concassées, et présentant systématiquement des structures obliques à fort pendage de 22° en moyenne et qui peut atteindre 27° à Sidi El Abed. Ces plans obliques sont tous inclinés vers l’est, ce qui indique les vents dominants qui ont édifié le cordon, en l’occurrence des vents d’ouest, ainsi que l’origine d’alimentation de cette dune (Purser, 1980, Reineck et Singh, 1975). Ce litage oblique est généralement suivi par une unité (unité 2) à litage subhorizontal à légèrement incliné vers le continent comme à El Hahoura. La surface d’érosion, séparant cette unité de la précédente, ne représenterait qu’une surface de réactivation du cordon et par conséquent la succession d’unités n’impliquerait pas obligatoirement deux phases distinctes de formation du cordon, mais probablement une seule. En effet, l’accroissement du cordon et le déplacement corrélatif des fronts d’avalanche des dunes suffisent à générer une telle succession de structures (McKee, 2004). Au sommet de ce premier corps dunaire, s’observe souvent des moules de racines (rhizolithes), qui
D. CHAHID et al, Actes RQM6, 2014, 60- 72
70
témoignent d’une stabilisation de la surface après la formation de la base du cordon.
L’unité suivante (unité 3) présente les mêmes caractéristiques sur tous les points d’observations. Il s’agit de sa couleur rouge claire, de l’abondance des coquilles de gastéropodes pulmonés et de coquillages marins, d’un contact net avec les unités sous-jacentes, légèrement irrégulier mais non lapiazé auxquels s’ajoutent, en observation au microscope, une cimentation peu prononcée et une fraction sableuse carbonatée « fraîche », c’est-à-dire composée de grains peu arrondi et de fragments bioclastiques non cristallisés. Ce faciès est interprété comme le résultat du remaniement d’un dépôt continental enrichi en éléments marins au cours d’une phase de transgression marine. Cela est bien documenté sur le site de Gayville où une remarquable succession de faciès latéraux permet de lier ce dépôt à l’étage supratidal, inséré entre un dépôt de pente fossilisant la falaise ouljienne et la plage contemporaine de sa formation.
L’unité sus-jacente (unité 4) est une calcarénite à sable moyen ou grossier riche en débris de coquilles et contenant parfois des coquilles terrestres complètes cristallisées. A sa surface, se développe une couche de calcrète rougeâtre d’épaisseur centimétrique.
En s’éloignant des unités 3 et 4 en direction de l’oulja, un autre placage rougeâtre nappe le pied du cordon (sous-unité 5a). Ce dépôt est décrit dans les travaux antérieurs où il est perçu comme le prolongement de l’unité 3. Les observations faites sur le site de Miramar montrent cependant qu’il s’agit d’une unité différente tant sur la base de sa lithologie (présence de lithoclastes formés de calcarénite remanié et auréolés de calcrète rougeâtre) que sur sa relation avec les dépôts plus récents préservés dans l’oulja.
Vers le fond de l’oulja, apparait un dépôt marin, constitué de grès gris riche en coquilles de moules (sous-unité 5b), dans lequel se distinguent des structures de chenaux. Ces dernières indiquent la direction des courants marins qui ont pénétré l’oulja lors d’une période de haut niveau marin que Gigout attribue au Mellahien (Gigout, 1957), comme l’ont confirmé ultérieurement les dates radiométriques obtenues par cet auteur (Gigout, 1959). Si la fiabilité de ces dates réalisées par radiocarbone sur un lot de coquilles variée (Mytilus
africanus, Cardium edula, Patella intermedia et autres espèces) peut être remise en cause, il n’en demeure pas moins que la présence de moules et de patelle de type intermedia semble distinguer ce niveau des niveaux marins pléistocènes.
5. 2. Age de la formation du cordon
Plusieurs éléments permettent de discuter l’âge de l’édification du cordon. A l’exception des dépôts les plus récents rattachés à l’Holocène (Mellahien de Gigout, unité 5), le cordon est constitué de deux phases éoliennes au sein desquelles s’intercale le dépôt supratidal de la « Marne de Témara ». La coupe de Gayville indique que cette dernière s’est formée en relation avec un niveau marin à une élévation comparable à celle de l’océan actuel. Ce site permet également d’observer que ce faciès est postérieur au façonnement de la falaise ouljienne qui est alors fossilisée par des dépôts de pente. Le façonnement de ce niveau de falaise est rapporté au dernier haut niveau marin (Gigout, 1965) en relation avec le stade isotopique marin SIM (5e) (Texier et al. 2002, Plaziat et al. 2008). Cette Marne de Témara s’est donc formée au cours d’un haut niveau marin situé à quelques mètres plus bas que celui de la mer ouljienne. La prise en compte de la courbe d’évolution du niveau marin lors du dernier interglaciaire, permet alors d’envisager trois hypothèses pour l’âge de la formation de cette « Marne de Témara », à savoir le SIM (5a), le SIM (5c) et le SIM (5e).
La datation absolue par la méthode OSL (SEES, Australie) sur quartz des différentes unités constituant le premier cordon situe la formation de ce dernier entre 86 et 111 ka BP (fig. 12 et 13). Ces datent montrent finalement que ce cordon s’est constitué dans un temps court, de l’ordre d’une dizaine de millier d’années. Ces résultats conduisent à privilégier l’hypothèse d’une formation du cordon lors du stade 5c (unité 1 et 2, fig. 12). Le niveau supratidal intercalé se serait, quand à lui, formé lors du même stade ou ultérieurement SIM (5c) ou SIM (5b) (Shackleton et al. 2000 ; Jouzel et al., 2002). Cette interprétation, avancée sur la base de la date obtenue : 99 ± 8 ka (SEES, Australie), est en accord avec le cachet ouljien de son contenu malacologique (fig. 12). Une reprise
D. CHAHID et al, Actes RQM6, 2014, 60- 72
71
Figure 12. Localisation des datations et âges des différentes unités de la coupe de Témara. Figure 12. Location of datings and ages of different units of Temara section.
d’accrétion éolienne prend place à la suite ou peu de temps après ce dépôt, et achève la constitution de ce cordon, vraisemblablement au cours du SIM (5b).
6. CONCLUSION
Au cours du Pléistocène supérieur, la région de Témara qui fait partie de la Meseta côtière a connu l’édification d’un cordon dunaire nommé ici post ouljien. Ce cordon est soumis actuellement à l’action des vagues qui l’ont taillé en falaise vive, en criques et en courtes plages.
L’étude lithologique, pétrographique et chronostratigraphique ont permit de caractériser les différentes unités constituant ce cordon. Sur l’ensemble de la région et en se basant sur plusieurs sections, le cordon pourrait être subdivisé en cinq unités. Au début du stade istopique marin (5c), les dunes côtières se mettent en place et constituent le corps du cordon (unité 1 et 2). Vers la fin de ce même stade, un dépôt supratidal (unité 3) bien différent par sa couleur rouge et ses constituants se met en place par mélange d’un stock marin (sables bioclastiques) et continentales (limons rouges et sables quartzo-feldspathiques). Sa datation absolue par la méthode OSL donne un âge de 99,9 ± 8,0 ka .Ce dépôt est coiffé par une quatrième unité de calcarénite dunaire de faciès similaire à ceux de la base du cordon, et prenant place peut de temps après l’édification de ce dernier (94 ± 7 ka).
En direction de l’Oulja, un dernier dépôt représenté par l’unité 5 nappe le pied du cordon en montrant un changement latéral de faciès, où un dépôt rougeâtre de faciès proche des sédiments intercalés
dans le cordon s’interdigitent avec un grès marin grisâtre. Ce dernier, réputé mellahien, conduit à rattacher cette dernière phase de formation à l’Holocène. Cette dernière interprétation mérite cependant d’être validée par de nouvelles datations du contenu malacologique du dépôts, dans la mesure où les âges obtenus dans les années soixante l’ont été sur un lot de coquilles marines mêlant tout autant des organismes filtrant que des gastéropodes de littoral rocheux susceptibles de fixer des carbonates anciens et, par voie de conséquence, d’altérer les résultats radiométriques.
Figure 13. Report des âge (à un écart-type) vis-à-vis des courbes de reconstitutions des variations mondiale du niveau marin proposées par Shackleton et al. (2000) bleu, et par Jouzel et al. (2002) en vert.Figure 13. Report of age (a standard deviation) towards curves of reconstructions of global sea level variations proposed by Shackleton et al. (2000) in bleu, Jouzel et al. (2002) in green.
D. CHAHID et al, Actes RQM6, 2014, 60- 72
72
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Aberkan, M., 1989. Etudes des formations quaternaires des marges du bassin du Rharb (Maroc nord-occidental). Thèse de doctorat, Université Bordeaux 1, Talence, 290 p.
Beaudet, G., 1969. Le plateau central marocain et ses bordures : étude géomo-rphologique. Thèse d’Etat, Université Mohammed V, Rabat, 480 p.
Bourcart, J., 1943. La Géologie du Quaternaire au Maroc. La Revue Scientifique, Paris, 81, 311-336.
Brébion P., 1979. Etude biostratigraphique et paléoécologique du Quaternaire marocain. Annales de Paléontologie, 65 (1), 42 p.
Caron, V., 2011. Contrasted textural and taphonomic properties of high-energy wave deposits cemented in beach-rocks (St. Bartholomew Island, French West Indies). Sedimentary Geology, 237 (3-4), 189-208.
Chabli, A., 2009. Etudes sédimentologique et néotectonique des formations plio-quaternaires littorales entre Rabat et Casablanca. Thèse de Doctorat, Université Mohammed V – Agdal, Rabat, 246 p.
Chahid, D., 2011. Etude lithologique et pétrographique du cordon littoral post-ouljien de Témara (Maroc). Mémoire de Master, Université Moulay Ismaïl, Meknès, 84 p.
Choubert, G., Ambroggi, R., 1953. Note préliminaire sur la présence de deux cycles sédimentaires dans le Pliocène marin au Maroc. Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc, 117, 5-53.
Choubert, G., Marcais, J., 1947. Le Quaternaire des environs de Rabat et l’âge de l’Homme de Rabat. C.R. Acad. Sci., Paris, 224, 1645-1647.
Gigout, M., 1957. Recherche sur le Quaternaire marocain. Travaux de l’Institut Scientifique, Série Géologie et Géographie Physique, 7, 77 p.
Gigout, M., 1959. Ages, par radiocarbone, de deux formations des environs de Rabat (Maroc). C.R. Acad. Sci., Paris, 249 (25), 28022803.
Gigout, M., 1965. Valeur de l’étage Ouljien. Notes du Service géologique du Maroc, 185, 91-93.
Guilcher, A. & Joly, F., 1954. Recherches sur la morphologie de la côte atlantique du Maroc. Travaux de l’Institut Scientifique, Série Géolologie et
Géographie Physique, 2, 140 p.
Jouzel, J., Hoffmann, G., Parrenin, F. & Waelbroeck, C., 2002. Atmospheric oxygen 18 and sea-level changes, Quaternary Science Reviews, 21, 307-314.
Lacroix, M. A., 1974. Carte géotechnique de la zone de Rabat (1/50 000). Notes et Mémoires du Service de Géologie du Maroc, n° 238.
Lecointre, G., 1952. Recherches sur le Néogène et le Quaternaire marins de la côte atlantique du Maroc, Notes et Mémoires du Service géologique du Maroc, 99, 2 vol., 198 et 173 p.
Mckee, E.D., 2004. Sedimentary structures in dunes. In: a study of global sand seas, University Press of the Pacific, Honolulu, 83-134.
Plaziat, J.-C., Aberkan, M., Ahmamou, M. & Choukri, A., 2008. The quaternary deposits of Morocco. In: The Geology of Morocco, A. Michard et al. eds., Springer, Berlin, 359379
Purser, B. H., 1980. Sédimentation et diagenèse des carbonates néritiques récents. Éd. Technip, Paris, 366 p.
Reineck, H.-E. & Singh, I. B., 1975. Depositional sedimentary environments. Éd. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2, 439 p.
Texier, J.-P., Lefèvre, D., Raynal, J.-P. & El Graoui, M., 2002. Lithostratigraphy of the littoral deposits of the last one million years in the Casablanca region (Morocco). Quaternaire, 13 (1), 2341.
Shackleton, N. J., 2000. The 100,000-Year Ice-Age Cycle Identified and Found to Lag Temperature, Carbon Dioxide, and Orbital Eccentricity. Science, 289, 1897-1902
Weisrock, B., Adele, B., Charif, A. & Tannouch-bennani, S., 2002. Dunes littorales et dunes continentales au Maroc atlantique semi-aride (29-30° N) du Pléistocène supérieur à l’Holocène. Cuaternario y Geomorfologia, 16 (1-4), 4356.
D. CHAHID et al, Actes RQM6, 2014, 60- 72