Analyse d'art mobilier sur côte du sud-ouest de la France
-
Upload
britishmuseum -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Analyse d'art mobilier sur côte du sud-ouest de la France
Claire LUCAS Juin 2007
L’inscription des représentations sur les supports dans l’art mobilier
magdalénien
Analyse d’art mobilier sur côte du Sud-Ouest de la France
Mémoire de Master 2 Archéologie préhistorique, Université de Paris I (UFR 03), Sous la direction de Nicole PIGEOT et Marianne CHRISTENSEN, et le tutorat de Valérie FERUGLIO.
- 1 -
Page de couverture : Lissoir gravé entier (face inférieure), Magdalénien moyen de la grotte d’Isturitz
(Pyrénées Atlantiques) (n° 11).
- 2 -
Avant de commencer la présentation de cette recherche, je tiens à m’adresser
aux personnes qui m’ont aidée pour leur exprimer mes profonds remerciements :
• A Marianne Christensen, qui a dirigé cette étude et m’a soutenue dans mes demandes d’accès aux collections, mais aussi pour m’avoir « envoyée » au stage « Stigos » ;
• A Nicole Pigeot, qui a assuré la direction de cette recherche ;
• A Valérie Féruglio, pour m’avoir conseillée sur le choix du sujet ;
• A Catherine Schwab et Marie-Sylvie Largueze, qui m’ont permis d’accéder aux collections du M.A.N., où j’ai apprécié la qualité de leur accueil et leur soutien ;
• A Jean-Jacques Cleyet-Merle, qui m’a autorisée à consulter les collections du M.N.P. ;
• A Norbert Aujoulat, pour m’avoir permis d’utiliser sa base de données, qui a considérablement facilité la recherche des côtes gravées de La Madeleine et de Laugerie-Basse au M.N.P. ;
• A toute l’équipe « encadrante » du M.N.P., dont la disponibilité et l’efficacité m’ont touchée, pour m’avoir aidée à trouver les pièces dont j’avais besoin et à les sortir des vitrines ;
• A l’Université de Bordeaux I, qui m’a fourni un logement à la Maison des Etudiants des Eyzies ;
• A Lucie Braem, pour l’attention qu’elle a portée à la relecture de certains passages de ce mémoire et pour m’avoir incitée à raccourcir les phrases.
• Enfin, mes derniers remerciements, mais non les moindres, sont adressés à Malvina, Aurélie et Laure, qui m’ont toujours amicalement conseillée et soutenue.
- A Flo. –
- 3 -
SOMMAIRE
1. Introduction ............................................................................................. - 6 - 2. L’inscription des représentations dans l’art mobilier sur côte d’Isturitz- 9 -
2.1. Le Magdalénien d’Isturitz .................................................................................. - 9 -
2.2. L’art mobilier sur côte au Magdalénien moyen ............................................. - 10 - 2.2.1. Différents types de supports ........................................................................ - 10 - 2.2.2. Des représentations diverses mais pas aléatoires ........................................ - 20 - 2.2.3. Les relations support/décor ......................................................................... - 31 - 2.2.4. Synthèse sur l’art mobilier sur côte d’Isturitz au Magdalénien moyen....... - 40 -
2.3. Au Magdalénien supérieur ............................................................................... - 41 -
3. L’art mobilier sur côte d’Isturitz dans le cadre du Magdalénien du Sud-Ouest de la France................................................................................ - 42 -
3.1. Les groupes magdaléniens du Sud-Ouest de la France : questions posées .. - 42 -
3.2. L’art mobilier sur côte de La Vache................................................................ - 43 - 3.2.1. Une thématique comparable….................................................................... - 44 - 3.2.2. …mais une répartition différente ................................................................ - 44 - 3.2.3. Des représentations moins typées ............................................................... - 45 - 3.2.4. Relations support/décor correspondantes.................................................... - 46 -
3.3. Comparaison avec la Dordogne ....................................................................... - 46 -
3.3.1. L’art mobilier sur côte de Laugerie-Basse .................................................. - 46 - 3.3.2. L’art mobilier sur côte de La Madeleine..................................................... - 52 -
3.4. Inscription des représentations sur côte et influences culturelles................. - 55 -
3.4.1. Magdalénien moyen/supérieur .................................................................... - 55 - 3.4.2. Les relations inter-sites au Magdalénien moyen ......................................... - 55 -
4. Conclusion .............................................................................................. - 57 -
- 4 -
5. Annexes................................................................................................... - 59 -
5.1. Explications complémentaires.......................................................................... - 59 - 5.1.1. Critères de détermination du corpus............................................................ - 59 - 5.1.2. Apports de l’approche technologique à la caractérisation des supports...... - 61 - 5.1.3. Les limites de l’identification thématique................................................... - 64 - 5.1.4. Tableaux comparatifs des sites étudiés ....................................................... - 66 -
5.2. Illustrations supplémentaires ........................................................................... - 67 -
5.2.1. Les incisions latérales.................................................................................. - 67 - 5.2.2. Les décors typés .......................................................................................... - 68 -
5.3. Lexique ............................................................................................................... - 71 -
5.4. Références bibliographiques ............................................................................ - 73 -
5.5. Table des figures................................................................................................ - 77 -
5.6. Base de données ................................................................................................. - 80 -
- 5 -
Pistes de lecture :
• Les étoiles (*) signalent les termes définis dans le lexique (cf 5.3). • Les numéros indiqués pour les pièces du corpus sont ceux que nous leur avons attribué pour
cette étude, qui permettent, pour toute information complémentaire, de retrouver plus facilement les pièces en question dans la base de données (cf 5.6).
• Sauf mention contraire, les clichés sont de l’auteur.
- 6 -
1. Introduction
Au fil des recherches sur l’art magdalénien, l’évidence de sa complexité s’est peu à peu imposée, notamment par l’intermédiaire de certains travaux-phares ayant démontré une conceptualisation préalable à la mise en œuvre. A l’origine de cette prise de conscience, les analyses d’A. Laming-Emperaire et d’A. Leroi-Gourhan sur la répartition des représentations dans les grottes ont révélé une organisation d’ensemble du discours graphique (Leroi-Gourhan, 1971), ouvrant ainsi la voie aux approches structurales inspirées par la linguistique, telles que l’analyse sémiologique de G. Sauvet, qui a permis d’entrevoir « un schéma […] complexe de compatibilités et d’incompatibilités » entre les différents types de signes (Sauvet et Wlodarczyk, 1977, p. 557). De cette façon, les recherches par décomposition des ensembles graphiques ont ébauché la perception d’un système de représentation structuré, résultat d’un projet, dont l’existence paraît confirmée par les analyses technologiques, nécessairement complémentaires, qui ont mis en évidence une esquisse préparatoire (au moins pour les gravures sur matières osseuses), permettant, entre autres, d’organiser l’espace graphique, ensuite validée et approfondie ou invalidée et effacée (Fritz, 1999).
Le support pourrait être l’une des composantes essentielles de ce projet car de nombreux chercheurs ont remarqué diverses relations entre les représentations et les objets sur lesquels elles figurent dans l’art mobilier magdalénien. Il s’agit essentiellement de liens d’ordre morphologique, témoignant d’une adaptation de la représentation à la forme du support, notamment perceptible au niveau de la disposition. En effet, même si ces considérations demeurent à l’état d’impressions générales, les supports de morphologie allongée ont semblé plus « favorables » à la représentation d’animaux en files et de signes en compositions élaborées, au contraire des supports de forme massive, sur lesquels on observe plus couramment des superpositions (Mons et Delporte, 1977, p. 71-75 ; Barandiaran, 1984). Au-delà de la morphologie, des associations particulières de certains types de représentations avec certains types d’objets ponctuent l’art magdalénien, comme en témoignent, par exemple, les baguettes demi-rondes à volutes excisées (fig. 1), qui arborent un décor apparemment conçu pour ce type d’objet (Buisson et Feruglio, 1996).
Figure 1 : Exemples de fragments de baguettes demi-rondes à volutes excisées (face supérieure) des niveaux attribués au Magdalénien moyen de la grotte d’Isturitz (d’après Saint-Périer, 1936).
- 7 -
Fort de ce genre de constats, indiquant vraisemblablement un système de représentation élaboré tenant compte du support sur lequel il se matérialise, il s’agit de remonter la démarche des Magdaléniens d’intégration des représentations aux supports. Cette problématique présente un double intérêt puisque l’insertion d’un décor dans un espace matériel témoigne à la fois d’une intention de représentation et d’une certaine perception du support. De ce fait, l’analyse de cette démarche permet d’aborder des notions relatives à la conception des représentations, en recherchant les implications liées au support en terme de projet graphique, pour tenter de retrouver les schémas mentaux (ensemble des caractères déterminants permettant de comprendre un projet) qui régissent l’élaboration de ces décors. Elle permet aussi de s’interroger sur la perception des objets par les Magdaléniens, selon les similitudes et les différences des décors qu’ils portent, qui pourraient les distinguer et/ou les regrouper. Ces deux axes, consistant à rechercher, d’une part, l’impact du support sur la conception des représentations et, d’autre part, une éventuelle classification des objets par les graveurs, par l’intermédiaire des décors réalisés, ont guidé notre approche.
Dans ce cadre, l’analyse d’art mobilier sur côte apparaît comme un prisme très intéressant parce qu’elle permet de questionner une matière première couramment utilisée par les graveurs magdaléniens, à partir de laquelle différents types d’objets sont produits (outils, parures, supports non-utilitaires ?). Nous avons caractérisé les supports, au moyen d’une approche technologique, pour définir les différences fonctionnelles et morphométriques auxquelles ils renvoient. Parallèlement, en vue de comprendre comment ces différents types d’objets ont été ornés, nous avons procédé par une « dé-structuration » analytique des décors. Il s’agit (sans nous attarder sur le développement théorique, un peu abstrait, de cette démarche, qui sera mieux mise en valeur par son application) de décomposer les représentations en plusieurs paramètres constituants, relatifs à la thématique (thèmes, « abréviation »*, association) et à la répartition* sur le support (position, disposition, orientation), entre lesquels nous avons recherché d’éventuels liens structurants, qui témoigneraient d’une intégration raisonnée des représentations aux supports. Ensuite, la mise en perspective des différents modes d’inscription* des représentations avec les types d’objets, nous a permis d’évaluer les relations entre les supports et les décors (fig. 2).
Figure 2 : Schéma global de la démarche méthodologique.
- 8 -
Cette méthodologie a été appliquée à l’art mobilier sur côte des niveaux magdaléniens de la grotte d’Isturitz (Pyrénées Atlantiques), qui constitue la base de notre analyse. Pour replacer ce site dans son contexte culturel, cet art a ensuite été comparé avec celui d’autres gisements magdaléniens du Sud-Ouest de la France, soit la grotte de La Vache (Ariège) et les abris de Laugerie-Basse et La Madeleine (Dordogne). Cet échantillon comprend uniquement quelques gisements majeurs, notamment par la quantité d’art mobilier exhumé, et ne saurait donc en aucun cas être jugé représentatif de l’ensemble du Magdalénien du Sud-Ouest de la France. Cependant, la richesse quantitative des séries constituait un critère de sélection nécessaire à l’application, dans un temps limité, d’une analyse en terme de proportions, qui doit donc être considérée comme une sorte de sondage des possibilités d’inscription des représentations sur les supports au sein de cet espace-temps.
- 9 -
2. L’inscription des représentations dans l’art mobilier sur côte d’Isturitz
2.1. Le Magdalénien d’Isturitz
La grotte d’Isturitz est une vaste cavité des Pyrénées occidentales (fig. 3), à laquelle cette situation géographique confère une position intermédiaire entre les Pyrénées centrales et les Cantabres (Esparza San Juan, 1990). Les fouilles réalisées par E. Passemard (1912-1922) et R. de Saint-Périer (1928-1958) ont mis au jour trois couches d’occupation magdalénienne (fig. 3), correspondant au Magdalénien moyen et supérieur, dont la répartition diffère selon les salles (Delporte, 1980-81, p. 21-23), cependant cette stratigraphie ne peut plus aujourd’hui être utilisée qu’avec prudence puisque les limites des niveaux ont été mal perçues par les inventeurs, comme en témoignent clairement des raccords de fragments issus de différentes couches (Pétillon, 2004, p. 32-45).
Figure 3 : Le contexte archéologique : situation géographique de la grotte d’Isturitz (fond de carte : www.wikipedia.org/wiki/france © NASA 2002) et schéma de la stratigraphie des niveaux magdaléniens.
• Les niveaux attribués au Magdalénien moyen (« IV »), d’après la domination des pointes de sagaie à biseau simple notamment, correspondent à deux séries de la salle d’Isturitz (II et E) et deux autres, moins importantes, de la salle Saint-Martin (SI et Ew), qui ont été synchronisées d’après l’ensemble de l’outillage et les caractères généraux de l’art (Saint-Périer, 1936). Cependant, la possibilité que plusieurs phases du Magdalénien moyen soient représentées dans la salle d’Isturitz a été envisagée, notamment par comparaison avec le matériel de la salle Saint-Martin, qui correspondrait à une seule de ces phases (absence de pointes de type « Lussac-Angles » dans la salle Saint-Martin, situation des baguettes demi-rondes à volutes exclusivement au milieu du niveau II…) (Saint-Périer, 1936 ; Pétillon, 2004). Rassemblés avec ce matériel, certains outils lithiques témoignent d’une faible présence solutréenne à la base (Esparza San Juan et Mujika Alustiza, 1996, p. 82-84) et des pièces caractéristiques du Magdalénien supérieur proviennent du sommet des niveaux de la salle d’Isturitz (Pétillon, 2004, p. 32-45).
• Deux autres couches, attribuées au Magdalénien supérieur (« VI ») sur la base de la présence de harpons et de pointes à base fourchue en particulier (Esparza San Juan, 1990), indiquent une occupation, moins dense, à cette période (Pétillon, 2004, p. 301). Les niveaux inférieurs (I et F1) forment un ensemble relativement homogène, à l’exception de quelques vestiges caractéristiques du Magdalénien moyen à la base, et le niveau supérieur (Ia), très localisé, pourrait correspondre à une phase finale du Magdalénien supérieur, avec quelques éléments aziliens (Esparza San Juan, 1990).
- 10 -
Au-delà de ces imprécisions stratigraphiques, l’attribution globale des niveaux reste valable et permet donc de séparer une couche au matériel essentiellement magdalénien moyen, de deux couches se rapportant principalement au Magdalénien supérieur, en dépit de la présence probable de quelques pièces extérieures à ces attributions (de l’ordre de 5 à 15%) (Pétillon, 2004, p. 301).
L’art mobilier de ces niveaux, très abondant, montre que l’occupation magdalénienne d’Isturitz n’est en aucun cas à considérer comme un phénomène isolé, puisqu’il présente des similitudes avec de nombreux gisements des Pyrénées (Esparza San Juan, 1990). La complexité de ces relations est particulièrement mise en évidence, au Magdalénien moyen, par l’analyse stylistique des contours découpés de têtes de chevaux, qui combinent différemment un répertoire de conventions graphiques (fig. 4), identiques dans toute la chaîne pyrénéenne (Buisson et al., 1996).
Figure 4 : Exemples de conventions graphiques partagées par des contours découpés de têtes de chevaux du Magdalénien moyen d’Isturitz et du Mas d’Azil (Ariège) (photographies : Collectif, 1996).
Au sein de cet art mobilier, les côtes constituent un support de choix, parmi les plus utilisés, ce qui peut être mis en relation avec leurs caractéristiques morphologiques et leur abondance dans le squelette (Lucas, 2006, p. 19-34). Nous avons déterminé 75 fragments de côtes gravées (les critères de détermination sont précisés en annexe, cf 5.1.1), dont la plupart proviennent des niveaux attribués au Magdalénien moyen, alors que seulement six pièces sont rapportées au Magdalénien supérieur (exclusivement dans la couche I-F1), ce qui s’explique, du moins partiellement, par la moindre importance de cette occupation. Par conséquent, notre analyse sera plus particulièrement concentrée sur le Magdalénien moyen.
2.2. L’art mobilier sur côte au Magdalénien moyen
L’art mobilier sur côte est donc très bien représenté dans le Magdalénien moyen d’Isturitz, avec 69 pièces, dont la diversité repose essentiellement sur la combinaison de différentes transformations des supports et de décors variés par les thèmes représentés et leur agencement.
2.2.1. Différents types de supports
Les supports gravés obtenus à partir des côtes présentent des caractéristiques différentes selon les transformations qu’ils ont subies, en vue de leur destination fonctionnelle, déterminant certaines propriétés morphométriques et correspondant à un usage particulier au sein des activités du groupe,
- 11 -
qui pourraient influencer la perception de ces supports par les Magdaléniens ; c’est pourquoi la classification fonctionnelle a été privilégiée, avant de revenir sur les différences morphométriques.
A. Eléments pour une classification fonctionnelle
Pour approcher le rôle des supports, leur caractérisation technologique permet de connaître les techniques employées pour leur fabrication et, de cette façon, de rechercher des critères distinctifs entre les différents types d’objets, ainsi que d’en déduire leurs possibilités fonctionnelles.
Des fonctions théoriquement très différentes…
En théorie, trois principaux types d’objets produits à partir des côtes sont distingués.
Premièrement, les supports « bruts »* se présentent sous la forme de supports à section pleine (fig. 5), ne portant ni traces d’utilisation, ni traces de façonnage*, à l’exception d’un éventuel raclage des faces de la pièce, qui n’a pas été considéré comme du façonnage tant qu’il ne modifie pas la forme, étant donné que plusieurs études ont montré qu’il pouvait être lié au décor (préparation de la surface à graver, suppression des tracés indésirables…) (Mons, 1972 ; Crémades, 1991 ; Barandiaran, 1996, p. 107 ; Fritz, 1999). Pour ces objets, une fonction non-utilitaire est donc supposée à partir d’arguments négatifs, ils auraient alors uniquement un rôle de support de l’expression graphique, comparable à d’autres supports « bruts » sur matières osseuses (Pettoello, 2005) et plaquettes lithiques non-utilitaires gravés. Toutefois, cette hypothèse n’est pas confirmée, en l’absence de supports « bruts » sur côtes, gravés et entiers, parvenus jusqu’à nous, du fait d’un taux de fragmentation élevé de ce matériel.
Figure 5 : Support « brut » gravé du Magdalénien moyen d’Isturitz (n° 2 : faces interne et externe).
- 12 -
Ensuite, les lissoirs* sont des outils plats et allongés, caractérisés par « la présence d’un « front de lissoir » (ou front actif) de faible épaisseur, d’incidence au plus oblique, dont le lustré, témoin d’un travail sur matières souples, est le principal stigmate d’utilisation » (Averbouh et Buisson, 2003, p. 309). Trois sous-types, qui présentent des divergences à la fois morphologiques, métriques et fonctionnelles, ont été distingués selon la morphologie et l’orientation du front de lissoir (fig. 6), impliquant des gestes différents lors de l’utilisation (Averbouh et Buisson, 2003) :
Figure 6 : Représentation schématique des trois sous-types de lissoirs définis par A. Averbouh et D. Buisson : morphologie et direction du front de lissoir (partie distale : face inférieure).
• Les lissoirs communs, caractérisés par un front de lissoir perpendiculaire à l’axe longitudinal de la pièce, sont souvent de petites dimensions.
• Les lissoirs d’angle, possédant une partie active déjetée et un front de lissoir oblique par rapport à l’axe longitudinal, constituent des outils généralement plus robustes que les lissoirs communs, qui répondraient ainsi à d’autres exigences fonctionnelles (Averbouh et Buisson, 2003). D’après l’observation générale de tous les outils sur côte du Magdalénien moyen d’Isturitz (pour plus d’informations sur cette analyse, cf 5.1.2), deux « ensembles » se dégagent (fig. 7) : certains lissoirs d’angle semblent conçus dès le départ en tant que tels, notamment par le choix de côtes d’animaux de grande taille et par un débitage adapté (« détachement longitudinal d’une large partie de la face inférieure […] par un rainurage bilatéral convergent, dont la rainure principale remonte obliquement vers la partie distale » -Averbouh et Buisson, 2003, p. 319), alors que d’autres sont très comparables aux lissoirs communs (débitage et façonnage similaires, éventuellement à l’exception de la partie distale, dimensions plus réduites), dont ils ne se distinguent considérablement que lors de l’utilisation (front de lissoir oblique).
Figure 7 : Représentation schématique des différences morphologiques entre les deux « ensembles » de lissoirs d’angle (partie distale : face inférieure et section).
• Les lissoirs dièdres sont déterminés par un front de lissoir double constitué de deux bords actifs, convergents et obliques. Cependant, ce sous-type, très faiblement représenté, est moins connu et pourrait également être considéré comme un sous-groupe des lissoirs d’angle (Averbouh et Buisson, 1996, p. 43).
- 13 -
Ces stigmates d’utilisation, associés aux propriétés morphométriques des sous-types, témoigneraient de différentes fonctions au sein d’activités de transformation de matériaux souples. L’hypothèse, la plus probante, d’un usage dans le traitement des peaux, établie à partir de données morphologiques et fonctionnelles (Lefebvre, 1994, p. 125-140), semble étayée sur le site de La Vache par les différences de qualité des matériaux souples pendant la saison d’occupation, ainsi que par la fabrication intensive et le fort taux d’usure d’autres outils fonctionnellement adaptés à ce genre d’activités (aiguilles, grattoirs) (Averbouh et Buisson, 2003). Dans ce cadre, les lissoirs d’angle robustes sembleraient plus appropriés à une phase de préparation des peaux, alors que les lissoirs communs conviendraient mieux à des phases finales du traitement, voire à des activités de transformation postérieures (confection de vêtements…) (Averbouh et Buisson, 2003, p. 321-322).
Enfin, les pendeloques* allongées (fig. 8) se caractérisent, en tant que parures, par la présence d’un moyen de suspension évident (perforation ou rainure), l’absence de fonction domestique et des dimensions réduites (le plus souvent comprises entre 20 à 70 millimètres de long), mais aussi par le façonnage qui permet de leur donner une forme maîtrisée et leur morphologie allongée (Taborin, 1991 ; 2004). Ces objets de parure, destinés à « provoquer le rayonnement personnel de celui qui le[s] porte et que l’on suppose destiné à être compris par les autres membres du groupe » (Taborin, 2004, p.103-104) constitueraient ainsi un langage social à base de signes.
Figure 8 : Pendeloque allongée gravée du Magdalénien moyen d’Isturitz (n° 31 : face supérieure).
D’une manière générale, les supports gravés sur côte correspondent donc à trois fonctions nettement différentes dans la vie des Magdaléniens : des supports à priori non-utilitaires, des outils liés aux activités de transformation et des objets de parure.
…Mais une classification perméable
Cependant la composition du matériel archéologique montre une réalité plus complexe et des difficultés d’identification considérablement accrues par la fragmentation.
En plus des lissoirs, d’autres outils « mousses »*, sans front de lissoir, plats et allongés, présentent un lustré périphérique au niveau de l’extrémité distale (fig. 9), indiquant également une fonction utilitaire par frottement. Généralement plus épais, mais de morphologie comparable, ces outils sont souvent désignés par le vocable « lissoir » dans les publications ; ils renvoient à une définition plus
- 14 -
générale de ce terme, correspondant à tout « outil allongé caractérisé par la présence sur l’extrémité distale d’une surface émoussée et polie » (Camps-Fabrer, 1966, p. 82), utilisée auparavant. Parce qu’il n’a pas fait l’objet d’analyses réellement approfondies et que sa caractérisation demeure vague (stigmates d’utilisation et morphologie imprécisés), cet ensemble est mal connu et regroupe potentiellement des outils polymorphes. L’un d’entre eux (fig. 9) correspond à un support à section pleine, apparemment non façonné (des stigmates de façonnage pourraient toutefois être recouverts par ceux d’utilisation au niveau de l’extrémité distale), comme cela a déjà été remarqué ailleurs (San Juan-Foucher, 2005, p. 99). De ce fait, certains supports « bruts » fragmentaires pourraient appartenir à ce type d’outil peu élaboré, toutefois quantitativement marginal.
Figure 9 : Outil « mousse » sans front de lissoir du Magdalénien moyen d’Isturitz : morphologie et stigmates d’utilisation (n° 8 : faces interne et externe, extrémité distale).
D’autre part, certaines pièces associent des caractères propres aux outils (stigmates d’utilisation) et aux objets de parure (moyen de suspension), conduisant à discuter l’existence d’outils suspendus. En effet, les lissoirs perforés sont des outils de petites dimensions (cf 5.1.2), aménagés d’une perforation (fig. 10), qui semble remettre en question de leur destination fonctionnelle :
Figure 10 : Lissoir perforé et gravé du Magdalénien supérieur de La Vache (n° 190 : face supérieure).
• La perforation pourrait répondre « à un soucis utilitaire » (Camps-Fabrer, 1966, p. 90 et 156), cet aménagement constituerait alors « une amélioration technique », « en vue de les accrocher en un endroit précis ou de les rassembler par un lien pour faciliter leur transport », voire de les protéger dans l’espace domestique (Camps-Fabrer, 1962, p. 130-131), mais leurs dimensions réduites, caractéristiques des pendeloques, pourraient indiquer un phénomène plus complexe.
• Les lissoirs perforés peuvent aussi être considérés comme des objets à double fonction, conçus à la fois comme des outils et des objets de parure, étant donnée la proximité formelle de ces deux types d’objets (forme générale allongée rectangulaire, ovalaire, ou en ellipse) et la possibilité de mettre en valeur le savoir-faire de ceux qui les portent (Taborin, 2004, p. 17). Ils « repoussent, dans
- 15 -
une certaine mesure, les limites de la définition des objets de parure [dénués de fonction domestique], prouvant que ceux-ci ont pu jouer plusieurs rôles » (Tymula, 2002, p. 99).
• Ces pièces pourraient enfin témoigner du réaménagement de parties distales de lissoirs en pendeloques, profitant ainsi de formes communes à ces deux types d’objets.
En dépit de dimensions généralement plus importantes, la même hypothèse des outils suspendus est envisageable pour certaines spatules*, dont les rares exemplaires entiers arborent un front de lissoir en partie distale (cf 5.1.2), alors que la partie proximale se caractérise par un façonnage particulier, créant un amincissement et/ou un étranglement du support, qui peut être interprété comme :
• Un manche, qui faciliterait la préhension de l’outil, par comparaison avec les spatules qui présentent un amincissement sans étranglement, ne favorisant pas leur suspension (fig. 11).
• Un moyen de suspension, permettant le port de ces objets, souvent traités avec les pendeloques.
Figure 11 : Représentation schématique des différents aménagements proximaux des spatules : amincissement et étranglement.
Ainsi, la séparation fonctionnelle entre les outils et à les objets de parure n’est pas rigide, étant donné que les caractéristiques ces deux catégories d’objets ne s’excluent pas.
Enfin, la présence de nombreux fragments indéterminés résulte de l’état fragmentaire du matériel, associé à la variabilité technique de la fabrication des outils, peu caractéristique (cf 5.1.2), qui ne permet pas toujours de différencier leurs parties mésiales de celles des pendeloques. Il s’agit essentiellement de lames de côte* (hémi-côtes dont le tissu spongieux a été totalement éliminé) (fig. 12), qui pourraient constituer des fragments de lissoirs, étant donnée la fréquence de la suppression complète du tissu spongieux sur les lissoirs du Magdalénien moyen d’Isturitz (cf 5.1.2).
Figure 12 : Lame de côte gravée du Magdalénien moyen d’Isturitz (n° 41, face inférieure).
- 16 -
Malgré l’identification de transformations et d’attributs fonctionnels distincts, de nombreux supports sont mal situés par rapport aux trois fonctions envisagées, en raison de l’état fragmentaire du matériel sur côte. Ces problèmes de conservation ne permettent pas de connaître toutes les caractéristiques des supports, constituant la principale limite de cette étude. De plus, l’association de caractères potentiellement révélateurs de différentes fonctions remet en question les limites de la classification.
Classification induite
Par conséquent, nous avons classé les supports, selon leur possibilités fonctionnelles, de la façon suivante (fig. 13) :
Figure 13 : Classification fonctionnelle des supports gravés.
• Les supports « bruts » : fragments de côte à section pleine sans traces de façonnage, ni d’utilisation, correspondant à des supports non-utilitaires ou à des fragments d’outils « mousses ».
• Les outils « mousses » sans front de lissoir : parties distales portant un lustré résultant de l’utilisation, mais pas de front de lissoir.
• Les outils indéterminés : fragments mésiaux et proximaux façonnés par une régularisation dégressive du tissu spongieux, caractéristique des outils (cf 5.1.2), avec ou sans front de lissoir.
• Les lissoirs : parties distales présentant un front de lissoir et parties mésiales ou proximales de lissoir d’angle robuste (au débitage particulier). Leur fonction utilitaire est avérée, mais il n’est pas exclu que certains d’entre eux soient des fragments d’outils potentiellement suspendus (lissoir perforé ou spatule).
- 17 -
• Les lissoirs perforés : pièces entières présentant un front de lissoir et une perforation, constituant des outils suspendus.
• Les spatules : parties proximales et pièces entières à amincissement et/ou étranglement proximal, qui ont une fonction utilitaire (lissoir), mais pourraient également avoir été suspendues.
• Les pendeloques : fragments perforés sans autres indices d’utilisation, cependant certains de ces objets de parure fragmentaires pourraient également avoir eu une fonction utilitaire (lissoir perforé).
• Lames de côte : fragments indéterminés sur hémi-côte, dont le tissu spongieux a été totalement supprimé, qui peuvent correspondre à des fragments de lissoirs, mais également de pendeloques.
• Divers supports présentant des aménagements particuliers, à considérer au cas par cas.
Cette classification des supports gravés est largement imparfaite, étant donné qu’elle reflète plus les limites des connaissances sur ces types d’objets que leurs différences fonctionnelles, mais elle permet de considérer des ensembles technologiquement homogènes, qui renvoient à différentes hypothèses fonctionnelles et, ainsi, de prendre en compte les particularités des supports.
B. Répartition fonctionnelle des côtes gravées
Le corpus d’art mobilier sur côte du Magdalénien moyen d’Isturitz comprend essentiellement des outils (30 pièces) et des fragments indéterminés (29 pièces), qui correspondent presque exclusivement à des lames de côte, alors que les supports « bruts » (7 pièces) et les pendeloques (3 pièces) sont plutôt rares (fig. 14). Cette répartition semble assez représentative, en proportion, des objets produits sur côte puisque les outils constituent l’essentiel des objets élaborés à partir de cette matière première, alors que les pendeloques sont souvent réalisées sur fragments de diaphyse d’os longs (Taborin, 2004, p. 101). Toutefois, les supports « bruts », relativement peu nombreux, n’ont pas été privilégiés.
7
2
19
5 4 3
25
4
0
5
10
15
20
25
30
support
"bru
t"
outil sa
ns fro
nt
lisso
ir
outil indét
spatu
le
pendelo
que
lame de cô
tedive
rs
Figure 14 : Répartition des différents types de supports gravés du Magdalénien moyen d’Isturitz.
- 18 -
Les outils gravés sont largement dominés par les lissoirs (21 pièces, dont 4 spatules), alors que les outils « mousses » sans front de lissoir sont rares (2 pièces), ce qui correspond à la différence quantitative de fabrication de ces types d’outils sur côte. Le façonnage de la face inférieure des lissoirs est généralement poussé jusqu’à l’élimination complète du tissu spongieux (sur 17 lissoirs/21), ce qui pourrait indiquer une prédilection pour les lissoirs présentant deux faces régulières, utilisables pour la gravure, mieux représentés que sur les exemplaires non gravés (cf 5.1.2).
Ainsi, l’art mobilier sur côte du Magdalénien moyen d’Isturitz ne montre pas de réelle sélection de certains types d’objets, au profit d’un assemblage relativement représentatif des produits sur côte, mais cette constatation générale peut être pondérée par la faible quantité de supports « bruts » et l’importance des lissoirs au tissu spongieux totalement supprimé.
C. Caractéristiques morphométriques des supports
L’ensemble de ces supports présente une morphologie générale similaire, caractérisée par une faible épaisseur et une forme allongée, inhérentes aux côtes, cependant ils possèdent des caractéristiques différentes selon les dimensions des côtes employées, le débitage et le façonnage mis en oeuvre.
Premièrement, la largeur (fig. 15) distingue la plupart des supports « bruts » et des lissoirs d’angle robustes (mesurant plus de 25 mm de large), réalisés sur des côtes d’animaux de grande taille, des autres outils et fragments indéterminés (compris entre 9 et 26 mm de large), ainsi que des objets de parure, de largeur restreinte et homogène (entre 12 et 13,5 mm), plutôt sur côtes d’animaux de taille moyenne. De ce fait, les supports « bruts » et les lissoirs d’angle robustes offrent généralement des espaces graphiques moins étroits, que les autres outils, pendeloques et fragments indéterminés. D’autre part, les dimensions variées des lames de côte, par rapport aux pendeloques, constituent un argument supplémentaire en faveur de l’hypothèse fonctionnelle (lissoir) pour la majorité d’entre elles.
Figure 15 : Largeur des supports gravés du Magdalénien moyen d’Isturitz.
- 19 -
Ensuite, le type de débitage (fig. 16) adopté selon les objets leur confère une épaisseur et des états de surface différents, plus ou moins adaptés à la gravure :
Figure 16 : Représentation schématique de la section des supports selon leur débitage.
• Les supports « bruts », sur côtes à section pleine, ne sont pas débités longitudinalement et conservent donc les deux faces (interne et externe) naturelles des côtes, gardant ainsi une certaine épaisseur.
• Les lissoirs d’angle robustes, ont fait l’objet d’un type de débitage particulier, conduisant à la suppression d’une partie de la face inférieure, mais pas de sa totalité. De ce fait, la face inférieure de ces outils est peu favorable à la gravure puisqu’elle comprend à la fois une zone de tissu compact et une zone de tissu spongieux, qui la subdivisent en deux espaces étroits.
• Les autres outils, fragments indéterminés et pendeloques sont presque toujours réalisés à partir d’hémi-côtes et ne conservent donc qu’une seule face naturelle de la côte, constituant ainsi des supports plats, dont une ou deux faces pourront être gravées en fonction de l’absence ou de la présence du tissu spongieux sur la face inférieure.
Enfin, le façonnage différencie la majorité des supports, de forme simple et régulière, de certains supports possédant un attribut morphologique particulier (fig. 17). Il s’agit des spatules dont l’aménagement proximal crée un amincissement et/ou un étranglement, modifiant ainsi la délinéation des bords et la forme de la surface, et des pendeloques, dont la perforation rompt l’uniformité de la surface.
Figure 17 : Morphologie des supports selon leur façonnage (pièces n° 12 et 26 : face inférieure).
- 20 -
Au-delà de leur forme bifaciale allongée, les différents types d’objets se singularisent donc par certaines de leurs propriétés morphologiques. En effet, il est possible de distinguer des supports relativement larges de forme simple, présentant une (lissoirs d’angle robustes) ou deux faces (supports « bruts ») adaptées à la gravure, des supports plus étroits de forme simple (lames de côte, lissoirs) et des supports étroits à attribut morphologique particulier (spatules, pendeloques), dont une ou deux faces pourront être gravées selon la présence/absence du tissu spongieux.
L’art mobilier sur côte comprend donc des supports de fonction (outil, parure, support non-utilitaire ?) et de morphologie (dimensions, propriétés des surfaces, forme particulière) distinctes, mais le cloisonnement de leur classification doit être relativisé, notamment à cause des incertitudes fonctionnelles résultant de leur état fragmentaire, qui permet tout au plus de créer des ensembles technologiquement homogènes renvoyant à plusieurs utilisations possibles. Ces divergences, plus ou moins importantes, leur confèrent à la fois un rôle particulier au sein de la vie des Magdaléniens et des surfaces aux propriétés formelles spécifiques, dont nous allons évaluer l’impact sur les représentations.
2.2.2. Des représentations diverses mais pas aléatoires
Pour remonter la démarche des Magdaléniens d’intégration des représentations à ces types d’objets, l’analyse des thèmes et de leur répartition constitue la base nécessaire à l’observation de l’inscription des différents motifs sur les supports.
A. Analyse thématique
L’analyse thématique a été subdivisée en trois paramètres (fig. 18), partant des thèmes abordés et de leur récurrence relative, puis tenant compte de leur traitement, à travers les types d’ « abréviation » mis en œuvre pour chacun d’eux et leur association sur un même espace graphique, pour tenter de comprendre comment les représentations sont structurées en agglomérant progressivement les éléments constitutifs et leurs relations.
Figure 18 : Les différents paramètres de l’analyse thématique.
- 21 -
La récurrence des thèmes
D’une manière générale, les thèmes représentés sur côte sont nombreux et variés, la plupart d’entre eux ne figurant que sur une faible quantité de supports. Les représentations exclusivement non-figuratives dominent (36 pièces/69) sur les figuratives (17/69), alors que les décors « mixtes » (12/69) sont également courants.
Au sein de cette thématique, les incisions parallèles prédominent largement (fig. 19), par leur présence sur plus de la moitié des pièces du corpus (37 supports). Elles constituent le seul signe à forte récurrence, les autres motifs non-figuratifs étant variables (tracés indéterminés, diverses lignes droites ou sinueuses…) ou uniquement représentés sur quelques objets, présentant des signes ramifiés (sur 4 pièces), des points et quadrillages obliques (sur 3 pièces chacun), et des lignes sinueuses composées de courtes incisions parallèles (sur 2 pièces). Cette faible récurrence de la plupart des signes, pourtant nombreux, illustre l’ampleur de la diversité dont ils font preuve.
Parmi les représentations figuratives, la prépondérance du « couple » bison-cheval est nette, avec une majorité de bisons, représentés sur dix supports (soit au moins 15 bisons), alors que les chevaux apparaissent sur sept pièces (comportant au moins 13 chevaux). Moins courantes, les autres figurations présentent des anthropomorphes, sur trois supports (soit au moins 7 anthropomorphes), des bouquetins et des cervidés, sur trois pièces chacun (soit 3 bouquetins et 3 cervidés), alors que certaines figures rares sont représentés uniquement sur un objet (ours, mammifère marin).
Figure 19 : Proportions de représentation des thèmes récurrents dans l’art mobilier sur côte du Magdalénien moyen d’Isturitz (en nombre de supports présentant chaque motif).
Les représentations sont ainsi dominées par trois principaux thèmes (incisions parallèles, bison et cheval), dont la forte récurrence, pas spécifique aux côtes, a souvent été observée dans l’art magdalénien, auxquels s’ajoutent des motifs récurrents secondaires (signes ramifiés, anthropomorphes…) et des sujets rares. Ces différentes proportions de représentation indiquent des prédilections marquées pour certains thèmes, en quelque sorte « complétés » par des motifs plus variés.
- 22 -
L’« abréviation » des figurations
Le traitement des thèmes figuratifs varie selon que l’animal est représenté dans son ensemble ou partiellement, c’est-à-dire réduit à certains segments anatomiques qui le suggèrent, correspondant à différents types d’ « abréviation »* (Tosello, 2003, p. 20).
Les bisons sont généralement abrégés à la tête, le corps n’étant pas figuré sur huit des dix supports comportant des bisons (fig. 20), mais peuvent aussi se présenter sous la forme de corps sans membres (sur 2 pièces). De même, les trois bouquetins sont uniquement représentés par la tête, au contraire des chevaux, souvent plus complets (4 supports/7 figurant le corps), et des figures rares (ours, mammifère marin), représentées en entier. D’autre part, deux figurations, d’espèce animale indéterminée (bovidé ou cheval, cf 5.1.3), témoignent de la mise en œuvre d’un type de réduction particulier par la représentation exclusive d’une patte de l’animal.
Figure 20 : « Abréviation » proportionnelle des représentations de cheval (n° 2) et de bison (n° 47).
Ainsi, la réduction de la figure à la tête est la plus courante, mais les proportions de mise en œuvre des différents types d’« abréviation », qui impliquent des différences formelles, et probablement sémantiques, importantes, varient selon l’espèce traitée (fig. 20) et pourraient donc constituer un premier indice de traitement différentiel des thèmes, confirmé par leurs associations.
Les associations thématiques
La présence de plusieurs motifs sur un même espace graphique est un phénomène courant, dont l’analyse, par observation des juxtapositions et superpositions, tend à évaluer l’existence de règles d’association, étant donné que « tant qu’une figure reste intelligible (fût-ce partiellement), la volonté d’assemblage ne saurait être entièrement écartée, surtout dans le cas d’œuvres dont la finalité est inconnue » (Tosello, 2003, p. 26).
De nombreux thèmes, peu représentés, paraissent associées de diverses façons, toutefois certains motifs permettent d’apercevoir des combinaisons récurrentes. Les incisions parallèles sont le plus souvent associées à d’autres incisions parallèles (sur 16 pièces), mais apparaissent aussi à côté de divers signes, tracés indéterminés et figurations. Au contraire, les lignes sinueuses composées de courtes hachures sont toujours directement juxtaposées à des incisions parallèles (fig. 21, n° 52), impliquant une association exclusive pour ce thèmes (sur 2 pièces). Par ailleurs, les signes ramifiées, parfois représentés avec divers motifs, sont à plusieurs reprises étroitement associés à certaines
- 23 -
figurations (bison, anthropomorphe – fig. 21, n° 61) par l’emploi de la superposition (sur 2 supports), mode d’assemblage très rarement utilisé sur côte, qui pourrait témoigner d’une volonté de combinaison particulière.
Concernant les figurations, différentes espèces ne sont jamais représentées sur un même espace graphique, au profit d’agglomérations d’animaux de même espèce. Les bisons apparaissent regroupés à plusieurs individus chaque fois que les fragments sont suffisamment étendus pour pouvoir l’observer (4 pièces), de même que les chevaux s’associent souvent entre eux (4 pièces), contrairement au bouquetins, toujours clairement représentés par un seul individu (fig. 21, n° 51 et 50).
Figure 21 : Les principales associations thématiques récurrentes.
Ainsi, au-delà de combinaisons variées, probablement liées à certains motifs, tels que les incisions parallèles, qui apparaissent comme une sorte de thème « universel », juxtaposé à la plupart des autres (probablement en relation avec leur prépondérance), le regroupement récurrent de certains thèmes indique des règles d’association privilégiée (fig. 21) par :
• Une opposition entre des figures largement agglomérées par espèce (bison, cheval) et des figures non répétées (bouquetin),
• La superposition de signes ramifiés sur certaines figurations (bison, anthropomorphe),
• La juxtaposition directe des lignes sinueuses composées de courtes hachures avec des incisions parallèles, alors que ce thème n’est jamais représenté dans d’autres « contextes ».
Malgré la présence de nombreux sujets, des récurrences thématiques indiquent un traitement approprié à certains motifs (particulièrement perceptible au niveau des thèmes les plus fréquemment abordés), qui se distinguent, en proportions, par leur récurrence, leur « abréviation » préférentielle et leurs regroupements, témoignant vraisemblablement d’associations d’idées.
- 24 -
B. La répartition : à l’interface entre les représentations et les supports
Le traitement graphique des thèmes, différentiel d’après l’analyse thématique, se manifeste aussi à travers leur répartition, qui correspond à la façon dont les motifs ont été placés sur les supports par les Magdaléniens et permet donc de mieux caractériser la manière dont ils sont associés. A travers un découpage analytique, purement théorique, nous avons observé la répartition des décors selon trois paramètres (la position, la disposition et l’orientation), qui correspondent, en quelque sorte, à différentes échelles d’analyse (fig. 22), en vue d’évaluer la possibilité d’une organisation particulière des représentations sur les supports.
Figure 22 : Les différentes échelles d’analyse de la répartition des représentations sur le support.
La position
En technologie osseuse, la position désigne la situation par rapport aux faces de la pièce (Averbouh, 2000, p. 64). Les côtes d’herbivore constituant nécessairement des supports bifaciaux, la position des représentations peut être faciale ou latérale.
Dans l’art mobilier sur côte du Magdalénien moyen d’Isturitz, les décors unifaciaux prédominent largement (54 pièces/69), alors que les décors bifaciaux (10/69) et latéraux (5/69) sont beaucoup plus rares (les décors faciaux et latéraux s’excluant mutuellement). Les représentations unifaciales se situent presque toujours sur la face interne, concave et lisse, des supports à section pleine (5/6), ce qui montre une prédilection pour cette face naturelle des côtes, alors qu’elles sont positionnées dans des proportions comparables sur les faces inférieure (27/47) et supérieure (20/47) des supports débités longitudinalement.
Mise en perspective avec les thèmes représentés, la position apparaît comme un critère d’organisation, dans la mesure où elle varie selon les motifs (tabl. 1) : Les thèmes principaux (incisions parallèles, bison et cheval) et ceux qui leur sont associés (ligne sinueuse) se situent plutôt sur la face inférieure des supports débités longitudinalement, alors que les motifs moins courants sont plus souvent positionnés sur la face supérieure (bouquetin, quadrillage oblique…).
- 25 -
face inférieure face supérieure autres incisions parallèles 19 11 7 bison 7 3 0 cheval 5 2 1 ramifiés 2 4 0 anthropomorphe 1 1 1 cervidé 1 2 0 bouquetin 0 2 1 quadrillage oblique 0 2 1 points 2 1 0 ligne sinueuse 2 0 0
Tableau 1 : La position des thèmes récurrents (les chiffres sont donnés en nombre de supports).
La position sur le support semble donc opposer les thèmes selon leur récurrence et leur association par une tendance à privilégier un placement sur la face inférieure pour les thèmes les plus fréquents, contrairement à la plupart des autres. L’analyse de la disposition va nous permettre de préciser la situation de ces décors sur ces différents espaces graphiques.
La disposition des représentations faciales
La disposition des représentations correspond à l’agencement des thèmes entre eux et par rapport à l’espace graphique, qui diffère selon leur organisation (fig. 23) :
• Les motifs couvrants, occupant toute la largeur du support , dominent par leur mise en œuvre sur presque la moitié des pièces (33/69) et font parfois l’objet de compositions* particulières, en suites* (représentations identiques disposées les unes après les autres, sur 8 supports), ou, plus rarement, inversées (représentations placées dans un sens opposé, sur 2 pièces).
• D’autres décors ne figurent que sur une partie du support, considéré dans le sens de la largeur, créant ainsi un « partage » longitudinal, par le jeu de la distribution des espaces ornés et vides. La plupart de ces représentations sont organisées en registres longitudinaux (sur 22 pièces), généralement tripartites, mais certaines sont centrées (sur 4 pièces) ou situées le long d’un bord (sur 6 pièces).
Figure 23 : Représentation schématique des différents types de disposition.
- 26 -
De nombreux décors font donc preuve d’une organisation élaborée par une structuration géométrique de l’espace, à travers les dispositions en registres longitudinaux, suites et représentations inversées (sur 30 pièces/69), témoignant d’une importante recherche de composition.
Ces différents types de disposition s’adaptent à certains thèmes, auxquels ils s’appliquent plus particulièrement (fig. 24) :
• Les motifs couvrants correspondent essentiellement aux représentations figuratives (27 décors couvrants/33), pour lesquelles ils constituent la disposition habituelle. Les compositions en suites et représentations inversées s’appliquent exclusivement aux figurations, la suite étant utilisée préférentiellement pour les bisons (4 suites/9) et parfois pour d’autres thèmes (chevaux, anthropomorphes, ours), alors que les représentations inversées semblent réservées aux chevaux (sur 2 pièces).
• Au contraire, les autres types de disposition concernent généralement les signes. En effet, les décors centrés et les registres longitudinaux incluent presque toujours des incisions parallèles, les registres longitudinaux constituant le type de disposition majeur pour ce thème (21 pièces présentant des incisions parallèles/22 supports à registres longitudinaux).
Figure 24 : Les dispositions caractéristiques des principaux thèmes.
En plus de s’adapter à ces différents thèmes, les types de disposition sont corrélés avec la position des représentations car les compositions en registres, suites ou motifs inversés sont plutôt situées sur la face inférieure (22 compositions sur la face inférieure pour seulement 9 dans une position différente), dont les représentations apparaissent donc plus organisées que les décors placés dans une autre position.
Ainsi, les types de disposition mis en œuvre diffèrent selon que l’on traite de thèmes figuratifs (couvrants) ou non-figuratifs (non-couvrants), en relation avec leurs proportions plus ou moins allongées (Lucas, 2006, p. 55). Cependant au-delà de cette dimension pratique de la disposition des représentations, des corrélations plus complexes apparaissent entre la recherche de construction de l’espace et la position (composition/face inférieure), d’une part, et certains thèmes et leur agencement (bison/suite, cheval/représentation inversée, incisions parallèles/registres longitudinaux), d’autre part, indiquant différents « modes » de représentations selon les thèmes, qui se retrouvent au niveau de l’orientation.
- 27 -
L’orientation des figurations
Les représentations figuratives, parce qu’elles figurent des sujets reconnaissables, donnent un sens de lecture au support, qui peut être soit horizontal (17 pièces), soit vertical (12 pièces) par rapport à son axe longitudinal et semble fortement lié à la thématique abordée :
• Les représentations orientées horizontalement correspondent à la quasi-totalité des figurations développées, présentant le corps de l’animal, mais aussi à certaines têtes isolées. Il s’agit de tous les chevaux et cervidés, des bisons représentés sous la forme de corps sans membres, de certaines têtes de bouquetins (2/3) et de représentations plus complètes d’anthropomorphes, ours et phoque.
• Au contraire, les décors verticaux comprennent une majorité de représentations abrégées, correspondant à toutes les têtes de bison, aux représentations de pattes, à une tête de bouquetin et un anthropomorphe plus complet.
Figure 25 : Différence d’orientation entre les têtes de bison et de cheval.
L’orientation varie ainsi selon le type d’« abréviation » mis en œuvre, mais aussi selon les thèmes puisqu’elle oppose les têtes de bison, toujours verticales, à celles de chevaux, toujours horizontales (fig. 25) par le choix, tranché, d’un sens de lecture différent du support sur lequel ces deux thèmes majeurs sont représentés, indicateur d’une exclusion mutuelle de ces motifs, alors que d’autres figurations apparaissent dans différents sens de lecture (bouquetin notamment).
La répartition des représentations apparaît donc fortement corrélée à la thématique, témoignant de différentes façons d’investir l’espace du support, selon les thèmes représentés, dans un système de relations complexes entre les thèmes, leur « abréviation », leur association, leur position, leur disposition et leur orientation. Cette analyse nous a ainsi permis d’observer une inscription raisonnée de nombreux décors dans l’espace, se manifestant sous forme de tendances de représentation, au caractère très rarement exclusif.
C. Les représentations : normes et variabilité
Ces tendances de représentation se matérialisent par la présence de décors typés, fortement structurés par certaines des corrélations que nous venons d’observer, auxquels s’ajoutent de représentations plus variées.
- 28 -
Les décors typés
Sept types de décors récurrents se dégagent de ce corpus :
Figure 26 : Les décors typés du Magdalénien moyen d’Isturitz.
• Des incisions parallèles, transversales et courtes, disposées en registres longitudinaux, se situent presque toujours sur la face inférieure (fig. 26, n° 1), sur huit supports, et constituent un ensemble homogène, en dépit de la présence de trois ou quatre registres. Ce type de décor a aussi été réalisé sur trois lames d’os des mêmes niveaux (hors corpus), dont l’origine anatomique n’a pas pu être déterminée (côte ?).
• Des incisions parallèles identiques, disposées en registres le long des bords, sont aussi associées à un motif sinueux central (fig. 26, n° 2), sur la face inférieure de quatre supports. Le thème central correspond généralement à une ligne sinueuse composée de courtes hachures (sur deux d’entre eux), mais aussi à des zigzags et tracés obliques. Ce type de décor est également représenté, parfois sous des formes un peu différentes (quatre registres, terminaison en incisions divergentes…), sur la face inférieure de sept lames d’os indéterminées, qui attestent de sa forte récurrence.
• Des incisions parallèles, transversales, courtes et généralement très rapprochées, sont positionnées sur un bord (fig. 26, n° 3), sur quatre pièces.
• Des têtes de bisons verticales, souvent disposées en suite (fig. 26, n° 4) et généralement sur la face inférieure, figurent sur huit pièces du corpus et trois lames d’os indéterminées. Cet ensemble est
- 29 -
remarquablement homogène par le thème présenté et son orientation, mais aussi sur les plans stylistique et technique. En effet, « la technique des incisions, le contour des figures, de l’œil, des cornes, des oreilles, les indications de pelage présentent des analogies frappantes » : « les mêmes incisions et champlevés dégagent la corne, l’oreille et l’œil »… (Mons, 1986-87, p. 93 à 95). Cette homogénéité des techniques de gravure et du style, jusque dans les détails de la représentation, a conduit à envisager la possibilité qu’elles soient l’œuvre d’un même graveur (Appelaniz, 1994, p. 301 ; Mons, 1986-87, p. 95).
• Des têtes de chevaux inversées (fig. 26, n° 5) sont représentées sur la face inférieure de deux supports et présentent également d’importantes similitudes stylistiques et techniques (tête levée, pelage de la crinière oblique reliant les deux figurations, traitement des yeux et des oreilles…).
• Des pattes d’animaux verticales (fig. 26, n° 6) se présentent sur la face supérieure (interne) de deux supports du corpus et d’une lame d’os indéterminée perforée.
• Des bisons représentés sous la forme de corps sans membres, associés à des signes ramifiés par superposition (fig. 26, n° 7), sont représentés sur deux supports.
Ainsi, l’art mobilier sur côte des niveaux attribués au Magdalénien moyen d’Isturitz comporte plusieurs ensembles de représentations homogènes, dont l’analogie réside dans l’associations de caractères communs, relatifs à la thématique et à la répartition sur le support, mais aussi au style et aux techniques mis en œuvre, qui permettent de les individualiser. Ces sept types de décor témoignent de normes de représentations complexes de certains thèmes et constituent une part importante du corpus, puisqu’ils représentent plus d’un tiers des représentations (40% environ), dont ils influencent considérablement les caractéristiques. Ils font écho à d’autres représentations codifiées connues dans l’art magdalénien d’Isturitz, et d’une manière plus générale des Pyrénées, tels que les contours découpés de têtes de chevaux ou les baguettes demi-rondes à volutes excisées.
Des représentations plus variées
Toutefois, de nombreuses représentations plus variées s’ajoutent à ces décors typées. Il est remarquable que la majorité de ces décors diversifiés est plutôt positionnée sur la face supérieure (15 représentations sur la face supérieure/37, pour seulement 7 sur la face inférieure, 7 décors bifaciaux, 5 représentations sur la face interne…), au contraire de la plupart des types de décors définis précédemment.
Parmi ces représentations variées, plusieurs manifestent encore certaines des corrélations mises en évidence lors de l’analyse de la thématique et de sa répartition et pourraient être regroupées selon ces analogies, même si elles apparaissent plus diversifiées. Par exemple, les incisions parallèles centrées sont plus ou moins longues et transversales ou obliques (fig. 27).
Figure 27 : Des représentations moins typées : les incisions parallèles centrées.
- 30 -
D’autres représentations ne proposent que peu de caractères communs (fig. 28), c’est pourquoi leur classification supposerait de privilégier l’un ou l’autre des caractères analysés.
Figure 28 : Variabilité des autres représentations.
Ces décors variés représentent plus de la moitié du corpus et pourraient témoigner de certains « espaces de liberté » au-delà des règles de représentation, étant donné que leur inscription sur le support diffère, témoignant ainsi de combinaisons apparemment plus libres à partir des différentes modalités de chaque paramètre.
Modes d’inscription des principaux thèmes
Le traitement graphique apparaît ainsi variable selon les sujets puisque, même s’il n’est pas possible d’en percevoir toute la complexité en raison de la faible récurrence de certains motifs, les thèmes principaux se distinguent par leurs modes d’inscription.
En effet, les incisions parallèles sont traitées de différentes façons, mais trois modes d’inscription récurrents, composant des décors typés (incisions parallèles en registres, incisions parallèles encadrant un motif sinueux et incisions latérales), constituent la plupart des représentations de ce thème (16 pièces/37 portant des incisions parallèles), alors que d’autres témoignent d’une importante diversité de combinaisons à partir de ce motif (variété d’association thématique et de répartition), probablement en relation avec sa récurrence exceptionnelle.
D’autre part, nous avons observé plusieurs caractères distinctifs des représentations de bison et de cheval (« abréviation » préférentielle, types de disposition et orientation notamment), dont l’inscription sur le support est très différente. Alors que le thème du bison est traité uniquement par deux (têtes de bison verticales, corps sans membres associés à des ramifiés) ou trois (pattes verticales ?) modes d’inscription récurrents, qui témoignent d’une codification importante de cette figure, qui illustre bien la dimension structurante des corrélations mentionnées, les chevaux apparaissent sous
- 31 -
diverses formes (fig. 29), parmi lesquelles une seule apparaît sur deux pièces (têtes de chevaux inversées).
Figure 29 : Diversité de traitement du thème du cheval.
La mise en œuvre de modes d’inscription plus ou moins diversifiés et adaptés aux motifs, distingue notamment la figure du bison, fortement codifiée, de celle du cheval, apparemment moins normée, et pourrait témoigner d’un sens différent attaché à ces thèmes.
Les décors sur côte du Magdalénien moyen d’Isturitz se caractérisent donc par des normes de représentation complexes associées à certains thèmes, dont les représentations sont très homogènes, alors que d’autres paraissent traités de façon plus « libre », ce qui semble indiquer différents degrés de codification des représentations.
2.2.3. Les relations support/décor
Pour évaluer l’impact du support sur la conception de ces décors, nous allons maintenant observer comment ces représentations se présentent selon leurs propriétés fonctionnelles et morphométriques, de manière à rechercher leurs relations.
A. Le décor selon les types d’objets
L’analyse de la place des décors normés permet d’observer à quels types d’objets ces représentations homogènes sont associées, en vue de rechercher d’éventuelles distinctions et/ou regroupements de supports, alors que la prise en compte de l’ensemble des représentations tend ensuite à une perception plus globale des caractéristiques de leurs décors.
- 32 -
La place des décors typés
Au Magdalénien moyen, l’art mobilier offre plusieurs exemples de décors complexes récurrents particuliers à certains types de supports (contours découpés de têtes de chevaux, baguettes demi-rondes à volutes excisées, crochets de propulseur « au faon à l’oiseau »…). L’analyse de la distribution des décors normés selon les différents types d’objets tend à évaluer la possibilité d’associations privilégiées de ce genre et/ou de représentations communes à différents supports.
Premièrement, les registres d’incisions parallèles se présentent sur quatre lissoirs (soit 2 lissoirs communs et 2 spatules) et quatre lames de côte, sur lesquels ils se positionnent presque toujours sur la face inférieure. De même, les incisions parallèles encadrant un registre central sont représentées sur deux lissoirs communs et deux lames de côte, toujours sur la face inférieure. Il est remarquable que ces deux types de représentations en registres ne figurent que sur des lissoirs communs et des spatules (fragments de lissoirs dont le sous-type est inconnu à cause de leur état fragmentaire – cf 5.1.2), ainsi que sur des fragments indéterminés éventuellement interprétables en tant que parties mésiales de lissoirs (lames d’os) (fig. 30). Ces représentations apparaissent donc caractéristiques des lissoirs, voire des lissoirs communs, et plus particulièrement de la face inférieure de ces outils. La représentation composée d’une ligne sinueuse faite de courtes hachures encadrée par des registres d’incisions parallèles a, par ailleurs, été observée sur des lissoirs et spatules provenant de niveaux attribués au Magdalénien moyen d’autres gisements pyrénéens (Duruthy, Les Espélugues, Le Mas d’Azil, Gazel) (Sacchi, 1990, p. 21-22, Omnès, 1980).
Figure 30 : Les supports des décors typés à registres d’incisions parallèles (pièces n° 10, 9, 27 et 53)
De même, les incisions latérales sont réalisées sur un lissoir commun, un outil indéterminé, une lame de côte et un fragment à aménagement particulier (cf 5.2.1), qui pourraient constituer des fragments d’outil. Cependant cette distribution remet en question leur rôle, puisque l’hypothèse d’un aménagement fonctionnel a été envisagée pour ce type d’incisions, qui offriraient alors une meilleure adhérence de l’outil à la main, voire pour un éventuel emmanchement (Lefebvre, 1994, p. 112). L’extrême discrétion de ces gravures tendrait plutôt en faveur de l’hypothèse fonctionnelle, toutefois leur localisation peut être en partie mésiale ou proximale et elles présentent parfois des espacements plus ou moins importants, évoquant un rythme graphique.
Ensuite, les têtes de bison verticales (fig. 31) sont représentées sur quatre lissoirs (dont trois lissoirs d’angle et un lissoir commun) et sept lames d’os. Sur côte, ce type de décor est donc
- 33 -
exclusivement associé aux lissoirs, et plutôt représenté sur les lissoirs d’angle, cependant des têtes de bisons verticales sont également connues sur des bâtons percés d’Isturitz et d’Enlène (collectif, 1996), indiquant une distribution plus large de ce décor, sur d’autres outils allongés.
Figure 31 : Les supports présentant des têtes de bison verticales (pièces n° 16, 17 et 46).
Enfin, les pattes verticales (fig. 32) sont figurées sur la face supérieure d’un lissoir « découpé » et d’une lame de côte, mais aussi sur une pendeloque sur lame d’os indéterminée. Ainsi, ce type de représentation a été réalisé aussi bien sur lissoir que sur pendeloque, impliquant soit un décor commun à différents types d’objets, soit un lien thématique entre ces supports.
Figure 32 : Les supports des pattes verticales (n° 64 et 22).
Les autres décors typés (têtes de chevaux inversées et bisons représentés sous la forme de corps sans membres associés à des signes ramifiés), uniquement figurés sur des fragments indéterminés, ne permettent pas d’aborder leur association avec les types de supports.
- 34 -
Sur côte, les trois types de décors les plus fréquents (incisions parallèles en registres, incisions parallèles encadrant un motif sinueux et têtes de bison verticales) sont donc plus particulièrement associés aux lissoirs, dont ils pourraient être caractéristiques, alors qu’ils ne figurent jamais sur des supports « bruts » ou des pendeloques. Dans ce cadre, les représentations en registres sont représentées sur des lissoirs communs, alors que les têtes de bisons figurent plutôt sur des lissoirs d’angle, cependant ces décors ne s’excluent pas, étant donné qu’ils sont associés sur un même support par la juxtaposition de registres d’incisions parallèles et d’une tête de bison verticale (fig. 31). Malgré ces relations privilégiées, la présence de têtes de bisons verticales sur bâtons percés et d’une patte verticale sur pendeloque semble indiquer des phénomènes d’association plus complexes.
Le décor des outils
Sur les lissoirs, la thématique est dominée par les représentations non-figuratives, par la prépondérance des incisions parallèles (sur 14 lissoirs/23), suivies des bisons (sur 4 lissoirs) et signes ramifiés (sur 2 pièces), alors que les autres occurrences sont uniques. Ces outils se singularisent par la présence quasi-exclusive, parmi les figurations, de représentations abrégées (généralement limitées à la tête), à l’exception d’un mammifère marin. Ces représentations, positionnées sur la face inférieure (12 lissoirs/23) ou supérieure (9 lissoirs/23), sont généralement couvrantes (9/23), formant parfois des suites (3/23), ou disposées en registres longitudinaux (8/23), principalement tripartites (6/8).
Figure 33 : Les décors caractéristiques des lissoirs communs et d’angle (pièces n° 15, 11, 60 et 13).
Au-delà de ces caractéristiques générales, largement influencées par la place importante des décors normés sur ces outils (11/23), les proportions varient selon les sous-types (fig. 33). En effet, Alors que les lissoirs communs affichent une proportion élevée d’incisions parallèles (sur 8 lissoirs communs/12), qui se retrouve sur les spatules (4/4), les lissoirs d’angle présentent une majorité de bisons (sur 3 lissoirs d’angle/7), au détriment des incision parallèles (2/7). En relation avec ces divergences thématiques, les lissoirs communs et les spatules comportent une majorité de registres longitudinaux (5 lissoirs communs/12 et 3 spatules/4), au contraire des lissoirs d’angle, caractérisés par l’absence totale de registres longitudinaux, au profit de représentations couvrantes (3/7) et centrées (2/7). Par ailleurs, les représentations sont plutôt positionnées sur la face inférieure des lissoirs
- 35 -
communs 7/12) et sur la face supérieure des lissoirs d’angle (5/7), en relation avec la particularité du débitage de certains d’entre eux (4 pièces), peu favorable aux gravures sur la face inférieure.
Les autres outils « mousses » sans front de lissoir (2 pièces) et les outils indéterminés (5 pièces) ne montrent pas de convergences frappantes avec les caractéristiques des décors des lissoirs, mais sont trop peu représentés pour établir une comparaison.
D’une manière générale, parmi les outils, seuls les lissoirs sont suffisamment nombreux pour définir les propriétés de leur décor. Ils se caractérisent par la prépondérance thématique des incisions parallèles et des bisons, l’ « abréviation » des figures, une position légèrement préférentielle sur la face inférieure et des dispositions couvrantes et en registres longitudinaux majoritaires. Toutefois, une différenciation pourrait s’esquisser entre les lissoirs communs et les lissoirs d’angle (proportions de mise en œuvre des thèmes et répartition), mais cette hypothèse repose sur un corpus encore faible.
Le décor des supports « bruts »
Parmi les sept supports « bruts » issus des niveaux attribués au Magdalénien moyen d’Isturitz, seuls six ont retenu notre attention, le septième (n°6), qui s’intègrerait très bien dans un contexte plus ancien (incisions très profondes près des bords rappelant l’art solutréen), ayant été écarté en connaissance des limites stratigraphiques. Au niveau thématique, les figurations dominent (au moins 4/6), contrairement à ce que nous avons observé sur les lissoirs ; seules les incisions parallèles sont récurrentes (2 supports) et aucun bison n’est figuré sur ce type d’objet. Ces représentations variées (fig. 34), ne présentant que peu de caractères communs, sont plutôt positionnées sur la face interne (4/6) et généralement couvrantes, alors que les registres longitudinaux sont rares sur ce type d’objet (1/6 : n°5).
Figure 34 : Les représentations sur supports « bruts » (n° 2, 5, 4, 7, 1 et 3).
- 36 -
Même s’ils sont peu nombreux, les supports « bruts » paraissent ornés différemment des lissoirs, du fait de l’absence de décors typés, de la prépondérance des figurations et de la rareté des compositions notamment, qui impliquent une place plus importante accordée aux représentations variées sur ce type d’objet, à priori non-utilitaire.
Le décor des pendeloques
Figure 35 : Les décors des pendeloques (pièces n° 32, 31, 30).
Les représentations réalisées sur les trois pendeloques sont diverses et plutôt positionnées sur la face supérieure (2/3) (fig. 35). L’une d’entre elle (n° 32) présente une représentation de cheval sans membre, dont la ligne cervico-dorsale s’inscrit entre deux registres de points, composant ainsi un décor proche des incisions parallèles encadrant un motif sinueux, qui crée un parallèle avec les lissoirs. Cependant, par sa longueur importante (92 mm), son façonnage (élimination totale du tissu spongieux), l’aspect lustré de sa surface et ce décor particulier sur la face inférieure, cette pendeloque pourrait constituer un fragment de lissoir perforé. Au-delà de représentations variables, les pendeloques présentent certains points de comparaison avec les lissoirs (décor à registres particulier, patte verticale sur lame d’os perforée), mais cette catégorie est trop faiblement représentée pour en tirer de conclusions.
Le décor des lames de côte
Figure 36 : Exemple de décors sur lames de côte (pièces n°42, 49 et 56, face inférieure).
Les lames de côtes constituent un groupe technologiquement homogène, probablement à rapprocher des lissoirs (façonnage, dimensions), en dépit de différentes fonctions possibles. Sur ces supports, les décors non-figuratifs (13/25) dominent sur les figurations (7/25), les incisions parallèles
- 37 -
constituant le thème dominant (14), suivies des bisons (5) et chevaux (3). Ces représentations sont souvent organisées en registres longitudinaux (9/25), mais généralement couvrantes (13/25), parfois composées en suites (4) ou motifs inversés (2). Elles sont plutôt situées sur la face inférieure (15/25) que sur la face supérieure (7/25), profitant ainsi de la possibilité offerte par la suppression totale du tissu spongieux.
Les caractéristiques des décors des lames de côte sont donc identiques à celles des lissoirs, notamment par la représentation de décors typés similaires, la fréquence des représentations de bison, l’importance des registres longitudinaux et la position préférentielle des décors sur la face inférieure, qui pourraient confirmer leur appartenance à ce type d’outil.
De ce fait, plusieurs éléments (présence/absence des décors typés, thématique abordée, proportions de registres longitudinaux…) conduisent à distinguer les lissoirs et lames de côte des supports « bruts ». Cependant, à l’exception de la place des décors typés, cette séparation repose sur l’inversion de certaines tendances de représentation, qui ne présentent aucun caractère exclusif. Alors que les lissoirs et lames de côte se caractérisent par une inscription raisonnée des représentation (nombreux décors typés, importance des compositions…), les décors des supports « bruts » affichent une variabilité importante. Au terme de cette analyse, on observe donc une tendance à représenter des décors plus normés sur les lissoirs, utilitaires, alors que les supports « bruts », à priori non-utilitaires, semblent utilisés pour des représentations apparemment plus « libres » et moins adaptées.
B. Le décor selon les propriétés morphologiques des supports
Au-delà de ces divergences de représentation selon les types d’objet, plusieurs pratiques récurrentes créent une relation formelle entre les représentations et les pièces sur lesquelles elles figurent, par des déformations anatomiques, la localisation des représentations par rapport aux zones de morphologie particulière et la mise en forme de certains supports.
Les déformations
Dans l’art mobilier sur côte du Magdalénien moyen d’Isturitz, deux types de déformation des représentations animales ont été mis en œuvre, il s’agit de l’allongement des proportions et du désaxement de certains attributs, qui concernent une part considérable des figurations (12/29).
Premièrement, l’allongement des figures s’applique exclusivement aux têtes de bison verticales, dont les proportions ne sont pas conformes la réalité puisque la robustesse naturelle de la tête du bison a été amoindrie au profit d’une longueur plus importante (fig. 37). Cet allongement est associé à un désaxement du chanfrein : « la tête est anormalement allongée par la position trop verticale du chanfrein, il suit le bord de la lame d’os » (Mons, 1986-87, p. 93 à 95), qui implique le désaxement conséquent des éléments internes. L’application de ces déformations paraît étroitement liée à l’orientation verticale choisie pour ces représentations, qui nécessite de placer la plus grande dimension naturelle de la tête dans la plus petite dimension de l’espace graphique.
Ensuite, le désaxement, couramment employé pour la figuration des parties saillantes des animaux, notamment à cornes et bois (Barandiaran, 1996, p. 105), est appliqué à certaines représentations
- 38 -
des cornes de bouquetins. Parmi les trois bouquetins de ce corpus, les deux individus orientés horizontalement portent des cormes très largement recourbées vers l’arrière, alors que les cornes du troisième, placé verticalement, s’élèvent largement au-dessus de sa tête en formant un léger arc de cercle, beaucoup plus proche de la réalité anatomique (fig. 37). Enfin, certaines têtes de chevaux orientées horizontalement (3/4) paraissent levées, tendues vers l’avant, alors que la tête de cet animal oblique normalement vers le bas, à part lors de mouvement spéciaux.
Figure 37 : Comparaison des représentations déformées avec les représentations plus « réalistes ».
Ces déformations, liées à l’« abréviation » des figures à la tête et à leur orientation, semblent concourir vers un même objectif, consistant à occuper au maximum l’espace disponible (qui constitue un concept de représentation récurrent dans l’art magdalénien -Barandiaran, 1984, p. 113), en présentant les têtes en « gros plan » et en minimisant les espaces vides (fig. 37). Dans tout les cas, il eut, évidemment, été possible de respecter l’anatomie des animaux, c’est pourquoi les déformations peuvent être considérées comme des particularités stylistiques de représentations généralement typées. Par conséquent, cette pratique met en évidence la priorité donnée au plan* et à l’orientation choisis, voire à une certaine construction stylistique, sur la recherche naturaliste. La déformation apparaît alors peu liée aux dimensions particulières des supports, qui peuvent varier considérablement pour les pièces présentant des têtes de bisons verticales notamment (de 11 à 33 mm de large), mais plutôt à leur morphologie allongée, qui favorise la mise en œuvre de ces types de plans.
Ainsi, les déformations, par allongement et désaxement, semblent résulter d’une volonté d’adapter des intentions de représentation (orientation, plan serré) à la morphologie allongée des supports, au détriment de la réalité anatomique, et mettent ainsi en évidence une recherche graphique liée à la forme des objets.
- 39 -
La localisation des représentations
Des relations morphologiques entre les représentations et les supports apparaissent également à travers la localisation* des graphismes selon les zones à délinéation particulière de certains objets. La localisation du décor sur les outils « mousses » de forme simple montre généralement un traitement différent de la partie distale, dont les bords convergent, par une interruption des gravures (sur au moins 7 pièces/16) ou la présence d’un décor exclusivement sur cette partie (2 pièces), alors que seulement deux de ces outils présentent un décor continu « homogène » sur leurs parties mésio-distales. De ce point de vue, le lissoir n°14 (fig. 38) est particulièrement significatif puisqu’une ligne transversale semble marquer la séparation entre l’espace décoré et l’espace vierge au niveau distal. De même, les spatules présentent généralement un décor distinct sur la partie proximale, de forme particulière (amincissement et/ou étranglement), de celui qui figure en partie mésiale (3/4). Par exemple, la spatule n°25 (fig.38) est ornée d’incisions parallèles sur sa partie proximale, alors qu’un cervidé est représenté sur la partie mésiale.
Figure 38 : Exemples d’individualisation des zones de morphologie particulière par le décor.
La localisation des représentations indique donc une tendance à la distinction graphique des parties distales des lissoirs et des parties proximales de spatules, par des différences de décor, qui individualisent ces zones de morphologie particulière par rapport à l’ensemble du support, comme cela a également été observé sur des harpons magdaléniens (Julien, 1982).
Les pièces découpées et sculptées
Enfin, quelques pièces témoignent aussi de relations morphologiques entre le support et le décor par une mise en forme particulière, conçue pour la représentation. Il s’agit de deux lissoirs, dont le façonnage du contour crée la représentation d’un mammifère marin et d’une patte verticale, complétée par la gravure des attributs internes, auxquels s’ajoutent des ours sculptés sur la partie compacte de la face inférieure d’un lissoir d’angle robuste, qui montrent également une recherche d’adaptation au support par le choix de cette position, unique, permettant de détacher la forme du fond en élaborant un relief (fig. 39). Cette pratique, consistant à donner au support une forme qui épouse celle de la
- 40 -
représentation, uniquement observée sur des lissoirs, semble associée à des figurations particulières, soit les animaux rares (mammifère marin, ours) et les pattes verticales, à plusieurs reprises découpées (également sur une pendeloque sur lame d’os). Ces rares exemples de mise en forme mettent en évidence la participation du support à la représentation, par son adaptation à la morphologie du décor.
Figure 39 : Les pièces découpées et sculptées.
Ces relations morphologiques entre les représentations et les supports, passant par la déformation des figurations, la distinction graphique des zones selon leur morphologie ou la mise en forme du support, mettent en évidence une recherche d’adéquation formelle entre les décors et les supports, par une adaptation de la représentation au support et/ou du support à la représentation.
2.2.4. Synthèse sur l’art mobilier sur côte d’Isturitz au Magdalénien moyen
Les côtes gravées des niveaux attribués au Magdalénien moyen de la grotte d’Isturitz correspondent aux différents types d’objets produits à partir de cette matière première, sans sélection flagrante de certains d’entre eux, à l’exclusion de la faible proportion de supports « bruts ».
Ces objets sont ornés de divers décors, dont la décomposition met en évidence un traitement différentiel selon les motifs. Alors que certaines représentations apparaissent fortement structurées par des corrélations entre la thématique et la répartition dans l’espace, qui leurs confèrent une inscription appropriée sur le support (très marquée pour les représentations de bisons), d’autres semblent beaucoup plus variables (notamment pour les chevaux et les motifs moins courants), impliquant sans doute différents degrés de codification.
Ces décors apparaissent en relation avec les supports sur lesquels ils figurent par leurs différences selon les types d’objets et certaines spécificités formelles. Les lissoirs et lames de
- 41 -
côte sont ornés de représentations particulièrement organisées (place des décors typés, recherche de composition), contrairement aux supports « bruts », apparemment utilisés pour des compositions plus « libres » (variabilité), qui indiquent vraisemblablement une perception différente des lissoirs et des supports « bruts ». D’autre part, de nombreuses pièces témoignent d’une recherche d’adéquation formelle entre les décors et les objets (déformations anatomiques, individualisation des zones de morphologie particulière, mise en forme du support). Ces faits montrent une adaptation des représentations aux supports, qui semblent tenir compte à la fois de leur fonction et de leur morphologie.
2.3. Au Magdalénien supérieur
Uniquement représenté par six pièces, l’art mobilier sur côte des niveaux attribués au Magdalénien supérieur d’Isturitz se répartit entre quatre lissoirs (dont trois spatules) et deux lames de côte. Une des ces lames de côte (fig. 40, n° 74) présente des registres d’incisions parallèles sur sa face inférieure, tout à fait comparables aux décors de ce type observés au Magdalénien moyen, toutefois elle pourrait appartenir à cette période, vues les limites de la stratigraphie. A l’exception de cette pièce, les objets présentent des décors couvrants variés (fig. 40), non organisés en compositions, à dominante non-figurative (3/5), alors que la seule figure reconnaissable présente un cervidé. Il est intéressant de constater que toutes ces représentations sont positionnées sur la face supérieure des supports, contrairement à la position préférentielle sur la face inférieure constatée au Magdalénien moyen. Ainsi, l’art mobilier sur côte des niveaux attribués au Magdalénien supérieur d’Isturitz présente une répartition des représentations sur les supports différente du Magdalénien moyen (position et disposition), même si la faible représentativité numérique de ce corpus ne permet pas d’en tirer de conclusions.
Figure 40 : L’art mobilier sur côte des niveaux attribués au Magdalénien supérieur d’Isturitz.
- 42 -
3. L’art mobilier sur côte d’Isturitz dans le cadre du Magdalénien du Sud-Ouest de la France
Par l’analyse de l’art mobilier sur côte des niveaux magdaléniens d’Isturitz, nous avons mis en évidence des tendances de représentation (position sur la face inférieure, organisation en composition courantes…) et des modes d’inscription récurrents appropriés à certains thèmes au Magdalénien moyen, qui ne se retrouvent pas vraiment au Magdalénien supérieur sur ce site. Pour replacer l’occupation magdalénienne d’Isturitz dans son contexte culturel, nous nous sommes alors interrogées sur la distribution, temporelle et géographique, de ces modes d’inscription des représentations sur les supports dans le cadre du Magdalénien du Sud-Ouest de la France.
3.1. Les groupes magdaléniens du Sud-Ouest de la France : questions posées
Le Magdalénien du Sud-Ouest de la France constitue un ensemble cohérent, notamment par les nombreuses convergences typo-technologiques des industries lithiques et osseuses, mais des particularités semblent indiquer la présence de groupes humains aux pratiques légèrement différentes.
Malgré un fond culturel inchangé (outillage lithique peu différencié, types communs de l’outillage osseux…), la variation de certains caractères, tels que les types d’armatures en matières osseuses, dans le temps, subdivise cet ensemble en deux périodes principales : le Magdalénien moyen et le Magdalénien supérieur (Pétillon, 2004). L’art mobilier du Magdalénien supérieur, moins abondant qu’à la période précédente, se distingue par la raréfaction des sculptures, la moindre proportion des représentations figuratives par rapport aux non-figuratives et l’adoption de décors typés différents (pointes à zigzags latéraux, représentations de chevaux à tête disproportionnée…) et sans doute plus rares (Saint-Périer, 1936 ; Desdemaines-Hugon, 1983 ; Alteirac et Vialou, 1984 ; Paillet, 1999…). Ces divergences générales conduisent à envisager une modification du système de représentation entre ces deux périodes, qui ouvre sur de nouvelles problématiques : Dans quelle mesure les décors du Magdalénien moyen et supérieur diffèrent ? Ces divergences graphiques traduisent-elles une adaptation ou un renouvellement du système de représentation ? Existe-t-il une concordance entre les changements techniques et artistiques ?
D’autre part, au-delà de l’unité culturelle du Magdalénien du Sud-Ouest de la France, notamment perceptible à travers la large distribution des contours découpés de têtes de chevaux, qui témoigne de relations étroites entre les groupes humains dans l’ensemble de cette région au Magdalénien moyen, certains éléments pourraient différencier plusieurs aires d’influence culturelle privilégiée. En effet, trois « provinces » (fig. 41) semblent présenter des particularités graphiques :
• Les Pyrénées occidentales se caractérisent par la présence, au Magdalénien moyen, de baguettes demi-rondes à volutes, inconnues en dehors de cette zone, qui pourraient donc « servir de marqueurs ethniques et délimiter une aire culturelle » (Clottes, 1989, p. 168).
• Les Pyrénées centrales se singularisent par la fréquence élevée de deux types de signes en contexte pariétal : les ramifiés et, surtout, les claviformes (Clottes, 1999).
- 43 -
• La Dordogne, et plus particulièrement la zone des Eyzies, présente des signes tectiformes « vrais » (par opposition aux tectiformes cantabriques de forme différente) en contexte pariétal, qui n’ont pas été observés ailleurs (Djindjian, 2005, p. 167).
Ces faits pourraient indiquer une individualisation graphique de différents groupes humains, qui demeure hypothétique, mais pose la question de l’existence de particularismes locaux et de leur signification en terme d’identité culturelle.
Figure 41 : Carte de répartition des sites étudiés par rapport aux différentes « provinces » envisagées (fond de carte : www.wikipedia.org/wiki/france © NASA 2002).
Sans prétendre apporter ici des réponses à toutes ces questions, nous nous sommes interrogées sur la stabilité et/ou la variation des modes d’inscription des représentations sur côte dont l’art mobilier magdalénien moyen d’Isturitz fait preuve par rapport à ces distinctions chrono-culturelles et régionales, liées à certaines pratiques graphiques. Pour cela, nous avons initié une comparaison entre l’art mobilier sur côte d’Isturitz et ceux de quelques gisements dont le contexte diffère (fig. 41), soit la grotte de La Vache (Ariège) et les abris de Laugerie-Basse et La Madeleine (Dordogne).
3.2. L’art mobilier sur côte de La Vache
La grotte de La Vache, située en Ariège (dans les Pyrénées centrales), a livré une couche dont l’attribution au Magdalénien supérieur, voire final, basée sur la typologie du matériel lithique et osseux, est confirmée par des analyses polliniques et des datations au radiocarbone, qui s’accordent pour affirmer que cette occupation s’étend sur un laps de temps « court » d’environ trois cent ans (Allard et Robert, 2003 ; Leroi-Gourhan Arl., 1967).
L’art mobilier sur côte de cette couche comprend au moins 70 pièces, qui se répartissent entre 29 supports « bruts », 16 lissoirs (dont un lissoir perforé), deux pendeloques et des fragments indéterminés, et comporte donc une proportion élevée de supports « bruts ». Les lissoirs de La Vache se distinguent de ceux du Magdalénien moyen d’Isturitz par un façonnage moins poussé, généralement
- 44 -
limité à une régularisation dégressive du tissu spongieux au niveau de la partie distale (Averbouh et Buisson, 2003), d’où la faible présence des lames de côte dans ce corpus.
3.2.1. Une thématique comparable…
Les représentations réalisées sur ces objets indiquent d’importantes convergences thématiques avec l’art mobilier sur côte du Magdalénien moyen d’Isturitz. En effet, les mêmes thèmes dominent, par la prépondérance des incisions parallèles (sur 15 pièces), suivies des bisons et chevaux (sur 4 pièces chacun), qui ne se démarquent cependant pas des bouquetins (sur 4 pièces) (Lucas, 2006). L’« abréviation » des figurations semble répondre aux mêmes principes par une réduction des figures à la tête, systématique pour les bouquetins et récurrente pour les bisons (3/4) (fig. 42), alors que les représentations de chevaux sont plus souvent développées (3/4). On retrouve également l’agglomération d’animaux de même espèce sur les supports, notamment des bisons (2/4), mais aussi d’autres figures, telles que les bouquetins (2/4), contrairement aux représentations de bouquetins « isolées » d’Isturitz.
Figure 42 : Exemple de représentation de têtes de bison sur support « brut » (pièce n°178).
Au-delà de ces caractères communs des représentations les plus fréquentes, l’absence de certains motifs (ligne sinueuse…), types d’ « abréviation » (pattes) et associations observés dans le Magdalénien moyen d’Isturitz, l’existence d’association d’animaux d’espèces différentes (sur 2 pièces)… constituent des différences, qui restent cependant secondaires par rapport à l’ensemble de la thématique, d’autant plus qu’elles concernent essentiellement des motifs peu récurrents, à l’exception de la place importante des tracés indéterminés dans ce corpus.
La thématique de l’art mobilier sur côte de La Vache présente donc un fond commun avec le Magdalénien moyen d’Isturitz par des thèmes dominants similaires, la même « abréviation » préférentielle selon les figures et la tendance au regroupement d’animaux de même espèce.
3.2.2. …mais une répartition différente
La répartition de ces décors sur les supports indique aussi certaines similitudes avec le Magdalénien moyen d’Isturitz, par la position préférentielle sur la face interne des supports à section pleine (21/30) et la domination des représentations couvrantes, couramment organisées en suites (sur 9 pièces), qui s’appliquent aux bisons, chevaux, bouquetins et cervidés (sur 2 pièces chacun) et à certains animaux rares (lions, ours).
- 45 -
Cependant d’importantes différences d’investissement du support apparaissent. En effet, la dispositions en registres longitudinaux est exceptionnelle (sur 5 pièces), d’où la moindre importance des compositions (seulement 15 pièces présentant des compositions/70), et l’orientation des figures est presque exclusivement horizontale (1 figure verticale/23). De plus, les décors se présentent toujours sur la face supérieure des supports débités longitudinalement, rarement complétés par des gravures sur la face inférieure (2 pièces au décor bifacial). Cette quasi-absence des représentations sur la face inférieure est en relation avec le façonnage des lissoirs, qui passe très rarement par la suppression totale du tissu spongieux et rend donc cette face impropre à la gravure.
Figure 43 : Exemples de représentations couvrantes de La Vache.
Ainsi, la distribution des représentations sur les supports présente une moindre diversification des modalités, au profit de l’emploi quasi-exclusif d’une inscription ordinaire (représentations généralement positionnées sur la face supérieure, couvrantes, et horizontales pour les figurations) et peu organisée (moindre importance des compositions), quels que soient les thèmes. La répartition des représentations distingue donc l’art mobilier sur côte de La Vache du Magdalénien moyen d’Isturitz, paraissant plus proche des pièces attribuées au Magdalénien supérieur d’Isturitz.
3.2.3. Des représentations moins typées
Ces différences se traduisent par l’absence de réels décors typés récurrents à La Vache. A l’exception des registres d’incisions parallèles représentés sur la face supérieure d’un pendeloque (fig. 44), qui témoigne de la perduration de cette représentation au Magdalénien supérieur, mais dans une position et sur un support différents, aucun des décors typés du Magdalénien moyen d’Isturitz n’est représenté dans ce corpus, qui ne propose pas non plus de types différents.
Figure 44 : Pendeloque à registres d’incisions parallèles (pièce n°189 : face supérieure).
- 46 -
3.2.4. Relations support/décor correspondantes
La moindre importance des relations entre la thématique et sa répartition sur les supports et l’absence de décors typés récurrents entraînent des différences peu caractéristiques entre les types d’objets. En effet, le décor des lissoirs ne se distingue de celui des supports « bruts » que par la proportion plus importante des figurations (contrairement à ce que nous avions observé dans le Magdalénien moyen d’Isturitz), au détriment des tracés indéterminés, et les compositions sont plus nombreuses sur les spatules et pendeloques notamment. Ces objets témoignent parfois de relations formelles entre les représentations et le support, notamment par la division de l’espace en registres à partir de la perforation (sur 2 des 3 pièces perforées – fig. 10 et 44) et le décor d’une spatule, reprenant la forme de cette outil par la figuration d’un poisson (fig. 45). Toutefois, ces adaptations morphologiques, uniquement associés aux attributs morphologiques marquants, sont rares au sein de ce corpus, qui ne présente qu’un seul cas de déformation et aucune pièce découpée.
Figure 45 : Spatule au poisson de La Vache (pièce n°188 : face supérieure).
Par conséquent, la comparaison de l’art mobilier sur côte du Magdalénien supérieur de La Vache avec celui du Magdalénien moyen d’Isturitz met en évidence un fond thématique commun au Magdalénien moyen et supérieur dans les Pyrénées, mais surtout une inscription des représentations sur les supports fondamentalement différente (uniformisation de la répartition, peu corrélée aux différents motifs), dont résultent des représentations peu typées et des relations entre les décors et les supports relativement peu marquées, à l’exception de quelques représentations. Ainsi, les caractéristiques de ce corpus rejoindraient plutôt les observations réalisées à partir des quelques pièces attribuées au Magdalénien supérieur d’Isturitz (position sur la face supérieure, représentations couvrantes, moindre importance des compositions) et pourraient éventuellement indiquer des différences d’inscription des représentations sur les supports entre le Magdalénien moyen et supérieur.
3.3. Comparaison avec la Dordogne
La comparaison avec l’art mobilier sur côte des grands sites périgourdins, soit Laugerie-Basse et La Madeleine, va nous permettre d’approfondir cette interrogation sur la portée culturelle et géographique des différentes caractéristiques de l’inscription des représentations sur côte.
3.3.1. L’art mobilier sur côte de Laugerie-Basse
Le site de Laugerie-Basse, en Dordogne, comprend deux abris, qui constituaient probablement un habitat continu (Roussot, 1984) et ont livré plusieurs couches d’occupation, attribuées à différentes phases du Magdalénien moyen et supérieur (Maury, 1925 ; Roussot, 1982). Cependant, à
- 47 -
l’exception de quelques pièces, les informations concernant la couche d’origine ont été perdues et ne permettent donc plus de savoir de quelle période du Magdalénien les objets proviennent.
La réunion des deux plus importantes collections, conservées au M.N.P. et au M.A.N., nous a permis de rassembler 48 côtes gravées, qui constituent théoriquement l’essentiel de l’art mobilier sur côte découvert sur ce site, malgré l’éparpillement des pièces dans divers musées. Ce corpus se répartit entre douze supports « bruts », onze lissoirs, quatre outils « mousses » sans front de lissoir, trois outils indéterminés, une pendeloque et dix-sept fragments indéterminés (dont 13 lames de côte), et présente ainsi un assemblage comparable à celui du Magdalénien moyen d’Isturitz, en dehors de la proportion plus importante de supports « bruts ».
A. Une thématique différente ?
La thématique représentée sur ces objets se distingue nettement de celles d’Isturitz et de La Vache par la rareté des figurations (seulement 7 ou 8 pièces/48), qui sont constituées de chevaux (sur deux pièces) et de bisons (sur 2 pièces), mais aussi de cervidés (sur 2 pièces) et de figures rares, telles qu’un poisson et un harpon (sur 1 pièce chacun) (fig. 46). Il est remarquable, malgré la pauvreté de cet art figuratif, que les représentations de bison ne sont pas abrégées à la tête (fig. 46, n°119 et 122) et qu’un support associe un bison à un cheval (fig. 46, n° 122).
Figure 46 : Principales figurations sur côte du Magdalénien de Laugerie-Basse.
Parmi les décors non-figuratifs, les incisions parallèles prédominent largement (sur 30 pièces), suivies des quadrillages obliques (sur 8 pièces), des lignes sinueuses composées de courtes hachures (sur 6 pièces) et des points (sur 6 supports), alors que les autres signes sont rares. La récurrence relative de ces motifs est analogue au Magdalénien moyen d’Isturitz, malgré une proportion plus importante de quadrillages obliques. Ce parallèle est confirmé par la présence d’associations non-figuratives identiques, telles que la juxtaposition exclusive des lignes sinueuses composées de courtes hachures avec les incisions parallèles (sur 6 pièces), alors que les incisions parallèles s’associent à divers signes (quadrillages obliques, points…).
- 48 -
Ainsi, la thématique de Laugerie-Basse se singularise par la rareté exceptionnelle des figurations, mais les représentations non-figuratives sont comparables avec le Magdalénien moyen d’Isturitz (récurrence et associations des signes).
B. La répartition des représentations
La répartition de ces décors sur les supports présente également des similitudes avec ce corpus :
• Préférence pour la face interne des supports à section pleine (7 pièces)
• Représentations courantes sur la face inférieure des supports débités longitudinalement (10 pièces), liées à certains motifs (ligne sinueuse), alors que d’autres apparaissent plutôt sur la face supérieure (quadrillages obliques).
• Abondance des registres longitudinaux, particulièrement appliqués aux incisions parallèles et lignes sinueuses (fig. 47, n°88 et 106).
Toutefois, certaines différences apparaissent :
• Proportion de représentations sur la face supérieure plus élevée (16 pièces).
• Importance des compositions en registres longitudinaux (25/48), au détriment d’une faible proportion de représentations couvrantes (12/48), en relation avec la rareté des figurations.
• Présence récurrente de quadrillages obliques disposés en registres (3 pièces) (fig. 47, n°86).
• Absence de réelle corrélation entre les registres longitudinaux et la position.
Figure 47 : Disposition caractéristique des principaux thèmes.
Ainsi, l’inscription des signes sur les supports à Laugerie-Basse témoigne de concepts identiques au Magdalénien moyen d’Isturitz, mais dans des proportions plus ou moins importantes.
- 49 -
C. Les décors typés
Du fait de ces corrélations entre les signes et leur répartition, des décors typés récurrents similaires s’observent dans ce corpus (fig. 49 et 50). Les registres d’incisions parallèles sont les plus courants (10 pièces) et se positionnent indifféremment sur la face inférieure (4 pièces) ou supérieure (3 pièces) des supports débités longitudinalement. Ensuite, les incisions parallèles encadrant un motif sinueux central (sur 6 pièces) présentent certaines variations, par la multiplication des registres sur deux pièces, et se situent plutôt sur la face inférieure (4/6), mais pas exclusivement. Deux pièces, attribuées au Magdalénien moyen, attestent la « diffusion » de ces deux modes d’inscription à cette période. A cela s’ajoutent des quadrillages obliques disposés en registres longitudinaux (sur 3 pièces), situés le long des bords ou en registres tripartites, qui composent un type de décor supplémentaire (fig. 47, n°86). D’autre part, deux lame d’os indéterminées arborent des représentations assimilables à certains décors typés du Magdalénien moyen d’Isturitz (fig. 48), par la figuration d’une tête de bison verticale en tous points similaire aux représentations d’Isturitz, qui sont supposées être l’œuvre d’un même graveur, et par la mise en forme d’une pièce représentant une patte verticale, mais dont les gravures internes diffèrent (cheval et poisson).
Figure 48 : Tête de bison et patte verticales sur lames d’os indéterminée de Laugerie-Basse.
La présence des principaux décors typés observés dans le Magdalénien moyen d’Isturitz indique des relations entre les occupants de ces deux sites au Magdalénien moyen, en dépit de l’absence de réelle corrélation entre ces décors typés et leur position et de la présence d’un type supplémentaire à Laugerie-Basse. Ces représentations normées ont sensiblement la même place dans ces deux corpus, où elles représentent un peu plus d’un tiers des décors, alors que les représentations variées sont plus nombreuses.
D. Les relations support/décor
Les registres d’incisions parallèles sont représentés sur quatre lissoirs (dont deux lissoirs d’angle, un lissoir commun et un lissoir double), quatre lame d’os et un support « brut », mais aussi sur un outil indéterminé et une pendeloque, portant seulement deux registres d’incisions parallèles le long des bords (fig. 49). Par conséquent, ce corpus indique une distribution plus vaste de cette représentation à un support « brut » et à une pendeloque, qui pourraient indiquer qu’il n’est pas exclusivement réservé aux lissoirs, même s’il n’est pas exclu que ces supports soient des fragments d’outils. Les incisions parallèles encadrant un motif sinueux sont quant à elles réalisées sur deux lissoirs (un lissoir dièdre et un lissoir double) et trois lames de côte, mais un outil « mousse » sans front de lissoir, sur côte à section pleine, présente également une déclinaison de ce type de décor par la multiplication des motifs, témoignant uniquement de sa représentation sur des outils (fig. 50). De même, les quadrillages
- 50 -
obliques en registres figurent sur un lissoir, un outil « mousse » sans front de lissoir et une lame de côte, et ne sont donc attesté que sur des outils dans ce corpus (cf 5.2.2).
Figure 49 : Les supports déterminés portant des registres d’incisions parallèles.
Figure 50 : Les supports des incisions parallèles encadrant un motif sinueux.
Par conséquent, la majorité des décors typés sont représentés sur des outils et plus particulièrement sur des lissoirs, comme nous l’avons remarqué dans le Magdalénien moyen d’Isturitz, toutefois la distinction entre les lissoirs communs et d’angle ne se retrouve pas et la présence exceptionnelle de registres d’incisions parallèles sur d’autres supports pourrait indiquer une association plus libre de cette représentation avec différents types d’objets.
D’une manière plus générale, les lissoirs portent presque exclusivement des signes disposés en registres, à l’exception des spatules, dont les décors sont plus variés et individualisent la partie
- 51 -
proximale (par des représentations particulières ou absentes sur cette partie) (fig. 51). De même les autres outils « mousses » et outil indéterminés présentent essentiellement des signes en registres, et parfois centrés, qui dominent aussi sur les lames de côte (9 pièces divisées en registres/13). De ce fait, les outils sont très majoritairement ornés de représentations non-figuratives organisées en compositions.
Figure 51 : Le décor des spatules.
Au contraire, le décor des supports « bruts » se caractérise par une proportion beaucoup moins importante de registres (4/12), au profit de représentations non-figuratives moins structurées (fig. 52) et de représentations couvrantes (4/12), en partie liées à la présence de plusieurs figurations sur ce type d’objet (au moins 3 pièces).
Figure 52 : Exemples de représentations non-figuratives sur supports « bruts ».
Ainsi, les différences de décor entre les lissoirs et les supports « bruts » sont encore plus marquées à Laugerie-Basse, par la présence des décors typés essentiellement sur les lissoirs, mais surtout par l’importance des compositions en registres longitudinaux sur ce type d’objet, alors que les représentations sur supports « bruts » apparaissent plus variées, moins organisées et présentent une proportion plus importante de figurations, qui confirment largement les observations réalisées à partir du Magdalénien moyen d’Isturitz. D’autre part, la même adaptation formelle au support est sensible à travers l’individualisation des parties proximales de spatules.
- 52 -
L’art mobilier sur côte de Laugerie-Basse, qui regroupe à la fois du Magdalénien moyen et supérieur, présente ainsi des convergences frappantes avec le Magdalénien moyen d’Isturitz, par la même inscription des signes sur les supports, impliquant la présence de décors typés identiques. Les relations entre ces représentations et les supports sont tout à fait comparables puisque les lissoirs se distinguent des supports « bruts » par des représentations plus normées et plus organisées, confirmant largement la distinction entre ces deux types d’objets, et les décors s’adaptent à la morphologie particulière des objets (spatules). De ce fait, en dépit de la rareté des figurations, des conséquences induites et de divergences secondaires (quadrillages, position…), l’inscription des représentations sur côte à Laugerie-Basse témoigne d’une communauté de concepts entre les Pyrénées occidentales et la Dordogne au Magdalénien moyen, qui implique des relations étroites entre les groupes humains.
3.3.2. L’art mobilier sur côte de La Madeleine
Situé à proximité immédiate du site de Laugerie-Basse, l’abri de La Madeleine a livré trois couches d’occupation magdalénienne, dont l’une est attribuée au Magdalénien moyen, sur la base de la domination des pointes de sagaies à biseau simple notamment, alors que les deux autres correspondent à du Magdalénien supérieur et se caractérisent par la présence de harpons (Capitan et Peyrony, 1928 ; Bouvier, 1977).
Par l’observation des pièces conservées au M.N.P. (correspondant à la majeure partie des collections de ce site) et au M.A.N., nous avons réuni 22 côtes gravées, dont treize sont attribuées au Magdalénien moyen et six au Magdalénien supérieur. Cependant, cette quantité relativement peu importante et, surtout, la très forte prépondérance des supports « bruts » (14 pièces/22 pour seulement 5 fragments interprétables en tant qu’outils) remettent en question la représentativité de ce corpus.
A. Au Magdalénien moyen
Les pièces attribuées au Magdalénien moyen se répartissent entre dix supports « bruts », un support façonné, un outil indéterminé et un fragment indéterminé, constituant ainsi un assemblage très différent de ceux que nous avons étudié auparavant.
La thématique représentée sur ces objets est, en proportions équivalentes, figurative (6/13) ou non (5/13), dominée par les incisions parallèles (sur 4 supports), suivies des chevaux (3 supports), alors que les autres motifs sont uniques ou indéterminés et qu’aucun bison n’est figuré. Les chevaux sont plus souvent « abrégés » à la tête (2/3) qu’entiers (fig. 53), contrairement à ce que nous avons observé à Isturitz et La Vache. Ces représentations variées se positionnent généralement sur la face interne de supports à section pleine (8 pièces), alors que les deux supports débités longitudinalement portent des décors sur la face supérieure. Les figurations sont couvrantes, souvent orientées horizontalement (4/6), mais aussi parfois verticalement (une patte verticale et un anthropomorphe), et ne composent apparemment pas de suites. Au contraire, les incisions parallèles sont plutôt disposées en registres (2/4) sur la face supérieure.
- 53 -
Figure 53 : Représentations de chevaux sur supports « bruts » de La Madeleine.
En terme de proportions, ce corpus apparaît donc très différent de ceux du Magdalénien moyen d’Isturitz et de Laugerie-Basse, par l’importance des figurations et la rareté des compositions notamment, mais ces différences sont peut-être liées à la prépondérance déterminante des supports « bruts », apparemment associés à une certaine variabilité. D’autre part, deux pièces créent un parallèle avec l’art mobilier sur côte du Magdalénien moyen d’Isturitz, car elles présentent des décors typés observés sur ce site (fig. 54). Il s’agit d’une patte verticale découpée sur un support façonné non-utilitaire et d’une lame de côte fortement ocrée, dont la couche d’origine est inconnue, présentant des incisions parallèles encadrant une ligne sinueuse composée de courtes hachures sur sa face inférieure.
Figure 54 : Les décors similaires à ceux du Magdalénien moyen d’Isturitz.
- 54 -
B. Au Magdalénien supérieur
Les sept pièces attribuées au Magdalénien supérieur correspondent à trois supports bruts, deux pendeloques, un fragment de lissoir d’angle et un fragment indéterminé, qui portent des représentations non-figurative (4/7) ou figuratives (3/7), parmi lesquelles le seul motif récurrent est le cervidé, « abrégé » à la tête sur deux supports « bruts » (fig. 55). Les supports à section pleine présentent uniquement des décors sur la face interne (3 pièces), alors que les supports débités longitudinalement sont gravés sur la face supérieure (2 pièces) ou un bord (1 pièce). Malgré la pauvreté de ce corpus, deux représentations indiquent une adaptation au support par le désaxement des bois d’un cervidé et la division de l’espace d’une pendeloque en deux registres longitudinaux symétriques à partir de la perforation (fig. 55 et 56).
Figure 55 : Représentations de cervidés sur supports « bruts ».
Figure 56 : Division de l’espace à partir de la perforation (pièce n°134)
La représentativité du corpus d’art mobilier sur côte analysé pour le site de La Madeleine est douteuse, étant donné la prépondérance des supports « bruts » et la rareté des outils, qui expliquent sans doute en partie les différences qu’il présente par rapport aux autres sites (variété des représentations…). Toutefois, cet art témoigne de relations avec Isturitz et Laugerie-Basse au Magdalénien moyen par la présence de deux décors typés identiques et indique la persistance une adaptation formelle des représentations au support au Magdalénien supérieur.
- 55 -
3.4. Inscription des représentations sur côte et influences culturelles
La comparaison de l’art mobilier sur côte de ces différents gisements indique certaines caractéristiques apparemment stables dans l’ensemble du Magdalénien du Sud-Ouest de la France. Il s’agit, au niveau thématique, de la prépondérance des incisions parallèles et de la réduction courante des animaux à la tête (concernant la moitié des figures). La répartition est plus variable, mais la domination des représentations unifaciales, et plus particulièrement de la position préférentielle des gravures sur la face interne, concave et lisse, des supports à section pleine se retrouve dans tous les corpus analysé (environ 70% des représentations sur supports à section pleine). De même, la prise en compte des attributs morphologiquement marquants des pendeloques et spatules constitue une intégration formelle du support récurrente. Ces pratiques témoignent de concepts « permanents » et d’une certaine adaptation des représentations aux supports, quelle que soit la période et le site. Cependant, au-delà de ces similitudes, des différences graphiques, pourraient distinguer le Magdalénien moyen du supérieur d’une part, et des convergences témoignent de relations entre différents sites au Magdalénien moyen, d’autre part.
3.4.1. Magdalénien moyen/supérieur
Etant données les difficultés posées par l’attribution chronologique des pièces de Laugerie-Basse et les incertitudes sur la représentativité des pièces analysées pour La Madeleine, la comparaison entre le Magdalénien moyen et le Magdalénien supérieur repose essentiellement sur l’art mobilier d’Isturitz et de La Vache, mais l’inscription des représentations sur côte semble varier selon la période. En effet, nous avons remarqué des différences au niveau de la répartition des décors, selon la proportion de représentations sur la face inférieure des supports débités longitudinalement, la fréquence des registres longitudinaux et la présence/absence de l’orientation verticale. Cependant, c’est surtout la corrélation entre les thèmes et leur répartition qui semble distinguer ces deux périodes, en conférant au Magdalénien moyen des modes d’inscription récurrents et appropriés à certains thèmes, qui ne sont pas attestés au Magdalénien supérieur (à l’exception de rares registres d’incisions parallèles), au profit d’une répartition apparemment moins structurée des motifs sur les supports, impliquant l’absence de réels décors typés sur côte à cette période. Ces observations pourraient mettre en évidence une intégration fondamentalement différente des représentations aux supports, qui apparaît plus ou moins adaptée aux thèmes et aux objets, mais elles se basent uniquement sur deux gisements et demandent donc une plus ample confirmation.
3.4.2. Les relations inter-sites au Magdalénien moyen
D’autre part, la structuration particulière de nombreux décors au Magdalénien moyen facilite la mise en relation des différents sites. La distribution des décors typés (tabl. 2) établit des parallèles complexes entre les sites d’Isturitz et de Laugerie-Basse, mais aussi, plus ponctuellement, de La Madeleine. Trois types de décors, soit les incisions parallèles encadrant un motif sinueux, les têtes de bison verticales et les pattes verticales, sont également connus
- 56 -
dans des gisements pyrénéens épars (Duruthy, Les Espélugues, Enlène, La Mas d’Azil, Gazel…) et témoignent donc d’une diffusion large de certains modes d’inscription des représentations dans le Sud-Ouest de la France, attestant de relations, à une vaste échelle, entre les Pyrénées et la Dordogne.
type Isturitz Laugerie-Basse
La Madeleine
La Vache attribution
incisions parallèles en registres 12 12 2 1Magdalénien moyen et supérieur
incisions parallèles encadrant un motif sinueux 11 6 1
seulement attesté au Magdalénien moyen
pattes verticales 3 1 1 seulement attesté au Magdalénien moyen
têtes de bison verticales 12 1 seulement attesté au Magdalénien moyen
bisons/ramifiés 2 seulement attesté au Magdalénien moyen
têtes de chevaux inversées 2 seulement attesté au Magdalénien moyen
quadrillages en registres 4 Magdalénien moyen et/ou supérieur
Tableau 2 : Distribution des décors typés.
Ces contacts ont, par ailleurs, été soulignés à plusieurs reprises, notamment à partir de la présence de quatre contours découpés de têtes de chevaux et de quelques rondelles perforées sur les sites de Laugerie-Basse et La Madeleine (Tosello, 2003, p. 492-493). Toutefois, la faible quantité de ces témoins en Dordogne conduirait plutôt à envisager la fin d’une aire de diffusion, une sorte de marge d’un territoire influent, alors que l’inscription des signes sur côte montre une communauté de concepts entre Isturitz et Laugerie-Basse par des corrélations identiques entre leur récurrence, leurs associations et leur disposition, qui correspondent à des normes de représentation communes pour l’ensemble des signes et indiquent une base culturelle identique.
Il convient toutefois de rappeler certaines différences plus discrètes, à travers les modes d’inscription particuliers de certains thèmes, qui sembleraient se restreindre à un contexte plus limité d’après le matériel analysé, comme les têtes de chevaux inversées d’Isturitz ou les quadrillages en registres de Laugerie-Basse (également représentés sur certaines pièces de Laugerie-Haute), et pourraient donc avoir une portée plus localisée. Toutefois, ces hypothèses de différenciation ne reflètent qu’un état des connaissances actuelles et sont sûrement amenées à évoluer.
- 57 -
4. Conclusion
Cette recherche sur l’intégration des représentations aux supports dans l’art mobilier sur côte du Magdalénien du Sud-Ouest de la France nous a amenées à mettre en place un procédé d’analyse par décomposition des représentations en différents paramètres, mis en perspective pour rechercher les relations créées par les Magdaléniens entre ces décors et les objets sur lesquels ils figurent. L’application de cette démarche nous a permis d’observer, dans l’art mobilier attribué au Magdalénien moyen de la grotte d’Isturitz, des corrélations récurrentes entre les thèmes et leur répartition, qui témoignent de normes de représentation complexes de certains sujets (bison, ligne sinueuse…), tenant compte du support, auxquelles s’ajoutent des décors plus variés et apparemment moins adaptés.
Ces différents degrés de codification des représentations distinguent les lissoirs, aux représentations très structurées, des supports « bruts », associés à une importante variabilité graphique, impliquant une perception différente de ces deux types d’objets, amplement confirmée à Laugerie-Basse, qui peut être mise en perspective avec leur fonction supposée différente et avec leurs caractéristiques morphologiques. L’hypothèse fonctionnelle consisterait à opposer un art « appliqué », fortement codifié, à un art « non-appliqué », plus varié, si l’absence de fonction utilitaire des supports « bruts » était confirmée. L’explication morphologique consisterait plutôt à invoquer la régularité de ces objets (plus ou moins importante selon leur façonnage), souvent mise en relation avec la présence de compositions en suites et registres longitudinaux notamment (Barandiaran,1996 ; Delporte et Mons, 1977). L’influence de la morphologie est d’ailleurs avérée par de nombreuses pièces, qui manifestent une intégration formelle du support à la représentation par des déformations anatomiques adaptées, une individualisation des zones de morphologie particulière et quelques objets découpés. Ces faits indiquent une influence du support sur les décors, puisqu’il constitue un fond et un élément visuel participant à la représentation, mais détient aussi un rôle « fédérateur » (compositions associées, structuration plus ou moins importante des représentations…), qui lui confèrent, dans de nombreux cas, un impact important sur la conception des décors, que ce soit par une adaptation à sa forme ou à sa fonction.
L’interprétation des différences graphiques mises en évidence n’a pas pu être approfondie du fait de nombreuses incertitudes fonctionnelles et de la morphologie générale allongée comparable des objets produits sur côtes, qui ne les distingue réellement que ponctuellement (attributs morphologiquement marquants). Toutefois, cette recherche enrichit le débat sur les relations entre les supports et les décors en interrogeant sur le poids relatif de la fonction et de la morphologie des objets par rapport aux représentations réalisées. Seule une comparaison avec d’autres types d’objets permettra d’éclairer cette question, puisque certains semblent partager des caractéristiques communes avec l’art mobilier sur côte, alors que d’autres indiquent plutôt d’importantes différences. Par exemple, la fréquence des registres longitudinaux a également été observée sur d’autres objets allongés et réguliers, tels que les baguettes demi-rondes et les pendeloques allongées (Picot, 2006). Au contraire, la réduction courante des figures à la tête, notamment pour les bisons du Magdalénien moyen d’Isturitz, ne semble pas se retrouver sur tous les supports, puisque ce sont les représentations de bison acéphales qui dominent sur les plaquettes lithiques gravées du Périgord à la même période
- 58 -
(Tosello, 2003), indiquant vraisemblablement une opposition, voire une complémentarité, entre certains types d’objets. Ces observations participent au regroupement des objets allongés, par opposition aux supports de forme massive, qui ne semblent pas liés aux mêmes types de disposition et d’« abréviation ». Par conséquent, l’élargissement de cette analyse à l’ensemble des supports plats constitue une voie de recherche intéressante puisqu’elle permettra d’établir des comparaisons entre des supports de morphologie nettement différente (allongée/massive) et de fonction bien distincte, et ainsi de caractériser les différences graphiques associées et d’en rechercher les relations de cause à effet.
Certaines relations élaborées entre les supports et les représentations paraissent liées à l’appartenance culturelle du graveur puisque la comparaison de l’art mobilier sur côte d’Isturitz avec d’autres corpus du Magdalénien du Sud-Ouest de la France semble différencier le Magdalénien moyen du Magdalénien supérieur par une inscription plus ou moins appropriée aux thèmes abordés et aux objets, mais permet surtout d’établir des parallèles complexes entre les sites d’Isturitz et de Laugerie-Basse au Magdalénien moyen. En effet, l’inscription des signes sur les supports est analogue sur ces deux gisements et se traduit notamment par la présence de décors typés identiques, qui témoignent d’une même conception des représentations, résultat de contacts entre les groupes humains qui ont occupé ces sites. Des indications bibliographiques semblent confirmer ces relations, à une plus vaste échelle, entre la Dordogne et les Pyrénées, par la distribution des décors typés au Magdalénien moyen, qui pourrait unifier le Sud-Ouest de la France, au-delà de quelques pratiques graphiques apparemment plus localisées.
L’analyse ciblée sur quelques sites ne permet pas de caractériser la portée des normes de représentation observées, mais tout au plus d’observer certaines convergences et divergences, dont l’interprétation chronologique et/ou régionale demeure conjecturale. Ces résultats conduisent toutefois à reconsidérer les questions de l’interdépendance des changements techniques et artistiques et de l’individualisation graphique des groupes humains. De ce fait, il serait particulièrement intéressant de revenir sur une analyse plus systématique de l’inscription des représentations dans l’ensemble du Magdalénien du Sud-Ouest de la France pour préciser les influences culturelles selon la période (Magdalénien moyen/supérieur) et la zone géographique (Pyrénées/Dordogne).
Si notre recherche a apporté quelques éléments, par la mise en évidence d’inter-relations particulières entre les décors et les supports et par l’observation de concepts plus ou moins partagés, de nombreuses questions restent en suspens. L’analyse de l’inscription des décors sur les supports permet de réfléchir sur la structure du système de représentation, sa variation et ses implications en terme d’identité culturelle, mais la compréhension des éléments en relation nécessite une recherche élargie, qui donnera les moyens d’envisager le rôle social de l’art mobilier dans la culture magdalénienne.
- 59 -
5. Annexes
5.1. Explications complémentaires
5.1.1. Critères de détermination du corpus
A. Détermination anatomique des côtes
Pour la détermination anatomique des côtes, plusieurs indices ont été particulièrement utiles :
• La faible épaisseur du tissu compact, associée à la présence du tissu spongieux ou de résidus de ce tissu osseux (fonds d’alvéoles), qui permet de distinguer les os plats.
• La courbure particulière des côtes (fig. 57), concave ou convexe selon que l’on se situe sur la face interne ou externe de cet os.
• Une largeur restreinte, confirmée par la présence des bords, ou de la courbure qui les précède directement, et permet d’observer leur morphologie, concave et mousse, pour le bord crânial, ou convexe et tranchante, pour le bord caudal, voire l’élargissement de la côte en direction ventrale.
• La morphologie du tissu spongieux.
• La diminution de l’épaisseur en direction ventrale…
Figure 57 : La morphologie des côtes : côte de cheval vue de profil.
- 60 -
La détermination a été réalisée à partir de l’association de plusieurs de ces indices, qui la rendent relativement aisée pour les supports peu modifiés, tels que les supports à section pleine, alors que la difficulté augmente proportionnellement au degré de transformation. De ce fait, de nombreuses lames d’os indéterminées, qui pourraient avoir été réalisées sur côtes, sur lesquelles les bords ne sont plus visibles (extraction, façonnage…) et dont le tissu spongieux a été totalement supprimé, ont du être laissées de côté puisqu’il nous était impossible d’assurer leur origine anatomique, c’est pourquoi nous les évoquons seulement à titre de comparaison.
B. Identification des décors
Au-delà de nombreuses représentations immédiatement reconnaissables par leur organisation et leur récurrence, l’existence de tracés indéterminés, avérée dans l’art paléolithique par leur association avec d’autres représentations notamment, conduit à reconsidérer la détermination des gravures à partir de leur caractère intentionnel et non-fonctionnel, c’est-à-dire sur des critères techniques qui les distinguent des traces de découpe et de fabrication. Pour cela, nous avons considéré l’intensité soutenue du tracé, qui a une profondeur et une section stable sur un longueur significative, contrairement à la morphologie effilée des traces de boucherie et des stigmates de dérapage d’outils, dont la profondeur diminue plus ou moins progressivement. Ensuite, les « incisions » proches de certains stigmates techniques (stries de raclage…) ont été éliminées.
Toutefois, par rapport à notre précédente étude (Lucas, 2006), nous ne sommes plus convaincues du caractère intentionnel de certaines « incisions » sinueuses en « S » allongé car l’observation d’autres séries nous a permis d’observer des traces effilées de morphologie proche (fig. 58), d’autant plus que ces « incisions » sont généralement seules et sur la face interne des supports « bruts ». Le matériel des niveaux attribués au Magdalénien moyen d’Isturitz n’a pas posé ce genre de problèmes d’identification, cependant des traces litigieuses de ce type, notamment issues des collections de La Madeleine, n’ont pas été considérées ici en temps que décor et le corpus d’art mobilier sur côte du site de La Vache a été réduit en conséquence.
Figure 58 : Traces effilées remettant en question le caractère intentionnel de certaines « incisions » interprétée antérieurement comme des tracés indéterminés, Magdalénien de La Madeleine (face interne).
- 61 -
5.1.2. Apports de l’approche technologique à la caractérisation des supports
A. Observation du matériel sur côte non décoré du Magdalénien moyen d’Isturitz
La recherche sur les techniques de fabrication associées aux différents types d’objets, nous a amenées à une observation générale de l’ensemble du matériel sur côte du Magdalénien moyen d’Isturitz et à une analyse particulière de certaines pièces sans décor, pour avoir un spectre plus large des possibilités techniques et envisager la place des pièces décorées au sein des industries sur côte.
Etant donnée l’absence de pièces sur côte sans gravures interprétables en tant que pendeloques, sans autres fonctions possibles, dans le Magdalénien moyen d’Isturitz, et la non-transformation des supports non-utlitaires sans décor, nos observations se sont concentrées sur les outils « mousses » (uniquement ceux possédant une partie distale permettant leur identification), dont l’examen révèle des différences relatives aux techniques de débitage, à l’étendue et à l’intensité du façonnage, ainsi qu’aux dimensions, que nous avons mises en perspective avec les types d’outils correspondants. Cette analyse a été considérablement limitée par la faible présence des outils « mousses » sans front de lissoir (seulement 6 pièces, sur les 46 pièces observées), qui ne sont pas suffisamment nombreux pour être réellement représentatifs. Toutefois, quelques pistes ont pu être dégagées :
Des différences de débitage : Dans l’ensemble, les procédés de débitage ne sont pas vraiment discriminants pour la classification des supports car les hémi-côtes, constituant le support débité le plus utilisé (15/28 supports débités identifiés), peuvent servir à fabriquer différents outils et conviennent également à la réalisation d’objet de parure. Cependant deux types de débitage apportent des indications sur le type d’outil :
• Les outils sur côte à section pleine (n’ayant subi aucun débitage longitudinal) sont rares (seulement 3 pièces/46) et correspondent exclusivement à des outils « mousses » sans front de lissoir (fig. 59), ils indiquent cependant que tous les fragments de côte à section pleine bruts de débitage ne sont pas nécessairement des supports non-utilitaires car des stigmates d’utilisation et/ou de façonnage pourraient se trouver sur une extrémité disparue, d’autant plus qu’aucun support non-utilitaire gravé entier n’est attesté sur côte.
Figure 59 : Exemple d’outil façonné sur côte à section pleine du niveau II d’Isturitz (d’après Lefebvre, 1994, p. 101).
- 62 -
• Les supports « type lissoir d’angle », produits par « détachement longitudinal d’une large partie de la face inférieure […] par un rainurage bilatéral convergent, dont la rainure principale remonte obliquement vers la partie distale » (Averbouh et Buisson, 2003, p.319), sont réservés à la fabrication de certains lissoirs d’angle, à laquelle ils s’adaptent : «ce procédé renforce l’aspect déjeté et angulaire de la partie active tout en lui donnant son épaisseur fonctionnelle » (Averbouh et Buisson, 2003, p. 319). Ce type de support débité constitue donc un critère discriminant des lissoirs d’angle, même s’il est peu représenté dans le matériel d’Isturitz, car il a été identifié ailleurs (La Vache) et n’est pas connu sur d’autres types d’objets. Il semblerait alors qu’il existe deux sortes de lissoirs d’angle : ceux qui sont conçu dès le départ comme des lissoirs d’angle par ce type de débitage et ceux qui présentent des techniques de fabrication, des dimensions et une morphologie similaires aux autres lissoirs (communs notamment), dont ils se distinguent uniquement par les stigmates d’utilisation (orientation du front de lissoir impliquant un geste différent en particulier).
Différents « degrés » de façonnage de la face inférieure : Le façonnage de la face inférieure est particulièrement important sur les lissoirs d’Isturitz car la suppression totale du tissu spongieux est pratiquée sur la majorité d’entre eux (20/36 lissoirs), alors qu’elle est très rare sur les autres outils « mousses ». De nombreuses autres pièces montrent une régularisation dégressive de ce tissu (13/46 outils), qui constitue le façonnage élémentaire caractéristique des outils « mousses », quelque soit leur type. Les autres « degrés » de façonnage (régularisation constante et absence de façonnage) sont rarement mis en oeuvre. Ainsi, le façonnage d’approche de la face inférieure montre certaines variations, mais correspond essentiellement à deux pratiques différentes : un façonnage particulièrement poussé, généralement associé aux lissoirs, ou élémentaire, pour les différents types d’outil.
L’épaisseur : Les outils « mousses » sans front de lissoir apparaissent dans l’ensemble comme des outils plus épais que les lissoirs car ils mesurent généralement entre 6 et 9 millimètres d’épaisseur, alors que la majorité des lissoirs se situe entre 1,5 et 4 millimètres (28/36 lissoirs). Cependant, l’existence d’outils « mousses » plus fins (2,5 et 4 millimètres) et de lissoirs d’angle épais (jusqu’à 9 millimètres) ne permet pas de distinguer les différents types d’outils par ce critère. Toutefois, une épaisseur supérieure à 6 mm augmentera les présomptions en faveur d’un outil « mousse » sans front de lissoir, à l’exception des lissoirs sur supports « type lissoir d’angle ». Ces différences d’épaisseur pourraient expliquer la faible représentation des outils « mousses » sans front de lissoir sur côte puisque d’autres matériaux (bois de cervidé notamment) sembleraient plus adaptés à la fabrication d’outils relativement épais.
Les aménagements particuliers : Enfin, les aménagements proximaux semblent exceptionnels, il s’agit de la réalisation d’une perforation sur deux lissoirs et du façonnage de la partie proximale sur un autre. Les deux lissoirs perforés sont de dimensions réduites (52 et 76 millimètres de long), ce qui les distingue de la majorité des outils. Cette corrélation entre la réalisation d’une perforation et de très petites dimensions, également remarquée à La Vache (Averbouh et Buisson, 2003, p. 316), constitue un caractère nécessaire aux objets de parure, alors qu’elle semble peu fonctionnelle pour des lissoirs et irait plutôt en faveur de l’hypothèse d’ « outils-parures » ou de lissoirs réaménagés en pendeloques. D’autre part, l’existence d’une spatule présentant un front de lissoir témoigne de la parenté fonctionnelle entre ces deux types d’outils, dont la différence réside essentiellement dans la morphologie particulière de la partie proximale.
Ainsi, les outils « mousses » d’Isturitz présentent une variabilité technique relativement importante, par comparaison des techniques de fabrications des lissoirs avec celles de La Vache, qui ne permettent d’identifier des supports fragmentaires que dans des cas précis.
- 63 -
B. Les spatules : stigmates d’utilisation
La plupart des spatules sont fragmentaires et ne peuvent donc être identifiées que par leur partie proximale, toutefois quelques exemplaires entiers donnent des indications sur la fonction de cet outil. Parmi les quatre spatules entières des corpus étudiés, trois possèdent un front de lissoirs oblique par rapport à l’axe longitudinal de la pièce, alors que la quatrième arbore un front de lissoir perpendiculaire par rapport à cet axe, qui tend à rapprocher ces outils des lissoirs d’angle et des lissoirs communs.
- 64 -
5.1.3. Les limites de l’identification thématique
A. Les représentations « à tendance figurative »
Des décors indéterminés, dont le traitement dénote une « tendance figurative » par la gravure de lignes courbes rappelant certaines lignes cervico-dorsales, de hachures fines et superficielles, qui ne sont pas sans évoquer les représentations du pelage des animaux…, n’ont pas pu être classées ici, posant le problème de la limite de la reconnaissance des thèmes figurés.
Figure 60 : Les représentations « à tendance figurative » du Magdalénien moyen d’Isturitz.
Figure 61 : Représentation indéterminée de Laugerie-Basse (n°84, face interne).
- 65 -
Figure 62 : Représentations indéterminées de La Madeleine (pièces n° 140 et 139).
B. Détermination spécifique des pattes
La détermination spécifique des représentations réduites à la patte de l’animal est délicate, cependant le caractère fendu ou non du sabot constitue un élément discriminant entre les bovidés et les chevaux. La présence ou l’absence de la figuration de la fente du sabot semble indiquer des représentations de différentes espèces parmi le type des pattes verticales (fig. 63).
Figure 63 : Représentations de pattes d’espèce différente.
- 66 -
5.1.4. Tableaux comparatifs des sites étudiés
Magdalénien supérieur de La Vache/Magdalénien moyen d’Isturitz :
points communs différences
Thématique thèmes principaux = incisions parallèles, bison et cheval
domination moins marquée des bisons et chevaux
segmentation préférentielle (Bison/tête, Cheval/entier, Bouquetin/tête)
association d'animaux par espèce quelques associations d'animaux d'espèce différente
Situation position sur face interne des supports à section pleine
quasi-absence de représentations sur face inférieure
une seule pièce présente un aménagement sur les bords
prépondérance des représentations couvrantes rareté des registres longitudinaux
proportion comparable de suites figuratives
Décor typés registres d’incisions parallèles registres d’incisions parallèles sur une pendeloque uniquement
absence d'autres décors typés Relations support/décor
différences peu caractéristiques lissoirs/supports « bruts »
Magdalénien de Laugerie-Basse/Magdalénien moyen d’Isturitz :
points communs différences Thématique domination des incisions parallèles rareté des figurations
autres signes importants (lignes sinueuses, quadrillages, points)
proportion plus importante de quadrillages
association incisions parallèles/lignes sinueuses
Situation préférence pour face interne des supports à section pleine
importance des représentations sur la face inférieure
proportion moins importante de représentations sur la face inférieure
relation thème/position importance des registres longitudinaux registres longitudinaux plus fréquents
lien registres/incisions parallèles et lignes sinueuses
absence de corrélation registres/position
Décors typés importance des registres d’incisions parallèles quadrillages en registres
Incisions parallèles encadrant une ligne sinueuse
tête de bison verticale patte verticale découpé
Relations support/décor majorité des décors typés sur les lissoirs
présence exceptionnelle de décors typés sur d'autres supports
lien registres/lissoirs/lames d'os
individualisation des parties proximales de spatules
- 67 -
5.2. Illustrations supplémentaires
5.2.1. Les incisions latérales
Figure 64 : Les supports à incisions latérales : un lissoir (n° 18), un outil indéterminé (n° 40), une lame de côte (n° 65) et un fragment particulier (n°69) .
- 68 -
5.2.2. Les décors typés
A. Quadrillages en registres
Figure 65 : Les représentations de quadrillages en registres de Laugerie-Basse.
Figure 66 : Pendeloque de Laugerie-Haute (d’après Taborin, 2004).
- 69 -
B. Incisions parallèles encadrant un motif sinueux
Figure 67 : Exemples de lames d’os indéterminées portant des incisions parallèles encadrant un motif sinueux, Magdalénien moyen d’Isturitz (face inférieure).
Figure 68 : Incisions parallèles encadrant une ligne sinueuse composée de courtes hachures sur des pièces d’Isturitz, de Gazel et du Mas d’Azil (d’après Sacchi, 1990).
- 70 -
Figure 69 : Carte de répartition des pièces présentant des incisions parallèles encadrant une ligne sinueuse composée de courtes hachures.
- 71 -
5.3. Lexique
« Abréviation » : « Procédé » de réduction des représentations renvoyant à deux pratiques différentes : « la réduction d’une figure à un (ou plusieurs) caractères essentiels à la détermination et la représentation de segments anatomiques isolés » (Tosello, 2003, p. 20).
Composition : Organisation élaborée des représentations selon une géométrie particulière.
Disposition : Agencement des motifs entre eux sur l’espace graphique.
Façonnage : « En technologie, le façonnage désigne l’action intentionnelle de mettre en forme les supports choisis, quelle que soit la méthode de transformation suivie ». Il « comprend toutes les opérations consistant à modifier la forme du support » et permet de mettre en place les masses, de corriger les contours et d’aménager les « attributs morphologiquement marquants » (Averbouh, 2000, p. 59).
Orientation : Sens des figurations par rapport à l’axe longitudinal de la pièce.
Inscription : Façon dont les représentations sont intégrées au support, selon les thèmes, leur « abréviation », leur association et leur répartition.
Lame de côte : Côte débitée longitudinalement ayant fait l’objet d’un façonnage important de la face inférieure correspondant à la suppression totale du tissu spongieux, pour ne conserver que le tissu compact de l’os.
Lissoir : Outil « mousse » caractérisé par la présence d’un front de lissoir, formant un léger biseau lustré.
Localisation : Situation par rapport aux parties proximale, mésiale et distale des objets, considérés d’un point de vue technologique (Averbouh, 2000, p. 64).
Outils « mousses » : Les outils « mousses » (par opposition aux outils tranchants et perforants) sont « caractérisés par l’absence de tranchant, l’importance du polissage des contours et l’émoussé d’au moins une des extrémités » (Camps-Fabrer, 1966, p. 82).
Pendeloque : Objet de parure façonné.
Plan : Cadrage des figurations sur le support selon l’ « abréviation » et l’occupation de l’espace.
- 72 -
Position : Situation des représentations par rapport aux faces de la pièce.
Répartition : Manière dont les représentations sont placées par rapport à la morphologie du support ; ce terme général est employé pour regrouper différentes échelles d’observation de la situation des décors, soit la position, la localisation, la disposition et l’orientation.
Spatule : Lissoir caractérisé par le façonnage de sa partie proximale, créant un amincissement et/ou un étranglement de l’objet.
Suite : Succession de figures identiques. Les suites comportant au moins trois individus constituent des « files », mais l’état fragmentaire du matériel ne permet pas toujours d’observer plus de deux individus, dont la succession témoigne également d’un concept de répétition par alignement.
Support « brut » : Support caractérisé par l’absence de traces de façonnage et d’utilisation.
- 73 -
5.4. Références bibliographiques
• ALLARD Michel et ROBERT Romain, 2003 – Historique des recherches et fouilles de Romain Robert. In La grotte de La Vache (Ariège), CLOTTES (dir.), La Réunion des Musées Nationaux, Paris, tome 1, p. 29-42.
• ALTEIRAC André et VIALOU Denis, 1984 – La grotte du Mas-d’Azil. In Livret d’excursion A5, Pyrénées, 9ème congrès U.I.S.P.P., Nice, p. 99-102.
• APELLANIZ Juan Maria, 1994 – Analisis de la semejanza y desemejanza entre las obras de un mismo autor y entre las varias autores en la serie de cabezas de bisonte grabadas sobre costillas del nivel II (Magdaleniense IV) de Isturitz. In Homenaje al Dr Joaquin Gonzalez Echegaray, LASCHERAS (dir.), édition du Ministerio de Cultura, Madrid, p. 301-311.
• AVERBOUH Aline, 2000 – Technologie de la matière osseuse travaillée et implications palethnologiques. L’exemple des chaînes d’exploitation du bois de cervidé chez les Magdaléniens des Pyrénées. Thèse de Doctorat, Université de Paris I.
• AVERBOUH Aline et BUISSON Dominique, 1996 – Approche morpho-fonctionnelle des objets nommés « lissoirs » : proposition d’une fiche analytique théorique. Antiquités Nationales, n° 28, p. 41-46.
• AVERBOUH Aline et BUISSON Dominique, 2003 – Les lissoirs. In La grotte de La Vache (Ariège), CLOTTES (dir.), La Réunion des Musées Nationaux, Paris, tome 1, p. 309-324.
• BARANDIARAN Ignacio, 1984 – Utilizacion del espacio y proceso grafico en el arte mueble paleolitico. In Francisco Jorda Oblata, Scripta Praehistorica, Universidad de Salamanca, p. 113-161.
• BARANDIARAN Ignacio, 1996 – Art mobilier cantabrique : styles et techniques. In L’art préhistorique des Pyrénées, Collectif, La Réunion des Musées Nationaux, Paris, p. 88-121.
• BARONE Robert, 1976 – Anatomie comparée des mammifères domestiques. Vigot Frères, Paris, tome 1 : Ostéologie.
• BOUVIER Jean-Marc, 1977 – Un gisement préhistorique : La Madeleine. Edition Pierre Franlac, Périgueux.
• BREUIL Henri, 1936 – Œuvres d’art magdaléniennes de Laugerie-Basse (Dordogne). Actualités scientifiques et industries, 382, Hermann et Cie éditeurs, Paris.
• BUISSON Dominique et FERUGLIO Valérie, 1996 – Les baguettes demi-rondes à volutes. In L’art préhistorique des Pyrénées, Collectif), La Réunion des Musées Nationaux, Paris, p. 220.
• BUISSON Dominique, FRITZ Carole, KANDEL Dominique, PINCON Geneviève, SAUVET Georges et TOSELLO Gilles, 1996 – Analyse formelle des contours découpés de têtes de chevaux : implications archéologiques. In Pyrénées préhistoriques : arts et sociétés, Actes du 118ème congrès des Sociétés Savantes (Pau, 1993), CLOTTES et DELPORTE (dir.), Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, Paris, p. 327-340.
• CAMPS-FABRER Henriette, 1962 – Les pendeloques en os. In Parures des temps préhistoriques en Afrique du Nord, extrait de Libyca, Anthropologie préhistorique, Ethnographie, tome 8, 1960, p. 129-135.
- 74 -
• CAMPS-FABRER Henriette, 1966 – Les outils mousses. In Matière et art mobilier dans la Préhistoire nord-africaine et saharienne, Mémoires du Centre de Recherches Anthropologiques, Préhistoriques et Ethnographiques, éditions Arts et Métiers graphiques, Paris, p. 82-99.
• CAPITAN Louis et PEYRONY Denis, 1928 – La Madeleine : son gisement, ses industries, ses œuvres d’art. Publication de l’Institut d’Anthropologie, n°2, Paris.
• CLOTTES Jean, 1989 – L’art mobilier et l’art pariétal des Pyrénées. In Le temps de la Préhistoire, MOHEN (dir.), 23ème congrès préhistorique de France, Société Préhistorique française, édition Archeologia, tome 2, p. 168-171.
• CLOTTES Jean, 1999 – La vie et l’art des Magdaléniens en Ariège. La Maison des Roches, Paris.
• Collectif, 1996 – L’art préhistorique des Pyrénées. La Réunion des Musées Nationaux, Paris.
• CREMADES Michèle, 1991 – De l’analyse technologique à la signification de l’art mobilier gravé du paléolithique supérieur. Revue d’Archéométrie, 15, p. 5-16.
• DELPORTE Henri, 1980-81 – La collection Saint-Périer et le Paléolithique d’Isturitz : une acquisition prestigieuse. Antiquités Nationales, n° 12-13, p. 20-26.
• DELPORTE Henri et MONS Lucette, 1977 – Principes d’une étude sur les supports osseux de l’art paléolithique mobilier . In Méthodologie appliquée à l’industrie de l’os préhistorique, CAMPS-FABRER H. (dir.), deuxième colloque international sur l’industrie de l’os dans la Préhistoire, abbaye de Sénanque, 1976, Centre National de Recherche Scientifique, Paris, p. 69-76.
• DESDEMAINES-HUGON Christine, 1983 – Les décors non-figuratifs du mobilier osseux des niveaux Magdaléniens IV et V de La Madeleine (Dordogne). Préhistoire Ariégeoise, tome 48, p. 123-203.
• DJINDJIAN François, 2005 – L’art paléolithique dans son système culturel. In Apports théoriques et méthodologiques en archéologie. Applications à la connaissance du Paléolithique supérieur européen. Thèse d’Habilitation, p. 149-179.
• ESPARZA SAN JUAN Xabier, 1990 – El Magdaleniense y el final del Paleolitico superior. In El paleolitico superior de la cueva de Isturitz en la Baja Navarra (Francia), thèse de Doctorat, Université de Madrid, p. 1014-1040.
• ESPARZA SAN JUAN Xabier et MUJKA ALUSTIZA J.A., 1996 – La cueva de Isturitz en el Pireneo occidental. In Pyrénées préhistorique : arts et sociétés, Actes du 118ème congrès des Sociétés Savantes (Pau, 1993), CLOTTES et DELPORTE (dir.), Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, Paris, p. 73-86.
• FRITZ Carole, 1999 – La gravure dans l’art mobilier magdalénien. Contribution de l’analyse microscopique. La Maison des Sciences de l’Homme, Paris.
• JULIEN Michèle, 1982 – Le décor des harpons. In Les harpons magdaléniens, 17ème supplément à Gallia Préhistoire, CNRS, Paris, p. 107-121.
• LEFEBVRE Karine, 1994 – Les lissoirs magdaléniens d’Isturitz, collection Saint-Périer. Mémoire de Maîtrise, Université de Paris I.
• LEROI-GOURHAN André, 1971 – Préhistoire de l’Art Occidental. Mazenod, Paris.
• LEROI-GOURHAN Arlette, 1967 – Pollens et datations de la grotte de La Vache (Ariège). Préhistoire et Spéléologie Ariégeoises, tome 2, p. 115-127.
• LUCAS Claire, 2006 – L’art mobilier magdalénien sur côte de la grotte de La Vache (Ariège) : choix et utilisation des supports. Mémoire de Master 1, Université de Paris 1.
- 75 -
• MAURY Jean, 1925 – Laugerie-Basse. Les fouilles de M. J.-A. Le Bel. Imprimerie Monnoyer, Le Mans.
• MONS Lucette, 1972 – Notes de technologie de l’art paléolithique mobilier. Antiquités Nationales, n°4, p. 14-21.
• MONS Lucette, 1986-87 – Les figurations de bisons dans l’art mobilier de la grotte d’Isturitz (Pyrénées Atlantiques). Les particularismes techniques éclairent-ils les processus créatifs ? Antiquités Nationales, n° 18-19, p. 91-99.
• OMNES Jacques, 1980 – Le gisement préhistorique des Espélugues à Lourdes (Hautes-Pyrénées). Essai d’inventaire des fouilles anciennes. Centre aturien de recherches sous terre, mémoire 1, Tarbes.
• PAILLET Patrick, 1999 – Le bison dans les arts magdaléniens du Périgord. 33ème supplément à Gallia Préhistoire, C.N.R.S., Paris.
• PAILLET Patrick, 2006 – Les arts préhistoriques. Collection Histoire, éditions Ouest-France, Rennes.
• PASSEMARD E., 1922 – La caverne d’Isturitz (Basses Pyrénées), édition Ernest Leroux, Paris.
• PETILLON Jean-Marc, 2004 – Des Magdaléniens en armes. Technologie des armatures de projectiles en bois de cervidé au Magdalénien supérieur de la grotte d’Isturitz (Pyrénées Atlantiques). Thèse de Doctorat, Université de Paris I.
• PETTOELLO Aurélie, 2005 – Les supports « bruts » en matière dure animale : un choix pour l’art gravé ? Définition dans la littérature, étude de matériel. Mémoire de Master 2, Université de Bordeaux I.
• PICOT Charline, 2006 – L’organisation de l’espace graphique dans l’industrie osseuse magdalénienne : étude comparative des pendeloques et objets domestiques du Sud-Ouest français. Mémoire de Master 2, Université de Paris I.
• ROUSSOT Alain, 1982 – Abri des Marseilles à Laugerie-Basse. Gallia Préhistoire, tome 25, fasc. 2, Informations archéologiques, Aquitaine, C.N.R.S., p. 416-417.
• ROUSSOT Alain, 1984 – Abri de Laugerie-Basse. In L’art des cavernes. Atlas des grottes ornées paléolithiques, Ministère de la Culture, Paris, p. 136-137.
• SACCHI Dominique, 1990 – Bases objectives de la chronologie de l’art mobilier paléolithique dans les Pyrénées septentrionales. In L’art des objets au Paléolithique, colloque de Foix-Le Mas d’Azil, CLOTTES (dir.), Ministère de la Culture, Paris, tome 1, p. 13-26.
• SAN JUAN-FOUCHER Cristina, 2005 – Industrie osseuse décorée du Gravettien des Pyrénées. In Homenaje a Jesus Altuna, Munibe, Sociedad de Sciencias, tome 3, p. 95-111.
• SAINT-PERIER René (de), 1930 – La grotte d’Isturitz I : Le Magdalénien de la salle Saint-Martin. Archives de l’I.P.H., mémoire 7, Masson et Cie éditions, Paris.
• SAINT-PERIER René (de), 1936 – La grotte d’Isturitz. II : Le Magdalénien de la grande salle. Archives de l’I.P.H., mémoire 17, Masson et Cie éditions, Paris.
• SAUVET Georges et WLODARCZYK André, 1977 – Essai de sémiologie préhistorique (pour une théorie des premiers signes graphiques de l’homme). Bulletin de la Société préhistorique française, tome 74, fascicule 2, p. 545-558.
• TABORIN Yvette, 1991 – Fiche pendeloque. In Fiches typologiques de l’industrie osseuse
préhistorique, cahier 4 : objets de parure, La Commission de Nomenclature sur l’industrie de l’os préhistorique, Université de Provence, Aix-en-Provence, p. 1-6.
- 76 -
• TABORIN Yvette, 2004 – Langage sans parole. La parure aux temps préhistoriques. La Maison des Roches, Paris.
• TOSELLO Gilles, 2003 – Pierres gravées du Périgord magdalénien. Art, symboles, territoires. 36ème
supplément à Gallia Préhistoire, CNRS éditions.
• TYMULA Sophie, 2002 – Le matériel archéologique. In L’art solutréen du Roc de Sers (Charente), Document d’Archéologie française 91, La Maison des Sciences de l’Homme, Paris, p. 66-125.
- 77 -
5.5. Table des figures
• Figure 1 : Exemples de fragments de baguettes demi-rondes à volutes excisées des niveaux attribués au Magdalénien moyen de la grotte d’Isturitz. ................................... - 6 -
• Figure 2 : Schéma global de la démarche méthodologique. ........................................... - 7 - • Figure 3 : Le contexte archéologique : situation géographique de la grotte d’Isturitz et
schéma de la stratigraphie des niveaux magdaléniens. .................................................. - 9 - • Figure 4 : Exemples de conventions graphiques partagées par des contours découpés de
têtes de chevaux du Magdalénien moyen d’Isturitz et du Mas d’Azil (Ariège). .......... - 10 - • Figure 5 : Support « brut » gravé du Magdalénien moyen d’Isturitz. ........................... - 11 - • Figure 6 : Représentation schématique des trois sous-types de lissoirs définis par A.
Averbouh et D. Buisson : morphologie et direction du front de lissoir. ....................... - 12 - • Figure 7 : Représentation schématique des différences morphologiques entre les deux
« ensembles » de lissoirs d’angle. ................................................................................. - 12 - • Figure 8 : Pendeloque allongée gravée du Magdalénien moyen d’Isturitz. .................. - 13 - • Figure 9 : Outil « mousse » sans front de lissoir du Magdalénien moyen d’Isturitz :
morphologie et stigmates d’utilisation. ......................................................................... - 14 - • Figure 10 : Lissoir perforé et gravé du Magdalénien supérieur de La Vache. .............. - 14 - • Figure 11 : Représentation schématique des différents aménagements proximaux des
spatules : amincissement et étranglement. .................................................................... - 15 - • Figure 12 : Lame de côte gravée du Magdalénien moyen d’Isturitz............................. - 15 - • Figure 13 : Classification fonctionnelle des supports gravés. ....................................... - 16 - • Figure 14 : Répartition des différents types de supports gravés du Magdalénien moyen
d’Isturitz. ....................................................................................................................... - 17 - • Figure 15 : Largeur des supports gravés du Magdalénien moyen d’Isturitz. ................ - 18 - • Figure 16 : Représentation schématique de la section des supports selon leur débitage- 19
- • Figure 17 : Morphologie des supports selon leur façonnage. ....................................... - 19 - • Figure 18 : Les différents paramètres de l’analyse thématique..................................... - 20 - • Figure 19 : Proportions de représentation des thèmes récurrents dans l’art mobilier sur
côte du Magdalénien moyen d’Isturitz.......................................................................... - 21 - • Figure 20 : « Abréviation » proportionnelle des représentations de cheval et de bison.- 22 - • Figure 21 : Les principales associations thématiques récurrentes................................. - 23 - • Figure 22 : Les différentes échelles d’analyse de la répartition des représentations sur le
support. .......................................................................................................................... - 24 - • Figure 23 : Représentation schématique des différents types de disposition. ........................ • Figure 24 : Les dispositions caractéristiques des principaux thèmes............................ - 26 - • Figure 25 : Différence d’orientation entre les têtes de bison et de cheval. ................... - 27 - • Figure 26 : Les décors typés du Magdalénien moyen d’Isturitz. .................................. - 28 - • Figure 27 : Des représentations moins typées : les incisions parallèles centrées.......... - 29 - • Figure 28 : Variabilité des autres représentations. ........................................................ - 30 - • Figure 29 : Diversité de traitement du thème du cheval. .............................................. - 31 - • Figure 30 : Les supports des décors typés à registres d’incisions parallèles................. - 32 - • Figure 31 : Les supports présentant des têtes de bison verticales. ................................ - 33 - • Figure 32 : Les supports des pattes verticales. .............................................................. - 33 -
- 78 -
• Figure 33 : Les décors caractéristiques des lissoirs communs et d’angle. .................... - 34 - • Figure 34 : Les représentations sur supports « bruts ». ................................................. - 35 - • Figure 35 : Les décors des pendeloques........................................................................ - 36 - • Figure 36 : Exemple de décors sur lames de côte. ........................................................ - 36 - • Figure 37 : Comparaison des représentations déformées avec les représentations plus
« réalistes ».................................................................................................................... - 38 - • Figure 38 : Exemples d’individualisation des zones de morphologie particulière par le
décor. ............................................................................................................................. - 39 - • Figure 39 : Les pièces découpées et sculptées. ............................................................. - 40 - • Figure 40 : L’art mobilier sur côte des niveaux attribués au Magdalénien supérieur
d’Isturitz. ....................................................................................................................... - 41 - • Figure 41 : Carte de répartition des sites étudiés par rapport aux différentes « provinces »
envisagées…………………………………….............................................................. - 43 - • Figure 42 : Exemple de représentation de têtes de bison sur support « brut » de La Vache.-
44 - • Figure 43 : Exemples de représentations couvrantes de La Vache. .............................. - 45 - • Figure 44 : Pendeloque à registres d’incisions parallèles de La Vache ........................ - 45 - • Figure 45 : Spatule au poisson de La Vache. ................................................................ - 46 - • Figure 46 : Principales figurations sur côte du Magdalénien de Laugerie-Basse. ........ - 47 - • Figure 47 : Disposition caractéristique des principaux thèmes..................................... - 48 - • Figure 48 : Tête de bison et patte verticales sur lames d’os indéterminée de Laugerie-
Basse.............................................................................................................................. - 49 - • Figure 49 : Les supports déterminés portant des registres d’incisions parallèles. ........ - 50 - • Figure 50 : Les supports des incisions parallèles encadrant un motif sinueux. ............ - 50 - • Figure 51 : Le décor des spatules. ................................................................................. - 51 - • Figure 52 : Exemples de représentations non-figuratives sur supports « bruts ».......... - 51 - • Figure 53 : Représentations de chevaux sur supports « bruts » de La Madeleine. ....... - 53 - • Figure 54 : Les décors similaires à ceux du Magdalénien moyen d’Isturitz................. - 53 - • Figure 55 : Représentations de cervidés sur supports « bruts ». ................................... - 54 - • Figure 56 : Division de l’espace à partir de la perforation............................................ - 54 - • Figure 57 : La morphologie des côtes : côte de cheval vue de profil............................ - 59 - • Figure 58 : Traces effilées remettant en question le caractère intentionnel de certaines
« incisions » interprétée antérieurement comme des tracés indéterminés, Magdalénien de La Madeleine................................................................................................................. - 60 -
• Figure 59 : Exemple d’outil façonné sur côte à section pleine du niveau II d’Isturitz. - 61 - • Figure 60 : Les représentations « à tendance figurative » du Magdalénien moyen d’Isturitz.
....................................................................................................................................... - 64 - • Figure 61 : Représentation indéterminée de Laugerie-Basse........................................ - 64 - • Figure 62 : Représentations indéterminées de La Madeleine. ...................................... - 65 - • Figure 63 : Représentations de pattes d’espèce différente. ........................................... - 65 - • Figure 64 : Les supports à incisions latérales................................................................ - 67 - • Figure 65 : Les représentations de quadrillages en registres de Laugerie-Basse. ......... - 68 - • Figure 66 : Pendeloque de Laugerie-Haute................................................................... - 68 - • Figure 67 : Exemples de lames d’os indéterminées portant des incisions parallèles
encadrant un motif sinueux, Magdalénien moyen d’Isturitz......................................... - 69 - • Figure 68 : Incisions parallèles encadrant une ligne sinueuse composée de courtes
hachures sur des pièces d’Isturitz, de Gazel et du Mas d’Azil...................................... - 69 -
- 79 -
• Figure 69 : Carte de répartition des incisions parallèles encadrant une ligne sinueuse composée de courtes hachures. ..................................................................................... - 70 -





















































































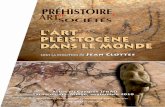









![L'organisation territoriale dans le nord-ouest de la péninsule ibérique (VIIIe-Xe siècle): vocabulaire et interprétations, exemples et suggestions [2009]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631fe5ebfdf36d7df603732f/lorganisation-territoriale-dans-le-nord-ouest-de-la-peninsule-iberique-viiie-xe.jpg)






