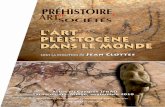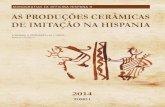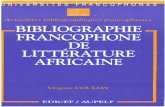1994 - Signes gravés au Sahara en contexte animalier et les débuts de la métallurgie...
Transcript of 1994 - Signes gravés au Sahara en contexte animalier et les débuts de la métallurgie...
SIGNES GRAVES AU SAHARA ENCONTEXTE ANIMALIER ET LES DEBUTS
DE LA METALLURGIE OT]ESGAFRICAINE
Christian DIIPUYLAPMO - I.Jniversité de Provence - CNRS
Réflarné: Des graveurs qui faisaient panie d'une société à fone tradition d'élevage de bovins réalisèrent au sommer d'une monagne deI'Adrar des Iforas (massif sud-saharien situé dans le nord du Mali) des centaines de signes abstraia aux côtés de nombreux animaux maiséglement dbbiets coudés en métal et de chars à timon simple. [a comparaison de ces gravures avec celles relevées dans des régions plusseptentrionales tend à montrer que le quart nord-ouest du continent africain fut sensible à la symbolique des mondes des méaux deI'Occident et de I'Odent méditerranéens du IIe millénaire avant J.-C.
Abstract : Engravers belonging to a society with a srrong tradidon of cattle breeding engraved hundreds of abstract signs, together withrepresentations of animals, bent meal ôbjects and single shaft chariots, at the summit of a mountain of the Adrar des Iforas range in thesouthem Sahara, Northem Mali. The comparison of these engravings with othen found in regions to the nonh indicates that thenorth-westem part of the African continent was affected by the symbolism of meal works ftom the Westem and Easrem mediterraneanareas in the IInd millenium bc.
"Quand, comment, par qui et par où I'Ouest-africain a-t-il connu les métaux ?n. C'est en s'interrogeant ainsi que R.Mauny entreprit en |gs?.son Essar sur I'histoire dsnétmxenAfnqrre occidentale.Répondre à cette question lui fut difficileen raison du faible nombre des données archéologiques êorê-gisnées à Pépoque. Aussi fut-il conduit, au tenne de son essai,à nommer <(sièc[es obscurs> [a tranche de temps avant notreère au cours de laquelle la métallurgie était apparue puiss'était développée dans l'Ouest-africain. Les découvertesarchéologiques se sont depuis multipliées. Les plus récen-tes révèlent une métallurgie du fer à Termit-Egaro(Quéchon 1989) et un travail à chaud du cuivre natif àI'ouest de l'Air sur des sites datés du IIe millénaire avantnotre ère (Paris et al 1992). Bien que près d'un millénaire
plus hautes que celles qui jwque-là situaient I'apparitionde la métallurgie du fer et du cuiwe (r) et, simulmnément,celle des premiers objerc en métal dans le sud du Sahârâ,ces datations élevées du Niger septentrional ne sont pastohlement pour surprendre au regard de signes gravés dansI'Adrar des Iforas (fig. 1) et dans des régions voisines jus-qu'en Afrique du Nord pré-saharienne. Ces signes rnon-trent des affinités troublantes avec ceux de l'art abstrait dela Péninsule ibérique du Chalcolithique et de l'Âge dubronze. Leur présence dans le sud du Sahara conduit às'interroger sur la diffusion rapide de croyances et de coo-cepts nouveaux liés à la divulgation d'une invention tnâ-jeure, la métallurgie, selon des modalités que nous allonschercher à approcher, données iconographiques à I'appui.
t - Situation géographique de I'Adrardes Iforas (d'apÈs Fabrc et al. 1982).
PnÉmsrcrns ArmRopoloctr MÉonennaxÉnxxrs 1994, r. 3, p. 103-124 r03
Srcxrs cnavÉs nu SnHeRA...rr oÉsuts DE LA uÉrnlluRctE oUEST-AFRIcAINE
LE CONTEXTE FIGURATIF DES SIGNES ABS.TRAITS GRAVÉS DANS L'ADRAR DES IFORAS
Il existe au nord-ouest de l'Adrar des Iforas une stationde gïavures s'individualisant des stations alentour (une
cinquantaine réparties dans un rayon de soixante kilomè-tres) par la place importante qu'y tient I'art non frguratif.Les signes abstraits s'y comptent par centaines alors que lenombre de ceux présents sur les stations voisines ne dé-passe pas la dizaine. Issamadanen est le nom que donnentles Touaregs à cette montagne sur laquelle s'exprimèrentnon seulement les auteurs des signes abstraits mais aussid'autres gïaveurs à différentes époques (Dupuy 1991). Seulsles signes abstraits et les représentations d'animaux, d'ob-jets et de personnages leur étant liés sur des parois comIrIU-nes, vont retenir notre attention.
La montagne d'lssamadanen est constituée de plusieurséperons rocheux parallèles orientés nord-sud s'élevant endivers endroits à plus de quarante mètres de hauteur parrapport au niveau de la vallée d'Egharghagh avoisinante(frg. 2). Cette montagne offre deux particularités : elle est,d'une part, la plus imposante du versant nord-occidentalde I'Adrar des Iforas et, d'autre part, sous I'effet des phéno-mènes thermoclastiques, nombre des granitoïdes dont elleest constituée se délitent en bancs de grandes surfaces.Ailleurs, les blocs répartis sur les crêtes sont plus morcelés.
C. Dupuv
Les signes abstraits apparaissent sur dalles horizontales oulégèrement inclinées, aux sommets et sur les mlus deséperons rocheux. Ils consistent en cercles simples parfoisreliés entre eux par un trait, en cercles pointés en leurcentre de piquetages ou d'une cupule ou barrés d'une croix,en cercles entièrement piquetés munis ou non d'un appen-dice rayonnant, en cercles multiples et emboîtés, en cer-cles concentriques desquels partent quelquefois des lignescourbes parallèles, en spirales, en arceaux, en alvéoles, enquelques rubans, serpentins ou lignes ondulées, en ovalessouvent biponctués auxquels il faut ajouter pour être corrr-plet deux croix inscrites à I'intérieur de lignes enveloppesassociées à une croix bouletée. La technique ayant présidéà la réalisation de tous ces signes est le piquetage. Lestracés n'en demeurent pas moins très variés. Certains sontlarges et profonds. Quelques-uns superfrciels et disconti-nus. Les autres sont de tous les intermédiaires. Les signessur dalles horizontales présentent pour [a plupart des pati-nes totales. Ceux sur parois inclinées offrent en règle géné-rale des patines plus claires bien que sans doute d'âgeidentique.
Les relevés exhaustifs que nous avons entrepris permet-tent de comparer les compositions entre elles. De ces colrl-paraisons, il ressort plusieurs motifs récurrents autorisantdes rapprochements et, pour frnir, [a réalisation d'un véri-table puzzle au sein duquel les signes abstraits apparaissentliés à des cupules, à des plages piquetées ou polies sans
2 - La montagne d'lssamadanen barrant en partie la vallée d'Egharghagh.
:ai
*lall|;FFti+
r04 PnÉrnsrornr ANrHRopoLocrn MÉurERReNÉeruNes 1994, t. 3, p. 103-124
C. Dupuy
recherche de profondeur, à de nombreux animaux, plusrarement à des objets coudés et à des chars (frg. 3). Malgtéles srylisations auxquelles sont soumises les représentâ-tions, on reconnaît sans difficulté parmi les animaux, desbovins, des autruches, des girafes du mufle desquelles des-cend parfrois un lien qui aboutit ou non dans la main depersonnages aux silhouettes filiformes, des antilopes va-riées, quelques rhinocéros dont un rhinocéros blanc(Ceratothqium simwn).
Objets coudés, girafes à lien et chars se retrouventgravés sur d'autres stations du nord-ouest de I'Adrar desIforas dans des contextes frguratifs riches en représenta-tions de bovins, d'autruches etde girafes (frg. 4,5 et 6).S'yretrouvent également quelques motifs ovalaires biponctuésintégrés dans des compositions animalières (frg. 7), alorsque ces mêmes motifs, à Issamadanen, sont soit isolés surdes parois soit rassemblés en panoplie et associés à desalvéoles ou encore lies à des spirales, à des cercles concen-triques ou à des animaux (frg. 3). Ces affinités iconographi-ques entre stations ajoutent des pièces supplérnentaires aupuzzle d'lssamadanen. Ainsi compléré, ce puzzle pennet deconclure à l'existence d'un art non frguratif, partie inté-grante d'un art à prédominance animalière. Deux hypo-thèses peuvent alors être avancées pour expliquer [a fortereprésentativité des signes abstraits à Issamadanen et leurtimide présence ailleurs :
- ou bien la montagne d'lssamadanenr pâr son caractèreimposant et la morphologie peu commune des bancs ro-cheux la surmontant, fut investie d'un pouvoir particulierqui motiva la réalisation de signes originaux ;
- ou bien, I'art non frguratif d'lssamadanen marque uneétape transitoire dans l'évolution d'un art animalier bienreprésenté le long des vallées nord-occidentales de I'Adrardes lforas.
Q.r. l'on retienne I'une ou I'autre de ces hypothèses, laforte représentativité des silhouettes gravées de bovins entout lieu, indique que les graveurs faisaient partie d'unesociété qui pratiquait l'élevage. Quand s'exprimèrent-ilsdans I'Adrar des Iforas ? Quand et dans quel contexteréalisèrent-ils les signes absmaits d'lssamadanen ? Leursgravures comparées à celles relevées dans des régions voisi-nes fournissent des éléments de réponse. Ceux'ci condui-sent à s'interroger sur les modalités d'apparition de la mé-tallurgie dans le sud du Sahara et s'avèrent donc d'ungrand intérêt eu égard à la question du "Quand, comment,par eui, par où.. . ?o de R. Mauny.
L'APPARITION DE LA METALLURGIE DANSLE SUD DU SAHARA: UNE INNOVATION
PLUTÔT QU'UNE INVENTION
En raison de leur valeur archéologique, les gïavures
d'ob1e6 coudés de l'Adrar des Iforas méritent un dévelop-pement particulier. Nous en avons relevé soixante douze lelong de cinq vallées successives aux sommem de sept épe-rons rocheux.
PnÉHIsrorRE ANrHRopoLocrE MÉnrrrRRANEENNrs 1994. r. 3. p. 103-121
SlcNEs cRAvÉs lu S*nnl...er oÉBUTs DE LÂ MÉTALLURGTE ouEsr-AFRTcATNE
Ces objets ont en commun les caractères suivants(fre. 8) :
- tous sont munis de lames pointues ;
- toutes les lames se situent à I'extrémité des manches ;
- la plupart leur sont orthogonales, à I'exception de sixpositionnées à 120" et de trois à 70o ;
- le rapport de la longueur des lames sur celle des manchesest sensiblement constanr et en moyenne égal à 9/10,exception faite de trois représentations à lames niangulai-res courtes et larges pour lesquelles ce rapport est égal à 1/2.
Au-delà de ces caractères communs. lames et manchesépousent des profils variés. Les lames sont soit criangulai-res, soit foliacées, ou en segment de cercle ou en croissant.La plupart sont munies d'un crochet. Ce crochet est toumévers le bas des manches et se referme parfois sur ceux-cipour former une boucle. Un seul est toumé vers le haut. EnI'absence de crochet, le bout des manches montre un légerrenflement. Les manches sont droits ou légèrement cour-bes. Deux sont munis d'un appendice annulaire en partieproximale. Les silhouettes frliformes de certains objets té-moignent de stylisations extrêmes rendant délicate I'inter-prétation de la diversité morphologique des lames et desmanches. Cette diversité tient-elle à des approximationsde transcription figurative d'un seul et même type d'objetou reflète-t-elle I'existence d'objets de types variés ? Lesrépartitions spatiales des gravures jouent en faveur de laseconde hypothèse. Comment en effet imaginer qu'un seulet même modèle de lame ait pu donner lieu à une représen-tation en niangle équilatéral sur une paroi et en 6n seg-ment de cercle sur une paroi voisine ? L'établissement d'unprofrl type d'oblet par intégration des divers profrls repré-sentés, on Ie voit, s'avère impossible. La diversité des sil-houettes autorise donc la reconnaissance d'objets qui, bienque de morphologie générale apparentée, épousaient dansla réalité des profrls variés. La silhouette marginale d'unobjet à lame en forme de niangle isocèle omé à deux de sesangles d'un crochet ne dément pas cetre idée (6g. 9). Lerapport de la plus grande longueur de la lame sur celle dumanche proche de 9/10 ainsi que I'orthogonalité lame-manche apparentent cet objet à la famille des objets cou-dés décrite ci-dessus, et ce, malgré la présence d'un troi-sième crochet en partie basse du manche.
La variété des profrls des lames, l'étroitesse de la plupartd'entre elles et surtout la présence de crochets plus oumoins courbes situés à la base des lames ou attenant auxmanches, sont autant d'éléments qui attestent de la naturemétallique des objets coudés gmvés sur les rochers de hau-teur de I'Adrar des lforas. Les graveurs les ayant représen-tés, parfois aux côtés de signes absnaits comme àIssamadanen, connaissaient donc le métal. A quelle épo-que le connurent-ils ?
En l'état des connaissances actuelles sur les arts rupes-tres sahariens et sud-sahariens, il n'y a que les girafes à liende I'Adrar des Iforas (six sur les vingt six sujets que nousayons relevés) qui soient gravées aux côtés d'objets coudés
r05
SIcNrs cnnvÉs au SIHaRA...ET nÉnum DE LA UÉTru-IURGIE OUEST.AFRICAINE C. Dupuv
E()(L
I
c.)
,(!
FT
<)
L.
c.)
cl(t)
tt
èôt-
c
v2vJ
oI
Ia,)5-
r+
èb
o
\o)
(J
c)
c
\1
êôk
ri)
I
c,)
,D
a,).9
'J
K'
e$l
O
uL}
U
c)()ÉoÀÀK'
,Jtt
o()IE
e)U
\n
ùLr
=rid
OJ
\n
"ô
.9,3!
erË. :3â
tâ
c)
a)U
ca
l-\C)(.,
tL
\9
. :,''Çl
ECJ
U
--- Ë
PnÉmsrotRE ANTHRopoLoctE MÉDITERRANÉENNES 1994, t. 3, p. 103-124106
C. Dupuy StcNEs cnnvÉs nu SeHaRA...ET nÉsurs DE LA naÉrauuRcrn ouEsr-AFRTcAINE
(t)
q)(JCÉd
t4 O.Oçv c.)OXaa.)dl<
{.)(! l-.
n'û
Q3îoEU(.) c)U L,'(.) IE*ç ,r-,
UېC)
O.OF .t)
( )9
çO
t- 0.)
cv
.q) .9(! c!
ËYJ<c) c!'=o
çc)
.â;
crPCu)CÉ \A)r<
E0.. 'o9?
EF (r>
âzèo(.) u)Fc)
Irr .y| ' )dqJO
'9E
(,h F
L/ V)
H*
:qr6Eéb,tt) 'â
3u)(! 0.)
: '1]X!rN=
-céa! i( )YI
'; u)
v) t)
qJx
-O /^t
sùtr o.);; ç.,
3 -9,
' . .6e(hC
\O cJ
3oa
u
oo6
I
\0
CE
o
\c)
*
{J
t-
.*
t ,o
((l
v)a)
(t)
tâa.)
U
l--
É.=o
aâ
O
s:l
t--
^^
V.
aL
râ
i)
CJ
în "o
Wt l
;lii\ \
v,,&.\ ) r
{
t07PnÉrusrorRE ANTHRopoLocrE MÉDTTERRANÉENNEs 1994, r. 3, p. 103-124
C. DupuvStcNps cnnvÉs nu SnHeRA...ET pÉsurs DE LA t'lÉruuRctE ouEsr-AFRIcAINE
Nï\l,t {{q
a - Objets coudés : a - Issamadanen ; b - Tirist ; c - Ikasan ; d - Adarmolen.
lm
-t''
l-,*
5-Girafesàl ien:a- lssamadanen(détai ld 'unecomposi t ionplÉsentéesur laf ig.3);b- lnDjoraouen;cetd-Adarmolen'
108 PnÉmsrotRE ANï{RoPOLoclr MÉotrrRRANÉENNEs 1994, r. 3, p. 103-124
C. Dupw Stcxrs cnnvÉs ,ru SernRA...ET pÉnurs DE r-A uÉrelruRcrr ouEsr-AFRIcAINE
PnÉHrsrornr ArgrsRoFot.ocre MÉoreRneNÉwnns I gg4,T. 3, p- lo3-124 109
Srcxrs cnevÉs nu SnneRA...ET pÉsrtrs DE LA uÊret-luRclE ouEsr-AFRIcAtNE C. Dupw
I - I-es divers typcs d'objets coudés repÉsentés dans I'Adrar des lforas.
110
u)r-'lËlFÀe
-râtvf - .FtIt
FJratu
i'(zmU)x
v̂eË.U
Ël
r'lUJ
-r-'tFa
Ur{a\FI
FztrlràvFl
(t)
2u)f-l El
\ | iHI
HA\r'r-Ë
v1 |( l ) I:J1
.É1I
\J]
klt-' I\c) lrr'r Ia') l(t) I0.)1
I
- ln Polr r=lJvlËl- lx l
\ tr i l;)rÊ Ivlzl
* Ë. l.C€I
- ladl
q) irâIa) lu1
h. lFlê1
j
vt
L)' l
T {(
r t r l - ïfr
r
rrrr
Manches épais LAMES NON
PERPENDICT]LAIRESAT]X MANCIIES
PnÉmsrotRr, AtrruRoPoLocrs MÉonrRRexÉexHH 1994, T. 3, p. 103-124
C. Dupuv
9 - Silhouette marginale d'un objet à lame en forme de triangle isocèle orné àdeux de ses angles d'un crochet (hauteur =20 cm).Un troisième crochet est
figuré en partie basse du manche (Tikokaten).
à lames pointues, longues et étroites dont trois sont munies
à leur base d'un crochet (frg. 10). Les rares personnagesassociés sur des parois communes aux girafes à lien que I'onretrouve gravées sur les rochers de régions plus orientaleset plus septentrionales, lorsqu'ils sont armés, portent des
SrcNes cnevÉs eu SeHaRA...ET nÉsurs DE LA naÉrru-luRclE oUEST-AFRICAINE
objets coudés dépourvus de crochet et de fait identifra-bles à de simples crosses ou bâtons de jet (Dupuy 1987,p. 130). Ces éléments donnent à penser que les repré-sentations de certaines girafes à lien dans I'Adrar desIforas datent de I'acquisition des premiers objets enmétal chez les pasteurs de bovins à I'origine de leurréalisation. Le comparatisme inter-régional appliqué àd'autres motifs fournit des indications chronologiquesplus précises.
Sur les soixante douze objets coudés de I'Adrar desIforas, douze ont des lames triangulaires semblables àcelles des hallebardes représentées dans le Haut Atlasmarocain (Malhomme 1959-1961, Chenorkian 19BB)et à celle de la hallebarde gravée dans I'Ahaggar sur lastation de Tin Suok (Camps &, Maître 1964,p. 374) quidemeure à ce jour I'unique exemplaire connu du Saharacentral (frg. 11). Les aurres objets coudés de I'Adrar desIforas, c'est-à-dire la majorité, ont des lames aux profilsdissymétriques, courbes ou sinueux, diftrents de ceuxrectilignes des hallebardes. Des points communs néan-moins existent entre ces deux familles d'objets ; ilstiennent aux longueurs équilibrées des lames et desmanches et à la présence de crocherc ou de renflementsen partie distale des manches. Les objets coudés deI'Adrar des Iforas représentent-ils alors des hallebardes ?Certains peut-être, les autres probablement pâs, pourles raisons suivantes.
Tandis que les graveurs du Haut Atlas rendirentsouvent compte des nervures des lames et de leurfixation par rivetage sur les manches, ceux de l'Adrardes Iforas ne tracèrent pas le moindre trait pour signalerla présence de nervures ou seulement pour signifierI'existence d'obiem en deux parties, avec d'un côté lalame, de I'autre le manche, la lame ayant pu être renduesol idaire du manche par r ivetage ou bien par
emmanchement à soie, ou à collier, ou à spatule et surliure.Cette absence de raccordement peut être interprétée dedeux façons différentes : ou bien il s'agit d'une simpleabstraction frgurative, ou lames et manches étaient d'unseul tenant. A s'en tenir à cette demière hypothèse, les
10 - Objets coudés associés à des girafes à lien (lssamadanen). Voir aussi la fig. 3 et la fig. 4a.
PRÉHIsrolRE ArvrHRopolocrE MÉDnERRANÉÊNNx 1994, r. 3, p. 103-124 r l l
SrcNgs cnevÉs nu SnHnRA...ET oÉsurs DE LA uÉreuuRctE ouEsI-AFRICATNE
objets coudés de I'Adrar des Iforas représenteraient nonpas des hallebardes aux lames de cuivre ou de bronze mouléfrxées orthogonalement à I'extrémité de manches, mais descouteaux de jet obtenus par forgeage à chaud d'une loupede fer ou d'un morceau d'acier tels qu'il s'en fabriquaitencore autour du lac Tchad vers les années 50 (ûg. IZ).L'abondance des minerais de fer dans [e sud du Sahara et larareté de ceux de cuivre et d'étain, la grande variété des
,9-l*'*ta
(ii ..-ô"'J,fI
ItI)
II
t
C. Dupuv
formes pouvant être obtenues par forgeage à chaud (2) dufer ou de I'acier et le caractère standard des objets encuivre ou en bronze moulés dès lors qu'ils atteignent lataille d'une hallebarde, sont autant d'éléments opposés quijouent en faveur de I'identifrcation à des couteaux de jet.
Doit-on alors envisager I'existence par le passé de deuxrégions aux marges du Sahara, d'un côté le Haut Atlas, d.l'autre I'Adrar des lforas, au sein desquelles auraient cir-
l l -Hal lebardes:a-HautAtlasma.rocain(d'apÈsMalhomme1959-1961);b-Ahaggar(hauteur=30cm;relevédeG.Camps,inédit).
t t2
12 - Couteau dejet exposé au Musée des Missions africaines de Lyon. Origine probable : bassin du lac Tchad.
PnÉHtsrotne AvrnRopoLocrE MÉorsRnnNÉEr.rNas 1994, T. 3, p. 103-124
C. Dupuy
culé des objerc coudés de formes semblables par le simplejeu des convergences ? On pourrait souscrire à cette idée siles hallebardes gravées dans [e Haut-Atlas marocain (])
tout comme celle gravée dans I'Ahag garet n'apparaissaientaux côtés de signes abstraits ou à proximité de stationsriches en signes abstraits -cercles simples souvent pointésen leur centre d'une cupule, cercles multiples et emboîtés,cercles barrés d'une croix, cercles concentriques, spirales,l ignes ondulées, alvéoles, f f iéandres, ovales, croixbouletées- qui sont autant de motifs que ['on rerrouveincisés sur des rochers du Sud-marocain et de Mauritaniejusque dans I'Adrar des Iforas, à Issamadanen, à côté préci-sément des objets coudés aux silhouettes proches de cellesdes hallebardes représentées plus au nord. Ajoutons que lessignes relevés dans les régions allant du littoral atlantiquejusqu'à l'Adrar des Iforas apparaissent dans des contextesfiguratifs riches en bovins, souvent sur des dalles horizor-t-tales de hauteur et à proximité de chars dételés à timonsimple comme à Issamadanen (s). La distribution de cessignes en relais iconographiques entre I'Afrique du Nordpré-saharienne et le sud du Sahara ne doit vraisemblable-ment rien au hasard. Leur répartition engage à f idée d'unediffusion de croyances ou de concepts nouveaux à traversle Sahara, à un moment où y circulaient les premiers objetsen métal. Cette circulation put motiver des imitations etentraîner la naissance de métallurgies locales. Les débutsde la métallurgie du fer au Niger septentrional (Quéchon1989) pourraient avoir été ainsi influencés de I'extérieur ;les fondeurs à Termit-Egaro innovant toutefois en la ma-tière en plaçant dans leurs fours le minerai local le plusabondant, à savoir le minerai de fer. A se tenir à cettehypothèse qui fait la part belle au diffusionnisrrr€, les objetscoudés de I'Adrar des Iforas aux lames triangulaires pour-raient représenter des hallebardes d'importation tandis queles autres en auraient été des imitations en fer, des sortes decouteaux de jet obtenus par forgeage à chaud de loupes defer ou d'acier (0) qui étaient produites dans le sud du Sa-hara. .. Ce sont là autant de suppositions méritant plusamples démonstrations.
UN ART RUPESTE ANIMALIER À STCNESABSTRAITS, OBJETS EN trlÉrnl- ET CHARS À
TIMON SIMPLE, DATABLE DU IIT MILLÉNAIREAVANT NOTRE ÈNT
Les signes de formes élémentaires dont il vient d'êtrequestion montrent des affrnités avec ceux du répertoireabstrait de I'art rupestre ibérique du Chalcolithique et del'Âge du bronze dont cercles, spirales, lignes ondulées etcruciformes constituent les motifs de base (Abelanet1986). Mais tandis que les signes du Sahara atlantique etméridional apparaissent dans des contextes animaliers ri-ches en bovins, ceux de la Péninsule ibérique sont I'es-sence même d'un art non figuratif damble de la deuxièmemoitié du IIIe millénaire et du IIe millénaire avant notreère. Tout le problème est de savoir si la réalisation de ces
PnÉutsrotnE ArurHRopolocre MÉurnnneNÉEr.rNes 1994, r. 3, p. 103-124
Srcxrs cn,cuÉs eu S.lgenl...sr oÉBUTs DE LA MÉTA[uRcrE ouEsr-AFRTcATNE
signes dans les régions les plus occidentales des continentseuropéen et africain releva ou non d'un même horizon et siIeur apparition en Afrique, au même titre qu'en Europeatlantique, fut liee à la divulgation de la métallurgie. Plu-sieurs données engagent à répondre par I'affirmative.
Les découvertes de céramiques campaniformes et d'ar-mes en cuivre ou en bronze Ie long et à proximité des côtesnord-africaines (Camps 1961, 1992 ; Souville 1992),laprésence d'ivoire d'éléphant et de coquilles d'æufs d'autru-che sur des sites de la civilisation argarique du sud deI'Espagne (Hanison 1986, p. 139), attestent d'un négoce àI'aube et au début du IIe millénaire avant notre ère entre leMatoc, l'Algérie occidentale et la Péninsule ibérique. Ceséchanges se doublaient d'une diffusion de courants de pen-sée qui n'allèrent pas sans influencer les rites religieux etles pratiques funéraires comme en témoignent les sépultu-res en ciste de part et d'autre du Détroit de Gilbraltar(Camps 196I,1992), et les découvertes le long de la façadeatlantique, du Maroc au Ponugal, de statuettes en pierrede forme triangulaire (Boube 1983) ainsi que de monoli-thes portant des décors incisés à base de lignes ondulées etd'arc de cercles (Souville 1973). L'intérieur des terres futtouché par ce jeu des relations mutuelles nord'sud/sud-nord puisque, comme le monre R. Chenorkian (1988),
deux des crois types de hallebardes figurés dans Ie HautAtlas marocain (sans compter les poignards et pointesfoliacées à languette gravés à leurs côtés) repésentent lesprototypes d'armes qui étaient produites dans la Péninsuleibérique durant le IIe millénaire avant notre ère. Le troi-sième type caractérisé par un rapport lame/manche pluséquilibré et sans équivalence dans la péninsule ibériquepourrait être, selon R. Chenorkian, d'origine autochtone.Cette observation constitue un indice supplémentaire enfaveur de I'existence d'un Âge du cuivre et du bronze auMaroc soutenue par G. Camps depuis 1960. Dans un telcontexte, il est permis de penser que les signes abstraitsassociés aux hallebardes du Haut Atlas et plus largementceux répartis sur le quart nord-ouest du continent africainservirent de supports à I'expression de croyances nouvellesliées à la divulgation de la métallurgie comme ils le 6rentparallèlement côté européen tout le long de la façade at-lantique. Vers quelle époque ces croyances affectèrent-elles le sud du Sahara ? Cette question est importante car sile cadre chronologique délimité par les gravures de I'Adrardes Iforas devait inclure les datations hautes du Nigerseptentrional relatives aux débuts de la métallurgie, alorsl'hypothèse diffi.rsionniste avancée plus haut en sortiraitrenforcée.
Deux gravures de chars dételés à timon simple et rouesà rayons sont présentes sur une dalle à Issamadanen auxcôtés de signes à base de cercles que I'on peut désormaisconsidérer à affinités atlantiques (6g. 3). Deux chars d'untype semblable se retrouvent intégrés, le long d'une valléevoisine, dans une composition animalière. Cette composi-tion est située en contrebas d'une dalle incisée d'une spi-rale développée en entrelacs (fig. 13). Une spirale de mêmetype est ébauchée un kilomètre en amont sur une dalle
r 13
C. DupuvSIcNes cnevÉs nu SnHeRA...ET nÉgurS DE LA NAÉIEU-URGIE OUEST-AFRICAINE
13 - Spirale développée en entrelacs en surplomb d'une composition animalière montrant deux chars dételés à timon simple. Un troisième char' vu de
pro6l, apparaît dans la partie basse de la composition (Asenkafa).
entourée de nombreuses gravures de bovins. Quatre spira-
les développées en enffelacs de manière semblable ont été
relevées au Sahara central (Blais e 1956; Kunz I974,l9BZ ;Lhote 1953, 1985). Alors que deux sont gravées sur ro-
chers de plein air, les deux autres sont peintes au plafond
d'abris sous-roche du Tassili-n-Ajjer. Un motif à entrelacs
similaire à ceux soudés aux spirales du Sahara central et de
l'Adrar des Iforas est gïavé plus au nord dans I'Atlas sud-
oranais d'Algérie sur la station de Brézina (Roubet 1967).
Parmi ces signes de forme complexe, celui peint au Tassili
sous l'auvent de \Teiresen va retenir plus particulièrement
notre attention ; il est associé à des rubans ondulés et à des
l14
chars affelés qui constituent autant de motifs que I'on
rerrouve gravés en champlevé sur trois stèles funéraires des
tombes à fosse du cercle A de Mycènes datant du XVIe
siècle avant notre ère. Ces stèles montrent des chars atte-
lés à des chevaux entourés de rubans ondulés et de spirales
liées. Les analogies se jouent par conséquent à deux ni-
veaux : à un niveau non frguratif avec les signes en rubans
et en spirales développés et à un niveau figuratif avec les
attelages. Certes, les attelages peints sous l 'auvent de
\Teiresen ne sont pas les répliques de ceux gravés sur les
stèles mycéniennes. Outre les conventions distinctes âuX-
quelles sont soumises leurs représentations respectives, les
PnÉrnsrolnn Ax-mRoPoloclr MÉolrmnnnNÉrNxx 1994, T. 3, p. 103-124
C. Dupuv
conceptions ayant présidé à leur réalisation sont, ellesaussi, diftrentes. Pour ne prendre que I'exemple de laplateforme, celle des chars mycéniens est posée en équili-bre sur I'essieu alors que celle des chars sahariens est placéeen avant de I'essieu et lui est attenante par sa partie arrière,Du fait de ces différences, plusieurs auteurs ont écartéI'hypothèse d'interférences culturelles entre I'Egée et leSahara. Celles-ci me semblent pourtant mériter considéra-tion au vu des faits suivants.
Les Crétois étaient en relations suivies avec I'Egypte duMoyen Empire (Vercoutter 1956). Ces relations perdure-ront, peut-être même se renforceront, durant la périodedes Rois hyksos (Janosi 1992). Deux facteurs naturels yaidaient : vents étésiens et courants marins de Méditerra-née orientale qui poussaient et portaient les navires deI'Egée vers les côtes de Cyrénaique (Kemp et aL 1980,p.270). Aussi ces côtes devaient-elles être familières auxCrétois ; ils dirigeaient vers elles sans difficulté leurs navi-res qui, de là, pouvaient gagner par cabotage les contréesafricaines voisines, à I'est, le Delta du Nil, mais peut-êtreaussi parfois, à I'ouest, le Maghreb oriental, comme don-nent à le penser les affinités qui s'établissent enre lesdécors intérieurs de sépultures en falaise de Tunisie et ceuxintégrés à I'architecture palatiale égéenne de l'Âge duBronze, bien que, dans ce demier cas, un cheminementplus complexe par les îles et péninsules du bassin occiden-ml de la Méditerranée soit aussi envisageable (Camps 1987,p.54-55).
A partir du XVIe siècle, un basculement s'opère enEgée. La Royauté mycénienne s'affirme... Au XVe siècle,Ies Mycéniens triomphent des Crétois. Simultanément,Thoutmosis III ordonne la réalisation du réseau "des forre-resses de la mer" pour prévenir toute menace à I'ouest duDelta. Deux siècles plus tard, Ramsès II fait prolonger cesystème défensif sur près de 300 kilomèrres en direcrion dudésert libyque. A la frn du XIIIe siècle survient dans cetterégion, sinon en effervescence du moins guère souriantedepuis plusieurs générations à l'égard des Egyptiens duNouvel Empire, une première bataille que Merenptah rem-porte face à une coalition de Libyens et "d'habitants despays de la mer" transcription mieux connue sous celle,approximative, de "Peuples de la mer" (Grandet 1990). AI'issue des comba6, douze paires de chevaux appartenant àla tribu des Ribou de Cyrénaique commandée par un cheflibyen dénommé Meryozy sont ramenées le long de laVallée du Nil. Une génération s'écoule... Puis la menace ànouveau se précise. Deux coalitions successives liant Li-byens et pirates de Méditerranée affrontent I'armée deRamsès III en I'an 5 puis en I'an 11 de son règne. Lescombats consacrent à deux reprises le miomphe de Pha-raon. A I'issue de la deuxième bataille, outre de nombreu-ses épées d'origine mycénienne, une centaine de charsattelés à des chevaux sont pris comme butin de guerre. Duhaut de I'un d'eux avait combattu Mésher, 6ls du roi vaincude la tribu libyenne des Mashoucsh qui nomadisait à I'ouestde la Cyrénaique.
PnÉHrsrornE ANrHRopoLocrE MÉDTTERRANÉENNES 1994, r. 3, p. 103-124
Sloltrs cuvÉs lu SeHene...st nÉBUTs DE LA MÉTAUURGIE ouEsr-AFRIcÂtNE
Ces événements, tout demièrement relatés dans le dé-tail par P. Grandet (1993), sont importants pour notrepropos. Ils témoignent d'abord de rapports cordiaux entreLibyens et Egéens dont les menaces à I'ouest de la Valléedu Nil se firent pressantes à partir du XVe siècle avantnotre ère. Mais ils révèlent aussi des Libyens mieux organi-sés sur le plan politique qu'il n'y paraît en première lecturedes chroniques égyptiennes. Ceux-ci, en effer, étaient diri-gés par des chefs suffisamment puissants et inlluenrs pournouer alliance avec des peuples belliqueux de Méditena-née et les liguer contre les Egyptiens du Nouvel Empire. Lanature guerrière des coalitions devait moriver la fabrica-tion de chars tant en Cyrénaique qu'à Mycènes et qu'enEgypte où Ia présence de chevaux et de chars légers est sanséquivoque à partir du XVIe siècle av. J.-C. (Braunstein-Silvestre 1982, p. 39). Aussi, divers prototlpes purent-ilsêtre réalisés quasi simultanément dans ces rrois régions dèsle XVIe siècle avant notre ère pour servir au prestige d'aris-tocraties et, au premier che( à leurs dirigeanrs. Une foisconçus et adaptés par les nibus de Cyrénaique qui étaientpréparées à recevoir une telle innovation, ces engins rou-lants, attelés à des chevaux et conduits par des guerrierslibyens animés d'un esprit de conquête ou d'une volontéde domination, pénétrèrent au Sahara où ils furent repré-sentés en peinture aux plafonds d'abris sous-roche, parfoisaux côtés de signes complexes apparentés à ceux du réper'toire mycénien, parce que vraisemblablement réalisés versle milieu du IIe millénaire avant notre ère par des artistespeintres qui étaient sensibles aux décors à base de spiralesdéveloppées prisés de longue date par les Egéens et encoreprisés par eux lorsque furent érigées, au-dessus des tombes àfosse de Mycènes, des stèles représentant pour la premièrefois en Péloponnèse des guerriers sur des chars.
Si des peintres du Tassili central furent sensibles à cesdécors d'inspiration égéenne, des graveurs du Sahara et deI'Afrique du Nord pré-saharienne (7), le firrent également.Cependant aucune des spirales à entrelacs qu'ils réalisè-rent, à la différence de celles peintes sous les auvents duTassili central, n'apparaît à côté de chevaux, seulementparfois aux côtés de bovins et de chars dételés comme dansI'Adrar des lforas. Par leur complexité, I'homogénéité deleur forme et leur rareté, celles-ci supposent un phéno-mène rapide de diffirsion et, en conséquence, une proxi-mité chronologique entre art gravé et art peint de l'époquedes premières représentations de chars rendant énigmati-que I'absence du cheval en gravure ; absence sur laquellenous allons revenir. Notons au préalable que la récentedécouverte en Mauritanie d'une gravure de char dételé auxcôtés de piquetages en méandre sous un muret d'un villagedu dhar Oualata appuie plutôt bien notre hypothèse dechronologie haute en ce qui conceme les plus anciennesreprésentations gravées de char du Sahara méridional. Unedatation sur céramique contemporaine du village a donnécomme àge : 7740 + 160 BP (Ly 3334), soit aprèscalibration 1348-479 av. J.-C (Amblard &. Ould Khattar,1993).La probabilité pour que la réalisation de la gravurede char. antérieure à la construction du muret la recou-
115
Srcnes cnevÉs eu SaneRA...rr nÉsurs DE LA uÉrruuRclE ouEsr-AFRIcAINE
vrant remonte au IIe millénaire plutôt qu'au premier mil-lénaire avant notre ère, I'emporte si I'on tient compte dufait que les plus anciennes dates relatives à I'occupationdes villages en pierres sèches du Dhar Tichitt voisin serangent dans la première moitié du IIe millénaire et queces villages atteindront leur développement maximum àl'aube du Ier millénaire avant notre ère (Munson 1968,re7 r).
Les deux détours que nous venons d'effectuer, le pre-mier par la Péninsule ibérique via le Haut Atlas marocainen partant des signes de formes élémentaires présents àIssamadanen, le second par ['Egée via le Sahara central dufait de la présence de spirales développées en entrelacs auxcôtés de chars à timon simple dans le nord-ou€st de I'Adrardes lforas, nous ont projetés dans le IIe millénaire avantnotre ère. Ces cheminements distincts conduisant à ladélimitation d'un même cadre chronologique augmententsingulièrement la probabilité pour que I'art rupestre sryliséde I'Adrar des Iforas à prédominance animalière et à signesabstraits, date du IIe millénaire avant notre ère. Un telcadre chronologique intègre les dates hautes relatives auxdébuts de la métallurgie du fer à Termit-Egaro. Il en dé-coule une mise en relation possible de cette métallurgiesud-saharienne, en dépit de son caractère original indénia-ble, avec les mondes des métaux de ltOrient et de I'Occi-dent méditerranéens. Mais, il est vrai que nous avons envi-sagé à deux repr ises des di f fusions et évolut ionsiconographiques rapides à travers le Sahara et qu'à envisa-ger une évolution lente des arts rupestres saharien et sud-saharien sous I'effet de conservatismes locaux ou de I'exis-tence de mondes clos (qu'aucune des données qui précè-dent, du reste, ne vient étayer), I'idée de fondre les mine-rais de fer à Termit-Egaro pourrait ne rien devoir à desinfluences extérieures. Il importe donc de présenter leséléments tirés d'autres champs de recherche que I'art ru-pestre, à même d'appuyer la reconnaissance de processus
llrt"nnistes rapides et conjugués sur de longues distan-
LA MOBILITE DES GROUPESp'ÉTEVEURS DE BOVINS
Les aires de représentation des signes et des motifs,
objets des réflexions qui précèdent, surprennent par leur
étendue. Leur vaste répartition géographique suppose ou
une communauté de traditions et de croyances chez des
groupes ayant occupé de vastes territoires ou s'étant dé-
ployés sur de vastes espaces ou bien une mobilité plus
grande de la part de groupes moins nombreux gui, chemin
faisant, exprimaient par la gravure certaines de leurs pré-
occupations. Plusieurs données jouent en faveur de la se-
conde hypothèse. En premier lieu, les contextes frguratifs
riches en bovins au sein desquels apparaissent ces signes et
ces motifs, laissent supposer que leurs auteurs étaient por-
tés sur l'élevage. Or, il est aujourd'hui acquis que le Sahara
méridional entra dans une phase d'aridifrcation rapide à
I t6
C. Dupuv
l'aube ou au début du IIe millénaire avant notre ère (Maley
1981 ; Petit-Maire & Riser 1983 ; Servant 1983). A partirde cette époque, les groupes d'éleveurs de bovins durent,en conséquence, étendre leur aire de nomadisation ou enchanger et vraisemblablement pratiquer, au gré des ryth-mes saisonniers, la transhumance en direction de valléesoù I'effet d'impluvium palliait mieux qu'en régions de plai-nes aux conséquences néfastes d'une baisse de la pluviositésur la formation des pâturages.
Dans l'Adrar des lforas, les gravures d'objets coudés auxprofils apparentés à ceux de hallebardes protohistoriquesgravées plus au nord et à leur côté les signes à aftnitésatlantiques pourraient témoigner des déplacements degloupes d'éleveurs selon une direction générale nord-ouest/sud-est. Par ai[eurs, la présence de chars aux côtés despirales développées en entrelacs pourrait rendre compted'une autre altemative en réponse à la détérioration duclimat : la pratique de la transhumance en direction desmassifs centraux sahariens occupés depuis peu par unepopulation d'origine septentrionale possédant des chars etdes chevaux. Les gravures de girafes à lien que I'on re-trouve incisées sur des rochers du Sahara cenral et méri-dional, pourraient témoigner, quant à elles, du flux etreflux de groupes d'éleveurs qui représentèrent, dansI'Adrar des Iforas, leurs premiers objets coudés en métal,objets qu'ils s'étaient procurés soit dans le nord, soit dansle sud du Sahara, soit dans l'une et l'autre de ces régions.Ainsi, la mobilité de groupes de pasteurs qui avaient pourmadition d'exprimer par la gravure certaines de leurs pré-occupations sur les rochers des régions qu'ils parcouraient,foumit une explication aux troublantes similitudes quis'établissent entre des gravures rupestres parfois éloignéesde plus d'un millier de kilomètres. Aujourd'hui encore, lapratique du nomadisme pastoral conduit des groupes d'ho-rizons culturels différents à se rencontrer et à communi-quer. Les naditions et les croyances des uns ne sont pasalors sans influencer celles des autres, les biens valorisésdes uns non sans attirer la convoitise des autres. Tant et sibien que des idées, des concepts, des objets, des armes,s'acquièrent, circulent, se transmettent rapidement sur delongues distances (8). L'exemple actuel des Peuls wodaabe,pasteurs nomades et éleveurs de bovins d'Afrique deI'Ouest permet de se faire une idée des ordres de grandeursmis en jeu dans ces déplacements. Scindés en petits grou-pes, les Peuls wodaabe des savanes humides de Centrafri-que et du Nord-Camerounais suivent leurs bovins sur desdistances dépassant certaines années les cinq cents kilomè-tres (Boutrais 1988, p. 48). ConÊonté à des situationsécologiques défavorables répétées, un groupe peut ainsiparcourir six mille kilomètres en douze ans, soit, pourprendre une image, le continent africain dans sa plusgrande largeur...
A I'aube ou au début du deuxième millénaire avantnotre ère, I'apparition de la métallurgie puis sa divulgationvers I'intérieur des terres africaines ne durent pas aller sansinfluencer les manières de penser des gtoupes de pasteursnomades dès lors qu'ils en découvrirent I'existence. Fasci-
PRÉHrsrorRE Avmnopolcrcre MÉDTERRANÉENNx 1994, r. 3, v. lO3-124
C. Dupuy
nés, subjugués par les changements specraculaires de lamatière sous I'action du feu et de la chaleur, ceux-ci enri-chirent leur répertoire iconographique jusque-là animalierpour I'essentiel, de signes abstraits en relation avec I'uni-vers magique des métaux, et c€, en des lieux suspendusentre ciel et terre comme à Issamadanen dans I'Adrar desIforas.
L'absence des silhouettes gravées de femmes esr unautre élément en faveur de I'hyporhèse de la prarique d'unnomadisme pastoral durant le IIe millénaire avant notreère. En effet, chez les groupes de pasteurs nomades, ce sontles hommes qui guident le bétail vers les points d'eau et lesbons pâturages et, simultanément, le protègenr des dangersde la brousse ; responsabilités dont les femmes sonr déchar-gées parce que souvent moins mobiles du fait de leur devoirde matemité (Dupire 1960). Aussi esr-ce par les hommeset non par les femmes que se transmettent les recettesmagiques de fertilité du bétail, les croyances sur la faunesauvage... qui sont autant de préoccupations masculinestoumées vers un monde extérieur aux campements. Enadmettant que des pasteurs nomades et éleveurs de bovinsfurent les auteurs des signes abstraits de l'Adrar des lforaset des régions voisines, on s'explique mieux le caractèreanimalier de leur art et, du même coup, l'absence en toutlieu des silhouerres gravées de femmes.
A partir du milieu du IIe millénaire avanr norre ère,certains pasteurs virent évoluer à I'occasion de la transhu-mance eui, en saison sèche, les amenait le long des vallées
Slcxrs cnnvÉs eu SnHnRA...ET nÉsurs DE LA uÉrer-luRcrE ouEST-AFRTcATNE
des massifs cenrraux sahariens, des engins défrant I'imagi-nation : des chars attelés à des chevaux. L'élémenr roulantdes attelages, le char, retint surtout leur attention. Par lasomme considérable des savoirs et savoir-faire à la foisrévolutionnaires et inaccessibles à beaucoup que sous-tên-dait leur réalisation, ces chars du Sahara central exercè-rent une fascination telle dans I'esprit des éleveurs debovins qui en découvraient I'existence durant [e IIe mi[[é-naire avant notre ère que ceux-ci en intégrèrent les repré-sentations souvent approximatives et parfois fantaisistes(fig. L4) dans leur répertoire iconographique. Qu'à cerreépoque, ces pasteurs qui étaient nomades aient possédé deschars est diffrcile à concevoir. Commenr en effet imaginerque des artisans peu ou prou spécialisés aient pu non pasconstruire mais seulement entretenir une charrerie au seinde groupes à forte mobili É I A supposer que de tels arrisansaient existé et qu'ils aient été sédenraires er indépendanmdes groupes nomades qui évoluaient autour d'eux, on peurse demander au profit de qui ceux-ci auraient construitsdes chars ; I'art rupestre de I'Adrar des lforas datable du IIemillénaire avant notre ère ne témoignant d'aucune srratifi-cation sociale . La mode allait au port d'objem coudés. Lesrares personnages qui brandissent ces objets, épousent surles rochers des silhouettes miniatures de dimension infé-rieure ou égale à celle des obje6 portés (frg. L5). Aussi cespersonnages doivent-ils plus être vus sous l'angle de por-teurs d'ob;em sacralisés dont les vocations étaient cérémo-niellesr peut-être sacrifi.cielles, que comme ayant éré eux-mêmes obiet de sacralisation.
9cq" 1\
a, l -r--l-;t
*f @w*\.-r-Y$(
/t
I/t/
/
I,II
I\Ql ï\ l
qr)
ryl4 - Chars associés par paire, placés I'un devant t'autre (le personnage fortement sexué est d'âge plus écent - Imeden). Un <<train> d'au moins huitchars a été relevé par J. Meunié et Ch. Allain (1956, p. 63) dans I'extrême sud-est marocain. R. Vemet (1993, p. 137) mentionne la pÉsence d'un
<<convoi> de trois chars en bordure de I'Adrar mauritanien sur la station d'El Rhallaouiva.
PnÉmsrorns Abr-rHRopot-ocre MÉonsRRnNÉENNrs 1994, T. 3, p. 103-lz4 n7
StctrEs cnlvÉs eu SnxaRA...ET pÉgurs DE LA uÉrau-uRctE ouEsr-AFRtcAINE
15-Porteursd'objetscoudésdel 'Adrardeslforasassociésàdesbovinsetàdesobjetscoudésisolés:aetb-lssamadanen;c-InTahæen.
La pratique du nomadisme pastoral permet en outred'expliquer I'absence des représentations gravées de che-vaux aux côtés des premières gravures de chars à timonsimple. Elever des chevaux en zone tropicale est délicat. Ala différence du taurin (race de bovins sans bosse, de petitetaille, encore élevée aujourd'hui au Sahel et qui fut la racesurtout représentée par les graveurs), le cheval est trèsvulnérable aux parasites et aux trypanosomes qui prolifè-rent durant la saison des pluies de mousson. C'est vraisem-blablement pour limiter les risques d'épizooties que lesMarbas, agriculteurs sédentaires vivant au sud du lacTchad, enferment leurs chevaux, pendant les rrois moisque dure la saison des pluies, dans des écuries intégrées àI'habitat (Seignobos et aL 1987, p. 49-53). Cet aménage-ment particulier de I'habitat tend à montrer que le chevalne peut s'accommoder d'une vie itinérante à longueurd'année en région tropicale. Le fait qu'aucun des groupesnomades peuls wodaabe évoluant aujourd'hui dans l'Ouest-africain n'élève de chevaux à I'inverse des groupes peulssédentaires, abonde dans ce sens. Par la construction desabris qu'il nécessite et les soins réguliers dont il a besoin, lecheval est source fréquente d'immobilité. Elever cet ani-mal constitue donc un frein à la pratique du nomadismepastoral. Compte tenu de ces observations, on peut suppo-ser que les pasteurs nomades à tradition de gravure rupestregui, il y a plus de trois mille ans, suivaient leurs bovins surla frange méridionale du Sahara n'adoptèrent ni ne repré-sentèrent, dans I'Adrar des Iforas et dans les régions voisi-nes, de chevaux parce que ces animaux remettaient encause la pratique ancestrale du nomadisme pastoral et, parvoie de conséquence, le fonctionnement même de leur
r 18
C. Dupuv
société. Et ce, d'autant qu'à cette époque, le biotope dansI'Adrar des lforas et ses environs était encore relativementhumide comme en témoigne à Issamadanen la silhouettegravée d'un rhinocéros blanc dont la patte arrière est tan-gente à un cercle pointé (fig. 3).
Des espèces de la faune soudanienne représentées àIssamadanen aux côtés des signes abstraits, c'est en effet lerhinocéros blanc qui est de loin le plus exigeant en nourri-ture et en eau. C'est un herbivore strict qui tond I'herbe dela savane et qui ne s'éloigne jamais beaucoup des pointsd'eau. Il parcourt tout au plus 10 kilomètres par jour. Onpeut donc déduire qu'à l'époque de sa représentation àIssamadanen, des plans d'eaux permanents existaient lelong de la vallée d'Egharghagh. Cette déduction s'accordeavec les données paléoenvironnementales obtenues surI'erg lne Sakane situé une centaine de kilomètres à I'ouest/nord-ouest de I'Adrar des Iforas où sur un des gisementspréhistoriques distribués sur cet erg, daté de 4 100 à3400 BP, C. Guérin et M. Faure (1983,p.741 ) ont ident i-fré des ossements de bovidés aussi inféodés à ['eau que I'estle rhinocéros blanc, à savoir du buffle (Syncerus caffer), del'élan de Derby (Tawrotragus derbyanru) et du guib hama-ché (Tragelaphru scn Ptw).
Tandis que I'Adrar des Iforas devait recevoir durant lasaison des pluies de mousson les 400 à 500 mm d'eaunécessaires au maintien d'un réseau de mares pérennes eten conséquence à la survie du rhinocéros blanc, plus aunord, en altitude, à I'abri des trypanosomes du fait destempératures basses d'hiver létales pour les glossines, deschevaux (mais également des bovins, des chèvres et des
PnÉrusrornr AmrRopolocrE MÉnnrnnaNÉExNrs 1994, r. 3, p. 103-124
I
?/
o
C. Dupuv
moutons) étaient élevés par un groupe qui possédait deschars que des peincres se plaisaient à représenter aux pla-fonds d'abris sous-roche. La fidélité des transcriptions esttelle que J. Spruytte (1986), après avoir construit, gran-deur nature, divers types de chars d'après des représenta-tions peintes du Tassili-n-Ajjer, a pu démontrer I'exis-tence d'un mode d'attelage à "barre de traction" originalau Sahara central et son efficacité pour le dressage deschevaux à l'attelage. A reprendre I'argumentation déve-loppée ci-dessus, on peut penser à la suite de G. Camps(L993), gue ce groupe était en position sociale dominantemais aussi qu'il était sédentaire ou semi-sédentaire, nonpas nomade comme l'étaient les groupes d'éleveurs de bo-vins peu ou pas hiérarchisés qui évoluaient plus au sud. Desartisans devaient waisemblablement travailler au servicede cette classe aristocratique, parrni lesquels des charronsdévolus à la fabrication, à I'entretien et au renouvellementd'une charrerie.
LA CONFIRMATION D'UNE CHRONOLOGIE
Aux discrètes silhouettes des porteurs d'objets coudésvont succéder sur les rochers de I'Adrar des lforas, cellesplus imposantes et plus nombreuses d'hommes souventfortement sexués, habillés, parés et armés d'une lance dans
SlcNrs cnnvÉs nu SaHeRA...ET oÉsurs DE LA uÉrru-luRcrr ouEsr-AFRIcATNE
un art qui garde son caractère animalier (frg. 16). Certainsdes signes abstraits d'lssamadanen sont recouverts par cesgravures de porteurs de lance. Ces superpositions donnentà penser que I'image de I'homme armé de sa lance futreprésentée sur les rochers de I'Adrar des Iforas alorsqu'étai t déjà refermée la parenrhèse non f igurat ived'lssamadanen. C'est aux côtés de ces représentationS rrou-velles de porteurs de lance qu'apparaissent les premièressilhouettes de chevaux dans l'Adrar des lforas mais égale-ment plus à l'est dans I'Air. Dans cene demière région,quelques chars sont figurés attelés à des chevaux er con-duits par des porteurs de lance (Roset I97 I, 1993) alorsque le char qu'il nous a été donné de découvrir dansI'Adrar des Iforas aux côtés de porreurs de lance et dechevaux, est dételé (Dupuy 1994). Mais cene différenceimporte peu. Car l'élément socio-culturel le plus signifrca-tif me semble tenir non pas à la frguration d'attelages quel'on peut certes désormais lier à leur présence effectivedans le sud du Sahara, mais à l'apparition concomittantedu cheval et du port de lance. A reprendre le raisonne-ment ci-dessus, cette association marque un toumant ; ellesanctionne selon toute vraisemblance I'abandon progressifd'un mode d'économie ancestral, le nomadisme pastoral,au profit d'un pastoralisme à vocation guenière croissanteet simultanément moins sujet à mobilité, rendant par làmême possible l'élevage du cheval et I'acquisition d'une
ù*'1't t
-r\ \ -\-./\\-*
I
/ - - ' . . . . . . .0I
\
-\--\\..-__________ -- -
\I
l6 - Porteurs de lance associés à des bovins et à des girafes (Adarmolen) à comparer avec les porteun d'objets coudés de la fig. I 5.
PnÉrusrotne ArnrRopoI-ocrE MÉDTTERRANÉENNas I 994. r. 3. p. I 03- I 24 I I 9
Stcxns cnlvÉs AU SAHARA. ..ET DÉstm oe Lr rvrÉTALLURcIE ouEsr-AFRlcÀtNE
charrerie. Les données archéologiques enregistrées cesvingt demières années dans le sud du Sahara et au Sahelpermettent de saisir les raisons sus-jacentes à cette évolu-tion et simultanément d'en fixer le cadre chronologique.Ce cadre, comme nous allons le voir, se raccorde à celuiélaboré plus-haut à partir de l'étude des signes abstraits eten valide ainsi en retour I'antiquité supposée.
J.-P. Roset (1988) a découvert au nord de I'Air, sur lesite d'lwelen, trois pointes de lance en cuivre dans ungisement archéologique daté du ler millénaire avant nocreère. Les arnatures mises au jour sont identiques à celles deslances qui sont représentées sur des rochers avoisinantsdans des contextes animaliers riches en bovins. Ces lancessont tenues par des personnages du style des porteurs delance de l'Adrat des Iforas mais aussi du sryle de ceuxrelevés plus à I'est dans le Tibesti, au Borkou et en Ennedidans des contextes frguratifs semblables en de nombreuxpoints à ceux de I'Air (Dupuy 1993). On est ainsi conduità penser que le port de la lance se généralisa chez desgroupes d'éleveurs de bovins qui évoluaient dans le sud duSahara durant le premier millénaire avant notre ère. Ladétérioration du climat qui s'était amorcée à I'aube du Ilemillénaire, culminera sous ces latitudes autour des débutsde l'ère chrétienne (Maley 1992). Elle est sans nul doute lacause principale des faits suivants révélés par I'archéologie.
Les recherches menées par M. Raimbault et O. Dutour(1990) dans le Sahara malien d'abord, puis sur le site deKobadi, plus méridional, mettent en évidence un repliprogressifdes populations sahariennes confrontées à la dé-térioration du biotope à I'Holocène récent. Les villages enpierres sèches du Dhar Tichitt et du Dhar Oualata quiavaient atteint leur développement maximum à I'aube dupremier millénaire avant notre ère, se fortifrent puis sontabandonnés aux alentours du IVe siècle avant notre èrepar suite, semble-t-il, d'un épuisement des ressources eneau. Simultanément, et sensiblement sous la même lati-tude, la boucle du Niger est colonisée (Mc Intosh &. McIntosh 1980). Il en naîtra au début de l'ère chrétienne lapremière civilisation proto-urbaine de I'Ouest-africain.
Quelques siècles auparavant, avaient été construits desdizaines de greniers dans une grotte de hauteur de la falaisede Bandiagara toute proche (Bedaux 1972).L'aridité fut àtel point marquée dans la région du Haut-Sénégal qu'elleentraîna I'abandon d'un village protohistorique de hauteurqui s'était déployé sur un vaste espace durant le premiermillénaire avant notre ère (Dupuy &. Riser 1994). Cesdonnées, bien qu'éparses, sous'tendent un resserrement dupeuplement dans le sud du Sahara et, par endroit, la nais-sance d'une insécurité à une époque où le développementde la métallurgie, grande consommatrice de bois, dût accé-lérer la désertifrcation de certaines régions.
Or, qu'advient-il du nomadisme pastoral lorsque le bio-tope se dégrade et le peuplement se resserre I Un constatd'ordre général vient en réponse à cette question : plusforte est la densité du peuplement dans une région donnée,plus difficile est I'exercice du nomadisme pastoral. Le fait
120
C. Dupuv
qu'à partir du premier millénaire avant notre ère des pas-teurs de bovins se soient représentés sur les rochers armésd'une lance à large arrnature dont l'aptitude à percer et àfaire couler le sang est avérée, tend à démontrer qu'à partirde cette époque, des litiges territoriaux firrent résolus , àt-mes à la main. La lance était I'arme qui dissuadait I'adver-saire de s'opposer. Imposant ainsi leur autorité sur les airesde nomadisation qu'ils voulaient sauvegarder, les descen-dants des pasteurs de bovin à tradition de gïavure rupestredu IIe millénaire avant notre ère firrent progïessivementamenés à représenter sur les rochers des régions de plus enplus perçues par eux comme leur territoire, les imagesviriles de porteurs de lance, waisemblablement leurs sil-houettes magnifiées avec parfois à leurs côtés des chars,engins fortement valorisés, et celles d'animaux prestigieuxau rang desquels finit par figurer le cheval. Un cheval élevépar eux et probablement abrité des pluies de moussondevenues plus sporadiques, au sein de campements à I'ar-chitecture désormais en partie conçue pour accueillir cenouveau compagnon de voyage (Dupuy 1994). Peut-être€st-c€ aussi de cette époque que date I'apparition dans lesud du Sahara des premières sociétés de castes, compor-tant, entre autres, des castes d'artisans qui satisfaisaientaux besoins de plus en plus exigeants et spécifiques d'unpastorat désormais dirigé et contrôlé par des pasteurs guer-riers ? Ceci put avoir pour corollaire une scission idéologi-que : les concepts religieux lies à la production et au travaildu métal devinrent exclusifs aux métallurgistes et forge-rons tandis que les pasteurs guerriers les délaissèrent, aban-donnant par là même leur répertoire iconographique àbase de signes abstraits au profi.t d'un art en quelque sortelaïcisé dans lequel primauté fut donnée aux représenta-tions de porteurs de lance et à celles d'animaux et d'enginsrecouvrant aux yeux de la société nouvelle les caractèresdès lors les plus prestigieux.
Cet art rupestre ne s'exprimait plus dans I'Adrar desIforas lorsque s'installèrent dans la régioo, aux alentoursdu Ve siècle de notre ère, des groupes d'aristocrates berbè-res, éleveurs de chevaux et de dromadaires et ancêtres desTouaregs (Dupuy 1992,p. lls-LZZ).
SUR QUELQUES CROYANCES ET COUTUMESDES PEUPLES DE LA BOUCLE DU NIGER
"Dans la cosmogonie Dogon, le forgeron est assimilé àun génie qui se brise les membres aux articulations lorsqu'ildescend brutalement sur terre avec une arche contenantdes techniques, des graines ou semences, des ancêtres hu-mains ou animaux (voir ovales biponctués des frg. 3 etfrg.7).Des croyances analogues existent chez les Bamba-ras, voisins des Dogons. Les uns et les autres croient no-tamment en Faro, divinité suprême responsable de I'orga-nisation du monde et également maître des métaux. LesBambaras matérialisent cette divinité par un couvre-chefde vannerie à huit spires, dont I'usage était autrefois ré-servé aux rois (voir spirale de la frg. 3 liée à un ovale
PnÉmsrotnr Ax'mRopolocle MÉorrrnRnruÉrNNes 1994, r. 3, p. 103-124
C. Dupuv
biponctué). Le cuivre représente le son du Faro. C'estpourquoi les Bambaras portent aux oreilles des boucles decuivre rouge spiralées pour que s'y enroule la divinité. LeFaro des Bambaras, de même que le dieu d'eau des Dogons,est aussi représenté avec un torse humain et une queue depoisson (voir ovale biponctué sous tendu d'une oqueue depoisson" et [ié à des alvéoles sur la frg.3). Ajoutons enfrnque pour les Dogons, les rayons solaires cuivrés sont leschemins de I'eau. C'est pourquoi on ne les voit que partemps de brume chaude ou par temps orageux, lorsqu'iIstraversent les nuages ; on les appelle eau de cuiwe. Mais ilsne se transforrnent en cuiwe qu'au fond de la terre, tropprofondément pour que les hommes puissent le voir. Unemontagne du territoire des Dogons, particulièrement richeen minerai de cuiwe, est appelée le ffrontt-€au de ctiwe.C'est là que les âmes des morts sont supposées se rendrepour faire leur provision de cuivre, c'est-à-dire d'eau, avantd'entreprendre leur grand voyage vers le pays des morts.>>(extraits tirés du Dcnonnaire des Symbole.s de J. Chevalieret A. Gheerbrandt L98Z).
Ces difrrents éléments de la cosmogonie dogon erbambara ayant trait à l'univers du métal sont troublan$ auregard de certains moti fs gravés sur la montagned'lssamadanen, d'autant que cette demière n'est situéequ'à quelques huit cents kilomètres au nord/nord-ouest dumont-eau de cuiwe des Dogons. Ajoutons que des Peulssédentaires organisés en une société hiérarchisée viventaux côtés des agriculteurs dogons et bambaras. Les famillesnobles sont les propriétaires d'un gïand nombre des bovinsprésents dans la boucle du Niger et à la fois les dépositairesdes connaissances pastorales et initiatiques (Hampaté Bâ&. Dieterlen 1961, p. 10).En leur sein se comptaient lesguerriers dont la lance, transmise de père en fils, étaitI'arme de prédilection (Vieillard, cahier n" 44 er frg. 17).
Cette liste sommaire de croyances et de coutumes rap-portées par les ethnologues, loin d'être exhaustive, foumitun faisceau d'indices qui, au terme de cette étude, devien-nent autant de signes éclairants sur I'histoire ancienned'une région sud-saharienne où le métal er la magie destransforrnations liées à sa producrion, pénétrèrent le mondedu pastorat au cours du IIe millénaire avant notre ère,comme donnent à le penser les signes abstraits réunis àIssamadanen aux côtés de nombreux bovins mais égale-ment d'objets coudés en métal et de chars à timon simple.
AIVNETG
Coordonnées géographiques des différentes stations degravures rupestres auxquelles il est fait référence dans leslégendes des frgures t
Adarmolen
Asenkafa
Ibdakan
Ikasan
Imazaoue[et
r9"49',N - 1008' E
20"^07'N - 1008'E
1B'43'N- 1014'E
7c-04'N - 1005' E
20"21'N - 1" lz 'E
SlcNss cnevÉs eu SnHeRA...ET oÉnurs DE LA uÉrru-luRcrE ouEsr-AFRTcATNE
lm
0,5
l7 - Personnages traités dans des dimensions différentes et tenantmême lance (Ibdakan).
la
Imeden
In Djoaouen
In Tahaten
Issamadanen
Tikokaten
Tirist
20" 13'N - 1"04' E
20'05'N - 1008'E
7.0" 10' N - 0"59' E
19"56',N - 1007' E
20"19'N - 1007'E
20"23'N - 1"09',E
BIBLIOGRAPHIE
Abelanet 1986, ABELANET J., Signes scns paroles, cent, sièclesd'artrupestre enEwope occiàenule, Paris, Hacherre, 1986, 345 p.
Almagro-Basch 1944, ALMAGRO-BASCH M., El arreprehistorico del Sahara espanol, Ampurias, Barcelona, 4, 1944, p.773.284.
Almagro-Basch 1946, ALMAGRO-BASCH M., Prehistoria delNoræ de Africa ) del Salwra esparwl, Barcelona, Institut desEtudes Africaines, 1946, 302 p.
Amblard 1993, AMBLARD S., Les gravures rupestres du Hodhseptentrional (Mauritanie sud-orientale), in : L'arte e l'ambienædel Sohora preisnico : daA e inærpretnioni, Milano, Società Imlianadi Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Narurale, 1993,p. 41-51. (Memorie)
Amblard & Ould Khattar 1993, AMBLARD S., OULDKHATTAR M., Nouveaux chars rupestres sur le Dhar Oualam(Mauritanie sud-orientale), Dossiers et recherches sur l'Afnque,Meu.don, 1, 1993, p. 143-155.
Amblard & Vernet 1984, AMBLARD S., VERNET R., Desgravures rupestres intégrées à une structure d'habimt : I'exempled'Akreijit (R. I. Mauritanie ), Journal de lo Société des Afncanistes,54, 1, 1984, p. 67 -78.
Bedaux 1972, BEDAUX R.M.A., Tellem, reconnaissance ar-chéologique d'une culture de I'Ouest africain au Moyen-Age :recherches architecturales, Journal de la Société des Africonistes,42, 1972, p. 103-185.
121PnÉHtsrornr AvruRopolocre MÉorrERRnNÉENNEs 1994, r. 3, p. 103-124
Stcxss cR vÉs AU SÂHARA...ET DÉBtm DE LA MÉTALLURcIE ouEsr-AFRIcATNE
Blaise 1956, BLAISEJ., Peintures et gravures rupestres dans leSerkout et lânahef (Ahaggar oriental), Lib1ca,4, 1956, p. 125-r34.Blandin et aI. 1992, BLANDIN 4., BITON M., CELIS G. etal., "Fer noir' d'Afùqe del'Ouest, Salon de Provence, Imprim, B.Amigon,, 1992,239 p.
Boube 1983, BOUBE J., Une idole néolithique à Chellah, BuI-ledn d'Archéologle marocaire,15, 1983-1984, p. 125-130.
Boutrais 1988, BOUTRAIS J., Des Peuls en sanarlcs humides.Développernent pawral dans I'Ouest centîdfricain, Paris, Orstom,1988, 383 p.BTAUNSIEiN.SiIVCSITC 1982, BRAUNSTEIN.SILVESTRE F.,Coup d'oeil sur le cheval et le char dans I'Egypte du NouvelEmpire, in : I-es clwrs préhistoriqæs du Sahara. Arcleologie er æch-nQue d'atælage, CAMPS G., GAST M. Ed., Aix-en-Provence,LAPMO - Université de Provence, 1982, p.35-44.
Camps 1960, CAMPS G., Les traces d'un âge du bronze enAfrique du Nord, Revw aficaine, 104, 1960, p.3l-55.
Camps 1 96 1, CAMPS G., Aux oigilvs de Ia Bcrbéie. Monumenuet riæs funéraires protohistori4æs, Paris, Arts et Métiers graphi-ques, 1961,628 p.
Camps 1987, CAMPS G., Protohistoire de I'Afrique du Nord.Question de terminologie et de chronologie, Reppal, Twis, 3,1987,p.43.70.
Camps 1992, CAMPS G., Bronze (Age du), in': EnclclopédieBerbère, II, CAMPS G. Ed., Aix-en.Provence, Edisud, 1992,p. 1614-1626.
Camps 1.993, CAMPS G., Chars (art rupestre), in: EncyclopédieBerbère,l2, CAMPS G. Ed., Aix-en-Provence, Edisud, 1993, p.r877.1892.
Camps & Maitre 1964, CAMPS G., MAITREJ.-P., Mission enAhaggar (février-Mars 1964), LibJca, 12, 1964, p. 373.375.
Celis 1991, CELIS G., I*,s fondeies africaines du fer, un grond"méder disparu. Frankfurt, Museum fiir Vôlkerkunde, SamlungAfrica, 199I,225 p.
Chenorkian 1988, CHENORKIAN R., I-es arrnes méwJliEtesdarc I'art protohisbrique de l'Occident nédiænanéen, Marseille,CNRS, 1988, 414 p.
Chevalier & Gheerbrandt L982, CHEVALIER J.,GHEERBRANDT A., Dicaontwire des symboles. Mytlws, ftues,councmes, gestes, fomes , figwes, coulews , rwmbres, Paris, Laffont-Jupiter, 1982, 1060 p.
David &. Huard 1979, DAVID D., HUARD P., Les spirales deI'oued Timissit (confins algéro-libyens\, Bulletin de lo Société pré-historiqtz française,76, L0-12, 1979, p. 454.461.Dupire, 1960, DUPIRE M., Situation de la femme dans unesociété pastorale (Peuls wodaabe, nomades du Niger), in : Femmesd'Afrique noire, PAULME D. Ed., La Haye, Mouton & Co, 1960,p. 5 l -92.Dupuy 1987, DUPUY C., Evolutions stylistique et thématiquedes gravures de trois stations de I'Air méridional (Niger), Tra-uaux du IâPMO, Aix.en-Provence, 1987, p. lZ5-135.
Dupuy 1991, DUPUY C., Les graq)ures îupestres dc l'Adrar desIforas (Mali) dans le curæxæ de l'art saharierL : utle conrribution àl'histoire du peuplement pastora) en Afiquz septentnmab du Néoli-thr4ue à nos jours, Université de Provence, Aix.en.Provence, 2tomes, 1991, Thèse de I'Université, 404 p.
Dupuy 1992, DUPUY C., Trois mille ans d'histoire pastorale auSud du Sahara, Préhistoire et Anthropologie nédiænanéennes, 1,1992, p. 105-126.
t22
C. Dupuv
Dupuy 1994, DUPUY C., Bovins montés et chevaux, puis che-vaux montés dans I'art rupestre de I'Adrar des Iforas (Mali), in :Caualiei dell' Africa : icuwgrafia e simboksmo, Milan, Centro StudiArcheologia Africana, 1994.
Dupuy s.p., DUPUY C., Primauté du masculin dans les artsgravés du Sahara. Nomadisme pasroral er sociétés, in: L'hunmeméditerranéen. Ouurage colleæif en hommage à G. Carnps,CHENORKIAN R. Ed., Aix-en-Provence, Université de Pro.vence, s.p.
Dupuy & Riser 1994, DUPUY C., RISER J., Le site prorohis-torique de Dialaka (Mali) : strari$aphie et climar à I'Holocènet écert, Quatemaire, Montpelker, 199 4.Fabre et al. 1982, FABRE J., et al., Caræ géolagtque de I' Adrar desIfaras au | : 500 000, Bamako, Direction de la Géologie et desMines, 1982.
Feblot-Augustins & Perles 1992, FEBLOT-AUGUSTINS J.,PERLES C., Perspectives ethnoarchéologiques sur les échanges àlongue distance. In : Ethnoarchéologie, jusrification, problèmes,limites, in: Acæs dcsXIIe rencontres inæmotianales d'arclwobgie etd' histoire, Juan-les-Pins, APDCA, 1992, p. 19 5.210.
Grandet 1990, GRANDET P., La migration des Peuples de lamer, L'Hisæire, 132, 1990, p. 16.24.
Grandet 1993, GRANDET P., Ramsès III, Histoire d'un règne,Paris, Pygmalion, 1993, 419 p.
Grébenart 1988, GREBENART D., Izs arigines delamétalurgieen Afrirye Occidmtale, Paris, Nouvelles éditions africaines / Er-rance, 1988, 290 p.
Guérin & Faure 1983, GUERIN C., FAURE M., Mammi{ères,in : Sahara ou Salvl ? Quaæntaire récent du bassin de Taoulenni(Mdli), PETIT-MAIRE N., RISER J. Ed., Marseille, ImprimerieLamy, 1983, p.239-272.
Hampate Ba & Dieterlen 1961, HAMPATE BA 4.,DIETERLEN G.,Kournen, tcxte initiati4nc des pasæws peuls, Paris/ La Haye, Cahiers de I'Homme, 1961,95 p. (Nouvelle série)
Harrison 1986, HARRISON R.J., L'âge du anture. La civilisa-tion du vase canpaniforme, Toulouse, Coll. des Hespérides, 1986,160 p.
Huard 1966, HUARD P., Contribution à l'étude des spirales auSahara central et nigéro-tchadien, Bulledn de Ia Société préhismri-que française,63, 1966, p. 433-464.
Janosi 1992, JANOSI P., Recent excavations of the AustrianArchaeological Institute at the village of 'Ezbet Helmi / Tell el-Qirqafa near Tell el Dab'a, VIe Congresso Internazionale diEgitnlagia, Torino, l, 1992, p. 684.
Kemp et cl. 1980, KEMP 8.J., MERRILLEES R.S., EDEL E.,Mircen Potær1 in Second Millenniun Egypt, Kairo, Deutschesarchâologisches Insritut, 1980, 340 p.
Kunz 1974, KUNZ 1., Neue Sahara-Felsmalereien, AntilætVeh,Feldnæilen, 1974, p. 19.76.
Kunz 1982, KUNZ J., Contribution à l'étude des chars rupestresdu Tassili-n-A1jer occidenral, in : Izs chars préhistarirycs du Sa.hara : ArclÉologie et æchnique d'atælage, CAMPS G., GAST M.Ed., Aix-en-Provence, LAPMO - Université de Provence, 1982,p. 81-88.
Lambert 19?5, LAMBERT N., Mines et métallurgie antiquesdans la région d'Akjoujt, Annales de l'Inscitut mauiwnien dc Re.cherches Scientifiqtæ.s, Nouakchott, 1975, p. 6.24.
Lhote 1953, LHOTE H., Le cheval et le chameau dans lespeintures et gravures rupestres du Sahara, Bullctin de l'Institutfonàamental d'Afriqut noire (B),15, 3, 1953, p. 1138-1228.
PnÉurstornr Arsrunopor-ocrr MÉonrnnexÉexxrs 1994. r. 3. p. 103-124
C. Dupw
Lhote 1957, LHOTE H., Les gravures rupestres d'Aouineght(Sahara occidental). Nouvelle contribution à l'étude des charsrupestres du Sahara, Bulletm de I'Irsritut fondamental d'Afriquercire (B), 19,3-4, 1957, p. 617-658.
Lhote 1964, LHOTE H., Gravures rupestres de Tachoukent etde Tan Zega (Sud-marocain), Libyca., 12, 1964, p. 225'245.
Lhote 19?5-19?6, LHOTE H., Izs graarwes rupestres de I'uudDjuat, Paris, Arts et Métiers graphiques, L975'L9?6, 830 p.(Mémoire du CRAPE)
Lhote 1985, LHOTE H., Spirales et enlrelacs du Sahara, IzSalwrien,92, L985, p. L7-19.
Maley 1981, MALEY J., Etudes palyrwlafuues dans b bassin duTchaÀ et pa)éoclhwmlogie de l'Afrique rcrd nopicale dz 30 0N ansàl'époqe actuelh, Paris, Orstom, 1981, 586 p. (Travaux et Do'cuments)
Maley 1992, MALEY J., Mise en évidence d'une péjorationclimatique entre ca. 2500 et 2000 BP en Afrique tropicale hu-mide, Bnlletin de Ia SociérÉ géologtque de France, 163, 3, 1992,p.363-365.
Malhomme L959-L961, MALHOMME J., Corprs des gravwesrupesnes duGranl,Atlas, Rabat, Service des Antiquités du Maroc,1959-1961,156 p. et 164 p.
Mauny 1952, MAUNY R., Bsai sur l'histoire des métaux enAfrique occidentale, Bulletin de l'Ircriwt fmàanental d'AfiEEnolre (B), 14, Z, 1952, p. 545-595.
Mauny & Hallemans 1957, MAUNY R., HALLEMANS J.,Préhistoire et protohistoire de la région d'Akjoujt (Mauritanie),in : Acæs du 3ème Congrès porcfricain dc Préhistoire, Livingsrme1955, CLARK J.D. Ed., London, Chatto & Vinde41957 ,p. 248-/.ot.
Mc Intosh & Mc Intosh 1980, Mc INTOSH S.K., Mc INTOSHR.J., Prehistoric Investigatioru in the Region of Jenrw, Mali: a satdyin the deuelapnwnt of Urbanism in tlv Sùel. Part.l: Archaeologicalanl Historical Backgrand anÀ tlw excavotions at Jernwlerc. P art 2 :Tlæ RegonoJ Suruey anÀ Conclusioru, Oxford, B.A.R., 1 980, 54 1 p.(Cambridge Monographs in African Archaeology)
Meunié & Allain 1956, MEUNIE J., ALLAIN C., Quelquesgravures et monuments funéraires de I'extrême sud-est marocain,Hesperis, 43,1956, p. 51.81.
Milburn 1972, MILBURN M., Felsbilder und Steinbauten inder ôstlichen Saguia el Hamra, Spanische Sahara, Almogara4 3,1972, p. 19?-206.
Monod 1938, MONOD T., Gratwes, peintwes et irudiptionsrupesûes. Conributiotts à l' étuÀe du Sahora occidental, Paris, Larose,1938, 157 p.
Monod & Cauneille 1951, MONOD T., CAUNEILLE J.,Nouvelles figurations de chars rupestres au Sahara occidental,Bullcdn de l'Institut fonÀmnenwl d'Afriqul rnire (B), 13, 1, 1951,p.181-197.
Munson 1968, MUNSON P.J., Recent archeological researchin the Dhar Tichitt region of South-central Mauritania, WestAfrican archaeolagical Newsletær, 10, 1968, p. 6-13.
Munson 1971, MUNSON P.1., The Tichiu ûadttion : a I-oæprehistoric ocanpation of tlw Sowh-wesæm Sahora, University UrbanaChampaign of lllinois, 1971, PhD Thesis, 393 p.
Paris et al.1992, PARIS F., PERSON 4., QUECHON G.etal.,Les débuts de la méallurgie au Niger septentrional, Jounal de IaSoaété des Africanisæs, 62, 2, 1992, p. 55-68.
Pellicier & Acosta 1972, PELLICIER M., ACOSTA P.,
PnÉmsrorns Avrunopolocre MÉDTTERRANÉENNx 1994. r. 3. p. 103-124
SrcNEs cRAvÉs lu SlHlu,..rr oÉBtm DE LA MÉTALLURGTE ouEsr-^FRIcAINE
Aportaciones al estudio de los grabados rupestres del Saharaespaftol, Toborn, Uniuersidad de Ia Laguna, l, l9?2, p. 4-57.
Petit.Maire & Riser 1983, PETIT-MAIRE N., RISER J. (Ed.),Sahara ou Sahel ? Quaæmaire récmt du Bassin de TanuÀmni (Mali) ,Marseille, Imprimerie Lamy, 1983, 473 p.
Puigaudeau & Senones 1939, PUIGAUDEAU du O., SENO-NES M., Gravures rupestres du Hank (Sahara marocain), Bulletinde la SoeétÉ préhisari4ue française,36, LL, 1939, p. 437-453.
Puigaudeau & Senones 1941a, PUIGAUDEAU du O., SENO-NES M., Gravures rupestres de la montagne d'lcht (Sud-maro-cain), Jountal dz Ia Société des Africanisæs, 1 I , 1941 , p. 147 -156.Puigaudeau &. Senones L94Lb, PUIGAUDEAU duO., SENO-NES M., Gravures rupestres de la vallée moyenne du Draa (Sudmarocain), I ounwl de Ia Société des Aficanisæs, I 1, I 94 1, p. 159 -167.
Puigaudeau & Senones 1953, PUIGAUDEAU du O., SENO-NES M., Gravures rupesres de I'Oued Tamanart (Sud maro-cain), Bullctin de l'Instina forûamenwl d'Afri4te noire (B), 15,1953, p. 1742-126l .
Quéchon 1989, QUECHON G., Le néolithique final et le pas-sage à l'âge des métaux au Niger, Acæs du Colloque de Maghtria,Algéie,s.p. 1989.
Raimbault & Dutour 1990, RAIMBAULT M., DUTOUR O.,Découverte de populations mechtoides dans le Néolithique duSahel malien (gisement lacustre de Kobadi) ; implicationspaléoclimatiques et paléanthropologiques, Comptes Rendus deI'Academie des Sciences, Paris (3),310, 1990, p. 631-638.
Rodrigue 1990, RODRIGUE A., Nouveau foyer rupestre dansle Haut-Atlas marocain, Bulletin du Groupe d' Archeologie et d' An-thropologe de Casablarco,5, mars, 1990, p. 3-10.
Roset 1971, ROSET l.-P., Art rupestre en Aïr, Archeobgia,39,1971, p.24-3r.
Roset 1988, ROSET J.-P., Iwelen, un site archéologique del'époque des chars, dans I'Air septentrional, au Niger, in : Histoiregenérole del'Afrique, Paris, Presses Universitaires de France, 1988,p. l2l-155. (Etudes et documents UNESCO, I I )Roset 1993, ROSET J.-P., Lâ période des chars et les séries degravures ultérieures dans I'Air, au Niger, in: L'arte e I'ambianæ delSalvra preistarico : dati e intnpreazioni, CALEGARI G. Ed',Milano, Museo di Storia Naturale, 1993, p. 431-446 (Memorie26l2)
Roubet 1967, ROUBET F.-E., L'extension septentrionale etméridionale de la zone à gravures rupestres du Sud Oranais (Atlassaharien), in : Actes du 6ènw Congrès Panafricain de Préhistoire,Dakar, 1967, p. 244-266.
Searight & Hourbette 1992, SEARIGHT S., HOURBETTED.,Grauures rupesrres duHaut Atlas (Maroc) ,Casablanca, Belvisi,1992, 103 p.
Seignobos et aI. 1987, SEIGNOBOS C., TOURNEUX H.,HENTIC A. et oI.,b poney duLogoræ, Paris, I.E.M.V.T., 1987,213 p. (Etudes et synthèses)
Servant f 983, SERVANT M., Séquences contineîl.;:;lcs et uario-norc cknati4ues et évolution du bassin du TchaÀ au Cénozotquesupfrew, Paris, Orstom, 1983, 573 p. (Travaux et documents,15e)
Simoneau 1970, SIMONEAU 4., Gravures rupestres inéditesdu Haut-Atlas, in z V alcammica Slmposilm, C apo di P onæ, 197 0,p.369-379.
Souville 1973' SOUVILLE G., Atlas préhistoriquz duMaroc. 1.I-e,Maroc otlaîriqw, Paris, CNRS, 1973,368 p.
t23
StcNEs cnevÉs nu SlHnRA...Er oÉsurs DE LA tuÉret-luRcrE ouEsr-AFRtcAINE
Souville 1992, SOUVILLE G., Campaniforme (céramique), in :Enclcbpédie Berbère, 11, CAMPS G. Ed., Aix-en-Provence,Edisud, 1992, p. I7Z5-I77.8,
Spruytte 1986, SPRUYTTE J., Figurations rupestres saharien-nes de chars à chevaux, recherches expérimenrales sur les véhi-cules à timons multiples, Antrquités afncaines,77, 1986, p.29-55.
Trost L978-1979, TROST F., Die Felsbilder bei Ifregh 1 (Ahag-
gar), Almogaren, 9-I0, 1978-1979, p. 83-105.
Trost 1981, TROST F., Die Felsbildcr des zentralen Ahngar(Algeische Sahora), Graz, Austria, ADEVA, 198I,75I p.
Vercoutter 1956, VERCOUTTER J., L'EgJptE et le monàe égJP-tien préhelléniryc, Le Caire, Institut français d'Archéologie orien-
C. Dupuv
tale, 1956, 472 p. (Bibl iothèque d'Etude , 22)
Vernet 1993, VERNET R., Le site rupesrre d'El Rhallaouiya(Adrar de Mauritanie), Dossi ers et Recherclws sur l'Afirye, Mett-hn, 1, 1993, p. 125-142.
Vieillard L927.1939, VIEILLARD G., Fonds Vieillard, Dakar,Institut français d'Afrique noire, 1927 -L939, (Manuscrits origi-naux de I'IFAN, Cahier 44)
Wolff 1976, \7OLFF R., Chars schématiques de I'oued EC Cayyad,Bullein d'Archéologe marocairle, 10, I976, p. 53-69.
Wolff t978.1979, \UOLFF R., Rock Engravings of the upperwadi Eç Cayyad (Southern Morocco), Almogaren, g-10, 1978-1979, p. 183-202"
NOTES
( 1 ) -Plusieurs datations témoignent d'une pratique de la métallurgie dans diverses régions sud-sahariennes durant la première moitié dupremier millénaire avant notre ère :
- une métallurgie du cuivre se développe dans la région d'Akjoujt (Maurimnie) dès 2776 t 126 BP (Dak 25) soit 1308-620 av. J.-C.(Lambert 1975,p.20). Cette date est la plus haute des dates obtenues par I'auleur;
- la recherche de coupes géologiques quatemaires dans la région du Haut-Sénégal malien a permis de découvrir en stratigraphie, le longde la vallée de la Kolimbine, affluent de rive droite du fleuve Sénégal, les restes d'un ancien fourneau associé à des scories de fer avecquelques tessons sous-jacents. Une datation C14 sur charbon prélevé dans la coupe au même niveau que le foumeau a donné commeâge z 2520 + 70 BP (Gif 9585) soit 800-417 av. J.-C.. Cette date, si elle est confirmée par d'autres mesures, est la plus haute qui soitrelative à des vestiges de métallurgie du fer au Mali (Dupuy, en préparation).
- une métallurgie du cuiwe est attestée au Sud de I'Air (Niger), dès 2800 + 120 BP (Mc 2404) soit 1250-790 av. J..C. (Grébénart 1988,p. 123). Une ménllurgie du fer I'est dans la même région, dès 2440!90 BP soit 800-385 av. J.-C. (Grébénart 1988, p. 162). Ces deuxdates sont les plus hautes des séries de dates obtenues par I'auteur.
(2) - Les centaines d'objets en fer photographiés et publiés par A. Blandin et al. (1992) permettent de juger de certe diversiré des formesobtenues par les forgerons d'Afrique de I'Ouest.
(3) - Se reporter aux articles et ouvrages suivants: Chenorkian 1988, Malhomme 1959-1961, Rodrigue 1990, Searight & Hourbette1992, Simoneau 1970.
(4) - Voir à ce sujet Trost 1978.1979 et 1981.
(5) - La présence de ces signes en contexte riches de bovins est mentionnée dans les articles et ouvrages suivants : Almagro.Basch 1944et1946;Amblard1993;Amblard&OuldKhattar1993;Amblard&Vemet1984;Lhote1957et1964;Mauny&Hal lemansl95T;Meunié&.Al la in 1956; Mi lbum 1972;Monod 1938;Monod&Caunei l le 1951 ;Pel l ic ier&Acosta 1972;Puigaudeau&Senones1939, l94la,1941b et 1953 ; \folff 1976 er 1978-1979.
(6) - D'après les expérimentations et observations de G. Celis (1991) relatives à la pratique de la métallugie du fer en zone sahélo-soudanienne, de simples fours aménagés en cuvette dans le sol avec ventilation forcée, permettent d'obtenir une quantité de métaltoujours suffisante à la réalisation d'un fer de houe.
(7) -Des motifs complexes en spirales multiples et en rubans enlacés ont été relevés au Tassili.n.Ajjer (Lhote 1975-1976), dansl'Ahaggar (Trost 1978-1979 et 1981) ainsi qu'en Tripolinine occidentale (David & Huard 1979). P. Huard (1966) place la réalisationde ces signes dans la phase ancienne à gravures naturalistes. Plusieurs données iconographiques fonr aujourd'hui douter de cetteattribution (Dupuy, en préparation).
(8) - D'après J. Féblot-Augustins et C. Perlès (1992), les distances de circulation des biens forrement valorisés tels que les éléments deparures, les marqueurs de statut social ou les objets servan! aux rituels, se corrèlent chez les pasteurs nomades comme chez les chasseurscollecteurs avec l'étendue des territoires exploités par chaque groupe ; elles varient selon les cas de 600 à 3000 kilomètres (p. 204-205).
(C.O.1 - LAPMO, Université de Provence, 29 av. Robert Schuman, 13621 AIX-EN-PROVENCE Cedex
t24 PnÉHrsrorRE ANTHRopoLOcrn MÉomsRRANÉENNEs 1994, T. 3, p. 103-124