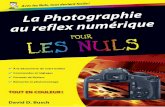Untitled - IDRC Digital Library / Bibliothèque numérique du ...
Sémiotique de l'’épistolarité numérique d’un public en situation de souffrance
-
Upload
univ-lorraine -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
Transcript of Sémiotique de l'’épistolarité numérique d’un public en situation de souffrance
chapitre 1Sémiotique de!l’épistolarité numérique d’un!public en situation de souffrance
Driss ABLALI
La catégorie du genre renvoie à des questions, à des traditions et à des épistémès distinctes, que nous ne saurions reprendre ici. Notre objectif ne consiste pas en faire l’histoire, ni lui trouver une solution. Dans cette contribution, nous voudrions montrer que l’interprétation est ce qui manifeste la puissance et le rôle des genres dans l’analyse des textes et des discours. Ce n’est pas le genre comme catégorie typologique ou taxinomique dont il sera question ci-après, mais le genre en tant que catégorie herméneu-tique qui relève de l’interprétation (Rastier!2011), car le genre n’a pas de lieu textuel arrêté. C’est une catégorie, d’abord annoncée par l’étiquette (édito, roman, lettre, recette de cuisine,! etc.), ce lieu sans lieu où le genre se tait, puis dispersée dans di"érentes composantes du texte. Fait fondamental, le genre ne se présente pas sous son seul aspect extérieur (son étiquette), il est la résultante d’un cheminement multi-sémiotique, qui reste illisible en dehors d’un parcours interprétatif, d’où la conjonction entre « corrélats génériques », « molécule générique », « communauté générique » et « interprétation » que cette étude essaiera de mettre au jour dans le
ABLALI_BADIR_DUCARD_PETIT_01.indd 11 30/03/2015 13:07
12 En tous genres
cadre d’une approche que nous appelons Sémiotique des Genres sur Corpus (SéGeCo).
Notre contribution se divisera donc en trois sections : la première à caractère introductif consiste à poser les bases épisté-mologiques et méthodologiques nécessaires à l’analyse du corpus pour montrer comment nous envisageons les liens entre genre et interprétation. Dans la deuxième partie, nous étudierons, du côté de la composition des textes, la mise en discours de l’épistolarité de la sou!rance sur un corpus de messagerie électronique, issus d’un dispositif d’écoute numérique du mal-être mis en place par une association de prévention contre le suicide. La troisième partie vise à identi"er, du côté de la morphosyntaxe, les relations entre temps verbaux, pronoms personnels et négation en vue d’une interpréta-tion multi-sémiotique du genre.
1. Corrélats génériques, molécule générique, communauté générique
Dans le cadre de la SéGeCo, nous examinons, depuis quelques années, les caractérisations multi-sémiotiques de di!érents genres de discours en considérant les corpus comme l’une des voies les plus appropriées pour l’accès à une telle entreprise. Avant d’entrer dans l’analyse des données, nous voudrions apporter un éclairage conceptuel sur les trois notions qu’annonce notre sous-titre.
Par « corrélats génériques », nous entendons tel ou tel ensemble de plusieurs variables unies par di!érentes liaisons. L’ensemble des corrélats est organisé selon une visée partagée, imposée par le genre, que nous appelons une « molécule générique ». Une molécule générique regroupe ainsi plusieurs variables accomplissant une visée pragmatique et pilotées par une intention de communiquer selon une même stratégie. Autrement dit, une molécule générique ne réside pas dans un contenu, ou dans une seule variable, elle réside dans la manière dont les corrélats génériques sont mis en discours en fonction d’une tradition générique (Coseriu), de telle façon que les choix de variables – pronom personnel, temps verbaux, signe de ponctuation, structure et longueur de phrases, présence ou absence de telle ou telle catégorie grammaticale (substantif,
ABLALI_BADIR_DUCARD_PETIT_01.indd 12 30/03/2015 13:07
13Sémiotique de!l’épistolarité numérique d’un!public en situation de souffrance
verbe, adverbe,!etc.) – renseignent sur la nature multi-sémiotique des genres. Car une variable n’existe que pour ce qu’elle permet de faire au sein d’une molécule générique, c’est-à-dire pour la di"érence qu’elle permet d’obtenir dans la con#guration même de cette molécule. Cela signi#e qu’une variable ne vaut jamais pour elle-même, mais pour son e"et générique sur une autre variable avec laquelle elle va s’associer pour con#gurer les corrélats de la même molécule. Et une molécule n’est que ce que nous en faisons lorsqu’on écrit dans un genre. Elle constitue un fonds commun pour une communauté sans être reconnue en tant que telle. Les membres de cette communauté forment ce que nous appelons une « communauté générique », terme qui désigne un collectif écrivant dans le même genre, où les individus et ce qui leur est propre s’e"acent devant une #gure globale. Il s’agit d’une com-munauté langagière structurée, où les membres ne se rencontrent pas forcément, n’échangent pas, mais partagent le même genre en écrivant des textes. C’est à cette acception du genre que nous nous en tiendrons ici pour l’analyse du corpus.
2. Le corpus2
Ce travail porte sur un corpus électronique lié au thème de la sou"rance, mis en place par une association de prévention contre le suicide, que nous appelons ici, dans le sillage des travaux de R.!Huët, « association Y ». Dans son dispositif d’écoute, plusieurs supports de communication ont été mis en place : le téléphone (depuis les années!1960), le courrier électronique (depuis!2000) et le chat (depuis!2006). Si l’écoute par téléphone reste le moyen le plus classique pour faire part de sa détresse, le virage numérique a pour principal objectif de répondre à la sou"rance d’écrivants de plus en plus nombreux à se livrer à travers le clavier plutôt qu’au téléphone.
Le corpus est constitué de plus de 10 000!courriels, écrits entre 2008!et 2010. Il comprend exclusivement des textes intégraux et
2 Le corpus sur lequel porte cette contribution est la propriété intellectuelle de R. Huët PREFics EA!3207 Université Rennes!2. Je le remercie vivement de me l’avoir transmis sans contrepartie en vue d’une exploration linguistique qui permettra de croiser nos regards sur ces données.
ABLALI_BADIR_DUCARD_PETIT_01.indd 13 30/03/2015 13:07
14 En tous genres
non des extraits, dont la réunion est justi!ée par leur appartenance à la même praxis, le discours issu du milieu associatif. Ce sont tous des textes écrits par un public en situation de grande détresse, venant des quatre coins de l’hexagone, et destinés au milieu associatif. Vu la taille de ce corpus, on peut le considérer comme un « échantillon » représentatif de la population observée, et plus précisément celui d’un « public sou"rant écouté/accueilli par le milieu associatif ». Ce corpus a été traité et exploré avec le logiciel Hyperbase3, désor-mais bien connu, dans sa version#9, qui permet le traitement des formes graphiques et des lemmes en parallèle. En e"et, grâce à une lemmatisation e"ectuée au préalable par l’analyseur Cordial4, nous pouvons traiter non seulement les mots, mais aussi les lemmes, les codes grammaticaux, ou encore les enchaînements syntaxiques.
3. Du côté de la composition
Une remarque préliminaire s’impose : l’objectif de cette étude n’est pas de dresser un parangon de l’épistolarité numérique éma-nant du milieu associatif. Elle n’a pas non plus la prétention de traiter tous les aspects textuels par lesquels on pourrait interpréter le genre. Dans nos intentions, il s’agit de montrer sur corpus les enjeux multi-sémiotiques d’un genre, la messagerie électronique. C’est en e"et en ce point qu’on peut souligner que l’épistolarité numé-rique telle qu’elle est mise en discours dans ce corpus obéit aux contraintes de la correspondance comme interaction et échange. Son dispositif sémiotique est subordonné aussi bien aux enjeux de l’épistolaire qu’aux contraintes numériques de son médium. Elle se distingue ainsi des autres genres épistolaires par la spéci!cité du destinataire qu’elle vise : l’allocutaire ne peut être visé nommément, il occupe donc une place indéterminable. Même si l’échange s’e"ectue entre deux individus, l’allocutaire de l’association Y ne répond pas en son nom, mais en tant que membre de l’association, représentant un groupe. Il n’est jamais nommé, il est désigné par
3 Des informations détaillées sur le logiciel Hyperbase sont disponibles à l’adresse suivante : www.unice.fr/bcl.
4 Des informations sur ce lemmatiseur sont à consulter à l’adresse suivante : http://www.synapse-fr.com/Cordial_Analyseur/Presentation_Cordial_Analyseur.htm.
ABLALI_BADIR_DUCARD_PETIT_01.indd 14 30/03/2015 13:07
15Sémiotique de!l’épistolarité numérique d’un!public en situation de souffrance
le « Vous », contrairement à l’épistolier qui est désigné par le « je » dans le texte et par un nom ou un pseudo à la !n de son courriel, et par l’adresse mail5. Comme le déclare D."Maingueneau dans un texte sur l’épistolaire, « le genre de discours implique un contexte spéci!que : des rôles, des circonstances (en particulier un mode d’inscription dans l’espace et dans le temps), un support matériel, un mode de circulation, une !nalité » (1998 : 55).
Commençons par les rôles. Les courriels du milieu associatif sont des textes conçus pour circuler à l’intérieur d’une sphère bien dé!nie, l’association. C’est une correspondance privée qui exige un devoir de réponse, et qui n’est pas une correspondance d’individu à individu. Les écrivants motivent leur démarche par une demande d’aide. Tous le savent : au niveau du topic, ils écrivent pour parler de soi, pour exprimer leur sou#rance ou mal-être, comme l’illustre clairement l’expression, parmi tant d’autres, « je vous écris » où la visée de l’échange est posée sans ambages dès les premières lignes du courriel6 :
je vous écris pour vous demander un peu d’aide car je me sens mal depuis plusieurs moisje vous écris ce soir juste car cette journée de Noël a été di$cilebonjour si je vous écris c’est que je suis en détresse et que je sens que mon corps et très fatiguéSI je vous écris, c’est pour mettre en mots ma vieje vous écris car j ai des problèmes, je pète littéralement les plombsje vous écris car j’ai du mal a surmonter ma peine
En ce point, les propos de Huët sont éclairants :En proie à des doutes existentiels, l’écriture aiderait l’indi-vidu à redonner sens au chaos de sa vie et de rechercher la trame narrative dans une série d’expériences qui pourraient paraître comme décousues (Huët, à paraître).
5 À ce propos Huët dit ceci : « ce corpus s’est plié aux règles de l’association : anonymat complet des personnes et des lieux d’écoute, con!dentialité. Ainsi les adresses e-mails sont masquées, les coordonnées transformées en chi#res, les noms et les pseudonymes modi!ées » (Huët"2013).
6 Une remarque s’impose ici pour dire que les citations du corpus sont intégrales et exactes, jusque dans leur orthographe.
ABLALI_BADIR_DUCARD_PETIT_01.indd 15 30/03/2015 13:07
16 En tous genres
Au niveau de la composition de ces courriers, les messages com-portent généralement, dans les séquences d’ouverture, des formes de salutation, comme marqueurs de politesse d’une relation de type symétrique (Kerbrat-Orecchioni! 1992 : 36), sans l’utilisation des titres du type Monsieur/Madame, qui pourraient augmenter la dis-tance, et qui sont dominants, par exemple, dans les courriers admi-nistratifs ou professionnels. « Bonjour » ou « Bonsoir » est la formule de salutation la plus adéquate, dans les milieux où la distance n’est pas une valeur sociale cruciale. Pour ouvrir le courriel, la salutation « Bonjour »/« Bonsoir », vu sa grande fréquence dans le corpus, per-met de faire mieux comprendre la visée communicative du locu-teur en l’inscrivant dans la sphère intime d’échange qui le légitime. D’entrée de jeu, il impose, juste après le rituel de contact, son noyau thématique pour fonder son droit à l’expression du mal-être et de la sou"rance. Ainsi se rencontrent dès l’ouverture des courriels et avec une forte fréquence des phrases posant clairement la visée de l’échange, que nous avons appelé plus haut « molécule générique » :
Bonjour, j’ai simplement besoin de m’exprimer mais les paroles ne me conviennentBONJOUR et merci de prendre la charge de me lireBonjour alors voila comment interpretriez vous un mari qui rentre avec une braguette ouverte et la chemise defaite au dos ?Bonjour, voilà mon soucis en e"et ma vie ne va plus…Bonjour je vous ecris parce j’en ai marre, je veux parler, je suis victime de la poisseBonjour, je vous contact car je suis en situation de mal êtreBonjour j’ai 40!ans, je suis toujours seule mes amies m’ont laissées tombées je recherche quelqu_un qui saurait me comprendre
Dans ces zones d’ouverture, le scripteur, en ancrant fortement son texte dans l’intime, met tout en place pour que son courriel entre dans un circuit communicationnel en harmonie non seu-lement avec le noyau thématique qu’il véhicule, mais aussi avec un certain nombre de traits qui forment un système quasiment immuable. Les courriels se terminent par une formule de remer-ciement très brève en lien direct avec la #nalité évoquée ci-dessus, celle de l’écoute. On passe ainsi de la #nalité à la clôture sans
ABLALI_BADIR_DUCARD_PETIT_01.indd 16 30/03/2015 13:07
17Sémiotique de!l’épistolarité numérique d’un!public en situation de souffrance
« préclôture ». Le courriel s’arrête souvent de manière brutale sans aucune justi!cation de la clôture, laquelle est réalisée de façon sys-tématique par le remerciement, comme on le lira dans les exemples donnés plus bas.
Au niveau des !nalités, malgré l’absence d’un modèle préétabli pour raconter sa sou"rance dans un courriel, les courriels des sou"rants se conforment aux routines de leur sphère d’échange. Une telle conformité apparaît largement liée à la !nalité du cour-riel qui s’e"orce dès les premières lignes d’assigner une identité au public sou"rant, celle d’un écrivant qui met son destinataire face à une forme précise de sou"rance. La sou"rance est ainsi à la fois la source des courriels et le propos des courriels. L’objet du courriel est le courriel lui-même : écrire non pour demander une aide, mais pour se mettre en récit : écrire la sou"rance, écrire pour l’expression de la sou"rance, pour libérer la parole. Huët le dit aussi sans la moindre ambiguïté :
Pour le dire encore autrement, cet espace d’écoute est une forme historique déterminée de saisie de soi dans la mesure où elle encadre et instruit l’introspection et les moyens de la réaliser. En appelant l’individu à se décharger de son passé biographique, elle l’incite à une meilleure maîtrise de soi […] et donc à une forme d’autodomestication (Huët, à paraître).
On peut le lire dans ces exemples, où tous les courriels adressés à l’association Y essaient de construire deux places, celle de la per-sonne qui sou"re et celle de la personne qui écoute :
Merci de m’avoir lu et désolée de vous enquiquiner avec tout çaEn fait je me sens fatigué et dépressif (je prends des médi-caments, je consulte… que puis _je faire ? merci de vôtre écoute ou de répondreJ’ai besoin d’être écoutée, merci d’être là, ça fait du bien, une raison de pas serrer la corde.Merci encore, c’est toujours plaisant de ce sentir écouterj’en ai mare je suis au bout du rouleau merci de me lireMerci de m’avoir lu jusqu’ici, et merci d’avance de votre réponse si vous trouvez quoi répondre à cela
ABLALI_BADIR_DUCARD_PETIT_01.indd 17 30/03/2015 13:07
18 En tous genres
Dans l’interprétation, il faut aussi se poser des questions sur les variables dont se prive un genre. Or, contrairement aux autres textes « médiés » par ordinateur, tels que les forums de discussion, les blogs, les chats, les SMS et sur lesquels beaucoup de travaux ont été menés en vue d’une caractérisation des procédés les plus visibles des écrits numériques, l’épistolarité numérique d’un public sou!rant écouté/accueilli par le milieu associatif n’est pas marquée par certains phé-nomènes linguistiques caractéristiques du langage Internet souvent dominé par les marques de l’oral7, comme les formes d’allègement, les phénomènes abréviatifs ou les siglaisons (stp, bjr, bsr, mdr), la troncation par suppression de la "n du mot (ou apocope), ou la réduction (bureau/buro, je peux/Je pe). On remarque la même absence, malgré la dimension fortement pathémique des écrits, de l’utilisation des majuscules et des italiques, techniques récurrentes de l’écriture électronique, pas de smileys (permettant d’introduire des aspects sémiologiques non-verbaux), pas de capitalisation, l’usage massif des lettres capitales (hurlements). Cette messagerie di!ère radicalement des autres formes d’écrits de l’internet8, d’où la nécessité d’éviter l’emploi de l’expression « écrits de l’internet » trop généralisante au pro"t d’une typologie des praxis et des genres.
4. Du côté de la morpho-syntaxe
Le courriel semble de surcroît comporter des invariants mul-ti-niveaux communs à tous les textes. La première variable concerne la présence massive, en tête de liste, du pronom personnel « Je ». Ce qui est hautement attendu et la statistique donne la con"rma-tion à l’intuition linguistique. Comme il est question d’une mise en récit de soi, personne ne sera surpris que la 1re#personne soit surem-ployée par les écrivants. La 1re#personne et sa fréquence deviennent ici discriminantes, grâce à la force émotive de la thématique du corpus. Restons encore quelques instants sur cette question de la première personne car la question morpho-syntaxique en cache
7 On constate ainsi que si certains discours électroniques comme les SMS ou les chats usent et abusent des procédés expressifs pour reproduire le non verbal, notre corpus en est majoritairement dépourvu.
8 Voir Ablali et Wiederspiel, à paraître.
ABLALI_BADIR_DUCARD_PETIT_01.indd 18 30/03/2015 13:07
19Sémiotique de!l’épistolarité numérique d’un!public en situation de souffrance
une autre, en rapport avec l’extraction des mots importants par leur haute fréquence. En tête de liste des formes les plus fréquentes, contrairement à toute attente, avant même les mots-outils, et juste en dessous du point et de la virgule, le lemme « Je » campe soli-dement sur le devant de la scène comme étant le lemme le plus signi!cativement suremployé dans les courriels. Ce qui en tout cas s’impose avec évidence, comme en témoigne le tableau ci-dessous, c’est que l’épistolarité du public sou"rant, entièrement orientée vers le destinataire, n’est rapportée qu’à la subjectivité sensible de celui qui écrit. Le sou"rant cherche ainsi à changer de statut en passant de sou"rant esseulé à celui d’écrivant qui ne demande qu’à être écouté :
Figure!1Les hautes fréquences du corpus
Si l’on adopte cette hypothèse, il faut étudier des corrélations et non se contenter d’explorer des vocables ou lemmes isolés, d’où le choix d’explorer les temps verbaux directement associés à la 1re#personne pour recenser les di"érents syntagmes que l’on peut former avec ce pronom personnel. Pour répondre empiriquement à cette question, on propose donc un retour aux textes, en allant
ABLALI_BADIR_DUCARD_PETIT_01.indd 19 30/03/2015 13:07
20 En tous genres
chercher sur corpus les associations les plus caractéristiques du courriel que le scripteur emploie trop ou pas assez quand il dit « Je ». Pour cela, nous avons exploré les emplois de ce lemme, et dans les 32 590!occurrences enregistrées, le taux du présent de l’indicatif, obtenu grâce aux sorties de Cordial, se révèle la forme dominante. En revanche, une forte réticence porte sur le futur, temps peu utilisé et indé"niment repoussé. Cela montre que le scripteur, dans un texte recueilli comme un témoignage, s’engage à raconter une suite rétrospective d’événements dont le pivot est le présent de l’indicatif : écrire pour mieux se comprendre et comprendre les traumatismes traversés mais sans aucune vision prospective. Le scripteur écrit son mal-être, retrace son histoire, tout en s’e#orçant de donner une cer-taine présentation de soi à partir d’événements antérieurs. Il tâche ainsi de démêler les nœuds de son vécu dans l’espoir d’inverser le cours des événements. Mais cette absence du futur n’est pas qu’une question de grammaire. Elle est surtout le signe chez les sou#rants d’une incapacité de surmonter ou d’a#ronter l’indétermination et l’opacité de ce qui va advenir : l’écrivant ne veut/sait/peut pas anticiper ce que sera son futur. En se privant du futur, il ferme son angle de vision. L’échelle temporelle dans laquelle il se place est dans l’immédiateté, dans le feu de l’urgence et de l’émotion, mais pas dans l’anticipation ou la prévision, la promesse ou la prophétie. Les sou#rants sont des sujets ancrés dans le hic et nunc, des sujets qui sont davantage dans la présenti"cation que dans la projection. Ici les exemples sont catégoriques :
mon avenir est sans horizonL’avenir est vraiment trop $ippantpourtant je ne vois pas d’avenirj’avais un but, un avenir. Maintenant, c’est "niJai très peur de l’avenir et je n’ai pas très envie de le connaîtrej’ai peur de l’avenir ça me terroriseJe ne peux plus me projeter dans l’avenirje ne laisse pas de place a demainmême si demain ressemble souvent à hierje sais que demain sera encore pire qu’aujourd’hui
Comme on peut le lire dans ces extraits, l’association « Je/Pr » est redondante, elle est dans toutes les phrases de tous les courriels. Elle montre clairement que la sou#rance est saisie à partir de ce qu’en
ABLALI_BADIR_DUCARD_PETIT_01.indd 20 30/03/2015 13:07
21Sémiotique de!l’épistolarité numérique d’un!public en situation de souffrance
disent e!ectivement les individus au moment où ils écrivent leur courriel en vue de donner à voir la sou!rance dans le prisme de l’écriture présente. En attestent des formules telles que :
je vous raconte cet épisode de ma vie et ces événements pour vous faire comprendre dans quel état d’esprit nous nous trouvions quand nous avons été livrés à notre pèreje me sens mal dans mon corpsPour le moment je vie dans la peur et dans l’angoisse permanenteje n’en peux plus de cette situation, tout ceci me fatigueje suis comme un fantome, envie de rien, je ne vaux plus rien de tte façonPour le moment je suis secrétaire à mi_temps, et je jongle avec des ménages et gardes d’enfants pour gagner ma vieje ne dors plus, je ne mange plus, je pleure pour un rien, je me sens en pleine déprime, je perds le goût de tout
Mais comme le montrent également ces exemples, cette corré-lation prend son sens à partir de son environnement dans la chaîne du texte. En tenant compte de son entourage lexical, on pourra lire clairement que la 3e"personne est l’une des formes le plus souvent associée au JE/Pr. La construction JE/Pr +Il est fort répandue, soit pour introduire un nom commun (le père, le #ls, la sœur, le conjoint, la collègue, le psy), soit pour préciser la cause du mal-être. Observons que Il #gure parmi les plus hautes fréquences des vocables du corpus, arrivant à la 15e"position. C’est la 3e"personne en e!et qui cimente la cause et le référent de la sou!rance et établit le moment à partir duquel le procès est considéré. Ainsi le Je/Pr apparaît comme un moyen d’évocation des autres en soi-même, pour reconnaître le lien intime qui unit le scripteur à eux et en même temps pour se défaire de ces liens quand ils le retiennent. Les causes du mal-être sont situées au moyen de relations avec un point de repère et pourront constituer à leur tour un point dans le temps. C’est à partir d’un événement passé, associé à la non-per-sonne que s’organise la temporalité de la sou!rance. En revanche, la temporalité du courriel se construit autour du moment du discours, c’est-à-dire du moment de l’énonciation, d’où la dominance du présent de l’indicatif qui montre l’aspect processuel de la sou!rance, la sou!rance comme procès en cours et continu. Car la mise en
ABLALI_BADIR_DUCARD_PETIT_01.indd 21 30/03/2015 13:07
22 En tous genres
discours de soi permet au sujet de mieux se situer dans une histoire présente à travers laquelle il pourra sortir de l’individuel et accéder au collectif, comme en témoignent ces exemples :
j’ai vécue avec lui des moments magiques comme à chaque début de relation, puis il a changé, il est devenu nombriliste et avec le temps, seul l’argent comptaitJe travaille comme assistante dans une entreprise et il pense que je ne fais rien dans Mon bureauEt lui, il rentre les pieds sur la table et à 20!h!30 il se couche sur le canapé pendant que je débarasseLe week_end il va à la chasse et je dois faire les repas et l’attendre pour manger même s’il est 13!h!00Je lui ai répondu que malgré les coups durs depuis juin j ai des panachés chez moi et je n y pense même pas…Souvent il compare ma cuisine à celle de sa mère, les atten-tions que je lui porte lui rappelle sa mamanJ’ai comme l’impression qu’il a pompé toute mon energie alors que je suis de nature généreuse, souriante et j’adore la vie
Plus nombreuses sont les variables partagées, plus grand sera le nombre des corrélats génériques. D’où l’exploration de la struc-ture syntaxique de la phrase qui fait apparaître la forte proportion de phrases négatives9 dans le corpus. Cela donne au courriel du sou"rant un aspect tendu qui est peut-être l’une de ses principales singularités syntaxiques, et du coup sémantiques. Les phrases syn-taxiquement négatives introduisent la sou"rance comme un a"ect ou une émotion dysphorique, comme impuissance à raconter, à savoir, à agir, à faire, bref comme impuissance à s’estimer soi-même. Les exemples suivants le montrent sans ambages :
Comme vous le remarquez il bien tard et je ne dort pasJe n’ose pas lui dire qu’elle en met trop dans mon assietteAvec ma crise d’angoisse je n’ai pas pu réviser hier soirJ’ai l’impression de ne pas vivre ma vie comme avantJe n’ai pas très faim depuis plusieurs joursJe n’arrive même pas à décrire se que je ressent
9 Le graphique des hautes fréquences le con#rme également : le « ne » et le « pas » sont parmi les formes les plus fréquentes (voir Fig.!1).
ABLALI_BADIR_DUCARD_PETIT_01.indd 22 30/03/2015 13:07
23Sémiotique de!l’épistolarité numérique d’un!public en situation de souffrance
6!ans de vie commune, je ne peux pas les e"acer du jour au lendemainJe ne me sens pas bien. Envie de mouriril y a quelque chose que je n’ose pas direDepuis longtemps je ne m’aime pas
Dans tous ces exemples, la négation exprimant un jugement sur un vécu établit une privation, elle équivaut pour les écrivants à l’absence de ce à quoi ils s’attendaient, elle est la marque du rejet par le sujet de ce qui est mauvais pour lui (« ne pas s’aimer », « ne pas oser dire », « ne pas se sentir bien », « ne pas vivre », « ne pas pouvoir e"acer »,! etc.). Ainsi comprise, la négation n’est pas uniquement un opérateur syntaxique visant à s’inscrire en discordance avec le dit, mais un corrélat générique capable de construire des tactiques et des stratégies en lien direct avec la molécule générique, la mise en récit de la sou"rance ; autrement dit, la négation devient ici la « marque de fabrique » souvent corrélée à une modalité dysphorique qui détruit la croyance dans le positif. Elle apparaît bien comme ayant une force qui modi#e le contenu du dit, comme déterminant une forme spéci#que d’assertion. Ce n’est pas seulement un fait de surface, elle a une valeur de jugement qui porte plutôt sur un contenu que les écrivants refusent dans sa forme et dans son fond. La négation s’entend donc comme dysphorie : ne pas être comme on aimerait. Car ce phénomène de manque à combler, qu’on vient plus haut d’observer, s’étend à tous les niveaux et à toutes les dimensions de l’écriture, en agissant comme un principe d’en-semble qui surplombe la structure narrative du courriel lui-même, par l’établissement d’un désir, c’est-à-dire par une négation d’objet. La négation est ainsi un acte de disjonction, elle réfute, elle conteste, elle prive. Le manque que les écrivants éprouvent, compris comme négation de force, travaille tous les paliers de la textualité. Au niveau modal, les écrivants sont des sujets impuissants face aux épreuves qu’ils endurent. Ils sont dans une position de ne pas pouvoir-faire ou de ne pas savoir-faire. Et cette passivité ne concerne pas que les verbes, elle est lisible également à travers d’autres observables, la négation pré#xale, laquelle permet d’évoquer en direction des valeurs investies dans des objets le propre mal-être des sujets ou celui des autres. En racontant leur sou"rance, les sujets ont tendance à privilégier des adjectifs et des substantifs plutôt quali#ants à valeur
ABLALI_BADIR_DUCARD_PETIT_01.indd 23 30/03/2015 13:07
24 En tous genres
négative. La négation est donc le point focal à partir duquel se joue la communication d’un sentiment de sou!rance. Ce qui est en jeu ici, c’est l’omniprésence de la négation pré"xale dans tous ses états :
« inapte », « je me sens décalée et inapte », « incapacité », « Je suis dans l’incapacité de vivre vraiment »), « incompréhensible » (« Je suis incompréhensible, inaccessible »), « incompris » (« je me sans incompris ! »), « inconsolable » (« Suite à une rupture dont je suis inconsolable »), « incontrôlable » (« je suis incontrolable, je casse tout autour de moi »), « inhu-maine », (« Mais je trouve la vie ici inhumaine »), « ininté-ressant » (« Je me sens moche et inintéressant »), « insup-portable », (« Cette sensation en moi est insupportable »), « insurmontable », (« Mais ma peur, peur insurmontable »), « inaperçu » (« Je passe inaperçu ou que je sois »), « immature » (en ce moment je me trouve immature, paumée, fatiguée, stressé »), « impossibilité » (« je suis dans l’impossibilité de combler les manques »), « impossible » (« notre vie de couple devient impossible »), « impuissance » (« un immense cha-grin et l’impuissance à aider maman »), « impuissante » (« je me sens impuissante, trriste, narcissique »).
Cette haute fréquence de la négation dans le corpus intéresse plus une sémiotique des textes qu’une grammaire de la phrase. La négation est à considérer comme un observable syntaxique autant qu’une force, une poussée énergétique de l’écriture, et un mode d’énonciation. Elle devient le marqueur d’un manque à combler, et le manque repose sur le défaut de l’objet. Comme un trait carac-téristique des récits de sou!rance, la négation fonctionne comme un jugement de rejet qui permet de comprendre les tensions et les con#its que vivent les sujets sou!rants dans leur cheminement vers la libération de la parole.
5. Remarques conclusives
Notre intention à travers cette analyse multi-sémiotique était de montrer la voie en nous posant temporairement sur certains points qu’il faudrait approfondir. Pour traiter correctement
ABLALI_BADIR_DUCARD_PETIT_01.indd 24 30/03/2015 13:07
25Sémiotique de!l’épistolarité numérique d’un!public en situation de souffrance
l’ensemble des corrélats génériques, il faudrait réaliser un exa-men exhaustif, évidemment disproportionné dans les limites du présent article. Mais comme on l’a aperçu plus haut à travers des observables multi-niveaux, c’est la communauté, sous l’impact du genre, qui l’emporte sur l’individu. Les singularités du courriel de chaque individu concourent à l’intégration des normes du groupe, lesquelles sont des contraintes du genre, d’où la notion de commu-nauté générique que nous proposons pour montrer que les lois du texte sont di!uses dans le genre. Les di!érents types de sou!rance sont ainsi sous la dépendance de l’action collective, laquelle s’inscrit dans la consonance d’une même trame générique. En écrivant à l’association Y, les sou!rants ne savent pas qu’ils appartiennent à un collectif, qu’ils doivent maîtriser les règles du jeu ou respecter un cahier des charges, mais lorsqu’on se penche sur leurs textes, on observe a posteriori des régularités langagières multi-niveaux inhérentes à une communauté générique, communauté dont les normes ne sont pas "xées par décret ni laissées à la libre discrétion de l’instance de production. Cet e!et est d’ailleurs clairement assumé par toutes les variables que nous avons relevées plus haut, lesquelles pèsent sur le genre et le façonnent dans ses di!érentes facettes. Ce qui montre que la même aimantation des textes, obser-vée au niveau sémantique (tous écrivent pour mettre en récit leur sou!rance), se retrouve au niveau narratif et morphosyntaxique : on y trouve au niveau de la narration un récit fortement charpenté qui organise la quête de savoir selon une progression téléologique tendant vers la même résolution "nale : être écouté par les membres de l’association Y. Que la sou!rance ait lieu au travail, en couple, en famille, elle s’exprime dans le même vocabulaire, dans la même syntaxe et dans le même rythme. La sou!rance, construite dans l’interaction, fait émerger dans les di!érents écrits des régularités morphosyntaxiques, une temporalité propre, une propension pour un usage intensif de la négation comme un opérateur d’expression transversal à presque tous les courriels. Grâce à l’interprétation en tant qu’opération multi-sémiotique visant à assigner un genre à un texte, on voit se dessiner une première ébauche descriptive de la structure con"gurationnelle du « courriel », issu du milieu associatif. On a des raisons en e!et de croire que la variable du genre l’emporte sur l’instance d’énonciation et qu’elle pèse également plus lourd que le thème. Dès lors, l’interprétation est une « action » productrice
ABLALI_BADIR_DUCARD_PETIT_01.indd 25 30/03/2015 13:07
chapitre 2non seulement de sens mais aussi et surtout de généricité. Tout autant qu’au texte, l’interprétation est subordonnée au genre.
BibliographieA!"#"$, D%$&& ('()*), La grammaire fonde-t-elle une nouvelle typologie
des genres textuels ? La cooccurrence auto-constituante dans les textes de randonnée, in Revue de Sémantique et pragmatique, 32, pp.+95-114.
A!"#"$, D%$&& ('(),), Types, genres, généricité en débat avec J.-M.!Adam, in Théories et pratiques des genres. Pratiques, 157-158, pp.+216-232.
A!"#"$, D%$&& - W$./.%&0$.", B%$1$22. (à paraître), La médiation du monde numérique en situation de sou"rance, in S.+ B#/$% - F%.+P%34.56#53 (eds), Pratiques émergentes et pensée du médium, Limoges, Lambert-Lucas.
B3"2#5&7$, L89 ('((:), La sou"rance à distance, Paris, Gallimard.
H8;2, R3<#$5 - E" K#="#38$, Soraya (2013), Les mots de la souf-france sociale, conclusions d’étude, rapport non publié, INPES, Paris.
H8;2, R3<#$5 - E" K#="#38$, S3%#># - S#%%38>, O"$4$.% ('()'), Épistémologie de la sou"rance sociale au service d’une critique du Capitalisme, communication au colloque Penser l’émancipation, Lausanne, 25-27+octobre.
H8;2, R3<#$5 (à paraître), Les organisations d’écoute de la sou"rance sociale sont-elles des lieux d’ajournement de la vengeance ?, Congrès S?c, Toulon, juin+2013.
K.%!%#2-O%.99=$35$, C#2=.%$5. ()@@A), L’interaction épistolaire, in Jürgen Siess (éd.) La lettre entre réel et #ction, Paris, SEDES, pp.+15-36.
M#$518.5.#8, D3<$5$B8. ()@@A), Scénographie épistolaire et débat public, in Jürgen Siess (éd.) La lettre entre réel et #ction, Paris, SEDES, pp.+60-71.
R#&2$.%, F%#5C3$& ('())), La mesure et le grain, Paris, Honoré Champion.
ABLALI_BADIR_DUCARD_PETIT_01.indd 26 30/03/2015 13:07