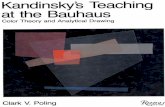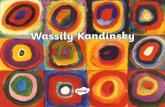Sémiotique - Kandinsky Compo IV & Identités visuelles (Floch)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Sémiotique - Kandinsky Compo IV & Identités visuelles (Floch)
Discours MaëlAnne CROLL GAUTIER
01.03.12
Compte-rendu de :
- Kandinsky. Composition IV- Identités visuelles
de Jean-Marie Floch
I/ L'auteur
Jean-Marie Floch (1947-2001) est un sémioticien qui a collaboré notamment avec A.J. Greimas
(dont il a été étudiant) à l'EHESS-CNRS, au sein du Groupe de Recherches sémio-linguistiques,
qu'il a un temps dirigée. Il est assez difficile de trouver des informations biographiques précises sur
cet auteur. Un très court article lui est consacré sur Wikipédia, qui fournit au moins une
bibliographie. Nous redonnons ici quelques titres d'ouvrages :
– Petites mythologies de l’œil et de l’esprit, 1985
– Les formes de l'empreinte, 1986
– Sémiotique, marketing et communication. Sous les signes, les stratégies, 1990
– Identités visuelles, 1995
Certains mots-clés figurent dans ces titres, par exemple « oeil », « formes », « marketing »,
« signes », « identités » et « visuelles ». Ainsi l'on pressent déjà que le travail de Floch est un travail
de sémioticien, et qu'il va porter plus particulièrement sur des objets visuels, et même déborder sur
l'étude de ce type de signes dans des pratiques de communication spécifiques comme le marketing.
En effet, Floch aura mené durant sa carrière une double activité de sémioticien et de consultant en
marketing, conseillant des entreprises sur leurs choix de communication (visuelle).
Pour en arriver là, Floch a développé longuement une théorie des objets de sens visuels, dont la
portée se veut très large : tout objet visuel non-arbitraire est potentiellement concerné, du simple
logo de société au tableau de maître.
Signalons que même si, comme dit plus haut, on trouve peu d'éléments biographiques sur
l'auteur, une rapide recherche sur internet permet de trouver quelques témoignages informels
(d'amis, d'anciens étudiants etc.), le présentant comme un personnage de très haute érudition,
disposant d'un savoir véritablement encyclopédique. Ceci peut expliquer les nombreux
rapprochements, associations, voire raccourcis, qu'il opère, et dont nous donnerons des illustrations
au cours de ce compte-rendu.
Le compte-rendu est organisé comme suit. Tout d'abord, nous tentons un résumé critique de
l'article Kandinsky. Composition IV, suivant de près notre présentation orale (l'article est disponible
en ligne à partir du lien suivant :
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-8018_1981_num_34_1_1511 ;
la version que nous avons consultée est celle présentée dans la première partie de la collection
d'articles Questions de sémiotique, sous la direction d'Anne Hénault). Après cela, nous essaierons
d'aller un peu plus loin dans l'élucidation du travail de Floch, en proposant un résumé partiel de son
livre Identités visuelles. Nous procéderons à une discussion du contenu de trois des six chapitres qui
composent son ouvrage et extraierons les éléments que nous y avons perçus comme les plus
saillants. Enfin, nous ferons une conclusion englobant ce que nous aurons dit à la fois de l'article sur
Kandinsky, et du contenu du livre.
II/ Kandinsky. Composition IV
i/ Résumé
Kandinsky (1866-1944) est un peintre extrêmement connu, et associé à la naissance de
l'abstraction en peinture. En plus de l'activité de peintre proprement dite, il a également enseigné
pendant la plus grande partie de sa carrière, et à publié des ouvrages théoriques sur l'art. Sa
production peut être divisée en périodes nettement distinctes. Kandinsky n'a pas commencé la
peinture par l'abstraction : il a laissé une riche œuvre figurative. La fin de sa carrière, en revanche,
est d'un degré d'abstraction très élevé. La période qui intéresse Floch dans son article est celle où
Kandinsky opère la transition entre figuratif et abstrait, où il délaisse progressivement les motifs
figuratifs ; cette période court de 1907 à 1916. C'est l'aspect progressif qui retient son attention, car
ces motifs, n'ayant pas entièrement disparu, sont intégrés dans des formes abstraites, d'une manière
plus ou moins reconnaissable et réminiscente de sa production antérieure. Pour Floch, il s'agira de
démontrer que Kandinsky développe à cette époque un « nouveau langage », qu'il appellera « semi-
symbolique ».
Floch considère le tableau Composition IV comme représentatatif, plus que d'autres, de cette
période. Comme son titre l'indique, il entre dans une série de tableaux simplement intitulés
« Composition » et numérotés de I à X. Cette pratique, Kandinsky l'a conservée du début à la fin de
sa carrière, plusieurs décennies séparant le premier de la série du dernier. On peut donc penser
d'emblée que ce tableau devait revêtir une importance particulière pour le peintre lui-même.
Première segmentation
Dans une perspective de description sémiotique, il faut, selon Floch, se conformer à un certain
nombre d'étapes, dont la première est la segmentation de l'objet d'analyse en unités discrètes. On se
situe là au niveau purement sensible : il y a l'objet, et les choses que l'on voit au sein de cet objet,
qui peuvent être distinguées les unes des autres dans un premier mouvement cognitif. L'existence
d'unités discrètes donne naissance à des « oppositions visuelles […] produisant des ruptures de
continuité dans l'étendue ». L'objet visuel est une substance, faite uniquement de fomes et de
couleurs ; en discrétisant cette substance (c'est-à-dire en la « découpant »), on a une première
approche de la forme.
Quelles sont alors, pour Floch, ces unités discrètes qui se donnent immédiatement à la
perception ? En premier viennent les deux verticales noires situées au centre et scindant l'espace du
tableau en deux parties égales. Il y a donc au moins deux parties, et ces deux parties doivent être
différentes. Voici ce que Floch propose pour les distinguer :
a/ partie gauche : - lignes nombreuses, courtes, se coupant
- couleurs sombres/sales/peu étendues
b/ partie droite : - lignes peu nombreuses, longues, ne se coupant pas
- couleurs vives/étendues
Comme on le voit, il ne s'agit pas simplement d'une différence, mais bien d'une opposition,
terme à terme, des éléments de chaque partie, qui justifie de parler d'un effet « paradigmatique » :
les termes /court/ et /long/, par exemple, sont les constituants d'une catégorie binaire /court/ vs
/long/. Allant plus loin, Floch évoque aussi une opposition dans ce qu'il appelle la « syntagmatique
des lignes » : dans la partie droite, on a affaire à des lignes parallèles (au moins pour certaines),
tandis que dans la partie gauche, les lignes, indépendamment de leurs formes, s'organisent en paires
symétriques. Cela contribue à les différencier.
Dans un même élan, Floch établit la présence d'une partie centrale, caractérisée à la fois par des
éléments présents dans les parties droite et gauche, comme « empruntés », et des éléments qui lui
sont propres. Pour les premiers, il note que cette partie centrale comprend à la fois des lignes
longues et se coupant rarement, comme dans la partie droite, et des endroits où elles se croisent,
comme dans la partie gauche. Cette partie centrale présenterait donc un aspect « mixte », vis-à-vis
des deux autres. Les autres éléments que l'on y trouve, et qui lui sont propres, sont : la grande masse
bleue, semblable à une montagne, le « polygone » qui y est juché, les silhouettes blanchâtres du bas,
ainsi que certains autres petits détails, comme les points rouges dans la zone des silhouettes, qui
pourraient être des yeux, ou encore la tache verte qui déborde sur le polygone, tout au sommet.
Ceci pour la première segmentation (qui ne saurait bien sûr jamais être exhaustive). On
remarque que jusqu'ici, aucune hypothèse quant au sens des unités dégagées n'a été formulée ; il
s'agit bien de ce que l'on voit, et uniquement de cela.
Unités signifiantes
Pour Floch, l'étape suivante est de dégager les unités signifiantes. Dans sa démarche, cela prend
la forme d'un recensement des formes visuelles récurrentes dans la période de création en question.
Il note deux types de récurrence dans cette période : d'une part, la reprise incessante de « sujets
usés », de nature religieuse, et d'autre part, l'utilisation régulière de lignes noires et de plages
colorées.
Procédant selon les parties dégagées lors de la première segmentation, Floch établit une sorte de
liste des unités signifiantes qu'il reconnaît dans ce tableau : parties gauche, droite, et centrale.
Dans la partie gauche, il relève les éléments suivants.
Tout d'abord, le paquet de traits noirs situé dans la moitié supérieure. Il s'agit d'un « signe-
objet », quasi-figuratif, et « auquel la grille de lecture du monde naturel conjoint un signifié ». En
regardant assez attentivement, on distingue en effet une forme issue du monde réel, et présente dans
de nombreuses œuvres de cette période : il s'agit de deux cavaliers en situation d'affrontement.
L'affrontement n'est pas la seule modalité dans laquelle des cavaliers apparaissent dans des tableaux
de Kandinsky de cette période : ils peuvent aussi apparaître seuls ou à plus de deux, et peuvent
représenter l'élan, la course, plutôt que le combat. Il reste que le « cavalier » est une unité
sémantique récurrente, qui ici semble représenter un combat entre le Bien et le Mal.
La partie inférieure comprend deux obliques descendant abruptement l'une vers l'autre. L'une est
nette, lisse, alors que l'autre est hérissée de traits noirs épais. Ce hérissement peut être, justement,
associé à l'adversité, à l'hostilité, au Mal. Ainsi, les deux cavaliers en présence se voient attribuer
des rôles, puisqu'à chacun semble correspondre une pente. Il faut noter que l'opposition entre deux
pentes se retrouve dans plusieurs tableaux du peintre.
Enfin, la présence d'un arc-en-ciel et d'un soleil dans le creux des deux obliques, eux aussi des
éléments récurrents, est à mettre en lien avec les notions de renouveau et d'issue heureuse du
combat. Le renouveau spirituel est par ailleurs un thème central dans les écrits théoriques de
Kandinsky.
Dans la partie droite, Floch relève :
Une double forme allongée oblique et d'apparence vaguement humaine. La récurrence de
formes allongées dans de nombreux tableaux, qu'elles soient doubles ou non-doubles, est associée à
des sujets humains et sacrés. Quand, comme ici, elle est double, cette forme peut être une « image
du couple »
Des plages vivement colorées et étendues, notamment dans la partie supérieure. Ces plages
concentriques évoquent des nuages, et donc le ciel. En même temps, leurs couleurs sont irréelles.
Cet ensemble peut être ramené à l'idée du bonheur et de l'harmonie. Dans d'autre tableaux, on
trouve aussi des plages colorées, des auréoles, avec d'autres éléments, semblables à des fleurs ou à
des soleils.
L'image du couple représentée par la forme allongée, ainsi que ces plages colorées, forment
pour Floch une « combinaison syntagmatique », qui signifie « couple conjoint à l'amour et la vie
éternelle ».
Voici ce que Floch dit pour résumer l'opposition entre partie gauche et partie droite : la partie
gauche est la « manifestation d'un récit de combat (dont l'issue sera heureuse) » ; la partie droite est
la « conjonction de sujets d'état duels, investie d'une valeur positive ».
La partie centrale n'est pas en reste, car Floch y trouve également des unités signifiantes :
La « plage claire inférieure », c'est-à-dire le groupe de silhouettes blanchâtres, serait « le
formant d'un actant collectif conjoint à un objet axiologique positif » ; on peut penser qu'il s'agit
justement d'une occurrence des ces « sujets usés » religieux, mais Floch fait en plus le
rapprochement avec la partie droite et son « couple ».
Cette partie contiendrait également des éléments « guerriers », en commun avec les cavaliers de
la partie gauche : la « griffure violette » ressemble à ce que l'on voit du côté des cavaliers, et évoque
un sabre ; les taches rouges sont l'irruption d'une couleur vive et violente dans un ensemble pâle ;
enfin, les deux verticales centrales, dans la mesure où elles coupent la plage blanchâtre en son
milieu et semblent être tenues par des mains, peuvent être vues comme des lances.
Le « polygone », qui est désormais une « forteresse », prend une connotation religieuse si l'on
regarde d'autres tableaux, où des forteresses très haut juchées font référence au récit biblique du
Déluge. Floch va même jusqu'à voir une croix chrétienne dans l'intersection des deux verticales et
de la ligne supérieure de la forteresse.
Pour résumer, la partie centrale à un caractère différent des deux autres parties : non seulement
elle cumule des éléments présents dans celles-ci, mais encore Floch y détecte la présence d'un
Destinateur-Judicateur, c'est-à-dire une entité morale ou religieuse, difficile à circonscrire, et qui
domine, qui préside à la scène entière.
Selon Floch, la finalité d'un tel recensement est de pouvoir décrire le plan de la manifestation.
Ici, on analyse la formation des signes ; on dépasse le seul sensible et, dans le cas d'un tel tableau,
on rend compte de l'effet de la défigurativisation des « formants visuels » sur l'interprétation.
Expression-contenu
Floch épouse la séparation usuelle en sémiotique entre plan de l'expression et plan du contenu.
Il propose la schématisation suivante pour ce tableau :
expression contenu
couleurs contraction : expansion /issue heureuse /jouissance ::
lignes intersection : adjonction du combat/ du bonheur/
Cela représente l'« homologation schématique » des catégories visuelles et sémantiques
présentes dans le tableau. Les catégories visuelles ont déjà été discutées. Les catégories
sémantiques, quant à elles, prennent la forme de deux énoncés thématiques et forment ainsi le plan
du contenu. Floch juge que ces deux énoncés peuvent être réduits à des catégories sémantiques
encore plus élémentaires : /vie/ et /mort/.
Avec cette réduction à l'esprit, il tente une représentation des énoncés thématiques sur le carré
sémiotique, un outil de base de la sémiotique :
énoncé 2 /vie/ /mort/
↑ ↑
|__ énoncé 1 /non-mort/ /non-vie/
Le carré sémiotique comprend quatre positions interdéfinies. L'axe horizontal oppose des termes
contraires, tandis que l'axe vertical oppose des termes contradictoires. Cette distinction
contraire/contradictoire est utile car elle rend mieux compte de la dynamique de la signification.
Passer de /mort/ à /non-mort/, puis à /vie/, représente un mouvement plus complexe que passer
de /mort/ à /vie/.
La notion sémiotique pertinente ici est celle de parcours génératif de la signification. Grâce à
deux opérations de transformation, la négation et l'assertion, on passe d'un niveau profond de
signification, précédant tout mouvement, à un niveau de surface, où les catégories sémantiques se
trouvent actualisées.
Cette représentation sémiotique se rapproche, selon Floch, de l'organisation du tableau lui-
même comme objet visuel : si la négation de la mort - le passage de /mort/ à /non-mort/ - se trouve
dans la partie gauche, et l'assertion de la vie - la passage de /non-mort/ à /vie/ - se trouve dans la
partie droite, alors le tableau peut se lire comme un objet de sens, en l'occurrence comme le récit de
deux énoncés simultanés, mais que l'oeil suit en allant de la gauche vers la droite, rencontrant sur ce
chemin, au centre, une instance morale. Cette instance morale, à partir de là, peut être lue comme le
vrai sujet du tableau, une métaphore du peintre, du créateur, qui préside à l'avènement d'un nouvel
âge et d'un nouvel art.
ii/ Critique
Dans cet essai, Floch a tenté (« tenter », « essayer » : ce sont des mots que Floch utilise
régulièrement lui-même) de donner un exemple de réflexion sémiotique appliquée à un « objet
planaire », c'est-à-dire un objet non seulement visuel, mais aussi limité à deux dimensions. Nous ne
pensons pas que Floch ait été le premier chercheur à aborder des objets planaires, puisque par
exemple, la signalisation du code de la route, avec ses panneaux, est fréquemment citée dans des
textes de sémiotique (voir par exemple Klinkenberg). Son ambition, bien plutôt, fut certainement de
s'attaquer à des objets planaires particulièrement difficiles : le sujet de cet article, justement, est un
tableau de maître. Il comptait ainsi ouvrir, élargir, complexifier la recherche en sémiotique visuelle.
Faute, à la fois, d'être connaisseur d'art, et connaisseur de sémiotique, nous ne percevons pas
immédiatement et clairement quelles perspectives s'offrent à une telle approche. En effet, l'art
pictural, nous semble-t-il, a une existence bien plus ancienne que les analyses du type que Floch
propose ; son évolution est associée à une très vieille tradition, et ne dépend aucunement, dans notre
idée, de cette autre tradition, beaucoup plus récente, qu'est la sémiotique.
Il est notable, par exemple, qu'à la lecture de l'article de Floch, on ait parfois le sentiment qu'il a
choisi avec un peu d'arbitraire les éléments du tableau dont il voulait discuter. Cela, il le relève lui-
même, en avouant qu'une « segmentation n'est jamais exhaustive ». Fatalement, de nombreux
détails sont omis, car il n'est pas envisageable d'aller jusque dans le domaine microscopique. Pour
nous, ce constat a un rapport direct avec la complexité de l'objet choisi : on ne traite pas un panneau
routier, par nature extrêmement dépouillé, comme on traite une œuvre d'art.
Cela dit, il se peut que le parti pris de Floch soit purement cognitif, même s'il ne le dit pas. Si
c'était le cas, alors cela signifierait que son but est uniquement de rendre compte de l'effet immédiat
produit par la vue du tableau sur une personne prise au hasard dans une population. Il n'y a pas de
raison, a priori, de rejeter cette démarche. Admettant la présence obligatoire de catégories
sémantiques basiques comme /vie/ vs /mort/ dans l'esprit humain, il peut en effet être intéressant de
« tester » si ce tableau produit l'effet cognitif escompté chez un individu donné.
« Voyez-vous la vie et la mort dans ce tableau ? Et si oui, y voyez-vous un cheminement de l'un
vers l'autre ? Oui, ou non. ».
Si c'est dans cet esprit que Floch travaillait, alors il faut conclure qu'il n'avait pas de regard
particulier sur l'art, avec toute son histoire, mais seulement sur les tableaux en tant qu'objets visuels
réductibles au strict minimum de signification, au-delà (ou en-deçà) des véritables intentions des
artistes.
Quoi qu'il en soit, et cela rejoint les remarques faites par l'enseignante lors de notre présentation
orale, il apparaît que l'auteur ne donne pas assez explicitement les clés de sa méthode de travail, ne
précise pas assez les termes qu'il utilise. Quelle est, dans son travail, la place réelle de notions
(sémiotiques ou linguistiques) comme la segmentation initiale, le carré sémiotique, les syntagmes,
les paradigmes, la diachronie ? Forment-elles la base de sa réflexion, ou sont-elles de simples
auxiliaires, empruntés à des fins d'illustration ? La réponse n'en est pas véritablement fournie.
Il reste néanmoins une notion, celle de « bricolage », empruntée à Claude Levi-Strauss, et qui
est utilisée par Floch avec beaucoup de constance. Cette notion a une certaine puissance, puisque
Floch s'en sert pour caractériser le langage d'oeuvres selon leur seul « mode de production de la
signification ». Chez Kandinsky, il a relevé l'utilisation de ce langage semi-symbolique, empruntant
des éléments à la tradition religieuse, à d'autres peintres, à sa propre œuvre antérieure, etc... Dans la
discussion du livre Identités visuelles, qui suit, nous aurons également à chaque fois affaire à l'idée
de bricolage.
III/ Identités visuelles
i/ L'ouvrage
Cet ouvrage, paru en 1995, a pour but de décrire des « identités visuelles », au sens très large.
Le monde intellectuel de Floch est aussi celui des entreprises, des publicitaires, des designers. En
tant que tel, il avait un œil pour la façon dont de tels acteurs constituent leur identité. Dans son
introduction, il justifie l'intérêt qu'il porte au monde de la communication visuelle. Comprenant
qu'un sémioticien puisse vouloir se détourner de recherches trop exclusivement visuelles (pour se
préserver de toute superficialité), il insiste néanmoins : l'aspect plastique des créations en tous
genres qui nous entourent quotidiennement a une influence sur nos esprits. En effet, constamment,
les marques, les institutions etc. nous parlent de valeurs, et se servent pour cela de signes en
principe interprétables par tous.
Dans ce livre, Floch se livre à un décryptage de six identités visuelles qui l'ont marqué au cours
de sa carrière. Leur diversité inattendue peut frapper le lecteur, mais Floch souhaitait sans aucun
doute montrer que la sémiotique visuelle est opératoire en toutes circonstances et s'applique à tout.
Ces six sujets sont, dans l'ordre : une pub Waterman, le logo d'IBM vs le logo d'Apple, la cuisine du
chef Michel Bras, l'offre de l'enseigne Habitat, le « total look » de Coco Chanel, et le couteau
Opinel. Nous avons choisi trois d'entre eux pour illustrer le contenu de l'ouvrage.
La cuisine de Michel Bras
Le sujet ici est la gastronomie, et particulièrement la cuisine du chef contemporain Michel Bras,
originaire de Laguiole. Le titre de l'essai (« L'Eve et la Cistre ») met d'emblée sur un même plan
deux éléments entièrement différents, mais présents graphiquement sur l'identité visuelle du chef,
telle qu'elle a été créée par un designer. L'Eve est une typographie, la cistre est une plante
aromatique. Floch reconnaît une qualité essentielle dans cette identité visuelle : la délicatesse. D'une
part, la typographie est fine, subtile, et d'autre part, le dessin de la cistre constitue en lui-même un
symbole de délicatesse. Il s'agit d'une ombellifère particulièrement agréable à regarder, et qui, pour
Floch, appelle des réflexions esthétiques.
Au-delà de son seul aspect, la cistre est une plante sauvage, fragile, rare, qui ne supporte que la
chaleur et la sécheresse, et qu'on ne trouve que dans les hauteurs (Plateau de l'Aubrac, Massif
Central). Cela fait dire à Floch que l'identité visuelle du chef se rapporte à la nature plus qu'à la
culture : on n'y décèle aucune référence à l'activité industrielle, ou même agricole, de la région. Le
discours tenu se démarquerait ainsi de celui d'autres chefs, qui mettent l'accent (y compris dans
leurs logos) sur leur métier, leur technicité, leur très haute compétence.
Sortant du symbole, Floch cherche à montrer que la présence de la représentation d'une cistre
pointe vers un programme narratif de nature culinaire. Il précise immédiatement ce qu'il entend par
là : en sémiotique, il est tentant de considérer la recette comme programme narratif basique, en
matière culinaire ; lui, en revanche, veut considérer le plat lui-même comme un véritable récit, et
ses divers composants comme « dotés de rôles et de compétences », comme « des sujets agis, ou des
sujets agissants ».
Evidemment, si la cistre figure dans l'identité visuelle du chef, c'est qu'il l'incorpore aussi dans
ses plats. Pour Floch, la sémiotique gastronomique commence lorsqu'un critique gastronomique se
met à anthropomorphiser les composants des plats. Ayant débusqué une critique d'un plat du chef où
l'auteur, par métaphore, attribue des vertus quasi-humaines à la cistre (la cistre « qui lance une
pointe anisée sur le filet de loup »), Floch déclare cette dernière, ainsi que la plat, comme objets de
sens.
En l'occurrence, la cistre deviendrait un « petit héros végétal, ou plutôt gastronomique ». La
propriété des aromates (comme la cistre), celle de « relever le tout », alors même qu'ils se trouvent
en quantité très limitée dans un plat, est une « force du faible », à laquelle on peut associer
« intelligence », « subtilité », « rapidité », « délicatesse » etc....
Et Floch de citer des exemples tirés de la mythologie grecque. Se référant à des hellénistes, il
évoque une « mythologie des aromates », liée au culte d'Adonis. Si nous suivons bien Floch et sa
compréhension des hellénistes, le tradition du culte d'Adonis comprenait un volet culinaire, selon
lequel les aromates s'opposeraient à d'autres aliments en termes axiologiques. En voici une
schématisation :
sec+chaud
Aromate
|
|
humide et sec - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - humide et sec (axe de l'équilibre -
Blé | Orge Demeter)
|
Laitue
humide+froid
(axe du déséquilibre – Adonis)
Ainsi, les aromates s'opposeraient à la laitue (?) en étant le terme /chaud/ et /sec/. Cette
opposition a, semble-t-il, d'innombrables connotations, notamment par rapport à la fonction
sexuelle. Cherchant à situer la cuisine du chef dans ce système, Floch prend l'exemple de son plat
« Loup au petit-lait et à la cistre, baselle et quenelle de pain à la sauge ». Précisons que la baselle est
un épinard sauvage, et que la quenelle est faite de pain brûlé. Voici la représentation qu'il en tire :
CISTRE QUENELLE DE PAIN A LA SAUGE sauvage élaboré
| |LOUP ----------------------------------------------------------------------------- AXE DE L'EQUILIBRE(moelleux)
| |PETIT LAIT BASELLEélaboré sauvage
| |
AXE DES DESEQUILIBRES DEDOUBLE
Ce qui intéresse Floch ici, c'est que les divers composants du plat en question entrent dans des
oppositions complexes : cistre et quenelle entrent dans la catégorie chaud+sec, tandis que petit lait
et baselle entrent dans la catégorie opposée. En outre, les termes de la catégorie /élaboré/ vs
/sauvage/ sont distribués également parmi les éléments termes de la catégorie /chaud+sec/ vs
/froid+humide/. Autrement dit, il n'existe pas d'implication nécessaire du type, par exemple,
/sauvage/ → /chaud+sec/, et on trouve un composant à la fois /sauvage/ et /froid+humide/ dans ce
plat, ainsi qu'un composant /élaboré/ et /chaud+sec/. Floch voit dans cela un véritable phénomène
sémiotique, une sorte de « jeu d'inversion » qui ne se comprend que si l'on parle des significations.
Floch termine cet essai par deux remarques. L'une est sur la notion de bricolage : le chef est un
bricoleur au sens de Levi-Strauss, car il effectue ses trouvailles culinaires lors de recherches très
« libres ». Un virée dans la montagne et les idées lui viennent, l'envie lui prend de tester,
d'expérimenter non seulement avec les saveurs, mais aussi avec les significations. En l'occurrence,
la cistre, toute sauvage qu'elle est, n'est pas dénuée de « passé sémiotique » : elle représente la
nature sauvage de l'Aubrac, et les gens d'un peu de culture le savent bien. La deuxième remarque est
sur l'identité visuelle qui est le point de départ de l'essai : Floch cite des propos du designer lui-
même, qui dit avoir l'habitude, lors de voyages, de « garder sous le coude » des éléments de visuels
rencontrés un peu au hasard, comme ce fut le cas avec la typographie Eve. Pour Floch, le parallèle
est tout trouvé entre les attitudes du chef cuisinier et de son designer.
Coco Chanel
Ici, Floch propose une « sémiotique plastique » ; il sort de l'analyse de signes de petite
dimension, et aborde le « total look » de Coco Chanel, comme un tout de signification. A noter que
parmi les six sujets de son livre, c'est à celui-ci qu'il a consacré le plus de recherches (une dizaine
d'années).
Ce thème l'intéresse car il comporte une dimension à la fois esthétique et éthique. Du point de
vue esthétique, il faut considérer le fait que Chanel a créé un nouveau style absolument englobant :
tous les éléments de l'habillement féminin ont été repensés par elle, des pièces les plus centrales aux
accessoires.
Pour commencer, Floch aborde ce qu'il appelle la dimension sémiotique « figurative » du look.
Dans cette dimension, le look se définit par rapport aux modes qui existaient quand il est apparu.
Floch parle de lexicalisation et de relativisme culturel : telle ou telle pièce du look sera reconnue
comme différente de la ou les pièce(s) correspondante(s) dans les modes contemporaines. A ceci est
associé un discours : Chanel emprunte aux monde du travail, du sport, et de l'habillement masculin,
mais s'adresse aux femmes, sortant des conventions en tenant un discours de liberté.
Cependant, au-delà de cette dimension figurative, fondée sur une lexicalisation, Floch insiste sur
une autre dimension, qui est plastique, et donc purement visuelle. A la suite de Greimas et
Hjelmslev, mais contre Barthes, Floch considère que le signe visuel n'est pas inférieur au signe
linguistique : il « tient debout » sémiotiquement, il n'a pas besoin d'être « mis en mots » pour être
analysé.
Avec cette base théorique, Floch va chercher à situer le look de Chanel dans l'arc classique-
baroque. Il ne considère pas ces deux termes comme dénotant de simples périodes historiques, mais
comme des « visions » ou des « optiques cohérentes » qui traversent l'Histoire, et par ailleurs
contraires. Il définit ces deux visions comme des sémiotiques visuelles, dotées d'un plan de
l'expression et d'un plan du contenu.
Plusieurs phénomènes visuels, au nombre desquels l'effet produit par les lignes et par la lumière,
ont un statut antagoniste dans ces deux courants ; ici, Floch cite l'historien de l'art Wölfflin. La
schématisation, sémiotique, qu'il en propose, est la suivante :
« Vision » classique « Vision » baroque
Expression Non-continuité Non-discontinuité------------ --------------------- ---------------------Contenu Non-discontinuité Non-continuité
L'idée en est aisée à comprendre : une œuvre (picturale) baroque privilégiera le mouvement des
formes, et leur imbrication, leur continuité donc, mais leurs sujets (un humain, un végétal etc...)
seront représentés avec moins d'intégrité. A l'inverse, une œuvre classique découpera davantage les
formes, en utilisant notamment les lignes, mais leurs sujets seront perçus comme possédant une
structure propre, contribuant à leur intégrité, et donc, leur continuité.
Plastiquement, le look de Chanel s'oppose, selon Floch, à la mode du créateur Poiret, qui lui
était contemporain, selon des termes identiques. Chanel, c'est la ligne, l'équilibre des formes, la
compartimentation, et l'harmonie de l'individu ; Poiret, c'est la masse, l'indistinct, le trop-riche, les
« boursouflures ».
Une chose qui distingue le travail de Chanel, c'est aussi la capacité à utiliser des éléments
« tout-venant » dans sa création : tout ce qui peut l'intéresser dans les traditions d'autres cultures et
qui peut être mis à profit. Floch retrouve ici la notion de bricolage, qui lui est chère, car elle lui
permet de singulariser un certain type de production sémiotique où un créateur s'approprie une
collection de signes et « fait du neuf avec ».
Du point de vue éthique, le look est également investi d'une signification. Floch distingue, dans
la création vestimentaire, fait de mode et fait de style. Il associe le fait de mode à la dimension
figurative, et le fait de style à la dimension plastique. Le premier est simplement différentiel (il
s'oppose à d'autres faits de mode) et permet une identification du sujet par le biais du caractère. Le
second est apparemment plus profond car il repose sur la notion de maintien de soi. Floch donne ces
deux notions, caractère et maintien de soi, comme opposées, et se réfère par là à des notions
similaires développées par le philosophe Paul Ricoeur : la persévérance (le maintien de soi), contre
la préservation (le caractère).
Selon Floch, cette opposition est de nature éthique, et elle trouve sa pleine réalisation, chez
Chanel, dans une dimension plastique (et donc visuelle), qui mérite une analyse sémiotique.
Habitat
Dans cet essai, Floch propose d'utiliser un carré (sémiotique) des valeurs de consommation pour
caractériser l'offre de l'enseigne de mobilier Habitat : une offre serait la proposition faite au client de
se situer sur telle ou telle position du carré. Voici la forme que ce carré prend :
meubles « solides » valorisation valorisation « traditionnels »et « modulables » pratique utopique ou « modernes »
| X |
« économiques » valorisation valorisation « luxueux » etet « astucieux » critique ludique « raffinés »
Il s'agit là d'un système axiologique, c'est-à-dire d'un paradigme de valeurs à l'état de virtualités,
et non d'actualités. L'actualisation de ces valeurs constituera l'offre concrète d'une enseigne
particulière.
A travers ses recherches, Floch constate qu'à son époque, la tendance générale pour les
enseignes de mobilier est de proposer au client un parcours bien défini et correspondant aux quatre
âges de la vie. Par exemple, il est courant, dans les catalogues et autres publicités, d'associer faible
coût, facilité de mise en place et faible encombrement (d'une étagère, etc.), à un moment important
de la vie d'un individu, en l'occurrence celle où il s'installe, acquiert enfin son indépendance, mais
ne dispose que de peu d'espace, et, surtout, de moyens financiers en général limités. Et il est
également courant que, dans le même catalogue, d'autres produits soient proposés, et associés à
d'autres moments de l'existence, avec d'autres valeurs : avec le temps, on acquiert de l'aisance, et
donc de l'espace, il « faut » donc penser à un mobilier de plus grande dimension, ou plus stylé, et
ainsi de suite.
Pour le montrer, voici le même carré que ci-dessus, agrémenté de commentaires laconiques
résumant le discours tenu par les enseignes pour chaque âge/type de valorisation :
« élever ses valorisation valorisation « créer sonenfants » pratique utopique univers »
↑ ا__ ↑« démarrer valorisation valorisation «s'offrir etdans la vie » critique ludique recevoir »
Le mouvement d'une position à l'autre, représenté par les flèches, est le parcours, le projet de
vie, la « quête » du « bon usage » du mobilier, que les enseignes proposent. Selon Floch, ce
mouvement est cette fois-ci un fait syntagmatique, car ce sont là des étapes qui succèdent les unes
aux autres.
Ces bases posées, Floch fait un rapide comparatif de Habitat et Ikea, et juge que les deux
enseignes se sont distribués les pôles opposés du carré des valeurs. Habitat aurait comme valeurs
centrales les valeurs utopique et ludique, en ne mettant pas l'accent sur le faible coût, la facilité de
rangement, mais plutôt sur la valeur esthétique de son offre. Habitat propose des articles « simples
et beaux », sans être luxueux, et son offre serait une incarnation de l'épicurisme en matière de
mobilier : à la fois naturelle et non-nécessaire.
Un aspect essentiel pour Floch est que cette offre est à la fois hétéroclite et dotée d'un contenu
« culturel » : on y trouve des objets très divers et provenant de différentes cultures, et chacun d'entre
eux est porteur d'une référence à une époque, un lieu, une mode, identifiable pour quiconque est
ouvert sur le monde et « connaît des choses ». A cela correspond une organisation particulière : un
magasin Habitat est conçu pour que les objets soit littéralement « rencontrés » par le client au fil de
sa visite, et qu'ainsi une petite histoire se constitue dans son esprit. Formes, couleurs, et agencement
spatial jouent un rôle primordial dans cette organisation.
Partant de ces constats, Floch reprend les concepts directeurs de son travail. D'abord l'idée de
bricolage : organiser un magasin de la sorte, avec des objets hétéroclites mais étant chacun un signe
à part, c'est créer une structure signifiante, qui doit parler au chaland. Cette communication avec lui
est donc fondée sur ces « blocs précontraints de signification » dont parle Levi-Strauss ; et si elle ne
suit pas un schéma figé et préétabli, elle n'advient pas non plus ex nihilo, car elle fait appel à des
références.
Selon Floch, cette manière de vendre/acheter est en soi une « praxis énonciative », où le client
devient sujet d'un programme narratif comparé au tissage, où il est invité à tisser lui-même l'objet de
sa quête. Comme preuve que cette « praxis » a bien une existence indépendante, Floch relève que,
dans certains magazines, on vante cette manière d'organiser son mobilier comme la seule réellement
honorable.
S'appuyant sur ces réflexions, l'auteur rappelle que l'objet de la sémiotique n'est pas de décrire
tous les aspects sociologiques, économiques, psychologiques, qui sont en jeu, mais « simplement »
de définir ce que peut être une identité visuelle et son mode de conception : un magasin Habitat est
un objet sémiotique, un signe, parce qu'il est doté d'une forme (au plan de l'expression) qui
correspond point pour point au programme narratif évoqué.
ii/ Critique
Comme nous le disions au tout début, en introduction, les intérêts intellectuels de Floch sont
particulièrement riches, voire débordants. La lecture, initialement, de l'article sur Kandinsky, nous
avait laissé avec le sentiment de ne pas avoir tout compris. Dans ce seul article, les références à des
artistes, des anthropologues, des historiens de l'art, des sémioticiens, étaient déjà particulièrement
nombreuses, sans qu'il fût possible d'entrevoir comment ces différentes références devaient
s'imbriquer.
Cependant, la notion de « bricolage », certes empruntée à l'anthropologue Levi-Strauss, avait été
mise en avant par Floch comme une idée centrale, et nous avions senti qu'elle pointait vers une
approche sémiotique, parce qu'elle s'occupait de la réappropriation de « vieux » signes pour en faire
de nouveaux.
Nous avons donc eu le désir de lire plus d'écrits de Floch, et nous sommes tourné vers ce livre
pour approfondir. Avant de l'ouvrir, nous ne savions pas s'il nous offrirait davantage que l'autre
article en ce qui concerne la méthode employée, les finalités du travail sémiotique. Ce que nous y
avons vu, c'est surtout une très grande insistance sur cette même notion de « bricolage », mais pas le
développement systématique d'outils formels qu'on aurait pu y attendre.
L'écriture elle-même n'est pas pédagogique – elle est érudite. Elle comporte de très grandes
ellipses, et des « sauts de pensée » incessants. De nombreux passages, parfois longs, et consacrés à
des questions apparemment importantes, sont balayés en une ligne par des « mais tout cela n'a
aucune importance », n'aidant pas la lecture. Jean-Marie Floch apparaît donc comme un esprit à la
fois très brillant, mais aussi quelque peu brouillon.
En faisant cette réflexion, nous repensons à une remarque de Anne Hénault dans son
introduction à la collection d'articles Question de sémiotique, où nous avons trouvé l'article de
Floch sur Kandinsky. Dans cette remarque, elle dit que la sémiotique est en réalité avant tout une
tradition orale. Peut-être le sens de ceci est-il que la sémiotique se construit d'abord sur
l'accumulation d'intuitions, qui doivent être partagées, recoupées, confirmées. Floch nous semble
avoir un profil correspondant à cela : aux quatre vents, plein d'idées, subjectif et intuitif.
Pour conclure, la lecture de cet auteur invite à une certaine attitude, et à une certaine façon de
regarder, plus qu'à épouser une théorie établie et formalisée. La frontière est brouillée entre la
pratique sémiotique et la vie et ses expériences.